4 Chantier mieux-être
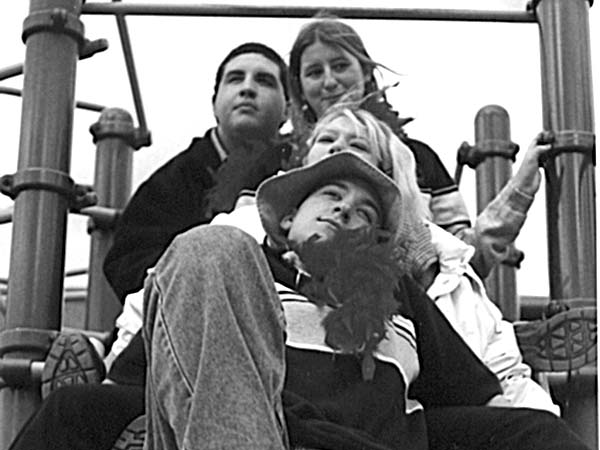
4.1
Problématique
L'état
de la situation présentée dans l'introduction du Chantier
mieux-être semble teintée de la vision de l'épidémiologie
sociale. On y parle de "détection précoce des problèmes
sociaux et de santé" et de "réduction des facteurs
de risques". On insiste sur la nécessité "d'intervenir
dès la petite enfance" et "de rejoindre davantage les
familles les plus vulnérables et de les aider plus intensément"[59].
Cette tendance est populaire chez les gouvernements occidentaux, qui
remettent de plus en plus en question les programmes sociaux universels.
L'approche de l'épidémiologie
sociale, qui s'exprime dans la section sur le Chantier mieux-être
du Plan d'action jeunesse, ne s'attaque pas aux rapports sociaux inégaux,
aux politiques sociales et aux facteurs structurels socio-économiques
qui engendrent la pauvreté et les problèmes sociaux (effritement
du filet de sécurité sociale, non-accès à
un revenu décent pour vivre, à un logement adéquat,
etc.). Selon Michel Parazelli, cette "normalisation médicale
des problèmes sociaux revient alors à traiter les personnes
en responsables de leurs "pathologies": plutôt que de
leur permettre d'acquérir un pouvoir sur leur existence sociale,
on les invite à suivre une thérapie qui modifiera leur
comportement à risque. C'est là que le dérapage
se produit : on occulte les causes collectives et on met l'accent sur
la culpabilité individuelle"[60].
Les principales
problématiques sur lesquelles il faudrait agir, selon le Plan
d'action jeunesse, sont identifiées comme étant: les mauvais
traitements que subissent les enfants et les jeunes, la détresse
et le suicide chez les jeunes, la consommation de drogue et d'alcool,
le tabagisme, les grossesse à l'adolescence, la sédentarité
accrue chez les jeunes. Il est aussi question des difficultés
d'intégration des jeunes adultes et de ceux et celles qui vivent
la parentalité.
Dans la section
sur les interventions gouvernementales, on rappelle la nouvelle politique
familiale qui a vu le jour en septembre 1997, suivie de deux mesures
qui " répondent aux besoins des jeunes familles et du marché
du travail "[61]: la
nouvelle allocation familiale et la mise en place de services éducatifs
et de garde à la petite enfance. Notons que la politique familiale
ne s'adresse pas spécifiquement aux "jeunes familles"
malgré la façon dont la présente le Plan d'action
jeunesse.
4.2
Actions financées
Une différence
entre le document écrit du Plan d'action jeunesse et la version
disponible sur Internet nous donne une idée des tactiques utilisées
par le gouvernement pour enjoliver ses interventions. Dans le document
publié, on lit que le gouvernement "injectera 45 millions
de dollars de plus sur deux ans"[62]
dans le Chantier mieux-être. Cela laisse entendre que ce seront
des fonds additionnels à ceux déjà prévus
dans les crédits gouvernementaux. Dans la version du texte publiée
sur Internet, on lit que "le gouvernement a annoncé l'injection
de 45 millions de dollars additionnels, sur deux ans, lors du dépôt
de son budget 1998-1999". Il s'agirait donc plutôt de budgets
déjà planifiés. La présentation des interventions
gouvernementales nous laisse croire que cette deuxième version
est certainement la plus proche de la réalité.
La majeure partie
des 45 millions de dollars, soit 25 millions de dollars, est destinée
à financer l'élargissement des services de garde à
5$ aux enfants de 3 ans, à compter de septembre 1998. La distribution
des autres 20 millions n'est pas définie dans le Plan d'action
jeunesse. Il y est toutefois mentionné qu'une "stratégie
pour les enfants, les jeunes et leur famille" devait être
rendue publique à la fin de l'été 1998. Finalement,
la sortie de cette stratégie[63]
a été retardée au début 1999, après
le dépôt du rapport de la Commission Cliche. "Ce rapport
a été écrit par un comité de travail chargé
de se prononcer sur la capacité du réseau à répondre
aux besoins et aux problèmes des jeunes ainsi que pour proposer
une plan d'action visant à améliorer l'accessibilité
et la qualité des services, la concertation et la collaboration
intersectorielle"[64].
Le Plan d'action
jeunesse indique que la stratégie[65]
pour les enfants, les jeunes et les familles s'articulerait autour de
six grands types de mesures visant, entre autres [66]:
ð à
intervenir sur les conditions de vie des jeunes et de leur famille,
particulièrement lorsque la pauvreté est en
cause ;
ð à
consolider, sur une base locale, les services intégrés
destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles en
encourageant la collaboration entre les principaux partenaires (éducation,
municipalités, économie, secteur communautaire,
justice) ;
ð à
diversifier les formes d'aide naturelle selon les besoins décelés
par les parents (mères visiteuses, maisons de parents)
;
ð à
augmenter l'intensité des services offerts aux jeunes en difficulté
et à implanter des mesures diversifiées pour
soutenir les personnes responsables de leur développement,
et
ð à
mettre en place des interventions mieux adaptées aux enfants
victimes de négligence et de violence en favorisant
la formation et la recherche.
D'autres interventions
sont identifiées dans le Plan d'action jeunesse, sans plus de
détails sur leur mise en oeuvre ou leur financement. Plusieurs
sont orientées vers un "soutien " à la
famille, aux communautés et aux groupes communautaires, ce qui
laisse entrevoir la volonté de continuer à transférer
certaines responsabilités des services sociaux publics, quelque
soit la lourdeur et la complexité des problématiques vécues.
En effet, où est le soutien, sans les crédits? Par exemple,
on lit:
L'ensemble
des orientations à l'égard des enfants et des jeunes,
quelles que soient la problématique et la cause visées
(santé mentale, handicaps physiques, déficience intellectuelle,
délinquance, toxicomanie, etc.), met en évidence la
nécessité d'assurer un meilleur soutien aux familles
par le développement des compétences parentales et
en offrant des mesures de répit-dépannage.[67]
Dans la section
"Estime de soi et habitudes de vie", le Plan d'action jeunesse
parle de "transformer les services de santé mentale",
une transformation qui "touche en premier lieu les personnes atteintes
de troubles mentaux graves et persistants" et qui s'adresse entre
autres aux jeunes de 15 à 30 ans. L'emphase est mise sur "la
nécessité de rapprocher l'intervention des milieux de
vie des individus, de diversifier les ressources et de les adapter à
l'évolution des besoins". Il s'agit ici encore apparemment
d'un transfert de responsabilité des services sociaux vers "les
milieux de vie", soit l'entourage, la famille (surtout les femmes)
et les groupes communautaires. La réalité, dans certains
cas, ce sont plutôt des familles essoufflées ou elles-mêmes
en difficulté. La charge risque d'être lourde à
voir ce qu'on attend des "communautés", déjà
surchargées par l'effet des dernières compressions budgétaires
en santé [68]:
Les principales
ressources à développer dans les communautés
concernent l'accès au logement et la réponse aux besoins
de subsistance, l'intervention de crise en tout temps, le maintien
à l'accès au traitement dans la communauté,
l'accès à des services de réadaptation ainsi
qu'à des activités de soutien aux familles et aux
proches. [69]
Quant à la
stratégie d'action en vue de réduire la toxicomanie, elle
s'appuie non seulement sur la consolidation des services mais aussi
sur "l'utilisation maximale de l'expertise des groupes communautaires",
dans le cadre d'une approche intersectorielle, sans plus de précisions.
Par ailleurs, le
Chantier mieux-être prévoit aussi "accélérer
le développement des programmes Opération Quartier (·)
un instrument qui permet d'accélérer le processus de prise
en charge des personnes démunies dans chacun des quartiers où
þuvre un centre communautaire privé de loisirs"[70].
L'idée de
"l'utilisation maximale de l'expertise des groupes" et de
la définition des interventions par l'État qui en transfère
ensuite la charge à la "communauté" indique
que, dans le Plan d'action jeunesse, tout comme au ministère
de la Santé et des Services sociaux, les groupes communautaires
sont considérés comme une composante du réseau
public.[71] Or, les groupes
communautaires autonomes jeunesse tiennent à rester autonomes
du réseau public et de l'État ainsi qu'à définir
avec leurs membres les orientations de leurs actions. De plus, ils sont
conscients de l'importance que l'État garantisse des services
publics accessibles, universels et gratuits et que ce rôle ne
leur revient pas.
Malheureusement,
le Chantier mieux-être du Plan d'action jeunesse n'ouvre pas de
perspectives pour que les services publics soient élargis plutôt
que rétrécis, afin de répondre aux besoins des
jeunes. Par exemple, où se retrouvera une jeune fille qui a vécu
l'inceste et qui a besoin d'un service de suivi psychosocial? Ce n'est
pas le Carrefour Jeunesse Emploi qui le lui offrira. Au CLSC, elle doit
actuellement attendre plus de trois mois avant d'obtenir un suivi par
un-e psychologue pendant une période assez limitée. Entre
le centre d'accueil jeunesse et la pédo-psychiatrie, où
sont les services d'intervention psychosociale de deuxième ligne
assurés par l'État pour les jeunes en difficultés?
Enfin, le Plan d'action
jeunesse n'aborde pas la question du soutien à l'action communautaire
autonome jeunesse.
Notes :
59 ibid p.51[retour au texte]
60 Parazelli, Michel, " De la pauvreté traitée
comme une maladie ", Monde Diplomatique, décembre 1995. [retour
au texte]
61 Plan d'action jeunesse, op.cit. p.50[retour
au texte]
62 ibid p.53[retour au texte]
63 Ministère de la santé et des services sociaux,
Pour une stratégie de soutien du développement des enfants et des jeunes:
Agissons en complices, Gouvernement du Québec, 1998[retour
au texte]
64 Claudine Laurin, Nouvelles structures gouvernementales.
Des structures convergentes pour qui ou pourquoi?, Bureau de consultation
jeunesse, printemps 1998. [retour au texte]
65 Le ROCAJQ souhaite faire l'analyse sous peu
du document "Agissons en complices"[retour au texte]
66 Plan d'action jeunesse, op.cit. p.53[retour
au texte]
67 ibid p.53[retour au texte]
68 Leur équilibre, notre déséquilibre. Rapport
d'enquête sur les impacts de la transformation du réseau de la santé
et des services sociaux ˆ Montréal, Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal, avril 1998, 158 p. [retour
au texte]
69 Plan d'action jeunesse, op.cit. p.54[retour
au texte]
70 ibid p.55[retour au texte]
71 voir Coalition Solidarité Santé, Commentaires
préliminaires suite ˆ la publication par le MSSS des orientations 1998-2000,
automne 1998. [retour au texte]
|