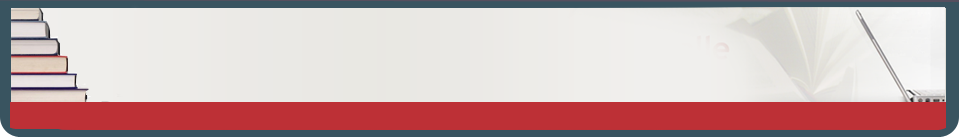- Préface
- Les trésors de ma mémoire
- Racines familiales
- La famille de mon grand-père Horace Bélanger
- Mon oncle Petit
- Croyances et malédictions
- La malédiction
- Ti-Paul l'orphelin
- L'école
- Le petit chevreuil blessé
- La religion
- Les sacrements
- Les mauvaises pensées
- L'hiver, les dîners dans le bois autour du feu
- La bêtise humaine
- Hommes forts, personnages mytiques et colorés
- Kétaine et Ozilda
- Grand Jos
- Pierrot Rioux
- Ti- Blanc Criquet
- Jos Guérette
- Contes fantastiques
- L'Ile Maudite
- La légende des Trois conseils
- Le Lion à quatre pattes rouges
- Présentation de Jeanne et Victor
- Lexique
- Remerciements
- Crédits
À Simon mon filleul adoré toujours fasciné par mes histoires
Préface
Au cœur de l'Histoire
Acheter le journal, écouter la radio, regarder la télévision sont des gestes quotidiens qui ouvrent des fenêtres sur Ce monde et élargissent les connaissances, mais ils impriment souvent aux hommes une pensée unique et des comportements stéréotypés.
(Bruits, images et bavardages médiatiques donnent un certain reflet de l'activité Humaine et l'illusion de participer à la marche de l'Histoire.
Pourtant, chaque personne est unique et a une existence dont elle est libre et responsable. (Plonger dans la mémoire des gens de l'ombre, de tous ceux qui ne font jamais la une des journaux c'est retrouver la petite histoire du monde des humbles qui ont forgé la vie contemporaine. Une histoire riche de la véritable aventure humaine au Québec. Une histoire qui valorise leur savoir et leur confire une juste dignité.
Grâce au Centre Alpha des Basques et au festival de contes «Les grandes gueules» de Trois-Pistoles, Ces habitants de Saint-Jean-de-Dieu ont trouvé un lieu pour s'exprimer, un lieu où raconter et ouvrir leur mémoire riche d'un passé où s'enracinent non seulement leur vie mais aussi la marche du Québec vers son développement et sa modernité.
Victor Bélanger est un moteur de cet atelier. (Depuis 1996, il a fait l'effort de se souvenir, de parler, de conter et, enfin, décrire quelques-uns de ses innombrables souvenirs.
Il lègue ainsi le plus précieux des héritages à sa famille et à la société entière: un recueil dune richesse inaltérable, tout d'amour et de tendresse. Un trésor de valeurs humaines oit l'honnêteté côtoie le sens du devoir et de la responsabilité. Un cheminement de vie rempli de joies, de peines et de témoignages parfois teintés d'imaginaire.
Son livre laisse une empreinte dans le temps, celle d'un homme qui, la tête haute et le cœur fier, a participé a l'Histoire du Québec.
Marc Laberge
Les trésors de ma mémoire
[Voir l'image pleine grandeur]

Dans mon entourage, plusieurs personnes s'étonnent qu'à mon âge, 87 ans, j'ai encore des projets comme celui d'écrire et de publier mon histoire et mes contes.
Il faut dire que j'ai de qui tenir! Au Centre d'accueil de Trois-Pistoles, ma mère était directrice des loisirs à 92 ans. Elle écrivait des lettres au ministre en place pour lui demander des subventions pour les soirées de danse et de jeux de cartes qu'elle organisait. Il faut le faire!
Autour des années 1975 (je ne sais pas trop au juste...) quand le Canada s'est converti au système métrique, cela a rendu ma mère bien triste parce qu'elle n'y comprenait rien. Elle avait fait venir des dépliants et des tables de conversion et étudiait ça sans trop d'autres références.
- «En quoi cela peut-il vous déranger?» lui avait-on demandé.
- «Je veux me faire une robe. Je suis allée au magasin pour m'acheter un coupon d'une verge et demie mais la vendeuse n'a rien compris. Alors je suis revenue à lège...! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne comprends rien au système métrique.»
Nous l'avons bien taquinée avec ça. Ma mère avait toujours un projet quelconque. Par exemple, elle demandait à tous ses visiteurs d'écrire dans un cahier posé sur un petit meuble à l'entrée de sa chambre. Elle se montrait peinée si on refusait car elle étudiait la graphologie, disait-elle. Cela nous faisait bien rire, n'empêche que cela la gardait occupée et très lucide.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre quelque chose, pour avoir un projet, pour se rendre utile à ses enfants, à ses petits-enfants et aux autres. C'est ça que je voudrais transmettre à mon tour.
[Voir l'image pleine grandeur]

Racines familiales
La famille de mon grand-père Horace Bélanger
Pour faire une histoire courte. Saviez-vous que le Canada fut l'un des plus grands bassins d'immigrants et de main-d'œuvre de l'histoire des États-Unis?
Entre 1840 et 1930, 2.8 millions de Canadiens se sont installés aux États-Unis.
Aujourd'hui, en 2003, selon les Archives nationales du Québec, plus de 12 millions d'Américains ont des origines québécoises.
C'est dans cette première vague que mon grand-père Horace et sa famille immigrèrent aux USA, à Lewiston plus précisément, surnommé alors Le Petit Québec du Maine.
En partant pour les États, le but premier de mon grand-père était de gagner de l'argent pour reprendre sa terre natale au 3eme Rang de Trois-Pistoles. Il n'a jamais réalisé son rêve! Six autres enfants sont venus s'ajouter aux quatre premiers. Ça prenait tout pour vivre, si bien que, d'une saison à l'autre, on remettait toujours le retour au Québec.
Le travail de grand-père et de ses enfants consistait à weaver dans des manufactures de coton. C'était très malsain ce travail-là: au bout du cardeur, l'ouvrier devait casser les brins de coton avec ses dents et aspirer ce brin pour reprendre le fil... Évidemment, il aspirait la poussière du coton aussi. Plusieurs connaissaient de graves problèmes pulmonaires, c'est pour ça qu'on disait qu'ils étaient maganés au coton, expression restée populaire depuis. Mais mon grand-père Horace ça ne l'a pas trop dérangé puisqu'il est mort à 97 ans de la grippe espagnole.
Les filles, mes tantes: Marie-Anne, Blanche, Léontine, et plus tard Albertine, se sont mariées très jeunes et sont restées aux États dans le Massachusetts. Elles ont peu ou pas travaillé dans les factory. D'ailleurs dans ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas... (à l'extérieur, je veux dire...) Elles devaient tenir maison, s'occuper de leur homme et élever leurs enfants; elles n'avaient pas le temps de travailler.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les garçons, mes oncles: Charles, Edmond (mon père) et Joseph (Jos) ont eu le mal du pays et sont revenus s'établir au Québec.
Les autres, mes oncles: Alfred, Majorique et plus tard Horace s'installèrent définitivement aux USA. Ils y firent leur vie, s'y marièrent et eurent des enfants. Certains modifièrent leur nom de Bélanger en Bellenger ou Baker.
À seize ans, mon oncle Charles, le plus vieux, s'est acheté une terre au 8eme de Saint-Jean-de-Dieu. Il était seul, toute la famille étant aux États, il a donc décidé de se marier. C'est Eugénie Rioux, dix-sept ans, qui fut désignée. Après trois semaines de fréquentations, à raison d'une visite par semaine, ils se sont mariés. De leur union naquirent quinze enfants.
Pour en savoir plus sur mon oncle Charles, lisez Les grands-pères, de Victor-Lévis Beaulieu. Oui, c'est son petit-fils et mon cousin, puisque sa mère Léonie est la fille de mon oncle Charles.
C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses visites à Saint-Jean-de-Dieu que mon père avait rencontré Florence, ma mère. Il l'avait courtisée et lui avait fait miroiter la possibilité de réaliser son rêve en l'amenant travailler aux États. Ils se sont mariés en février 1909. Et à l'insu de ma mère, conseillé par grand-père Morency (le père de ma mère), mon père a acheté une terre à la Société. Après une brève installation, il l'a laissée seule, enceinte, et il est parti travailler aux États le reste de l'hiver jusqu'en juin. Même si le but était de payer la terre, ma mère ne lui a jamais pardonné ça! Ils ont vécu sur cette terre et ont eu seize enfants.
Mon oncle Jos (Joseph) a, pour sa part, travaillé dans une usine de pneus aux États-Unis. Il devait faire du bon travail puisque, quelques années plus tard, la compagnie Good Year lui a donné la direction de l'une de ses filiales au Québec, à Ste-Hyacinthe plus précisément.
Mon oncle Majorique s'est surtout intéressé au baseball si bien qu'il est devenu un fameux joueur. Il se faisait appeler Ricki Baker et son nom figure au Temple de la Renommée à Washington.
Les deux derniers: ma tante Albertine surnommée Titite et mon oncle Horace appelé Petit pour le différencier de son père qui portait le même prénom, sont venus habiter chez mes parents pendant quatre ans.
Ma tante Titite souffrait de congestion pulmonaire. Je l'aimais beaucoup. Elle était ma marraine et m'appelait mon fillot. Elle a contribué aux relevailles de ma mère qui a mis au monde ses sixième et septième enfants pendant ces années-là. Cela a été une aide considérable pour ma mère puisque les femmes restaient neuf jours au lit après une naissance. Elles ne s'occupaient même pas du bébé sauf pour la tétée et encore, voir les seins d'une femme c'était secret, pour ne pas dire péché! Après, ma tante Titite est retournée, elle aussi, aux États.
Mon oncle Petit
Malgré son surnom, mon oncle Petit était un beau grand mince, intelligent, aimable et charmeur. En pleine crise d'adolescence, il détestait et désertait souvent l'école. Or l'école était obligatoire aux États-Unis. C'est pour cette raison que son père (mon grand-père) l'a envoyé chez mes parents. Il y est resté de l'âge de douze à seize ans.
Si mon oncle Petit était paresseux à l'école, il était vaillant aux champs et dans le bois. Il aimait beaucoup les enfants et jouait souvent avec eux. Moi, le petit Victor, j'avais deux ans à son arrivée chez nous. Il me prenait dans ses bras et jouait au cheval avec moi. Il me chantait des chansons, me racontait des peurs, puis me jouait du ruine-babines pour me calmer, me consoler et pour m'endormir le soir. Il disait souvent à mes parents:
- «Je l'aime trop ce petit Victor-là, je vais le coucher sur mon testament.»
Comme il était né aux États et déjà naturalisé Américain, il a quitté notre maison à seize ans pour retourner aux USA. Il a vécu chez sa sœur Albertine, ma tante Titite.
Mon oncle Petit est revenu une seule fois à Saint-Jean-de-Dieu. Qu'a-t-il fait après? Je ne sais pas trop... Tout ce que je sais, c'est qu'en 1923, il a été conscrit et forcé de faire son service militaire. Il a aussi reçu une formation pour conduire les chars d'assauts, mais il n'a jamais été au front.
Mon oncle Petit a été engagé dans la police secrète américaine. - Non, pas la CIA, puisque cette agence a été créée en 1946 par le président Truman.

Musée du Bas-Saint-Laurent, Fonds photographique Stanislas Belle, NAC B 14468b
Au début, il agissait comme agent double pour le compte de la police secrète. Son rôle consistait à infiltrer la pègre américaine et les gangs de la mafia italienne reliés à la prohibition, à la prostitution et au trafic d'armes. Après, il est monté en grade et s'est vu confier des missions plus importantes.
Mon oncle Petit habitait toujours officiellement chez sa sœur Albertine. Il partait trois à quatre mois puis revenait deux à trois semaines. Il mettait un peu d'argent à la banque mais se gardait beaucoup de liquide dans un cochon, ce qui déplaisait à ma tante. Il laissait croire qu'il était volage et gambler. Il n'était pas marié, il vivait accoté, en concubinage et ça dans plusieurs villes du Colorado et de la Californie pour les besoins de la cause, bien entendu... Un espèce d'agent 007 avant son temps.
À l'été 1941, la Deuxième Guerre mondiale prenait de l'ampleur: Hitler croyait tenir l'U.R.S.S. à sa merci parce qu'il venait de détruire 200 divisions de l'Armée Rouge. Il prévoyait déjà, avec l'ambassadeur japonais Hiroshi Oshima, de détruire l'Union soviétique de fond en comble et que le Japon se chargerait des État-Unis.
Alors, Les États-Unis arrêtèrent leurs livraisons de pétrole au Japon. Ils s'apprêtaient à expédier du matériel militaire en Union soviétique.
C'est dans ce contexte que la Maison Blanche confie à oncle Petit la mission d'infiltrer un groupe soupçonné de trafic d'armes. Il se rend une première fois à Guantanamo, à Cuba, une base navale concédée aux États-Unis en 1903. Puis de là, il revient à Washington, où il apprend qu'un meurtre a été commis en Floride en rapport avec cette affaire.
Comme il s'apprêtait à retourner chez lui en train, un homme s'est approché et lui a dit à l'oreille:
- «Si tu te mêles encore de cette affaire-là, tu vas te faire descendre.»
Alors, mon oncle Petit a continué un bout de son voyage dans les gros chars, puis, à l'arrêt suivant, proche d'un aéroport, il est descendu et il a pris un avion pour Miami, en Floride.
À sa descente d'avion, il a reçu trois balles en plein cœur. Il est mort instantanément.
Trois à quatre jours après le drame, mon père a eu la nouvelle de ce qui s'était passé. Mais nous, dans la coulée Bleue, en plein bois, sans téléphone ni radio ni journaux, aucune visite de personne, on n'en savait rien. Cependant, le soir après nous être couchés comme de coutume, on a entendu du bruit au grenier. Je suis monté voir: rien ne semblait anormal. Je me suis recouché et là, le bruit était très clair: ça sautait sur le plancher. Je suis retourné voir avec un fanal: rien, tout était calme.
J'ai dit à ma femme:
- «Tu sais, ton père et ta mère sont vieux, et les miens aussi, il se peut qu'il leur soit arrivé quelque chose. Si tu veux, on va se mettre à genoux et on va réciter une dizaine de chapelets.»
Après, nous n'avions pas peur, mais nous étions sûrs qu'il était arrivé un malheur. Alors, nous avons essayé de dormir, mais à peine assoupis, nous avons entendu jouer de la musique à bouche. En écoutant bien, j'ai reconnu le reel du Money Must. Là, j'étais certain que quelqu'un nous envoyait un avertissement.
Le lendemain, je suis resté à varnousser près de la maison, je n'osais pas m'éloigner. Une semaine après, nous sommes descendus à Saint-Jean-de-Dieu et là, mon père nous a appris la nouvelle du meurtre de mon oncle Petit. Cela coïncidait avec le même soir, à peu près à la même heure où nous avions entendu les bruits et la musique.
C'était le 7 octobre 1941. Mon oncle Petit avait 36 ans.
Plus tard, mon père et ses frères ont reçu chacun un chèque de 48.00$ en argent américain, destinés à couvrir leurs dépenses pour se rendre à la Maison Blanche, pour l'ouverture du testament de mon oncle Petit. Mon père et mes oncles n'ont pas voulu se rendre à Washington, ils n'ont jamais su combien mon oncle avait de fric et moi, mon héritage s'est terminé là.
Selon la police secrète américaine, il faut attendre 75 ans après l'événement pour savoir en détail ce qui s'est réellement passé. Ceci nous amène en 2016. Comme je ne serai plus là, j'espère qu'un de mes petits ou arrières-petits-enfants m'enverra un Money Must au ciel pour m'avertir de ses trouvailles. J'aurais tellement aimé savoir la vérité vraie que, soyez-en sûr, je le bénirai et cela lui portera chance.
N.B. Dans le cimetière des Forces Armées à Sainte-Augustine, en Floride, mon gendre Hubert a retrouvé un monument portant le no. A-70-8 au nom de Horace Bélanger, décédé le 7 octobre 1941 et enterré le 10 octobre 1941.
Croyances et malédictions
La malédiction
Ça s'est passé au Chemin Taché de Sainte-Rita dans les années 30. Ça fait au moins 70 ans. L'oncle à Ti-Jeanne, Donat et sa femme Élise, avaient 15 enfants. J'y suis allé une fois, j'avais dix ans. En voiture, c'était loin. Dans ce temps-là la pauvreté était très grande. Les hommes et les femmes les plus adroits réussissaient de peine et de misère à survivre.
Un de leur fils est mort d'une pneumonie à la fin du mois de mars. Dans ce temps-là, la mort pouvait emporter un jeune homme dans la fleur de l'âge en quelques jours. Il n'y avait pas de remèdes contre l'inflammation de poumons. On n'avait pas d'argent pour payer un docteur. On soignait comme on pouvait et la plupart du temps ce genre de maladie finissait par une mortalité. Même si on le savait les gens trouvaient ça dur et triste.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les malheurs n'arrivent jamais seuls. À la fin de l'hiver, les chemins étaient bien souvent impraticables. Les chemins n'étaient pas ouverts, il faisait doux, ça défonçait. Il fallait un cheval spécial pour passer sur ces chemins-là sans s'embourber, sans casser les ménoires et en plus, traîner une charge. Ce matin-là, le cheval devait transporter le cercueil du jeune homme. Le croque-mort ne se déplaçait pas jusqu'au fond d'un rang, en hiver surtout.
Quand le père à Ti-Jeanne est arrivé à l'église de Sainte-Rita, la famille n'était pas arrivée avec le corps. Dans ce temps-là, les services se chantaient à 7 heures du matin. Son père a demandé au curé d'attendre l'arrivée de la famille en expliquant la misère qu'ils devaient avoir pour s'en venir à l'église. Le curé a répondu que le service était à 7 heures et que c'était à la famille de s'arranger pour être à temps. Ça fait que le curé a commencé à chanter le service sans le cercueil. Quand le corps est arrivé, il était rendu au Libéra.
À La fin de la cérémonie, Élise, la mère du jeune homme, a dit au curé qu'il aurait pu attendre pour chanter le service. Il s'en est suivi un échange de mots entre elle et le curé. Ça fini quand le curé leur a souhaité du malheur pour avoir osé s'opposer à leur pasteur.
[Voir l'image pleine grandeur]

En revenant à la maison, le père à Ti-Jeanne a dit qu'il ne voudrait pour rien au monde être à leur place.
Élise, à bout de peur et de chagrin, a fini par écrire une lettre d'excuses au curé lui demandant pardon pour s'être emportée. Le curé lui a répondu:
- «Ce qui est dit, reste dit.»
Pour eux autres, à partir de ce moment-là, les malheurs ont commencé. La tante Élise est tombée malade, au lit. Elle a paralysé. Une des grandes filles est morte pendant que sa mère était au lit.
Ensuite, un des garçons qui avait un moulin à scie a tout perdu dans un incendie. Le feu a tout consommé. Même les chevaux sont morts brûlés.
Finalement, la tante Élise est morte à l'âge de 49 ans. Le corbillard venait de l'Isle-Verte. Le père à Ti-Jeanne a dit:
- «Préparez-vous vite, il ne faut pas être en retard.»
Il avait la mémoire fidèle. Il se souvenait des funérailles du plus vieux. Il avait goûté lui aussi au châtiment du curé qui lui avait fait perdre son lot de Sainte-Rita. Dans ce temps-là, fallait donner le 26e minot de grain récolté à l'église pour payer la dîme. Peu de colons arrivaient à avoir une aussi belle récolte. Il en avait fait la remarque au curé. Ce dernier voulait des résidants sur les lots de colonisation et non un fermier qui habitait la paroisse d'à côté et qui avait son franc parler par-dessus le marché. Le curé s'était arrangé pour lui faire perdre son lot.
Le matin du service de la tante Élise, la tempête faisait rage. Ils se sont vite dépêchés à mettre la tombe sur la traîne. Le corbillard n'était pas arrivé. Ils sont arrivés à l'église juste à temps: les cloches sonnaient. Le malheur a voulu que ce soit le même curé qui célèbre le service.
Plus tard, un autre des garçons était bien installé sur sa ferme. Un dimanche, il a dit à sa femme qu'il allait à la pêche avec les enfants en tracteur. Les enfants et le père sont montés sur le tracteur qui était sur le fenil. En reculant, le père a fait une fausse manœuvre et le tracteur est tombé en bas du pont. La mère qui voyait tout par le châssis est morte sur le coup: une veine du cœur avait éclaté.
Les malheurs se sont abattus sur cette famille sans répit pendant plusieurs années. Qu'on y croit ou pas, les paroles du curé ont semblé exercer leur puissance sur les deux générations suivantes.
Ti-Paul l'orphelin
J'ai connu un garçon qui s'appelait Paul. Je me souviens de sa petite face jaune, de ses cheveux en brous saille tondus avec le cleaper à mouton. Il n'était pas joli à voir. Ma sœur Élise et moi on l'aimait et on le surnommait Ti-Paul. On l'aimait pour ses farces, pour sa gaieté, pour toutes ses folies. On avait pitié de lui. C'était un petit orphelin qui était placé chez notre voisin Louis. Le petit Paul aurait sans doute eu besoin d'une mère qui le caresse, le cajole et le prenne dans ses bras. Il n'y avait pas grand monde pour lui dire des tendresses et des mots doux pour adoucir son malheur d'orphelin.
Il devait avoir six ans, le même âge que moi, quand ce que je vais vous raconter s'est passé.
Une famille qui avait une croix de tempérance dans la maison pouvait prendre un petit verre de gin mais sans en abuser. Notre voisin Louis, le père adoptif de Ti-Paul, ne se gênait pas pour dépasser la dose. Il buvait, buvait; il n'était pas contrôlable. Il buvait trop, laissant sa famille dans la misère. Ça fait qu'un jour, sa douce moitié en avait assez de le voir saoul et lui dit:
- «À matin, tu choisis: c'est la bouteille ou c'est moi et ta famille.»
Louis connaissant la fermeté de sa femme, il n'avait pas le choix.
Une fois, il était vers les 10 heures du soir quand mon Louis ramasse sa pinte de gin puis il la lance dans le signe. La pinte de boisson a passé droite, le signe était en fonte, puis c'est lui qui s'est cassé. La bouteille a descendu dans la cave. Notre Louis a descendu puis il l'a cassée à coup de masse. Ensuite, il a monté dans la cuisine, a décroché la croix de tempérance et en la brandissant au bout de son bras il a dit ces mots:
- «Si je prends une goutte de boisson, je veux que le bon Dieu me punisse sur le champ.»
Le temps a passé et Louis n'a pas touché une goutte de boisson, mais il y a toujours un mais.
Un jour, il a marié sa fille. Il s'est dit que le bon Dieu ne lui tiendrait pas rancune de quelques verres bus à la santé de sa fille et de son nouveau gendre. Il s'était donc désaltéré sans penser plus loin que son nez.
Pendant que tout le monde fêtait, le petit Paul pouvait en profiter lui aussi. Il avait trouvé une boîte d'allumettes et il s'en alla à la grange familiale sur le fenil pour s'amuser. Il entraîna avec lui deux fillettes, Marie et Antoinette, à peu près du même âge. Le petit Paul commença à allumer quelques brins de paille. Voyant que ça s'éteignait vite, il en fit un petit tas et y mit le feu. C'était beau, ça brûlait et ça s'éteignait vite. Les fillettes n'étaient pas rassurées et demandaient à Paul de s'arrêter.
[Voir l'image pleine grandeur]

Paul fit des feux avec toujours un peu plus de paille. Ce qui devait arriver, arriva. À un moment donné, il perdit le contrôle et le feu s'empara de la tasserie et commença à brûler les murs de la grange.
Un des noceurs vit la fumée et cria de toutes ses forces:
- «Au feu! Au feu!»
J'entends encore son cri d'horreur dans mes oreilles. Malgré tous les efforts, en quelques minutes la grange était complètement détruite. Et pour comble de malheur, on ne retrouvait plus Marie et Antoinette, de même que le petit Paul. On les croyait disparus dans le brasier.
Notre homme supplia Dieu de lui pardonner d'avoir brisé son serment lui disant qu'il était bien trop puni. Quand le soir tomba, on vit sortir du petit bois proche de la maison, trois petits enfants effrayés et affamés, pleurant à chaudes larmes, réalisant trop tard leurs bêtises. En voyant grandir le feu, les trois avaient couru se cacher dans le bois. Il a bien fallu reconstruire, c'était le temps des foins. Tous les voisins lui ont aidé et dans un temps record, il y avait une autre belle grange à la même place et la vie continua.
Or, s'il pardonna aux deux fillettes, il n'oublia pas de sitôt la folie du petit Paul qui mangea pendant un bon bout de temps, plus de taloches que de pain blanc.
À l'automne, on se retrouva tous à l'école. Pieds nus, des guenilles sur le corps, la face en grimace, le petit Paul n'avait rien pour plaire à la maîtresse. On allait à l'école du rang. Une école mal rambrissée, mal chauffée, humide, pas très confortable. Mais qui s'en souciait. Notre grande peur, c'était la cave de terre sous l'école. Pour y entrer, il s'agissait de tirer sur un anneau de fer fixé dans une des planches de la trappe. Il n'y avait même pas d'escalier. C'était noir et ça sentait le moisi. Il y avait un petit trou dans le solage par lequel entrait un filet de lumière. Pour tous les enfants d'école, c'était l'œil de Dieu. La chose la plus épeurante qui puisse exister.
Un jour, le petit Paul était plus agité que d'habitude. La maîtresse n'arrivait pas à en venir à bout. Elle avait beau le menacer des pires punitions, rien ne l'arrêtait. La classe s'est figée quand la maîtresse a dit qu'elle allait l'enfermer dans la cave. Le petit Paul eut beau faire toutes sortes de promesses, crier, pleurer, se débattre, la maîtresse le prit par les oreilles et l'enferma. On l'entendit longtemps crier, supplier, se lamenter. Tous les enfants pleuraient. La maîtresse resta impitoyable. Au bout d'un temps interminable, elle ouvrit enfin le caveau pour y trouver Paul sans connaissance baignant dans son sang. Ce fut, je crois son dernier jour d'école.
Quelques années plus tard quand il eut douze ans, il demandait pour chauffer les boillers au moulin de Louis son père adoptif. Il s'était assagi et on lui fît confiance. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours à l'ouvrage. Il a été aussi vanté pour son travail au moulin qu'il avait été disputé pour ses mauvais coups d'enfant.
Il faisait bien son travail veillant à ce que la vapeur ne soit pas trop forte, huilant les vis et surveillant tous les cadrans. On ne sait trop comment ni pourquoi, un jour, sa chemise resta pris dans un shaft Il fut complètement défait en quelques instants. Je ne sais même pas ce qu'on a fait des restes ni s'il eut un enterrement.
Ainsi finit bien tristement l'histoire du petit Paul que ma sœur Élise et moi aimions tant.
L'école
Je voudrais vous parler de l'école du temps, de mon jeune temps.
Il y avait deux sortes d'écoles: l'école du village et les écoles de rang. Nous autres, mes frères, mes sœurs et moi, on allait à l'école du rang de La Société, pas très loin de chez nous. On était chanceux. D'autres enfants devaient marcher jusqu'à un mille ou un mille et demi pour se rendre à l'école. Il n'y avait pas de transport en commun, encore moins d'autobus scolaire. Pour les enfants en hiver, (les filles surtout qui n'avaient pas le droit de porter de pantalons) vous vous rendez compte de la force et du courage que ça demandait pour marcher cette distance.
[Voir l'image pleine grandeur]

La maîtresse d'école de rang était parfois âgée de seulement quinze ou seize ans, pas encore mariée bien sûr. Elle avait la charge de trente à trente-cinq élèves. Même s'il y avait peu de matières à enseigner ça ne devait pas être facile.
Pour apprendre à lire, écrire et compter, le matériel scolaire n'était pas compliqué: une ardoise, deux cahiers, un coffret pour mettre des craies, un crayon, une plume, une règle, le tout dans un sac d'école en bandoulière.
Même pour si peu, il fallait travailler fort pour se procurer le nécessaire scolaire. Avec leurs seize enfants, mes parents étaient pauvres comme tout le monde autour. Chez nous, nous autres les enfants, on ramassait des fruits sauvages: fraises, framboises, bleuets, mûres, merises, cerises à grappes, noisettes, qu'on réussissait à vendre aux gens du village pour nous permettre d'acheter des fournitures scolaires.
Pour réussir à nous habiller l'année durant, ma mère tricotait des bas, des mitaines, des foulards, des tuques et des vestes de laine. Elle cousait aussi des chemises, des pantalons, des grosses froques d'étoffe pour les garçons, des robes et des manteaux pour les filles. Elle se couchait toujours très tard et malgré sa fatigue, elle se levait le matin avec un beau sourire. Ma mère, c'était une sainte!
Le pire, c'était les chaussures. Mon père faisait tanner une peau de bœuf pour nous faire faire à chacun une paire de pichous. C'était une sorte de mocassin fait d'une seule pièce dans la peau d'un animal. C'était pas très chaud et ça ne durait pas très longtemps, surtout pour nous les garçons. En hiver, ça glissait bien et on avait vite fait d'user nos semelles.
L'hiver, on dînait à l'école. Un bout de pain, une couenne de lard salé, une carotte, de l'eau ou un glaçon arraché au toit ou à la galerie en guise de breuvage.
Je n'avais pas toujours le ventre plein mais ça ne m'empêchait pas de voir clair. C'est pas croyable comme je trouvais la petite Caro belle, puis plus tard, ma Ti-Jeanne avec ses bas de laine refoulés qui laissaient voir un bout de ses cuisses rouges et gelées par le froid. Alors, je l'invitais à venir se réchauffer en passant par chez nous.
Mon père était souvent malade. Nous, les plus vieux enfants, on devait faire la besogne: traire les vaches, soigner les animaux, pomper l'eau car il n'y avait pas d'eau courante et pas d'électricité. On avait peur d'aller dans la grange à la noirceur. Chacun notre tour, on montait dans la tasserie pour débouler du foin servant à nourrir les chevaux, les bêtes à cornes et les moutons et de la paille pour les cochons. On avait peur, on voyait des gros yeux partout: probablement des chats ou des renards. On se sentait épiés, surveillés.
Parfois, des quêteux venaient coucher dans la grange à notre insu. On pensait que c'était des méchants, des malfaiteurs, qui voulaient nous faire mal, nous jeter des sorts, nous changer en crapaud comme dans les histoires de sorcières. On n'était pas gros dans nos bottines.
Après souper, les plus vieux des garçons débitaient le bois de chauffage. Un soir du mois de janvier, Ti-Bé sciait des morceaux de bois avec le sciotte et Lucien fendait les bûches avec la hache. Or, en fendant une bûche d'érable, la hache a glissé sur un nœud et mon Lucien s'en est donné un coup sur le bord du pied, près de la cheville. Il est tombé sur le côté en criant. Ti-Bé l'a aidé à rentrer à la maison. Puis, maman a désinfecté sa blessure avec de l'eau bouillie et lui a fait un pansement avec de l'onguent de camphre. Lucien a sangloté toute la nuit tellement sa cheville et son pied lui faisaient mal.
Le lendemain matin, maman a dit:
- «On n'est pas pour laisser Ti-Bé faire la besogne et aller bûcher tout seul. On va retirer Victor de l'école.»
Moi, ça faisait bien mon affaire. Vous comprenez, laisser le crayon pour la hache, j'étais fier.
L'année d'ensuite, quand il a fallu reprendre le chemin de l'école, j'étais pas très enthousiaste! Comment faire comprendre à ma mère que ça ne m'intéressait plus? Par quel moyen? La grève de la faim n'était pas à la mode dans ce temps-là! J'étais triste, ma mère s'en est aperçue. Alors, elle est allée voir la maîtresse d'école et lui a dit:
- «Montrez-lui son catéchisme, y'a pas besoin d'autres choses, il veut faire un cultivateur!»
Or, à force d'entendre les plus vieux le réciter, je savais mon catéchisme par cœur. J'ai passé pour un bollé même si le terme n'était pas employé dans le temps. À la vérité, je ne savais ni lire ni écrire. J'avais seulement neuf ans mais j'étais un homme et fier de l'être!
Il faut dire qu'autrefois, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte. L'adolescence n'existait pas. Il n'y avait pas de place pour les trips d'ados comme on dit aujourd'hui.
Depuis, j'ai découvert le Centre Alpha et grâce à ce monde-là, j'ai su me dé-aller un peu côté écriture, mais il y a encore de la place pour l'amélioration.
Tout ça pour vous dire que moi, Victor Bélanger, à quatre-vingt-six ans, je vous dis encore qu'apprendre devrait être le but de toute la vie. Quand on n'apprend plus rien, on est mort!
Le petit chevreuil blessé
Dans les années 1925-1950, toutes les bêtes qu'on rencontrait, on aurait dit qu'il fallait les faire disparaître. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais si on voyait un lièvre au printemps, on le tuait sans penser qu'il pouvait y avoir des petits dans son ventre ou qu'il cherchait à nourrir cinq ou six petits levrauts qui l'attendaient au chaud, cachés pas bien loin dans les buissons. On pouvait tout aussi bien casser les œufs de toute la couvée d'une perdrix que tuer une mère chevreuil qui nourrissait ses petits. On ne pensait qu'à détruire, tuer, blesser, chasser, plutôt que de penser à protéger cette richesse de nos forêts. Aujourd'hui, on pleure: il n'y a plus de ravages de chevreuils, presque plus de lièvres, pas beaucoup de perdrix non plus. Nos forêts sont de plus en plus pauvres.
Mon frère Tibé et papa bûchaient dans la cédrière au nord de la maison. C'était en janvier. Tibé avait aperçu au loin un petit chevreuil ; il sauta sur ses raquettes, puis il courut pour rejoindre le petit animal, avec bien sûr l'idée en tête de le tuer. Mais il se trouvait que la petite bête souffrait déjà d'une mauvaise blessure, peut-être une morsure de chien. Elle était, en tout cas, incapable de se sauver. Tibé approchait de plus en plus de l'animal pour se placer à proximité de sa tête. Celui-ci se sentant traqué, voulut se défendre. Il a d'abord monté avec ses pattes de devant sur les raquettes de mon frère, pour ensuite lui asséner littéralement un coup de patte en pleine face. Non content d'avoir déchiré le veston du jeune homme, il continuait de le marteler de ses pattes tant et si bien que ce dernier s'est retrouvé estropié pour la peine. C'est à ce moment que mon père est enfin arrivé à leur hauteur: il était temps! Il a saisi sa hache et en a assené un bon coup sur les reins de l'animal, le blessant ainsi à mort. Ce n'est qu'à cet instant qu'ils ont découvert la première blessure de la pauvre bête, ce qui expliquait son comportement si agressif Mon fière, quant à lui, en a eu pour son rhume: deux semaines au lit et un mois aux petits soins... c'est comme ça qu'on protégeait l'avenir des générations!
Une leçon à retenir: Je m'excuse d'avoir jugé les autres; moi aussi, j'étais presque comme eux. Je pense qu'aujourd'hui j'en suis guéri... J'ai compris...
[Voir l'image pleine grandeur]

La religion
Aujourd'hui, quand on parle de religion, c'est pour la critiquer ou dénoncer les excès de certains de ses déviants ou tordus et pour mettre tous ses fidèles dans le même bateau. Même si l'un n'exclut pas l'autre, il n'y a pas eu plus de pédophiles chez les prêtres catholiques que chez les coachs de hockey et les entraîneurs sportifs d'aujourd'hui.
Astheure, pour toutes sortes de raisons, les gens délaissent facilement les églises et la religion catholique. Même qu'il n'y a presque plus de prêtres et de religieuses dans les couvents. Autrement dit, il n'y a plus de relève.
Les temps ont bien changé! On va même jusqu'à convertir les églises en condos et les couvents en centres d'accueil pour les vieux. C'est triste à mort!
On a beau chialer et critiquer, n'empêche que sans toutes ces personnes dévouées: les curés, les pères, les frères et sœurs religieuses, nous n'aurions pas eu accès à l'instruction publique et aux écoles supérieures. Sans eux, il n'y aurait pas eu de soins aux malades et aux handicapés, aux orphelins et aux démunis de toutes sortes.
La religion a toujours eu une importance capitale dans notre milieu, dans notre famille et dans notre vie à tous. Personnellement, je dirais même qu'elle a orienté, sinon mené ma vie.
Autrefois dans les paroisses, la seule personne instruite était le curé. On le consultait pour tout, autant pour les choses matérielles que spirituelles. Par exemple, pour le plan Vautrin, qui consistait à allouer un lot sur une terre de colonisation à un homme qui se mariait et fondait une famille, bien le curé avait son mot à dire sur l'acceptation ou non des colons. Les voleurs, les saoulons, les paresseux, les impies et ceux qui ne faisaient pas leurs Pâques étaient exclus automatiquement.
Comme le curé entendait chacun des paroissiens en confession, il était donc au courant de tout. Il savait tout et menait tout. Même les relations sexuelles, sous prétexte de favoriser ou d'empêcher la famille, n'échappaient pas à sa gérance ou à sa curiosité.
Le péché était un passe-partout sans limite et Satan avait le dos large et une grande charrette pour vous conduire en enfer. L'endoctrinement était bien structuré: le baptême, les dix commandements, le catéchisme, la confession, la première communion, la confirmation, la communion solennelle, le mariage, l'extrême onction, etc.
Les activités religieuses prenaient une grande place dans nos vies. Outre la messe, la confession, la communion, il y avait le Carême, l'Avant, le temps des Fêtes de Noël, de Pâques, la Fête-Dieu, il y avait encore les Quarante heures, la semaine Sainte, le mois de Marie, le premier vendredi du mois, les rogations, les retraites fermées, etc.
Toutes sortes de conditions étaient associées à ces activités religieuses. Par exemple, pour la communion, il fallait être à jeun depuis minuit. Même se brosser les dents était un problème, car avaler une goutte d'eau constituait un empêchement à recevoir l'Eucharistie. De plus, celui qui n'allait pas communier à la messe le dimanche était pointé du doigt par le curé et les paroissiens.

Musée du Bas-Saint-Laurent, Fonds photographique Chamberland-Breton, NAC CB218
En réalité, cette loi ou cette coutume déjeune avant la communion faisait économiser un repas. Multipliez ça par dix ou par quinze selon le nombre d'enfants et ça vous donne une idée de ce que cela signifie quand on est pauvre et qu'on tire le diable par la queue.
Une couple de fois par année, le curé visitait les écoles pour s'assurer de l'apprentissage et de l'évolution des élèves. Il en profitait aussi pour questionner les enfants sur certaines coutumes domestiques:
- «Est-ce qu'il y a des petits barils derrière le poêle chez vous?» demandait-il dans le but de savoir si on fabriquait de la bagosse et de vérifier la tempérance des parents.
Le curé faisait aussi de fréquentes visites paroissiales. À chaque saison, il rendait visite à chacune des familles de son territoire. Les buts visés étaient de s'assurer de la bonne tenue de la maison, de vérifier le garde-manger, de déceler l'état de pauvreté nécessitant de l'aide, de découvrir les alambics domestiques cachés derrière le poêle ou la fournaise et surtout le contrôle des naissances. S'il n'y avait pas d'enfant au berceau, le curé s'informait s'il y avait un bébé à venir. Empêcher la famille était vu comme un péché mortel. Les grosses familles étaient considérées comme riches à cause du nombre d'âmes dans l'Eglise et de la main-d'œuvre qu'elles fournissaient pour cultiver la terre.
Cela nous agaçait dans le temps, mais aujourd'hui, je crois que ce contrôle a permis d'assurer la survie des Canadiens français, sans quoi, il y a longtemps que nous n'existerions plus.
Les sacrements
Quel est le sacrement qui m'a le plus marqué? Tout le monde va répondre que c'est le mariage. Vous avez raison. Soixante-cinq ans de mariage, ça marque un homme! Mais avec ma Ti-Jeanne, j'ai été heureux. Nous avons eu 15 beaux enfants, dont un ange, et nous sommes très fiers d'eux.
Au risque de vous surprendre, le sacrement qui m'a le plus marqué est celui de l'Eucharistie. D'abord la préparation: apprendre le petit catéchisme par cœur puis marcher au catéchisme pendant un mois et surtout la confession avant la première communion.
À sept ans, chercher et trouver un péché, c'est pas une chose facile. J'avais demandé l'aide de mes sœurs sans succès. Après des nuits de réflexion j'ai trouvé, mon plus gros péché avait été de me brosser les dents avec du sucre en poudre au lieu du soda à pâte comme le recommandait ma mère. J'étais fier d'avoir un péché à confesser. Au lieu de dire: «Mon père, je m'accuse de rien.», je pouvais dire: «Mon père, je m'accuse d'avoir désobéi à ma mère.» J'avais enfin l'âge de raison!
Après, pour la communion: manger le corps du Christ sans que l'hostie ne touche aux dents, ça aussi c'était presque un exploit. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était le curé qui buvait le sang du Christ dans la calice. Je le voyais comme un espèce de vampire et ça me levait le cœur. Jusqu'à ce que je comprenne la valeur symbolique du vin de messe, pour moi, le vrai miracle était l'intarissable, l'inépuisable et l'inexplicable capacité du Christ à verser son sang pour une telle quantité de prêtres jamais rassasiés qui recommençaient l'opération chaque jour.
Les mauvaises pensées
«Les mauvaises pensées et les mauvais désirs, ça couche ensemble et parfois avec moi.»
C'est surtout à l'adolescence que le fantôme des mauvaises pensées et des mauvais désirs a commencé à hanter mes jours et surtout mes nuits. Monsieur le curé disait:
«C'est un péché mortel que d'avoir des pensées impures. Quant aux mauvais désirs, c'est assez pour aller brûler en enfer pendant toute l'éternité.»
C'est pas drôle ce qu'on nous faisait à croire dans ce temps-là! C'est épouvantable de vivre avec une pareille menace au-dessus de la tête.
Les mauvaises pensées et les mauvais désirs étaient les trois-quarts du temps reliés au sexe. Dans mon cas, je vous le jure, c'était 100% en rapport avec la sexualité. Par exemple, quand on allait à la messe, on était placé face à la statue de la Sainte Vierge. Belle, grandeur nature, elle avait de généreuses formes et moi en la regardant, je croulais sous le poids de mes mauvaises pensées. Le pire, c'est que loin de flotter dans, mes pantalons comme de coutume, il manquait de place tout à coup.
La Sainte Vierge avait le pied droit posé sur un serpent lequel personnifiait le Diable. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle écrase la tête du serpent pour m'enlever mes mauvais désirs. Même que j'aurais fait n'importe quoi pour l'aider. Des fois, je voulais apporter une pioche, une fourche, un croc ou une hache pour couper la tête du serpent mais à la messe du dimanche devant tout le monde, j'ai jamais osé.

Musée du Bas-Saint-Laurent, Fonds photographique J-P Martineau, NAC JM50286a
Avoir de mauvaises pensées et de mauvais désirs face à la Mère du Petit Jésus, ça se peut pas! Quel sacrilège!
Avec l'âge, tout est rentré dans l'ordre. Plus tard, j'avais une grande dévotion pour la Sainte Vierge. J'espère qu'elle me pardonnera mes folies de jeune garçon.
Un soir, dans le temps des Fêtes, je devais avoir une quinzaine d'années, on était allé veiller à Tobin, dans l'anse de l'Isle-Verte. Dans cette maison, comme dans toutes les autres, il n'y avait pas de salle de bain. Quand on avait envie, il fallait aller dans un coin au grenier. C'est là que j'ai vu une jeune femme en train de donner le sein à son bébé. J'étais gêné, je me suis excusé. Elle m'a dit:
- «Aie pas peur, je ne vais pas te manger! Tu peux t'approcher!»
Je me suis approché timidement. Elle a ajouté:
- «C'est pas un péché, c'est tout naturel, c'est le Bon Dieu qui nous a créés comme ça!»
J'ai remercié cette femme de sa générosité et de l'émotion qu'elle m'avait fait vivre, et surtout, de m'avoir permis de me coucher le soir en état de grâce.
Depuis, je n'ai pas cessé d'aimer et d'admirer la nature et ses cadeaux de tous les instants.
L'hiver, les dîners dans le bois autour du feu
Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé dîner dans le bois. La première fois, je devais avoir quatre ans, j'accompagnais mon père dans le chantier sur notre terre du nord. C'était l'hiver, j'étais gelé et j'avais faim. Mon père avait fait un feu de branches d'épinette, puis il avait fait griller des tranches de pain de ménage que nous avions mangé avec un morceau de sucre d'érable. J'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Et que dire des odeurs des copeaux d'épinette qui brûlent dans le froid de l'hiver... Encore aujourd'hui, je trouve qu'aucun parfum n'est aussi riche que
Plus tard, avec tout le respect de la forêt et la prudence requise, j'ai continué à faire des feux de branches d'épinette sèches pour cuire le dîner l'hiver, lorsque mes frères et moi allions bûcher, et au printemps à la sucrerie de Bellevue.
Mais, c'est dans les chantiers de la compagnie «Anglo-Pulp» à Forestville que j'ai le plus souvent dîné dans le bois autour d'un bon feu d'épinette noire.
Si ma mémoire est bonne, c'était en 1950. Mon frère Florian et moi étions montés bûcher là à Forestville. Le boss, un dénommé Murray, nous avait assigné une coupe à faire dans la montagne, à environ trois quarts d'heure de marche du camp. C'était assez loin, mais pas de problème jusqu'au jour où il annonça à tout le monde que:
- «À partir d'astheure pus de lunch dans l'bois! Ça coûte cher à la compagnie!»
Après une couple de jours, j'ai dit à Florian:
- «On perd ben trop de temps! On bûche trop loin pour voyager ça: du camp au bûcher et du bûcher au camp, quatre fois par jour! À soir, je m'en va voir le boss!»
- «Fais pas ça! tout l'monde dit qui est pas parlable! Y va t'envoyer chez l'diable, pis ça va être pire pour nous autres!» avait répliqué Florian.
M. Murray habitait un petit camp avec sa femme, pas trop loin du gros camp des bûcherons. Comme je l'avais dit à Florian, le soir même, je me suis présenté chez lui. Il m'a reçu poliment et m'a invité à m'asseoir près du feu. Sans tarder, je lui ai fait part de ma demande:
- «Monsieur, comme vous le savez, mon frère et moi on coupe dans la montagne, on aimerait dîner dans le bois parce qu'on perd trop de temps à voyager!»
M. Murray a répondu:
- «Si je vous donne la permission d'apporter votre lunch, les autres vont chialer, ils vont dire que c'est pas juste!»
Je lui ai répondu:
- «C'est vrai! Mais nous autres on part plus tôt et on revient plus tard parce qu'on bûche plus loin!Y'a pas grand monde qui vont s'en apercevoir de toute façon!»
M. Murray a dit:
- «O.K. Arrange-toi avec le cook, je vais l'avertir.»
Après ça tous les matins, dans une chaudière de vingt livres, j'apportais de la viande: steaks, côtelettes de porc ou rondelles de ballonné, parfois on prenait un lièvre ou une perdrix, on apportait aussi du pain et des feuilles de thé.
Dans le chantier, Florian bûchait des billots de seize pieds d'un côté, moi, j'étais à la corde de l'autre bord. Ça veut dire que je coupais de la pitoune de quatre pieds avec ces billots-là et qu'ensuite je les cordais.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le cheval charriait tout seul! Mon frère le chargeait de billots de son côté et me l'envoyait. Arrivé à moi, le cheval s'arrêtait tout seul et je le déchargeais de son bois, quand je disais:
- «O.K.! Le King!»
De lui-même, il prenait la virée puis le chemin de twich et s'en retournait vers mon frère. Un cheval, c'est bien plus intelligent qu'on pense!
Vers midi, j'attachais une touffe d'épinette après les cordeaux du cheval. C'était le signal pour dire à mon frère que le dîner serait près et qu'il s'en vienne avec un dernier voyage de bois.
Pendant ce temps-là, je faisais un feu d'épinette sèche, puis je faisais cuire la viande pour nous deux. J'avais aussi rempli une chaudière de belle neige blanche qui fondait sur le feu pour faire notre thé. On aimait boire un bon thé chaud le midi en mangeant des toasts chauffées dans la braise du bois. Le reste du thé, on le buvait glacé dans l'après-midi, en mâchant de la gomme d'épinette noire, la meilleure à mon goût.
Peut-être que «la faim fait le bon chiard!» mais encore aujourd'hui, je trouve que rien ne goûte meilleur que ça et qu'aucun parfum n'arrive à battre l'odeur d'un feu d'épinette dans le froid de l'hiver.
L'odeur de la nourriture attirait automatiquement les écureuils et les oiseaux de toutes sortes, particulièrement les petites pies de lunch, les geais bleus, qu'on ne voit plus aujourd'hui.
Ben non, on n'avait pas oublié le cheval! Pendant ce temps, bien à l'abris, une couverture sur le dos, le King mangeait son avoine, sa balle de foin et se reposait.
Nous autres après le dîner, on se roulait une bonne cigarette, la première de la journée, qu'on fumait avec plaisir ; moi en limant les sciottes et Florian en affilant les haches.
On parlait pas. On écoutait la nature, les craquements du bois, le vent dans les arbres, les courses des écureuils, le piaillement des oiseaux, etc. Parfois, on écoutait le silence tout simplement.
Ça doit vous sembler bizarre aujourd'hui dans notre monde de bavardage? Mais «c'est pas parce qu'on parle qu'on dit quelque chose...», comme le dit si bien le sculpteur Armand Vaillancourt.
Un jour en fin d'après-midi, en revenant au camp, Florian me dit:
- «Le cheval est déferré. Arrangé comme ça, on pourra pas haler le bois avec lui demain!»
J'ai répondu:
- «On va demander au Cyr de le ferrer!»
- «Tu sais ben que l'boss a dit que personne ne doit ouvrir la boutique de forge!» a répondu mon frère.
M. Murray avait raison, tout le monde allait gosser dans la forge. Quand on venait pour réparer quelque chose on ne trouvait plus rien. Le Cyr Jalbert de Saint-Guy était un homme adroit, mais quand il nous a vu venir il a dit:
- «Y a pas un christ qui va me faire rentrer dans la forge!»
J'ai répondu:
«M. Murray m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre personne que Monsieur Jalbert qui va entrer dans la forge à soir!»
Alors, mon Cyr tout content, a ferré notre cheval comme il faut.
Ça s'est terminé le dimanche suivant par une petite veillée chez M. Murray. On avait apporté un reste de flacon de bagosse qu'on a bu ensemble autour du feu. J'ai joué du ruine-babine pendant que le boss et sa femme dansaient et que Florian accordait avec des cuillères.
J'ai jamais eu de problèmes plus que ça avec les boss! quand tu veux travailler, pis que t'es franc et honnête, tu peux être respecté dans des demandes justes et raisonnables même si le boss a la réputation d'être un dur.
Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que même si j'ai trimé fort dans ma vie, j'ai eu la chance de connaître des expériences que je considère d'une valeur inestimable.
La bêtise humaine
En 1925, la compagnie Brown faisait des chantiers sur ses limites situées à la tête de la Boisbouscache. Ils dravait ce bois jusqu'à Tobin et pour ce faire, ils engageaient des hommes de métier et aussi des journaliers.
Il y avait une famille qui demeurait dans le rang de la Société. Quinze enfants, des garçons et des filles. Le deuxième des gars, du nom de Jean, on l'appelait le gros Jean. Il pesait 180 livres, 17 ans, pas trop habitué de travailler. Sa mère lui a dit:
- «Jean va donc à la drave, tu vas gagner un peu d'argent et puis tu vas être nourri, tu pourras manger plein ton ventre.»
Pour les journaliers, on payait 1.75$ par jour. Pour les gars de métier, on payait 2.25$. C'était beau, la rivière passait dans la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu.
Le gros Jean est parti. Il avait quatorze jours de fait mais la quinzième journée, il n'a pas été chanceux. Il travaillait avec un piquarom. Il a piqué une bûche de pitoune le dos à la rivière, son pic a glissé puis le malheureux est tombé à l'eau. Il y avait un rapide. Il a réapparu une couple de fois puis fini. Le gros Jean Ouellet n'était plus.
La compagnie a arrêté la drave 15 jours de temps pour retrouver le corps. Le curé de la paroisse a donné du pain béni et leur a mentionné d'envoyer le morceau à l'eau et dit:
- «Suivez-le et là où il s'arrêtera, c'est là que le corps est supposé être.»
[Voir l'image pleine grandeur]

Mais la rivière était embarrassée, ils n'étaient pas capables de suivre le pain et ils se sont découragés de courir et ont abandonné les recherches.
Ils ont trouvé le corps au mois de juillet, vers le 15. C'est un pêcheur de Trois-Pistoles qui a fait la macabre découverte. Ils l'ont sorti de la rivière, l'ont déposé dans une tombe et ils l'ont monté chez-eux.
Le drame continue... Ils l'ont gardé trois jours et trois nuits. Ils ne pouvaient pas le déshabiller, il était en état de décomposition liés liés avancée. Il a commencé à enfler, à sentir, à couler...comble de tout, la tombe a fendu. On l'a attachée avec de la corde de lieuse puis avec de la broche. Ils mettaient des cannes de tomates pour ramasser le bouillon puis des seaux.
On disait le chapelet aux heures le jour puis aux heures et demie la nuit. On ne se couchait pas. Les pauvres parents, la pauvre femme, une sainte... De temps en temps, elle venait s'asseoir près du corps puis elle pleurait, elle pleurait son cher enfant.
La compagnie leur a donné 700 dollars d'assurance. Le matin du service, le corbillard est venu le chercher. Ils avaient pris soin d'amener les seaux: le corps coulait toujours au moindre dérangement. Puis ils l'ont enfin porté en terre.
Moi, je plains les parents qui ont vécu une telle épreuve de vrai martyr. Ça fait 77 ans de cela et moi je me rappelle comme si c'était hier. On restait près de la famille. Je n'oublierai jamais la senteur qu'il dégageait suite à la tragédie. Par contre on l'aimait. Ça toujours été des amis de la famille. C'était de braves gens.
Hommes forts, personnages mytiques et colorés
Kétaine et Ozilda
Descendantes des Dumont-Marteau, Kétaine et Ozilda étaient deux vieilles femmes assez originales et drôles à voir.
Si elles provoquaient un certain malaise et même une véritable peur chez plusieurs adultes à cause de leur manie de jeter des sorts, pour nous autres les enfants, il en était tout autrement. Quand elles se pointaient au printemps, pour nous, c'était la fête!
Nous avions ben du fun à les voir arriver de loin: Ozilda attelée à une petite waguine à quatre roues et Kétaine poussant par derrière.
- «Marche donc drette!» criait Kétaine à sa sœur.
- «Maudite charogne!» répondait Ozilda.
- «Tais toé! J'suis certaine que t'as jamais sucé sur un cornet, Ozilda!»
- «T'as menti!»
Elles se chicanaient tout le temps. Et leurs voix fortes, à la fois rauques et méchantes, nous faisaient frissonner.
Kétaine et Ozilda étaient grosses, vieilles et laides. Elles avaient des allures de sorcières qui nous enchantaient. Elles étaient vêtues de longues robes foncées plus ou moins propres, des vestes tricotées à la main et chaussées de bottines de rubber. Ozilda avait une très grosse bedaine qui valsait sous un grand tablier qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Kétaine la veuve devait avoir dans la soixantaine tandis qu'Ozilda, la vieille fille, fiisait les soixante-quinze ans.
Ozilda était aveugle de l'oeil droit et avait la paupière tombante pour l'œil gauche. On l'appelait la «Coq-l'œil» en chuchotant et en ricanant dans son dos. Ma mère nous faisait de gros yeux en nous signifiant de nous taire... Mais, si Ozilda était aveugle, elle était loin d'être sourde. Elle répondait à ma mère:
[Voir l'image pleine grandeur]

- «Laisse-les faire, ils le disent parce qu'ils l'ont entendu dire!»
Kétaine et Ozilda dînaient parfois à la maison quand on suppliait ma mère de les garder. Elle acceptait à la condition que l'on soit poli. On s'assoyait sur le grand banc en face d'elles et on les écoutait raconter toutes sortes d'histoires sans perdre un mot, ni un geste.
Kétaine et Ozilda quêtaient du printemps à l'automne. Le printemps et l'été, ma mère leur donnait du pain, des œufs, parfois un morceau de lard salé.
- «Tâte, tâte, tu vas voir comme y'é pas gros...» disait l'une à l'autre.
Elles demandaient toujours un peu plus:
- «T'aurais pas un p'tit peloton de laine avec ça? Ou un peu de fil pour repriser mes bas?»
Ma mère, elle trouvait toujours de quoi les contenter. Mais c'était pas tout le monde qui pouvait le faire. Ainsi, le père Eugène à qui un jour Kétaine et Ozilda avaient demandé:
- «T'aurais pas un morceau de lard avec ça?»
- «Ben là, j'pense que c'est assez!» leur avait-il répondu.
Alors les deux quêteuses choquées avaient répliqué:
- «Ben, si t'en as pas à nous donner, du lard, ben t'en aura pu jamais toé itou!»
Et à partir de ce moment là, le père Eugène n'a plus jamais été capable de garder un gros cochon, ils mouraient tous!
Un jour, Kétaine et Ozilda passaient dans le chemin des Dubé. Une jeune fille, Germaine, avait ri d'elles. Alors, les quêteuses fâchées lui avaient souhaité des poux. Germaine a eu tellement de poux qu'elle disait:
- «C'est pas moé qui ai les poux, ce sont les poux qui m'ont!»
Pour se défaire de la malédiction ou casser le mauvais sort, on faisait bouillir des aiguilles à coudre et là, ça été fini, Germaine n'a plus jamais eu de poux.
Kétaine et Ozilda couchaient chez Joseph Sénéchal et sa femme Anastasie que son mari appelait «Tasie». Elles couchaient dans la rallonge de la maison, sur une paillasse installée par terre.
Une fois, Ozilda avait été appelée à témoigner dans une affaire de vol. Voyant son handicap, le juge lui avait dit:
- «Comment pouvez-vous jurer avoir vu monsieur un tel commettre ce vol? Moi, me voyez-vous comme il faut?»
Alors Ozilda avait d'une main tiré en relevant sa paupière supérieure et de l'autre abaissé celle du bas et avait répondu au juge:
- «J'vois ben que t'es laite pis que t'es fou!»
Une autre fois, en allant chercher de l'eau à une source difficile d'accès, elles avaient rencontré monsieur le curé qui, constatant leurs difficultés, leur avait conseillé:
- «Vous seriez mieux de vous marier!»
Kétaine, un peu dure d'oreille, avait répondu:
- «Le trou est trop petit monsieur le curé!»
L'automne, Kétaine et Ozilda quêtaient pour se faire des provisions pour l'hiver. Les gens donnaient soit une poche de patate, des légumes, carottes, choux, navets, ou une poche de farine, du sucre, de la cassonade, et le reste. Alors, Kétaine disait à Ozilda:
- «Ça prend juste des écœurants pour nous charger comme ça!»
L'hiver, elles demeuraient dans un «camp en bois rond» sur le coteau de la grande ligne, avant d'arriver au chemin Taché, à la droite sur la route de St-Cyprien, tu sais, là juste avant le village...
Entre temps, peut-être pour suivre les conseils du curé..., Kétaine s'était mariée à un homme qui n'est pas resté longtemps avec parce qu'il y avait trop de rats dans leur camp en bois rond.
Kétaine et Ozilda ont arrêté de quêter quand le gouvernement a commencé à donner des pensions de vieillesse: 15 à 18 piastres par mois. Dans ce temps-là, c'était assez pour vivre comme il faut! Ozilda est morte de vieillesse dans son vieux camp en bois rond et Kétaine est allée mourir chez les Dubé.
Grand Jos
Joseph Dion mesurait six pieds quatre pouces. Il était fort et vaillant. Dans le camp où il travaillait, on l'appelait le «Grand Jos». Il aimait se faire respecter et se battait à l'occasion pour s'imposer. Faut dire que la bataille était à la mode dans ce temps-là. On se battait à la fois pour prouver sa supériorité et pour le spectacle. Acteurs et spectateurs y trouvaient leur compte.
Quand je le regardais, je l'enviais, j'aurais voulu avoir sa démarche royale. Dans le camp, quand il marchait, on aurait dit qu'il flottait, il ne portait pas à terre tellement il était agile sur ses jambes.
Un soir, je ne sais plus trop pour quelle raison, il devait se rendre au camp voisin. Ses amis lui ont dit:
- «Tu ne devrais pas sortir à la noirceur, il y a des ours dans le coin, c'est dangereux!»
[Voir l'image pleine grandeur]

- «Calvaire, c'est pas un ours qui va me faire peur, à moi!» qu'il leur a répondu. Et il est parti.
Au bout d'une heure environ, comme il devait être de retour depuis un bout de temps, ses chums inquiets sont allés voir ce qui se passait. À une couple de mille pieds du camp, ils ont trouvé Grand Jos écrasé sur un tas de branches essayant de replacer les chairs sur son bras déchiré. Il baignait dans son sang. En levant leur fanal pour mieux éclairer les alentours, ses amis ont tôt fait de trouver le responsable des blessures du Grand Jos: un ours noir, encore tout chaud, était étendu là, raide mort...
Voyant souffrir Grand Jos, ses amis lui ont administré une bonne ponge de «gros gin». Puis, ils ont construit un brancard de fortune et l'ont ramené au camp. De là, ils ont attelé une team de chevaux et l'ont conduit à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac.
[Voir l'image pleine grandeur]

Pas mal sonné, très souffrant, mais toujours conscient, voici ce que Grand Jos a raconté pendant le voyage du camp à l'hôpital:
- «Pour me rendre au camp, j'ai pris le tow path à drette qui passait par la moutonne. C'est là que j'ai vu l'ours en train de fouiller dans les vidanges. Surprise, la bête s'est levée sur ses pattes de derrière et m'a fait face comme un homme... Pis moé, ben j'ai jamais eu peur de ça un homme... Ça fait que j'y ai câlissé une savate en plein coffre avec mes bottes Korkay. L'ours a roulé mais en un éclair, il est revenu sur moé. J'ai continué à le marteler à coups de pieds dans les flancs... mais le tabarnac ya jamais lâché. On aurait dit que ça l'affilait... Y revenait toujours... Le souffle commençait à me manquer mais je fessais de plus en plus fort... Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir peur mais y était pas question que je revire de bord sans avoir sa peau le calvaire. À un moment donné, y m'a donné un coup de griffe su a mosselle de mon bras gauche. Ça été comme un coup de couteau. Je m'ai su dit: «Y va m'avoir le tabarnac!» Pour la vie ou pour la mort j'y vas. J'ai fait un steppe de quatre, cinq pieds dans les airs pis de toutes les forces qui me restaient, j'y ai quické ma botte dans l'estomac. L'ours a roulé d'un bord pis moé de l'autre. Y s'est pas relevé... Une chance parce que moé j'étais vidé...»
À l'hôpital, comme il était capable comme un ours, Grand Jos a pas fait vieux os, y'é pas resté longtemps. En moins d'un mois, il était de retour chez lui dans le rang cinq à Rivière-Bleue, chez son père.
Comme il ne tenait pas trop en place malgré son bras en écharpe, quelques semaines plus tard, Grand Jos a pris le «Petit Témis» pour se rendre à Cabano.
À la station, beaucoup de monde sont venus le voir. Des vieux, des jeunes, tous étaient curieux de rencontrer «l'homme qui s'est battu avec un ours». Ceux qui ont déjà vu un ours debout savent ce que ça veut dire...
Tout le monde lui posait des questions, remettant sa force et son agilité en doute.
- «Serais-tu capable de te battre avec rien qu'un bras astheure?»
- «T'es pas épeurant, t'es tranquille arrangé d'même, hein?»
Ils ont continué à le taquiner, à l'achaler et à se moquer de lui. Grand Jos a dit:
- «Poussez-vous un peu! Faites-moi de la place! Je vais vous montrer ce que je peux encore faire!»
Puis après une couple de sauts en l'air pour se réchauffer, Grand Jos a estampé ses deux bottes au plafond de la gare. Tout le monde est resté la bouche ouverte, le souffle coupé, tellement celui que l'on voyait comme un homme fini les avait étonnés par sa souplesse.
L'automne suivant, Grand Jos est retourné dans les chantiers. Il arrivait à faire une journée normale malgré la faiblesse de son bras gauche.
Au retour, il a repris le train de Fort Kent près des frontières du Maine jusqu'à Edmundston, puis de là, à Rivière-du-Loup. Ensuite, il est monté dans le «Petit Témis» jusqu'à Rivière-Bleue. À sa descente du train, Grand Jos était blême, fatigué, vidé. Il est entré dans le magasin général pour se reposer et prendre une bière. Il a dit au commis:
- «Donne-moé donc une bonne grosse bière, ben frette!»
Le commis, un jeune garçon de dix ans qui gardait le magasin en l'absence de ses parents en train de dîner dans la pièce voisine, lui a répondu:
- «Monsieur, donnez-moi l'argent, je vais vous en donner une bière!»
Grand Jos a répondu:
- «Mon p'tit tabarnac, une bière que j't'ai dit!»
Le jeune garçon a répété:
- «Monsieur, payez avant et je vous la donne tout de suite!»
- «Calice de christ, j'ai dit une bière, ostie! T'as pas compris viarge! T'es sourd ou quoi? Joual vert! Une bière c'est tu clair?»
Grand Jos était bleu, il a posé une main sur le comptoir et a sauté l'autre bord pour prendre une bouteille. Il l'a débouchée mais n'a pas eu le temps de la boire...
Sous le comptoir, le jeune avait un marteau. Il l'a saisi et sans hésiter, il en a sacré un grand coup à Grand Jos. Notre homme est tombé de toute sa longueur par terre. Il était raide mort! Le jeune garçon l'avait frappé sur la tempe...
Ainsi finit l'histoire de l'homme qui s'était battu avec un ours. Il s'est fait descendre par un enfant d'école. Ça ressemble au symbolique combat de David et Goliath, n'est- ce pas?
La morale de cette histoire c'est qu'il ne faut jurer de rien et respecter les gens même s'ils sont plus petits que soi!
Pierrot Rioux
Je voudrais vous parler de Pierrot Rioux, un gars de la paroisse, un homme pas ordinaire, un grand six pieds quatre, pas gros mais très fort. On disait de lui qu'il avait des ressorts dans les jambes.
Pierrot avait passé son enfance à se perfectionner dans les exercices de sauts: sauter les clôtures, sauter dans la tasserie, sauter par-dessus les cordes de bois, sauter pardessus le cheval, sauter, sauter et sauter encore... ses frères l'appelaient «Le Chat».
Un jour, la chicane a pris avec un gars du village. Pierrot s'est battu avec ses pieds, il l'a mis KO. sans même se servir de ses mains.
Dans ce temps-là, les batailles étaient à la mode. C'était non seulement une façon de régler ses comptes, mais comme il n'y avait ni télévision ni cinéma, c'était aussi un beau spectacle. Or, notre Pierrot payait comptant. Pour lui, se battre contre un homme c'était ennuyant, contre deux c'était intéressant et contre trois, c'était encore mieux.
Avec les années, notre jeune homme s'était assagi. Il disait:
- «La vie est trop courte pour faire ce métier-là. Je ne veux plus me chicaner et me battre avec ceux de mon entourage que j'aime.»
Mais un beau dimanche matin, devant la porte de l'église, est arrivé un gars de Cabano. Il a dit:
- «Moi, je suis le meilleur batailleur de ma paroisse. J'ai entendu dire qu'il y avait un dénommé Pierrot qui se disait aussi le meilleur de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu. Je veux le voir!»
[Voir l'image pleine grandeur]

Un paroissien est allé chercher Pierrot et l'a présenté au gars de Cabano. Celui-ci a dit:
- «C'est toi le boulé de la place? Hé bien, approche si t'as pas peur!»
Notre grand Pierrot s'est approché et lui a serré la main en lui disant:
- «Je suis fier de voir un brave venir nous visiter. Je veux que tu sois mon ami.»
L'étranger lui a répondu:
- «On va demander au monde s'ils veulent nous faire de la place et on va arranger ça.»
Pierrot a répondu:
- «Là, on va aller à la messe, après on décidera quoi faire.»
Puis, à la sortie de l'église après la messe, Pierrot a dit au gars:
- «Si tu tiens absolument à te battre, tu vas me signer un papier comme quoi tu ne me tiens pas responsable de ce qui peut t'arriver.»
Après les signatures d'usage, les deux hommes se sont donné la main. Puis Pierrot lui a dit:
- «Attaque le premier, et moi je me défendrai!»
Il se défendait à coups de pied; il lui en a administré un en plein estomac et il ne s'est pas relevé. En moins d'une heure, le gars de Cabano était mort, l'estomac défoncé.
Pierrot Rioux a décidé de partir. Il s'est pris un lot dans les limites à bois de la compagnie Fraser, aux alentours de Notre-Dame-du-Lac.
Dans ce temps-là, la hache faisait le permis. Ça veut dire qu'un homme se bûchait un espace, se logeait un camp et il était chez lui. C'était la loi du gouvernement. Cependant, la compagnie Fraser avait un droit de coupe de bois pendant deux ans.
Notre Pierrot vivait le vrai bonheur. Il aimait cette vie calme, pas de chicane, pas de bataille. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Un matin, il a entendu bûcher. Il est allé voir. Il y avait des bûcheux dans sa talle, chez lui. Notre Pierrot a dit aux hommes:
- «Ici c'est mon lot, c'est mon bois, c'est chez moi. Je suis dans mon droit et je suis bien décidé à faire respecter ma propriété.»
Les bûcherons sont partis dire ça au jobber. Le boss a dit:
«Vous avez peur? Y'a ti icitte des hommes? Bon c'est le temps de me montrer ce que vous savez faire!»
Le lendemain matin, quatre gars sont partis bûcher sur le coteau du lot à Pierrot. Celui-ci est venu dire aux bûcherons:
- «Je ne veux pas entendre un seul coup de hache parce que ça va mal aller. C'est mon dernier avertissement!»
Face à la démarche de cet homme et devant une telle détermination, les bûcherons ont sacré leur camp! Très en colère, le boss a de nouveau défié ses hommes:
- «Y'a ti icitte du monde qui ont pas peur de leur ombre?»
Après un long silence, un homme s'est levé et a dit:
- «Moé, pis ma gang, on n'a pas peur, pis on va y aller bûcher là!»
Le lendemain, quand de nouveau les quatre bûcherons se sont installés et ont commencé à bûcher, Pierrot les attendait. Il a pris sa carabine, l'a épaulée et a tiré, tuant du coup un des bûcherons. Les autres se sont sauvés et sont retournés au camp.
Réalisant qu'il venait de tuer un homme, Pierrot Rioux s'est dit:
- «Je suis fini. Astheure, je vais être poursuivi! Je vais me sauver du côté américain dans le Maine.»
Il a marché une journée et demie. La police à ses trousses, suivait ses traces. La deuxième journée, un des policiers a aperçu notre homme, assis sur une souche, fumant une cigarette. Le policier s'est approché et là sans émettre d'avertissement comme quoi Pierrot était en état d'arrestation, il l'a abattu comme on abat un chien.
Ainsi s'est terminée la vie de notre grand athlète, Pierrot Rioux.
Ti- Blanc Criquet
Mon père avait vendu une charge de patate: le problème, c'est qu'il fallait monter ce voyage dans les chantiers situés à 25 milles de chez nous.
Nous, on restait à la Société de Saint-Jean-de-Dieu et le camp aux alentours du lac Bellavance dans les limites de la compagnie Price-Brothers.
Monsieur Alphonse Couturier était le jobber. Mon père m'a regardé et il a dit:
- «Toi Victor, t'es bon pour faire le voyage. Tu vas atteler la Grise puis tu vas coucher là et tu soigneras la jument comme il le faut.»
On a trié les patates puis le lendemain matin je me suis mis en chemin. Avec une charge de patates, il ne faut pas arrêter longtemps parce que les patates gèlent. Je suis arrivé au camp vers les 4 heures et j'ai déchargé mon voyage puis j'ai rentré les couvertures dans le camp et là, il était le temps de manger. J'ai pris une place à la table pis un gars est arrivé et m'a dit:
- «T'es à ma place mon p'tit christ.»
Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'un monsieur m'a dit:
- «Reste là toi, tu es mon chum et lui, y est mieux de filer doux, si non, c'est à moi qu'il va avoir affaire.»
Après, on est revenu dans le camp puis il m'a dit:
- - «Si tu veux, on va étendre les couvertes par terre et on va coucher ensemble.»
J'ai dit oui, je n'avais pas le choix. Il s'appelait Maliger Sirois. Mon sauveteur était un homme de 6 pieds et devait peser quelques deux cents livres. On s'est couché puis on a dormi comme des compères. J'ai pas été dérangé de la nuit. J'ai été déjeuner pis j'ai attelé la Grise. J'avais pas 3 milles de fait que j'ai entendu crier:
- «Arrête un peu!»
Maliger Sirois sort du bois et me dit:
- «Tu vas descendre mes chevreuils chez nous. J'ai peur de me faire prendre.»
- «J'ai peur de me faire prendre!» que je lui ai dit.
- «Pas besoin d'avoir peur, ça sera pas long, je vais lever tes couvertures et je vais te les coucher dans le fond de la traîne.»
Ça n'a pas été long que 5 belles bêtes étaient allongées dans mon traîneau. Puis il m'a dit:
- «Pour te payer, t'en garderas un, le plus gros. Les autres, tu les déposeras dans mon hangar.»
C'est à ce moment que j'ai connu Ti-Blanc Criquet. Tout le monde le connaissait sur ce nom-là.
Je veux vous en parler de Ti-Blanc Criquet. Un homme d'une force herculéenne mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant environ cent soixante-dix livres. Souple comme un chat, vaillant, plaisant à l'ouvrage, toujours prêt à rendre service. J'ai travaillé avec lui quelques semaines dans le bois. Pour charger un gros billot, il disait:
- «Viens m'aider, on va charger mon bout ensuite on ira charger le tien.»
Il était capable de le charger seul, une manière de ne pas me faire savoir qu'il était plus fort que moi.
Un dimanche, il a dit au monde qui était sur le perron de l'église:
- «Moi, je peux tirer sur une longueur de 100 pieds, 1000 livres de farine dans une traîne glissée sur le planche, tout d'un trait sans m'arrêter.»
Le monde lui disait:
- «Es-tu fou? C'est la charge d'un cheval!»
- «Êtes-vous prêt à me le payer le 1000 livres de farine?»
- «Oui, oui.», de répondre les plus fortunés.
Après le dîner, on a chargé le fardeau en question: 10 poches de 100 livres et mon Ti-Blanc s'est attelé à la charge. Non pas sans avoir lâché plusieurs grands cris à en faire trembler un peu beaucoup tout le monde. Il avait de grosses lanières de cuir pour soulever le devant de la traîne et il a fait les 100 pieds comme il avait dit. Il venait de gagner assez de farine pour un an. Il était fort comme un cheval! C'était vrai!
Chez le marchand général des fois, il y avait des discussions puis quand ça chauffait fort, mon Ti-Blanc n'avait qu'à lâcher un de ses cris que tout le monde avait peur de répliquer. Ça finissait là, Ti-Blanc avait parlé.
Une fois, c'était vers le mois de décembre, Ti-Blanc disait qu'un humain était plus toffe qu'une bête. Il a dit:
- «Je suis capable de pogner un chevreuil à courir.»
- «Jamais de la vie!» disaient ses chums.
- «Je peux vous le prouver.»
[Voir l'image pleine grandeur]

Ils ont gagé 25.00 piastres puis il a parti du ruisseau Chaud de Saint-Médard, le matin de bonne heure vers les 6h30. Il faisait clair déjà et à 5h00 du soir, il a sorti par la route du bois à Saint-Jean-de-Dieu. Il avait capturé un buck. Il lui avait passé une corde dans une branche du panache. Il venait de gagner 25.00 piastres, donc 25 jours d'ouvrage ou l'équivalent.
Une autre fois, il a gagé 10 piastres qu'il pouvait monter de Trois-Pistoles une petite traîne avec 100 livres un cheval avec 1000 livres. Et je vous dis que le cheval ne me baverait pas dans le cou. Là aussi, il a gagné son pari. Seul Ti-Blanc pouvait faire pareils tours de force. Il était le numéro un de Saint-Médard.
Jos Guérette
L'histoire que je vais vous raconter s'est passée autour des années cinquante, sur la Côte Nord, à Forestville plus exactement.
Jos Guérette vivait là, heureux, entouré de sa femme Rosa-Rose et de leurs quatre enfants, deux garçons et deux filles, âgés de quatre à onze ans.
Jos Guérette était un homme simple, vaillant et bon vivant. Bûcheron, il était aussi le violoneux de son coin de pays. Ce qui, en ce temps-là, lui procurait une réputation peu commune. Il était ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de «grande vedette». Pas une noce, pas une fête n'était complètement réussie sans la présence de Jos, le violoneux.
Jos était aussi un bon conteur, sensible et imaginatif. Ses contes étaient loin de faire «dormir débout» son auditoire.
Mais tout ça, ça fait pas vivre son homme... On était déjà au début de l'automne et il fallait bien s'appareiller à r'monter dans le bois pour l'hiver.
Sauf que cet automne-là, Jos avait de la misère à se décider à partir.
- «Ça me coûte de vous laisser mes enfants.»
- «Je vais m'ennuyer de vous autres!»
- «Et toi aussi, ma belle Rosa-Rose. Je suis bien obligé d'aller gagner de l'argent pour faire vivre ma chère famille! Faut bien faire des sacrifices pour ceux qu'on aime!»
Puis il a pleuré à chaudes larmes, pour la première fois de sa vie. Parce qu'un vrai homme, ça pleure pas.. Comme vous le savez... Sa femme était tout à l'envers!
Puis il a rangé ses outils: la faux, le broc, le râteau, l'égoïne, la pelle, etc. Il a ramassé son siau, son godendart, sa hache, il a ramassé «sa poche» pis son violon et il est parti les yeux pleins de larmes après avoir fait une dernière caresse à sa femme et à ses enfants.
Dans le bois, Jos disait à ses chums:
- «J'sais pas ce que j'ai?... J'me sens pas comme de coutume... J'file un mauvais coton... on dirait!...»
Peu à peu, Jos s'est remis à l'ouvrage. Il a repris son rythme. Le soir, il jouait du violon ou de l'égoïne pour désennuyer les gars du camp. Même s'il jouait avec moins d'entrain que de coutume, y avait pas son pareil pour interpréter les reels du mon oncle, de Ste-Anne, du pendu, du diable, des petits sauvages, le money must, la gigue à Victor, la gigue à Ouellet, etc, etc.
Les jours passaient, tous pareils. Finalement, arrive la semaine de Noël. Notre Jos a reçu une invitation pour aller jouer du violon dans un camp voisin.
Le matin du 24 décembre, notre homme s'est habillé, a mis son violon et son archet dans sa boîte, a enveloppé tout ça dans une vieille poche d'avoine, l'a attachée sur son dos et est parti pour le camp en question situé à 7 milles de distance par le tow path.
À cause de la neige lourde et abondante, la marche était très difficile dans le sentier. Jos calait jusqu'à la fourche. Alors, il a décidé de prendre un raccourci et de piquer tout drette vers le camp voisin. Contournant les arbres, évitant les branches, je ne suis pas sûr qu'il raccourcissait sa marche.
Environ cinq milles plus loin, Jos a entendu des loups hurler. Après un premier frisson dans le dos, il s'est dit:
- «Je dois être fatigué, j'entends des voix! Les loups n'attaquent pas les hommes!»
Mais plus il essayait de se convaincre du contraire, plus les bêtes lui semblaient proches. Il s'est dit:
- «C'est parce que le temps est écho...»
Il s'est assis pour boire et pour manger une croûte de pain qu'il avait glissée dans sa poche avant de partir.
Là, il a cru voir une tête de loup à travers les branches d'un sapin. Comme il commençait à faire brunante, il s'est approché pour voir... c'était bien des pistes de loups.
Jos Guérette marcha encore un peu en pensant à sa chère Rosa-Rose et à ses beaux enfants. Se sentant surveillé, entouré et suivi, Jos s'est mis à marcher plus vite puis à courir.
En courant ainsi, Jos arriva près d'une shed où on entassait du foin destiné à nourrir les chevaux qui halaient le bois. Il monta sur le toit. Le toit était construit avec une sorte de rondin de bois recouvert en papier noir. Et là, Jos constata qu'il n'y avait pas un, mais deux loups, puis cinq, puis dix loups. Toute une meute en fait! Les jambes de Jos passèrent à travers du papier noir et ça donnait la chance aux loups de lui mordre les bottes. Il a allumé une écorce de bouleau, les loups ont eu peur et se sauvés pour revenir plus nombreux par la suite.
[Voir l'image pleine grandeur]

Alors, Jos a sorti son violon et avec son archet, il a donné un grand coup sur la chanterelle. Les loups sont partis en hurlant de plus belle et ils sont revenus encore. Jos a recommencé son jeu avec plus ou moins d'effet Les loups s'éloignaient à peine. Alors, malgré ses doigts gelés qui lui faisaient déraper quelques notes, Jos a entamé le réel de Ste-Anne. Plutôt que comme une gigue, Jos l'a joué comme une prière. Les loups ne sont pas fous, ils n'ont pas dansé... Ils ont attendu tranquillement mêlant leurs hurlements à la lune naissante.
Alors Jos s'est dit:
- «Mes heures sont comptées.»
Il a sorti un petit crayon et sur son livret de papier à cigarette, il a écrit ceci:
«Je vais mourir, je serai la nourriture des loups. Déjà, ils ont commencé à mordre mes bottes, mes pieds sont gelés, ils saignent... je crois que je ne pourrai plus tenir longtemps. Ma chère Rosa-Rose, mes chers enfants, je vous aime beaucoup. Je vous demande de rester unis entre vous comme vous l'êtes dans mon cœur.»
Jos a placé le livret de papier près du chevalet, dans une des ouïes de son violon.
Il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là... Donc, au bout d'une semaine, comme Jos Guérette n'était pas de retour au camp, ses chums sont partis à sa recherche. Ils ont retrouvé ses bottes, des morceaux de linge encore souillés de sang éparpillés autour des arbres... Le violon était resté accroché au toit de la shed à foin avec son précieux contenu: le livret de papier à Jos.
Cette tragédie a surpris tout le monde. Sa femme et ses enfants ont eu bien du mal à s'en remettre.
Pour ma part, chaque année lorsque arrive la semaine de Noël, je repense à Jos Guérette.
Contes fantastiques
L'Ile Maudite
C'est l'histoire de Rodrigue Bras-de-Fer. Rodrigue était un bon gars, un bonjack que tout son entourage aimait. Solide, travaillant, il maniait la hache et le sciotte comme pas un. Rodrigue avait aussi un exceptionnel don: il était fort comme c'est pas possible. On dit fort comme un bœuf mais avec lui, c'est le bœuf qui prenait son trou. Un don de cette catégorie peut facilement devenir une calamité lorsqu'il est utilisé à mauvais escient. Il ne cherchait pas le trouble mais c'est christ, le trouble était toujours collé après lui. Il y en avait toujours un pour venir le braver et essayer de faire mordre la poussière au célèbre Bras-de-Fer. Il n'était pas malin mais mettons qu'il n'aimait pas se faire piler sur la grosse orteil.
Ainsi il avait eu plusieurs démêlés avec la justice si bien qu'un jour, un juge lui ordonna de ne plus jamais se battre à main fermée, il ne pouvait plus se battre à coups de poing. On ne lui donnait pas de peine plus sévère car il était aimé de tous et ce n'était pas lui qui se mettait dans des situations de bagarre.
Au cours des années qui suivirent, il s'efforça de garder la paix. Il tentait de calmer les esprits de ceux qui voulaient le tester et tournait le dos à ceux qui ne voulaient rien savoir. Pour lui, pas question de se battre et de désobéir au juge. Il ne voulait pas faire du bagne ou se retrouver sur l'échafaud. Mais un jour, il dut se battre, il dut défendre sa vie et celle de sa femme. Il donna un coup de poing dans l'estomac de son agresseur. Le gars est tombé comme une poche, raide mort. Grosse marde! Un meurtre, c'est la pendaison assurée. Il arrive devant le juge.
- «Tu m'as pas écouté, je t'avais dit de ne plus te battre à coups de poings. Je n'ai pas le choix de sévir mais comme tu as des circonstances atténuantes je vais te donner le choix. Le Gibet ou un an et un jour sur l'île Maudite. De toute façon le résultat sera le même, personne n'est jamais revenu vivant de l'Ile du Diable.»
Comme de raison, Rodrigue choisit l'île sinon il n'y aurait plus d'histoire. Et le voilà parti pour un an et un jour. Pour son périple, il apporta divers objets: des cannages, des semences pour le jardin, des pièges, une hache, des raquettes, trois bouteilles de vin ainsi que son chien Guido, permission spéciale du juge.
Rodrigue coula, si l'on peut dire, des jours heureux sur l'Ile Maudite. Il vivait du fruit de sa chasse et de ses cultures. Sur l'Ile, il y avait une petite cabane aménagée pour les punis qui avait eu comme Rodrigue le choix entre la mort et ... la mort. Rodrigue était si bien qu'il se demandait en quoi ce séjour était une punition.
Puis, au bout de... je dirais 9 mois, un soir à la brunante, son fidèle chien Guido se mit à siler, à trembler, à brailler de peur. Il avait les oreilles couchées sur le corps et la queue entre les deux pattes. Il semblait vraiment terrifié. Rodrigue, peur de rien, sortit pour voir ce qui se passait dehors. Ce qu'il vit le glaça de terreur. Il y avait un homme en fuite. Ça ressemblait autant à un ours qu'à un homme. Il se tenait à la lisière du bois à environ un arpent du shack.
L'homme semblait couvert de fourrure et devait bien mesurer 10 pieds. Il avait les oreilles qui lui tombaient jusqu'aux épaules et ses yeux renvoyaient un étrange éclat rougeâtre dans la lumière de la lune naissante. Une mystérieuse fumée semblait lui sortir du nez et de la bouche.
[Voir l'image pleine grandeur]

L'homme ou la bête, semblait se diriger vers la cabane mais lorsqu'elle vit Rodrigue, elle revint sur ses pas et s'enfonça dans le bois. Rodrigue a vraiment eu la peur de sa vie. Il a fait au moins six pouces de trace dans ses shorts. Il rentra aussitôt dans la cabane et s'y barricada. Il entassa devant la porte tout ce que contenait la cabane. Puis, il s'assit sur son bed et entama une bouteille de vin qu'il eut vite fini et commença la deuxième qui ne dura pas plus longtemps. Guido lui ne cessait pas de se plaindre et avait toujours une peur d'enfer.
Vers les 11 heures, Rodrigue commença à entendre gratter autour du shack. Il ne savait plus si c'était la bête qui était revenu ou si c'était son état d'ébriété avancé qui lui jouait des tours. Puis, des coups commençaient à se faire entendre d'abord faiblement puis avec tellement de force que la cabane en tremblait sur ses bases. Rodrigue était paralysé par la peur et par le gallon de vin qu'il avait ingurgité.
Chaque coup lui résonnait dans la tête comme un coup de masse. Puis il tomba sans connaissance tellement il avait peur et était ivre.
Rodrigue ne se rappelle plus de ce qui se passa ensuite. Il ne reprit vraiment conscience que lorsque les autorités vinrent le chercher après qu'il eut purgé sa peine. Les gendarmes trouvèrent Rodrigue inconscient sur son lit, amaigri par le manque de nourriture. Son chien était à l'agonie sur le plancher, il avait jusque mangé la babiche des raquettes et le cuir des bottes de son maître tellement il avait faim.
On ignore pourquoi la bête épargna Rodrigue ce soir là mais toujours est-il qu'il fut le premier et le seul à revenir vivant d'un séjour sur l'île Maudite. Bien que j'ignore totalement où cette fameuse île se trouve, je ne souhaite à personne d'y être un jour conduit. Alors les fortes têtes et les batailleurs, modérez vos transports.
La légende des Trois conseils
L'histoire que je vais vous raconter me vient de mon oncle Charles, le frère de mon père et le grand-père de Victor-Lévis Beaulieu, l'écrivain que vous connaissez tous ici à Trois-Pistoles.
Il était une fois, un homme appelé Paul, sa femme Jeanne et leurs trois enfants: un garçon de 15 ans et deux filles de 9 et 7 ans. Ils vivaient pauvrement dans une petite maison de deux pièces en bois rond, située non loin d'un village nommé Esprit-Saint, quelque part dans le Bas-du-Fleuve, près d'un ruisseau qui leur fournissait de la belle truite rouge. Ils n'avaient qu'un petit lopin de terre cultivable, ce qui leur permettait tout juste de posséder deux vaches, quatre moutons, une portée de petits cochons, tous entassés dans une vieille étable.
Les parents rêvaient de s'agrandir, de se loger dans une maison convenable, de faire instruire leurs enfants, mais à vrai dire, leurs moyens financiers ne leur permettaient pas de voir le jour où ils pourraient se sortir de leur misère.
Dans le coin, on parlait d'un homme à l'Isle-Verte qui avait besoin d'un bon travailleur. Il promettait un salaire de trois cent piastres par année pour un contrat de trois ans, à plein temps, sans sorties, sans vacances. Malgré l'éloignement et les conditions, dans ce temps là, neuf cents piastres pour trois ans, c'était une vraie mine d'or.
Paul et Jeanne s'aimaient beaucoup et formaient une famille très unie. La proposition de cet employeur était alléchante, mais trois ans sans se voir, c'était un tour de force quasi impensable pour eux et ils oublièrent cela.
Cependant, à la fin de l'été, une tornade arracha le toit de la grange et dévasta une partie de la récolte. Paul organisa une corvée avec ses voisins pour rafistoler la grange. Mais endetté et découragé, le couple était au bord du désespoir.
Alors Jeanne dit à Paul:
- «On n'a plus le choix, tu vas aller travailler chez le monsieur en question. On va s'ennuyer à mourir, mais quand tu reviendras, on sera en mesure de faire vivre nos enfants convenablement, de les faire instruire et de vivre heureux le reste de notre vie. De mon côté, je te promets de te rester fidèle.»
Après un long silence, Paul a répondu:
- «Moi aussi je suis capable de te rester fidèle, ma chère Jeanne! Fais-moi un sac de galettes, je vais prendre le chemin de l'Isle-Verte demain matin. Je serai trois ans parti, mais je te promets que je reviendrai et on sera heureux ensemble, comme au premier jour de notre mariage.»
Le lendemain matin, au levé du jour, Paul a pris le chemin vers l'Isle-Verte. Jeanne et les enfants sont allés le reconduire au bout du sentier, jusqu'à la grande route. Après les accolades, Paul a fait un signe de croix de la main comme pour bénir sa famille.
Il faisait beau et il neigeait à peine. Paul était un bon marcheur, à raison de vingt milles par jour, il avait évalué son voyage à une semaine de marche. Or, cinq jours plus tard, Paul arrivait au deuxième rang de l'Isle-Verte chez l'employeur en question. Celui-ci s'appelait Martin L'Ermite et portait bien son nom parce qu'il était un genre d'intendant qui s'occupait de subvenir au ravitaillement, à l'entretien et à la sécurité (relative) d'un groupe d'ermites dispersés au cœur d'une vaste étendue de forêt.
Après quelques mots de bienvenue et une visite du centre de ravitaillement, Paul fut rapidement initié à son nouveau travail. Entre autres, celui-ci consistait à parcourir, tous les quinze jours, un vaste labyrinthe de sentiers en forêt lesquels conduisaient à chacun des ermites.
Ceux-ci vivaient dans des cabanes en bois rond ou dans des espèces de huttes faites de pierres et de terre glaise et recouvertes de branches d'épinette.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les ermites avaient la réputation de vivre de prières et d'air pur. En réalité, ils allaient chercher l'eau à une source naturelle, s'alimentaient de fougères, de têtes de violon, d'oseille, de champignons, d'ail des bois, et de divers fruits sauvages: fraises, framboises, bleuets, merises, cerises à grappe, mascowc, prunes sauvages, mirabelles jaunes, noisettes, gomme d'épinette, etc.. Ils mangeaient aussi des sauterelles et pêchaient la truite à l'occasion.
Pour l'hiver, Paul et Martin s'assuraient que chacun ait une provision de nourriture de base: une jarre de lard salé, des patates, carottes, navets, et un fanal avec une réserve d'huile de charbon, des allumettes et du bois de chauffage si le moine n'était pas en mesure de s'en ramasser. Ils s'assuraient aussi que chacun des ermites ait une hotte de paille pour se coucher, des couvertures de laine et une pièce d'étoffe pour qu'ils se confectionnent une bure chaude. Il leur apportait aussi des pichous neufs, des raquettes et de la babiche.
Chacun des moines ermites se faisait un devoir de laisser un message à la porte de sa cabane ou de le clouer sur un arbre à proximité:
[Voir l'image pleine grandeur]

S'il n'y avait pas de message, on entrait dans la cabane et on partait à la recherche de l'ermite.
Ainsi passaient les jours, les semaines, les mois et les années... Paul arrivait à la fin de son contrat de trois ans, À cinq jours du terme, Martin reçu la visite d'un pedleur juif, un genre de colporteur itinérant. Martin lui acheta des étoffes, de la laine et du fil.
Puis comme il se faisait tard, le commerçant demanda à coucher. Le lendemain matin, après un copieux déjeuner, il s'apprêtait à partir. Martin s'informa de la direction qu'il prenait:
- «Je m'en vais du côté de Saint-Jean-de-Dieu, j'ai des bons clients là-bas. Après, ça dépendra de la température et de l'état des routes.»
Alors, Martin dit à Paul:
- «Il te reste cinq jours de travail avant la fin de ton contrat, mais comme tu m'as tellement bien servi, on va dire que tes trois ans sont terminés. Je vais te régler ce que je te dois.»
Et Martin remit neuf cents piastres à Paul et ajouta:
- «Tu vas partir avec le commerçant qui s'en va de ton côté, comme ça tu n'auras pas à marcher toute cette route-là à pied.»
Paul était fou de joie! Il ne portait pas à terre!
Pendant que Paul rapaillait ses affaires et faisait son pack-sac, Martin lui dit:
- «Si tu veux me donner cent piastres, je vais te donner un conseil.»
Surpris, Paul a dit:
- «O.K.»
1 er conseil:
- «Ne laisse jamais un vieux chemin pour un neuf!»
Paul a répondu:
- «C'est payer cher, mais je vais suivre votre conseil.»
Puis après quelques minutes, Martin lui a dit:
- «Si tu veux me donner un autre cent piastres, je vais te donner un autre conseil.»
Paul ne savait plus sur quel pied danser tellement il se sentait mal à l'aise...
- «O.K. vas-y!» répondit-il.
2 ieme conseil:
- «Remets toujours ta colère à demain!»
Paul n'était pas trop content. Alors Martin lui a dit:
- «Si tu me donne un autre cent piastres, je te donne un dernier conseil!»
- «Envoyez donc!... tant qu'à y être!» répondit Paul, déçu.
Alors Martin s'est levé, est passé dans la cuisine et en a rapporté un gros pain doré décoré comme une bûche de Noël, puis il a dit à Paul:
3 ième conseil:
- «Ce pain, tu le mangeras avec tes meilleurs amis seulement!»
Paul a répondu:
Puis, il a vu sa femme, sa Jeanne courir au devant d'un jeune homme et l'embrasser chaleureusement. Choqué, Paul a ramassé sa carabine et l'a épaulée. Il allait peser sur la gâchette quand le deuxième conseil de Martin L'Ermite lui est revenu à l'esprit: «Remets ta colère à demain!»
Paul a rengainé, puis s'est approché de sa maison et là, il a reconnu le jeune homme: c'était son propre garçon. Tout en larmes, Paul a dit:
- «Merci mon Dieu d'avoir mis Martin sur ma route. Sans lui, j'aurais pu tuer mon propre fils!»
Puis il est entré dans la maison sous les cris et les acclamations de sa femme et de ses enfants.
Le souper était déjà sur la table, son couvert déjà mis, comme avant.
- «Tu m'attendais?» dis Paul en regardant sa femme.
- «Je t'ai attendu tous les jours mon amour!» répondit-elle.
Au moment du dessert, Paul a sorti le pain doré décoré en bûche de Noël et a demandé à son gars d'en couper des tranches pour chacun.
- «Papa, il y a quelque chose de dur dans cette bûche-là!» dit le garçon.
En effet, à l'intérieur il y avait une petite boîte en bois contenant les trois cents piastres payées à son boss Martin L'Ermite pour ses précieux conseils.
Paul était au comble du bonheur! «Voilà tout le nécessaire pour faire instruire chacun de nos enfants, hein Jeanne!»
Après ces chaleureuses retrouvailles, Jeanne s'est retrouvée enceinte et neuf mois plus tard, elle a donné naissance à un beau petit garçon qu'ils ont nommé Martin en souvenir de Martin L'Ermite, le généreux employeur de Paul.
Le Lion à quatre pattes rouges
Il était une fois, un jeune garçon aux cheveux roux. Un peu bohème et parfois dans la lune, Léo se promenait souvent et chantait toujours:
- «La-la-la-la-lère, c'est moi le roi de la rivière, Ron-ron-ron-ron-ron, c'est moi le roi de la maison!»
Un jour par mégarde, Léo marcha dans la plate-bande d'une sorcière et de plus, il renversa son chaudron de potion. Bleue de colère, la jeune sorcière lui donna un coup de balai en lui criant:
- «Toi pis tes gros sabots rouges, tu seras désormais un...»
Et le jeune garçon fut transformé en chat?... Non! en lion! Un lion à quatre pattes rouges! Et la sorcière ajouta:
- «Tu seras délivré de ton sort le jour où quelqu'un t'aimera assez pour prendre ta place! En attendant, tu peux toujours chanter: Y-Ya-Yo, c'est moi le roi des animaux.»
[Voir l'image pleine grandeur]

Et la sorcière disparut dans un éclat de rire.
Pendant ce temps, dans le nouveau continent, au Royaume du Saguenay, vivait un jeune homme de seize ans appelé David.
Avec sont teint ensoleillé, ses cheveux châtain clair légèrement ondulés, et ses yeux bleu-vert ou pers, je dirais même «pers vert»; il était beau à s'en confesser. De plus, David avait une voix douce et mélodieuse et un sourire à vous chavirer le cœur. Toutes les femmes en étaient amoureuses. Même les vieilles le trouvaient charmant, ce qui faisait dire à sa grand-mère taquine:
- «C'est pas parce que t'as de la neige sur le toit, qu'il n'y a pas de feu dans la cheminée!»
David semblait indifférent à ces compliments. Toutefois, cela n'était pas sans lui attirer les railleries des ses frères jaloux et des autres jeunes garçons des alentours. Mais David ne s'en offusquait pas outre mesure; il avait l'habitude de se sentir à part des autres et dans le fond, cela faisait son affaire. Ça lui laissait du temps pour rêver à sa blonde et imaginer sa vie avec elle.
Mais oui! David était follement amoureux d'une ravissante jeune fille de quatorze ans du nom de Julienne mais qu'on surnommait Julie. Ils passaient tous les dimanches ensemble. Souvent, David et Julie se rencontraient au bord du Lac St-Jean pour pêcher, se baigner, faire un pique-nique et simplement se regarder et s'aimer.
Mais l'endroit préféré de nos deux amoureux était un espace sauvage dans l'anse du Saguenay, à l'ouest de la rivière Éternité. Ils y avaient aménagé une petite cabane en bois rond. Là, dans les bras l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, David et Julie se juraient un amour éternel. En gage de fidélité, ils s'étaient échangés des cailloux dorés ramassés aux abords de la rivière Éternité.
[Voir l'image pleine grandeur]

Un dimanche matin après la messe, comme d'habitude, David se rendit chez sa bien-aimée. Le père ouvrit la porte et lui dit:
- «Julie est partie travailler chez une de ses tantes. Vous avez fait des cochonneries ensemble, tu ne la reverras plus!» Et il lui claqua la porte au nez.
Anéanti, David s'écrasa au pied du perron et pleura toutes les larmes de son corps, jusqu'à ce que le père lance son chien après lui pour le chasser de la maison.
David repartit le cœur en lambeaux. Il ne pouvait pas croire que sa bien-aimée l'avait quitté. Leur amour était si fort que rien ni personne ne pouvait les séparer.
David retourna à leur cabane au bord de la rivière Éternité. Sa belle Julie n'y était pas. En appelant sa blonde de toutes ses forces, il repartit en courant à travers les champs et les bois. Il courut et marcha et marcha... jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement en travers d'un chemin de twitch.
Le lendemain, un homme qui passait par-là, trouva David à demi-mort. Il le releva, lui donna à boire, le fit monter sur sa jument et l'amena dans son village. Sa femme le lava et le soigna avec la tendresse d'une mère. Au bout de quelques jours, David avait repris des forces et il raconta son histoire. La femme était émue et très empathique à son malheur.
Cependant le soir même, quand son mari rentra de sa journée de travail, David, sa petite pierre dorée à la main, s'adressa à lui en disant:
- «Vous êtes un génie, aidez-moi à retrouver ma fiancée! Sans elle, la vie m'est insupportable et je préfère me laisser mourir!»
À la fois embarrassé et fier d'être considéré comme un génie, l'homme fit un clin d'oeil à sa femme et répondit au jeune homme:
- «Écoute David, je ne peux pas réaliser ton souhait! Les peines d'amour ne peuvent pas être soignées par un génie! Laisse-moi réfléchir et je vais voir comment je peux t'aider!»
Et l'homme disparut avec sa femme... dans le jardin... Sa femme dit:
- «Y t'prend pour un génie? Y'é un peu fêlé le jeune!»
Son mari lui répondit en riant:
- «David n'est pas si fou que ça! Il a raison, je suis un génie!»
Sa femme répliqua avec fermeté:
- «En tout cas, si tu pars dans le chantier demain comme prévu, y'é pas question que tu me laisses seule avec c'te malade là. Je l'aime bien là, mais on sait jamais ce qui peut arriver avec des gens de même. C'est trop de responsabilités pour moi. Tu l'amènes avec toi, un point c'est tout!»
Le lendemain, pendant que sa femme préparait ses bagages, des vêtements chauds pour son mari et David, ainsi qu'un panier de provisions pour chacun, l'homme monta réveiller le jeune.
En l'apercevant, David s'écria:
- «Génie, vous m'avez pas oublié?»
Encore plus mal à l'aise que la veille, l'homme lui remit une boîte contenant trois gros œufs blancs et un petit œuf noir.
- «Les œufs blancs serviront à calmer ta faim si tu es mal pris. Quant à l'œuf noir, tu t'en serviras pour délivrer ta blonde.»
- «Comment ça?» demanda David.
- «Ta fiancée est prisonnière d'un géant. Pour la délivrer, le seul moyen que je connaisse, c'est de prendre le petit œuf noir et de l'écraser entre les deux yeux du géant.»
Et le génie disparut... à l'étable. Pendant qu'il attelait les chevaux, l'homme se disait:
- «Ma femme a bien raison, je ne peux pas laisser ce jeune garçon ici.»
Et après les adieux d'usage à sa femme, l'homme partit avec David. Ils voyagèrent pendant quelques jours, puis arrivèrent dans un des chantiers du Maine aux États.
David dit alors à l'homme:
- «Vous m'avez sauvé la vie et je vous en suis très reconnaissant. Je ne vais pas rester avec vous plus longtemps. Il faut que je retrouve ma fiancée. Grâce à vous, j'ai repris espoir et je serai assez fort pour traverser tous les obstacles!»
Et sans plus de manières, David ramassa son baluchon et partit en sautillant à travers la forêt, laissant l'homme bouche bée. Même s'il n'était pas un génie au sens magique du terme, c'était un sage à sa manière. Il se dit:
- «Les choix que l'on fait ne sont pas une chance que l'on prend, ils déterminent notre destinée.»
Et levant la main, il cria à David:
- - «Va où ton cœur te porte, mon grand!» et l'homme continua sa route.
De son côté, après plusieurs heures de marche, assis près d'un ruisseau pour se désaltérer, David entendit un espèce de rugissement.
Effarouché et un brin paniqué, il monta dans un arbre. En regardant en bas, il vit un lion qui venait vers lui. Un drôle de félin avec une grosse tête, une belle tignasse et quatre pattes rouges.
[Voir l'image pleine grandeur]

- «N'aie pas peur! Pas besoin de te sauver! Je ne te mangerai pas!» dit le lion.
- «Un lion à quatre pattes rouges, c'est déjà assez bizarre, mais un lion qui parle, ça se peut pas!» répondit David.
- «Enlève ton déguisement et dis-moi ce que tu me veux!» ajouta-t-il.
Le lion répondit:
- «Je me suis échappé d'un cirque. J'étais tanné de monter sur des boîtes et de passer dans des cerceaux enflammés sous la menace constante du fouet, pour un bol de viande, devant une foule de spectateurs qui criaient sans cesse: Bravo! Bravo! Encore! Encore!»
David méfiant, descendit de l'arbre.
- «En quoi puis-je t'aider?» risqua-t-il.
Le lion répondit:
- «Tu vois l'orignal mort là-bas? Bien moi, l'aigle et une fourmi, on se chicane pour savoir qui va manger cette bête.»
- «C'est simple!» répondit David.
- «Dans la vie, il faut savoir partager! Toi, la fourmi, tu pourrais avoir la tête. En plus de la nourriture, elle te ferait une bonne cachette. Pour toi l'aigle, une fesse tendre serait un bon choix puisque tu n'as pas de dents. Et toi le lion, avec ton gros appétit, tu mangeras le reste.»
Satisfaits, les trois animaux décidèrent de remercier David à leur façon. Le lion lui donna un poil de sa moustache en disant:
- «Quand tu seras mal pris, tiens le bien dans ta main et prononce la formule magique...Par les vertus de
mon poil de moustache, je souhaite me transformer en lion, le roi des animaux.»
À son tour l'aigle lui remit une de ses plumes en assurant à David que:
- «Par la vertu de cette plume, tu pourras te transformer en oiseau le plus rapide au monde.»
La fourmi ne fut pas en reste. De peine et de misère, elle s'arracha une patte et dit à David:
- «Par la vertu de ma patte, tu pourras au besoin te transformer en fourmi, ce qui te permettra de passer incognito et d'avoir accès à tous les petits endroits généralement inaccessibles aux humains.»
David prit les trois présents: le poil de moustache du lion, la plume de l'aigle et la patte de la fourmi, et les déposa précieusement dans son mouchoir, près du petit œuf noir.
Avant de partir, le lion à quatre pattes rouges fit une caresse de félin sur la joue de David qui se sentit tout chaviré, comme en présence d'un beau gros chat ronronnant.
Puis, le cœur léger cette fois, David continua son voyage jusqu'à l'océan Atlantique. Là, il s'engouffra dans la cale d'un gros navire qui coula à pic lors d'une tempête tropicale près des Iles Canaries. Seul survivant à son arrivée dans l'archipel, il fut pris pour un voleur et un pirate par les Espagnols. Ceux-ci le traquèrent, le firent prisonnier puis décidèrent de le donner en pâturage à leurs chiens enragés. C'est alors que David, saisissant le poil de moustache, prononça la formule magique qui le transforma en lion à quatre pattes rouges. Tous les habitants des Iles et leurs chiens s'enfuirent et on en les revit plus jamais.
Une fois seul, encore sous le charme du lion à quatre pattes rouges, David se mit à chanter:
- «Y-Ya-Yo, c'est moi le roi des animaux! Oups, c'est bizarre ça!» se dit-il.
Il se mit à renifler à la recherche de son mouchoir contenant les cadeaux des autres animaux. Il le trouva dans les mains de Léo, le jeune garçon aux cheveux roux.
- «Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas parti avec les autres?» demanda David.
- «Merci de m'avoir assez fait confiance pour me délivrer du mauvais sort que m'avait jeté une jeune sorcière il y a bien longtemps! Maintenant, c'est toi le lion à quatre pattes rouges!» répondit Léo. Et il raconta son histoire.
Après s'être reposé, le garçon couché sur sa bedaine, toujours sous le charme du lion, David dit:
- «C'est pas sur cette île que je vais retrouver ma fiancée. Il me faut traverser la mer, mais un lion ça nage pas fort.»
Alors, saisissant la plume d'aigle, David prononça la formule:
- «Par la vertu de cette plume...»
Et il fut aussitôt transformé en oiseau, le plus grand et le plus rapide au monde.
Léo, ébahi, dit:
- «Ne me laisse pas tout seul ici, amène-moi avec toi!»
N'écoutant que son cœur, David répondit:
- «O.K! Monte!»
Le garçon grimpa sur les ailes de l'oiseau et ils s'envolèrent très haut, survolèrent le détroit de Gibraltar, puis la mer Méditerranée.
[Voir l'image pleine grandeur]

Épuisé, à bout de forces, l'oiseau atterrit sur la rive, au pied d'une montagne. Là, David repris sa forme originale et après s'être régalés avec les trois œufs blancs, lui et le jeune Léo se reposèrent jusqu'au lendemain matin. À son réveil, David constata la présence d'une drôle de fissure dans laquelle était inséré un genre de tuyau au centre de la montagne. Il grimpa au sommet, regarda à l'intérieur mais ne vit rien. Aux alentours, aucune vie perceptible, tout semblait mort.
Alors David se dit:
- «Je n'ai rien à perdre!» et saisissant la patte de fourmi, il prononça la formule.
- «Par la vertu de cette patte...»
Et il fut transformé en fourmi. S'introduisant prudemment à l'intérieur du tuyau, David découvrit une ville endormie au milieu de laquelle trônait un immense bâtiment muni d'une tour avec des fenêtres grillagées à travers desquelles il crut reconnaître le profil de sa belle Julie.
- «Oui! C'est ça!... Le génie me l'a dit! Ma fiancée est prisonnière d'un géant!» se rappela David.
Toujours sous le charme de la fourmi, David s'introduisit dans le bâtiment en passant par le trou de la serrure. Là, il entendit nettement sa bien-aimée l'appeler:
- «Dav-i-id, Dav-i-id, ...» criait-elle en sanglotant.
Son cœur fit trois tours, il voulait courir la rejoindre mais la sagesse lui recommandait la prudence. Il escalada silencieusement les douze étages de la tour et trouva sa chérie enchaînée à une poutre. David réussit à la défaire de ses chaînes et là, ils s'embrassèrent et se caressèrent. Julie expliqua à David que le géant l'avait enlevée et amenée dans ce monde immobile et métamorphosé dont il était le roi. David et Julie attendirent la nuit pour descendre de la tour. Puis, laissant Julie seule accroupie au pied du grand escalier près de la porte d'entrée, David s'introduisit dans la chambre du géant.
[Voir l'image pleine grandeur]

Celui-ci dormait en émettant des ronflements qui faisaient trembler toute la ville. S'approchant lentement, David monta sur le lit du géant. Il prit le petit œuf noir et de toutes ses forces, le projeta entre les deux yeux du géant Herculanum. Celui-ci poussa un cri épouvantable qui réveilla la ville immobile. Puis en agonisant, il vomit des larves de morve qui donnèrent naissance au Vésuve lequel crache encore sa «marde» de nos jours.
À sa sortie de la tour avec Julie à son bras, David fut acclamé comme un héros par tous les habitants de la ville. Ceux-ci organisèrent une grande fête au cours de laquelle David fut proclamé sauveur et couronné roi de Pompéi. David et Julie se marièrent durant ces festivités avec pour témoin...devinez qui? Oui! Le lion à quatre pattes rouges en personne. En effet Léo, le jeune garçon roux, avait découvert l'entrée d'une caverne bien camouflée au pied de la montagne. Il s'y était aventuré pour aider son ami David quand toute la montagne fut saisie par un tremblement de terre et une violente secousse sismique provoquée par la mort du géant Herculanum.
David, pardon... le roi David et son ami Léo, alias le lion à quatre pattes rouges, firent ouvrir le grand tunnel derrière la grotte au pied de la montagne, permettant ainsi à tous les habitants de la ville de Pompéi d'avoir accès à la mer Méditerranée.
David et Julie s'aimèrent passionnément, ils eurent plusieurs beaux enfants et vécurent heureux, aimés et respectés de tous les habitants, non seulement de Pompéi mais aussi de toute l'Europe.
Quant à Léo, en plus d'être le bras droit du roi David, son passe-temps favori était de sculpter des lions en pierre.
C'est une belle histoire, hein! Vous ne me croyez pas? Vous pensez que c'est un jeune fou de Saint-Jean-de-Dieu (hôpital psychiatrique) qui m'a raconté cette histoire-là? Bien non! Mon histoire est vraie! La preuve, si vous voyagez un brin, partout dans tous les pays d'Europe, d'Amérique et même d'Asie, observez bien... Dans la
plupart des grandes villes à l'entrée des châteaux, des maisons, ou sur les bras des escaliers, vous pouvez voir plusieurs sculptures de lions dans différentes positions. Certains sont assis, la gueule ouverte, la patte gauche appuyée sur un écusson royal et l'autre patte levée en l'air en guise de serment. Ce sont les sculptures de Léo en souvenir du lion à quatre pattes rouges.
Présentation de Jeanne et Victor
faite par Marco son fils
II y a quelques mois, j'ai reçu la mission suivante: préparer une adresse qui résume en vingt minutes les soixante ans de mariage de Jeanne et Victor... Soixante ans en vingt minutes... Dans la famille, le sens des proportions n'a jamais été notre fort. Par contre, on ne peut pas dire que le sens de l'humour ne s'applique pas à nous.
Soixante ans en vingt minutes... Ma première idée fut de charcuter au cœur même de l'épopée comme le ferait si bien un fonctionnaire du ministère de la Culture. Donc, en éliminant la vingtaine d'années de changement de couches, il ne me resterait que quarante ans à couvrir. Un peu con comme raisonnement!
S'il s'agissait seulement de vous lire leur adresse postale: Jeanne et Victor, 7, Place Parent, Saint-Jean-de-Dieu...ou Jeanne et Victor, rang de la Société Ouest, Saint-Jean-de-Dieu... ou encore Jeanne et Victor, Grande Route, Saint-Guy...
Là, je suis évidemment coincé: pas facile de résumer et d'expliquer le passage d'une villa bien établie à une toute nouvelle colonie. Partir de Saint-Jean-de-Dieu pour aller s'installer à Saint-Guy... Personnellement je me suis toujours demandé ce qui avait motivé pareille folie. C'est en interrogeant les deux principales causes de mon problème que j'ai pu en savoir un peu plus. Alors, installez-vous bien confortablement, je vais vous faire une histoire courte dans le même style que celles racontées par papa.
Fin des années trente, Victor, fort de ses 22 ans, avait un œil sur une petite terre de Saint-Guy et un autre sur une petite fille de la Société. Pour la terre, ce n'était qu'une question de formalités. Par contre pour la fille, la tâche s'avérait plus ardue. Le pire étant de convaincre le père Eugène de lui laisser sa petite Jeanne.
Un beau soir, Victor alla veiller chez les Ouellet avec la ferme intention de leur en mettre plein la gueule et d'en revenir avec une promesse de mariage. Il fallait se vendre, quitte à exagérer un peu. Debout devant Eugène et Aglaé, qui étaient sérieux comme une photo d'époque, Victor déballa son curriculum vitae: à six ans, les rubber aux pieds, le crochet à pitounes sur l'épaule et la pollock au bec, il bûchait déjà ses 2 cordes de bois par jour. À 15 ans, il dirigeait son premier chantier et terrorisait les bûcherons en leur criant:
- «Aye, les p'tits hommes! Faites d'la bel ouvrage.»
Sans prendre le temps de respirer et à grands gestes, papa décrivit Saint-Guy comme un nouveau Klondike. Tout y était plus grand qu'ailleurs: les arbres, les chevreuils, les mouches, les côtes et surtout les roches. Le père Eugène, qui en avait vu d'autres, fut impressionné par le verbiage de ce jeunot quoi qu'un peu inquiet sur la dimension des roches de Saint-Guy. Il se disait qu'en plein bois, sa discrète fille ne pourrait s'ennuyer avec un gars comme ça.
De son côté, Aglaé, qui ne perdait jamais le nord, voyait à travers ce grand parleur un futur politicien. Si Duplessis pouvait se faire élire avec sa dégaine pourquoi pas ce jeune homme... et puis, elle le trouvait bien poli, le gars à Edmond. En trois fois, il offrit ses services pour aller faire une petite attisée dans la cave, malgré un mois de mai bien avancé...
Ti-Jeanne, cachée derrière la porte, n'avait rien perdu de l'entrevue de Victor. Pour elle, c'était clair qu'il fallait une personne sensée pour tirer les ficelles de ce beau rêveur. Et puis, elle aimait bien sa façon de jouer du violon mais comme toute jeune femme, elle voulait en savoir plus sur son coup d'archet... De toute façon, le verdict des Ouellet était tombé: «Marie-le, ça presse!!!»
[Voir l'image pleine grandeur]

Les voilà donc à Saint-Guy, nos tourtereaux, bûchant, défrichant et brûlant l'abattis. Et de ce dur labeur naquirent leurs huit premiers enfants et la désormais célèbre expression: semer à la «drill» et «récolter à la dynamite».
En plus de construire deux granges, Jeanne et Victor durent bâtir une maison sur leur deuxième terre. D'apparence conventionnelle à l'extérieur, l'intérieur de cette demeure n'en demeurait pas moins à la fine pointe de l'architecture moderne. Ici régnait l'aire ouverte, le décloisonnement presque total. D'ailleurs, Jeanne et Victor n'ont jamais pu souffrir une maison mal divisée.
Nous voilà au début des années 50, en plein exode vers la banlieue. Et pour papa et maman, la banlieue de Saint-Guy, c'était Saint-Jean-de-Dieu. À vrai dire, il était assez difficile de se la couler douce au pays de la coulée Bleue.
Ils achetèrent donc la terre voisine du père Edmond, celle de Gérard à Joseph à Samuel Gagnon. Maman voyait avec cet achat, une meilleure terre, de meilleurs bâtiments, une meilleure qualité de vie quoi! Papa y voyait avant tout la proximité d'au moins quatre moulins à scie et qui dit moulins à scie dit ...bois de chauffage pour ne pas dire ... croûtes.
Mais la raison majeure de ce déménagement était avant tout économique. C'est que Jeanne et Victor, selon les méthodes du Dr. Spock, nourrissaient leurs huit premiers enfants au chocolat, denrée qu'ils faisaient monter à grand frais de la gare de Trois-Pistoles. Malgré le déménagement, ils firent leur deuil du chocolat, sauf en certaines occasions, et optèrent pour une nourriture à base de petites fraises des champs. Nous tairons ici le scandale de 200 pots de confiture volés par un membre de la famille, tout ce qu'on peut dire c'est que celui-ci a les yeux bleus.
Le retour à la Société Ouest fut également l'occasion de renouer avec la parenté et le voisinage: avec l'oncle Mothé, l'Zeuf, Roland à Ti-Simn, Varisse Leblond, le Yam d'Auteuil, Isidore Roussel sans oublier Adrien à Luc pour les cas destination; enfin, bref, des gens que tous ici présents, jeunes et moins jeunes avez évidemment biens connus...
Pendant toutes ces années, après chaque récolte, Victor préparait son bagage et partait vers les chantiers de la Côte-Nord, des Passes dangereuses ou ceux du Maine. Il en revenait pour le temps des Fêtes, amaigri, parfois blessé, et avec un tas de nouveaux amis que l'on appelle communément des poux!... Mais ces périples permettaient à papa d'accumuler suffisamment d'argent pour entretenir la marmaille pour plusieurs mois.
[Voir l'image pleine grandeur]

Après quinze années à ce rythme, Ti-Jeanne, qui devait gérer à elle seule la ferme et la dizaine d'extra-terrestres y gravitant, décida de mettre un terme aux exils de son mari en lui disant:
- «Victor, t'as assez touché de bois pour nous porter chance jusqu'à cent ans. Si on augmente notre troupeau...là je ne parle pas des enfants... on pourrait se débrouiller avec l'entreprise agricole.»
De toute façon, l'heure était au changement et la famille vécut tranquillement sa révolution. À l'origine de celle-ci la longue convalescence de papa, opéré pour soigner une hernie intestinale. Ce fut l'occasion d'introduire de nouvelles technologies à la ferme dont l'installation d'un système de trayeuse à vaches; et question de former le caractère et de mettre à l'épreuve la patience de leurs enfants, papa et maman construirent une soue à cochons avec toutes commodités exclues...
En passant, dans le cadre des festivités entourant le soixantième anniversaire de mariage de Jeanne et Victor, le musée d'art contemporain de Saint-Jean-de-Dieu organise une exposition de photos et cicatrices. C'est un événement à ne pas manquer. Pour ceux et celles qui ne pourront s'y rendre, les enfants de Victor se feront une joie de vous montrer, ce soir même, leurs balafres et séquelles d'opérations de toutes sortes. Mais je mets en garde les cœurs sensibles car certaines plaies coulent encore.
Le retour pour de bon de Victor, en ce début des années soixante, permit à maman d'alléger considérablement sa tâche. Plus de train à faire soir et matin. Elle pouvait faire la grasse matinée et ne se lever qu'à 6 heures, la chanceuse... préparer tranquillement le déjeuner pour une dizaine d'enfants, aider les plus jeunes à manger et les autres à s'habiller pour l'école, laver la vaisselle du déjeuner, faire le ménage de la maison et des chambres d'enfants, laver le linge de la dizaine d'enfants, passer à la tordeuse ce linge, étendre ce même linge, éduquer les p'tits derniers, piocher et arroser le jardin, préparer le dîner, faire manger les plus jeunes, laver la vaisselle du dîner, coucher les p'tits derniers pour leur sieste, travailler aux champs, préparer le souper, faire manger les plus jeunes, faire la vaisselle, laver les p'tits derniers et les coucher... Bref, lorsqu'il n'y avait pas de visite, maman se croyait presque en vacances.
Malgré son retour au bercail, Victor était toujours imprégné de l'ambiance des chantiers et des longues soirées passées à y parfaire ses talents de conteur. Il s'efforçait donc de recréer cette même ambiance à la maison. Le seul problème c'est que papa n'a jamais fait de distinctions entre public d'hommes mal engueulés et un auditoire de jeunes enfants. Pour lui, c'est le visa général pour tous, peu importe la violence du récit.
Jos Guérette, un de ses personnages légendaires, finissait toujours par se faire manger les tripes par la meute de loups qui lui couraient après. Et Victor ne lésinait pas sur les détails de la fin atroce et sanglante de ce pauvre homme. Sans parler des carcasses d'animaux reprenant vie, conduite pas une tête de bœuf aux yeux rouges en direction d'une cabane où les bûcherons s'amusaient à blasphémer le petit Jésus en pleine nuit de Noël. Et cette vieille fille revenue de l'au-delà pour dire à sa sœur comment l'enfer était horrible.
Nous avions à peine quatre ans la première fois que ces histoires nous sont venues aux oreilles! Couchés dans la noirceur de Saint-Guy ou celle de la Société, avec les murs qui craquent et l'imagination qui vous projette les pires scénarios, ça vous marque pour la vie! Il n'y a pas de psychopathes ni de meurtriers en série dans la famille mais on est peureux en sacrament.
Bon, je viens de parler d'imagination, ce qui n'est d'ailleurs plus aujourd'hui le lot des vingt ans et moins, trop absorbés par la télévision, les jeux vidéos et leur cri primai raté. Comme vous ne pouvez pas vous concentrer plus de trente secondes sur un même sujet, je vous ai sans doute perdu depuis un bon moment. Alors, s'il vous plaît, ceux et celles qui ont un adolescent à leur côté, vous seriez gentils de lui secouer le pommier pour le réveiller.
Si Victor nous a transmis son adresse manuelle, son imaginaire et sa langue bien pendue, en revanche, Ti-Jeanne nous a légué son esprit réfléchi, son sens de l'organisation et surtout son formidable don de la réplique. La réplique qui tue, celle qui vous laisse sur le derrière, celle qui vous fait remporter le point d'un match d'improvisation, celle que tout grand auteur cherche pendant des semaines pour finir un acte cruel. Jeanne la discrète nous a appris à ménager nos paroles sans perdre de vue la situation et à frapper fort lorsque l'interlocuteur s'en attend le moins. Rares sont les personnes qui se sont relevées d'une réplique de Ti-Jeanne et si le père Edmond était encore de ce monde, il pourrait vous en parler longtemps de sa bru à la forte tête.
C'est que grand-père s'est fait fermer la trappe par maman lors d'une certaine soirée. Avant de vous raconter cet épisode, il faut tout d'abord vous préciser que le père Edmond avait, chaque soir avant de s'endormir, l'habitude de manger des biscuits dans son lit. Revoyons la scène: Jeanne et Victor discutent de tout et de rien avec grand-mère Florence, tandis que grand-père, dans son coin, fume sa pipe et tripote distraitement d'un doigt jauni, les bonbons réservés à ses petits-enfants.
Comme Edmond commence à trouver le temps long et qu'il a hâte que Jeanne et Victor débarrassent le plancher, il lance à Florence:
- «Sa mère, prépare mes biscuits là! Pis oublie pas mon lait chaud, pis essaye de pas trop le faire chauffer c'te fois cite, pis les biscuits, mets-les dans une plus grande assiette, pis pour pas faire de graines dans le lit, oublie pas de les casser...»
Le père Edmond avait à peine terminé sa dernière phrase que Ti-Jeanne répliqua:
- «Un coup parti, grand-mère, mangez-les donc à sa place les biscuits!»
Le grand-père faillit avaler son dentier tellement il fut surpris par cet assaut et dut prendre son trou sous l'œil triomphant de Florence. Mais comme grand-père aimait les femmes qui lui tenaient tête, il pardonna à maman.
Au milieu des années 70, après la vente de la ferme, Victor alors âgé de 59 ans, se met à la recherche d'un nouveau travail. Il dénicha assez tôt une job de concierge dans un hospice pour personnes âgées. Un peu abattu, il annonça la nouvelle à Ti-Jeanne qui au contraire de son mari s'en réjouissait.
- «C'est quoi le problème Victor, tu t'es escrimé à scier des gros troncs d'arbres une bonne partie de ta vie et tu as peur d'un petit manche à balai?!»
- «Le problème Ti-Jeanne, c'est que je pense que je n'aime pas les vieux!»
Sur ce, maman rappela à papa que Saint-Jean-de-Dieu, ce n'était pas la Baie-James et qu'il devrait au moins y bosser une fois avant de sauter aux conclusions.
Après sa première journée de travail, Victor revint à la maison et déclara à Ti-Jeanne:
- «Hier, je pensais détester les vieux, aujourd'hui j'en suis persuadé.»
Bientôt Victor passa de concierge à préposé et nous ramena, après chaque nuit passée auprès de ces fossiles édentés, des récits apocalyptiques de radotages, de changements de couches, de bains et de gavages forcés.. Mais les p'tits vieux aimaient bien le jeune Victor et avec l'aide d'infirmières bien intentionnées, papa trouva le courage et la motivation pour y travailler même au-delà de sa retraite.
Pendant cette même période, papa et maman se portèrent acquéreurs d'une ancienne école de rang déménagée sur la place Parent, face au cimetière de Saint-Jean-de-Dieu. Comme le plafond était à 10 pieds de hauteur, il fallait abaisser le tout pour aménager un deuxième étage. La légende dit que Jeanne et Victor soutinrent à bout de bras, la structure de ce plancher tandis que leurs fils affolés couraient de tous côtés pour fixer celle-ci à l'aide d'équerres.
Cette nouvelle demeure se transforma rapidement à la mesure du couple et les loups y trouvèrent même dans le grenier une petite porte spécialement conçue pour eux. Avant que Victor ne prenne sa retraite de la Villa Dubé, Ti-Jeanne avait encouragé ce dernier au travail du bois, art pour lequel papa a un talent indéniable. C'était aussi une façon pour maman de parer au pire, elle ne voulait pas que ce dernier vire la maison à l'envers sous prétexte d'un nouveau projet d'aménagement. Mais c'était oublier l'excentricité de papa qui a toujours préféré pour établi, la table de salon que le comptoir de la cave.
Après avoir élevé 14 enfants, il n'était pas question pour Jeanne et Victor de céder à la sédentarité. Ils parcoururent donc le Québec d'est en ouest, du nord au sud et traversèrent l'Atlantique vers la France et les montagnes de la Suisse. Il ne manquait que la Floride pour compléter le fameux triangle du voyageur québécois.
C'est alors que Victor et Jeanne se sont dit:
- «Si nous ne pouvons pas aller vers la Floride, c'est la Floride qui viendra à nous.»
Chose dite, chose faite! Derrière la maison, ce n'est plus un jardin qui pousse mais une véritable jungle tropicale. Et dans la maison, Victor garde sans problème la température à un minimum de 90 degrés Fahrenheit hiver comme été. Il y fait tellement beau et chaud que même gavé de tourtières, de cipâtes et de tartes aux fraises, le cholestérol n'arrive pas à prendre prise et fond carrément dans les veines.
Et s'il y en a qui ne me croit pas, allez constater vous-même. Vous verrez...Jeanne et Victor n'ont pas changé du tout, ils sont et seront toujours le couple le plus accueillant que ce jeune pays puisse compter.
Marco
Lexique
|
Accordait: |
Donner le rythme |
|
Accoté: |
Vivre en concubinage |
|
À croire: |
Tromper qqn avec des mensonges |
|
Affilait: |
Stimulait |
|
À lège: |
Sans charge, déchargé |
|
Astheure: |
A présent, maintenant |
|
Babiche: |
Lanières de cuir |
|
Bagosse: |
Alcool de contrebande |
|
Ballonné: |
Saucisson de bologne |
|
Bed: |
Lit |
|
Ben: |
Bien |
|
Boillers: |
Chaudières à vapeur |
|
Bollé: |
Être premier de classe |
|
Boss: |
Patron |
|
Bosser: |
Travailler |
|
Boulé: |
Brute, homme fort |
|
Broche: |
Fil de fer |
|
Bûcheux: |
Bûcheron |
|
Buck: |
Mâle chevreuil ou orignal |
|
Câlissé: |
Juron québécois, donner, asséner |
|
Cannages: |
Boîtes de conserve |
|
Cannes: |
Boîtes de conserve |
|
Cardeur: |
Cardeuse, machine à carder |
|
Chars: |
Train |
|
Chiard: |
Repas fait de patate et lard |
|
Christ: |
Juron québécois |
|
Chums: |
Amis, copains |
|
Cipates: |
Mets traditionnel des Fêtes |
|
Cite: |
Cette fois-ci |
|
Cleaper: |
Rasoir |
|
Coachs: |
Entraîneurs |
|
Cochon: |
Tire lire |
|
Coffre: |
Poitrine |
|
Couple: |
Quelques |
|
Croûtes: |
Parties extérieures d'un billot |
|
Dégaine: |
Sortir |
|
Dé-aller: |
Sortir du trou, débrouiller |
|
Drette: |
Droit |
|
Estampé: |
Estampillé |
|
État de grâce: |
Pas de péché sur la conscience |
|
Factory: |
Manufacture |
|
Fêlé: |
Fou |
|
Fillot: |
Filleul |
|
Frette: |
Froid |
|
Froques: |
Manteau |
|
Fun: |
Plaisir |
|
Gambler: |
Joueur, parieur |
|
Godendart: |
Scie manuelle actionnée par deux travailleurs |
|
Icitte: |
Ici |
|
Itou: |
Aussi |
|
Jack: |
Grand chum |
|
Job: |
Travail |
|
Jobber: |
Gérant de chantier |
|
Jouai vert: |
Juron québécois |
|
Korkay: |
Bottes à cap d'acier et semelles cloutées |
|
Laite: |
Laide |
|
Libéra: |
Chant religieux |
|
Lieuse: |
Corde des moissonneuses |
|
Marde: |
Juron québécois, merde |
|
Mascoux: |
Petit fruit rouge vif |
|
Ménoires: |
Partie de l'attelage du cheval |
|
Minot: |
Unité de mesure valant 8 gallons |
|
Moé: |
Moi |
|
Mosselle: |
Biceps |
|
Moutonne: |
Dépotoir des camps de bûcherons |
|
Musique à bouche |
: Harmonica |
|
Ostination: |
Contradiction, obstination |
|
Pack-sac: |
Sac à dos |
|
Pedleur: |
Vendeur itinérant |
|
Petit Témis: |
Petit train du Témiscouata |
|
Pichous: |
Mocassins |
|
Pies de lunch: |
Pie-grièche migratrice |
|
Piquarom: |
Outil pour la drave avec long manche et pic |
|
Piquer tout drette: |
Aller tout droit |
|
Pis: |
Puis |
|
Pitoune: |
Billes de bois coupées en 4 pieds |
|
Pollock: |
Cigarettes roulées à la main |
|
Ponge: |
Once de boisson alcoolisée |
|
Primai: |
Primaire |
|
Pus: |
Plus |
|
Quêteux: |
Mendiant |
|
Quicke: |
Donner un coup de pied latéral |
|
Rambrissée: |
Revêtue |
|
Rapaillait: |
Regroupait, ramassait |
|
Reel: |
Air de quadrille |
|
Relevait les: |
Convalescence de maternité |
|
Revire: |
Retourne |
|
Rubber: |
Bottine en caoutchouc |
|
Ruine-babines: |
Harmonica |
|
Sacrament: |
Juron québécois |
|
Sacré: |
Asséner |
|
Sciotte: |
Outil de travail pour abattre le petit bois |
|
Shack: |
Cabane en bois rond |
|
Shaft: |
Moyeu |
|
Shed: |
Hangar, remise |
|
Shorts: |
Slip, caleçon |
|
Signe: |
Évier |
|
Siler: |
Pleurnicher |
|
Soigneur: |
Médecin |
|
Steppe: |
Saut |
|
Su a: |
Sur la |
|
Talle: |
Touffe de plantes d'une même espèce |
|
Tasserie: |
Partie de la grange où l'on entasse le foin |
|
Team: |
Attelage de deux chevaux |
|
Tobin: |
Rivière Trois-Pistoles |
|
Tow path: |
Chemin de hallage |
|
Toé: |
Toi |
|
Toffe: |
Endurant, résistant |
|
Train: |
La besogne |
|
Twitch: |
Hallage du bois avec une chaîne |
|
Vaillant: |
Travailleur |
|
Varnousser: |
Faire différents petits travaux, fureter |
|
Viarge: |
Juron québécois |
|
Waguine: |
Voiture de ferme à 4 roues |
|
Weaver: |
Tisser |
|
y: |
Il, lui |
|
y'é: |
Il est |
Remerciements
L'équipe de production tient à remercier pour leur gracieuse participation au présent recueil:
Madame Anne-Marie Ouellet pour l'ensemble des illustrations de l'œuvre.
Madame Lucette Bélanger et ta famille (Bélanger pour leur suivi et leur soutien moral.
Le Centre dédition des Basques pour son appui à l'édition.
Le Musée du (Bas Saint-Laurent pour te prît de photographies d'époque.
[Voir l'image pleine grandeur]

Crédits
Auteur
Victor Bélanger
Préface
Marc Laberge
Coordination du projet
Marcel Desjardins
Saisie des textes
Julie Ouellet
Représentations graphiques
Anne-Marie Ouellet
Collaboration spéciale
Centre d'Édition des Basques
Correction
Marcel Desjardins
Julie Ouellet
Isabelle Rioux
Linda Beaulieu
Publié par le Centre Alpha des Basques avec l'appui financier du ministère de l'Éducation du Québec.
Pour commander des exemplaires
Centre Alpha des Basques
15, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: (418) 851-4088
Télécopieur: (418) 851-3854
Courriel: centrealpha@intermobilex.com