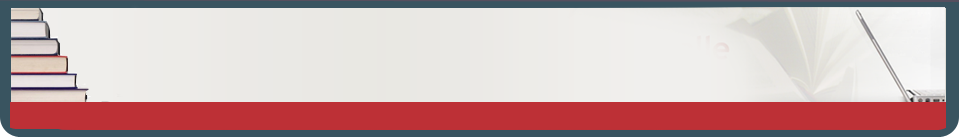- Préface
- Marie-Rose Ouellet
- L'accouchement
- Le baptême
- Les tâches quotidiennes
- L'été et le poêle à bois
- Les repas
- Les dimanches
- La Religion
- Le mariage
- Le deuil ou la mortalité
- Le temps des fêtes
- Mon arbre
- Midas
- Enfin!
- Anne-Marie Ouellet
- Il était une fois ma vie
- L'enfance
- Le couvent
- L'Angleterre
- L'Afrique
- Retour au Canada
- La retraite
- Lexique
- Remerciements
- Crédits
À Marcel,
Même de là-haut, tu nous amènes à nous dépasser encore
Préface
Raconter son histoire
Généralement, quand on demande à quelqu'un de raconter une histoire voire son histoire, les gens ont tendance à exagérer même à pimenter un peu leur récit. Comme si les conteurs mentaient nécessairement parce qu'ils racontent des histoires. C'est souvent ce que le monde pense.
Pourtant les histoires et les récits de vie que nous retrouvons dans ce recueil sont vrais. Deux conteuses, Marie-Rose et Anne-Marie qui nous révèlent une partie de leur vie. Une nous parle de la vie d'antan, l'autre nous parle de la vie moderne. Mais, un seul déterminant, la vocation. Pour l'une la vocation d'être mère pour l'autre la vocation spirituelle. Deux vies diamétralement opposées mais qui se rejoignent par cette soif commune de vivre.
Marie-Rose et Anne-Marie ont participé à la parution de Paroles des gens d'ici, le premier tome des Mémoires du terroir. Elles ont contribué aussi aux ateliers de récits de vie du Centre Alpha des Basques, organisés dans le cadre du Festival de contes et récits «Le Rendez-vous des grandes gueules de Trois-Pistoles».
Elles avaient donc des histoires à raconter. C'est ce qu'elles ont fait et elles l'ont bien fait.
Michel Leblond
Marie-Rose Ouellet
On ne déracine pas une rose...
Elle se raconte pour que son parfum ne meurt jamais.
[Voir l'image pleine grandeur]

Marie-Rose, c'est Lanou. Cette petite fille d'une famille nombreuse que les terres de notre terroir avaient l'habitude d'accueillir et de nourrir au début du siècle dernier. Marie-Rose, c'est aussi cette mère de famille dont le vécu est une richesse en soi, parce qu'il illustre à lui seul toutes les facettes de la vie d'une femme colonisatrice des haut-pays du Bas-du-Fleuve.
La littérature nous instruit abondamment sur le vécu des hommes de cette époque, la vie dans les chantiers, sur la terre ou sur la mer. Derrière ces hommes, ces héros du quotidien, se cachaient aussi des héroïnes, ces mères aux doigts de fée qui, de vieux bouts de laine mille fois raccommodés, faisaient de douillettes couvertures pour que les enfants dorment au chaud.
Marie-Rose, c'est aussi une artiste. Une femme de cœur. Du rang de la Bellevue au grand village de Saint-Jean-de-Dieu, elle nous raconte plus de huit décennies d'existence. Ne vous y méprenez pas: il ne s'agit pas d'un récit féministe; il s'agit simplement du récit d'une femme remarquable, mère de 14 enfants et épouse fidèle, tel que raconté par cette rose digne d'avoir été cueillie par le Petit Prince de Saint-Exupéry, petit héros de notre héroïne...
Isabelle Rioux
L'accouchement
Mon père avait cinq ans de plus que ma mère. Elle avait seize ans lorsqu'ils se sont mariés en 1917. Après être restés deux ans au village de Saint-Jean-de-Dieu, ils ont acheté une terre à la Rallonge pour y déménager. Ils avaient déjà deux enfants, Antonio et Léo, quand ils s'y sont installés.
L'accouchement dans ce temps-là, mon Dieu! On nous laissait croire que les bébés étaient amenés par les sauvages! Nous, les jeunes, on croyait ça dur comme fer, même qu'on avait peur de ça. Quand mon père nous disait:
- «Habillez-vous, les sauvages s'en viennent. Ils nous amènent un petit bébé.»
On était bien content d'avoir un petit bébé mais les sauvages, on ne voulait pas les voir. Je te dis qu'on ramassait nos guenilles et on se greillait vite. Ils nous emmenaient dans une sorte de dépense à côté de la maison où ils rangeaient des pots de conserve. Ils nous emmenaient là avec un tapon de couvartes. Durant l'été, on en n'avait pas besoin mais quand c'était l'automne ou l'hiver, ils nous apportaient des couvartes pour se cacher et pour toffer là une bonne secousse. Nous, les enfants, on parlait pas ou on parlait tout bas parce qu'on voulait pas que les sauvages nous entendent. Mon père nous avait dit:
- «Si les sauvages voient qu'il y a des enfants icitte, ils vont nous en donner un petit bébé mais ils vont prendre un de vous autres.»
Nous autres, on ne voulait pas s'en aller avec les sauvages. C'est pour ça qu'il ne fallait pas parler, fallait pas mener de train, fallait rien faire. Sinon on n'aurait pas eu notre bébé et ils auraient pu partir avec un de nous autres.
Quand ma sœur Thérèse est venu au monde, le voisin est venu nous chercher pour nous amener chez eux parce que les sauvages allaient passer. Fallait traverser le bois dans une traîne attelée à un cheval pour s'y rendre quand tout d'un coup, je vois un sauvage qui longe le bois en courant. J'avais assez peur qu'il court après nous autres et qu'il nous attrape dans la traîne. On croyait tellement aux sauvages qu'on en voyait. C'est pas drôle croire à des affaires de même surtout que nous étions convaincus de les avoir vus.
Lorsque ça achevait ou que le bébé était arrivé, il venait nous chercher, nous faisait entrer dans la maison et nous couchait dans nos lits. On pouvait attendre toute une nuit, des fois c'était moins long, mais on rentrait pas dans la maison tant et aussi longtemps que le bébé n'était pas arrivé et que la pelle à feu n'était pas partie. Dans ce temps-là, c'était la sage-femme qui accouchait; y avait pas de médecin.
Du moment que la sage-femme était partie, que le bébé était lavé et que tout était fait, il nous montait dans nos chambres. On voyait le petit bébé et on allait se coucher. Le lendemain matin on descendait voir maman qui nous disait:
- «Colle-toi pas trop après le lit pour pas faire mal à maman. Pour avoir le petit bébé, il faut que les sauvages lui cassent une jambe.»
Nous autres, on croyait ça dur comme fer. On restait poli avec maman parce qu'elle avait une jambe cassée. On était choqué après les sauvages de lui avoir fait ça. On se demandait bien pourquoi ils avaient cassé une jambe à maman. Elle nous répondait qu'elle ne l'aurait pas eu sans ça. On se rendait compte de rien.
Quand on allait dans la chambre à maman, on marchait sur le bout des pieds. On se penchait pour allez voir le petit bébé qui était placé à côté de son lit sans lui toucher pour ne pas faire mal à notre mère qui avait une jambe cassée. Elle devait avoir envie de rire parce qu'on faisait attention pour rien.
Des filles de la Rallonge venaient s'occuper de la maisonnée parce que les femmes dans ce temps-là restaient huit jours au lit. Elles perdaient plus de force à rester au lit que de se relever debout le lendemain ou le surlendemain comme astheure.
Quand je suis devenue un petit peu plus vieille, ils ont arrêté d'engager des filles. C'était moi qui m'occupais de la maisonnée lors des autres accouchements parce que j'étais la plus vieille des filles de la maison.
C'est à l'âge de quatorze ans que j'ai su que ce n'était pas les sauvages qui apportaient les petits bébés. J'étais plus une enfant! C'est pas ma mère et mon père qui me l'ont dit. C'est en allant chercher une commission chez la voisine que je l'ai appris. Marie-Louise, la voisine, me dit:
- «Sais-tu ça toi que c'est les sauvages qui emmènent les petits bébés?»
- «Ben oui je sais ça. Ce n'est pas vrai?»
- «Ben non, c'est pas vrai. Le petit bébé, elle l'avait dans son ventre!»
Je ne m'amuse pas là! Veux, veux pas, le fait qu'elle m'ait dit que maman avait un bébé dans son ventre, ça me dérange assez que je prends la commission et je m'en vais chez nous. Tout le long en m'en revenant je pense à ce qu'elle m'a dit.
- «Par où que c'est sorti c'te bébé-là si elle l'avait dans son ventre? Par le nombril je crois ben!»
Je ne voyais pas d'autres endroits.
Maman ne me l'avait jamais expliqué. Je l'ai appris toute seule quand je suis tombée enceinte. On en avait su quand même un peu par d'autres. Il y avait des filles que leur mère leur avait raconté. Elles nous contaient ce qu'elles savaient. Ça nous a un petit peu instruit mais pas complètement.
Le premier enfant, c'est sûr que ça été très dur. D'abord, j'ai accouché avant le temps: elle était supposée venir au monde le vingt-sept octobre et elle est arrivée le premier. Dans notre maison, les murs étaient en pièces, il n'y avait pas de revêtement dessus. J'ai tapissé ça toute seule. Monte sur la chaise, redescends et remonte sur la chaise et redescends. On n'avait pas la tapisserie d'astheure que tu mouilles et que tu colles. Dans ce temps-là, il fallait faire notre colle avec de la farine détrempée dans de l'eau. J'embarquais sur la chaise, je collais le haut et quand je redescendais pour coller le bas, le haut tombait. Remonte sur la chaise coller ça. Maudit, que j'avais de la misère. J'ai fini par tout faire mon mur, mais il restait les planchers à laver. J'étais plus capable, j'étais rendue au bout, j'étais fatiguée, fatiguée. Je me suis dit tant pis, je le ferai demain. Le mal m'a pris le soir et ma fille est venue au monde dans la nuit. Mon mari assistait à l'accouchement. C'est ma sœur Lucienne qui mettait le chloroforme. Quand le bébé était sur le bord de venir au monde, il nous endormait. Il nous mettait du chloroforme parce que quand le bébé passait, c'est là que ça faisait le plus mal. On n'en avait pas connaissance. Quand on se réveillait, le bébé pleurait, il était arrivé. C'est ma sœur Lucienne qui partait avec le bébé de son bord; elle le lavait, l'habillait. C'est une garde-malade qui accouchait. Les trois premiers que j'ai eus, c'était une garde-malade de Saint-Médard. Elle a fait ça cinq ou six ans, après c'est le docteur de Saint-Jean qui s'occupait des accouchements.
Comme dans le temps de ma mère, je suis restée couchée au lit huit jours. C'est ma sœur qui s'occupait de moi. Je restais chez elle, vu qu'on n'avait pas pu loger notre maison; on était encore dans notre petit camp.
Après les huit jours, je m'occupais juste de mon petit bébé. Je lui donnais son bain, je l'habillais, etc. Il fallait leur mettre une petite chemise, une ceinture pour le nombril. Astheure, le nombril, il le laisse à l'air et ça guérit tout seul. Nous autres, il leur fallait une ceinture, et même, ils mettaient de la laine de mouton noir sur le nombril pour guérir ou encore une grosse cenne noire. Chez nous, c'était de la laine de mouton. On lui mettait ça sur le nombril pendant sept, huit jours. La ceinture, on pouvait lui laisser cinq ou six mois. On lui mettait la couche, la ceinture, la petite chemise et on l'enveloppait dans un lange. On les enveloppait bien serré jusqu'au pied. Tout attaché comme un petit rouleau, c'était beau à prendre, c'était solide. Il était au chaud là-dedans. On les emmaillotait comme ça jusqu'à temps qu'il fasse beau. Le beau temps arrivé, on les laissait en pyjama ou en petite robe quand c'était une petite fille. Pour faire les couches, on achetait du flanellette à la verge qu'on coupait par morceau. On faisait tout à la main. Des fois, on pouvait avoir trois enfants aux couches. T'avais le bébé, l'autre d'un an et demi et un de deux ans qui n'étaient pas encore propres. Ça en faisait des couches à laver. Pour les petits bébés, je prenais toujours des couches neuves blanches en flanellette. Les plus vieilles couches, je les mettais aux bébés un peu plus vieux, pour ceux qui se traînaient. Je faisais des couches dans des dos de chemises de mon mari. Les manches et le devant étaient finis mais le dos n'était pas brisé. Ça ménageait la flanellette.
Le premier enfant que j'ai eu à l'hôpital, c'est Thérèse. J'ai été à l'hôpital parce qu'on n'avait pas de fille engagère. Celle qu'on prenait est tombée malade et on n'a pas pu en engager une autre. Je n'étais pas pour accoucher à la maison avec tous les enfants qu'on avait, surtout qu'on restait huit jours couchées au lit. Yvon m'a dit:
- «Tu vas accoucher à l'hôpital, lorsque tu reviendras, tu vas être capable d'avoir soin de ton bébé. Nous autres tout seuls icitte, on est capable de s'arranger.»
À l'hôpital, ce n'est pas les mêmes accouchements. Ils m'ont endormie au début et quand je me suis réveillée, tout était terminé. Probablement que Yvon aurait pu venir assister à l'accouchement mais il fallait qu'il s'occupe des autres petits à la maison. J'ai préféré accoucher à l'hôpital pour ma sécurité et pour celle du bébé. Habituellement, j'accouchais à la maison parce que je ne voulais pas y laisser les autres enfants; les filles n'étaient pas assez grandes pour avoir soin de tous les autres.
Trucs
On avait pas grand chose pour calmer les coliques, mais quand les petits bébés avaient des coliques, on mettait sur leur ventre de la flanelle chaude, que l'on faisait chauffer dans le fourneau. On faisait aussi un petit liquide avec de l'ânis, cette petite fleur blanche des champs qui mûrit l'automne et qui donne une petite graine. On cueille les graines, on les ébouillante puis on met le tout dans un pot. Quand le bébé pleure et fait des coliques, on lui donne une cuillère de ce liquide. Le bébé arrête d'avoir mal et s'endort. C'était vraiment bon!
Exercices
On s'occupait des bébés, on leur donnait les soins de base mais il n'y avait pas vraiment d'exercices de stimulation ou quoi que ce soit comme astheure. Ma mère disait:
- - «Un bébé quand y dort, y bouge pas. Quand y pleure pas, y bouge pas, y est couché tranquille et il ne bouge pas. Quand y pleure par exemple, regarde-le aller. C'est son exercice! Arrête-le pas de pleurer! En autant qu'y pleure pour rien. Des fois, y pleure juste pour se faire prendre. Tu le prends et y pleure plus. Y a pas mal! Tu le laisses pleurer une secousse, pis là ça gigote, ça se brasse su un bord pis sur l'autre. Il fait ses exercices. Des fois, y va pleurer pendant dix minutes de temps et y s'endort. Ça lui a permis de faire ses exercices.»
J'utilisais ces conseils. Quand il pleurait plus que dix minutes, je le prenais pour voir ce qu'il avait. Si je voyais qu'il était ben de bonne humeur dans mes bras, ben je le remettais dans sa couchette et il se remettait à pleurer. Je lui disais:
- «Pleure, c'est le temps de tes exercices.»
La première chose que je savais, il dormait.
Le baptême
J'ai eu neuf filles et sept garçons mais j'en ai quatorze de vivants. Marcelline et Nicole sont décédées.
Sur les quatorze enfants, j'ai connu un seul baptême. Comme j'allais accoucher à l'hôpital, ils ont attendu qu'on en sorte pour baptiser. On choisissait le nom. Par exemple pour Marcelline, j'avais trouvé ce nom-là dans un livre. Des fois, on s'attache à des personnages de livres. J'étais enceinte et je me disais si c'est une fille, je vais l'appeler Marcelline. Elle a vécu une journée et elle est morte. Ils l'ont baptisée à neuf heures et elle est morte vers quatre heures de l'après-midi.
À l'époque, le baptême était un peu différent. Aujourd'hui, ils font baptiser quand ils le veulent, un mois, trois mois, six mois, un an après que l'enfant soit né. Dans notre temps, on faisait baptiser le lendemain de l'accouchement. Si t'accouchais dans la nuit, le lendemain après-midi, ils le baptisaient. La mère n'était pas présente; il y avait seulement le père, le parrain et la marraine.
Il n'y avait aucune cérémonie après. On faisait tellement baptiser jeune, on ne pouvait pas rien faire. Les parrains venaient, ils prenaient le bébé, ils allaient le faire baptiser, le ramenaient et après ils s'en allaient chez eux. Aucune fête. Maintenant, ils attendent pour faire baptiser, ils se remettent en forme, ils sont joyeux. C'est tout un changement avec ce temps-là.
Les tâches quotidiennes
À l'époque, les journées étaient bien longues. Elles commençaient à quatre heures et demie, cinq heures du matin et ça filait jusqu'au soir. On débutait par la besogne à l'étable. À quatre heures et demie, je partais pour l'étable débouler le foin sur les tasseries, gratter les vaches sur les pavés, mettre ça dans l'allée et allez porter ça au fond. Tant que les jeunes gars n'ont pas été assez vieux, c'est moi qui le faisais sauf quand mon mari était là. Généralement, il partait dans le bois l'automne et il revenait au printemps.
L'hiver, les vaches étaient dans l'étable. Il fallait débouler le foin sur les tasseries pour nourrir les animaux. On n'était pas greillé comme astheure, avec une grande allée avec les vaches tête à tête. Les vaches étaient toutes dans des crèches. Il fallait entrer le foin dans chacune d'elles. Il y en avait douze comme ça et on devait les faire une par une. Tu y allais souvent dans la tasserie chercher du foin.
Ensuite, il fallait pomper l'eau à bras. Le bras de la pompe était court. On l'avait rallongé avec un morceau de bois pour que ça soit moins dur à pomper. Les petits gars, même Nicole quand elle est devenue plus grande, pompaient de l'eau.
Une fois le travail à l'étable terminé, on apprêtait le déjeuner. Il fallait préparer les enfants qui vont à l'école, en premier, et ceux qui restaient à la maison après. Ensuite, tu laves le bébé, le deuxième, tu lui enlèves sa couche, le changes et tu les habilles.
Après, tu te mets au gros ouvrage. La journée de lavage, écoute un peu, il fallait retrousser ses manches et y aller vite. On avait des gros lavages à faire avec trois bébés aux couches. Ce n'était pas des couches jetables dans ce temps-là. En plus, il n'y avait pas de moulin, pas de tordeur, seulement une cuve et une planche à laver. On tordait tout à la main. Quand on avait fait la première eau, fallait vider la cuve. On ne pouvait pas la vider dans le sink, c'était trop pesant. On se servait d'un plat pour la vidanger. Quand il en restait rien qu'un peu, on prenait la cuve pour vider le restant. On la remplissait pour faire une deuxième eau. Eau qu'on faisait chauffer sur le poêle à bois, même en plein cœur d'été, parce que pour laver, ça prend de l'eau chaude.
C'est avec le savon du pays qu'on lavait le linge. Le savon du pays, c'était du savon qu'on faisait nous-mêmes quand on faisait boucherie. On gardait toutes les panses des animaux, on les vidait, les lavait, ensuite on mettait ça dans un grand chaudron noir en fer, dehors sur le feu. Il y avait toutes sortes d'ingrédients qui allaient là-dedans et on faisait bouillir ça toute la journée. Le soir quand on voyait que c'était tout défait et que c'était bien cuit, on arrêtait le feu et on laissait reposer. Le lendemain, le bon gras qu'on prenait pour faire le savon, remontait sur le dessus. On coupait ça par carreaux pour ensuite les faire sécher dans la maison.
On prenait aussi de la cendre de poêle pour faire la lessive. On mettait à peu près la moitié de la chaudière de cendre et on vidait une grande bombée d'eau bouillante là-dedans. Ça virait en vase. On laissait ça reposer une heure. Pendant ce temps-là, la cendre descendait dans le fond et l'eau montait sur le dessus. Ensuite, on prenait un vesseau et on ramassait toute l'eau pour la transférer dans un autre contenant. C'était notre eau de javel. Ça lavait aussi bien le plancher et le linge, que l'eau de javel d'astheure. On faisait tremper les linges à vaisselle et les serviettes tachées et les taches disparaissaient.
Généralement, je lavais deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. J'avais pas assez de linge pour faire plus de jours que ça. Le lavage pouvait se terminer le midi, si je me dépêchais et si je n'avais pas trop d'arrêts par rapport aux enfants. Un enfant qui pleure, faut bien arrêter pour en prendre soin, ou le faire boire. Ils dînaient et souvent je ne pouvais pas dîner en même temps qu'eux parce que je voulais finir le lavage et étendre dehors.
Même l'hiver, on étendait dehors, pas sur la poulie parce que ça brisait mais sur des dossiers de chaises. On faisait geler le linge parce que ça tirait l'eau. Le soir, quand les enfants étaient couchés, je fermais leur porte de chambre et on entrait le linge à l'intérieur. J'avais une corde qui faisait bord en bord de la maison et j'étendais là-dessus. Le lendemain, je le ramassais et je le pliais. Le plus dur à sécher et à laver, c'était les piqués parce que c'était épais. De toute façon ce sera toujours le linge des bébés, avec les couvertes, les couches et les piqués, qui seront le plus dur à laver. Ce qui était plus facile à laver, c'était les petites robes, les petites paires de culottes, les chandails et les jupons des autres enfants.
Dans l'après-midi, quand le lavage était fini, il nous restait à faire les lits des enfants. Les premières années, les enfants n'avaient pas de matelas. On se servait de paillasses faites avec des poches de moulée vides avec des trous dessus qu'on remplissait de paille. C'est ce qui servait de matelas. Ils avaient tous des paillasses comme ça dans leur lit. Imaginez-vous l'ouvrage! Fallait brasser ça pour la remettre égale parce que la paille se tassait et ça faisait des trous. Ça faisait de la saleté en plus. Quand la paillasse était neuve c'était correct mais quand elle commençait à être vieille, c'est-à-dire quinze jours, trois semaines, elle égrainait et ça faisait plein de cochonneries par terre. Fallait passer le balai, prendre la paillasse, l'emmener à l'étable pour la vider et la remplir de paille neuve. On faisait ça une couple de fois par mois.
Le repassage se faisait avec un fer qui chauffait sur le poêle, même en plein cœur de l'été. C'était des fers à repasser avec une poignée de fer. Quand le fer était chaud, la poignée aussi était chaude. Il fallait le prendre avec des poignées en tissu épais pour pouvoir repasser avec ça. Le fer ne restait pas chaud longtemps. Il fallait le remettre sur le poêle pour le réchauffer. Je te dis que ça en faisait du pilotage. Notre planche à repasser, c'était la table. On mettait une catalogne dessus et on repassait les blouses, les robes, les couches.
Le dimanche, les hommes mettaient toujours une chemise blanche. Ça leur prenait un col empesé. On empesait ça avec de l'empois, une sorte de poudre blanche qui mettait le col raide. On mélangeait une cuillerée à soupe d'empois pour une tasse d'eau. On délayait ça puis on trempait le col là-dedans. On le tordait comme il faut et on le repassait. On le faisait sécher avec le fer à repasser. Il venait bien beau, bien raide.
Travailler dans du vieux, nous autres on connaît ça. J'habillais les enfants moi-même. Je ne leur ai jamais acheté de petites robes, de pantalons. J'ai toujours fait ça moi-même dans des grands manteaux que ma grand-mère et mes tantes me donnaient. C'est encore plus d'ouvrage. On gardait tout ce qui était bon. C'est pour ça qu'on pressait la couture parce qu'on pouvait en avoir besoin de ce petit bout-là. Il ne restait que les chaussures à acheter parce que des petits robeurs, je n'étais pas capable d'en faire.
Je me faisais des patrons avec de la gazette. Je prenais la grandeur de la taille, la longueur du pantalon et là je me taillais un patron. Quand ils sont devenus plus grands c'était un peu plus compliqué, ça leur prenait une flye. C'est difficile à faire une flye. Il a fallu que j'en démanche une sur une paire de pantalon de mon mari et que je regarde comment c'était fait. J'ai cousu et décousu plusieurs fois avant d'arriver à bien coudre un zipper. Je te dis que les petits gars étaient contents de ne plus avoir d'élastique et d'avoir un zipper à la place. Ensuite, ce qui n'était pas facile, c'était de mettre des poches sur le côté des pantalons. Il fallait encore regarder comment c'était fait pour faire pareil. Tu pensais avoir réussi, tu la virais de bord pour t'apercevoir que la poche était à l'envers. Combien de fois j'ai dû recommencer avant de réussir, souvent trois, quatre fois. Mais, une fois compris, c'était appris pour toujours.
Je faisais mes patrons dans l'après-midi quand les bébés étaient couchés, que les autres jouaient et que les plus vieux étaient à l'école. J'avais plus de temps. Le soir, quand ils étaient tous couchés, je m'embarquais sur le moulin à coudre pour travailler une bonne partie de la nuit. Des fois, je finissais la froque ou le pantalon à quatre heures et demie du matin. Pourquoi je me serais couchée pour me relever à cinq heures? Alors, je ne me couchais pas. C'est arrivé souvent, je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Ça faisait des journées longues en mautadit.
Les mitaines et tout le reste, je faisais tout ça avec notre laine. On tondait la laine, on la filait. Ensuite, on la mettait en peloton et on tricotait à la main. Moi, j'ai eu une machine à tricoter plusieurs années après avoir été mariée. Il y en avait une chez Désiré et on l'a achetée. Ça ne prenait pas de temps pour faire une paire de bas avec ça.
Dans ce temps-là, les filles ne portaient pas de pantalons. On les voyaient plutôt avec des jupes ou des robes avec des bas qui allaient jusqu'en haut du genou. Tu tricotes longtemps, pour faire les jambes, surtout à sept ou huit ans, elles commencent à être grandes. L'été, elles ne mettaient pas de chaussures ni de bas, elles marchaient nu-pieds. On vient les pieds endurcis. Tu marches sur les roches et ça fait même pas mal. Du moment qu'il faisait beau, que la neige était fondue et que le chemin était sec, on serrait les chaussures et on les ressortait l'automne quand il faisait frette. Dans les champs, à l'école, dans l'étable, partout, on allait nu-pieds. Mes enfants n'ont pas vraiment connu ça, c'était un peu moins pire. On gagnait un petit peu plus d'argent dans ce temps-là et on pouvait leur acheter des chaussures.
Le samedi, je faisais le ménage dans toute la maison avec la brosse, la chaudière d'eau, le savon et la cendre de poêle. C'était un plancher de bois, un plancher où il manquait des cannures: il y avait des trous, des creux. Il fallait prendre la guenille en tapon et la rentrer dans le creux pour enlever l'eau. Ça prenait deux heures pour laver le plancher et c'était à toutes les semaines et des fois deux fois la semaine. Quelques années après, on a mis un prélart sur le plancher. Ha! Là, ça été une vraie beauté, plus de brosse, plus de lessive. Le laver, une affaire de rien. Quasiment à tous les soirs. Il y avait plusieurs pieds qui marchaient là-dessus. Ils arrivaient de dehors, les jeunes de jouer, les autres de l'école. Ce n'était pas la mode dans ce temps-là d'enlever ses souliers. Il restait une petite secousse sur le tapis et après il partait à la grandeur de la maison. Ça faisait de l'ouvrage.
La nourriture
L'été on cultivait un grand jardin. L'automne, je faisais quatre-vingts pots de conserve. Des carottes, de la macédoine, des fèves, des fraises. Quand on cueillait des fraises, l'ouvrage à la maison ne se faisait pas. Il fallait travailler encore plus tard le soir, pour pouvoir tout faire l'ouvrage qui n'avait pas été fait durant la journée.
L'été était la saison où l'on mangeait le moins de viande. De temps en temps, le dimanche, on en mangeait. Ce n'est pas comme le lard salé, on en avait tout le temps. On le gardait dans la saumure pour le conserver.
Comme on n'avait pas de frigidaire, l'été, on mettait la viande en pot. Délicieux! Je faisais des sandwiches avec de la viande en pot pour les hommes qui revenaient de faire les foins. Ils arrivaient souvent avec l'estomac creux.
Ils trouvaient donc ça bon. C'est vrai que c'était bon! Le goût était meilleur que cuit dans le chaudron. Je mettais du poulet, du porc et du bœuf crus dans le pot et faisais cuire le tout à la vapeur. Des fois, on pouvait mettre de la viande déjà cuite. On la faisait cuire moins longtemps environ une heure pour que le pot steame et qu'il ferme étanche. Quand la viande était crue, il fallait qu'elle bouille un peu plus longtemps.
L'automne, quand on faisait boucherie vers le mois de décembre, on préparait nos cretons. On faisait cuire des gros chaudrons de viande de porc. On chauffait le poêle pour que ça bouille continuellement en brassant souvent. On plaçait le chaudron loin du feu pour éviter une cuisson trop rapide et pour que ça ne colle pas au fond. Pour préparer les cretons, on avait un petit moulin à viande que l'on attachait après la table et on hachait toute la viande dans ce moulin à bras. On les transvidait dans des contenants de plastique qu'on plaçait ensuite dans la petite dépense dehors pour les garder au frais. Le moulin à viande servait aussi pour faire notre steak haché.
Pour conserver la viande l'hiver, on la mettait à geler dans une petite armoire dehors avec des panneaux. Comme on n'avait pas de frigidaire, on faisait boucherie à la Notre-Dame, le huit décembre. Les gars descendaient du bois et faisaient boucherie. Ça se faisait chez nous, chez le voisin, chez le deuxième voisin, chez le troisième voisin, tout au long du rang. Tout le monde s'entraidait. Ils chauffaient de l'eau dans les grands chaudrons noirs dehors. Ils tuaient le cochon. Ils l'ébouillantaient dans une boîte spéciale pour enlever le poil. Ils le sortaient de l'eau et l'étendaient sur un panneau pour le gratter avec de gros couteaux de boucherie jusqu'à ce que la peau devienne belle avec plus un poil. Ensuite, ils le pendaient par les pattes d'en arrière sur une échelle accotée après le garage. Ils le laissaient là et partaient en faire un autre chez le voisin, ainsi de suite. Des fois, certains avaient un bœuf et un cochon à tuer, c'était plus long.

Une boucherie à la campagne, Musée des maîtres et artisans du Québec, 1985.17
On ramassait le sang des cochons et on le faisait cuire pour faire du boudin. Nous avions une recette à nous autres, c'était encore meilleur que le boudin qu'on achète. On faisait ça dans des casseroles à pain. On le faisait cuire dans l'eau chaude. On avait une grande cuve, une grande soupière et les deux bols à pain rentraient dans la soupière. Ça bouillait dans l'eau, le plat, lui, cuisait avec de l'eau bouillante autour. Quand on voyait que le dessus était bien lisse, on le piquait et s'il ne coulait pas, on l'enlevait et on en mettait deux autres. Quand on sortait nos casseroles de l'eau bouillante, on les virait la gueule en bas sur du papier ciré pour les faire refroidir. On les mettait dans des contenants et on les rangeait au froid dans la petite armoire fait exprès pour ça. On avait toute notre viande pour l'hiver, le bœuf, le cochon, les poulets, du lard salé et la jarre dans la cave. On avait tout ce qu'il fallait, il ne restait qu'à acheter la farine, le sucre et le sirop.
On faisait notre beurre aussi. On écrémait le lait et on gardait la crème. Au commencement, on avait un petit moulin à beurre à manivelle. Tout était à la manivelle. Je te dis que tu vires longtemps pour faire du beurre. Quelques années après, mon mari a acheté un vrai moulin à beurre. Un gros baril dans lequel on mettait la crème. Il y avait une manivelle mais il y avait aussi une pédale à côté. On pesait sur cette pédale et le baril tournait. Là, les enfants pouvaient le faire tourner aussi. Je le faisais virer une escousse mais les enfants prenaient la relève quand j'arrêtais. Une fois terminé, on roulait ça en petite boule pour la déposer ensuite dans des jarres avec de la saumure.
Dans la cave, il y avait le carreau pour les patates et une grande tablette. Sur cette tablette, il y avait un gros coffre dans lequel on mettait le pain et une jarre pour la viande qui était dans la saumure. Pour savoir si la saumure était bonne, on mettait du sel dans une chaudière d'eau. On brassait, on brassait. Ensuite, pour vérifier, on ajoutait un œuf dans l'eau salé. Si l'œuf descendait dans le fond, on enlevait l'œuf et on rajoutait du sel. On faisait cette étape jusqu'à ce que l'œuf flotte sur le dessus. Lorsque l'œuf flottait, ça voulait dire que la saumure était assez forte pour conserver la viande. C'était le temps de faire le lard salé.
Les poulets
C'est moi qui coupais le cou des poulets quand venait le temps de les tuer. Je les plumais et les vidais aussi. Habituellement, ce n'était pas le travail des femmes de leur couper le cou.
Comme on dit, c'était une méchante job et ça empestait le diable en plus. Je détestais faire les poulets mais quand je m'y mettais, je te dis que je le faisais vite pour débarrasser la maison.
On ne pouvait pas ébouillanter les poulets dehors, il fallait le faire dans la maison. Quand les filles sont devenues plus grandes, elles m'aidaient à les plumer même si elles n'aimaient pas ça, elles aussi. On gardait les plumes et on les étendait sur du papier journal pour les faire sécher. Une fois sèches, on en remplissait les oreillers. Ça permettait de faire un oreiller par année. Ça prenait pas mal de plumes, mais quand on tue douze poulets, je te dis que ça n'en fait quand même beaucoup.
Si durant l'été, un dimanche, on avait le goût de manger un poulet, on allait en tuer un, on le plumait et le faisait cuire. Si le samedi soir, je pensais faire du poulet pour le dîner du dimanche et qu'il n'était pas trop tard, je le tuais le soir et le préparais pour le lendemain. Le dimanche matin, je mettais le poulet, le bœuf et le morceau de porc dans ma grosse rôtissoire et ensuite j'envoyais le tout au fourneau. Fallait faire ça parce qu'on avait pas de frigidaire. On y allait au besoin. Par contre, l'automne on pouvait en tuer plusieurs et les faire geler dans la petite armoire dehors ou tout simplement dans la laiterie.
Les commodités
La toilette dans ce temps-là, c'était une chaudière qu'on retrouvait à l'intérieur. On appelait ça aussi la catherine. Elle était installée dans une chambre en haut. On ne retrouvait pas de catherine dans toutes les maisons. Il fallait l'acheter et le monde n'avait pas d'argent.
Une catherine, c'est fait en granit avec un couvert dessus. Nous autres ce qu'on avait, c'était une chaudière ordinaire de vingt livres qu'on recouvrait d'un carton. Il y avait des pots aussi, il y en avait des petits pour les jeunes et il y en avait des plus grands. Ils les mettaient en dessous de leur lit et il y en avait un plus grand pour tout le monde. À tous les matins et tous les soirs, il fallait les vider, les laver et les remettre à leur place. C'était à recommencer à tous les jours. Ce sont les enfants, quand ils ont été assez grands pour le faire, qui s'en occupaient. C'est mon plus vieux qui s'occupait de cette tâche-là.
Je me rappelle une histoire drôle à ce sujet quand j'étais jeune. Un soir à la Bellevue, il faisait très froid, papa était au chantier comme d'habitude, maman était seule à la maison avec les enfants, la besogne de l'étable à faire et la maison pas trop bien finie, il passait de l'air moyennement. C'était dur à réchauffer, maman chauffait le poêle. On n'avait pas de fournaise juste un poêle et pas de cheminée. Ce soir-là, il faisait très froid avec un grand vent. Il est minuit, elle n'est pas couchée, elle chauffe le poêle et à un moment donné, elle se rend compte que le tuyau est rouge et que le feu est pris dans le plancher du grenier. Elle monte en haut avec une chaudière d'eau. Les petits gars en montaient d'autres; des petites chaudières qu'ils vidaient dans la grosse chaudière. Elle avait un plat puis elle pigeait de l'eau dans la chaudière et elle lançait ça au plafond et ça allait vite, un plat, un autre. Vu qu'on n'avait pas de salle de bain, pas de toilette, c'était une grande chaudière. On était une dizaine qui allaient dans cette chaudière-là, il y en avait du stock et maman qui se dépêchait ne s'est jamais rendu compte qu'elle s'était trompée de chaudière. Elle avait pigé dans la catherine et voilà le désastre. La senteur du liquide après le tuyau chaud et les gros étrons qui restaient pendus après les poutres. Mais ce qui compte, c'est qu'elle a fini par éteindre le feu. Après, il me semble voir maman qui riait de sa mésaventure, de son erreur. Le lendemain matin, ça été toute une corvée pour nettoyer et remettre à l'ordre le grenier. Elle racontait ça aux autres et elle trouvait ça drôle. On n'a pas passé au feu, c'est ce qui compte.
La toilette est arrivée après l'électricité qui elle est apparue dans le rang en 1950. Avant l'électricité, on s'éclairait à la lampe à l'huile. Le matin, ça faisait partie de la routine, après le déjeuner, tu faisais un peu de ménage, tu ramassais le plus gros, tu lavais les globes des lampes, tu mettais de l'huile et les plaçais sur la tablette pour le soir. Ensuite, c'était le fanal, on faisait la même chose qu'avec les lampes. On se servait du fanal pour aller à l'étable parce que c'est parfait pour aller dehors, ça ne s'éteint pas au vent et le globe est solide là-dessus. Quand j'étais chez mes parents, c'est moi qui avais la job de laver les globes des lampes et du fanal. Je devais les remplir d'huile à tous les matins pour que ce soit prêt pour le soir. Aller à l'étable avec un fanal, ça éclairait pas beaucoup. Les vaches faisaient des ombres aux murs et moi j'avais peur, je pensais que c'était des fantômes.
Dans ce temps-là, tu ne pouvais pas tourner le piton pour avoir du chauffage, il n'y en avait pas de piton. Il fallait que tu chauffes le poêle. Chauffe le poêle pour faire à déjeuner, chauffe le poêle pour le dîner et chauffe encore pour le souper. Du bois, on en mettait souvent parce que ça brûlait vite. Il y avait une trappe dans le plancher puis en dessous, il y avait une boîte pour mettre le bois. Ça ne prenait pas beaucoup de temps que la boîte était vide et là, il fallait en remettre d'autres. Je trouvais difficile de rentrer le bois dans la cave quand mon mari partait pour les chantiers, l'automne. Les petits gars n'étaient pas encore assez forts. Je prenais la traîne, j'allais la remplir de bois dans le garage afin de pouvoir chauffer la maison.
On savait qu'il y avait de l'électricité dans le village quand on allait chez le docteur à Saint-Jean et qu'on voyait que toutes les lumières étaient allumées. C'était tellement beau! On se croyait dans la grosse ville de Montréal mais on était seulement au village de Saint-Jean-de-Dieu. Habitué de rester dans un rang à la noirceur et tu vois toutes les lumières allumées après les poteaux, quand tu vas au village, c'est normal de se croire en ville! Pour amener l'électricité dans les maisons, il fallait payer cent piastres. Nous autres le cent piastres, on l'avait pas. On a attendu quelques années avant d'avoir l'électricité.
L'avantage d'avoir l'électricité c'est qu'il faisait clair partout dans la maison. Une lampe, ça éclaire seulement un petit coin, le restant est noir. Le lendemain, pas de globes à laver, pas d'huile à remplir pour le soir. On sauvait de l'ouvrage! Là, c'était beau travailler le soir, coudre à la clarté. C'était plus facile aussi pour nettoyer les vases de nuit.
Même si on a eu l'électricité un jour, on n'a pas pu avoir la télévision tout de suite. Ça coûtait encore un gros montant. On n'avait pas grand argent et la priorité n'était pas là.
Une autre chose qui est arrivée en même temps que l'électricité, c'est la machine à laver. La première qui est entrée dans la maison, c'était un moulin à laver avec un tordeur. Fini le temps du frottage sur la planche à laver jusqu'à ce que l'eau te coule dans la face. Ça brassait tout seul. Le brassage fini, tu l'ouvrais et mettais ton linge dans le tordeur. Ça tordait tout seul, pas besoin de virer la manivelle. Ça m'a vraiment aidée.
Les deux seuls gros morceaux qu'on a eus avec l'arrivée de l'électricité c'étaient le moulin à laver et le frigidaire.
Les tâches ménagères des filles
Les filles pouvaient faire le petit ménage qu'elles étaient capables de faire, comme leur chambre. À sept ou huit ans, elles étaient jeunes, mais elles étaient prêtes à aider dans la maison. Elles passaient le balai, il restait des petits foins mais c'était assez bien fait pour les laisser continuer. C'était correct comme ça pour une fois.
Les filles lavaient la vaisselle. Elles ont fait ça longtemps. Avec le temps, les plus vieilles faisaient des choses plus difficiles et les jeunes reprenaient la place. La plus grande lavait la vaisselle, la plus petite l'essuyait. Des fois, la plus grande aimait mieux essuyer, fait que là c'était la plus petite qui lavait. Quand elle était trop petite pour être à côté du sink, elle se mettait à genoux sur une chaise.
Quand elles ont commencé à m'aider, il me semble que j'avais du lousse un peu. Tout ce qu'elles faisaient, je n'avais pas à le faire. Elles faisaient les lits des enfants, je n'avais plus besoin d'aller en haut. Elles ramassaient le linge sale et le mettaient au lavage. Toutes des choses que j'étais obligée de faire avant parce que quand les enfants se changeaient, ils mettaient leur linge à terre. J'aurais dû leur montrer et leur dire:
- «Quand tu te changes, emmène ton linge au lavage.»
Ça faisait des grosses semaines de travail ou des journées à ne pas dormir. C'était de même à l'année longue. Les nuits étaient courtes. C'était l'ouvrage de la femme, l'homme n'aidait pas dans la maison dans ce temps-là.
Les corvées
Tous les voisins du rang se mobilisaient pour faire des corvées comme pour la boucherie, les foins, construire une grange, construire une maison, bûcher.
Dans ce temps-là, vu qu'il y avait pas de scie mécanique, ils coupaient le moyen bois avec un sciotte. Après qu'ils aient fait leur petit bois, ils se regroupaient deux par deux pour couper le gros bois avec le galandar. Un galandar est une grande lame avec une poignée à chaque bout. Ça prend un homme qui pousse et l'autre qui tire. Ça se faisait à deux. Ils coupaient les arbres chez un et après, ils allaient chez l'autre. Ils abattaient tout ça ensemble l'automne.
Le monde s'aidait beaucoup dans ces années-là.
L'été et le poêle à bois
Le matin, on boulangeait notre pain, des grosses cuites de pain. Une grosse cuite, c'était environ une vingtaine de pains. Avec des grosses familles comme les nôtres, je te dis qu'un pain ne vivait pas vieux quand tu avais donné une tranche à tout le monde. Des fois, il y en a qui en prenaient plus qu'une. On faisait une cuite deux fois par semaine et c'était long parce qu'il rentre seulement quatre pains dans le fourneau. Imagine-toi qu'on chauffait longtemps et fort pour faire monter la température du fourneau. Quand les quatre pains étaient cuits, on en remettait quatre et ainsi de suite. On cuisait tard en soirée.
Un moment donné mon mari m'a acheté une machine à boulanger le pain. On mettait les ingrédients et on tournait une manivelle. Là je pouvais me faire aider par les petits gars. Ils trouvaient ça beau, c'était celui qui l'aurait le plus longtemps. Moi, je les laissais faire avec plaisir, parce que la manivelle, je ne l'aimais pas tant que ça. Vu qu'on boulangeait le pain le matin, il fallait recaler le pain, recaler plusieurs fois durant la journée. De la pâte à pain, plus tu joues là-dedans, plus elle est souple et plus la mie est belle. Il fallait rester dans la maison toute la journée pour chauffer le poêle comme dans les gros frettes et surveiller notre pain. Les enfants couchaient en haut et il n'y avait pas de châssis qui ouvraient en haut et il faisait chaud. Des fois j'allais les voir et ça me faisait de la peine de les voir. Ils avaient toutes les petites couettes du front mouillées, ils avaient chaud, ils étaient tous décachés et ils avaient chaud. La chaleur monte ben plus en haut. Un moment donné, j'ai eu une idée. Je me suis dit:
- «Au lieu de boulanger le matin, je vais boulanger le soir.»

La fournée au bon vieux temps, Musée des maîtres et artisans du Québec, 1985.9
Cette idée là d'où elle m'est venue, je ne le sais pas. J'ai essayé ça, j'ai boulangé le soir. J'ai recalé mon pain toute la veillée et à onze heures et demie, quand mon ouvrage était toute faite et que j'étais prête à me coucher, j'ai mis mon pain dans les casseroles et j'ai mis un essuie-main là dessus. Le lendemain matin, le pain était levé. J'ai cuit ça toute l'avant-midi en faisant mon dîner. Je ne chauffais pas juste pour le pain, je chauffais aussi pour le dîner. En plus, la chaleur avait le temps de s'évader au cours de la journée. Les enfants ne crevaient plus de chaleur en haut. Dès que j'ai eu cette idée là, j'ai tout le temps boulangé le soir. Ça sauvait du bois et de la chaleur. Ça en prenait du bois dans une année. La cave était pleine, on se gardait juste un petit coin de rien pour aller mettre du bois dans la fournaise et aller au carreau aux patates. Je te dis que, quand le beau temps prenait et qu'on avait plus besoin de chauffer, il ne restait plus grand bois dans la cave.
L'été quand on chauffait le poêle pour faire à manger, il faisait chaud. Vu qu'il faisait chaud, on ouvrait toujours les portes de la maison pour laisser sortir la chaleur mais ça apportait d'autres inconvénients. Les mouches entraient dans la maison. C'était noir de mouches au plafond. On n'avait pas de porte de scring dans la maison. On commençait avec rien et on greillait ça petit à petit. Une porte de scring ça coûtait pas une fortune mais quand tu gagnes vingt-cinq cennes par jours, ben...On est venu par en avoir une porte de scring et là on était content. Il y avait des mouches. Tu comprends bien, on était des cultivateurs, l'étable et les animaux étaient proches de la maison. On avait acheté une sorte de produit que l'on mettait sur le poêle, ça brûlait et ça faisait une peste écœurante. On devait sortir dehors tout le monde pendant une heure pour laisser agir ça. Quand on rentrait, ce n'était pas croyable, il faut le voir, le plancher était noir de mouches. Tu ramassais ça quasiment à la pelle. En tous cas, les mouches ça tombaient. L'expression «Ça tombe comme des mouches» doit venir de là. Ça faisait une épaisseur sur le plancher. Il y en avait pas juste trois, quatre qui tombaient au sol, c'était plein. Tu prenais le balai, tu ramassais ça et tu remplissais un porte-ordure dans le temps de le dire. Pour la nuit, on était ben, on avait pas de mouches dans la face et il y en avait pas une démone dans la maison. On faisait ça tous les soirs même quand on a eu notre porte de scring. On en avait moins, mais on en avait encore.
Les repas
Le dîner était moins long à faire quand les enfants étaient plus jeunes mais je vous dis que ça mange en vieillissant.
On faisait de la soupe à tous les jours. Le matin, avant de partir pour l'étable, je mettais ma soupière sur le poêle avec mon morceau de lard dedans et une patte de cochon. On faisait de la soupe au barley ou encore de la soupe au pois. On faisait une sorte de soupe où tout le repas était compris dedans. On faisait cuire en même temps, les patates, la viande et le barley. Une fois que tout était cuit, on sortait la viande et les patates qu'on plaçait dans des bols et la soupe dans d'autres bols. On mettait les bols dans le milieu de la table et tout le monde se servait.
Le soir pour souper, c'était du chiard avec des grillades de lard. On coupait les grillades de lard qu'on faisait nous-même. Quand on tuait notre cochon, on gardait le lard, on le coupait par lisière et on le salait dans des jarres. Après, on faisait un beau chiard brun là-dedans. Du chiard avec du sirop noir, je te dis, quand les jeunes ont eu douze, treize ans, il me fallait un grand chaudron pour en avoir assez pour tout le monde. Après venaient les desserts. C'était surtout des gâteaux, je ne faisais pas de tartes souvent. J'avais un grand plat et je mettais de la cassonade dans le fond ou du sirop d'érable quand on pouvait à en avoir. Je mettais mon gâteau là-dessus. Ils avaient leur sucrage en même temps que le gâteau. Les enfants aimaient bien ça.
Dans le temps, on mangeait beaucoup de viande, des rôtis, du poulet, etc. Des fois, on pouvait manger du macaroni mais les autres pâtes comme le spaghetti, la lasagne, je ne connaissais pas ça. Nous autres, ce qu'on faisait dans ce temps-là pour souper, c'était de la sauce, pour ménager les patates. On mettait moins de patates, on l'épaississait avec de la farine et on cassait des œufs dedans. Ça faisait un souper de première classe et ça coûtait quasiment rien. Des fois, il y en a qui disaient:
- «Chez un tel, ils ont été élevés à la sauce.»
Ils étaient élevés à la sauce mais au moins ils mangeaient. Ça arrivait souvent qu'on mange de la sauce. Moi-même, j'en ai faite.
On mangeait deux bons repas par jour. Le midi, c'était de la soupe avec de la viande dedans. Ceux qui n'aimaient pas ça, mangeaient autre chose, des cretons, des beans.
Les dimanches
Les dimanches ressemblaient à une journée de semaine excepté qu'on allait à la messe. Il y avait autant d'ouvrage à faire le dimanche que la semaine. La routine ne changeait pas parce que c'était dimanche. Il fallait s'occuper aussi des couches, des repas et de la besogne. Ça n'empêchait pas les enfants de faire des dégâts. Il n'y avait pas de différence, on travaillait autant le dimanche que la semaine.
Il restait toujours quelqu'un à la maison pour garder les plus jeunes de cinq ans en descendant lors de la messe du dimanche. Une semaine, c'était Carmen qui gardait, l'autre semaine c'était Nicole pour permettre à Carmen d'aller à la messe. Encore une autre semaine, c'était moi qui restais à la maison et les filles allaient à la messe. Dans ce temps-là, la messe c'était très important. Pas besoin de les traîner par les oreilles pour y aller. C'était son dimanche, il se préparait et allait à la messe.
Le dimanche, on s'habillait propre. Les filles mettaient leur petite robe que je leur avais faite dans une robe que ma grand-mère m'avait donnée. Je leur avais fait des belles petites robes avec de la dentelle, une petite jupe godée avec une grosse boucle dans le dos. Autour du collet, il y avait de la dentelle, une petite boucle icitte, une petite boucle là. Elles étaient fières avec leur petite robe du dimanche. Elles la mettaient pour aller à la messe et au retour, elles l'enlevaient et en mettaient une autre. Les garçons aussi, ils avaient un petit habit pour aller à la messe qu'ils ne mettaient pas la semaine. Tout le monde en arrivant de la messe se changeait pour mettre le linge de semaine. La messe était à neuf heures le matin. Elle était longue, je pense même qu'elle était plus longue que celle d'astheure. Il y avait peut-être plus de prières à lire. En tous cas, on trouvait ça long. La messe du dimanche était plus solennelle, il y avait plus d'artifices, de monde, des servants de messe. Il y avait des chants dans le chœur. Dans la messe de semaine, le curé s'organisait tout seul. Dans ce temps-là, pour aller communier, il ne fallait pas déjeuner. On devait être à jeun. Si tu avais pris une gorgée d'eau avant d'aller communier, tu ne pouvais même pas recevoir la communion. Dans ce temps-là, c'était le curé qui venait te porter l'hostie sur la langue. Tu n'avais même pas le droit d'y toucher. C'est comme ça que ça marchait à l'époque, c'est plus lousse maintenant.
Chaque famille avait son banc à l'église. C'était six piastres par année. Ces six piastres en valent bien vingt-cinq aujourd'hui. L'argent était dur à gagner, les gens ne recevaient pas beaucoup par jour. Si on ne pouvait pas payer notre banc, ils le vendaient à un autre. Il y avait toujours un avertissement qui disait:
- «Dimanche prochain, c'est la vente des bancs. Ceux qui n'auront pas payé, vos bancs seront vendus.»
Ceux qui voulaient garder leur banc avaient la semaine pour le payer. Ceux qui n'y allaient pas, le dimanche suivant, leur banc était vendu. Quand le monde ne payait pas leur banc durant la semaine, le curé prenait le nom et le numéro du banc et annonçait:
- «Il y a trois bancs à vendre, voici les numéros. Ceux qui sont intéressés, aujourd'hui c'est la vente des bancs.»
Ceux qui voulaient avoir un banc restaient debout en arrière ou ils s'assoyaient dans les marches d'escaliers. Des fois, certaines personnes avaient de la place et leur offraient de s'asseoir avec eux. Mais c'était ben mieux quand t'avais ton banc à toi. Dans ce temps-là tout le monde avait besoin d'un banc parce qu'ils emmenaient leurs jeunes enfants et ça prenait de la place. Si quelqu'un n'était pas capable de payer en argent, il pouvait toujours s'arranger avec monsieur le curé. Il leur disait:
- «Donne-moi un journée d'ouvrage pour payer ton banc.»
Nous autres on en avait deux, un dans le jubé l'autre dans l'église en bas.
On revenait de la messe vers dix heures et demie, des fois onze heures quarante-cinq. Je préparais le dîner un peu avant, quand j'arrivais, le poêle chauffait, je mettais les patates sur le poêle. Je faisais le feu plus gros, je mettais du bois dans le poêle. Ça ne prenait pas de temps, je mettais les patates en plus petits morceaux. Le temps de faire chauffer la viande et tout ça, les patates avaient le temps de cuire. Les petites filles mettaient la table, quand elles sont venues assez grande pour le faire.
Il y avait une messe à tous les matins vers sept heures. Les enfants qui étaient assez grands pour aller à l'école allaient à la messe. Ils s'habillaient, allaient à la messe, revenaient, déjeunaient et s'en retournaient à l'école. Une bonne fois, ils avaient été à l'école avec un petit habit que j'avais fait dans un vieil habit d'homme. Ils n'avaient pas eu le temps de se changer parce que c'était la messe du vendredi du mois. Si tu faisais les neuf vendredis de suite, tu étais certain d'aller au ciel. Il y avait autant de monde à la messe ce vendredi-là qu'à celle du dimanche. La messe du vendredi du mois était plus tard, les enfants y avaient été et ils avaient déjeuné mais ils n'avaient pas eu le temps de se changer. Ils ont été à l'école avec leur habit qu'ils mettaient pour aller à la messe. La maîtresse d'école dit:
- «Vous êtes donc ben beaux à matin!»
- «C'est maman qui a fait ça.»
- «Hein! Ce n'est pas vrai!»
- «Hé oui! C'est maman qui a fait ça. Elle a fait ça dans du vieux linge. Elle défait toute ça et elle refait du neuf.»
Le soir elle vient chez nous et dit:
- «Les enfants vous ont-t-ils dit ça que je les avais trouvé chics ce matin avec leur bel habit sur le dos?»
- «Ben oui, c'est parce qu'ils ont été à la messe et quand ils sont revenus, ils n'ont pas eu le temps de se changer.»
- «C'est vrai que c'est vous qui avez fait ça?»
- «Ben oui, c'est moi!»
- «Vous êtes vraiment bonne.»
Elle a trouvé ça extraordinaire.
La Religion
Pour tout le monde dans ce temps-là, la religion était quelque chose de très présent. Ce n'est pas comme astheure où il n'y a presque plus de religion. Chez nous après le souper, on allait jouer dehors. À sept heures, quand c'était le temps du chapelet, maman sortait dehors et nous disait:
- «Venez, il faut dire notre chapelet.»
On laissait tout là et on rentrait dans la maison toute la gang. On disait le chapelet avec les Mystères du Rosaire. La prière, les actes de contrition, d'espérance, de charité et les dix commandements de Dieu. Ça finissait plus, ça durait presque une heure. Le mystère de la croix, du chemin de croix, du Seigneur. À chaque station, il y a des prières qui se disent. Quand on fait un chapelet, on fait cinq mystères. Le mystère c'était une prière qu'on apprenait pas par cœur. Il y a cinq dizaines dans un chapelet, ça fait qu'il y a cinq mystères. La prière durait environ une demi-heure et se faisait à genoux. C'était pas mal toujours à la même heure. Il pouvait arriver qu'on ait du retard ce qui nous amenait à souper plus tard. Au lieu d'être à sept heures, c'était à sept heures et demie. C'était à tous les soirs. Si on avait de la visite, elle faisait le chapelet avec nous autres.
Dans les églises avant, ça parlait tout bas, si ça parlait. Astheure, ils rentrent dans les églises, il n'y a aucun respect. Ça parle fort, ça rit. Avant, les gars ne devaient rien avoir sur la tête. Les femmes, elles, n'avaient pas le droit d'aller dans l'église nu-tête. Il fallait avoir un chapeau. Une fois, des tantes, des sœurs à maman, étaient venues se promener et elles voulaient voir l'église. Mais, elles étaient venues pas de chapeau. Pour pouvoir entrer dans l'église, elles ont mis des mouchoirs blancs sur leur tête. Les femmes devaient avoir un chapeau sur la tête tandis que les hommes, eux, devaient l'enlever. Les femmes devaient aussi avoir un collet haut, du moins pas de décolleté.
La dîme, c'est une loi de l'Église. C'est un montant d'argent fixe que tout le monde donne pour aider à l'entretien de la bâtisse. La dîme s'élevait à une vingtaine de piastre par année. Souvent le curé passait faire sa visite et il y en a qui en profitaient pour la payer lors de son passage. Si on la payait pas à la visite du curé, il fallait allez la payer au presbytère. C'était un honneur, une fête de recevoir le curé chez nous. Monsieur le Curé annonçait le dimanche, il disait, exemple:
- «Aujourd'hui, je fais la Bellevue.»

Visite de la quête de l'Enfant-Jésus, Musée des maîtres et artisans du Québec, 1985.8
On savait qu'il venait mais on ne savait pas à quelle heure. On faisait un ménage à tout casser pour que ça soit beau pour sa visite. On mettait des chandelles. Monsieur le curé arrivait, on se mettait à genoux et il nous bénissait. Il disait trois «Je vous salue Marie». On se levait et lui s'assoyait. Il ouvrait son livre et s'informait comment ça allait.
La religion à l'école
La religion à l'école, c'était pareil, c'était sévère. Il fallait que tous les élèves participent. Quand on arrivait à l'école le matin, on disait trois «Je vous salue Marie» et une petite prière. À tous les midis, on disait le chapelet au complet. Il y avait toujours quelqu'un qui disait le chapelet, quand ce n'était pas la maîtresse d'école, c'était une plus vieille des petites filles et nous autres on répondait. Le soir, il y avait une petite prière avant de partir de l'école. Elle nous disait, faites vos sacs et quand nos sacs étaient faits, on se levait debout et on disait trois «Je vous salue Marie» et un «Notre Père». Dans le chapelet du midi, on disait les cinq dizaines de chapelet mais il n'y avait pas de Mystères. Des fois, elle le faisait dire par plusieurs, un disait une dizaine, l'autre un autre dizaine et ainsi de suite. Tout dépendait de la maîtresse d'école. C'était spécial! Une fois ou deux par année, monsieur le Curé venait. Il venait voir comment ça allait, les élèves. Il faisait des petites remontrances sur la charité chrétienne. Il ne voulait pas que les enfants en prennent un en aversion. Il disait:
- «Vous êtes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Toi t'es un Gagnon, toi t'es un Ouellet mais vous êtes tous des frères en Jésus-Christ. T'as pas le droit de fesser sur un, fesser sur l'autre, haïr un et aimer l'autre. Faut que ce soit égal.»
Ils n'ont pas toujours écouté. Avec une gang de même, il y en a des fois qui se foutaient des recommandations du curé, ils se chicanaient. La maîtresse d'école les reprenait, elle les mettait en punition comme dix ou quinze minutes à genoux, faire des devoirs de surplus ou écrire un petit papier à celui avec qui ils s'étaient chicanés pour lui demander pardon. Ils n'aimaient pas ça ben, ben mais ça créait la bonne entente. C'est peut-être pour ça qu'entre voisins, il y avait beaucoup d'entraide. Si un voisin était malade, tout le rang se déployait pour l'aider.
Moi, je trouve que la religion c'était vraiment important. Le curé portait toujours la soutane. On ne l'a jamais vu à part qu'en soutane. Astheure, on les voit aussi en habit. Quand ils ne sont pas à l'église, souvent, ils sont en habit.
Avant de faire la première communion, il fallait marcher au catéchisme. Ils ne faisaient pas ça à l'école. C'est sûr, ils le commençaient à l'école mais pour faire la grande communion solennelle, il fallait marcher au catéchisme. C'était un curé qui l'enseignait et ça durait une semaine. Moi je ne l'ai pas fait, ce sont mes frères plus vieux qui m'ont dit que c'était de même. Ils avaient un petit brassard blanc avec des pendants dorés autour du bras, la cravate dans le cou. Je te dis que c'était toute une fête. Le catéchisme en lui-même, c'était un livre de religion de questions et réponses que tu apprends par cœur Quand il te pose des questions et que tu réponds la bonne réponse, tu as des notes et tu es apte à faire ta première communion solennelle parce que tu sais ton catéchisme. Tu faisais ta petite communion à sept ans, ta grande communion à douze ou treize ans ensuite tu faisais ta confirmation. C'était tous des sacrements qui avaient raison d'être. Il fallait au moins quatorze ans pour être confirmé et c'est l'Évêque qui venait. Il y en a qui se faisaient confirmer vieux parce qu'il leur manquait un an pour avoir l'âge et que l'Évêque revenait seulement tous les quatre ans. Il confirmait tous les élèves de la paroisse du même coup.
Pour allez au catéchisme, il fallait y aller à pied. Mon frère Léo, comme on restait à la Bellevue, était obligé de rester chez mon grand-père Ouellet. Les autres étapes, comme la petite communion, se faisait dans les écoles. Il y avait seulement la grande communion solennelle et la confirmation qui se faisaient à l'église.
Pour montrer au Seigneur qu'on s'en-gageait, les garçons portaient un brassard et les filles portaient la robe blanche et le voile. Comme les soldats, ils portent une marque, un brassard, une épinglette pour s'afficher ou montrer son engagement. C'était pareil pour la confirmation, il y avait l'étampe du Saint-Sacrement qui était apposée sur le brassard. Tous ces gestes ou signes disaient: «Je m'engage dans la religion catholique. Je veux être un catholique.»
Le Carême
Le carême commençait quarante jours avant Pâques et finissait à Pâques. Le vendredi de la semaine Sainte, c'était maigre jeûne. Durant le carême, il y en avait des jours maigres. Maigre voulait dire que tu pouvais manger à ta faim mais rien de gras. Mais, maigre jeûne voulait dire que tu ne mangeais pas à ta faim. Exemple, au déjeuner, tu mangeais une toast avec un verre d'eau au lieu d'une toast avec des confitures et un verre de lait. Le dîner et le souper, tu mangeais normalement mais on servait de plus petites portions.
La semaine Sainte était spéciale parce qu'il fallait faire carême, nos chemins de croix et se priver de nourriture toute la semaine.
Le dimanche de Pâques au midi, on pouvait avoir du chocolat, un gros dîner et se bourrer tant qu'on pouvait. C'était la fête. On fêtait avec un bon repas. Un beau gros coq dans la rôtissoire, du cochon, du bœuf, des patates en masse, des légumes, du pain avec du sirop. Tu pouvais manger ce que tu voulais le dimanche de Pâques, tu te régalais pour avoir fait carême pendant quarante jours.
Le chemin de croix se faisait le vendredi Saint. On lisait une prière pour chaque station. Les stations ce sont les images sur le mur qui commencent à gauche. Il y en a quatorze, sept d'un côté et sept de l'autre. Lorsqu'on est rendu en avant, on se rend devant l'hôtel et on récite une autre prière pour terminer. Ça durait une bonne demi-heure.
Le mariage
Pour rester avec un homme, il fallait se marier. Ceux qui ne se mariaient pas se faisaient montrer du doigt. Les gens placotaient dans leur dos:
- «Elle reste avec un gars pis elle n'est pas mariée. Pis c'est ci. Pis c'est ça.»
Ce n'était pas qu'un petit scandale, une fille qui restait avec un gars et qui n'était pas mariée. S'ils avaient des enfants, c'était encore ben pire. Ils ne voulaient même pas les baptiser parce que c'était les enfants du péché. C'était beaucoup trop sévère dans le temps pour ce que c'est maintenant.
Je me suis mariée le cinq janvier 1943 à sept heures. Le mariage terminé, nous sommes retournés chez mes parents. Mon frère Léo, parce que je me mariais, voulait se marier aussi. On s'est mariés les deux dans la même journée. Vu qu'on se mariait tous les deux la même journée, ça me prenait un père et Léo aussi. On n'en avait rien qu'un père. Il ne pouvait pas accompagner les deux. Léo voulait absolument que ce soit papa qui l'accompagne à l'église. Lui a eu son père et moi j'ai eu mon oncle Ti-Jos Lévesque, le frère à maman.
Nous sommes allés au mariage en voiture tirée pas des chevaux. Mes frères, le Bis et Lucien, avaient fait des tresses avec leur crinière et ils avaient mis des boucles de ruban. Il y en avait après l'attelage, après la voiture. C'était beau!
On n'était pas obligés de se marier en noir et blanc, mais il fallait que la femme ait un chapeau par exemple. Dans ce temps-là, c'était encore la mode des chapeaux dans l'église. J'avais un chapeau de velours et un beau manteau rouge vin avec une pelleterie. La robe en dessous, j'aurais pu y aller comme je suis là, parce qu'elle paraissait pas. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, ils nous ont fait à déjeuner. Il y avait des petits bouquets, des petites décorations un peu partout sur les tables. Nous sommes restés là jusqu'à deux heures et demie. On chantait des chansons, on jouait de la musique. Il y avait monsieur Philippe Beaulieu qui chantait comme Tino Rossi. C'était beau!
Dans l'après-midi, Léo est descendu souper à Sainte-Françoise parce que ses beaux-parents y restaient. Nous autres, notre souper était chez Charles. Les frères à Yvon sont venus veiller, mes frères sont aussi venus. Il n'y avait pas de musique, on faisait juste parler. Ça été ça notre voyage de noces. Faut dire qu'à l'époque ce n'était pas courant de faire des voyages de noces.
Le deuil ou la mortalité
Un sujet plus triste, plus sombre, le deuil. Les gens touchés par la mortalité dans leur famille, s'habillaient tout en noir. Les bas, l'habit, les souliers, la robe, tout était noir. Les hommes qui ne pouvaient pas avoir d'habits noirs, ils portaient un brassard noir pour montrer qu'ils étaient dans le deuil. Le grand deuil durait un an. Au bout de six mois, c'était le semi deuil. Il pouvait mettre du gris. Ils ne mettaient pas de couleur. On allait jusqu'à teindre en noir les froques carottés que les gars mettaient pour travailler. Tous les membres de la famille devaient porter du noir sans exception à longueur d'année. C'était exagéré pas à peu près.
Il n'y avait pas de salon funéraire dans ces années-là; les morts étaient exposés dans les maisons. Je me rappelle un moment donné le monsieur qui restait en face de chez nous à la Rallonge est décédé. Le soir mon père et quelques autres personnes sont allés l'installer. Ils ont pris des morceaux de bois comme des chevalets qui servent pour scier du bois. Ils en ont pris deux, ils ont mis deux madriers là-dessus et ils y ont mis un drap blanc. Ils ont couché le monsieur sur le drap avec un oreiller. Il avait son habit, sa cravate dans le cou et il était couché là-dessus. C'est comme ça qu'ils étaient exposés. Le lendemain, la voiture, pour emmener le corps, c'était un corbillard à cheval. C'était un cheval noir qui était attelé sur une belle voiture, toute noire avec des belles décorations sur le toit, sculptées à la main. Quand le corbillard arrivait, ils mettaient le monsieur dans la tombe.
Ils embarquaient la tombe dans le corbillard et l'amenaient à l'église. Après le service, ils le remettaient dans le corbillard et l'apportaient à la charnière l'hiver. L'été, ils allaient directement l'enterrer. L'été c'était un bogey qui était attelé sur le cheval noir. Le bogey avait un top avec ces dentelles-là fabriquées après. C'était spécial, ce n'était pas une voiture comme une autre. Ce n'était pas un bogey que tu voyais à tous les jours. Il avait un top et des sculptures dessus et des arrangements de fer forgé.
Dans ce temps-là c'était de la vraie religion. C'est trop facile maintenant, trop laissé de côté. Il passe dans le vide là-dedans et ils font rien de spécial. La religion n'a plus de signification.
Le temps des fêtes
Le temps des fêtes commençait à la messe de minuit. Les plus jeunes demeuraient à la maison et le reste de la famille partait pour la messe. On y allait en voiture à cheval sous des grosses couvertes ou peaux de carriole.

Le retour de la messe de minuit, Musée des maîtres et artisans du Québec, 1985.12
Après la messe, maman préparait sa table et c'était le réveillon. C'était toujours un peu spécial, c'était des choses qu'on avait un peu plus rarement, qu'on ne mangeait pas à tous les jours. Pour le dessert, elle faisait des beignes et les accrochait dans l'arbre de Noël. C'était donc spécial! Elle nous en faisait de temps en temps des beignes durant l'année, mais elle les mettait sur la table dans un plat. Mais, parce qu'ils étaient accrochés dans l'arbre de Noël, ils étaient encore meilleurs, plus significatifs. Notre dessert, c'était un cadeau dans l'arbre de Noël.
Chez nous, comme on n'était pas riche, que nous étions une grosse famille et que maman était adroite de ses mains, elle avait fait une belle crèche en carton. Elle avait pris un petit Jésus qu'elle avait découpé sur une carte de Noël et l'avait couché là-dedans avec des petits brins de paille. Elle disait:
- «Quand vous faites des sacrifices, prenez une petit brin de paille et mettez-le dans le petit berceau du petit Jésus.»
Le petit Jésus n'était pas dans la crèche avant le soir de Noël à minuit. La crèche était prête, le petit berceau était là, mais le petit Jésus n'était pas dedans. Quand on arrivait de la messe, le petit Jésus avait repris sa place dans la crèche. Si on faisait des sacrifices ou des ouvrages qu'on n'aimait pas faire, on allait chercher un petit morceau de paille et on le mettait dans le berceau. Maman disait:
- «Si vous voulez que le petit Jésus soit bien couché, il faut que vous fassiez des sacrifices. S'il y a juste trois, quatre brins de paille, le petit Jésus ne sera pas ben couché!»
Nous autres, on le faisait et on y croyait. Elle mettait, en plus, une petite chandelle devant la crèche. Ça ressemblait encore plus à une église avec la chandelle allumée.
Après avoir mangé notre beigne, tout le monde, du plus jeune au plus vieux, on ramassait toute la vaisselle pour aider maman à débarrasser la table. Ensuite, c'était le temps des cadeaux. Mes parents, étant pauvres dans ce temps-là, ne pouvaient pas acheter de cadeaux. C'était maman qui les fabriquait. Elle faisait des chevaux aux petits gars, des poupées aux petites filles. Elle nous faisait des poupées en linge et elle bourrait avec de la guenille et de la ouate. Elle faisait les yeux de la poupée avec de l'encre, la bouche avec des crayons de couleur. Pour faire les cheveux, elle allait chercher de la laine sur le dos du mouton qu'elle teignait. Elle leur faisait de beaux arrangements. Il y a avait des poupées qui avaient des petites robes, d'autres avec des tabliers. C'était du linge qu'on pouvait enlever et remettre. Ils duraient longtemps dans ce temps-là les poupées. Quand je me suis mariée, j'avais encore la mienne.
Les petits gars, eux, elle leur faisait des chevaux dans du bardeau pour couvrir les maisons. Elle taillait un cheval dans son bardeau et elle le collait avec des braquettes. Le cheval tenait debout à cause de ça. Elle leur faisait des voitures avec des boîtes d'allumettes de bois. Elle collait du carton après ça pour faire une manière de ménoires et elle allait attacher ça après le cheval avec une braquette. La voiture était en arrière du cheval et ils mettaient des bonbons, toutes sortes d'affaires dans cette petite voiture. Ils se promenaient sur le plancher avec leur petite voiture et leur cheval. Ils se rencontraient et ils se parlaient. Ils faisaient l'air qu'ils allaient au magasin acheter de la marchandise. Ils faisaient les hommes et ils se donnaient même des noms: un c'était mon oncle Eugène, l'autre, c'était mon oncle Dollard, etc.
Ils nous auraient donné... je ne sais pas comment, mais on aurait pas été aussi content.
Le soir de minuit, on prenait chacun un bas qu'on accrochait sur la rampe d'escalier et on allait se coucher. Le père Noël passait dans la nuit et mettait plein de choses dedans; une poignée de peanuts, une orange et une pomme.
Le matin quand on se levait, on décrochait notre bas et on remontait en haut pour découvrir ce qu'on avait. Nous avions tous la même chose. Il n'y avait pas de jaloux. Plus tard, quand ils ont eu plus d'argent, ils nous donnaient chacun un petit sac de bonbons. Le vingt-quatre décembre se passait comme ça, juste dans notre maison, avec notre petite famille.
Nous aussi, au début, on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter toutes sortes d'affaires aux enfants. Ça fait que les poupées, je les faisais et les habillais. Les petits gars, c'était pareil, je leur taillais des chevaux en carton.
[Voir l'image pleine grandeur]

Ça pris une couple d'années avant d'être capable de leur acheter des petits cadeaux que l'on prenait dans le catalogue Dupuis. On commandait ça de Montréal. On avait des bons de commande et on commandait ce qu'on voulait. On a acheté une poupée, une petite salle de bain en plastique pour poupée pour les filles. Une belle poupée, c'était dix-neuf cennes. Pour les gars c'était des petits chevaux, des animaux, des voitures qui valaient dix ou douze cennes. C'était pas cher mais tout additionné ensemble, ça faisait quelques piastres. Les enfants étaient ben contents de leurs petits cadeaux. On les enveloppait avec des sacs bruns ou de la gazette, on n'avait pas de papier d'emballage comme aujourd'hui.
Pour garnir mon sapin de Noël, comme je n'avais pas de boules, de guirlandes et de glaçons, j'avais fait des animaux. Toutes sortes d'animaux, des voitures attelées, des chevaux, des rennes qui tirent le père Noël dans un traîneau avec des cadeaux sur le dos. Il y avait aussi des clowns, un la patte en l'air, l'autre la patte en arrière. Il y en avait de toutes sortes faits avec des crayons de couleur. Je travaillais ça le soir quand les enfants étaient couchés et je les cachais dans une boîte en dessous de mon lit.
Le soir de minuit quand Yvon allait à la messe avec les plus vieux, je restais à la maison pour garder les bébés. Je greillais mon arbre de Noël. Je mettais un brin de fil en arrière de mon carton pour pouvoir l'accrocher après l'arbre. J'en avais fait assez que l'arbre était chargé, chargé. J'avais fait une petite crèche moi aussi comme maman. J'avais fait un petit berceau et j'avais pris un petit Jésus et une Sainte Vierge découpés sur une carte de Noël. J'avais tout plein de personnages comme la Sainte Vierge, le Saint Joseph, le petit Jésus, des anges. Je leur avais mis du carton dans le dos pour qu'ils tiennent debout. C'était de l'ouvrage, mais ça faisait beau. Quand ils revenaient de la messe de minuit, là c'était la surprise. Ils trouvaient tu ça beau! C'est des souvenirs qu'ils n'oublieront jamais comme j'oublierai jamais mes Noëls chez nous, chez mes parents.
Le jour de l'an, ça se passait chez les grands-parents. Le repas se donnait là et tout le monde se réunissait là mais sans les jeunes enfants. Papa et maman y allaient mais nous autres, on restait chez nous et on gardait les enfants plus jeunes que nous autres. Quand on est venu plus grand, là c'était différent, on pouvait y aller parce que c'était mes frères et mes sœurs Un soir, c'était chez nous, le lendemain soir, c'était chez Léo et un autre soir c'était chez le Bis et ainsi de suite. Ça durait longtemps, on était dix-sept enfants dans la famille et on les visitait tous. Si un soir il y avait une tempête, la veillée était remise au lendemain. Le jour de l'an pouvait durer tout le mois de janvier. Avec les années, ça c'est calmé. Les familles ont grossi. Aller veiller sans les enfants, c'était plate, et les emmener, ça faisait trop de monde.
Dans ces veillées-là, on chantait des chansons et tout le monde chantait. Il y avait aussi Alain, le mari à Thérèse, qui jouait du violon. C'est un joueur de violon extraordinaire. Je te dis que quand, il était là, le violon faisait du feu. On tassait les chaises et on dansait.

Une veillée d'autrefois, Musée des maîtres et artisans du Québec, 1985.11
Personne ne se faisait prier pour chanter. C'est pour ça que j'aime chanter, j'ai tellement entendu chanter chez nous. Maman était une chanteuse aussi. Elle chantait tout le temps. Elle travaillait et chantait, elle berçait des bébés et elle chantait. Mon père aussi chantait très bien. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est pour ça qu'il n'était pas d'accord qu'on aille à l'école. Lui ne savait ni lire ni écrire et il avait réussi sa vie. C'est sûr qu'il avait réussi sa vie mais de peine et de misère. Quand tu es obligé de faire un contrat et signer avec un x. J'ai vu moi les mariages des plus vieux, mon père signer avec un x. Un moment donné, maman a montré à mon père à signer son nom. Il avait de la misère. Elle lui as-tu montré assez longtemps pour qu'il vienne à le savoir! Il le faisait comme elle lui avait montré mais il ne savait pas c'était quoi les lettres. Pour lui, c'était comme un dessin. Maman savait lire et savait écrire. Elle le savait très bien. Des fautes, je pense qu'elle n'en faisait pas.
Mon arbre
Salut à toi mon arbre, toi, partie et reflet de moi-même. En racontant ton histoire, c'est celle de ma propre vie qui renaît et apparaît ici.
C'était hier à peine, tu avais commencé à prendre racine dans la Rallonge de mes jeunes parents, entourés des oncles et des tantes dont je garde tant de beaux et fidèles souvenirs.
Tu étais un bien petit arbre en ce temps-là, sans beaucoup de racines; on ne t'a point brisé, à l'époque, quand on t'a transplanté de la Rallonge au 8ième rang. Tu n'as même pas flétri. Puis on t'a encore arraché de là pour te replanter à la Bellevue sans te faire de grands dommages.
C'est là, à la Bellevue, que tu as pris racine pour de bon et que tu as grandi. Tes racines ont descendu profondément dans le sol et tes branches s'élançaient vers le ciel chaque jour un peu plus haut. Tu poussais dans un sol riche, dans de la bonne terre enrichie de l'amour de tes enfants, de tes frères et sœurs. Malgré la tempête, malgré la tourmente, malgré la foudre et les vents cruels et rageurs, tu restais planté là, debout, sans gémir, tel un majestueux chêne, jusqu'au retour du beau temps. Tu étais le roi de ta forêt et le couvert de ta feuillée était le refuge des âmes ou des cœurs affligés.
Un jour pourtant, contre toute attente, on t'a arraché de ton habitat, de ton sol complice; imaginez le dégât! Un arbre de cette grosseur-là, c'est enraciné creux, c'est solide. Il faut prendre le temps et bien des précautions pour arracher un arbre comme ça. Toi, sans crier gare, sans prendre le temps et les précautions nécessaires, on t'a arraché de force. Les racines ont cassé, les branches ont été abîmées et la terre qui te donnait la vie t'était enlevée. En te replantant à Saint-Jean-de-Dieu, dans ces conditions, il te fallait un instinct de vie extraordinaire pour ne pas mourir. Tu savais sans doute combien ton feuillage manquerait à tous ces cœurs affligés qui venaient s'y abriter.
Pauvre arbre! Comme tu as souffert! Tu étais brisé, trop brisé. Tu aurais eu besoin de soins, d'engrais, d'arrosage, d'ingrédients qui ont pour nom AMOUR, TENDRESSE, COMPRÉHENSION, COMPASSION... et pourtant tu n'as rien eu du tout. La maladie s'est installée dans ton corps et dans ton âme et, pire qu'une gangrène, t'a dévoré peu à peu et t'a vidé de ta substance. La terre nourricière à laquelle tu t'étais liée au fil de toutes ces années, ne pouvait être remplacée en quelques années. Tu as vécu toi aussi le phénomène du REJET. Tout t'était inconnu; tu ne reconnaissais plus les gens, ni le climat, ni l'environnement. Tu ne te reconnaissais plus toi-même. Tu mourais à tout ce qui t'avait fait, à la Bellevue; tu mourais à toi-même dans cet «autre monde» inconnu. Telle une pluie acide, tes larmes ont coulé pour te faire dépérir et peu à peu te dessécher.
Au premier printemps, à peine quelques bourgeons ont éclos et quelques feuilles ont poussé dans ta tête. Tout le reste était dégarni et tu n'étais vraiment pas beau à voir. Tu es resté pourtant planté là, debout, en attendant que revienne la vie dans tes branches qui se mouraient. Bientôt, un coup de vent viendrait mettre un terme à ton existence. Tu étais devenu un arbre de surface, sans prise solide et chaque jour plus faible. La vie ne coulait plus en toi et tu n'attendais plus que la mort vienne marquer le dernier de tes jours.
Oui, c'est bien beau tout ça, mais faut pas oublier que c'est à cinquante et un ans qu'on t'a transplanté; ne trouvez-vous pas que c'était pas mal vieux pour entreprendre une seconde vie en terre nouvelle?
Sans doute, mais c'était pourtant possible. Tu mourais parce que tu ne croyais plus à la vie. Tu allais tomber parce que tu ne pensais plus pouvoir continuer de pousser. Tu t'es découragé et tu as baissé les branches comme un humain baisse les bras. C'était une erreur, c'était TON erreur d'accepter la défaite. Ce qu'il y avait de plus beau en toi tu l'as oublié et tu t'es replié sur toi-même pour attendre la fin.
Après dix-huit ans tu viens de te réveiller, mon arbre. Tu viens de comprendre. Bien sûr, tu as pris du retard, mais quel défi plaisant de faire renaître un bel arbre d'un chicot. Quelle satisfaction de retrouver l'existence d'une vie au cœur de ce qui n'était plus que «bois mort». Reprends tes ambitions, redonne-toi le goût de vivre; retrouve ta confiance et ta foi par lesquelles tu vas continuer de te tenir debout même au milieu de la tourmente; regarde vers demain, vers l'avenir. Ce n'est pas facile et c'est pour ça que la joie d'y parvenir est si grande et satisfaisante. Tu dois le faire pour toi, mais aussi pour tes amis, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tous ceux et celles qui ont cru en toi. Tu ne peux pas et tu ne veux pas les décevoir.
Tu as transformé ta beauté comme tu as transformé le charme qui t'habite. Tes courbatures, tes meurtrissures, tes cicatrices de toutes sortes te rendent encore plus attachant et attrayant. C'est une beauté taillée dans l'épreuve et la misère qui t'habite et te donne tes attraits. Cette beauté est tellement plus riche et plus grande que la simple beauté que la nature nous a donnée sans qu'on l'ait méritée, par de longs labeurs. Regarde sous ta feuillée tous ceux et celles qui te pressent, printemps après printemps, de refaire et parfaire ta beauté: Carmen, Charles-Henri, Denise, Jean-Léo, Roger, Marcel, Gervais, Thérèse, Colette, Yvon-Robert, Madeleine, Diane, Marc-André, Pauline, et regarde, regarde bien, il y a encore ceux-ci: Léo, Bis, Lucien, Marielle, Ti-Jean, Thérèse, Fernand, Anne-Marie, Irène, Raymond et Paul.
Tu es content! Tu es fier maintenant! Continue mon arbre car on te trouve bien correct de t'acharner à vivre et à t'embellir comme tu le fais. Bravo et sache que c'est comme tu es et pour ce que tu es qu'on t'aime. Ta lutte pour te faire plus beau dans ta seconde vie nous touche et nous font, à ton endroit, lever notre chapeau.
Midas
Oui ma vie à Saint-Jean-de-Dieu au onze de la Villa n'a pas été facile, je n'étais pas capable de me sentir chez nous. J'étais tellement gênée, je ne sortais pas. Je sortais le soir pour aller à la messe. J'espérais toujours ne pas rencontrer personne, mes voisines essayaient de m'approcher, faire connaissance, mais j'étais tellement prise dans ma souffrance, mon ennui de la Bellevue que je ne voulais voir personne. Mais petit à petit, elles ont fini par m'apprivoiser et m'emmener à l'Âge d'Or.
Je me suis assise près de la porte et j'ai pas bougé de là, même si j'avais une soif terrible, je n'étais pas capable de me lever de sur ma chaise et d'aller boire un verre d'eau. Madame la présidente avait entendu dire que je chantais, elle me demande pour chanter. «Oh mon Dieu! Quel supplice!» Je m'exécute après bien des supplications. Si vous m'aviez vu, je tremblais comme une feuille, le cœur dans la gorge, je finis par faire ma chanson. Ça pas arrêté là, dès que je mettais les pieds à l'Âge d'or, fallait que je chante et petit à petit ma gêne a fini par diminuer. J'ai pris confiance en moi et là je ne me faisais plus prier pour chanter et conter des histoires. Pas toujours propres, propres, les gens riaient à pleine gueule et ça m'encourageait à aller encore plus loin. J'avais une mémoire phénoménale. J'entendais une histoire une fois et je la savais. Je suis devenue très populaire: «le clou de la soirée».Vu que j'étais toute seule toute la journée, mon mari partait le matin et revenait le soir pour souper, j'avais plus de besogne à faire, juste mon petit ménage.
J'avais bien du temps à consacrer à mes jeux. Avec une histoire, je faisais des sketchs de deux à quatre personnes, des fois plus. Là j'ai commencé à aller plus loin dans mon talent d'actrice. J'écrivais des sketchs allant même jusqu'à sept personnes. J'écrivais tout ça à la main, quand j'avais fini d'écrire mon sketch, fallait que je le transcrive en sept copies, toutes à la main. Je leur donnais mes ordres au téléphone: «Toi, tu es Alice, tu fais ça et ça». À l'autre c'était pareil, toujours par téléphone. On apprenait notre sketch par cœur, pour une seule répétition. «À la va comme j'te pousse» et c'était toujours réussi à cent pour cent. J'avais beaucoup d'imagination. Il me passait une idée par la tête, je sortais du texte et je passais mes trois ou quatre phrases que je venais d'imaginer. Je revenais toujours au texte exactement où j'avais bifurqué. Les autres, ça les mêlait un peu, elles pensaient que j'avais oublié mon texte, que j'étais partie ailleurs, mais toujours je revenais à l'endroit exact où j'avais laissé. Elles se sont habituées à ça et quand je partais comme ça avec autre chose que le texte elles n'avaient plus peur, elles savaient que je reviendrais à la bonne place. C'était drôle, je les voyais se dire:
- «Mais ce n'est pas dans le texte ça!»
C'est vrai que ce n'était pas dans le texte mais je n'y avais pas pensé en l'écrivant. Là, ça me venait à l'esprit, je le disais et ça ne dérangeait absolument pas le texte et c'était drôle. Fallait que je le fasse.
Je me rappelle, j'avais fait un sketch qui se passait à l'école et moi j'étais malcommode pas rien qu'un peu. Je passais en dessous des chaises des autres élèves c'était le bordel dans l'école. Imaginez-vous, la maîtresse m'avait mise en pénitence, pensez vous que je suis restée là? Eh bien non! Je suis partie à quatre pattes en dessous des chaises. Mon Dieu que le monde a ri. La maîtresse d'école a perdu le contrôle ça n'a pas été long. Ça aussi ce n'était pas prévu quand j'ai écrit le sketch. J'ai pensé à ça une fois en pénitence, je l'ai fait et ça été le moment le plus drôle du sketch. J'avais beaucoup d'imagination, dans tous les sketchs que j'ai faits, j'ai toujours ajouté des choses comme ça, à l'improviste.
J'habillais toutes mes actrices moi-même. J'ai fait des chapeaux, des manteaux, même un coat à queue, un chapeau de castor que j'ai fait avec une boîte de biscuits au soda, que j'ai recouverte en polyester noir. Ça me faisait un vrai beau chapeau de castor. Je passais des heures et des heures à fabriquer mes costumes et à chaque sketch c'était des habillements différents. J'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années et j'en ai fait aussi aux clubs de Saint-Clément, de Saint-Médard, de Saint-Cyprien et de Trois-Pistoles. Le bonhomme Midas était très populaire et très fortement apprécié. C'était une joie pour eux d'avoir la visite de Midas dans leurs soirées; des chansons et des histoires, ils n'en avaient jamais assez.
Je vous disais un peu plus haut que je faisais tous les costumes moi-même pour les sketchs. Quand il y avait sept personnes ça prenait pas mal d'imagination pour qu'ils soient drôles. Savez-vous que le costume est aussi important que le sketch lui-même? Ça commençait à rire dès qu'ils nous voyaient entrer avec nos accoutrements. Les costumes étaient aussi drôles que l'histoire elle-même. Je mettais bien des précautions pour l'habillement. Les gens commencent à rire dès qu'on entre, donc ça augure bien pour le reste et j'avais toujours un sketch différent à chaque mois. À part ceux que je faisais dans les autres clubs. Les gens m'appelaient et me disaient:
- «On invite votre club cette semaine, oubliez pas d'amener Midas.»
- «Ben oui, je vais amener Midas Bel air Bête.»
C'était son nom et les gens l'aimaient ce Midas-là. Je pense qu'ils aimaient plus ce Midas que madame Yvon, comme on m'appelait dans ce temps-là. Midas avait tassé Madame Yvon. Ah! Le faniant, mais je l'aimais bien car c'est lui dans le fond qui m'a aidée à contrôler ma gêne. Avec Midas, je pouvais oser faire des choses que je ne m'aurais jamais permises. Avec Midas ça passait bien; ça été ma chance pour reprendre goût à la vie, de ne plus m'ennuyer à Saint-Jean. À Saint-Médard, j'avais fait le numéro «Le mort vivant». Quand je rencontre des gens de Saint-Médard et de Saint-Guy, ils me parlent encore de ce numéro après pas moins de 20 ans. Ça veut dire que c'était bon!
Nous aussi, on invitait d'autres clubs à venir veiller chez nous. Quand le club de Saint-Simon venait, c'était en autobus. Quand je vois l'autobus en avant de la porte je suis contente et je me dis:
- «T'as besoin d'être bonne pour ne pas décevoir ces gens-là.»
À les voir rire à en pleurer, je savais que j'avais gagné. La salle est pleine à craquer, y a presque plus de piste de danse, y a trop de monde. Il faut les asseoir ces gens-là, au diable la danse. Avez-vous imaginé le succès de ces soirées-là, on vendait des billets au cours de la veillée pour aider au financement. On a vendu pour deux cent dix-huit piastres de billets. On n'avait jamais vu ça et ça a continué comme ça pendant plusieurs années.
J'ai appris des chansons à répondre et toujours déguisée en Midas, c'était moi l'homme dans toutes les chansons à répondre ou dans les sketchs. Durant l'hiver 2003, j'ai joué à Trois-Pistoles le numéro du «Mort vivant». Il a vieilli Midas c'est pas croyable, il a de la misère à se relever maintenant. Quand je pense à ça maintenant ce sont des beaux souvenirs et ça m'a beaucoup aidée à refaire ma vie à Saint-Jean-de-Dieu et à oublier un peu la Bellevue. Oui, ma Bellevue je ne l'oublierai jamais, même si maintenant mon chez-nous est à Saint-Jean-de-Dieu. Je suis heureuse ici. J'ai d'autres activités maintenant que Midas est vieux, il ne veut pas toujours venir, je ne le force pas, il a fait son temps ce cher Midas et c'est grâce à lui si j'ai repris goût à la vie et que je suis heureuse maintenant à Saint-Jean-de-Dieu. Il m'a guérie de ma gêne maladive et j'en suis très heureuse. Merci Midas! Maintenant, j'ai d'autres activités, je fais partie du groupe de prières de Saint-Jean-de-Dieu, je fais partie du groupe d'étudiants en alphabétisation. Je peux vous dire sans risque de me tromper que l'alpha dans ma vie a été aussi bénéfique que mon cher Midas. Ça m'a vraiment aidée à m'exprimer, si j'avais eu ça avant je pense que Midas aurait été encore meilleur. Ben oui, tout ce que j'ai appris, il l'aurait appris lui aussi. Voilà pourquoi il aurait été meilleur lui aussi. C'est vrai ça et je n'en démords pas, c'est venu dix ans trop tard l'alphabétisation, mais vaut mieux tard que jamais. Ça me fait de la peine de penser que Midas a manqué ça. Vous autres qui lisez mon texte ne faites pas comme Midas, allez aux ateliers d'alphabétisation. Si vous êtes bon, vous serez encore meilleurs «parole de Nanoue» alias Midas, alias madame Yvon, alias Marie-Rose Ouellet. Aujourd'hui j'ai quatre-vingt-trois ans et je ne suis plus aussi dynamique que voilà trente ans. J'ai fait beaucoup de chemin depuis et c'est de mieux en mieux, mais la capacité n'est plus là comme avant et c'est normal.
Toutes ces belles expériences font partie du passé mais ça me fait de drôles de bons souvenirs que j'aime me rappeler. C'est valorisant de se sentir appréciée des gens, de se faire reconnaître sur la rue ou dans les magasins. Je rencontre des gens que je ne connais pas mais qui me reconnaissent. Ils se rappellent de Midas, c'est normal, moi j'étais en avant avec mes chansons, mes histoires, la salle était pleine de monde, je ne pouvais pas les voir tous, je les voyais mais pas assez pour les connaître. Après, moi, vu que j'étais la vedette, ils me remarquaient plus, c'était normal. Il y a un monsieur Beaulieu de Saint-Guy qui a vu le «Mort vivant». À toutes les fois qu'il me rencontre, il me demande des nouvelles du mort vivant et il rit comme un fou. Il n'oubliera jamais ces moments et ce n'est pas le seul pour qui, en me voyant, ça leur rappelle les folies de ce temps-là.
- «C'était le bon temps, y en aura plus d'autres comme vous madame Gagnon.»
Je me fais dire ça souvent et ça me fait plaisir. Si j'ai rendu des gens heureux avec mes folies j'en suis très heureuse parce que pour moi ce n'était pas un fardeau, c'était vraiment un plaisir de faire ce que je faisais. Il y en a qui me disaient:
- «Tu es cent fois meilleure que la «Poune». Elle aussi s'appelait Rose Ouellet. Tu aurais fait une belle paire avec Olivier Guimond.»
Non, je ne prétends pas aller à la cheville de ces gens-là, mais je faisais de bons numéros, dans nos petites paroisses d'ici. C'est vrai que j'étais bien connue et appréciée pour mon côté comique et j'avoue que c'était bon. Parlez à mon frère Paul-André, il va vous dire ce qu'il pensait de moi. C'était bien flatteur, il me trouvait très bonne, un «talent extraordinaire», perdu. Perdu parce que j'avais le talent d'actrice en moi et il n'a pas été développé faute de savoir, faute d'argent, mes parents étaient pauvres. Je n'ai pas été à l'école après l'âge de douze ans, fallait bien que quelqu'un aide maman qui avait dix enfants. Pas d'électricité, tout se faisait à la main. Ça lui prenait de l'aide pour arriver à tout faire l'ouvrage qu'elle avait à faire. Maman aurait voulu qu'on aille à l'école plus longtemps, quitte à travailler plus, mais papa disait qu'une fille n'avait pas besoin d'avoir des diplômes longs comme le bras pour laver des couches et éplucher des patates. C'était ça la mentalité de ce temps-là, c'était en 1934 et j'avais onze ans. Si je savais lire c'est parce que dès que j'avais une minute de libre, la chose que je faisais était de lire, de lire et de lire encore. J'ai pas perdu le savoir lire, mais écrire je l'ai pas perdu, je l'ai jamais su. C'était ça la vie dans ce temps-là. La vie était si compliquée par la faute de la pauvreté des gens qui avaient besoin de bras pour travailler.
Les garçons c'était pareil. À dix ans, plus d'école, la grosse ouvrage sur la terre qu'il fallait défricher à la main. Ils n'avaient pas d'outils à leur disposition, tout se faisait par la force des bras. Il fallait faire de la terre pour semer du grain, semer les patates, il y avait plusieurs enfants mais chacun avait sa tâche à faire suivant son âge et sa capacité. Ça veut quasiment dire que ce sont les enfants qui faisaient vivre les parents, ça aidait en tout cas. L'automne arrivé, mon père partait avec sa poche sur le dos pour aller aux chantiers. Il gagnait vingt-huit piastres par mois avec un cheval, ça ne faisait pas cher par jour. Le chantier durait six mois, de octobre à mars. À la fin mars ordinairement, le chantier était fini et papa revenait avec cent soixante et huit piastres dans ses poches. Dans ce temps-là, cent soixante et huit piastres c'était beaucoup. Avec le temps, les fermes se sont modernisées, maintenant c'est les tracteurs, etc. Tout est mécanique mais ça coûte les yeux de la tête, mais c'est comme ça.
Les temps changent et ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on a avec dix piastres maintenant? Pas grand chose, et c'est ça la vie! Dans le fond, on ne peut pas rester comme en 1900, même pas d'électricité! Il faut suivre la parade, ça ne veut pas dire que c'est mieux aujourd'hui. Chaque décennie a ses misères et ses difficultés et ce sera toujours de même, les problèmes changent et ça continue d'être difficile mais d'une autre façon...
Pour votre information maman a eu dix-sept enfants, dont onze garçons et six filles. Les plus jeunes n'ont pas connu ce temps de pauvreté, l'électricité est arrivée en 1950. Il n'y avait pas d'autres choses que la lumière au plafond, il n'y avait pas d'appareils encore. Sur les dix-sept enfants, il n'en reste que onze, six garçons et cinq filles. Maman est décédée en 1968, elle avait soixante-huit ans. Papa est décédé en 1982, à quatre-vingt-six ans, il était au foyer Villa Dubé depuis 1971. C'est mon frère Fernand qui réside dans sa maison au village de Saint-Médard et c'est Jean-de-Dieu qui reste sur la ferme à la Bellevue et même s'il ne cultive plus, il a quand même gardé la maison. Beaucoup d'eau a coulé dans la rivière depuis ce temps. C'est ainsi que le temps passe et que nous voilà rendus vieux à notre tour, avec la chance qu'eux n'ont pas eue de faire partie du groupe Alpha et d'écrire sur leur vécu comme j'ai écrit sur le mien. Je ne remercierai jamais assez ceux qui ont eu l'idée de faire ce programme-là pour nous, les petits de la planète, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école étant jeunes. Il y en a bien d'autres comme moi. Merci pour l'alphabétisation qui m'a tant aidée à prendre un peu de place sur cette grande planète qui est la terre.
Mon mari, Yvon, est décédé en 1989, à l'âge de soixante et onze ans. C'est bien trop jeune pour mourir, mais que voulez-vous, il était pris avec le diabète. C'était un homme, une pièce d'homme bâti pour vivre cent ans mais la maladie c'est plus fort que tout, même les gros calibres, la maladie les mange pareil.
Moi, je pesais quatre-vingt-treize livres quand je me suis mariée. Mon père me disait que je n'avais pas le poids du mariage, fallait au moins peser cent livres mais j'avais une très bonne santé. J'ai travaillé fort avec mes petits bras, mais j'ai résisté et j'ai tenu le coup. Un moment donné après avoir eu quinze enfants, au seizième j'ai engraissé, je pesais deux cent quatorze. Me voyez-vous la petite carcasse de quatre-vingt-treize livres peser deux cent quatorze? C'était énorme. J'étais malade, j'aurais pas eu envie de faire Midas dans ce temps-là, j'en menais pas large. J'ai subi trois grosses opérations, j'ai failli mourir les trois fois. La pire ça été l'opération de la glande thyroïde. Je suis partie trois ou quatre minutes dans l'autre monde et je me suis souvenue que je devais un jour incarner Midas et je suis revenue sur terre. J'étais à ce moment-là à l'hôpital Laval à Québec en 1962. Après, j'ai été opérée pour le foie. Sur la table d'opération, une alvéole d'un poumon a éclaté. Encore là, je suis passée à la porte du Paradis mais je suis pas rentrée, je pensais toujours à Midas. La troisième fois, c'est une descente de vessie. Cette fois-là, j'avais la poignée de la porte dans la main mais j'ai reviré de bord et suis redescendue sur la terre toujours pour pouvoir faire vivre Midas. J'ai été deux mois et demi à l'hôpital, je ne vous raconterai pas toutes les souffrances que j'ai eu à subir avant que la santé reprenne sa place. À force de courage, de prières et de confiance, j'ai réussi de peine et de misère mais j'ai gagné encore une fois.
Le fantôme de la mort qui planait sur moi a eu affaire à disparaître et vite. J'avais plein d'autres choses à faire et je ne voulais plus lui revoir la face avant au moins cinquante-cinq ans minimum. Je ne l'ai plus revu. J'espère qu'il m'a oubliée, tant mieux, et je suis en train d'écrire: quel beau pied de nez je lui ai fait. Il est choqué et il n'est plus revenu. Il boude. Tant mieux, boude et laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir dans les parages, espèce de fantôme insignifiant. Tu vois le travail que j'ai à faire, j'ai besoin encore de quelques années, mais je sais bien que ces belles années-là avec Midas ne reviendront plus jamais. Il est trop vieux ce pauvre Midas. Il est un peu sénile et dur d'oreilles, ces folies-là ne sont plus pour lui. Il faut savoir s'arrêter quand on est vieux. Il a très bien compris et n'est pas trop malheureux de la situation. Il faut savoir de quel côté est le bonheur. Pour lui son bonheur c'est de rester bien tranquille chez lui à repenser à tout ce beau passé qui entretient sa lucidité et son amour de la vie. Il sait que je ne l'abandonnerai jamais et ça le rend heureux. Il est assis dans sa chaise, il fume sa pipe, il songe à ce passé qui l'a rendu si heureux. Moi, j'écris, j'ai le dos à lui, je pense qu'il s'est endormi. Tout d'un coup, il me dit:
- «Coup donc Nanoue, as-tu pensé de leur écrire une couple de petites histoires.»
- «Ben oui Midas, bonne idée, merci de me l'avoir fait penser. Il veut l'histoire de la madame qui avait treize enfants. Ah oui! Écoute, je te la raconte. Ça va comme ça. C'est une madame qui a treize enfants. Elle est enceinte du quatorzième quand elle a une démangeaison entre les cuisses. Elle se gratte ça pas de bon sens. Le bonhomme lui dit: "Mais sa mère, va voir le médecin, ça pas de bon sens!" Elle est choquée et continue de se gratter de plus belle. Son bonhomme lui redit: "Mais vas y chez le docteur!" Elle part et va chez le docteur, elle lui raconte son mal. Le docteur lui dit: "C'est cutané madame, c'est rien de grave, c'est juste cutané sur la peau, y a rien là, un peu d'onguent et ça va rentrer dans l'ordre." Mais elle n'a remarqué que le nom de sa maladie, «cutané». Elle s'en vient et elle est en colère. C'est de la faute de son mari. Dès qu'elle entre, il s'empresse de lui demander: "Pis c'est quoi ta maladie?" Elle répond choquée: "Cutané!" Il ne comprend pas, il dit: "C'est quoi ça cutané?" Elle répète en pesant chaque syllabe: "Cu - ta - né, cu -ta - né! Ce n'est pas si dur que ça à comprendre. J'ai le cu - ta - né." Il ne comprend toujours pas, elle se choque et lui crie: "Écoute là j'ai treize enfants, le quatorzième s'en vient, si tu étais à ma place tu l'aurais toi aussi le cul tanné!"»
[Voir l'image pleine grandeur]

Vous savez dans ce temps-là l'alphabétisation existait pas. Ces pauvres malheureux n'étaient pas capables de s'exprimer et pas capables de comprendre ce que ça voulait dire cutané. Ce n'était pas dangereux, ce n'était que cutané sur la peau.
Ensuite, une autre histoire que Midas veut que je vous raconte, celle du gars qui avait les hémorroïdes.
Le gars a mal sans bon sens, pas capable de s'asseoir, ça lui fait trop mal. Sa femme lui dit:
- «Va voir le docteur avec ça!»
Il va voir le docteur et celui-ci lui dit:
- «Ce sont les hémorroïdes que vous avez monsieur.»
Il lui donne des suppositoires et lui dit:
- «Vous mettrez ça dans le rectum!»
Le gars se dit en lui-même:
- «Que c'est compliqué l'instruction, ce monde-là ça parle en tarmes, on comprend rien.»
Il oublie le nom de sa maladie. Il se rappelle seulement du nom de l'objet qu'il a besoin pour mettre ses suppositoires. Dès qu'il est sorti de chez le docteur, il se creuse la tête pour savoir si on a ça chez nous un rectum. Je pense qu'on a pas ça, peut-être que ma femme en a un qu'elle me l'a pas dit. Dès qu'il arrive à la maison, il demande à sa femme:
- «Est-ce qu'on a ça ici un rectum?»
- «Mais voyons donc mon vieux, ça prend tout pour avoir le nécessaire. Ici, on a pas ça certain un rectum. Va chez le voisin, ils sont un peu plus en moyen que nous, peut-être qu'ils en ont un et qu'ils pourraient te le prêter.»
Il part avec sa petite boîte de suppositoires et va chez le voisin.
- «Monsieur auriez-vous ça vous un rectum à me prêter. Le docteur m'a donné ça, il m'a dit de mettre ça dans le rectum.»
- «Mon Dieu, ici j'ai un solarium, mais j'ai pas de rectum. Peut-être que le voisin en a un.»
Le gars part avec sa petite boîte et va frapper à la porte de l'autre voisin.
- «Auriez-vous ça un rectum à me prêter? Le docteur m'a dit de mettre ça dans le rectum, je n'en trouve pas!»
- «Ici, j'ai un solarium, une harmonium, mais j'ai pas de rectum. Peut-être le voisin qui est un ramasseux de toutes sortes de choses vous rendra ce service-là.»
Il part chez l'autre voisin et lui fait la même demande qu'aux deux autres. Le gars lui dit:
- «Moi, j'ai ici un solarium, un harmonium, un aquarium mais j'ai pas de rectum.»
- «Cherchez monsieur, cherchez. Ça m'en prend un absolument.»
Il pilote autour du monsieur, le supplie de chercher encore. Le gars se tanne et lui crie par la tête:
- «J'en ai pas de rectum, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. J'en ai pas de rectum, pis là sacrez-moi la paix. Si vous en trouvez pas d'rectum là, fourrez-vous le dans l'cul, ça va faire pareil.»
Là, Midas est parti à rire. Ça c'est la meilleure, il me suit partout Midas, il m'aide à continuer à me remémorer mes souvenirs, il aimait beaucoup chanter la chanson de Tex Lecor, «Ses ptits robers», «Les ivrognes», «Les métiers», «Le cadeau». Les gens l'aimaient beaucoup ce Midas, il était drôle et très dévoué. Il me donnait un fameux coup de pouce dans mes veillées. Merci Midas pour ton aide.
Enfin!
Quand j'ai écrit mon arbre, c'était Karole Dumont mon professeur. Quand elle l'a lu, elle a pleuré, et plusieurs personnes dans la salle pleuraient. Elles ont compris que mon arbre c'était moi et ça les touchait beaucoup car ils avaient le lien entre les deux. Mon arbre c'était moi, ma souffrance à moi et c'est du fond du cœur que je vous dis merci. Vous m'avez beaucoup aidée à sortir de ma souffrance, de mon ennui et si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Si je vous ai aidés, si vous aviez du bonheur pendant le temps du sketch, vous m'avez beaucoup aidée à vouloir continuer de vous rendre heureux et heureuses. Ça été ma chance dans la vie, à reprendre goût à la vie, à me rendre heureuse en vous rendant heureux vous tous qui m'aimiez, qui m'encouragiez à continuer. J'ai beaucoup grandi moi dans vos commentaires élogieux qui me donnaient le goût d'en faire encore plus. Cette période-là de ma vie a été très, très bénéfique pour mon moral qui était au plus bas. Relisez-la, vous allez voir que j'étais mal en point dans ces années-là. C'est du passé maintenant et je suis très heureuse du bien que j'ai fait grâce à mon talent de comique.
Je vous remercie d'avance si vous achetez ce livre. Je serai récompensée de tout ce travail acharné qui m'a aidé à reprendre le goût de vivre, ce sera un grand plaisir pour moi d'avoir votre amour, c'est le plus beau cadeau que j'aie jamais eu. Je vais dire comme la comédienne Rose Ouellet de la télévision. Elle disait toujours que tout ce qu'elle faisait c'était par amour pour son public. C'est vrai que le public a une grand importance dans ce qu'on fait. Si je m'étais rendu compte que les gens s'ennuyaient ou avaient hâte que ça finisse, j'aurais certainement abandonné. Mais non, ils en redemandaient tout le temps et moi pour faire plaisir aux autres, je travaillais du mieux que je pouvais afin de plaire aux gens et qu'ils en redemandent et ça, ils en redemandaient. J'étais très heureuse de les rendre heureux ces gens-là. C'était la seule occasion qu'ils ou elles avaient pour rire et se détendre, elles avaient toujours hâte au mois suivant.
Merci de me lire, merci de m'encourager à continuer sur ce chemin-là qui nous ouvre de nouveaux horizons. Moi, ça a beaucoup changé ma vie et je tenais à vous le dire et le redire pour que ce programme continue. Merci aussi aux professeurs formidables que nous avons pour nous aider à cheminer sur ce chemin difficile quand même, qu'est l'alphabétisation mais si utile et indispensable dans notre vie.
Je termine ici ce récit de vie et remercie bien gros les personnes du Centre Alpha des Basques qui ont mis sur pied ce projet qui s'appelle «Mémoires du terroir». Merci pour ce projet si intéressant! Quels beaux souvenirs de la vie d'autrefois que je laisse à mes enfants et petits-enfants. Je vous le transmets avec tout mon amour.
Nanoue
Anne-Marie Ouellet
[Voir l'image pleine grandeur]

Native du Rang de la Bellevue de Saint-Jean-de-Dieu, Anne-Marie s'est découvert une âme de missionnaire très jeune.
Sa voie intérieure l'amène à voyager un peu partout dans le monde. Elle parcourt ainsi plusieurs pays pour apprendre différentes langues ce qui lui permet de s'impliquer dans ces communautés.
À sa retraite, elle décide de revenir dans sa région et de partager son immense bagage avec les gens d'ici. Cette femme cache de nombreux talents comme la peinture, le chant, la musique, l'écriture et le bricolage.
En plus de participer à cet ouvrage en nous livrant son récit de vie, elle a contribué aux trois premiers tomes des Mémoires du terroir en produisant les illustrations. Si vous lisez son récit de vie et que vous en voulez davantage, vous pourriez faire la lecture de deux autres textes dans le premier tome.
Je vous en dis pas plus, à vous de la découvrir.
Julie Ouellet
Il était une fois ma vie
Une chanson de Nana Mouskouri me touche profondément, c'est ce que j'aimerais être.. cette colombe de paix, discrète, rassurante, ouvrant à l'espérance d'un monde meilleur. J'aimerais faire le tour du monde pour dire à chacun et à chacune que Dieu les aime d'un AMOUR ÉTERNEL. Une colombe autour du monde est partie ce matin.
C'est l'été, le soleil s'est levé tôt et déjà à la pointe du jour, la chaleur est très intense. C'est un vingt-cinq juillet 1939. Rien de très spécial au calendrier ce jour-là. Sauf qu'une enfant, la treizième d'une famille de dix-sept, vient au monde. Et cette enfant, c'est moi, Anne-Marie-Yvonne. Ce nom m'est donné en l'honneur de la bonne Sainte Anne dont la fête est le vingt-six juillet. Marie, parce que toutes les petites filles s'appelaient ainsi, ou du moins, ce nom devait apparaître sur tous les baptistères, de même que le nom de Joseph pour les garçons. Yvonne, je ne sais trop pourquoi. On m'a toujours appelée Anne-Marie ou tout simplement Marie, ne sachant même pas que sur mon baptistère apparaissait aussi le nom d'Yvonne.
On habite sur une ferme à la campagne dans un petit coin du Bas-du-Fleuve appelé Saint-Médard.
Le travail ne manque pas sur cette terre nouvelle à défricher.
Les enfants, déjà au nombre de douze, donnent chacun leur part. Le père, d'une santé fragile, travaille à la fois sur la ferme, à la drave et sur les chantiers pour faire vivre toute sa marmaille.
[Voir l'image pleine grandeur]

La maman est donc très heureuse d'avoir une fille de plus qui plus tard pourra l'aider dans la besogne. Elle a confiance que sa fille sera forte puisqu'elle n'a pas attendu que la sage-femme arrive pour venir au monde. Elle a pris l'initiative de sortir d'elle-même. La vie semblait déjà l'intéresser.
Était-ce un présage?
Selon les dires de maman, j'étais une fille en santé. Il paraît qu'à l'âge de six ou sept mois je ne voulais plus de suce pour m'endormir mais j'ai su plus tard la cause de ça. C'est que Fernand volait ma suce et allait la «mâchouiller» derrière le poêle. Comme la suce s'était brisée on a dû la remplacer. À cause de la crise du temps, on manquait de tout, même de suce. On a donc acheté une grosse suce rouge qui goûtait le caoutchouc. C'est sûrement la raison pour laquelle je ne voulais plus rien savoir des suces dès l'âge de six mois.
Maman n'avait pas le choix de me prendre dans ses bras chaque fois que je devais me nourrir. Cet événement a certainement été heureux pour moi. J'avais toute l'attention de maman plusieurs fois par jour. Cette chaleur maternelle a dû façonner en moi ce désir d'aimer et d'être aimée.
Me sentant choyée et aimée, j'étais heureuse. Papa aimait me bercer et souvent il s'amusait avec nous en inventant toutes sortes de jeux comme «tirer au renard», tirer de la «jambette», «devine la couleur», «les chaises qui se promènent» etc.
Un souvenir que m'a rapporté ma grande sœur Marielle où j'avais un an ou un an et demi.
Mon père, maquillon comme il était, changeait souvent de chevaux. Cette fois-là il avait une jument très farouche qu'il essayait de «dompter». Elle s'appelait «Morlouche». Maman, dans la cuisine, en train de pétrir son pain, surveillait d'un œil inquiet papa qui essayait de maîtriser la vilaine, tout en haut de la côte attenante à la maison. Soudain, elle voit la jument s'échapper et revenir à la course vers l'étable. Au même moment elle me voit, moi qui n'avais qu'un an et quelques mois, dans le chemin allant à l'étable, en train de jouer innocemment dans le sable. Elle crie à Marielle qui n'avait environ que onze ans à ce moment-là.
- «Va vite chercher la petite, la jument s'en vient directement sur elle!»
Marielle, comme une fronde, se précipite vers moi. Mais la jument farouche s'est arrêtée subitement. La poussière vole encore dans l'air. Je regarde la jument qui me regarde à quelques pouces de moi. Elle me renifle et repart calmement vers l'étable.
Maman, qui a tout vu, n'en croit pas ses yeux. Pourquoi la Mourlouche si farouche et endiablée s'est-elle arrêtée si brusquement devant un si petit enfant? Est-ce que les animaux respectent à ce point les êtres humains? Ou est-ce autre chose? Mystère.
[Voir l'image pleine grandeur]

Marielle me ramène à la maison et maman n'en finit plus de dire merci à Dieu et à mon ange gardien de m'avoir miraculeusement protégée. Elle se dit que c'est peut-être parce qu'elle m'a déposée sur l'autel de la Vierge, à l'église, pour me consacrer à Marie, dès ma naissance.
Les mois et les années passent. Je suis une enfant comme les autres, peut-être même plus espiègle et entreprenante à cause de mon assurance et de mon sans-gêne.
J'aime jouer des tours, rire et chanter. J'aimerais pouvoir apprendre le violon danser le ballet, devenir professeur.
L'enfance
Arrive le moment de me préparer pour entrer à l'école. Maman s'est aperçu que j'étais gauchère. Comme, déjà, Lucienne était gauchère et qu'elle s'était fait taper sur les doigts pour se corriger, maman décide de me corriger et, par le fait même, de m'enseigner à écrire.
C'est pourquoi, à peine âgée de six ans, je savais déjà écrire de petites phrases, mon nom et ceux de papa, maman, de mes frères et de mes sœurs.
Un jour, c'était la coutume du temps, Louis dit à la maîtresse:
- «Mademoiselle, voici ma petite sœur Anne-Marie. Elle sait lire et écrire.» Il riait fièrement.
L'institutrice, très sceptique:
- «Ah oui? On va voir ça...»
Elle me demande d'aller au tableau. Ah! quelle grande joie d'écrire sur le grand tableau noir. Sans gêne je m'approche et j'écris: «Le coq a chanté cocorico», puis mon nom et...oups, la maîtresse m'enlève la craie et me regarde en se baissant jusqu'à mes épaules.
- «Mais qui t'a enseigné ça?»
- «C'est maman qui m'enseigne tout tout tout.»
C'est le rire général dans la classe.
- «C'est ma petite sœur.» d'ajouter Louis en souriant fièrement.
Je n'ai jamais oublié cette journée ensoleillée de ma petite enfance.
À l'automne 1945, je commence à aller régulièrement à l'école qui est à environ un mille de la maison.
L'institutrice Évelyne Bérubé était excellente. Exigeante, elle nous poussait à donner toujours le meilleur. J'aime bien aller à l'école apprendre toutes sortes de choses, bien faire mes devoirs, compétitionner pour tenir la première place dans le rang.
Tout allait bien jusqu'à la quatrième année ou j'ai eu une institutrice qui enseignait d'une drôle de façon. Il me semblait qu'elle manquait de compétence et que je perdais mon temps à écrire. Alors j'ai commencé à être dissipée et à faire rire les élèves avec des tours de toutes sortes. Alors j'ai attrapé le nom de «petit clown». Malgré tout, je réussissais en classe mais l'intérêt n'y était plus. Je rêvais d'aller ailleurs dans une autre école où je pourrais apprendre le piano, le violon, le ballet.
Maman l'aurait souhaité aussi mais nous étions trop pauvres et avec les seize enfants à la maison, c'était peine perdue de vouloir réaliser un tel rêve.
À la maison, j'étais boute-en-train. J'aimais inventer des pièces de théâtre, des jeux inédits, des contes inventés de toutes pièces.
Un jour j'ai dit à Irène, ma sœur cadette:
- «Cette année, on n'a pas de poney pour s'amuser, si on jouait aux cow-boys dans la bergerie sur le dos des moutons!»
Irène était moins entreprenante que moi, mais elle osait exécuter mes désirs à la condition qu'elle ne soit pas trop mêlée à l'action directe.
- «Toi tu vas te cacher derrière la demi-porte et avec cette branche feuillue, tu l'agiteras aussi fort que tu le pourras pour exciter les moutons et les faire courir. Moi j'embarque sur le bélier puisqu'il a des cornes; ce sera plus facile de me tenir!»
Irène me regarda les yeux ronds comme des «trente sous».
- «Tu n'as pas peur?»
- «Mais non! Ce n'est pas haut un mouton. Si je tombe je ne me ferai pas mal!»
[Voir l'image pleine grandeur]

J'arrive à saisir le bélier dans le coin de la bergerie et hop sur son dos, les deux mains agrippées sur les cornes et me voilà partie.
Irène agite sa branche et la vitesse du bélier s'accélère.
Ce que je n'avais pas prévu c'était les quarante-cinq moutons effrayés par tout ce branle-bas et qui se sont mis à courir autour de la bergerie. C'était vraiment tout un rodéo. La poussière de balles de foin s'élevait dans un nuage ténébreux. Je riais «jaune».
Je ne pouvais descendre du dos du bélier de peur de me faire passer dessus par les quarante-cinq autres qui suivaient à toute allure.
Mon père était dans l'étable en train de nourrir les animaux. Le bruit des sabots venant de la bergerie ne présageait rien de bon. Passant sous le fenil, il arriva à la bergerie, entrouvrit la porte pour apercevoir, dans un nuage de poussière, une espèce de petit lutin maléfique sur le dos de son bélier. Bien sûr, ce lutin n'était nul autre que Marie qui ne pensait qu'à s'inventer de nouveaux jeux.
Irène s'était accroupie derrière la demi-porte et je n'ai rien dit pour qu'elle ne soit pas disputée.
Mon père entra dans la bergerie et essaya de m'attraper. Mais ça allait trop vite.
Alors il lança une brassée de paille devant la cohorte et les moutons ont dû freiner un peu. Et c'est ainsi qu'il a pu m'attraper à la volée.
- «Mais qu'est-ce que tu as pensé d'agir de la sorte? Les moutons auraient pu t'écrabouiller. Il ne faut plus jamais faire ça. Et pour que tu t'en souviennes, tu vas aller te coucher sans souper.»
Sans rouspéter je retourne à la maison et monte à ma chambre un peu pas mal penaude.
Tout à coup je vois Irène entrer dans la chambre avec un grand sac brun.
- «Moi aussi je suis coupable et je n'ai pas été punie parce que tu ne m'as pas déclarée. J'ai pris des galettes et du raisin à tarte, mange ça. Ça n'a pas de bon sens, te coucher sans manger.»
- «Non, non Irène, toi tu n'es pas dans le coup, c'est moi qui t'ai entraînée à y participer. Je ne veux pas manger. Papa m'a punie et je le mérite. Je n'aurais pas dû faire ça. Retourne avec ton sac et fais attention pour ne pas être vue de papa.»
Comme Irène me faisait toujours confiance, elle repartit avec son sac de victuailles. Mais papa avait tout vu du stratagème. Quand Irène descendit l'escalier avec son sac derrière le dos, il lui demanda:
- «Qu'est-ce que tu as dans ton dos? À qui t'apportais ça?»
- «Je ne voulais pas que Marie aille se coucher sans manger alors je lui apportais des galettes et des raisins à tarte.»
Papa avec un sourire retenu, garda le silence quelques instants et dit:
- «Bon, Anne-Marie tu peux descendre souper, je pense que la punition a assez duré et que tu as bien compris.»
D'un bond je sautai du lit et en trois enjambées j'étais au bas de l'escalier. Je pris papa par le cou et l'embrassai.
- «Je ne ferai plus jamais ça papa.»
- «C'est bien, c'est bien, viens manger maintenant.»
Ah! Que la sauce aux patates et aux fèves avait été bonne ce soir-là. Papa ne levait jamais la main pour nous frapper. Il punissait en nous faisant mettre à genoux au pied de la croix noire, dite croix de tempérance. Mais on sentait bien que c'était pour nous montrer le bon chemin. Il avait un cœur d'or. J'ai toujours été très proche de papa. Il y avait une sorte de complicité entre nous deux. J'avais onze ou douze ans et je me faisais encore bercer par lui. Maman disait:
- «Écoute Anne-Marie, regarde les jambes te traîner à terre; tu es trop grande maintenant pour te faire bercer par ton père.»
- «Ah dommage! J'aimerais ça rester toujours petite, ai-je répondu.»
Maman voulait m'intéresser au travail de la maison. Je l'aidais à repasser, à laver la vaisselle, à faire du ménage. Mais quand les garçons me réclamaient dans les champs, oh quel bonheur!
Les garçons disaient à papa et à maman:
- «Marie est très bonne pour fouler le foin et vous devriez la voir ramasser des roches. On l'a appelée "Marie-Poussière" tellement elle se déplace pour aller de plus en plus vite en mettre le plus possible sur le stone boat!»
Cependant, maman demeurait convaincue que pour faire une bonne mère de famille je devais aussi apprendre un tas de choses de l'ordinaire ménager.
Souvent, quand je travaillais avec maman, elle me chantait des chansons, me racontait des histoires et me parlait de la vie de Dieu en nous.
- «Dieu est toujours là. Dieu est dans les quêteux qui passent régulièrement chez nous et, souvent, demandent pour coucher. Il faut les traiter comme si c'était Dieu lui-même qui frappait à notre porte.» disait-elle.
Elle concluait souvent par ce chant approprié:
- «Mets Dieu dans ta vie ô mon cher enfant tout rose et tout blanc... si tu tombes c'est humain, relève-toi c'est divin... ne cherche pas d'autre appui, il n'est de bonheur qu'en lui. mets Dieu dans ta vie sois-en le témoin et porte-le bien loin pour tous ceux dont le destin est au bout de ton chemin .jusqu'au dernier soir qu'il soit ton espoir...»
Cette vieille chanson dont les paroles sont de H. Colas, et la musique de G. Singery, je l'ai entendue souvent.
- «Maman, chante-moi encore «Mets Dieu dans ta vie»... je l'aime beaucoup.»
Et maman la chantait avec tant d'âme et de sincérité.
Le goût de Dieu, elle me l'a inculqué. J'aimais me retrouver seule pour prier. Chez nous on avait une Bible. À ce moment-là je ne comprenais pas pourquoi maman la cachait sous ses vêtements dans un des tiroirs du bureau de sa chambre à coucher.
De temps à autre j'allais la chercher et je me camouflais derrière la porte de sa chambre et je lisais des passages. L'Apocalypse me fascinait. C'était un peu des histoires de «Bonhomme Sept Heures».
Mon frère Paul-André, de quatre ans plus jeune que moi, s'intéressait aussi à ce gros livre «défendu».
Un jour, on a décidé de se faire une cabane de cèdre dans le petit bosquet non loin de la maison. Là j'avais construit, avec des boîtes de bois et de carton, un petit autel. Avec des retailles de coton ou de soie de couleur pâle, j'avais taillé et cousu des voiles de tabernacle que je changeais souvent.
Cette cabane nous servait à nous évader régulièrement, bien sûr, avec «le gros livre» qu'on appelait la Bible, pour lire et relire des passages de L'Apocalypse. Paul n'avait que six ou sept ans mais il avait son idée sur la bête à sept têtes de L'Apocalypse. Si elle a sept têtes, elle aurait combien de pattes? Et on lisait en détail pour voir si on nous l'indiquerait quelque part; mais peine perdue. Cela ne nous décourageait pas. On y revenait constamment.
Quand maman nous appelait pour aller souper ou pour donner un coup de main habituel, en cachette et sur la pointe des pieds, on allait replacer la «Sainte Chose» dans son tiroir attitré. Et dans nos petites têtes d'enfants, on devait se dire:
- «Quand la grosse bête va arriver ce sera la fin du monde. Peut-être qu'en 1960 on n'existera plus...»
Après le souper c'était les devoirs et les leçons. Et à l'heure d'aller se coucher, Paul, qui était le plus jeune, aimait bien qu'une de ses grandes sœurs, soit Thérèse, le monte à sa chambre en «avion». Accroché aux épaules et les mains autour du cou, il s'imaginait qu'il était en avion pour monter vers les nuages et s'évader au pays des rêves.
Si le sommeil ne venait pas tout de suite on se réunissait tous dans le même lit, Irène, Raymond, Paul et moi. On s'inventait des histoires abracadabrantes. Quand les fous rires se glissaient jusqu'à la chambre des parents, mon père nous rappelait à l'ordre en disant:
- «Les enfants, cessez vos conneries et allez vous coucher chacun dans votre lit!»
Après un ou deux avertissements, on finissait par aller se coucher et dormir à poings fermés.
Un jour, j'avais onze ans, j'aidais maman à repasser les habits des garçons. C'était le lendemain de ma fête, soit le vingt-six juillet. Maman était venue à moi avec une orange cachée dans ses mains qu'elle tenait dans son dos.
- «Je t'aime beaucoup ma petite fille. Tu es un rayon de soleil; c'est, pourquoi je te donne une belle orange. C'est comme un symbole de soleil, ne trouves-tu pas? Bonne fête ma fille!»
Je repensais à tous ses gestes d'affection si abondamment prodigués à chacun des membres de ma famille et je repassais en y mettant tout mon cœur pour donner moi aussi des preuves tangibles à ceux que j'aimais. Soudain, quelque chose d'étrange se passa en moi. Je sentis comme une chaleur, une énergie, une présence qui m'habitait.
Vite je déposai le fer à repasser sur le poêle et je montai à ma chambre, comme transportée par un sentiment de bonheur inexplicable.
Je me jetai au pied du lit, à genoux, les mains sur les yeux. Là, je ressentis une présence de Dieu très intense et n'osai pas ouvrir les yeux de peur de voir Dieu. Si j'ouvrais les yeux et que je le voyais, j'en étais convaincue, j'en mourrais. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, en avais-je conclu. Après un certain temps, j'osai ouvrir les yeux et je réalisai que Dieu était là, en moi, et que jamais il ne me quitterait. J'ai compris que dans mon royaume intérieur l'Hôte divin y habitait depuis toujours mais que je n'en avais jamais été si consciente. Ce bonheur a dû me faire une lésion au cœur tellement il était grand.
[Voir l'image pleine grandeur]

Moi, une petite fille de rien du tout, je peux contenir le Maître de l'univers.
Ceci ne doit pas être pour moi toute seule, je devrai être témoin de cet Amour, je serai missionnaire, pour dire que ce qui m'arrive à moi peut arriver à chacun car Dieu nous aime tous en particulier. Comment éveiller le monde à cette Présence réelle? Moi je ne sais pas, Toi, Jésus, tu me guideras, je serai toujours à ton écoute, je m'abandonne à Toi.
Maman qui avait vu ce qui s'était passé, discrètement est montée au bord de la porte de ma chambre. Mais elle n'a rien dit.
Quinze jours plus tard, alors que nous étions à causer de choses et d'autres, maman me dit:
- «Qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre jour?»
Elle me raconte alors qu'elle était montée à la porte de ma chambre et qu'elle m'avait vue demeurer une heure à genoux, sans bouger, au pied de mon lit. Je lui racontai l'expérience tangible de la présence de Dieu en moi.
Je vis des larmes couler des yeux de maman. Elle me prit dans ses bras et me serra très fort sans dire un mot.
Ensuite elle me regarda dans les yeux et me dit:
- «Je suis tellement heureuse pour toi. N'en parle à personne, on pourrait te ridiculiser. Qui pourrait comprendre?»
J'avais donc décidé d'être missionnaire.
Quelque temps après on nous annonce de la grande visite à l'école de Saint-Médard: une missionnaire de l'Immaculée-Conception.
Déjà, les sœurs de l'Enfant-Jésus qui nous enseignaient, m'avaient approchée pour sonder le terrain en me demandant si ça m'intéressait de devenir religieuse.
Oh non! Je ne voulais rien savoir: elles n'étaient pas missionnaires. Alors, pour qu'elles changent d'idée à mon sujet, je me mis à faire la folle, à être dissipée à perdre mon temps en classe et à le faire perdre aux autres. J'ai même répété ma 6e année à cause de ça.
Mais quand j'ai vu la religieuse missionnaire nous parler des missions, des gens qui ne savaient pas encore que Dieu les aimait, alors ce fut clair en moi: c'est ça que je ferais.
Avant de partir, la religieuse nous a remis des images. Certaines étaient en couleurs, d'autres en noir et blanc. La religieuse qui s'appelait Mère Saint Siméon me donna une belle grande image en couleur. À Jean-Charles qui était dans le même banc que moi, elle donna une toute petite image en brun et beige d'un Jésus sculpté sur laquelle était écrit: «Aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis.» Jean-Charles n'aimait pas son image et enviait la mienne.
- «Veux-tu échanger avec moi?» lui demandai-je.
- «Oh oui! J'aime bien mieux la grande en couleur. D'accord!»
L'échange, en fait, ne fut que bénéfique. En voyant l'inscription «Aujourd'hui même tu seras avec moi en paradis», il a semblé qu'elle m'était adressée directement. Une fois de plus j'expérimentais d'une façon qui semblait banale, mais combien signifiante pour moi, la présence de Jésus toujours là, me donnant des signes de son amour pour moi. Merci Jésus!
[Voir l'image pleine grandeur]

Jean-Charles ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé en moi ce jour-là, mais est-ce vraiment important? Cette image, je ne m'en suis jamais départi. Elle me parle toujours. Cette présence m'habite et m'apporte une plénitude difficile à décrire.
Arrivée à la maison j'ai raconté la belle visite que nous avions eue à l'école. Papa sembla s'intéresser à cette visite jusqu'au moment où je lui demandai vingt-cinq cents pour les petits païens.
- «On en a assez de petits païens dans la maison.» répliqua-t-il.
Ça m'a fait de la peine mais papa devait avoir raison.
Le lendemain matin, à l'heure du départ pour l'école, papa me glissa une pièce de vingt-cinq cents dans la main en me disant:
- «Tiens, ça c'est pour ton petit païen.»
Ah! Enfin je sauverais un enfant par un don si petit... quelle merveille.
Les soirées d'hiver sont revenues. On s'amuse dans la neige. On glisse sur des cartons, on se fait des forts, on joue à cache-cache. Papa nous fait des skis avec des planches de vieux barils. La vie bat son plein. On est heureux.
La noirceur venue, les plus grands vont faire le «train», c'est-à-dire traire les vaches, donner de l'eau et du foin aux animaux et s'assurer que ceux-ci vont bien.
Pendant ce temps, alors que le souper est sur le feu et que le poêle ronronne, maman, assise près du poêle, dans une grande chaise berçante, nous chante des chansons. Ces vieilles chansons étaient comme des histoires. Entre autres chansons, il y avait celle du Juif errant qui comptait vingt et un couplets. Quand on demandait à maman de nous la chanter, elle hésitait toujours et disait:
- «Cette chanson-là, paraît-il, quand on la chante, elle fait changer la température.»
- «C'est certain qu'avec une chanson de vingt et un couplets, la température a le temps de changer au moins deux fois.» répliquais-je.
- «Belle fine!» ajoutait ma mère pour clore la discussion.
Après la besogne faite, toute la famille s'assemble autour de la table, éclairée à la lampe à l'huile, et déguste le bon repas que maman nous préparait avec tant de goût.
Après souper, les leçons, les devoirs, un conte ou quelques chansons; et venait ensuite la prière en famille. Il fallait aller se reposer car demain le même boulot reprendrait.
À tous les soirs revenait la prière en famille et le chapelet. C'était sérieux...mais pas toujours. Certains, plus haïssables que d'autres, s'arrangeaient pour ne pas se faire voir et allaient chatouiller le dessous des pieds des autres. C'était les aye, les oups! Mais le regard de papa nous ramenait à l'ordre:
- «Vous regarder c'est pas assez?»
Tous se calmaient mais la résolution n'était pas toujours ferme.
Un soir que j'avais fait, à l'école, un chapelet d'à peu près trois pieds de long, avec des papiers aluminium pour cigarettes, je préparai le coup suivant. Mine de rien, alors que la récitation du chapelet est commencée, je sors mon phénomène et m'installe pieusement à genoux sur une chaise, face au dossier, en laissant retomber mon chapelet jusqu'à terre. Entendant un bruissement tous les yeux se tournent vers moi et tous éclatent de rire. Et à chaque fois qu'on voulait reprendre notre sérieux, le fou rire nous revenait. Alors, ce soir-là la récitation du chapelet à été écourtée d'au moins la moitié.
J'ai déjà douze ans, mais pas plus sage pour autant. Quand maman me cherche, elle doit regarder partout, même dans les endroits les plus inusités comme le pignon de la grange, sur le poteau soutenant le toit du hangar ou dans l'enclos des cochons. Elle m'a même retrouvée dans le poulailler en train de raconter des histoires aux poules qui démontraient leur approbation par leur caquètement.
À quatorze ans, étant pensionnaire chez les Sœurs de l'Immaculée-Conception à Rimouski, j'entreprends de lire «Histoire d'une âme», l'histoire de sainte Thérèse de Lisieux. Je suis emballée par cette religieuse qui, tout en étant contemplative, se dit missionnaire par l'Esprit. Est-ce illusion ou réalité? Je souhaite maintenant devenir une sœur cloîtrée.
Mes sœurs et frères s'esclaffent de rire.
- «Toi le petit diablotin, une religieuse? Non, pas une sœur cloîtrée, mais une sœur couettée!»
Le couvent
On a beau rire, l'idée fait son chemin. J'achève mes études au pensionnat et tout va bien.
Pendant ce séjour, chez les M.I.C. j'ai fait un drôle de rêve ou de songe dans la nuit précédant la Pentecôte, un ciel tout bleu dans lequel apparaissent des écussons garnis d'or, de diamants et de pierres précieuses. Soudain tous ces symboles de richesse tombent et le ciel est à nouveau dégagé. Mais voilà qu'apparaît une croix rouge sang sans aucun ornement, comme un signe + dans le ciel. Au pied de la croix, des lettres de plus en plus nettes apparurent:
récompense
récompense
récompense
récompense
Je m'éveillai et réalisai que la présence de Dieu en moi devenait encore plus évidente. Mais quel était réellement ce message? Quel chemin de foi? Dieu nous parle souvent par charade. Avant de rassembler le tout pour comprendre, combien faudra-t-il de temps?
Un peu plus tard, la Vierge m'apparaît en songe et me fait comprendre que je dois être témoin de l'Amour. Réalité ou illusion? À mon âge, je ne saurais pas inventer tout ça. Au mois de juin, je reviens chez moi à Saint-Médard.
En septembre, on me demande d'enseigner à l'école du Rang 7 de la paroisse. J'aime ce métier. C'est toujours un grand plaisir d'arriver à l'école chaque matin. Je veux toujours donner le meilleur.
[Voir l'image pleine grandeur]

L'année scolaire terminée, l'idée de me faire religieuse continue toujours de me hanter. Mais comment faire comprendre ça à ma famille qui n'y croit pas du tout? N'étant pas majeure je dois demander la permission à mon père qui, lui, refuse catégoriquement.
- «Tu n'iras pas t'enfermer dans un couvent. J'aimerais mieux te voir six pieds sous terre que religieuse et missionnaire en plus. Il n'en est pas question.»
Quelques semaines plus tard je reviens à la charge, mais cette fois, auprès de maman. Maman me dit de ne pas m'inquiéter, d'avoir confiance, quelle en parlerait à papa.
- «Si Dieu te veut là, aucun obstacle ne pourra t'empêcher d'y aller.»
Finalement maman me dit de faire les démarches et même s'il n'est pas d'accord, papa ne se fâchera pas. Papa est certain que cette idée folle passera. J'avais aussi un ami sérieux même cette amitié ne pouvait me retenir au bercail. Le sept août 1958, mon frère Jean et ma plus jeune sœur Irène me reconduisent au train à Trois-Pistoles.
Ce soir-là, mon père est allé se coucher à huit heures, ce qui était contraire à ses habitudes.
Dans l'auto, en route pour Trois-Pistoles, j'essayais de rendre ce départ moins triste en chantant cette boutade: «Me voilà partie i i pour la grande capitale a al, tout le monde pleure et moi je ris...» Tous les membres de ma famille me connaissant bien et sachant combien j'étais ennuyeuse ne pouvaient s'imaginer que je resterais très longtemps. On me donnait deux ou trois semaines tout au plus.
Me voilà dans le train faisant des signes de la main en guise d'amitié, le cœur gonflé de peine en me voyant séparée de ma famille que j'aime tant. Pourquoi je fais cela? Le mystère continue...
Cependant, une assurance et une présence m'habitent. Je ne suis pas seule. Il est là au cœur de ma vie. C'est Lui qui a les guides. Confiance!
Huit heures du matin. Bien sûr je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. On arrive à la gare. Je récupère mes bagages. Tout autour, personne que je connaisse. Je vois le grand escalier qui mène à l'extérieur. Une fois dehors j'aperçois une voiture noire différente des autres. Pensant que c'était un taxi je le signale. Le monsieur s'arrête.
- «Vous allez loin mademoiselle?»
- «Chez ma sœur, au 1523 rue Valois.»
Je monte à l'avant, près du conducteur. Pendant le parcours, ce monsieur très distingué me pose toutes sortes de questions. Voyant que je ne connais pas Montréal il m'offre de me faire visiter la ville.
Je le trouve extrêmement prévenant et super gentil. Je ne m'affole pas; ça doit être comme ça les taxis à Montréal.
Après mille et un détours dans la Métropole et plein d'explications sur cette grande ville le "taxi" ajoute:
- «Vous voilà au 1523 de la rue Valois. Vous avez aimé votre visite de la ville?»
- «Je suis enchantée. Combien je vous dois?»
- «Rien du tout.»
- «Comment ça rien? Les taxis de Montréal ne se font pas payer?»
- «Mais, mademoiselle, je suis pas un taxi. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi j'ai accepté de vous amener chez votre sœur. Je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas le droit de faire ça. Regardez à l'arrière de l'auto. Il y a un grand espace pour servir le café; les sièges sont en velours rouge. Je suis le conducteur privé du Cardinal Léger. J'arrivais justement de l'aéroport quand vous m'avez signalé.»
- «Quoi? C'est une limousine? La limousine du Cardinal Léger avec qui nous récitions le chapelet, le soir, à la radio?»
- «Hé oui! ...Je crois que le Bon Dieu vous aime beaucoup.» ajouta-t-il en riant.
Je sortis alors de l'auto pour entrer chez ma sœur Marielle qui, de la fenêtre, a tout vu ça. Elle n'en croyait pas ses yeux alors qu'au même instant son mari Lionel l'appelait au téléphone:
- «Je cherche Marie à la gare mais je ne la trouve pas...»
- «Elle est ici reviens. Je t'expliquerai tout ça.»
On était le huit août 1958, la journée même de mon entrée officielle au Couvent de Pont-Viau chez les Sœurs de l'Immaculée-Conception. Toutefois, Marielle ne l'entendait pas ainsi.
- «Tu es trop fatiguée pour entrer au couvent aujourd'hui. Je téléphone aux religieuses pour leur dire que tu n'entreras que demain.»
Ce qu'elle fit. Après quelques protestations les religieuses acceptent l'idée. Le lendemain, Lionel, mon beau-frère, est venu me conduire au Noviciat de Pont-Viau.
Une immense maison de pierres grises avec la statue blanche de l'Immaculée-Conception, et, devant, la Rivière-des-Prairies qui coule doucement.
Deux religieuses souriantes viennent m'accueillir. Salutations et présentations terminées, Lionel repart chez lui et moi j'entre au Postulat pour une nouvelle aventure.
Vingt-deux compagnes sont entrées la veille. Elles semblent joyeuses et déjà chez elles. Cela me rassure. Présentations et visite des lieux, suivies du rendez-vous chez la Sœur Maîtresse Dolorès St-Cyr. Je remets mes bijoux, ma montre... Je revêts la robe et le bonnet noirs des postulantes.
Bientôt ce sera l'initiation à la vie communautaire, aux expériences spirituelles, aux travaux habituels journaliers. Tout est bien amorcé. Quelques semaines plus tard je me sens très à l'aise dans ce nouveau milieu de vie.
Si je suis venue chez les M.I.C. plutôt que chez les sœurs cloîtrées, c'est sur les conseils de notre curé Pantaléon Doucet, qui m'a convaincue que j'étais trop active pour passer ma vie dans un monastère.
Au fil des mois je ne suis plus aussi sûre que c'est vraiment là que Dieu m'appelle. Chaque fois que j'en parle à mes supérieures on me dit que c'est une tentation du démon.
On me désigne pour la cuisine; ce n'est pas un travail que j'aime. Je préférerais de beaucoup l'enseignement. Mais je m'y prête volontiers. Je me dis que pour Dieu ce n'est pas plus important d'avoir un pinceau ou une spatule dans les mains. Ce qui compte c'est l'amour intense et sincère dans tout ce que l'on fait.
Tout cela ne m'empêche pas d'être joyeuse et de faire la bouffonne à l'occasion. Le temps passe, l'hiver s'amène.
Une grande patinoire est arrosée tous les matins près du noviciat et, le soir, au son des valses de Strauss, on patine. Plusieurs des novices sont d'excellentes patineuses. Deux ou trois me prennent en charge et, avec mon entrain habituel, j'apprends vite à patiner et à faire des pirouettes.
La journée débute à quatre heures quarante-cinq et se termine à vingt et une heures. Chacune est à son boulot. On n'a pas le droit de parler mais on peut chanter, pas n'importe quoi, bien sûr. Tous les cantiques y passent. Et moi qui adore chanter... Je trouve ça formidable!
Après encore quelques semaines je prends des cours de violon; j'apprends à diriger une chorale, tout en demeurant responsable du bon fonctionnement de la cuisine.
Les études occupent plusieurs soirs de la semaine. Les examens de fin d'année s'ajoutent au travail quotidien, aux exercices de prière, aux retraites, bref, le temps file à grande vitesse.
Nous voici dans l'Avent et je vois venir mon premier Noël loin de ma famille. Aucune visite dans les familles n'est permise. On peut aller chez nous pour le décès de nos parents mais pas pour celui des frères et sœurs
Maman m'écrit chaque semaine et me donne des nouvelles de chacun. Irène s'ennuie. Paul est au séminaire, Thérèse a eu une fille... et ainsi de suite. Papa, lui, n'accepte toujours pas mon entrée au couvent. Il avait espéré mon retour dans les semaines qui suivraient mon départ. Mais il semble bien que je suis au couvent pour y demeurer.
À Noël maman m'envoie une boîte de bonnes galettes, du gâteau et du bonbon aux patates. Ça sent mon ancien chez-nous et ça me fait rêver.
Vingt-quatre décembre 1958. Nous voici donc à la veille de Noël. Le coucher a lieu bien plus tôt que d'habitude. À dix-neuf heures quinze, je ne dors pas encore. Je revois maman, papa, chacun des membres de la famille, la maison illuminée. Il me semble entendre le tintement des carillons, le crissement des patins sur la neige.
Je revois nos soirées d'entraide familiale où chacun fait sa part soit pour écarder, nettoyer la laine de mouton et la préparer pour la passer au moulin. J'entends le rouet tournant à fière allure, avalant les cordons de mousse blanche et dont les brins s'enrouleront sur le dévidoir. Puis je vois ce que maman pouvait faire de cette laine qu'elle teignait de multiples couleurs des bas, des gilets, des mitaines, des pantoufles, des écharpes. Avec une maman aussi dépareillée, toute la famille était au chaud.
Je revois encore nos randonnées pour la cueillette des fruits sauvages à l'orée des bois, nos automnes colorés, la récolte des pommes de terre, la rentrée du bois de chauffage, les labours en vue des semences du printemps.
Tous ces souvenirs se bousculent dans ma tête et je me dis que je ne reverrai plus jamais ça. Si c'est ta volonté, que je dis à Dieu, très bien, je le veux aussi. Merci de me donner la chance de Te prouver que je T'aime. L'horloge du couvent sonne vingt-deux heures. Je reviens à la réalité du couvent et, épuisée de fatigue, je m'endors.
Grelots, chants des chœurs angéliques, montent dans les airs. La flûte et le violon jouent les plus beaux airs de Noël.
Je crois rêver quand, tout à coup, une copine met sa main sur mon épaule en me disant:
- «Sœur Anne-Marie réveille-toi. Il faut se préparer pour la messe de minuit.»
J'ouvre les yeux; je vois sept ou huit sœurs chantant, jouant du violon ou de la flûte, secouant des carillons et qui, avec un grand sourire, m'invitent à les suivre. C'est la coutume, chez les M.I.C., de faire cette surprise aux nouvelles venues pour les aider à passer ce premier Noël loin des leurs.
Petit à petit j'ai appris à goûter davantage la joie de l'âme à Noël. La joie de savoir la Vie prendre racine en nous grâce à l'Amour infini. Sans la foi, Noël n ' a pas tellement de sens.
«Je vous donne ma joie et nul ne pourra vous l'enlever.» dit le Seigneur. Le jour où, l'on comprend cette grande réalité tout bascule pour le mieux dans nos vies. Les valeurs qui passent nous intéressent de moins en moins. Le Royaume intérieur grandit.
«Bienheureux les cœurs purs, les cœurs pauvres... car le royaume des cieux est à eux.» Combien de gens seraient transformés s'ils comprenaient seulement cette simple parabole!
Le temps des Fêtes est passé. Nous nous préparons pour une autre grande fête, notre passage du postulat au noviciat, le onze février 1959.
Six mois de postulat écoulés. Viennent deux ans de noviciat, pour une formation encore plus engageante et sérieuse. C'est une période où l'on passera par toutes sortes de métiers et à toutes les sauces.
J'ai appris les métiers de couturière, cordonnière, lavandière, ou buandière, cuisinière, trésorière et infirmière en plus d'étudier les langues, la missiologie, la théologie...
Comme nous étions affiliées à l'Université de Montréal, nous n'avions pas besoin de sortir du couvent pour obtenir les certificats ou diplômes voulus.
Le onze février 1959, enfin, je revêtais l'habit de novice: j'étais toute de blanc vêtue avec un ceinturon bleu à deux pendants qui se détachaient sur ma belle bure blanche.
Maman, Irène, Léo, Yvonne, Patricia, Lionel et Marielle sont venus pour la cérémonie. Tous et toutes me disaient combien j'avais l'air heureuse. Je l'étais.
Un bon jour je suis demandée au parloir. Surprise! C'était mon père qui avait pris l'initiative de venir me voir. Il était venu seul à Montréal pour me ramener.
- «Tu ne peux pas rester ici, tu dois revenir à la maison.»
Ce fut peine perdue, je n'allais pas le suivre. J'ai essayé de lui faire comprendre que si un jour je ne me sentais plus à ma place ici je retournerais chez nous. Pleurant à chaudes larmes il me prit par les épaules en me disant:
- «Tu reviens à la maison; ici ce n'est pas une place pour toi, c'est une prison.»
Devant mon entêtement à ne pas quitter ce couvent il est reparti en pleurant. Cela m'a fait très mal, mais il y avait une force en moi qui me dépassait. Comment autrement expliquer que j'ai pu ainsi résister à mon père que j'aimais tant?
L'année suivante il revint à la charge, mais sans plus de succès.
[Voir l'image pleine grandeur]

Après deux ans de noviciat je devrais prononcer mes vœux temporaires mais on me demande de tenir six mois supplémentaires pour éprouver ma vocation. Ça ne me dérange pas beaucoup; à vrai dire j'aime mieux ça car la cérémonie aura alors lieu en août et ce sera plus facile pour ma famille de voyager.
Un bon matin la Supérieure me fait venir à son bureau pour me dire:
- «J'ai reçu une lettre de votre curé et de quelques-uns des membres de votre famille. On dit dans cette lettre qu'on vous oblige à rester ici et que vous n'avez plus votre liberté.»
Imaginez la surprise que j'ai eue.
- «Oubliez cette lettre d'abord. Ensuite, le jour où je ne serai plus à ma place ici je saurai bien quitter et refaire ma vie ailleurs.»
L'affaire, depuis ce jour, fut classée et ne revint jamais plus.
Vœux temporaires
Après mes premiers vœux on me nomme à différentes maisons de la communauté.
À Chicoutimi, j'enseigne et je fais la cuisine. Je suis en charge de tout le secteur culinaire. Enseignement et pratique. Nous avons de soixante-quinze à quatre-vingts retraitantes, de vingt à vingt-cinq religieuses et une trentaine de pensionnaires. C'est un gros boulot. Par les soirs je prends des cours de chant, de solfège et de guitare. J'entreprends aussi des cours de violon avec une sœur musicienne qui avait toujours enseigné la musique aux Philippines.
Les années passent et je n'ai pas revu ma famille depuis août 1958. Nous voilà déjà au début d'août 1964. Je me préparais à prononcer mes vœux perpétuels lorsque j'ai eu un songe que je n'oublierai jamais par la suite. Une fois de plus ce songe me donnait la certitude d'être aimée et que je n'avais rien à craindre puisque Dieu veillait sur moi à chaque instant.
Dans ce songe, je trébuche sur un obstacle et, en me relevant, je vois quelqu'un tout près de moi. Levant les yeux, j'aperçois Jésus. J'étais toute petite. Jésus me prend dans ses bras et dit au ciel entrouvert:
- «Qu'importe ses bévues, je l'aime!!!»
Je m'éveillai au même moment et demeurai longtemps dans un état d'extase et de béatitude. Je me disais que je ne méritais pas ça plus qu'un(e) autre et que c'était par pur amour qu'Il me l'offrait.
Souvent je me dis que si on n'a pas la foi on fait comme si et la foi vient. Il faut prier et essayer de vivre en présence de Dieu Amour. Jésus nous dit de prier sans cesse et la foi grandit, c'est assuré.
Et puis, arrive le moment de la prise d'habit et des vœux perpétuels. Une grande surprise m'attendait: mon père est là et fier de sa fille! C'était tout un miracle. Mon cœur fut fort soulagé de voir mon père et ma mère repartir comblés et heureux.
Bien sûr j'aurais aimé m'occuper de papa et maman qui avançaient en âge. J'aurais tellement aimé les gâter et me faire leur bâton de vieillesse. Mais Dieu me demandait autre chose et je savais que c'était là la meilleure chose à faire, même si, je l'avoue, ce fut un sacrifice énorme. J'avais l'assurance que Dieu, mieux que moi, veillait sur eux.
Après cette cérémonie à Pont-Viau, je retournai à Chicoutimi pour reprendre l'enseignement, les cours et la routine habituelle. C'est à partir de là que je rencontrai les nombreuses difficultés qui m'attendaient. Mais toujours j'avais l'assurance de son amour. «Ton Dieu sera ta Beauté» (Isaïe 60, 19). Cette parole de la Bible fut et demeure pour moi une source d'inspiration et de nourriture solide pour augmenter ma conviction qu'en Lui seul se trouvaient la seule grandeur et la seule beauté que nul ne peut ternir.
«C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse ; j'ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. Elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, car le Maître de tout l'a aimée.» (Sagesse 8, 24.)
Ayant été saisie par Lui dès mon enfance, ayant compris toute jeune, d'une façon spéciale, à quel point Il m'aimait, comme unique au monde, la vie religieuse ne m'a jamais pesé lourd. Mon bonheur est de vivre en sa Présence.
Jour après jour, comme une Cendrillon autour de mes chaudrons, je chante et je m'abandonne à ce Dieu qui m'aime.
Tous les matins qui viennent, me donnent la chance de multiplier les preuves d'amour.
Une de mes premières difficultés vint des jeunes aspirantes à la vie religieuse et qui demeuraient à cette maison de retraites fermées.
En dehors des cours que je donnais, je n'avais pas le droit de leur parler. On pouvait leur parler seulement lors des grandes fêtes comme l'Immaculée-Conception, Noël, Pâques...
Nous étions le huit décembre. En l'honneur de notre fête patronale nous préparions une soirée chantante. La mère de l'une de nos pensionnaires venant, de son violon, nous divertir. C'était un violon qu'elle avait elle-même fabriqué et qui jouait très bien.
Une des pensionnaires vient à moi et commence à me raconter sa vie. Son père est parti alors quelle n'avait que trois ans. Sa sœur de onze ans passe ses nuits dans des clubs et sa mère passe son temps à boire le peu d'argent qu'elle a. Elle veut en finir avec sa vie et elle n'a que quatorze ans. Elle ne croit pas sa mère quand elle l'assure que son père est demeuré à la maison avec elle pendant trois ans. Elle croit plutôt être l'enfant d'une fille mère. Tout cela, bien sûr, la faisait beaucoup souffrir.
Comme nous ne pouvions pas nous parler en dehors des grandes fêtes, je lui ai demandé de m'écrire. Je l'ai avertie aussi que ses lettres seraient lues par la Supérieure mais la rassure en lui confiant que la Supérieure est une femme très compréhensive.
Les lettres s'accumulent dans la boîte aux lettres de la Supérieure qui me les remet au fur et à mesure, mais avec un brin de suspicion et quelques questions d'usage.
- «Pourquoi cette jeune fille te raconte tout ça? Pourquoi t'aime-t-elle autant? Vous rencontrez-vous en cachette?»
Et voilà que la Supérieure décide de rencontrer la jeune fille pour lui demander de s'ouvrir à elle plutôt qu'a moi, ce qui me semble assez normal pour une supérieure. Toutefois, la jeune fille refuse et préfère correspondre avec moi. La conclusion de la Supérieure est que nous sommes lesbiennes et que l'on doit se rencontrer en cachette quelque part. Elle décide donc de nous épier, mais sans résultat.
Malgré l'évidence du non fondement de ses suspicions, elle écrit à la Supérieure provinciale pour lui parler du «scandale». Ma réputation ternie se répand à travers la communauté. À ce moment-là, il y avait déjà six mois que j'avais demandé à un Père Jésuite de s'occuper de la jeune fille, en raison des problèmes que mon aide semblait causer dans la communauté.
Le Père Jésuite et la jeune fille correspondaient déjà depuis un bon moment; en visite à Chicoutimi, il devait la rencontrer au parloir et me donnerait ensuite quelques consignes à son sujet.
Je récitais mon chapelet dans la cour. La jeune fille s'approche de moi et dit vouloir se joindre à moi pour dire, elle aussi, le chapelet. Je lui ai dit que ce serait mieux d'éviter ça en raison de l'interdiction de se parler en dehors des cours. D'autres, en outre, penseraient qu'on se parle et ce ne serait pas bien vu.
La Supérieure, de sa fenêtre, avait assisté à la scène. Telle une lionne qui attaque:
- «Tu fais tout pour attirer cette jeune fille! Avec les lettres qu'elle t'écrit, c'est une brebis galeuse! Éloigne-toi de ça!»
- «Non, ce n'est pas une brebis galeuse. C'est une enfant qui a besoin d'être écoutée et comprise. Je vous demande de la laisser me parler plus souvent. Ça ne fera de tort à personne...»
- «Baise le sol puisque tu as eu l'audace de me répondre. Et ça ne restera pas là, je te le promets!»
Rien ne lui est plus urgent que de réécrire à la Supérieure provinciale et au Père Jésuite pour qu'ils viennent constater les dégâts.
Peu de temps après, les deux s'amènent et m'interrogent. Avec le Père Jésuite, l'interrogatoire tourne court puisqu'il est le directeur spirituel de la jeune fille. La Supérieure provinciale et le Père Jésuite réalisent assez vite que notre Supérieure de Chicoutimi est plutôt névrosée. Elle suppose chez les autres des attitudes qui n'existent en réalité que dans sa tête. Avec ses névroses elle faisait déjà souffrir plusieurs autres sœurs de notre groupe. On lui a donc enlevé son supériorat et on l'a retournée à Montréal.
Quant à moi, loin de m'éloigner de la jeune fille, on m'a demandé de la rencontrer une fois ou deux par semaine aussi longtemps qu'elle serait pensionnaire chez nous.
Une semaine avant de retourner à Montréal, la Supérieure m'a fait venir dans son bureau, m'a fait mettre à genoux et m'a administrée une taloche en plein visage. Elle espérait peut-être que je lui rendrais la pareille; mais en vain. Je trouvais qu'elle faisait pitié et j'ai pensé qu'elle souffrait beaucoup pour agir aussi brutalement avec les autres.
Les noces d'or de mes parents (Juin 1966)
Les deux seules véritables occasions de visiter notre famille c'était la mort de notre père et celle de notre mère. Mais il y en avait une troisième: les noces d'or. Ça faisait huit ans que je n'avais pas revu mes frères et sœurs Avaient-ils changé? Et les neveux, et les nièces? Permission de sortir était donnée mais pour deux jours uniquement.
Moment inoubliable quand je revis mon grand fleuve, respirai l'odeur de la campagne, revis les fleurs champêtres. Moment troublant quand je franchis le seuil de la porte. Maman qui me saute au cou, papa qui me tient par les épaules, mes frères et mes sœurs tout autour qui me disent que je n'ai pas changé, que je suis toujours Marie...
Deux jours qui m'ont semblé bien trop courts.
Un an plus tard, le huit août 1968, après quelques jours seulement d'hospitalisation, maman nous laisse pour de bon, à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Elle avait soixante-huit ans. Avec un règlement devenu moins sévère, j'ai la permission de demeurer quelques jours auprès de mon père.
Quelques semaines plus tard on me transfère à notre maison de Rimouski pour me rapprocher de mon père que je pourrai voir plus souvent. J'étais ravie de pouvoir écouter mon père me raconter sa vie, des moments dont il aimait le plus se souvenir.
En 1969 je retournais à Pont-Viau pour d'autres études en couture et en diététique, en préparation à mon futur travail de promotion de la femme en Afrique! Je suis aussi des cours de guitare et d'anglais. L'apprentissage des langues africaines se fera sur place. Mes cours achevés, je vais partir pour l'Afrique, juste après avoir perfectionné mon anglais à l'Université de Cambridge en Angleterre.
L'Angleterre
Le cinq septembre 1973: départ pour l'Angleterre où je suis des cours intensifs en anglais pendant un an et demi.
À l'inscription je rencontre le recteur qui s'avoue surpris de voir le sigle M.I.C. au bout de mon nom.
- «Que signifient ces trois lettres?»
- «Made in Canada! je réponds à la blague.»
- «It's good, very good!» dit-il en éclatant de rire.
Je lui explique que je suis missionnaire de l'ordre de l'Immaculée-Conception et, devant sa surprise, j'ajoute que l'on n'a pas tous les mêmes croyances.
Heureuse d'apprendre une deuxième langue, je mets tout mon cœur à la tâche et je progresse très rapidement. Dans mes temps libres j'apporte ma guitare et chante avec les étudiants.
Le recteur s'intéresse de plus en plus à moi. M'invitant à prendre un café, il me pose plein de questions sur la religion, la Bible...
- «Pourquoi t'es-tu faite religieuse? Ce n'est pas fait pour toi.»
Le voilà qui déblatère contre l'Église, le pape et tout ce qui a trait à la religion catholique. Prêtres et sœurs sont des gens bornés et il est incompréhensible pour lui que je sois une «nun», une «bonne sœur».
Je lui explique que l'appel de Dieu est plus fort que tout pouvoir humain. Il n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux.
- «Une fille comme toi, sœur..»
Et moi de lui répondre:
- «Il n'y a peut-être rien à comprendre.»
[Voir l'image pleine grandeur]

Un jour, Sandra Vielle, une de mes professeurs, me demanda pour chanter auprès de groupes anglophones qui apprenaient le français. Volontiers. Guitare en bandoulière j'allais à travers les rues de Londres où je semblais avoir vécu depuis ma tendre enfance. Ces gens étaient de la «High Class». Oh my dear! L'expérience durera toute l'année.
Plus tard Sandra me demande de donner des cours de catéchèse en anglais les samedis matin. J'étais assez à l'aise pour le faire et ce fut là encore une expérience très positive qui m'a fait progresser dans mon apprentissage de l'anglais. À raison d'une heure/semaine je suivais des cours de guitare classique lorsque l'épouse du recteur me demanda pour garder son enfant de quatre ans une fois ou deux par semaine. Une autre opportunité de parfaire mon apprentissage de l'anglais; j'acceptai.
À ce moment-là j'ignorais qu'elle et son mari étaient en instance de divorce. J'allais garder régulièrement l'enfant qui ne se gênait pas pour me reprendre, me corriger dans mon langage, quand je lui racontais des histoires pour l'endormir.
Le recteur revenait plus tôt que sa femme. On conversait sur toutes sortes de sujets. Avec de grandes connaissances en musique classique et en opéra, il m'entretenait là-dessus pendant des heures et des heures.
Un sujet, par contre, l'intriguait de plus en plus: l'Évangile Au départ, pour lui, c'était de la fabulation.
- «Que ferais-tu si tu apprenais que Jésus n'a jamais existé? Ta vie s'écroulerait...»
- «Ça ne changerait rien puisque je suis convaincue que le simple fait d'être bon, de donner, de partager, de s'entraider, sont, en soi, de grandes valeurs humaines qu'il vaut la peine de vivre et de cultiver.»
Au fil des discussions ce sujet prit une place de choix.
- «Je suis athée mais ça me fascine de te voir si croyante, si convaincue.»
Il m'invitait à ses rencontres d'amis qui posaient, eux aussi, une foule de questions. J'ai trouvé en ces gens une capacité d'écoute peu commune.
- «Pourquoi m'écoutent-ils avec autant d'intérêt?» demandai-je au recteur.
- «Tu parles avec ton cœur et tellement de conviction. Ton être parle davantage que tes paroles.»
- «Ces gens, en général, sont habitués de pelleter des nuages. Ils sont fascinés par une grande ouverture de l'âme et du cœur que tu peux leur faire.»
- «Si tu n'étais pas si heureuse, Anne-Marie, j'essaierais de tout mon pouvoir de te donner mes idées, mes convictions. Mais tu me sembles si heureuse et si bien dans ce que tu vis que je n'arriverais jamais à te donner un tel bonheur. Si c'est là confesser Dieu devant les hommes, alors tu es une bonne publicité pour ta religion. Si tous les chrétiens étaient convaincus comme toi et si la religion chrétienne apportait aux chrétiens ce qu'elle t'apporte à toi, ça vaudrait vraiment la peine d'être chrétien.»
Joie profonde que celle que je ressentais à l'écouter parler ainsi. Lui, un athée, semblait s'intéresser à Dieu!
Un soir, nous causions près du foyer.
- «Voudrais-tu m'épouser? Je ne voudrais plus jamais qu'on se quitte. On se sent si bien avec toi. Je voudrais me faire catholique juste pour être comme toi. Ton exemple est si entraînant. Tu as l'air si bien dans ta peau. Tu fais beaucoup de bien à ceux que tu rencontres...»
- «Tu sais bien que je n'accepterais pas de t'épouser puisque je suis déjà en «Amour», mon Dieu m'a épousée.»
- «Tu demeureras toujours mon modèle, Anne-Marie. Je me demande souvent ce que tu ferais à ma place. Tu n'as pas raté ton but avec moi. Ta vie m'apprend ce que c'est que l'amour. Je ne croyais qu'a l'amour charnel; mais là tu m'ouvres à autre chose d'inattendu. Je n'ai jamais su aimer et c'est maintenant que je m'en rends compte en te voyant. Je ne sais ce qui m'arrive. Jamais je n'ai aimé comme ça, de cette façon-là. C'est tellement sain de t'aimer. Qu'as-tu donc? Tu exerces sur moi un tel pouvoir! Comme tu es forte! Et moi qui voulais t'amener à mes idées! C'est toi qui m'as envoûté.»
Je demeurais silencieuse.
- «Oui, Anne-Marie, ça te va très bien d'être religieuse. Ça prend une personnalité très forte pour ce genre de vie. Tu es seule, ici en Angleterre. Tu pourrais te laisser aller. La première fois que je t'ai vue et que tu m'as dit, d'un air coquin, que M.I.C. voulait dire «Made ln Canada», j'ai voulu te connaître davantage. Tu n'as pourtant rien fait pour m'attirer mais tu rayonnes je ne sais quoi de si pur. Moi qui me croyais fort comme le roc, je suis comme un enfant devant toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui croyait autant en Jésus, avec autant de conviction, autant d'audace et de force. Et tous les grands de ce monde que je te fais rencontrer n'ont pas l'air de t'énerver. Tu es unique. Je ne croyais plus au bonheur et tu me l'apportes. Tu m'apportes une lumière et un bonheur que je n'ai jamais eus dans ma vie. Tu es pour moi un miracle vivant. Comment peux-tu être religieuse et si heureuse aujourd'hui dans un monde ou chacun veut faire seul son salut? Je ne suis pas tout seul à penser ainsi de toi. Je te verrais dans la haute classe, parmi ceux qui ne croient plus, parmi ceux qui n'espèrent plus... et tous ceux-là tu les ferais revivre. Regarde-moi, moi qui me disais athée. Je n'y comprends rien. Je m'abandonne, comme tu dis si souvent. Je fais confiance. Désormais, je veux être franc et loyal. Tu as mis de la lumière dans ma vie. Merci. Jamais je n'aurais cru qu'il existât des êtres comme toi. Sûrement que Dieu existe, puisque je le vois en toi.»
Ce qui me fascinait dans tout cela c'était la façon dont Dieu se servait d'une simple femme comme moi pour dire son amour. Sans nous, Dieu n'a pas de mains pour aider les pauvres. Sans nous, Dieu n'a pas d'yeux pour les regarder avec compassion, avec joie. Nous sommes ses yeux, ses mains, son cœur Quelle responsabilité! Mais en même temps, quel bonheur puisqu'il suffit de Lui demander de passer par nous et Il le fait. Combien de fois je l'ai expérimenté! Donner et s'abandonner. Il est tout-puissant et Il nous aime.
Arrive juin 1974. Chez les religieuses c'est le début des vacances. Toutes les pensionnaires doivent se trouver un lieu de résidence pour les mois d'été. Où aller? Je connaissais bien le Dr Allen et son épouse. J'allais causer avec eux tous les après-midi. Je leur demandai conseil. Ils me dirent que c'était plutôt ennuyeux d'aller chez des inconnus, et me suggérèrent d'aller demeurer chez le recteur. Il avait, en haut, une chambre qui ne servait pas.
- «Nous, nous sommes prêts à meubler cette chambre pour l'été.»
J'avais le goût d'accepter mais à la condition d'avoir quelqu'un avec moi pour me sentir plus à l'aise. J'écrivis à Montréal, à la communauté, afin d'avoir quelqu'un qui viendrait passer les deux mois d'été en appartement avec moi. Nous étions déjà quatre M.I.C. en Angleterre, mais très éloignées les unes des autres. Certaines suivaient des cours de sage-femme et d'autres, des cours en sciences sociales.
Régulièrement des sœurs passaient par l'Angleterre pour parfaire leurs connaissances de l'anglais. Mes chances étaient bonnes d'avoir quelqu'un pour passer les mois d'été avec moi.
La réponse vint rapidement par téléphone; j'aurais quelqu'un qui partait dans deux jours et qu'il s'agissait d'aller chercher à l'aéroport.
La fin juin arriva, mais pas la religieuse, pour des raisons de santé. Je me devais donc d'aller vivre dans cette famille du recteur, famille que je connaissais quand même très bien.
Au milieu de l'été, l'épouse du recteur part en vacance avec son fils de quatre ans. Une note sur la table, à mon intention dit:
- «Tu savais que j'étais en instance de divorce? Je pars maintenant mais ne crois pas revenir.»
Que faire? J'appelle au Généralat de la communauté à Montréal. J'explique la situation à la Supérieure générale qui se dit peinée de ce qui arrive et que, devant son incapacité d'intervenir, elle me fait confiance.
Me voilà seule avec un homme dont je sais qu'il m'a i m e beaucoup.
Je fais le ménage, prépare les repas, décore la maison et je l'écoute. Il a tellement à dire! Il me donne aussi l'occasion d'échanger avec lui et avec ses amis. Il ne comprend pas que la communauté me laisse seule de la sorte. Je sais qu'il me respectera et je fais donc confiance. Que de beaux échanges d'idées! Que d'heureuses conversations! Homme de grande culture, il parlait cinq langues parfaitement. On ne pouvait que sortir grandi de ce genre de conversation. Il m'aimait et moi aussi.
L'automne arriva et je retournai vivre chez les religieuses à Carshalton.
Avec novembre 1974 circulent des rumeurs. Quelques compagnes ont appris que j'ai vécu seule avec un homme au cours de l'été! S'ensuit un procès en règle! Des lettres parviennent à la Supérieure générale, à la Préfète des études. Il faut mettre fin à ce scandale!
Peu de temps après s'amènent nos deux importantes visiteuses. La rencontre se déroule en après-midi lors d'une réunion qui regroupe sept intervenantes. Ce sont des regards fuyants: on n'ose pas trop me regarder. Tout commence par une prière au Saint Esprit pour nous «éclairer» dans la présente démarche.
- «Vous avez demeuré seule avec un homme au cours de l'été?» me demande, en entrée de jeu, la Générale.
- «En effet.»
- «Avez-vous tenté d'avoir quelqu'un avec vous?» continue-t-elle.
- «Oui, mais la sœur qui devait venir pour les deux mois d'été n'est jamais venue pour, semble-t-il, des raisons de santé.»
S'adressant aux autres religieuses la Générale demande:
- «Et vous? Vous ne pouviez pas la recevoir chez vous?»
- «Avec les religieuses qui transitaient pour aller en Irlande, les chambres étaient toutes occupées, obligeant ainsi les pensionnaires à se trouver une chambre quelque part ailleurs.»
- «Personne d'entre vous n'a daigné faire un bout de métro pour accommoder Anne-Marie. Et là vous l'accusez et la jugez. À votre place j'aurais honte!»
Ce fut la fin des entretiens et de la réunion. Je retournai à Carshalton pour terminer mes études et en décembre je partais pour l'Afrique. Mon ami le recteur m'ayant promis de continuer à m'écrire, je lui ai laissé «Le Milieu Divin» de Teilhard de Chardin, livre qu'il avait découvert par moi et qui semblait le fasciner.
L'Afrique
Arrivée à Malawi, dans un petit avion de quinze places, j'observe les maisons champignons, les cochons et les arbres noirs, c'était la saison sèche. Une poussière rouge vole dans les airs. Des poules noires, des chiens noirs, des gens merveilleusement noirs avec un large sourire. Accueil chaleureux sous un soleil torride et accablant.
On me donne une chambrette où je prends quelques heures de repos. Au souper, manifestations de joie de la part des sœurs heureuses de me compter parmi elles. Le travail ne manquerait pas: enseignement à l'école secondaire, travail social, radio locale, liturgie familiale, visites des «stations» si éloignées qu'on aurait pu se croire de l'autre côté de la lune.
Il faut se méfier des dangers nocturnes, heureusement les sœurs s'y sont habituées et adaptées car il y a des religieuses ici depuis une cinquantaine d'années. Faisons confiance!
Le premier soir, en me couchant dans mon lit entouré d'une moustiquaire et à la lueur d'une chandelle, j'ai revu papa, maman, mes frères et sœurs Est-ce possible que la petite fille de Saint-Médard soit maintenant missionnaire en Afrique?
Le lendemain on me fait visiter les lieux. La chaleur est telle que je crains de m'évanouir. On me rassure en m'expliquant que mon corps va progressivement s'adapter et que tout rentrera dans l'ordre.
Il faut dès maintenant apprendre certains dialectes essentiels pour rencontrer et converser avec les gens. J'entreprends l'étude du Cynianga et du Chitoumbouka, des dialectes qui s'apprennent très bien. Les mots se prononcent pratiquement comme ils sont écrits. Le u devient un ou et le c devient un tsh. La grammaire est inexistante. Pour exprimer le passé, on ajoute une particule au verbe. Ex, J'ai bien mangé, Ndi Na Kudio buino ambiri. Pour le présent on ajoute un Ku avant le verbe et pour le futur, on emploie le Dza toujours devant le verbe. Il faut aussi apprendre beaucoup de proverbes africains.
On me fait visiter beaucoup de familles. En arrivant on se salue de la tête mais sans se parler. On se regarde en silence. Les gens visités sont les premiers à parler:
- «Moni, muli bwanzi?» (Bonjour, comment ça va?)
- «Ndi li bwino. Kaya inu?» (Ça va bien. Et vous?)
[Voir l'image pleine grandeur]

Autre moment de silence suivi d'une invitation à s'asseoir par terre sur des nattes de paille. Puis la conversation s'engage pour de bon.
C'est un grand honneur de recevoir les religieuses. D'une très grande simplicité, ces gens ont des coutumes en apparence plutôt étranges. Ainsi, les soirs de pleine lune, ils dansent toute la nuit au son du tam-tam.
Certains soirs les rugissements des bêtes sauvages nous tiennent éveillées.
Un travail pour la paroisse m'attendait à Chipata en Zambie: un chemin de croix de grande dimension et de style africain pour la nouvelle église.
Vient par la suite l'enseignement de l'anglais et des arts à l'école secondaire des Sœurs Grises.
Entre temps, les Pères Blancs m'invitent à visiter leur mission. Rencontres fréquentes, en cours de route, avec des girafes, des éléphants, des antilopes, de nombreux singes qui nous font la grimace. Le Père Roy m'annonce que demain on ira à une noce dans la brousse.
Je m'adapte très bien à mon nouvel environnement. On vit au jour le jour et ne faisons point aujourd'hui ce qui peut être fait demain. On prend le temps en tout et pour tout. Pas de grands magasins, pas de télé, pas même de radio sauf la radio locale.
Les gens aiment beaucoup s'amuser et monter des petites pièces de théâtre. On chante, on danse et on cause longuement en mâchant une branche de bambou.
J'anime aussi un groupe de jeunes pour la liturgie du dimanche. On fabrique des guitares qui ont des boîtes de conserve vides comme caisses de résonance. Le manche est fait de bois d'ébène et les cordes roulées sont en fil de sisal. Le sisal est une plante qui, en séchant, donne de longues fibres que les Africains roulent autour de leurs jambes pour les rassembler et les renforcer. Avec ce fil teint de différentes couleurs, on fait plein de belles choses souvent utiles et parfois justes pour le plaisir de créer.
J'ai encore pour tâche de m'occuper du poulailler où les serpents cracheurs me font face plus souvent que je ne le voudrais.
À l'école secondaire, en arts, je prépare les élèves pour un concours de dessin interprovincial entre les provinces anglo-américaines et toutes celles de l'Afrique Centrale. On se prépare et on y met tout notre cœur Dessins et peintures achevés sont envoyés à un grand jury à l'extérieur de la région. Est-ce que ça se rendra?
Deux mois plus tard une lettre nous parvient avec mon nom et celui de l'école où j'enseigne. On nous annonce qu'une de mes élèves a gagné le grand prix, en plus des trois autres prix secondaires qu'ont raflé d'autres élèves de ma classe. Les responsables feront un calendrier à partir des reproductions de ces dessins. J'ai encore en ma possession ce calendrier.
Ce succès va m'amener à me perfectionner en arts. Où? En Ouganda? La période politique trouble du temps exclut ce territoire des endroits possibles. Monseigneur Médardo, évêque de Zambie, m'incite à retourner à l'Université d'Ottawa pour ensuite revenir comme professeur attitré à l'école de Chipata. La Supérieure provinciale Germaine est tout à fait d'accord. Elle savait mon intérêt, depuis le noviciat, pour les arts et mon secret désir de devenir artiste-peintre.
- «Tu as de la chance, Anne-Marie» qu'elle me dit.
Elle communique avec le Généralat pour leur annoncer la bonne nouvelle. Déception là-bas, on se montre peu emballé et même réticent à me voir revenir au Canada pour étudier en arts. La Générale se souvenait m'avoir dit d'oublier ça quand j'étais au Noviciat.
Sœur Germaine prend le temps d'écrire et d'expliquer la situation. De plus, les nouveaux règlements permettaient aux supérieures provinciales des missions de prendre les décisions qu'elles jugeaient opportunes en ce qui concernait le perfectionnement des sœurs sous leur autorité.
La réponse à sa lettre est positive mais spécifie qu'il s'agit d'une période de courte durée.
Tu pars pour le Canada. Sœur Préfète, aux études, va te rencontrer. Aie confiance. Prends tout le temps voulu.
Je ne devais partir pour le Canada que dans quelques mois, ce qui me laissait encore du temps pour vivre avec mes amis africains.
De ce séjour en Afrique je retiendrai surtout les grands rassemblements, les fêtes fréquentes, la bonne humeur et la sérénité des gens de là-bas qui n'ont pas peur de faire des dizaines de kilomètres pour assister à des manifestions aussi bien sociales que religieuses ou autres.
J'ai vécu là des Noëls extraordinaires empreints de simplicité et de grande foi. Pas besoin de neige ou de sapins illuminés pour fêter Noël.
Il est beau de voir surgir de la brousse, torche en main, des milliers de gens qui s'avancent vers l'église en chantant «Ça bergers assemblons-nous» ou encore «O nuit de paix, sainte nuit» avec une ferveur jusque là inconnue. L'Esprit de Noël y est présent et entier. Décor différent mais avec un même esprit de Noël dans les cœurs C'est un Noël qui, par son dépouillement même, est encore plus réaliste.
Retour au Canada
Université d'Ottawa, Canada, 1977. Me voilà redevenue étudiante au Canada, cette fois, à Ottawa. J'étudie en philosophie, sociologie, littérature et dans les deux spécialités que sont les arts et la pédagogie de l'enseignement des arts. Ces cours s'échelonneront sur quatre ans à raison de onze mois d'étude par année.
J'ai trois années d'études complétées lorsque la Provinciale me demande de cesser mes études pour aller prendre la direction de la cuisine à Joliette. La tâche est telle qu'on ne trouve personne pour l'assumer. Il me faut une bonne dose de foi pour accepter, mais finalement je consens.
La nouvelle Générale, heureusement, me donne confirmation, avec le sceau de la communauté, qu'après cette année à Joliette, je pourrais reprendre mes études à Ottawa.
De retour en milieu universitaire je me sens heureuse et pleine d'entrain. Je deviens même gardienne de buts dans une équipe de hockey mixte. On travaille dur sous les ordres d' un bon entraîneur. Au dos de mon chandail la mention «Sœur volante No 1». Lorsque l'on gagne la partie on va manger au restaurant universitaire au coin de Laurier et Nelson. Les curieux, autour de notre table, agrandissent le cercle de semaine en semaine.
[Voir l'image pleine grandeur]

Un bon jour un journaliste du Citizen me demande une entrevue que je lui accorde volontiers. Des journalistes s'amènent à l'appartement que j'occupais, hors communauté, sur la rue Alta-Vista. Séance de photos et échanges sur divers sujets. Un des journalistes aperçoit les dessins d'une bande dessinée qui sera traduite en huit langues à travers le monde.
- «Vous êtes artiste peintre en plus!»
Son travail professionnel achevé, le journaliste responsable de cette séance me demande pourquoi je suis devenue religieuse et poursuit avec d'autres questions dans le même genre.
Dans le journal du lendemain un premier article paraît avec, en gros titre «ANNE-MARIE OUELLET une passion pour la nature humaine... peintre et religieuse.» Toute une page du journal pour ma petite personne. C'est beaucoup et les sœurs n'apprécient pas du tout. Je laisse les choses aller.
Un autre article du Weekender titre: «From Convent to canvas». Des sœurs de la communauté sont à la limite de leur tolérance. Un troisième article annonce «Nun as artist setting example» de Nancy Basle.
Pour ne pas être en reste, Le Droit d'Ottawa y va d'un article intitulé «Anne-Marie Ouellet religieuse - L'ART peut également conduire à Dieu».
Bien sûr, chaque nouvel article amenuise les liens qui me rattachent à la communauté.
Chaque fois que j'expose mes toiles, un article s'ajoute aux précédents. À la communauté, on n'en peut plus et on m'ordonne de faire cesser ces conneries.
Pourtant les articles sont repris ici et là dans les journaux du Québec. «Une religieuse gardienne de buts au hockey à l'Université d'Ottawa», «Anne-Marie Ouellet vient d'endisquer un trente-trois tours», «Artiste peintre mais aussi guitariste», «Elle chante ses propres compositions».
Abasourdies par toute cette publicité autour de moi, les sœurs s'inquiètent et se demandent comment mettre fin à tout cela.
Dans mes cours je témoigne de ma ferveur religieuse et de ma vocation. Si certains m'admirent, d'autres me ridiculisent. De tout ceci voici un exemple.
Pendant un cours d'arts débute une discussion à laquelle j'évite de participer. À mon chevalet, je dessine des esquisses.
- «Moi je déteste les sœurs!» lance une des élèves. «Si j'en voyais une ici je ne sais pas ce que je lui ferais.»
- «Attention, il y en a peut-être une et tu ne le sais pas.» lui répond une autre élève.
- «Hein! S'il y en avait une ça se verrait! On les détecte de loin ces gens-là.»
Regardant les élèves le professeur demande:
- «Vous croyez qu'il pourrait y avoir une sœur ici?»
- «Oui, oui, je sais qu'il y en a une mais je ne vous dis pas qui c'est.» dit quelqu'un dans la salle.
S'adressant à chacune le prof demande:
- «C'est toi la nun?»
La réponse était un éclat de rire ou un:
- «Fiche-moi la paix avec ça!» Venant vers moi:
- «Dis donc Anne-Marie, où est-ce qu'elle est la sœur? Il paraît qu'il y en a une dans la classe.»
- «Bien sûr que je la connais. C'est moi, la «Nun», la sœur!»
Surprise générale. Silence dans toute la classe.
- «Ai-je bien compris? C'est toi la sœur?» qu'il me demande en me donnant une tape sur l'épaule.
- «Oui, oui, c'est bien moi.»
Il m'installe sur un tabouret au milieu de la classe et tout le monde s'attroupe autour de moi alors que les questions fusent de toutes parts. On s'interroge et on s'exclame. Je ris et m'amuse comme une petite folle. À ce moment le professeur de photographie entre et demande:
- «Comment, sœur Anne-Marie, donnez-vous une conférence sur les missions?»
Tous se tournent vers lui pour lui demander comment il se fait qu'il sait cela alors qu'eux l'ignorent.
- «Mais c'est un fait connu de tous; elle n'a jamais caché sa vocation même les journaux en parlent...»
Ce genre d'anecdotes est survenu souvent et m'a toujours bien fait rire.
Au travail et aux études j'ai ajouté beaucoup de voyages organisés dans des pays comme l'Italie, la Grèce la Suisse, la Hollande, l'Irlande, la Floride, et Hong-Kong. Avec l'Angleterre et la Zambie, ça fait neuf pays où j'ai rencontré des gens aux cultures toutes plus intéressantes les unes que les autres.
[Voir l'image pleine grandeur]

Mes études terminées, il n'était plus question de l'Afrique. On avait besoin de moi à Ottawa où je m'occuperais de pastorale à la paroisse Sacré-Cœur et enseignerais les arts à l'Université.
Sur la rue Stewart mon studio était aussi très achalandé. Les expositions se succédaient à un rythme de deux par mois. C'est là qu'un bon soir un médecin venu acquérir quelques toiles me lance tout bonnement:
- «Tu sais qu'on veut fermer le Centre de Pastorale de l'Université d'Ottawa, faute d'argent?»
On m'avait déjà approchée de ce côté-là mais, avec tout le travail que j'avais sur les bras j'avais décliné l'offre. Mais ce soir-là je me sens attirée par cette occasion. Je rencontre le directeur de la pastorale à l'Université et, après quelques minutes, l'affaire est conclue. J'accepte le poste d'animatrice de la pastorale auprès des universitaires.
Il fallait préparer un programme incluant le plus de gens possible et faire vite. Deux jours plus tard je revenais avec un projet intitulé «Magoshan» c'est-à-dire «Fête de la paix au village» en langue amérindienne. Une idée comme ça qui m'est venue spontanément. Ce projet comprenait cinquante-deux ateliers et panels avec des kiosques des différents intervenants et représentatifs des gens des différentes nationalités et des différents pays qu'on pouvait rejoindre. On parlerait de paix, paix intérieure aussi bien que paix dans le monde. Paix dans toutes les confessions, toutes les religions, selon toutes les croyances. Ce serait une recherche du sens de la paix, de la signification de ce mot à tous les niveaux, aussi bien chez les bouddhistes que chez les communistes, les protestants ou les catholiques. Voilà un projet à caractère universel et universitaire. Ce pouvait sembler une utopie mais il fallait tenter le coup. Le projet est accepté par le directeur. Maintenant, où prendre l'argent?
- «Je le trouverai» lui dis-je.
Au terme d'une brève rencontre avec le recteur de l'Université je me retrouve bredouille. Il n'accepte le projet qu'à la condition que je trouve l'argent nécessaire à la réalisation. Parfait, que je me dis, j'ai les mains libres.
Je file aussitôt vers les ambassades de différents pays et vers des groupes non gouvernementaux. J'inclus l'Archevêché, les communautés religieuses, etc.
Quinze jours plus tard je retourne chez le recteur avec quarante mille dollars en poche!
Le projet est en marche et le chantier va bon train. Je fais venir Don Helder Camara du Brésil, John Littleton de France, des gens d'un peu partout au Canada.
Chaque jour j'allais faire du recrutement dans les classes de l'Université pour pouvoir constituer une équipe qui puisse compléter l'énorme travail à faire:
- Montgolfières décorées du «Magoshan pour la paix»;
- Impression des programmes;
- Pancartes et affiches publicitaires à confectionner;
- Danseurs (euses), chansonniers (ères) à inviter;
- Spectacles de ballet à organiser;
- Gens de toutes sortes à contacter;
- Kiosques (52) à confectionner.
C'était un feu roulant et le directeur en était abasourdi. Il n'en revenait pas. C'était comme une ruche bourdonnante d'activités. Ce fut tel qu'on décida de ne pas fermer le Centre de Pastorale et, du même coup, de me garder comme animatrice. Il fallait créer de nouvelles approches, impliquer le plus de profs et d'étudiants possible. C'est ce que je m'acharnai à faire pendant cinq ans.
Toujours religieuse je continuais à prier et à méditer. Je gardais l'idée d'aller chez des sœurs cloîtrées. Malgré le plaisir que j'avais à faire tout ce travail, je ressentais ce besoin de paix, de silence, qu'on ne saurait retrouver que dans un cloître.
On est en 1984 et, en faisant le bilan, je pensais aux années passées en Afrique, aux amis actuels qui m'aimaient et me gâtaient, aux soirées au Centre National des Arts, aux sorties dans les salles de concert et d'opéra, aux multiples rencontres avec des gens de grande culture. Tout cela m'enrichissait et pourtant, j'avais le goût de laisser tout ça pour vivre de Dieu seul.
J'entrepris donc les démarches pour passer des M.I.C. aux Bénédictines de Mont-Laurier, à la stupéfaction des gens qui demeuraient incrédules devant ma décision. Autant de succès ne se conciliaient pas avec ce besoin de tout abandonner pour aller vivre enfermée. Pourquoi aller se terrer au fond d' un cloître?
J'avais réalisé, l'année auparavant, le trente-trois tours titré «Il y parmi nous quelqu'Un» parlant de la présence persistante de Dieu au creux de moi-même. L'effet de cette présence était toujours aussi actif en 1984. Une présence tenace, persistante et ce bonheur intense.
[Voir l'image pleine grandeur]

Je ressentais un immense besoin de me ressourcer et de donner du temps gratuit à Dieu que j'aime et qui m'aime. Je voulais Lui donner plus, toujours plus.
Acceptée chez les Bénédictines, j'abandonne tout et entre au cloître. La grande paix du cloître me fait grand bien. L'adaptation est rapide. La Mère abbesse me fait remarquer:
- «On dirait que tu vis ici depuis dix ans. Tu as l'air de si bien comprendre notre vie de bénédictine qu'un jour tu seras peut-être l'abbesse de lieux.»
Cette femme de quatre-vingt-treize ans était très lucide pour son âge et très humaine. D'une ouverture d'esprit un peu rare elle nous taquinait et tentait de nous rendre heureuses tout en étant fidèles à la vie mystique et sobre du monastère. Quelle belle simplicité!
La vie austère m'allait très bien. On partageait notre vie entre la prière, le travail et la méditation, dans un grand silence qu'on ne rompait que quinze minutes par jour, après le souper.
Quel contraste avec la vie trépidante que je venais de laisser! À travers toutes ces activités silencieuses revenaient tous mes souvenirs d'Afrique, d'Angleterre, d'Ottawa ou d'ailleurs. Quelle emprise Dieu avait-Il sur moi? Je laisse bredouille un ami sérieux à dix-huit ans; je renonce à des demandes en mariage en Angleterre, en Afrique ou au Canada. Que d'occasions qui me sont offertes et que je décline, de vivre ma vie autrement! Et moi qui aimais tant les enfants! Comment avoir sacrifié cette opportunité de bonheur pour suivre un Dieu qu'on ne peut rencontrer que dans la foi?
Avec les semaines et les mois qui passent je savoure cette paix de l'âme et du cœur Pendant ce temps, à l'Université d'Ottawa, on cherche en vain un animateur ou une animatrice en pastorale. Les Pères Oblats, fondateurs de l'Université d'Ottawa et responsables de la pastorale, sont très actifs et continuent de me contacter dans l'espoir de me voir revenir à ce poste éventuellement.
Au monastère, on me donne plus de responsabilités. La confiance règne. La vie ici est gratifiante. Voilà ce que j'écris dans mes lettres à l'occasion de Noël.
Je pousse l'abandon de moi-même jusqu'à me faire raser le crâne. Dépouillement total, libération intérieure, détachement de ce qui est matériel. Tout ce qui compte c'est d'aimer et d'être aimée. Mon seul Bien c'est Lui.
Le trois janvier 1985 Mère abbesse et deux sœurs du Conseil me font venir à leur bureau.
- «Sœur Marie-Emmanuelle, nous avons quelque chose à te dire. Le Seigneur ne vous donnera pas toujours des consolations, du lait et du miel. Il vous a fait une grande grâce de détachement. Remerciez-Le chaque jour pour cela. Mais, selon l'Écriture même, on ne doit pas mettre la lumière sous le boisseau. Si le Seigneur te demandait un détachement encore plus total l'accepteriez-vous?» demande l'abbesse d'une voix tremblante.
- «Tu as voulu mourir à tout pour le faire vivre et témoigner de son amour. Tu es prête à tout pour Le suivre, même à quitter ce milieu où tu te sens si bien, où nous t'apprécions tant pour tout ce que tu nous apportes. La vie religieuse est pour toi comme une gloire que tu dois Lui donner. Dieu t'a amenée jusqu'ici pour te montrer qu'Il veut encore plus de toi dans l'avenir. La contemplation dans l'action, l'action dans la contemplation sera toujours ton leitmotiv. Marie-Emmanuelle veut dire «Dieu avec nous». C'est ça ta vocation et tu n'as plus besoin des murs de ce cloître pour Le suivre là où Il te veut.»
Au fil des propos je crois comprendre mieux mon passage ici, au milieu de femmes extraordinaires nourries de silence et de prières. Ce désert, cette oasis de paix était là pour forcer l'événement. J'abaisse les armes, je capitule devant l'exigence du Dieu d'Amour, du Dieu de mon cœur J'accepte d'aller là où Il voudra que je sois. Au ciel ou dans les enfers Il sera près de moi. Depuis toujours Il est à l'œuvre en moi. Le royaume doit grandir et «l'Être Plus» augmenter, se dilater.
Je les remercie et demande pour aller prier seule à la chapelle. Ouvrant la Bible au hasard je lis: «Voici que je la conduirai au désert et que je lui parlerai au cœur..» Je ne pense plus; je regarde le tabernacle et je commence à tout comprendre.
Si Tu m'as placée ici en serre chaude, que je Lui dis, c'est pour mieux me ressourcer et me relancer au front. Je m'abandonne... ta volonté et rien d'autre. Je suis à Toi sans réserve. Que tous ceux et celles qui me voient ou me rencontrent m'oublient pour ne voir que Toi, que ton amour. Comme Marie je te donne au monde. Noël c'est ça, donner Jésus au monde par un geste, une bonne action, par la prière. Noël c'est donc tous les jours puisque Noël c'est l'Amour. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ne jamais perdre de vue que tu es l'Essentiel d'une vie. Le jour où Tu me diras «Va», j'irai.
Je suis soulagée d'avoir tout abandonné à Dieu et je ressens un bonheur tel que mon cœur semble vouloir éclater. Il n'est pas assez grand pour loger tout ce bonheur. C'est le cœur de Dieu qu'il me faut en ce moment. Je sais que j'ai trop à dire pour être écoutée. «Ton Dieu sera ta Beauté.» (Isaïe 60, 19)
L'ineffable prenait corps en moi. Le Noël de l'âme devait le faire éclater comme un bourgeon trop à l'étroit dans son corsage vert. La pâte c'est moi et le levain c'est Lui. Sans lui je demeure inerte et sans vie. Il est de ces choses que seul le cœur sait comprendre et goûter. La bataille de la vie, pour moi, est une étreinte d'amour, un amour exigeant mais combien gratifiant. «Que sert à l'homme de gagner l'univers ...s'il vient à perdre son âme?» On gagne tout en abandonnant tout par amour, dans les mains du Dieu aimant.
À l'instar de Jacob dans sa lutte avec l'ange, je capitule. Je partirai du cloître le cinq janvier.
Le soir du quatre janvier je reçois un appel d'Ottawa. Le Père Médéric Montpetit m'annonce que plusieurs profs de l'Université et lui-même viendraient samedi me voir au couvent. Ils veulent me convaincre de revenir là-bas comme animatrice de pastorale.
Je lui réponds que ce ne sera pas nécessaire car je quitte le couvent vendredi le cinq sans trop savoir où j'irai. En attendant j'irai chez ma sœur Marielle à Ville de Laval. Me revient en tête la métaphore de la charade; pas facile à défricher.
Une petite fête est organisée en mon honneur. Avec mes cheveux rasés c'est un peu froid pour la tête. La Mère abbesse arrive avec un sac de perruques. C'est le délire tellement on rit au fil des essayages de perruques. Cheveux longs, courts, raides, bouclés. Les sœurs elles-mêmes enlèvent leur voile pour essayer des perruques alors que la soirée se prolonge au-delà de la limite habituelle.
On me donne de belles cartes de souhaits et on me demande de ne pas les oublier. Elles-mêmes ne m'oublieront pas, m'assurent-elles.
- «Tu sera notre missionnaire bénédictine!»
Vingt et une heures. Les sœurs vont à la chapelle pour la prière du soir. Ce sera ma dernière nuit au cloître.
Le cinq janvier au matin, dans un tailleur bleu foncé et affublée d'une perruque brune je prends mon déjeuner, seule, au parloir en attendant ma sœur et mon beau-frère. Les sœurs viennent me dire un dernier au revoir. À travers les larmes je franchis discrètement le seuil. Une autre étape derrière, une autre aussi devant.
Je m'installe dans une des chambres chez ma sœur Le téléphone sonne et c'est le directeur du Centre de la Pastorale qui demande à me parler.
- «Je ne te connais pas car je remplace l'ancien directeur qui a démissionné. Le Père Médéric m'a informé que tu laissais ta communauté pour aller travailler et vivre à Montréal. J'ai entendu parler de toi par nombre de personnes et proches collègues. On menace à nouveau de fermer le Centre et c'est pourquoi ta présence nous serait si précieuse. Je ne te donne pas le choix, tu dois commencer dès lundi à préparer les activités du printemps et ça presse!»
J'annonce la nouvelle à Marielle et nous savons bien que je ne serai pas longtemps à Montréal. En jetant un coup d'œil dans le miroir j'aperçois ma perruque défraîchie. Je l'enlève pour la laver et c'est le fou rire dans la maison. Mais voilà qu'une fois séchée ma perruque ne fait plus! Marielle et moi tirons d'un côté, puis de l'autre et mon beau-frère qui est malade de rire. De quoi aurai-je l'air lundi matin à l'Université d'Ottawa?
Après le dîner j'essaie à nouveau ma perruque et, ô miracle! Cette fois elle me fait. Quel soulagement!
Dimanche matin je prends l'autocar pour Ottawa où je me rends au Holiday Inn pour la nuit car je n'ai alors personne chez qui rester.
Lundi matin le huit janvier 1985, à huit heures et demie, je suis à l'Université. Mon bureau est tel que je l'ai laissé. Ainsi en est-il pour l'autel du Magoshan, sculpté par un artiste de St-Jean-Port-Joli. Je l'avais fait sculpter spécialement pour mes activités de pastorale. C'est à plusieurs, sous la direction du maître sculpteur, que, ciseaux à bois en main, nous l'avions sculpté quelques années plus tôt pendant la semaine du Magoshan.
Les activités vont donc reprendre à nouveau: un journal informatique appelé Euréka, des rencontres dans les classes, un théâtre biblique, hockey tous les vendredis soirs, chorale «Les chanteurs de la paix».
J'ai trouvé un appartement à Kanata et voyage en autobus.
En décembre 1985, c'est un voyage à HongKong pour préparer d'autres projets. J'apprends le chinois et l'art chinois pour se faire plus proche des étudiants (es) asiatiques à l'Université. À mon retour c'est la semaine sainte et la grande fête pascale. Chemins de croix avec acteurs et actrices universitaires, conférences internationales, préparation d'un groupe de voyage. La vie va à bon train. Je prends aussi des cours de piano et je dirige des messes. Je prépare les gens des ambassades au baptême de leurs enfants. La Saint Vincent de Paul occupe une bonne part de mon temps.
Il y a aussi les visites des Gîtes des démunis, de prisons, du Berger de l'Espoir avec un groupe de jeunes universitaires convaincus que la paix ça se prouve dans des gestes concrets.
Pendant l'été je fais la cuisine au chalet Duguay des Pères Oblats à Aylmer. À l'hiver 1988, soit le vingt février exactement, j'emménage dans un appartement tout près de l'Université.
À chaque vendredi, mon travail à l'Université terminé, je pars au Chalet Duguay pour la fin de semaine. Travail bénévole mais travail combien enrichissant aux côtés de ces missionnaires à la retraite!
Un bon jour je reçois de la visite inattendue, un ancien de mes professeurs d'Université.
- «J'ai fait le tour du monde pour te retrouver! J'ai besoin de toi dans l'école Glaude de Vanier dont je suis devenu directeur.»
- «Intéressant, mais mes élèves de huitième année qui ne veulent rien savoir de l'école et ne pensent qu'à faire des mauvais coups?»
- «Tu donnes la moitié de ton temps à la pastorale. Pourquoi ne pas enseigner à temps plein? Et c'est ce que je t'offre. Je te lance un défi: prendre en main mes élèves de huitième année. À part toi je ne vois pas qui oserait relever le défi.»
- «Je dois réfléchir, consulter. Donne-moi une semaine et je te rappelle d'ici là.»
Quoi faire? Le directeur du centre est compréhensif et consent à me libérer si je me trouve un ou des remplaçants. Cette condition fut vite résolue car j'avais préparé une relève qui était déjà informée et entraînée. J'ai refilé les clés à mes remplaçants qui sauraient, de façon neuve, à leur manière, poursuivre le travail réamorcé depuis trois ans.
Mon nouvel emploi d'enseignante à temps plein m'oblige à enseigner onze matières. Quel boulot! Mon directeur est heureux de ma décision:
- «Fais ce que tu peux avec eux et surtout ne t'épuise pas. Pourvu que tu les tiennes en classe. Tu ne feras pas de miracle avec des élèves qui se maintiennent entre trente et trente-cinq pour cent.»
Septembre 1988. Vingt-cinq élèves entrent dans la classe en criant et en gesticulant. Adossée au tableau je les regarde en souriant. Le directeur s'amène et fait les présentations.
Sitôt ce dernier parti, certains gesticulent et d'autres s'étirent, bâillent et lancent même leurs livres à travers les fenêtres.
- «Vous avez bien raison, pas besoin de ça!»
Et je lance mes livres par la fenêtre à mon tour. Saisis de stupéfaction, ils restent là sans bouger, bouche bée. Puis c'est le fou rire général.
- «Vous n'aimez pas ça venir à l'école?»
- «Non on n'aime pas ça. C'est moche!»
- «Bravo! Que diriez-vous si j'apportais ma guitare et qu'on chantait?»
- «Vous jouez de la guitare?»
- «Oui, j'aime bien ça et demain, apportez vos chants préférés et on les chantera ensemble.»
- «Oh madame! vous êtes cool!»
Deux ou trois jours plus tard le temps était venu d'avoir une bonne discussion. On a placé les pupitres en cercle et chaque élève a expliqué sa situation, a parlé de lui-même ou d'elle-même et des sujets qui l'intéressaient.
J'entendais dire par les autres élèves que ceux de huitième année avaient une prof bien spéciale, qu'ils avaient l'air heureux et qu'ils étaient plus calmes. La semaine a passé à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Vient enfin le moment où ils sont prêts à travailler plus assidûment.
- «À mon arrivée on m'a dit que vous seriez capables de rien faire; moi, par contre, je vous trouve formidables et capables de bien réussir. Si vous voulez on va surprendre tout le monde. Vos notes vont passer de trente à soixante-dix pour cent. Moi je vais donner cent dix pour cent pour vous aider.»
Je voyais des yeux s'allumer.
- «Oui madame, nous sommes prêts à le faire juste pour vous faire plaisir.»
Comme j'enseignais la culture physique en plus des dix autres matières, j'en profitais pour les récompenser.
- «Les devoirs sont tous faits, alors très bien, on fait du trampoline!»
L'intérêt en informatique étant là, on en a profité pour faire l'histoire, la géographie et les mathématiques sur ordinateur, en plus de beaux devoirs propres et agréables.
Un de nos projets était de présenter nos beaux devoirs à l'exposition de mai à l'École Laurendeau, à un groupe de sept à huit cents profs qui viendraient là pour la Convention. L'informatique étant une formule nouvelle en enseignement, nous serions une classe pilote. Les jeunes étaient emballés.
Ce fut bientôt le temps de passer à la catéchèse, sujet détesté par excellence. J'ai songé à leur faire faire de l'improvisation sur des thèmes bibliques. Peut-être aimeraient-ils ça? J'avais visé juste. Chacun(e) avait sa part d'Évangile à préparer et à jouer suffisamment bien pour que les autres reconnaissent le passage dont il s'agissait.
- «C'est quand la catéchèse, cette semaine? On ne pourrait pas en avoir deux fois par semaine?»
Pour varier, je leur demandais, par exemple d'apporter les posters qu'ils préféraient et de nous en parler. J'avais promis, moi aussi, d'apporter le mien. Le matin où l'on devait parler des posters le directeur était dans la classe comme auditeur libre.
- «Puis-je assister à votre cours? Je serai sage.»
Pas d'objection mais bien des sourires moqueurs. Tout le monde s'exprimait avec aisance et simplicité. Plusieurs, à la fin, ont déchiré leurs posters car ils «ne l'aimaient plus».
- «Et le vôtre madame Anne-Marie?»
J'avais une grande affiche d'un hippie.
- «Mais c'est Jésus?»
- «Vous l'avez reconnu! C'est merveilleux!»
Les questions sur Jésus, la souffrance, les contradictions de ce monde, la guerre fusaient de partout. Je leur retournais la question:
- «Et vous, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous?»
Je rectifiais, si nécessaire, leurs réponses à leurs questions.
De fil en aiguille, on parla de ma vie chez les religieuses, des missions, de ma philosophie. Le directeur n'en revenait tout simplement pas.
- «Et tu veux, en plus, préparer une pièce de Noël et la présenter à l'Université? En septembre ta demande m'aurait fait rire, mais là je te donne carte blanche.»
Ce dont les élèves avaient le plus besoin c'était la confiance en soi. Avec une certaine stratégie dans la correction, on pouvait leur en donner en augmentant quelque peu leurs résultats, pendant la période qu'il restait avant d'arriver à Noël. Quelle mine réjouie à la vue de leur bulletin dont ils prenaient grand soin. Les parents n'y comprenaient rien mais n'en étaient pas moins fiers. La confiance tant recherchée s'était installée pour de bon dans le groupe de huitième année.
Graduellement on retourna aux exigences régulières. Tous les élèves réussirent les examens du ministère à la fin de l'année, sauf un qui, en dépit des heures supplémentaires que je lui ai consacrées, n'a pu rattraper le temps perdu les années auparavant.
Exténuée en cette fin d'année, je décide de retourner à l'Université. Les journées bien remplies à l'école étaient suivies de longs travaux de préparation en soirée, en plus des rencontres pédagogiques et des rencontres avec les parents.
Le directeur, reconnaissant ce surcroît de travail, me proposa l'enseignement des arts, ma spécialité, et de la musique. J'acceptai cette nouvelle tâche sans doute moins exténuante que j'allais accomplir de 1989 à 1998. En ces domaines où l'originalité fait loi, ce fut l'enchantement. Je n'aurais jamais pu demander mieux.
Le temps de préparation étant moindre, je pouvais travailler à la pastorale, travail bénévole en Ontario. J'ai innové avec des chorégraphies, des gestuelles bibliques, des participations directes des élèves, etc., ce qui eut pour effet de faire cesser les critiques à l'égard des célébrations et des messes auxquelles il fallait assister, d'une part, et de créer un engouement pour ces activités, d'autre part.
La retraite
Nous voilà en 1998. Depuis deux ou trois ans je songe à la retraite. En janvier je prends ma décision, juin qui vient sera le signal de mon départ pour la retraite. À cinquante-huit ans mon plan de retraite est clair: retour dans mon coin natal pour retrouver ma famille et mes souvenirs d'antan. Achat d'une maison, peinture, activités de mon choix à travers les odeurs de ma campagne, à travers la sérénité et le calme d'une retraite dont je goûterai chaque instant. Donner du temps à mes frères, à mes sœurs, rendre service à la communauté paroissiale, prendre le temps «d'être» dans la contemplation et dans l'action.
[Voir l'image pleine grandeur]

Cette réflexion de St-Exupéry me revient «Ainsi mon petit Dieu te fait naître, te fait grandir, te remplit successivement de désirs, de regrets, de joies et de souffrances, de colères et de pardons puis Il te rentre en Lui. Tu n'es ni cet écolier ni cet époux, ni cet enfant, ni ce vieillard. Tu es celui qui s'accomplit. Tu goûteras tes mouvements d'éternité.»
C'est ainsi que je vis ma retraite en goûtant en chacune de mes journées des mouvements d'éternité. Vivre le moment présent. Qu'il soit plein de sa PRÉSENCE. Quel bonheur!
Nous sommes des passants sur cette terre, des gens qui ne sont que de passage. Folie ce serait de s'attarder au chemin quand c'est à l'autre bout que nous sommes attendus.
Défi irréaliste que de raconter sa vie en moins de cent pages! Défi à relever que de choisir parmi les événements ceux qui nous ont semblé les plus importants et les plus intéressants.
On naît avec un trésor dans un vase d'argile. Compte seul ce que tu es devenu(e) quand sonne le départ de cette vie terrestre.
Je crois en l'amour qui se change en temple, lieu où l'on bâtit le passage d'un état à un autre, où tout sera béatitude et contemplation dans l'Amour. (...)
Il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre, comme la poignée de sable, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. (...)
Ainsi je marche de fête en fête et d'anniversaire en anniversaire, de vendange en vendange comme je marchais, enfant, de la salle du conseil à la salle du repos, dans l'épaisseur du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens. (...)
Et celui-là n'habite pas le même univers qui habite ou non le Royaume de Dieu.» (St-Exupéry)
Je me suis prêtée à cet exercice de retour sur ma vie par simple plaisir. Ce fut l'occasion de ramener les faits les plus marquants de mon existence pour dire merci à la Vie, ce don merveilleux qui nous est prêté. Qu'il est magnifique d'être né(e)!
Anne-Marie Ouellet
Lexique
|
Astheure: |
Maintenant |
|
Barley: |
Orge |
|
Beans: |
Fèves au lard |
|
Ben: |
Bien |
|
Bogey: |
Voiture tirée par des chevaux |
|
Braquettes: |
Clou à tête plate |
|
Cannures: |
Cannelures |
|
Catherine: |
Chaudière |
|
Cenne: |
Cent, sous |
|
Chiard: |
Repas fait de patates et de lard |
|
Coat: |
Veston |
|
Cochonneries: |
Déchets |
|
Couvarte: |
Couverture |
|
Couvert: |
Couvercle |
|
Décachés: |
Découverts |
|
Dépense: |
Remise |
|
Engagère: |
Engagée |
|
Escousse: |
Moment |
|
Étampe: |
Estampe |
|
Faniant: |
Fainéant |
|
Flanelette: |
Finette, flanelle |
|
Fly: |
Fermeture éclair |
|
Frette: |
Froid |
|
Froque: |
Manteau |
|
Galandart: |
Godendart, grosse scie qu'on manie à deux travailleurs |
|
Greillait: |
Habillait |
|
Grailler: |
Installer |
|
Icitte: |
Ici |
|
Lousse: |
Pause, temps |
|
Mautadit: |
Patois |
|
Ménoires: |
Partie de l'attelage du cheval |
|
Pelle à feu: |
Sage-femme |
|
Pilotage: |
Va et vient |
|
Pis: |
Puis |
|
Piton: |
Bouton |
|
Ramasseux: |
Personne qui ramasse beaucoup de chose |
|
Robeur: |
Espèce de bottes en caoutchouc |
|
Scring: |
Moustiquaire |
|
Secousse: |
Moment |
|
Sink: |
Évier |
|
Steame: |
Cuisson à la vapeur |
|
Sucrage: |
Portion de sucre |
|
Tapon: |
Plusieurs |
|
Tarme: |
Terme |
|
Tasserie: |
Partie de la grange où l'on tasse le foin. |
|
Toast: |
Pain rôti |
|
Toffer: |
Résister |
|
Train: |
Bruit |
|
Vesseau: |
Contenant en plastique |
|
y: |
Il |
|
Zipper: |
Fermeture éclair |
Remerciements
L'équipe de production tient à remercier pour leur gracieuse participation au présent recueil:
Le Centre d'édition des Basques pour son appui à l'édition.
Le Musée des maîtres et artisans du Québec pour le prêt des illustrations de monsieur Edmond-J. Massicotte. www.mmaq.qc.ca
[Voir l'image pleine grandeur]

Le Musée du Bas Saint-Laurent pour le prêt de photographies d'époque.
[Voir l'image pleine grandeur]

Crédits
Auteures
Marie-Rose Ouellet
Anne-Marie Ouellet
Préface
Michel Leblond
Coordination du projet
Julie Ouellet
Saisie des textes
Julie Ouellet
Représentations graphiques
Edmond-J. Massicotte
Anne-Marie Ouellet
Collaboration spéciale
Centre d'Édition des Basques
Correction
Michel Leblond
Julie Ouellet
Lynda Beaulieu
Publié par le Centre Alpha des Basques avec l'appui financier du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme Initiatives fédérales-provinciales en matière d'alphabétisation (IFPCA).
Pour commander des exemplaires
Centre Alpha des Basques
15, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Téléphone: (418) 851-4088
Télécopieur: (418) 851-3063
Courriel: cadb@bellnet.ca