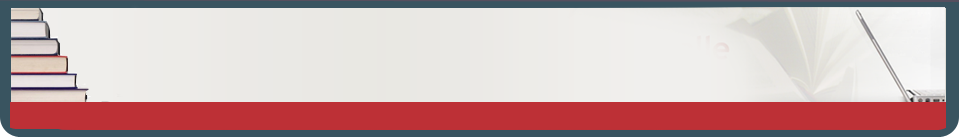- Avant-propos
- La mère Gravel
- Le moulin à scie de monsieur Maisonneuve
- L'arrivée du chemin de fer
- Le voyage du père Falher
- Le rite d'initiation
- La bagosse de Rodolphe Demers
- Le shack d'Odilon Proulx
- La veillée au corps du gros Lussier
- Le coup de gin du notaire Dansereau
- La noce d'Édouard Frémont
- Les déboires d'Hubert Gagnon
- La cayousse de Wilfrid Duguay
- La chasse à Tours
- Le charivari de Georges Dufour
- Le meulon de paille d'Eugène Gravel
- Glossaire
- Région de Rivière-de-la-Paix
- Publications des Éditions des Plaines
- Biographie de l'auteur
- Crédits
Avant-propos
Lors d'une visite récente à Ottawa, mon beau-frère, Louis-Philippe Moquin, m'a raconté pour la dixième fois des histoires de Jarrets noirs, qui s'étaient déroulées dans la paroisse du Sacré-Cœur, à Donnelly, située à près de trois cents milles au nord-ouest d'Edmonton, en Alberta.
On a trop peu tenu compte du fait français albertain. Presque toujours, on entend : "Ah, oui, Saint-Boniface", lorsqu'on parle de l'Ouest. Mais non. Le Royaume de la Paix, colonisé par des Canadiens français à partir de 1912, mais parcouru bien avant par des missionnaires français, se trouve à neuf cents milles plus loin encore.
Moquin était venu du Québec en 1918, avec d'autres colons. La vie était dure. D'aucuns, comme lui, y sont restés, s'y sont mariés et y ont élevé leur famille. D'autres, comme mon père, sont repartis en y laissant leur famille; cela explique comment il se fait que j'aie connu la plupart des personnages en cause dans ces contes, alors que j'étais jeune à l'époque.
Mais c'est grâce à la mémoire phénoménale de mon beau-frère si j'ai pu, tant bien que mal, con-
signer sur papier quelques-unes de ses nombreuses expériences et un peu de son merveilleux sens d'humour. Bien que brodées et renflouées, ces historiettes sont, en réalité, un témoignage authentique de la vie française en Alberta, durant la période entre les deux guerres mondiales.
Jean Pariseau
[Voir l'image pleine grandeur]

La mère Gravel
Je me souviens très bien de Marie-Anne Gravel pour l'avoir connue durant mon enfance. Elle était courte, assez grosse, et marchait lourdement, se balançant d'un côté, puis de l'autre. Mais elle aimait la vie. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais entendue disputer personne. Elle avait le rire facile et généreux, même après une grosse journée de travail dans son jardin. Je l'entends encore s'esclaffer...
J'avais toujours entendu parler de la mère Gravel comme étant la fondatrice de Donnelly. Disons qu'elle était une des deux premières Canadiennes françaises à venir dans la région. L'autre, madame Donat Forgues, née Marie Bouchard, l'accompagna de Grouard, après que son mari eût monté son shack en bois rond, dans lequel les pères Giroux et Falher célébrèrent la première messe.
Fille du vieux Télesphore Leblanc, Marie-Anne avait perdu son premier mari, portant lui aussi le nom de Leblanc, de qui elle avait eu un enfant. Elle vint dans l'Ouest avec son père, à la demande du père Jean-Baptiste Giroux, o.m.i., missionnaire-colonisateur. Et si le voyage par train de Montréal avait pris du temps, il était encore plus confortable que celui qui l'attendait à partir d'Athabasca Landing, tête de ligne au nord d'Edmonton. Après une courte ascension de la rivière Athabasca jusqu'à Mirror Landing, on devait portager femmes et bagages jusqu'à Saulteaux Landing, puis remonter à bord d'un deuxième bateau à aubes, plus petit celui-là, qui traversait le Petit lac des Esclaves de tout son long, avant d'arriver à Grouard.
Ancien poste de traite de fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest, connu alors sous le nom français de fort Blondin, et devenu propriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson, en 1820, l'endroit avait été nommé Grouard, du nom de monseigneur Émile Grouard, vicaire apostolique de l'Athabasca, qui avait choisi d'y établir sa "cathédrale". C'était la table tournante de toute activité dans la région. De là, on s'acheminait au nord ou à l'ouest, vers la prairie, en voitures à chevaux ou avec des bœufs, comme le fit Marie-Anne Gravel.
Pénible voyage, que celui-là, pour Marie-Anne, qui avait dû laisser son jeune frère, brûlant de fièvre, sous les soins de sa sœur, à Grouard, alors qu'elle-même amena son propre fils, sur ses genoux, également malade d'avoir bu de l'eau corrompue.
Le voyage dura trois jours. Le soir, on montait une tente et le jour on se protégeait du soleil ardent en affixant une toile à des cerceaux, au-dessus des têtes. Heureusement qu'il ne pleuvait pas. Mais cela n'empêchait pas les moustiques, avides de sang neuf, de se darder sur la chair blanche. Le lendemain de l'arrivée du groupe dans la prairie, Marie-Anne perdit son fils unique. Quelle douleur pour elle, mais aussi de quelle force de caractère elle sut faire preuve! On prit trois bouts de planches qui servaient de porte à la tente et on confectionna un petit cercueil; ensuite on repartit sans tarder pour aller enterrer l'enfant au cimetière de Grouard. En arrivant, double douleur d'apprendre que le jeune frère était mort au même instant que le fils. Les deux enfants, oncle et neveu, furent inhumés dans la même fosse. De retour à la plaine, quelques jours après, Marie-Anne s'installa sur un terrain au nord de celui de son père. En plus d'aider aux travaux de la ferme, elle fit le ménage, la nourriture, la vaisselle, et tout ce qui s'impose dans un pays neuf. En 1914, elle épousa Eugène Gravel dont elle eut un fils, et avec qui elle accepta de gérer la salle d'immigration au village naissant de Donnelly, peu après l'arrivée du chemin de fer en 1915. Mais ça c'est une autre histoire.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le moulin à scie de monsieur Maisonneuve
Pendant de nombreuses années, le moulin à scie Maisonneuve fut l'unique industrie dans la paroisse du Sacré-Cœur, sauf, évidemment, l'agriculture. Il y fut installé dès l'été de 1916, soit quatre ans après l'arrivée des tout premiers colons canadiens-français dans la région.
Originaire de Mascouche, Philias Maisonneuve avait travaillé comme arpenteur au Montana avant de se rendre à Edmonton, alors que l'Alberta était encore rattachée aux Territoires du Nord-Ouest. Un jour, sur le bac qui traversait la rivière Saskatchewan-Nord, reliant ainsi Strathcona et Edmonton, il offrit son siège à une jolie demoiselle, petite et très féminine, du nom de Madonna Léveillé. Six mois plus tard, les cloches de l'église Saint-Joachim annonçaient à la population locale que Philias et Madonna s'étaient unis pour la vie.
Bon menuisier, Philias construisit l'hôtel Transit, à Edmonton-Nord, et le couvent des Filles de Jésus, à Morinville. On n'a qu'à se donner la peine d'examiner les "bleus" pour le découvrir. Éventuellement, il acheta un moulin à scie, installé près du lac la Nonne où vivait Georges Bugnet, et y aménagea sa famille. C'est là que le père Falher, o.m.i., administrateur du vicariat de Grouard, lui rendit visite et le convainquit de déménager sa famille au Royaume de la Paix, afin de fournir le bois de construction nécessaire aux colons canadiens-français qui s'y amenaient à tous les jours.
Monsieur Maisonneuve installa son moulin sur le bord du ruisseau au Jargeau. L'endroit était idéal. Son engin à vapeur aurait toute l'eau dont il avait besoin. Mais plus que ça, il avait compris l'importance du geste qu'il posait, en achetant le terrain en face du lieu désormais historique où les premiers colons — les pionniers, comme on les appelait — avaient planté une croix, en présence des pères Giroux et Falher, en 1912.
Après l'installation du moulin, on bâtit rarement des shacks en bois rond ou en billots équarris. On allait plutôt acheter des madriers et de la planche chez monsieur Maisonneuve. Il était d'arrangement, selon l'expression courante, passant du du bois à crédit à ceux qui ne pouvaient pas payer en espèces; en retour, il exigeait qu'on travaille sans gages jusqu'à ce que la dette soit liquidée. C'est ainsi que presque tous les célibataires finirent par travailler au moulin avant de se marier. Il s'en développa un esprit-de-corps remarquable, et qui s'affermit, même après la fondation de la société des Jarrets noirs du Royaume de la Paix.
Ajoutons que malgré la bonne volonté de monsieur Maisonneuve, plusieurs nouveaux arrivants obtinrent du bois à crédit sans jamais payer celui qui devait mourir prématurément en 1940. Ces dettes ont depuis longtemps été oubliées. Cependant, mon beau-frère, Louis-Philippe Moquin, et moi-même, lui serons toujours reconnaissants, pour l'insigne honneur d'avoir épousé, l'un et l'autre, deux de ses quatre filles.
[Voir l'image pleine grandeur]

L'arrivée du chemin de fer
La colonisation en masse du Royaume de la Paix exigeait, comme prémisse, la construction d'une voie ferrée. Mais où passerait-elle? se demandait-on. Le terrain était beaucoup plus propice, au nord du Petit lac des Escalves, sans compter que le train desservirait la mission et le poste de Grouard. Au sud du lac, on rencontrait des marécages en séries, mais on économisait sur la distance et le temps.
Évidemment, il y a plus que cela à notre histoire. Alors que l'eau claire du Petit lac des Esclaves aurait bien servi la cause des engins à vapeur de la compagnie ferroviaire, on voulait s'assurer qu'il en serait de même pour l'eau du lac Rond qui donnait sur les abords de la plaine.
D'Edmonton, on envoya quelqu'un recueillir des bouteilles d'eau du lac Rond. Le bonhomme, non averti, se fit entraîner dans une beuverie avant de prélever ses échantillons. Tout froissé, il reprit son chemin et ce n'est qu'une fois rendu à Kinuso qu'il s'aperçut de son oubli. Sans se troubler la conscience, il puisa à même le Petit lac des Esclaves. L'eau fut examinée et jugée potable. On choisit alors la route du sud.
C'est donc ainsi qu'on en vint à délaisser Grouard au profit d'un nouveau village qu'on bâtirait près du lac Rond. On l'appellerait McLennan, ce qui ferait beaucoup plus chic; il servirait de point divisionnaire d'où monterait une ligne plus au nord, vers la rivière la Paix, tandis que l'autre continuerait franc ouest, vers Spirit River, traversant en plein centre la plaine du Royaume de la Paix.
En fin de compte, l'eau du lac Rond, infecte et saline, ne mit qu'un an à ronger les boyaux des locomotives. On fit enquête. On découvrit le jeu de l'imposteur. Et Grouard prit sa revanche : c'est l'eau du Petit lac des Esclaves qui alimente le centre divisionnaire depuis.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le voyage du père Falher
On parle de voyages de plaisir, et de voyages d'affaires, mais ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler du genre de voyage que fit le bon père Falher, en l'an du Seigneur 1917.
Né en Bretagne, sept ans avant la Guerre franco-allemande, Constant Falher fut recruté par Mgr Clut, o.m.i., pour servir dans les missions du vicariat Mackenzie-Athabasca. Lorsqu'il arriva à la mission Saint-Bernard, il fut tout de suite remarqué pour son habilité administrative : Mgr Grouard le prit à ses côtés, comme administrateur du nouveau vicariat apostolique portant son nom. C'est à ce titre qu'il partit pour Edmonton, un certain soir de juin 1917.
Tout était réglé d'avance. La colonie Saint-Jean-Baptiste — nommée ainsi en l'honneur des pères Giroux et Falher qui avaient accompagné les pionniers en 1912 — avait grossi au point où Mgr Grouard croyait qu'il fallait en faire une paroisse. Mais, comme toujours, dans des cas semblables, on devait tenir compte de certains facteurs. Parce qu'il existait déjà une paroisse Saint-Jean-Baptiste, à fort McMurray, on décida d'appeler la nouvelle paroisse : Sainte-Anne de Falher. Les villages naissants se regroupaient autour des deux gares installées le long du chemin de fer Edmonton, Dunvegan & British Columbia Railway, construit en 1915, plutôt qu'autour du moulin à scie Maisonneuve ou de la mission, tous deux écartés du tracé de la voie ferrée. Malheureusement, les responsables de la société ferroviaire, ne se souciant guère de donner des noms français à ces gares, les avaient appelées Donnelly et Fowler. On pourrait sans doute faire changer ces noms pour des noms français, tels Falher et Girouxville, si l'on se donnait la peine de frapper aux bonnes portes . . .
C'est justement ce que fit le père Falher. Il rendit visite au représentant des Postes, au Secrétariat provincial, à la société ferroviaire, etc. Tout le monde se mit d'accord. On ne savait rien lui refuser, d'autant plus qu'il avait parfaitement raison. On aurait dû le consulter bien avant ... Le père Falher revint au Royaume de la Paix, à bord du train, tout fier de ce qu'il venait d'accomplir. Et qui ne l'aurait pas été? Après tout, son nom allait passer à la postérité.
Le train s'arrêta, comme il le devait, à la petite gare rouge-marron de Donnelly. Il y avait foule. Le père Falher descendit du wagon, serra la main des notables et s'empressa d'annoncer d'une voix forte :
- Ici, ce sera désormais Falher...
Quelqu'un rétorqua que le village s'appelait déjà Donnelly et qu'il garderait son nom, tout irlandais qu'il était! Autant le père Falher n'avait pas eu recours au procédé démocratique, jusque-là, autant il fut rebiffé par une telle réponse. Remontant à bord, il demanda au conducteur du train de le déposer à mi-chemin entre Donnelly et Fowler. Lorsqu'il redescendit, tout fin seul, dans un immense marais, sans foule récalcitrante, il proclama de sa même voix puissante :
- Eh bien, c'est ici que sera Falher!
Les changements ne tardèrent pas à se produire. Il fit venir l'abbé Joseph-Albéric Ouellette, un bâtisseur d'églises, comme curé remplaçant le bon père Dréau qui repartit vers une autre mission. Il érigea la nouvelle paroisse en rognant les frontières des paroisses à venir, et l'ancienne gare de Fowler, dont le nom trop semblable à Falher portait à confusion, fut appelée Dréau. On établit un autre village, trois milles plus à l'ouest, que l'on nomma Girouxville en l'honneur du missionnaire-colonisateur; on ne pouvait évidemment pas démolir le premier élévateur à grain bâti à Donnelly, mais on déménagea sa salle d'immigration à Falher. La rumeur circula que la chapelle de Donnelly y serait déménagée elle aussi, ou du moins que son bois servirait à la construction de la pro-cathédrale de Falher. C'en fut trop. Quelqu'un fit brûler la chapelle. Un mois plus tard, le 22 novembre 1922, Mgr Grouard signa le décret d'érection canonique de la paroisse Sacré-Cœur de Donnelly.
En vérité, c'était tout un voyage qu'avait entrepris le bon père Falher, en l'an du Seigneur 1917.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le rite d'initiation
Ce n'était pas tous un chacun qui pouvait devenir membre de la société secrète des Jarrets noirs du Royaume de la Paix. Il faut bien l'avouer, c'était une société d'hommes. On peut se dire de telles vérités, maintenant, sans crainte de choquer l'autre moitié de la population, puisque ladite société est tombée en désuétude depuis déjà cinquante ans. De nos jours, on l'appellerait un "club". Ça ferait plus anglais. Les Jarrets noirs prenaient leur nom des Beaucerons que les Québécois avaient ainsi baptisés, voilà belle lurette, après le passage d'un feu de prairie.
Comme il était loin ce vieux Québec qu'on avait quitté depuis cinq ou six ans pour se joindre à d'autres colons venus s'établir en terre albertaine. Personne ne se plaignait de la bonne terre noire qui rapportait du cent minots d'avoine à l'acre. Mais c'est l'éloignement du monde "civilisé" qui, à la longue, ébranlait même les plus durs. Car la distance qui séparait le Royaume de la Paix, au nord-ouest de l'Alberta, de la vieille province de Québec, ressemblait à celle qui sépare Bruxelles de Moscou. Même une fois rendus sur place, les colons ressentaient encore un certain éloigneraient de leurs voisins qui s'installaient rarement plus loin d'un demi-mille, l'un de l'autre. Pire encore que l'éloignement, c'est la solitude qui rongeait les cœurs et les esprits, car presque tous les hommes, au début, étaient encore célibataires. À cette absence de femmes dans un pays nouveau venaient s'ajouter des présences incongrues : nuées de moustiques, eau de slough, chaleur écrasante et jours sans fin, l'été; tempêtes de neige, froid sec et noirceur interminable, l'hiver. Cela n'avait rien pour encourager les moins hardis à tenir le coup. Il fallait, de toute évidence, que les colons découvrent un stratagème pour contrer le mal du pays.
C'est de ce besoin que surgit l'idée de fonder la société des Jarrets noirs. Ce fut d'abord Adrien Royer, maître d'école, intelligent et plein d'esprit, qui formula les premières plans. Il s'adjoignit le notaire Louis-Philippe Dansereau, homme cultivé et d'une élocution parfaite. On s'était toujours demandé comment il se faisait qu'il n'était pas en politique. Il assumerait le rôle de secrétaire. Enfin, il fallait un trésorier; on eut recours à Édouard Trottier, agent des terres.
Mais avant d'aller trop loin, les fondateurs obtinrent l'assentiment préalable de la mère Marie-Anne Gravel, gérante de la salle d'immigration. Première femme blanche venue au pays, elle avait plein de gros bon sens. Plus fondamental encore, la salle d'immigration était le seul édifice, sauf la chapelle, assez grand pour accommoder un rassemblement quelconque. On ne prit comme modèle ni la confrérie des Chevaliers de Colomb, beaucoup trop irlando-américaine, encore moins celle des Francs-maçons, beaucoup trop anti-catholique. Il fallait tenter d'insuffler un peu de mystère dans un tel organisme, tout en préservant une grande simplicité qui concordait avec les mœurs des gens. Malgré cela, on n'hésita pas à se donner des titres prestigieux, ronflants même : grand chef exalté, scribe à l'encre noire, boursier magnifique, grand huissier de la verge noire, et deux gardes du corps; et on décida de n'accorder qu'une seule décoration : l'ordre vénérable de la jarretière noire.
Après s'être partagé les postes clé, autour d'une bouteille de la meilleure bagosse du pays, les fondateurs élaborèrent le rite d'initiation dans le plus grand secret. On dressa une liste des candidats : une quinzaine si l'on ne tient pas compte des cadres. Tout candidat était admis s'il était célibataire. Et s'il subissait le rite d'initiation, on acceptait aussi les "veufs à l'herbe", comme on appelait les personnes séparées. Puis on convoqua les candidats à la première initiation du genre qui n'eut jamais lieu dans ce lointain pays : salle d'immigration, onze heures du soir, la veille de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin). Chacun devait se rendre seul dans l'antichambre arrière où l'attendaient deux gardes du corps.
On avait d'ailleurs choisi ces gardes non pas tant pour leur acuité d'esprit que pour leur corpulence et leur force physique. Cérémonieusement, ils empoignèrent les candidats un à un, dès leur arrivée, et les lancèrent pêle-mêle dans la soute à charbon. Ainsi, tous furent contraints de se noircir les "jarrets" avant même le début officiel de la cérémonie. Une fois les quinze candidats réunis, le grand huissier fut mandé au sous-sol par un des gardes. Vêtu d'une ample mante écarlate et muni d'une verge de bois d'ébène, qu'il supportait à la cave où la seule lumière provenait de chandelles tenues par les deux gardes. Tirant une grosse clef de son gousset, il ouvrit la porte de la prison de fortune où gémissaient les malheureux détenus et les invita à le suivre en silence jusque dans la salle du grand conseil, au deuxième étage. Quelle procession que celle-là! Quinze bonshommes de taille inégale, tous noircis de charbon et penauds, précédés de l'huissier et encadrés des gardes, se suivant à la queue-leu-leu dans les couloirs et les escaliers assombris.
Quoique pénible pour les plus borgnes, l'ascension jusqu'au deuxième se fit sans trop d'accrocs au décorum. Arrivés dans la salle du grand conseil, les candidats cherchèrent à s'orienter à qui mieux mieux pendant que le grand huissier les fit s'aligner le long d'un gros câble tiré à travers la pièce, et qui avait pour but de délimiter une espèce d'avant-cour. Au centre-fond, on apercevait une table recouverte d'une nappe noire sur laquelle vacillaient deux autres chandelles enfilées dans des goulots de bouteilles. Derrière la table, trois personnages en grande tenue, jaune, noire et bleue, siégeaient, imperturbables.
Le grand huissier s'avança en silence, déposa avec précaution la verge noire sur la table et recueillit un document en échange. Puis, après avoir salué de la tête chacun des trois personnages principaux, il se retira du côté droit et se mit à lire d'une voix grave et bien articulée le nom de chaque candidat qui répondit aussitôt "présent".
- Désirez-vous devenir membre de la société des Jarrets noirs du Royaume de la Paix? leur demanda-t-il.
Tous répondirent "oui" comme s'il s'agissait d'une question du petit catéchisme.
- Promettez-vous de respecter les lois, les usages et les secrets de ladite société?
À nouveau un "oui" unanime retentit.
- Très bien, ajouta-t-il, agenouillez-vous en signe d'obéissance et de vénération devant votre grand chef exalté.
Tous exécutèrent tant bien que mal ce qu'on leur avait commandé, d'aucuns pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le foyer paternel.
Alors, seulement, le grand chef exalté, vêtu de sa toge noire et de son bonnet de castor, se leva de son siège, salua respectueusement ses deux associés, s'avança majestueusement vers le centre de la salle du grand conseil et regarda d'un œil sévère, un à un, les quinze candidats comme s'ils étaient des condamnés à mort. Il leur rappela, en un langage fort châtié, leurs devoirs patriotiques et leurs responsabilités de nouveaux colons dans ce pays neuf, de même que leur obligation de s'y accrocher et, surtout, de bien travailler leurs terrains.
- Mais, ajouta-t-il, vous ne sauriez tenir le coup sans le soutien moral de tous vos amis ici présents.
Suivit ensuite une longue pose qui permit aux candidats de saisir la profonde sagesse dans l'admonition du grand chef exalté.
- Promettez-vous de vous rassembler souvent et d'étancher votre soif en commun plutôt que de boire seuls, dans vos shacks respectifs?
"Oui" s'empressa-t-on de répondre sur un ton qui trahissait déjà une soif ardente.
- Comme vous ne sauriez résister à la tentation de retourner dans votre pays d'origine à moins d'occuper votre temps de loisir, promettez-vous de vous jouer des tours mutuellement ainsi qu'aux autres colons de la région?
À nouveau un "oui" unanime fusa de la bouche des quinze candidats prosternés.
- Préparez-vous donc à devenir membres en règle de la société des Jarrets noirs du Royaume de la Paix, dit enfin le grand chef exalté qui, s'avançant lentement vers la table, recueillit révérencieusement la verge noire.
Plaçant celle-ci tour à tour sur l'épaule droite de chaque candidat, il prononça une formule incompréhensible — j'ai ouï dire que c'était du par-cœur grec — sur un ton encore plus péremptoire qu'auparavant. Puis, après avoir redéposé la verge noire sur la table, il revint au centre et invita tous ses frères à laisser tomber le câble qui les avait retenus jusque-là et à partager l'amitié qui leur était réservée au sein de l'auguste société.
On alluma des fanaux. On sortit une cruche. Le grand huissier et les deux gardes versèrent un verre de bagosse à tout le monde. La grande salle du conseil, si mystérieuse et tranquille jusque-là, devint un centre bourdonnant d'activité et de conversation qui ne cessa de s'animer qu'aux petites heures du matin. Alors, chacun regagna son chez-soi, plus déterminé que jamais à mettre en exécution les promesses formulées par le grand chef exalté et auxquelles il avait consenti sans la moindre contrainte.
Le pays s'ouvrait. Il fallait tout bâtir. Pourquoi ne pas le faire avec un peu d'humour et de jovialité?
[Voir l'image pleine grandeur]

La bagosse de Rodolphe Demers
Une fois la cérémonie d'initiation terminée, on devait s'assurer d'un approvisionnement constant de bonne bagosse pour les besoins de la cause. Il fallait surtout prévenir pour qu'on ne se mette pas à boire de l'alcool frelaté. Les peu instruits ne s'étaient jamais départis de l'habitude d'appeler la bagosse par son nom anglais : moonshine, c'est-à-dire clair de lune; ce qui, à mon avis, dotait le produit fini d'une nomenclature beaucoup trop romantique.
La bagosse était distillée à partir de grains de blé ou de pommes de terre, dont un préparait un moût auquel on ajoutait un peu de levure. L'alcoolisation prenait environ un mois et une bonne dose de patience. On devait surtout se méfier des gendarmes qui recherchaient les bagossiers parce qu'ils évitaient de payer la taxe.
On disait de Rodolphe Demers qu'il était ni chair ni poisson, ce qui ne recouvrait qu'une partie de la réalité. À vrai dire, bien que fluet, il mesurait cinq pieds et six pouces. L'été comme l'hiver, il chaussait des mocassins indiens dont se dégageait une odeur de cuir de chevreuil pas tellement désagréable, et lui donnaient une drôle de démarche. Frugal dans ses vêtements comme dans sa nourriture, il n'en déployait pas moins une tête hirsute et une barbe luxuriante qui commençait déjà à grisonner. Sa conversation, surtout, trahissait son état d'esprit : s'il ouvrait la bouche — ce qu'il faisait rarement — il émettait un marmottement rauque, quasi incompréhensible, entremêlé de tous les jurons imaginables. Mais il fabriquait la meilleure bagosse au monde...
Or c'est justement à Rodolphe Demers que le grand chef exalté avait confié la mission très importante de fournir de la bagosse aux membres de la société. Pas un seul d'entre eux n'avait mis en doute la sagesse du grand chef. Quant aux autres colons, d'aucuns se doutaient bien qu'il se passait quelque chose de peu habituel chez Demers car on ne le voyait plus se promener au large. Depuis qu'il avait mis sa cuvée en marche, il restait aux aguets dans son shack et n'en sortait que pour rentrer du bois de chauffage. C'était surtout ça qui éveillait des soupçons durant les grandes chaleurs d'été. Heureusement, le shack de Demers était installé sur de larges poutres, en retrait de la route, de sorte que les passants, si rares soient-ils, ne réussissaient pas à renifler les mystérieuses émanations qui s'en échappaient. Pourtant, le secret bien gardé de Rodolphe Demers était à la veille d'être découvert par nul autre que le bon curé de la paroisse.
Récemment arrivé du Manitoba, l'abbé Maximilien Legros avait convenu avec les marguilliers d'entreprendre sans tarder sa première visite de paroisse. Issu d'une famille de costauds, il mesurait plus de six pieds et pesait bien deux cents livres. Son nom lui allait bien. Doué d'une vivacité d'esprit rare en ce pays, il se déplaçait lentement mais sûrement, sur ses deux grands pieds qui sortaient tout droits de sa courte mais ample soutane, sans le soutien moral d'une paire de pantalons. Accompagné du syndic Léonard Saint-Jean, qui se gonflait un peu trop de son importance, l'abbé Legros s'approcha du shack de Demers sans être vu et sans se douter de l'existence du précieux élixir qu'il recelait.
L'arrivée impromptue du curé, qu'il ne connaissait pas, surprit Demers. Croyant qu'il s'agissait d'un agent fédéral et qu'il avait été victime d'un espion, il ne lui vint qu'une seule chose à l'esprit : se débarrasser de l'évidence. Rodolphe n'hésita pas une seconde et, hic et nunc, renversa la cuvée de bagosse sur le plancher de bois embouffeté, au moment même où le curé entrouvrait la porte sur ses pentures grinçantes et s'apprêtait à y déposer un de ses larges souliers vernis.
Du coup le mystère s'éclaircit. Demers, tout confus et furieux, reconnut son erreur, marmottant et jurant plus qu'à l'accoutumée. Le curé, tout aussi confus, se retira du cadre de la porte, secouant de sa soutane les éclaboussures de bagosse qui auraient pu susciter des calomnies. Enfin, plus confus encore que les deux autres, le syndic Saint-Jean se mit à s'apitoyer sur son sort, ne cessant de se proclamer victime des circonstances. On aurait cru, ma foi, que c'était lui qui avait le plus souffert; c'était son visage qui était le plus rouge; c'était sa dignité qui avait été le plus bafouée.
Tous avaient intérêt à oublier cet incident de sitôt. Le curé fit nettoyer sa soutane et convint avec le syndic de ne jamais plus en reparler. Demers lava aussitôt son plancher avec une lessive plus forte que d'habitude; il était gagnant, à la fin, car il fut débarrassé de moustiques pour le restant de l'été. Quant au grand chef exalté, il décida à partir de cet instant, de ne confier ses missions secrètes qu'à des personnes entièrement fiables. C'est lui, dorénavant, qui s'occuperait de fournir la bagosse aux membres de sa vénérable société.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le shack d'Odilon Proulx
Avant de s'aventurer vers le Royaume de la Paix, Odilon Proulx avait séjourné quelques années à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, où il s'était endurci à la vie. Il avait dû perdre sa mère très jeune à en juger par la nervosité de son caractère. Mais quelle femme ce dut être!
De taille moyenne, Odilon ne savait pas vraiment comment marcher. Été comme hiver, il ne portait que des espadrilles à hausses, et trottinait partout où il allait à pieds. Sans être musclée à outrance, la partie supérieure de son corps était gonflée au point de peser le double de la partie inférieure. Malgré tout, elle débordait rarement au-dessus du cordeau qui lui servait de ceinture. Et, bien qu'il ressemblait à un homme-singe, il nageait comme un poisson. Mais il avait un de ces tics nerveux... Pas surprenant qu'on l'appelait : Proulx le grimaceux.
Dès son arrivée au pays, peu après la Grande Guerre, il avait inscrit son nom dans le registre du bureau des terres, pour un quart de section situé deux milles à l'est de celui de Philippe Moquin. Quiconque a connu Odilon Proulx ne saurait s'imaginer ce que c'était que de vivre dans ce nouveau pays sans un tel personnage. Il n'aurait guère fait mal à personne, même si des méchantes langues ont raconté qu'il avait, une fois, emprunté la musique à bouche de quelqu'un et qu'il l'avait fait jouer avec le vent de ses narines. Évidemment, on ne savait rien lui refuser, et tous ses voisins s'étaient empressés, selon la coutume, de lui aider à bâtir son shack sur un carré de douze pieds sur seize pieds, avec trois fenêtres et une porte en planches. Le bois de construction lui avait été fourni à crédit par le père Philias Maisonneuve; en échange, il avait convenu de travailler sans gages, au moulin à scie de ce dernier, jusqu'à ce que sa dette soit payée.
Odilon Proulx était un des quinze nouveaux initiés de la société des Jarrets noirs. Autant il aimait jouer des tours aux autres, autant il devenait une bonne cible en retour. Mais comme il était très nerveux, on avait préféré s'en prendre à son shack plutôt qu'à sa personne.
Tout nerveux qu'il était, cela ne l'empêchait pas de dormir profondément après une "brosse" à la bagosse. Un bon jour, comme il dormait encore sur l'heure du midi, deux amis venus lui rendre visite, Philippe Moquin et Jean Létourneau, s'apprêtèrent à remonter son shack au moyen de madriers-leviers et de bûches de seize pouces. Proulx ronflait toujours lorsque, tout à coup, ses visiteurs laissèrent choir le shack avec grand fracas. Vêtu d'un sous-vêtement Stanfield d'une seule pièce, qui, entre nous, n'était pas des plus nets et cachait mal plusieurs cernes jaunes et noirs — on ne saurait par modestie en décrire l'odeur — Proulx ouvrit la porte et bondit dans la cour en criant à tous les saints du ciel, croyant à un tremblement de terre. Moquin et Létourneau, cachés dans les broussailles non loin, se tordaient de rire et furent vite découverts par le malheureux Proulx. Remis de sa peur, mais non pas moins nerveux, ce dernier invita ses visiteurs à rester à souper. On n'a jamais su, en fin de compte, ce qu'ils avaient partagé comme nourriture et ce n'est que plusieurs années après que Moquin et Létourneau ont osé avouer qu'ils furent pris tous les deux, en pleine nuit, d'une de ces diarrhées...
Quelques jours plus tard, Proulx se vantait, au moulin à scie, d'avoir un saloir plein de lard, chez lui. Moquin décida de battre le fer pendant qu'il était chaud. Accompagné, cette fois, de Cyrille Lafortune, il retourna au shack de Proulx, après s'être assuré de l'heure où celui-ci cesserait son travail pour la journée. Pénétrant dans le shack, Moquin et Lafortune aperçurent au fond, près du poêle, un "jar" de grès contenant une seule couène de lard baignant dans une saumure putride. Découvrant une vieille chaussette de laine, sale et malodorante, sous le brancard du lit de bois, Moquin la leva du bout des doigts et la déposa dans le saloir avant d'en refermer le couvercle. Pendant ce temps, Lafortune s'affaira à clouer la porte du shack à son cadre, depuis l'intérieur. Et les deux intrus, sortant par une fenêtre, allèrent se cacher dans les broussailles déjà connues de Moquin.
Lorsque Proulx arriva, une demi-heure plus tard, il ne se doutait de rien, à en juger par la qualité de son sifflement et la légèreté de son pas. S'avançant tout droit vers la porte, il fut des plus surpris de voir qu'elle ne s'était pas ouverte du premier coup. Après deux ou trois grimaces et quelques petits jurons il essaya une deuxième fois. Même refus de la porte récalcitrante. Il débita alors une de ces litanies qui contenait plus de saints qu'on en retrouve dans l'ordo, puis, s'armant d'un billot en guise de bélier, enfonça la porte de planches d'un tel élan qu'il alla chuter lui-même au fond de la pièce. Un court examen des débris lui révéla qu'il s'agissait encore d'un mauvais tour. Même si tout lui semblait à l'ordre — on ignore toujours ce qu'il advint du contenu de son saloir — un tas de questions lui vinrent à l'esprit : Comment avait-on fait pour clouer la porte depuis l'intérieur? Qui avait pu lui faire ce coup pendable? Quand? Pourquoi?
Avant même qu'il ait eu le temps de se retrousser et de réparer sa porte, une dame d'une certaine réputation s'amena en buggy. Reconnaissant tout de suite madame Fauvette, à l'élégance de son manteau et à la grosseur de la plume sur son chapeau de paille, il en profita pour se décharger le cœur. Quels ingrats! Que leur avait-il fait? Qui? Quand? Comment? Pourquoi? Tant de questions qui fusaient au beau milieu de grimaces incontrôlables.
- Des clous de six pouces, madame, le croiriez-vous?
Au moment où madame Fauvette allait descendre de sa voiture, Moquin et Lafortune, fous de rire, sortirent de leur cachette. La visiteuse se rassit aussitôt, s'empressant de poser quelques petits gestes de modestie qu'on ne pouvait ignorer, puis, reprenant les guides, éconduisit son cheval au trot, hors de la cour. Moquin et Lafortune répondirent franchement à toutes les questions que leur posa le grimaceux qui, cette fois, ne réussit pas à les convaincre de rester à souper. Mais pendant de nombreuses années Moquin et Lafortune se sont demandé ce qu'il aurait bien pu arriver s'ils avaient montré un peu plus de patience et de curiosité intellectuelle à la suite de la visite de madame Fauvette.
[Voir l'image pleine grandeur]

La veillée au corps du gros Lussier
D'ordinaire, on est sérieux lorsqu'on parle d'une veillée au corps. Même s'il n'existe aucun lien de parenté entre soi et le défunt, ou qu'on ne le connaisse point du tout, il reste toujours, au fond du cœur, un certain sens de respect sacré. On n'intellectualise pas la mort d'un autre; on la souffre, sachant bien qu'un jour ce sera son tour.
Elzéar Lussier était un de ces colosses qu'on craint et qu'on évite instinctivement même, à cause de sa charpente. Il avait participé à l'initiation des Jarrets noirs, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, à titre de garde du corps. Ce rôle lui allait à merveille puisqu'il avait servi comme volontaire dans le vingt-deuxième bataillon, et s'était même distingué à la bataille de Courcelette sans pour autant devenir gradé. On disait de lui qu'il avait une belle carrure et qu'il se tenait droit comme un piquet. C'était un peu exagéré; il aurait fallu dire "comme un poteau" depuis qu'il avait pris de l'embonpoint.
Un jour, vers la fin de l'après-midi, un groupe de sociétaires avides de tenir leurs promesses d'initiation, se rendit au shack du gros Lussier. Celui-ci s'était installé loin de tout le monde, sur la branche nord du ruisseau au Jargeau, près du lac des Rats. On avait toujours cru qu'il avait préféré l'éloignement à cause de sa gêne, mais le gros Lussier élevait des animaux, et les abords du lac lui fournissaient tout le bois dont il avait besoin, sans qu'il ait à le cultiver. Il faut dire aussi qu'il était friand de canard et aimait à piéger les rats musqués qui abondaient dans le lac, pour leur fourrure. Cette trinité de raisons nous force à avouer que le gros Lussier était plus intelligent que ne laissait paraître ses relations personnelles avec les autres colons.
Venus à pieds depuis le moulin à scie Maisonneuve, environ six ou sept milles au sud-ouest, les visiteurs avaient emporté deux cruches de bagosse sur un genre de carcan que chacun, tant bien que mal, s'était évertué à porter à tour de rôle. Ils n'avaient pu s'empêcher d'entamer l'une d'elles, chemin faisant, et se sentaient déjà en pleine forme au terme de leur voyage. Le gros Lussier, habitué à vivre seul, ne cacha pas sa joie à la vue du cortège hétéroclite. Il invita tout le monde à s'asseoir autour de la table de bois et sortit des grosses tasses grises qu'il distribua à chacun : Charles-Henri Frémont, un grand sec, originaire de Baie-Saint-Paul et ancien conscrit; Louis-Philippe Moquin, plus rondelet, maquignon d'occasion et ténor à la voix d'or; Donat Beaudoin, faiseur de broue et ancien conscrit; Joseph Dansereau, maître-chantre, expert en billards et ancien conscrit; Adélard, son frère cadet, un ardent Bourassiste; Raoul Moquin, frère aîné de Philippe, poète à ses heures et ancien combattant; et, enfin, Odilon Proulx, surnommé le grimaceux. Tous célibataires, ils formaient ce qu'on daignait appeler "la crème du pays".
Contrairement à ses visiteurs, et bien qu'il eût passé quatre années à l'armée, le gros Lussier n'avait jamais pris l'habitude de boire. Le soir de l'initiation il avait consenti, à titre de garde du corps, à verser de la bagosse aux nouveaux initiés parce que cela faisait partie de la cérémonie. Cette après-midi, à titre d'hôte, il ne pouvait tout de même pas décevoir ses visiteurs. Aussi accepta-t-il gracieusement de boire avec eux une première tasse de bagosse. C'eût été tellement plus chic dans des verres, mais on ne retrouvait ceux-ci que dans les ménages établis, à la salle d'immigration et au presbytère.
Le premier coup descendit assez docilement; il fut suivi d'un deuxième, puis de plusieurs autres . . . On ne vit pas l'après-midi passer, ni la soirée . . . On oublia de manger et la bagosse en profita pour gruger les esprits . . . Naturellement, c'est le gros Lussier qui fut le plus durement touché. Vers onze heures du soir il faisait à peine gris au dehors; à l'intérieur du shack, tous les invités étaient parfaitement grisés. Quant à l'hôte, il s'était saoulé sans s'en apercevoir. Cela dénote à la fois la suavité et la qualité de la bagosse.
Les sociétaires réussirent à allonger le gros Lussier de tout son long sur le plancher de bois, ce qui n'était pas facile vu sa grosseur et son poids, puis, après avoir fouillé partout, on découvrit une boîte complète de chandelles jaunes. On en entoura le corps du gros Lussier et on les alluma comme on fait lorsqu'un mort est exposé dans le salon d'une maison beaucoup plus raffinée. Et, sans coup férir, les chanteurs entonnèrent le Dies irae et le Libéra qu'ils connaissaient tous par cœur depuis leur jeunesse. Le son de ce dernier cantique, surtout, a de quoi arracher des sanglots au pire des scélérats . . . C'est sans doute pour cela qu'il réussit à pénétrer le corps du gros Lussier, dans son subconscient d'abord, puis, à la fin, dans son esprit embrumé.
Quando caeli movendi sunt et terra :
Dum veneris judicare saeculum per ignem...
Le "mort" remua un bras, puis un pied; on dut reculer les chandelles de peur qu'elles ne mettent le feu au parquet.
Tremens jactus sum ego et tirneo,
dum discussio venerit, atque ventura ira...
Enfin, Lussier ouvrit les yeux, en crevasses au début, puis tout grands, comme ceux d'un hibou effaré. Les visiteurs, tout en chantant, s'étaient agenouillés près de la dépouille, trois de chaque côté. On aurait dit que les soubresauts du gros Cloutier les aidaient à se dégriser et les incitaient à exercer un peu plus de décorum.
D'un bond Lussier s'assit tout droit, croyant sans doute qu'il s'était retrouvé au purgatoire avec ses amis. Il se mit à se tâter le visage, les épaules, les jambes même. Et c'est là qu'il commença à douter, car il s'aperçut qu'il était en pieds de bas, alors qu'il se souvenait vaguement d'être chaussé de bottines de travail au moment de perdre l'esprit.
On ne saura jamais combien longtemps ce drame aurait duré car ce furent les chanteurs, les premiers, qui décrochèrent, cédant à la tentation de se rafraîchir le goulot. Le gros Lussier dut admettre, avec le temps, qu'il était bien vivant, car il en était sûr, on ne buvait pas de bagosse au purgatoire. Il éteignit une à une les chandelles à ses côtés. Puis, malgré un mal de tête qui le poussait à vouloir s'arracher les cheveux, il se leva d'un seul coup et chancelant, se mit à empoigner ses visiteurs, l'un après l'autre, un peu comme il l'avait fait lors de l'initiation, et à les "foutre" au dehors de son shack.
On n'a jamais su s'il lui advint, par la suite, d'avoir des cauchemars, mais on sait pertinemment que les sept sociétaires en question se sont toujours tenus loin du gros Lussier à partir de ce jour.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le coup de gin du notaire Dansereau
Tout le monde sait que les notaires n'ont pas l'habitude de boire. Après tout, ils commandent un certain respect dans la société et leurs clients verraient d'un mauvais œil qu'ils se replient sur l'alcool pour se défouler de la jérémiade de confidences auxquelles ils sont assujettis. Mais, comme ils sont humains, ils ont bien le droit d'avoir soif.
Justement, le notaire Dansereau, récemment arrivé de l'Est, avait soif pour du gros gin. Il n'avait pas pris l'habitude de boire, comprenez bien, quoiqu'il refusait rarement un verre de bagosse qui lui était offert. Tout acte de générosité en méritait un en retour, se disait-il avec une certaine sagesse. Mais c'était le De Kuyper, denrée beaucoup plus rare en ce lointain pays, qu'il préférait.
Au cours de l'après-midi d'un jour de l'an, le grand chef exalté avait convoqué une réunion extraordinaire dans la salle du grand conseil, au deuxième étage de la salle d'immigration. On y avait initié une demi-douzaine de nouveaux arrivés; et le notaire y avait participé à titre de scribe à l'encre noire. Né à Saint-Esprit dans le comté de Montcalm, il avait terminé ses études au Collège de l'Assomption avant de s'établir à Saint-Jacques. De taille moyenne, il avait appris très jeune à se tenir droit; c'était meilleur pour la santé et ça aidait à mieux chanter. Homme cultivé et bien élevé, il parlait toujours correctement, s'habillait correctement, et se conduisait correctement envers tout le monde. Personne, sauf son épouse, savait pourquoi il était venu passer un an "en pénitence" dans le Royaume de la Paix.
Après la cérémonie, le grand huissier et les gardes du corps s'apprêtaient à verser de la bagosse lorsque Philippe Moquin sortit une bouteille de John De Kuyper qu'il mit bien en évidence avant de la faire circuler — un peu trop librement aux yeux du notaire. La bouteille fit le tour, chacun commentant à sa manière l'effet tonifiant du gros gin. Pour une raison ou une autre, elle échappa au notaire au moment même où ç'aurait dû être son tour. Mais il fallait être raisonnable; après tout, ce n'était pas sa bouteille, et puis, de telles choses arrivent.
La conversation continua comme de plus belle; on avait tant de choses à se raconter. On écrivait peu à la parenté dans l'Est et les nouveaux arrivés débordaient de nouvelles. Tout à coup, comme par magie, la bouteille apparut à nouveau près du notaire. Il la voyait clairement chaque fois qu'elle passait d'une main à l'autre... Tout le monde devait savoir combien il avait soif... Elle ne lui échapperait pas cette fois.
Pourtant la fameuse bouteille disparut au moment où il aurait cru que son voisin allait la lui passer. Il n'y avait rien de pire pour donner soif aux plus vertueux des notaires... Nouvelle ronde de conversation; on parla de chevaux : des petits, des gros, des noirs, des rouges, des chevaux de trait, des ambleurs, des pur sang, des charognes, des juments, des étalons, des poulains d'un an, des pouliches de l'année. . . la bouteille de gin réapparut ... on parla de bêtes à cornes : de bœufs, de vaches à lait, de grosses, de petites, de brunes, de cailles, de Jersey, de Short Horns, de croupes, de pis...
- Je me sens très mal à l'aise d'interrompre notre conversation, mon cher monsieur, de s'excuser le notaire avec le plus grand calme extérieur qui ait jamais dissimulé un début d'affolement, mais auriez-vous des objections à ce que je partage à mon tour le contenu de la bouteille?... J'ai presque honte de l'avouer publiquement mais on m'a bel et bien oublié les deux premières rondes...
C'était le signal. Moquin se présenta devant lui comme par enchantement, avec la bouteille de De Kuyper et une profusion d'excuses qui aurait gêné le plus osé des filous. D'un œil averti, le notaire vit qu'il ne restait plus que deux doigts du précieux liquide. Il s'empressa d'accepter la bouteille avant qu'un quidam la lui ravisse à nouveau; puis, saluant Moquin à la manière des vieux habitués, en la levant dans la direction de son bienfaiteur — geste de pardon autant que d'amitié — il la vida d'un seul trait.
Ce n'est qu'en abaissant la bouteille que le notaire réalisa que le De Kuyper était de l'eau claire. Il s'était fait avoir. Tous, sauf le grand chef exalté, étaient impliqués. Et c'est sans doute pour cette raison que le notaire, gentleman jusqu'au bout des doigts, eut beaucoup de mal à oublier ce tour de la part de tant d'amis qui savaient très bien que les notaires n'ont pas l'habitude de boire.
[Voir l'image pleine grandeur]

La noce d'Édouard Frémont
Édouard Frémont n'avait jamais fait partie des Jarrets noirs. Non qu'il était anti-social, remarquez bien, mais il avait du métal bien à lui. Grand, mince, intelligent, autoritaire et bon travaillant, il préférait la lecture aux réunions mondaines. Pas surprenant, à la fin, qu'il ait choisi de faire alliance avec une infirmière belge : Amélie Van der Meer. Et comme elle demeurait encore chez ses parents, à Kinuso, sur le bord du Petit lac des Esclaves, c'est là que serait béni leur mariage par nul autre que le bon vieux père Giroux, le 3 février 1927.
Ce missionnaire était devenu légendaire dans le Royaume de la Paix, où il œuvrait depuis 1897. Tout le monde le connaissait. Voici, d'ailleurs, comment un biographe, l'abbé, J.-B.-A. Allaire, l'a décrit, au temps où moi-même je venais de le rencontrer à l'occasion d'un pique-nique d'enfants de chœur, à la rivière des Cœurs. À mon avis, on n'aurait pu mieux le décrire :
Plutôt court, les épaules carrées, la figure jeune sous une chevelure grisonnante, clairsemée; des joues pleines, rougeaudes; une démarche rapide, trottinante; vif de manière et d'esprit; portant mal un habit taillé pour un autre, boutonné de travers, aux goussets soulevés, remplis comme un fond de magasin, avec de ci de là des taches depuis le collet jusqu'aux bottines qui ont passé l'âge de rendre des services appréciables.
On comprend plus facilement pourquoi une demi-douzaine d'amis de Frémont se soient invités à la noce. Malgré un froid de moins 50 degrés, un cortège de quatre automobiles — une Ford, modèle A, une Chevrolet, un Essex et un Buick — servant d'escorte au fiancé, quitta la paroisse du Sacré-Cœur, la veille, dans l'après-midi, pour arriver à Grouard en pleine noirceur, à dix-huit heures. On soupa à la vieille mission, avant d'entreprendre la traversée du lac, sur la glace. On parla de route à suivre. Les chauffeurs de trois voitures insistaient : il fallait prendre la route directe, à travers le lac, plutôt que de le contourner. Ce serait beaucoup plus vite, et puis, on pouvait se guider l'un l'autre au moyen des phares.
La quatrième voiture, conduite par Pitou Tremblay, contenait le fiancé. Elle s'esquiva la première, à l'insu des autres, par la route qui longeait le lac du côté sud, et arriva au bout d'heure à bon port. Les trois autres voitures mirent près de quatre heures à traverser le lac. L'extrême froid avait fait boucler les glaces; parfois une voiture devait s'élancer à toute allure sur un genre de rampe avant de tomber dans le vide et d'atterrir au hasard des brisures; parfois on rencontrait un véritable mur ou un grand trou béant qu'il fallait évidemment contourner. Ce n'est qu'à minuit que les trois voitures arrivèrent à Kinuso, presque à bout d'essence.
À onze heures, le lendemain, tous se retrouvèrent à l'église Saint-Henri. Le couple était resplendissant, et le fiancé pensait à toute autre chose qu'au tour qu'on avait voulu lui jouer la veille. Mais quelle ne fut pas la surprise de tous de trouver, à titre de maître de cérémonie et de placier, le capitaine Thomas-Louis Thibault, crieur à la porte de l'église de Donnelly. Il était venu à son propre compte, semble-t-il, et détournait la conversation chaque fois qu'on le questionnait à ce sujet.
Le père Giroux reçut les vœux des nouveaux époux et célébra la messe à leurs intentions. La noce suivit. Monsieur Van der Meer savait comment faire les choses pour l'avoir appris en Europe. Il versa lui-même le Champagne; on proposa un toast; on prit un coup; on mangea; on se mit à chanter; quelqu'un sortit un violon et on se mit à danser des rigodons.
Eh oui! Vous l'avez sans doute deviné. Le capitaine Thibault avait à nouveau assumé le rôle de maître de cérémonie. Il se mit à "caller" moitié en anglais, moitié en français, à tort et à travers, à temps et à contretemps, à son grand plaisir et à la déconvenue de tous les co-paroissiens. Grand, dur, cheveux noirs et droits, visage osseux, ayant passé sa jeunesse à bord d'une goélette sur le bas Saint-Laurent, il parlait d'une forte voix accompagnée de gestes angulaires. On ne comprenait pas toujours ce qu'il disait à cause d'un accent particulier qu'il affectait et qui ne ressemblait aux parlers d'aucune région du Québec. Il s'était lui-même donné cet accent, je crois, et je ne serais pas surpris d'apprendre, un jour, qu'il fut le héros de l'histoire du bonhomme qui demanda à un conducteur de train :
- On peut-y rentrer en chiant (un chien) dans l'tran (le train)?
Le soir, après le départ des nouveaux époux, les gens de Donnelly décidèrent de rentrer immédiatement, malgré l'heure tardive et l'extrême froid. On suggéra au capitaine Thibault de prendre la route du milieu du lac, puis, après s'être assurés qu'il était bel et bien parti, chacun revint par la route du bord du lac.
On ne revit Thibault qu'une semaine plus tard. D'aucuns se préparaient à s'apitoyer sur son sort et à regretter le tour qu'on lui avait joué lorsque, de sa voix forte coutumière, il se mit à raconter comment il avait été invité, à le dernière minute, à servir de maître de cérémonie pour un mariage à Joussard, puis à nouveau à Grouard trois jours plus tard... Tout le monde se dépêchait à se marier avant le carême...
À partir de ce jour, personne n'osa plus tenter de prendre le vieux renard au piège, de peur de s'y retrouver lui-même.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les déboires d'Hubert Gagnon
Depuis Noël, Hubert Gagnon enviait son voisin, Jean-Noël Desjardins, qui avait reçu en cadeau une montre de poche, dont le boîtier artistiquement décoré semblait être fabriqué d'argent solide. Par malheur, la montre ne tenait pas le temps, sauf lorsqu'on ouvrait son couvercle pour la faire admirer. On aurait dit qu'elle se ménageait pendant les heures creuses pour être plus radieuse aux heures de pointe. Pourtant, elle ne s'était jamais donné la peine de le laisser savoir à l'illustre voisin de Desjardins.
Hubert Gagnon avait souffert de sa convoitise tout au long du carême. Au matin de Pâques, il n'en pouvait plus. Comme tout le monde, il se rendit à la grand-messe paroissiale où il entendit Desjardins chanter le Vidi Aquam et le Victimae Paschali Laudes. Après la cérémonie religieuse, les annonces du capitaine Thibault retinrent son attention sur le perron de l'église, et, quand il voulut voir Desjardins, ce dernier était disparu. Ce n'est que plus tard, dans l'après-midi, que Gagnon accueillit Desjardins venu à son shack, en buggy.
Desjardins reçut son voisin avec sa courtoisie habituelle, malgré une méfiance innée à son égard et un très fort désir de s'en moquer. Hubert Gagnon alla droit au but : Desjardins avait une montre qui lui plaisait et il la lui échangerait volontiers contre la sienne, une Waltham.
Celle-ci n'avait coûté que trois dollars mais elle avait la qualité d'être à l'heure. Desjardins refusa net. Sous aucun prétexte, allait-il se départir de sa montre en argent. Puis, connaissant tous les trucs de la pêche, pour les avoir pratiqués dans la rivière du Moulin, près de Chicoutimi, il se laissa tenter un peu. Se ravisant soudain, il refusa à nouveau. Enfin, à la suite d'une plaidoirie digne d'un chef berbère — et guère plus compréhensible — Desjardins mordit à l'hameçon et céda sa montre déréglée à Hubert Gagnon contre la Waltham. Heureux comme un prince, Gagnon repartit en direction de son shack.
Peu après, Laurent Savoie venant à s'arrêter chez Desjardins, eut vent de l'incident. Incité à se rendre chez son voisin et à s'enquérir innocemment de l'heure, au cours d'une conversation, Savoie joua le jeu. Lorsque Gagnon, encore tout fier de sa nouvelle acquisition, sortit sa montre, son interlocuteur lui fit remarquer laconiquement qu'elle ne marchait pas. Gagnon se montra incrédule, mais après maints essais couronnés du même insuccès, il dut admettre qu'il s'était fait avoir.
Savoie n'eut pas à le convaincre qu'il ne devait pas, en conscience, laisser surir l'affaire. Sur le champ, Hubert se rendit chez Desjardins, l'accusa vertement de l'avoir volé en réclamant sa Waltham. Il remit la montre détraquée à Desjardins, tourna sur ses talons et lui claqua la porte au nez. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui n'avait aucun respect de la propriété d'autrui... Desjardins laissa faire, sachant bien qu'il finirait par l'avoir à son tour.
Entre temps, il en profita pour affiler une centaine de pieux d'épinette rouge, graisser les roues de sa voiture de travail et de son buggy, et limer les sabots de ses deux chevaux de trait : Jenny et La Soie. Un jour, en indiquant les limites du clos à vaches qu'il avait l'intention de clôturer, il aperçut un porc-épic et l'assomma d'un violent coup de bâton. Desjardins, qui connaissait la valeur ethnologique de tels rongeurs, ne le tua que pour protéger son bétail et son chien. Ce n'est guère amusant d'entendre gémir un chien, le museau rempli de longs piquants, et encore moins de les arracher, un à un, au moyen d'une pince. Comme c'était le premier animal du genre qu'il rencontrait sur sa terre, il sortit son couteau de chasse et coupa une des grosses pattes d'avant de l'animal.
Le lendemain matin, Desjardins fit son "train" et s'empressa de dire à son voisin qu'il avait tué un ours aux confins de sa terre : pour preuve, il lui montra la patte du porc-épic. Il n'en fallait pas plus pour aiguiser la curiosité et l'instinct chasseur de Gagnon qui se fit inviter pour accompagner Desjardins. Comme ce dernier avait prévu de faire sa clôture cette journée-là — ses piquets étaient chargés et son attelage l'attendait — et qu'il n'avait pas de temps à prendre, Gagnon se prêta volontiers à masser en terre, un à un, chacun des cent pieux de clôture.
Arrivés au bout du terrain, les deux hommes avaient parcouru tout le trajet pour se rendre au gîte de l'ours. Il ne restait qu'à repérer ce damné animal. Où donc était-il passé? "Tout près d'ici" souffla Desjardins avec le sentiment qu'il jouait le rôle du serpent au paradis. S'avançant avec précaution, Gagnon découvrit l'animal recherché gisant au pied d'un grand sapin. "Taurieu d'Desjardins, s'écria-t-il avec trépignement, tu t'é fait aouère, va... Tu sé même pas la différence entre un ours pi un portipi..."
Affichant la plus sincère des innocences, Desjardins revint chez lui, dépité de son ignorance crasse mais jubilant à la vue de sa nouvelle clôture. Quant à Gagnon, il était tellement heureux d'avoir pu en montrer à son voisin qu'il ne lui vint jamais à l'esprit que c'était lui, en fin de compte, qui s'était fait avoir.
[Voir l'image pleine grandeur]

La cayousse de Wilfrid Duguay
Wilfrid Duguay avait passé quelques années dans une ville de Massachussetts avant de s'adjoindre à un groupe de colons récupérés par le bon vieux père Jean-Baptiste Giroux, o.m.i., missionnaire-colonisateur du vicariat de Grouard. Il était originaire de Montréal, je crois, à en juger par ses goûts plus raffinés, tant dans les vêtements que dans la nourriture. Il avait surtout appris très jeune à déceler une quelconque présence féminine partout où il se trouvait, et nous aurait sans doute légué une excellente histoire des femmes du Royaume de la Paix s'il avait eu le moindre talent comme historien. Ce n'était pas tant leur biographie qui l'intéressait que leurs attraits physiques. Beau garçon, bien mis, courtois, poli, gentil même, il savait toujours quoi faire pour plaire à une dame, peu importe son âge, son état ou son statut social. Chez lui, ce sentiment était inné. Il lui fallait néanmoins rechercher la compagnie d'une dame au moins une fois par semaine; il y réussissait remarquablement bien si l'on tient compte de leur pénurie dans ce pays neuf, au début de la colonie.
Un certain dimanche d'automne, alors qu'il travaillait encore au moulin à scie Maisonneuve, il avait emprunté, sans donner d'explications, la cayousse cendrée de Philippe Moquin. Ce dernier connaissait bien Duguay, ils œuvraient ensemble depuis déjà deux ans. C'est à lui que monsieur Maisonneuve avait confié la responsabilité d'opérer la machine à vapeur qui alimentait le moulin à scie en énergie. Bon travaillant, il était aussi des plus fiables, et, après tout, personne n'avait à lui servir de conscience. Duguay partit à cheval, peu après dîner, le midi, s'excusant auprès de la maîtresse de maison de ne pouvoir l'aider à essuyer la vaisselle, comme il en avait pris l'habitude, les dimanches. Madame Maisonneuve lui avait souhaité innocemment de passer un bel après-midi, et c'est justement ce qu'il comptait faire.
Après avoir traversé bois et guérets, Wilfrid Duguay arriva enfin à la maison de Fred Furlotte, située trois milles à l'ouest du moulin. Très peu de personnes avaient compris pourquoi Furlotte avait choisi de bâtir sa maison, finie en V-joint, au beau milieu d'une série de sloughs et de touffes de saules, au lieu de l'avoir placée un peu plus au sud, sur une belle butte entourée de bouleaux. L'été, les grandes chaleurs desséchaient les marais, mais les nuées de moustiques ne disparaissaient qu'à la fin d'août; l'hiver, on pouvait passer partout, après les grosses gelées, mais Furlotte croyait fermement que les grands froids éloigneraient les compétiteurs; mais c'est le printemps et l'automne, pendant la crue et à la suite des longues pluies, que ce terrain marécageux devenait impraticable. Et Furlotte y avait bâti sa maison pour longtemps.
Duguay préféra attacher la cendrée de Moquin à une touffe de saules sise à une centaine de mètres au sud de la maison, et de s'y rendre à pieds. Il y fut accueilli à bras ouverts par l'épouse du propriétaire absent, qui, d'ailleurs, avait la réputation de tromper son mari. Vers quatre heures, afin de ne pas éveiller les soupçons d'une population honnête et sans reproche, il quitta sa bien-aimée pour retourner au moulin à scie. Dès qu'il fut en selle, il vit arriver du côté sud le meilleur coursier de la région, monté par Jos Forcier, vétérinaire de la région. Duguay n'avait pas besoin d'explications ni d'ordres de personne pour savoir ce qu'il avait à faire. Il se cacha le visage, tant bien que mal, et partit au galop vers l'ouest, c'est-à-dire dans la direction opposée au moulin à scie. Il venait de réaliser qu'il avait passé l'après-midi dans une des talles du vétérinaire, mais il ne lui vint jamais à l'esprit que ce même monsieur connaissait par cœur tous les chevaux de la région. Jos Forcier enfila derrière Duguay qui commença à zigzaguer, qui revint sur ses pas, et retourna, toujours au galop, entre deux touffes de saules, puis entre deux autres, et enfin, jusqu'au ruisseau qu'il sauta d'un bond avant de disparaître de vue. Jos Forcier abandonna la course; il avait d'autres chats à fouetter et n'avait pas l'intention de se présenter tout haletant devant madame Furlotte.
Le soir, avant de se coucher, Moquin se rendit à l'écurie, comme d'habitude, afin d'y vérifier son cheval. Il trouva celui-ci bien attaché dans son port, mais couvert de broue, et l'étria de pied en cap avant de le mettre au clos pour la nuit. De retour à la bunk house, voyant que Wilfrid Duguay était déjà endormi, il décida d'attendre au lendemain pour lui poser des questions au sujet de sa cendrée.
Au déjeuner, Moquin n'osa pas en parler à table de peur d'embarrasser son compagnon de travail devant les autres. Mais quelle ne fut pas sa surprise, quelques instants plus tard, dans la cour du moulin, d'être accosté par le vétérinaire! Il était partout ce bonhomme-là! Le vétérinaire désirait savoir ce qu'il était allé faire, la veille, chez Fred Furlotte. Moquin n'eut aucune difficulté à prouver qu'il avait passé l'après-midi du dimanche à jouer aux cartes avec ses compagnons. Quant à Wilfrid Duguay, il quitta le moulin sans donner d'explications, encore une fois. Et ce n'est que dix ans plus tard, lorsqu'il revint brièvement en visite, qu'il avoua à Moquin qu'il avait eu un rendez-vous avec madame Furlotte, dans la belle ville de Los Angeles.
[Voir l'image pleine grandeur]

La chasse à Tours
Nous savons d'instinct que l'homme est né chasseur : il en va de sa survivance. Adélard Dansereau, frère cadet du notaire, né à Montréal en 1899, avait appris cette réalité fondamentale à l'école d'Henri Bourassa. J'écris cela comme s'il s'agissait d'un fait. C'est plutôt une opinion; mais ayant bien connu cet ardent Bourassiste, j'ai l'impression de ne pas me tromper. Ce n'est pas tant l'art de vivre que la logique qu'il avait appris de l'ardent défenseur des droits des Canadiens français.
Venu au Royaume de la Paix avec deux frères aînés, Maurice et Joseph, il s'était inscrit pour un homestead au coin sud-ouest du quart de section de Louis-Philippe Moquin. Mais peu enclin, et pas du tout habitué aux gros travaux de la ferme, Adélard préférait lire Le Devoir, la nuit, afin de se tenir au courant de la guerre et surtout, de la conscription. Âgé d'à peine dix-sept ans, il aimait chanter, comme tous les membres de sa famille; d'ailleurs, il était doué d'une voix forte et juste. Invité par Moquin à vivre avec lui jusqu'à ce qu'il construise son propre shack, Adélard prenait un malin plaisir à chanter la messe du sixième ton, avec son hôte; les deux firent "sauter" le shack plus d'une fois. Je ne voudrais pas pour tout l'or au monde insinuer qu'Adélard n'était pas travaillant. Disons plutôt qu'il n'avait pas encore trouvé soulier à son pied. Cela viendra plus tard.
Un bon jour, Philippe l'invita à aller à la chasse avec lui. Il avait repéré les traces d'un ours dans sa cour de ferme et sur ses bâtiments, et opina qu'il préférerait admirer sa belle peau noire sous son lit, en forme de tapis, plutôt que lui fournir l'occasion de s'attaquer à ses animaux. Mais alors que Philippe ne possédait qu'un seul fusil de chasse et désirait s'en servir lui-même, Adélard, lui, avait une hache neuve à deux tranchants, affilée par nul autre que son hôte et bienfaiteur.
Le jour désigné, ils mirent tout l'avant-midi à se préparer à la chasse. Cela demandait une certaine bravoure et il était logique de s'assurer, au départ, que tout était à point. On chanta "J'aime le son du cor", du premier au dernier couplet, à deux reprises, s'imaginant la grande chasse, les chevaux dressés, la meute de chiens, les redingotes rouges, les hauts-de-forme... On dégusta un coup de bagosse comme si l'on eut siroté du sherry, à l'anglaise... On discuta même de tactique, à coup de "batêche", mais sans trop s'y attarder; il ne fallait surtout pas prêter de mauvaises intentions à l'ennemi . . .
Peu après le repas du midi, ils s'armèrent, l'un avec son fusil et son couteau de chasse, l'autre avec sa hache à deux tranchants, et partirent, cahin-caha, à la recherche de l'animal sauvage. C'était facile... on n'avait qu'à suivre ses traces...
Nos deux chasseurs marchèrent ainsi pendant une quinzaine de minutes, s'enfonçant dans une forêt de petits trembles qui grossissaient à chaque pas. Tout à coup le sentier s'élargit en une petite clairière. Leur courage s'en affermit, car tout chasseur qui vaut son sel sait bien que les ours ont l'habitude de se cacher derrière les arbres pour guetter les hommes qui s'aventurent à leurs trousses. Les chasseurs en profitèrent pour se reposer, rafistoler ou fourbir leurs armes au besoin, prendre un dernier coup de bagosse et vaincre une fois pour toutes les dernières résistances. La survivance de l'homme a de ces impératifs...
Après deux ou trois bons grands respires ils se levèrent et repartirent vers le grand inconnu, doucereux, clopin-clopan, se donnant une derrière tape mutuelle dans le dos. Qui sait? peut-être pour ne jamais en revenir... Mais sitôt qu'ils furent à plein dans le fourré, à leur grande joie, ils aperçurent deux oursons noirs qui les regardaient, l'un à côté de l'autre, debout sur leur arrière-train, la tête haute et le museau au vent. "Alors, c'est à une ourse que nous avons affaire..." pensèrent instinctivement les deux braves sans mot dire. L'un et l'autre s'imaginaient déjà chacun propriétaire d'un beau tapis en peau d'ourson. Ce serait beaucoup mieux comme ç... aaaaahhhhh!!!!.... de mugir l'ourse derrière les chasseurs qui, se voyant pris en étau, détallèrent de chaque côté, à la recherche du plus haut et du plus gros arbre du monde...
Ce n'est qu'une fois revenus au shack, tout essoufflés et encore tremblants, qu'ils prirent conscience de ce qui venait d'arriver. Ni l'un ni l'autre avait manqué de bravoure, évidemment... Leur geste tenait de l'inexpérience et de rien d'autre...
Et puis, après tout, n'était-ce pas naturel pour l'homme de chercher à survivre?... Pourtant, ç'aurait été tellement plus chaud sur le plancher, l'hiver prochain... sans parler des visiteurs qui auraient été grandement édifiés...
À la décharge des chasseurs, il faut admettre que c'était leur première chasse à l'ours. Ce fut aussi leur dernière, à ce que je sache; et ils survécurent à de bien pires expériences encore car peu après, l'un et l'autre convolèrent en justes noces.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le charivari de Georges Dufour
Né à Sainte-Anne-des-Ponts avant le tournant du siècle, Georges Dufour, cinquième de douze enfants, avait accompagné ses parents jusqu'à Rhode Island, en 1909. C'est là qu'il fut recruté par le bon père Giroux, en 1913, avec son frère Tarcisius. Le reste de la famille suivrait deux ans plus tard.
Georges prit comme homestead le quart de section au nord-est de celui du vieux Télesphore Leblanc. Le temps venu, on se rassembla pour lui bâtir un shack, comme on avait fait pour les autres colons. Puis, en 1917, il fut appelé sous les armes comme les autres jeunes de la région. À leur retour, tel que promis, tous les conscrits se cotisèrent pour acheter une statue de saint Jean-Baptiste — grandeur nature — qu'ils offrirent à la paroisse. Pendant de nombreuses années, jusqu'au feu de 1963, on pouvait facilement l'identifier puisqu'elle portait une plaque en laiton avec l'inscription suivante :
DON DE GEORGES DUFOUR 1919
Trois ans après la guerre, Georges retourna à Sainte-Anne-des-Ponts où il épousa une amie d'enfance. La nouvelle se répandit et, quoiqu'il n'avait jamais fait partie de l'auguste société des Jarrets noirs, les membres décidèrent de l'honorer d'un charivari à son retour de l'Est.
Le soir de son arrivée, il se fit conduire en buggy jusque sur sa terre. Peu préoccupé par les mondanités, il s'affaira à installer sa nouvelle épouse dans son petit coin de paradis, sans se rendre compte des nombreux visiteurs cachés tant bien que mal, ça et là, aux alentours de sa cour. Ces derniers n'étaient pas du tout pressés; ils avaient tout le temps. Chacun, d'ailleurs, était muni de son propre flacon de bagosse et y pigeait volontiers.
Après un certain temps, Odilon Proulx se mit à jouer de la musique à bouche; Oscar Chagnon sortit son violon; Philippe Moquin et les frères Dansereau enchaînèrent avec des chants en partie. C'était bien beau mais ce n'était pas du charivari. On fit alors sonner des grelots; quelqu'un découvrit un tonneau et s'en servit comme d'un tambour... Tous ces glinsglins et ces boum-badi-boum n'eurent pas l'heur de plaire au nouvel époux qui, comme ses frères, n'était pas des plus sociables. Sortant de chez lui en brandissant le poing, Georges sauta à cheval en criant à qui voulait l'entendre qu'il s'en allait chercher un fusil chez son père.
Il n'en fallait pas autant pour que les tapageurs mettent fin au charivari. Avant de déguerpir cependant, l'un d'eux affixa sur la porte une petite plaque de laiton sur laquelle il avait fait graver ces mots :
DON À GEORGES DUFOUR 1922
De retour chez lui avec son arme, Georges eut honte de son emportement et se le fit pardonner par son épouse. Disons, en terminant, qu'il n'a jamais compris le véritable motif derrière le geste des anciens conscrits, membres de la société des Jarrets noirs du Royaume de la Paix.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le meulon de paille d'Eugène Gravel
On dirait que certaines personnes ont le don de tout faire tourner autour d'elles. Pas tant par égocentrisme que par voie conséquente de leadership. On n'y peut rien. Ils sont des meneurs-nés.
Eugène Gravel était un de ces hommes. Pas le seul de la région, sans manque, car on y retrouvait aussi des Philias Maisonneuve, des Joseph Fillion, des Édouard Frémont, des Antoine Tremblay... Veuf à son arrivée au pays, Gravel avait épousé Marie-Anne Leblanc, fille de Télesphore, veuve elle aussi. Avec elle, il avait accepté de gérer la salle d'immigration qui servait d'hôtel, au besoin, pour les moins fortunés et les sans-abris. Homme nerveux et fort, au large front découvert, c'est lui qui, au début de la colonie, avait assuré le transport bimensuel du courrier depuis Grouard, avant l'arrivée du chemin de fer. Il mettait une journée à marcher, ou plutôt à trottiner, les quarante milles qui séparaient la colonie de la vieille mission, et revenait le lendemain, beau temps, mauvais temps, sourire aux lèvres.
Vivant en communauté de biens avec son épouse, il cultivait son homestead non loin du moulin à scie. Ayant été victime des farces de Moquin à quelques reprises, il décida de lui rendre la monnaie de sa pièce en lui vendant pour dix dollars, un meulon de paille neuve qu'il venait de vendre au gros Poulin pour le même prix.
Contrairement à Moquin qui était vif, espiègle même, Philippe Poulin était lent et bonasse. Fort comme deux, il n'aurait pas fait mal à une mouche et se souciait peu de se défaire de leur présence, l'été, même lorsqu'elles formaient une nuée. L'hiver, son "raque" à foin renversé près d'un meulon de paille, et muni d'une grosse toile grise, lui servait d'abri, à lui et à ses chevaux. Il était comme ça : endurci, vivant de jour en jour, se souciant peu du lendemain. Il n'avait pas grand-chose, mais ce qui était sien, était sien, et il était bien capable de le défendre.
Pourtant, il y avait aussi un autre côté à son caractère. On ne savait rien de ses origines mais tout le monde le considérait comme un bon gars. Monsieur Maisonneuve lui montrait beaucoup d'affection et de respect à souper, sachant combien cela plaisait à tout célibataire. Poulin épiçait sa conversation de nombreux "menon, menon" et de "toro d'toro". Après le repas, il ne manquait jamais de remercier ses hôtes à sa manière en leur chantant :
Marci beaucoup
Monsieur Maisonneuve
Pi Madame Maisonneuve
De votre 'xcellent repas
Et des plats y'en avait gros
Mais d'la viande y'en avait guère
Il n'y avait rien que des os
Qui nous sabottent les mâchouères
Il n'y avait rien que des os
Qu'ébréchaient tous nos couteaux
Au sortire de la tab'e
Y se sont mis pour danser
Y' sautaient d'un plancher à l'autr'
Y'z étaient à la légère
Y n'avaient pas déjeuné
Encore ben moins d'quoi bouére
Y n'avaient pas déjeuné
Encore ben moins soupé
Quelle ne fut pas sa surprise, une froide journée de novembre, de trouver Moquin en train de recueillir le meulon de paille que lui, Poulin, venait d'acheter d'Eugène Gravel. Il n'avait certes pas froid aux yeux, mais n'avait pas, non plus, l'intention de se battre avec Moquin, beaucoup plus petit de taille, dans le seul but de récupérer son bien. Ce dernier saisit aussitôt l'astuce et proposa à Poulin de régler l'affaire en cour.
À l'insu de Poulin, Moquin fit convoquer le conseil suprême de la société des Jarrets noirs et lui soumit son plan. Éventuellement le "juge" instruisit la cause "Poulin versus Moquin". Les deux furent convoqués à la salle d'immigration qui servirait de salle de tribunal pour la circonstance. Et il parut tout naturel, le jour venu, d'y retrouver aussi tous ses amis.
Les deux avocats s'en donnèrent à cœur joie dans des diatribes à n'en plus finir, appelant tous un chacun comme témoins, tantôt en faveur du demandeur, tantôt en faveur de l'intimé. Le juge se prêta volontiers à cette passe d'armes, citant les uns pour outrage du tribunal et les autres pour refus de témoigner. À n'en pas douter ce fut le procès le plus farfelu jamais tenu hors des voies légales.
À la fin, Poulin et Moquin reçurent chacun, à titre de dédommagement, la moitié du fameux meulon de paille qui appartenait déjà à l'un et à l'autre en entier. Curieusement, l'instigateur de la farce, Eugène Gravel, ne fut jamais appelé à comparaître à la barre des témoins. La cour décida, néanmoins, qu'il devait garder les vingt dollars reçus, en guise de remboursement pour l'usage de la salle. Puis, en présence de tous les membres de la société secrète des Jarrets noirs du Royaume de la Paix, c'est à lui que le grand chef exalté, assisté du scribe à l'encre noire, du boursier magnifique, du grand huissier de la verge noire et des deux gardes du corps, octroya pour la première et la seule fois, l'ordre vénérable de la jarretière noire.
Ce fut aussi le dernier rassemblement de cette insigne société. Elle avait atteint son but. Peu après, elle cessa d'exister.
Glossaire
Bagosse : vin de blé ou de pommes de terre
Buggy : petit cabriolet découvert tiré par un ou deux chevaux
Bunk house : logement pour les hommes à gages, séparé de la maison familiale
Caller : de l'anglais : to call; directions aux danseurs
Cayousse : adaptation de l'Indien; petit cheval
Homestead : ferme du premier colon au nom duquel elle fut inscrite dans le registre du bureau des terres
raque : francisation de rack; voiture à ridelles employée pour charroyer le foin, la paille, les gerbes de grain, etc.
shack : maison temporaire de colon, bâtie en bois rond ou en plane lies, sans division interne
slough : marais, terrain marécageux
Région de Rivière-de-la-Paix
[Voir l'image pleine grandeur]

Publications des Éditions des Plaines
- Pour l'enfant que j'ai fait
Maria Chaput-Arbez - Manie Tobie : femme du Manitoba
René Juéry - Histoire de la nation métisse dans l'Ouest canadien
Auguste-Henri de Trémaudan - Poésies religieuses et politiques
Louis "David" Riel - De ta sœur, Sara Riel
Mary Jordan - Le petit dinosaure d'Alberta
Nadine MacKenzie - Les va-nu-pieds
Madeleine Laroche - Le rideau se lève au Manitoba
Annette Saint-Pierre - Un voyageur des pays d'En-Haut
Georges Dugas - Le livre des marges
Roger Léveillé - Changements de tons
Alexandre-L. Amprimoz - La petite jument blanche
Yvonne et Roger Lagassé - Une bagarre très politique
Rosemarie Bissonnette - Les manigances d'une bru
Roger Légal et Paul Ruest - Les Deux frères
Gilles Valais - Un sourire dans la tempête
Maurice Constantin-Weyer - La fille bègue
Annette Saint-Pierre - Maurice Constantin-Weyer
Roger Motut - Les trois pommes d'or
Yvonne Lagassé - Le premier rodéo
Nadine MacKenzie - Maurice Dufault, sous-directeur
Marguerite-A. Primeau - Pièces en un acte
Castelein de la Lande - Pensées
Claude Blanchette - La Métisse
Jean Féron - Manito et Jéronimo
Maurice Deniset-Bernier - Tezzero
Geneviève Montcombroux - Extraits
Roger Léveillé - La forêt
Georges Bugnet - Mots d'hier, mots d'aujourd'hui
Liliane Rodriguez - Les Franco-Canadiens dans L'Ouest
Grant MacEwan - Louis, fils des Prairies
Noëlie Palud-Pelletier - Riel
Charles Bayer & E. Parage - Sauvage-Sauvageon
Marguerite-A. Primeau - Georges Bugnet
Jean Papen - Le coupeur de têtes
Nadine MacKenzie - Vie et souvenirs d'un prêtre-soldat
Marcel Dacquay - La Ménagerie
Jocelyne Villeneuve
Distribué par les Éditions des Plaines
L'espace de Louis Goulet
Guillaume Charrette
(Éditions Bois-Brûlés)
Biographie de l'auteur
[Voir l'image pleine grandeur]

Jean Pariseau a vécu en Alberta où il a fait des études primaires et classiques avant de s'enrôler dans l'Aviation royale du Canada. Après la guerre, le major Pariseau entra au Service historique du Ministère de la Défense nationale. Son étude remarquable, Forces armées et maintien de l'ordre au Canada 1867-1967 : un siècle d'aide au pouvoir civil, sera publiée aux Presses de l'Université d'Ottawa.
Dans Les contes de mon patelin, l'historien nous apporte un écho albertain franc, sain et rafraîchissant dans la grisaille des jours; un écho qui donne le goût de fouiller dans ses souvenirs.
Crédits
Les Éditions des Plaines remercient chaleureusement le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts du Manitoba pour l'appui financier apporté à la publication de cet ouvrage.
Maquette de la couverture
Ron Sloan
Illustrations
Vincent Delmas
Composition typographique et mise en page
Sanford Evans Communications Limited, Winnipeg (Manitoba)
La reproduction d'un extrait quelconque de cette édition, notamment par photocopie ou par microfilm, est interdite sans l'autorisation écrite des Éditions des Plaines inc.
Directeurs : Georges Damphousse et Annette Saint-Pierre
Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale d'Ottawa 4e trimestre 1985
Jean Pariseau
Les contes de mon patelins
[Voir l'image pleine grandeur]

Les Éditions des Plaines
C.P. 123
Saint-Boniface, Manitoba
R2H 3B4
Achevé d'imprimer en décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq par Hignell Printing Limited, Winnipeg