
par Louis Favreau
centre de Formation Populaire
On peut se procurer les publications du CFP au :
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 300 Montréal Québec H2R 2W3 Téléphone : (514) 842-2548, poste 223, (France Clavette) Télécopieur : (514) 842-1417 Courrier électronique : info@lecfp.qc.ca
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés
INTRODUCTION : Le socialisme, un projet pour les travailleurs ?
4. La première Internationale (1864-1876)
5. La deuxième Internationale (1889-1914)
6. La révolution d'octobre (1917)
7. La naissance des partis communistes et la troisième Internationale (1919-1943)
8. La quatrième Internationale (1938-...) et le courant trotskiste
9. La révolution chinoise (1949)
10. Les révolutions cubaine (1959) et vietnamienne (1975)
12. Le projet socialiste dans le mouvement ouvrier québécois
ANNEXE 1 : LE SOCIALISME DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER (1800-1979)
D'où vient le projet socialiste ? Où et comment a-t-il surgi? Quels sont les mouvements et les organisations qui l'ont fait progresser ? Quels sont les différents courants qui se réfèrent au socialisme ? Qu'en est-il aujourd'hui du projet socialiste ?
En somme, comment et en quoi le socialisme est-il un projet de société pour les travailleurs ?
Ce dossier veut introduire les militants syndicaux et populaires au socialisme à partir de l'histoire du socialisme dans le mouvement ouvrier international.
D'où vient le projet socialiste ? Quels sont les événements importants qui l'ont marqué? Quels sont les mouvements et les organisations qui l'ont fait progresser? Quels sont les différents courants qui se réfèrent au socialisme ? Qu'en est-il aujourd'hui du projet socialiste ? Quels sont les problèmes que pose au mouvement ouvrier l'expérience des « socialismes existants » ? En somme, en quoi le socialisme est-il un projet de société valable pour les travailleurs ?
Voilà autant de questions que se pose tout militant qui, après avoir pris conscience du fait que la société capitaliste repose sur l'exploitation, voit dans le socialisme une solution possible aux problèmes des travailleurs. Ces questions sont fort complexes et ont fait l'objet d'une abondante littérature qui n'est pas toujours facile d'accès.
Ce texte se veut une introduction au projet socialiste,
À une approche dogmatique qui part d'un ensemble de principes pour décrire abstraitement un projet de société idéal ou pour fournir un modèle précis à imiter, nous avons préféré une approche historique qui cherche d'abord à décrire un ensemble d'événements, de mouvements sociaux et de révolutions pour ensuite tenter d'en dégager la signification politique.
Étant donné les objectifs de ce texte, chaque aspect abordé le sera nécessairement de façon sommaire. Les militants désireux d'approfondir certaines questions pourront consulter les ouvrages suggérés dans la bibliographie commentée qui se trouve à la fin.
C'est en Europe, au début du XIXe siècle (1800-1840), que prend forme un premier projet socialiste chez des écrivains et « militants » tels que Saint-Simon et Fourier en France et Owen en Angleterre. Au coeur de ce projet s'articule la revendication de l'égalité, non seulement des droits politiques, mais aussi de la situation sociale pour les différents groupes de la société. Cette revendication n'apparaît pas par hasard : elle vient au moment même où l'industrialisation capitaliste est en plein essor, industrialisation qui a pour effet de provoquer la misère et la pauvreté de larges secteurs de la population (en forçant l'immigration des paysans vers la ville, en imposant une nouvelle organisation du travail...).
Les auteurs socialistes de cette période, période où le projet socialiste avancé pourrait être qualifié d'utopique, partent tous d'un constat commun : la société capitaliste est un type de société qu'il faut rejeter parce qu'il est contraire aux intérêts de la très grande majorité de la population. Cependant, ces auteurs demeurent à bien des égards idéalistes, particulièrement sur les stratégies et les moyens de lutte pour contrer le capitalisme. Saint-Simon misera beaucoup sur les hommes de science pour diriger la société, Owen expérimentera les coopératives et projettera ce mode de gestion économique à l'ensemble de la société tandis que Fourier préconisera la constitution de petites communautés de base (appelées "phalanstères").
En réalité, le socialisme, à cette époque, véhicule un idéal de fraternité et d'égalité qui demeure — et c'est en cela qu'il est utopique — trop détaché des conditions concrètes dans lesquelles il pourrait s'épanouir. C'est plus tard, avec Marx et au moment de la création de l'Association internationale des travailleurs (la 1re Internationale fondée en 1864), que le syndicalisme et l'organisation de la classe ouvrière en force politique autonome, seront identifiés comme moyens privilégiés de lutte contre le capitalisme sur la base d'une analyse plus systématique des rouages de l'économie.
Parallèlement à ces socialistes préoccupés des questions sociales de façon quelque peu idéaliste, différents groupes politiques (tels les disciples de Blanqui) véhiculent des idées selon lesquelles la transformation radicale de la société peut se faire par des minorités éclairées organisées en société secrètes. La lutte pour le pouvoir participe donc dans leur cas d'une conception très élitiste de la lutte contre le système en place, conception dans laquelle la grande masse du peuple n'a d'autre rôle que celui de force d'appoint.
Il faudra attendre la fin des années '40 (1847-1850) avant d'observer des changements significatifs dans le pensée et la pratique socialistes. Marx procédera en effet à une critique à la fois des socialistes utopiques et des groupes politiques élitistes: des socialistes utopiques il reprendra une partie de leur diagnostic de la société capitaliste en approfondissant cependant les conditions de la lutte pour le socialisme (le socialisme n'est pas un arbre sans racines, il a des bases matérielles); par ailleurs il rejettera radicalement la conception de la lutte qui considère que la classe ouvrière a besoin de bourgeois éclairés pour assurer sa libération.

Un saut qualitatif important est franchi avec la parution en 1848 du Manifeste du parti communiste, écrit par Marx et Engels. C'est à partir de ce Manifeste et des débats qu'il suscitera jusque dans la 1reInternationale que le projet socialiste prend davantage de consistance et s'articule mieux à la classe ouvrière.
Le Manifeste est rédigé par Marx et Engels à la demande expresse de militants des groupes ouvriers les plus radicaux de ce temps-là. Il faut noter que c'est alors depuis quatre ou cinq ans seulement que Marx considère comme centrale la place de la classe ouvrière dans la lutte contre le capitalisme et pour le socialisme. Il faut ici avoir à l'esprit que, dans le plupart des pays européens (en Allemagne par exemple), le féodalisme domine (1). L'industrialisation capitaliste ne fait que commencer et, avec elle, apparaît la classe ouvrière constituée d'abord par les travailleurs salariés réunis dans des manufactures. L'idée dominante dans les couches progressistes de la petite bourgeoisie veut que la bourgeoisie, comme classe, soit révolutionnaire: la bourgeoisie naissante serait capable, à leur yeux, de renverser le régime féodal et capable d'amener de profondes transformations sociales.
C'est vers 1844-45 que Marx, exilé politique en France, entre en contact avec des ouvriers qui sont en train de mener les premières grèves dans les régions de Paris, Lyon, etc., et c'est à ce moment-là qu'il développe une toute nouvelle réflexion. La théorie de la plus-value(2), c'est à partir des premières grèves qu'il l'a pensée. C'est à partir de ses premières expériences de contact avec la classe ouvrière qu'il découvre la possibilité que cette classe mène à terme le projet socialiste à cause de la place qu'elle occupe dans la société. C'est aussi à cause de qu'il observe dans les faits : ceux qui luttent de la façon la plus conséquente sont les travailleurs organisés.
|
|
« L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes », tel est le leitmotiv que Marx préconise et à partir duquel il construit un certain nombre de propositions issues des débats qui entourent la parution du Manifeste, débats qui auront leur prolongement jusque dans la 1reInternationale (1864-1876). Ces propositions sont les suivantes :
5. « Les ouvriers commencent par former des coalitions contre lesbourgeois pour la défense de leurs salaires (...) le résultat véritable deleurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante destravailleurs (...) mais toute lutte de classes est une lutte politique (...) » : le syndicalisme est indispensable comme instrument de lutte et de solidarité tout comme l'action politique révolutionnaire, i.e. la constitution de laclasse ouvrière en parti politique ;
6.« Pratiquement, les communistes (4) sont donc la fraction la plus résoluedes partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes lesautres (...) » : ici Marx signale l'importance pour les militants politiquesd'être comme avant-garde de la classe ouvrière, au coeur des luttes dumouvement de masse.
Voilà donc en bref les premiers jalons d'un projet socialiste qui brise avec l'idéalisme antérieur en identifiant un certain nombre de conditions de sa réalisation. Ces premiers jalons d'un projet socialiste identifiés à partir du mouvement réel de la lutte des classes dans une société capitaliste, c'est avec Marx et Engels qu'ils prennent forme.
Vingt ans plus tard, en France, un autre événement va faire histoire : la Commune de Paris en 1871. C'est l'occupation par le peuple de la ville de Paris et l'administration de cette ville, à tous les niveaux (justice, santé, ravitaillement, organisation des décisions politiques, etc.), par des organes populaires créés à cette fin. La Commune de Paris a été, comme dit Marx, « essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail (5) ».

Contre l'agression, contre Thiers qui veut lui prendre ses canons, Paris s'enfièvre : le 18 mars 1871, une barricade à Ménilmontant.
La Commune se produit dans le contexte de la fin de la guerre entre l'Allemagne (qui s'appelait la Prusse à l'époque) et la France. Comme dans toutes les guerres, c'est le peuple qui en fait les frais, qui en subit les conséquences les plus directes : c'est le peuple qui est à la fois sur le front et qui travaille pour alimenter la guerre tout en essayant de survivre. Il y a donc un mécontentement général en France, et particulièrement à Paris où se déclenche une véritable insurrection populaire, un soulèvement de la majorité du peuple contre la bourgeoisie, contre le régime en place (le gouvernement de Thiers) qui cherche à continuer la guerre contre la Prusse.
Ce soulèvement, qui se transforme en occupation générale de la ville, va durer près de trois mois. Pour mettre fin à l'État bourgeois, le mouvement populaire initie toute une série de mesures : une justice populaire est instaurée ; des ouvriers sont élus dans le cadre d'un conseil communal pour la ville de Paris et sont considérés comme révocables en tout temps ; des fonctionnaires de la municipalité de Paris sont ramenés à un salaire semblable au salaire moyen des travailleurs de Paris (on leur enlève les privilèges rattachés à leur statut). Évidemment, on met aussi en place des mesures de défense de la ville parce que l'armée régulière française, qui a été dissoute dans Paris, est en voie de reconstitution dans le reste de la France. Devant l'insurrection populaire, les bourgeoisies allemande et française se réconcilient rapidement et l'armée française peut compter sur l'appui de l'Allemagne pour attaquer Paris et vaincre militairement les milices populaires qui défendent la ville. Après quelque temps de résistance, le peuple de Paris est obligé de concéder la victoire. La répression est féroce, des dizaines de milliers de fusillés, des dizaines de milliers d'exilés.
On retrouve plus tard un certain nombre de militants de la Commune de Paris exilés aux États-Unis et participant activement à l'organisation des Chevaliers du travail (6). Le chant de l'Internationale, écrit par Eugène Pottier, un communard, a été inspiré par l'expérience de la Commune.
La défaite de la Commune de Paris s'explique évidemment en premier lieu par l'ampleur de la force déployée contre les communards, force constituée par une alliance entre deux bourgeoisies, l'allemande et la française. Rien n'était en effet plus redoutable pour les bourgeoisies nationales des différents pays d'Europe qu'une commune populaire dans un des plus grands centres urbains de l'époque.
Mais l'échec est également dû à des faiblesses propres au mouvement populaire lui-même : Engels, dans sa préface au texte de Marx La guerre civile en France, écrit vingt ans plus tard (en 1891), signalera le poids des disciples de Blanqui dans l'organisation centrale de la Commune, de même que celui des socialistes utopiques comme Proudhon qui par méconnaissance des mécanismes clefs de l'économie auront une attitude de « saint respect... devant les portes de la Banque de France. Ce fut d'ailleurs une lourde faute politique... La Banque aux mains de la Commune... cela signifiait que toute la bourgeoisie française faisait pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la Commune (7). »
L'expérience de la Commune de Paris amènera Marx et Engels à réfléchir sur le problème de la transition au socialisme. L'expérience de la Commune analysée par Marx dans La guerre civile en France, mettra en relief l'importance capitale : 1) de renverser l'État, instrument du pouvoir de la bourgeoisie ; 2) d'instaurer un véritable pouvoir des masses populaires (ouvriers élus et révocables en tout temps, milices populaires chargées de défendre la ville, salaire ouvrier moyen pour les fonctionnaires de l'État...). En d'autres termes, anéantir ou tout au moins neutraliser la police et l'armée, établir une forme de démocratie plus réelle et plus populaire... Autant de choses qui ne se négocient pas mais s'imposent par la force de la mobilisation collective.
C'est en 1864 à Londres qu'est fondée la 1reInternationale dont Marx est un des fondateurs et des piliers. Cette association internationale de travailleurs regroupe des petits partis politiques qui se définissent comme socialistes et beaucoup d'organisations syndicales. Ils viennent d'abord d'Angleterre, de France et d'Allemagne puis, peu à peu se joignent à la 1reInternationale, des militants de Belgique, d'Italie et d'Espagne. C'est surtout dans les pays où le capitalisme est suffisamment développé et où des noyaux ouvriers sont assez radicaux que se développe la 1reInternationale et l'enracinement dans la classe ouvrière d'un véritable projet de lutte contre le capitalisme et pour le socialisme.
|
|
|
Le Quatrième Congrès de l'Internationale (1869). |
Ainsi, par exemple, au Congrès de 1868, on trouve dans le programme de l'Internationale les points suivants : la propriété collective du sol, des mines, des forêts, des moyens de transport. Cette idée-là n'est donc pas née d'hier. Elle fait ailleurs partie, dix ans plus tard, des revendications des Chevaliers du travail aux États-Unis, au Canada et au Québec. Sur le plan international, l'idée d'en finir avec la propriété privée fait donc progressivement son chemin.
Cette Internationale travaille beaucoup à coordonner ces organisations et à assurer le soutien aux luttes, tout particulièrement aux nombreuses grèves qui se mènent ici et là dans les différents pays de l'Europe.
La section française de la 1re Internationale sera impliquée dans la Commune de Paris, mais on ne peut pas dire qu'elle en ait été l'élément dirigeant. D'abord, le mouvement a été plutôt spontané puis, parmi les dirigeants de cette insurrection, si certains souscrivaient aux idées véhiculées par la 1reInternationale, d'autres souscrivaient davantage aux idées véhiculées pendant la période précédant la parution du Manifeste du Parti communiste et héritées du socialisme utopique.
En 1871, la répression féroce contre ceux qui ont participé à la Commune de Paris amènera un reflux à l'intérieur du mouvement ouvrier : les bourgeoisies dans les pays autres que la France vont persécuter systématiquement les militants de la 1reInternationale et les autres militants socialistes. Ces bourgeoisies ne voulant évidemment pas que la Commune de Paris se reproduise dans leur propre pays.
La défaite de la Commune sonnera le glas de l'Association internationale des travailleurs qui se disloquera puis sera officiellement dissoute en 1876 lors de sa dernière réunion à New York. La répression aura pesé de tout son poids dans la dissolution de la 1reInternationale, mais la division entre les « marxistes » et les « bakouninistes » y mettra définitivement fin. Le conflit porte essentiellement sur deux points :
L'existence de cette 1re Internationale aura néanmoins apporté au mouvement ouvrier : 1) quelques principes, moyens et conditions de se concerter au niveau international ; 2) elle aura aussi permis (à partir des analyses de Marx principalement) de soutenir la constitution du prolétariat en force politique indépendante de la bourgeoisie dans chaque cadre national.

|
|
Les années 1870-1880 sont marquées par une période de reflux, une baisse de la combativité des travailleurs et un affaiblissement des organisations ouvrières et socialistes. Durant les années '80, c'est la remontée lente, la reconstitution des organisations ouvrières et socialistes pour en arriver, en 1889, avec Engels, à la fondation d'une 2e Internationale, constituée cette fois-ci principalement de partis politiques contrairement à la 1reInternationale où les syndicats étaient plus nombreux que les partis.
Ces partis se sont surtout formés en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Soulignons au passage que le Parti Ouvrier (9), qui sera au Québec, à partir de 1899 jusqu'à la crise de 1929, la principale organisation politique ouvrière, en était membre.
Il faut distinguer deux périodes dans la 2e Internationale, quant au projet socialiste. La première période dure jusqu'en 1910-1915, la deuxième période est celle qui débute avec l'implication de la 2e Internationale dans la 1reGuerre mondiale (1914-1918) qui est une guerre impérialiste.
Durant la première période, les idées véhiculées sur le socialisme sont celles qui ressortent du Manifeste de 1848, de même que celles tirées de l'expérience de la Commune de Paris : pour en arriver au socialisme, pour en arriver à instaurer le pouvoir des travailleurs dans la société, c'est à-dire pour créer cette classe comme classe dominante dans la société, il faut renverser l'État capitaliste. Ce n'est ni par les élections (même si on peut les utiliser), ni par des grèves ou des occupations d'usines (même si ça fait toujours partie de la lutte pour le renversement de l'État capitaliste), mais par l'utilisation combinée de tous les moyens qu'il est possible de renverser l'État bourgeois. On ne peut pas l'investir, le gruger petit à petit, s'emparer d'un ministère, s'emparer du pouvoir exécutif, puis s'emparer du pouvoir législatif et ensuite s'emparer du judiciaire... Il faut le renverser, il faut développer un rapport de forces qui amène à rompre avec le régime capitaliste pour instaurer des organes de pouvoir ouvrier et populaire. Ce qui est en cause ici, c'est la stratégie que les travailleurs doivent mettre en branle de même que l'ensemble des moyens (des tactiques) à utiliser : l'expérience de la Commune de Paris avait révélé
1) que la transformation en profondeur de la société suppose lerenversement de l'État capitaliste et la construction d'une alternativec'est-à-dire la construction d'un pouvoir ouvrier et populaire ;
|
|
|
Pour un nouveau rythme de vie (1er mai 1906). |
Autre caractéristique de la 2e Internationale : en plus de véhiculer un certain nombre d'idées sur le socialisme, cette Internationale stimule l'organisation des travailleurs sur la base de la revendication de la journée de 8 heures. ''Rappelons que le massacre des travailleurs de Chicago, en 1886 (qu'on commémore le 1er mai), est la conséquence de leur lutte pour la journée de 8 heures, revendication reprise ensuite par la 2e Internationale.
Par ailleurs, dans la 2e Internationale, les organisations du côté des Etats-Unis, et en général du côté des pays non-européens, sont sur la deuxième et la troisième ligne de feu. La 2e Internationale a vraiment comme épicentre de la lutte l'Europe et comme parti hégémonique servant de modèle aux autres, le Parti social-démocrate allemand. (10)
En outre, durant la deuxième période, à la faveur de la guerre, la position prise par plusieurs partis et syndicats — surtout en Allemagne et en France — face à cette guerre va modifier considérablement les choses. Doit-on participer ou non à la guerre ? De quelle sorte de guerre s'agit-il ? D'une guerre du peuple ou d'une guerre impérialiste? Là-dessus la majorité des organisations du mouvement ouvrier s'entendent assez bien pour dire que c'est une guerre impérialiste entre la France et l'Allemagne, d'une part, et, d'autre part, une volonté d'expansion de pays comme la Russie en direction de la Hollande et des petits pays environnants. Ce sont les bourgeoisies qui entrent alors en guerre. Les éléments les plus radicaux de la 2e Internationale, parmi lesquels se retrouve Lénine pour la section russe, vont dire : « On ne participe pas à cette guerre. On n'a pas à appuyer sa bourgeoisie contre une autre ». Mais plusieurs partis socialistes vont s'engager dans la guerre, vont s'associer avec leur bourgeoisie nationale contre l'agression extérieure.
C'est ainsi, par exemple, que le Parti socialiste français va s'associer à sa propre bourgeoisie contre l'impérialisme allemand en votant au Parlement les crédits de guerre.
Ici, il faut dire qu'en 1890 et 1914, le capitalisme a connu une période d'expansion. La condition ouvrière s'est améliorée et, à cause de cette amélioration relative, on a commencé, à l'intérieur du courant marxiste, à remettre en question les idées développées dans le Manifeste et les leçons tirées de la Commune. Certains se sont alors mis à penser que le socialisme pourrait se réaliser en tablant principalement sur les élections, puis une fois rendus au pouvoir, commencer à travailler à la transformation graduelle de la société.
Notons que Lénine et plusieurs militants socialistes qui animeront la révolution russe s'opposent dans le cadre des débats de la 2e Internationale à ceux qui révisent les principaux acquis du marxisme révolutionnaire. (11)
La 2e Internationale, évoluant aujourd'hui sous le vocable d'Internationale socialiste, continue d'exister et d'influencer de façon significative bon nombre de mouvements ouvriers nationaux. À l'intérieur de cette Internationale socialiste, on retrouve entre autres le Parti social-démocrate allemand, le Parti travailliste anglais, le Parti socialiste français, le Parti travailliste d'Israël, le Parti ouvrier social-démocrate suédois, les Partis socialistes portugais et espagnol de même que le NPD canadien. Ajoutons à cela qu'elle a des ramifications dans certains pays du Tiers-Monde, comme au Sénégal ou au Venezuela. Certains des partis politiques qui lui sont affiliés se réfèrent encore au marxisme, mais façon réformiste ou social-démocrate.
On peut donc conclure que la 2e Internationale, fondée en 1889 dans une nouvelle période d'expansion du capitalisme et du mouvement ouvrier, répond à la nécessité de mener des luttes en commun sur des objectifs précis tels la journée de 8 heures, la reconnaissance syndicale, le suffrage universel... La 2e Internationale, au début, favorise aussi l'extension et l'enracinement dans la classe ouvrière des propositons contenues dans le Manifeste et dans La guerre civile en France tout en suscitant l'émergence de partis ouvriers puissants (notamment en Allemagne).
Toutefois, la 1reGuerre mondiale sera l'occasion d'une première crise idéologique importante dans le mouvement socialiste : la majorité des socialistes de l'époque se rangeront du côté de leur bourgeoisie en participant activement à la guerre. Le début du XXe siècle sera aussi l'occasion, à l'intérieur de cette Internationale, d'une révision des propositions de Marx par Bernstein (12)dans le cadre d'une conjoncture économique et politique qui favorise le réformisme. C'est Lénine, le Parti bolchevique et la révolution russe (1917) qui redonneront au mouvement socialiste son élan et sa perspective révolutionnaire.
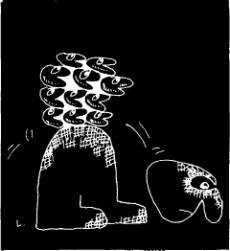
C'est dans ce contexte de guerre impérialiste en Europe que la classe ouvrière et les paysans russes, organisés en différents partis politiques, entre autre le Parti bolchevique (le parti de Lénine) vont renverser le régime tsariste et créer le premier État socialiste. Encore là, le mécontement du peuple face à la guerre est un des facteurs importants qui explique le soulèvement populaire en Russie, mais ce n'est pas le seul. Le fait qu'une partie du peuple soit organisée politiquement sur ses propres bases depuis plusieurs décennies en est un autre (par exemple, Lénine, en tant que dirigeant du mouvement ouvrier russe, milite politiquement depuis 1890 en travaillant à l'organisation de grèves, de luttes pour les libertés politiques, etc. contre le régime tsariste).
|
|
|
Tout le pouvoir aux soviets! (1917). |
Un facteur favorable à la révolution dans la Russie de 1917 est donc le rôle des partis politiques de gauche, plus particulièrement le parti bolchevique et des Conseils ouvriers. L'existence d'un parti au coeur de la lutte des masses, au coeur de l'organisation de la lutte économique, de la lutte politique et de la lutte idéologique est un élément déterminant pour le succès de cette révolution, élément qui n'existait pas durant la Commune de Paris. La constitution, à la faveur de l'insurrection populaire,d'organes autonomes de pouvoir ouvrier et populaire (les conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats) fournit la garantie ultime du caractère socialiste de cette révolution.

Avec Staline c'est la remise en question de la pensée de Marx, d'Engels et de Lénine. C'est aussi le début décisif d'un bond en arrière du socialisme en URSS.
Avec l'insurrection populaire d'octobre, les conseils ouvriers proclament la chute du gouvernement et proposent « une paix démocratique immédiate à toutes les nations, une remise aux comités paysans des biens des propriétaires fonciers, de la Couronne et de l'Église..., le contrôle ouvrier sur la production, la convocation de l'Assemblée constituante et le droit absolu de toutes les nationalités en Russie à disposer d'elles-mêmes (13) ».
Lénine meurt en 1923. Des luttes de tendances se polarisent dans le Parti. Ces luttes de tendances opposent principalement deux dirigeants : Trotsky (14) et Staline.
L'aile que dirige Staline en arrive à contrôler le Parti. Il devient ainsi secrétaire général du Parti bolchevique en 1924, et dirigeant de la 3e Internationale. Ici, toute une analyse est à faire de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie à partir de 1917. Chose certaine, il y a un processus, une dynamique qui aboutit progressivement à la non réalisation du socialisme. Même si la thèse officielle du Parti communiste chinois dit que la détérioration du socialisme a commencé en 1956 avec Krouchtchev, l'analyse que nous en faisons fait ressortir des reculs et des échecs qui sont là bien avant 1956, en réalité dès le milieu des années '20.
Un exemple d'échec du socialisme sous Staline est la collectivisation forcée des terres : en 1928-1929 les paysans russes sont vraiment « embarqués » dans un processus de création de grosses coopératives d'État dans lesquelles ils deviennent des travailleurs agricoles. Cela leur est imposé. Il n'y a pas de débats, de discussions et de décisions démocratiques prises avec les paysans. Cela leur est imposé drastiquement, avec l'épuration et l'emprisonnement des dirigeants paysans qui s'y opposent.
La révolution chinoise et la révolution cubaine procéderont différemment à l'égard de paysans et c'est là un de leurs apports particuliers. Car il est possible et nécessaire de faire avancer la situation de l'ensemble du pays, de faire le socialisme en suscitant la participation directe des paysans.
Pendant ces années-là, la difficulté principale du Parti bolchevique a été son incapacité à développer une politique adéquate et mobilisatrice avec les paysans qui représentaient un potentiel en Russie, potentiel que le Parti n'avait pas eu l'occasion de faire mûrir politiquement aussi bien qu'il en avait eu la possibilité avec la classe ouvrière. C'est un autre parti, le Parti socialiste révolutionnaire, parti plus enraciné dans la paysannerie, qui s'en est chargé.
Voilà un des facteurs qui expliquent l'échec du socialisme en URSS : l'absence de mise à contribution des paysans . Mais il y a aussi, sous Staline, toute la bureaucratisation du parti qui se développe avec la montée lente d'une couche dirigeante qui finit par s'emparer de l'ensemble des leviers de pouvoir dans les différents secteurs de la société russe, de manière telle que les organes de pouvoir ouvrier et populaire dans les entreprises, dans les quartiers, dans tous les secteurs de la vie, se détériorent, se dévitalisent, perdent complètement leur dynamisme. Et cela au bénéfice d'un couche de dirigeants qu'on retrouve aux différents niveaux de l'appareil d'État et du Parti. Dans ces conditions, le Parti devient le seul porte-parole du peuple dans le cadre d'un État auquel le Parti s'identifie de plus en plus. En d'autres termes la presse est contrôlée par le Parti, les syndicats, et les conseils ouvriers aussi...
On ne peut évidemment imputer aux seules erreurs de la gauche les reculs du socialisme en URSS à partir du milieu des années '20. Il faut voir aussi le contexte (les facteurs objectifs) dans lequel le projet socialiste en URSS a dû se développer. C'est d'abord un contexte où effectivement la révolution ne s'est pas étendue à d'autres pays d'Europe, comme Lénine l'escomptait beaucoup en 1917. Dès le début des années '20, le paysage commence à s'assombrir, en Italie d'abord, puis en Allemagne. La Russie devient vite dans toute l'Europe une espèce d'équivalent de ce qu'est devenu Cuba en Amérique du Nord en 1959, c'est-à-dire le pays contre lequel les bourgeoisies de tous les pays d'Europe font un blocus économique et mettent tout en oeuvre pour entraver la révolution. Un autre facteur a trait au caractère peu industrialisé de l'économie russe. La classe ouvrière, sur laquelle repose le nouveau pouvoir socialiste est numériquement très faible en 1917, ne comptant pas plus de trois millions de personnes par rapport à plusieurs dizaines de millions de paysans. Dans les années ultérieures, elle a diminué encore, d'une part, à cause des difficultés économiques faites par les autres pays, ce qui entraîne un recul de l'industrialisation, d'autre part, à cause de la guerre civile, c'est-à-dire la guerre entre les forces réactionnaires et celles de l'Armée rouge, des milliers d'entre eux sont tués, ce qui réduit encore numériquement la classe ouvrière. Enfin, plusieurs cadres militants de la classe ouvrière ont commencé à prendre des postes dans l'appareil d'État.
C'est dans ce contexte de guerre civile et d'isolement international, que Lénine dès 1919 est obligé de faire des compromis : par exemple,il se voit forcé d'accepter de payer des fonctionnaires et des technocrates plus cher que l'exigent les normes socialistes, sans quoi il n'obtient pas leur participation active. Alors, bien que ce ne soit pas du tout au goût des dirigeants du Parti bolchevique de faire ces compromis, entre le moindre mal et l'idéal impossible, ils préfèrent le moindre mal. En outre, toute une série de compromis d'ordre économique sont pris à partir de 1921 : recrutement de capitalistes et de techniciens bourgeois pour diriger des entreprises de l'État, concession d'entreprises à des capitalistes...
Qu'apporté la révolution russe au mouvement ouvrier international? Disons d'abord que c'est grâce au parti bolchevique et à la révolution russe que le mouvement socialiste reprend son élan et sa perspective révolutionnaire. Car cette révolution rappelle à juste titre aux dirigeants de la 2e Internationale la nécessité de la rupture avec le capitalisme par le renversement de son État. Cette révolution met également en lumière certaines conditions concrètes de prise du pouvoir par les travailleurs :
1. Dans le prolongement de la Commune de Paris l'importance de la prise en charge directe des affaires de l'État et des affaires de toute la société par les masses populaires elles-mêmes (les conseils d'ouvriers et de paysans) ;
|
|
La participation des paysans à la révolution.
2. La nécessité des alliances de classes (ouvriers et paysans), même si cesalliances ne sont pas très réussies;
3. La nécessité d'une avant-garde (qui peut être composée de plusieursorganisations politiques) (15) pour animer et diriger le processus de rupture avec le capitalisme et son Etat.
L'expérience de la révolution russe a donc fourni au mouvement ouvrier international de nouvelles armes en illustrant de façon concrète et visible comment se construisait le socialisme. Reste que la révolution russe a fait rapidement face à divers problèmes qu'elle n'a pas réussi à résoudre de façon satisfaisante :
C'est à la faveur de la révolution russe que naît la 3e Internationale (dite Internationale communiste) dans une période de crise idéologique au sein de la 2e Internationale. Y adhèrent des partis communistes parmi lesquels certains deviendront très forts, tels ceux de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Ces partis vont se constituer sur la base d'un double échec du mouvement ouvrier à cette époque :
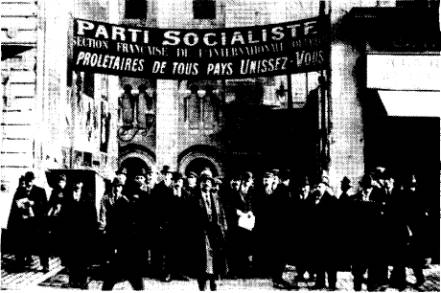
La fin du congrès du Parti socialiste à Tours ( janvier 1920). La scission à ce congrès donnera bientôt naissance au Parti communiste.
1. L'échec des partis socialistes, membres de la 2e Internationale, partis qui sont devenus tellement collaborateurs avec leur bourgeoisie nationale que les éléments les plus radicaux de la classe ouvirère ne s'y retrouvent plus vraiment à l'aise. En effet, la participation délibérée des partis socialistes à la Guerre de 1914-1918 amène la classe ouvrière, du moins ses fractions les plus conscientes, les plus dynamiques,les plus combatives, à se détacher de ces partis ;
2. L'autre échec est celui du syndicalisme révolutionnaire (16) ou de l'anarcho-syndicalisme. Le syndicalisme révolutionnaire reprend à son compte une bonne partie de l'héritage de la Commune de Paris : il est anti-capitaliste, il veut renverser l'État bourgeois, cependant, au niveau des stratégies de lutte, il rejette la nécessité du parti politique comme instrument de conquête du pouvoir ; c'est par la grève générale qu'il pense aboutir au renversement de l'État capitaliste. Or, l'histoire a démontré que ce n'était pas si simple.
Mentionnons à cet effet que les années 1918-1921 sont des années d'effervescence sociale généralisée en Europe (en France, en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne). Les travailleurs organisent des grèves générales, avec occupation d'usines, forment des conseils ouvriers qui font fonctionner les usines pendant des mois. Mais ça ne dure pas car la bourgeoisie sait reprendre l'offensive rapidement (17).
C'est le syndicalisme révolutionnaire qui est au coeur de ces mobilisations mais tout cela est fragile étant donné que c'est un syndicalisme minoritaire. On ne peut pas en effet maintenir l'ensemble de la classe ouvrière sur la brèche pendant des mois, à administrer, organiser l'usine, se défendre contre la police, s'alimenter, enfin tout faire. Il faut des moments de répit, et là, il n'y avait pas de possibilité de répit, la bourgeoisie, elle, n'attendait pas. Il y a donc eu un échec assez cuisant, la bourgeoisie réussissant à briser ce mouvement dans la plupart des pays.
Les Partis communistes et la 3e Internationale se constituent donc en bonne partie sur l'échec des autres, sur l'échec du Parti socialiste comme collaborateur avec la bourgeoisie dans la période de guerre et sur l'échec de la grève générale illimitée comme stratégie de lutte pour le socialisme. Les militants du syndicalisme révolutionnaire font le bilan de ce qui est arrivé et constatent qu'il faut un parti. C'est ce qui explique que la première génération de militants des partis communistes vienne de la fraction de gauche des partis socialistes et du syndicalisme révolutionnaire.
L'Europe, durant la 1ère Guerre Mondiale, est donc le théâtre d'un mouvement de masse imposant qui a comme référence immédiate et mobilisatrice l'URSS comme société en train de construire le socialisme. La révolution est, pour ainsi dire, à l'ordre du jour dans bon nombre de pays. Le diagnostic du Parti bolchevique et de Lénine est le suivant : 1) le socialisme ne peut avancer en Russie indépendamment des pays occidentaux car c'est en Occident que se trouvent les foyers industriels les plus nombreux et les plus développés, les grandes concentrations ouvrières ; 2) le capitalisme est international, la guerre le démontre bien (18) ; 3) il faut accentuer la tendance « naturelle » à la révolution présente dans ces pays.

Le 1er congrès de l'Internationale communiste à Saint-Pétersbourg. À la présidence on reconnaît Trotsky, Zinoviev, Lénine.
Mais la seule chose qui manque, c'est un agent conscient et organisé, un parti révolutionnaire de type bolchevique (les partis socialistes et la 2e Internationale ne conviennent plus). Il faut donc coûte que coûte créer le parti révolutionnaire à l'échelle européenne et mondiale avant que la situation, objectivement favorable au mouvement ouvrier, ne se modifie. C'est alors la course contre la montre pour créer une nouvelle internationale, l'Internationale communiste qui sera formée en mars 1919 comme parti mondial de la révolution.
Les principes d'adhésion à la 3e Internationale (19) seront stricts et le programme, la stratégie et les tactiques considérés comme universels, c'est-à-dire applicables partout. C'est à partir du Congrès de 1919 que, peu à peu, surgissent dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique des partis communistes (au Canada, au Chili, en France et en Italie, en 1921...).
La création de la 3e Internationale provient donc de la nécessité de défendre la révolution russe et de la conviction de l'imminence d'une révolution internationale (ou du moins européenne). Mais le problème de l'organisation de la classe ouvrière à l'échelle mondiale se heurte, avec la 3e Internationale, à un obstacle de fond : le problème d'une stratégie, d'une tactique et d'un programme universels est posé mais n'est pas résolu. Car il faut tenir compte de la diversité de la lutte des classes et de la variété des impératifs tactiques : la lutte des classes a un caractère international mais elle ne se développe pas de la même façon dans chaque formation sociale (régime politique de type dictatorial dans un pays,
régime démocratique dans l'autre, capitalisme développé dans certains secteurs seulement, capitalisme très développé dans toutes les sphères de la société, lutte de libération nationale dans un pays,lutte anti-capitaliste dans l'autre...)-
La centralisation autoritaire de la 3e Internationale et le recours à une grille d'explication théorique qui amène à définir un seul programme pour tous les partis dans tous les pays rendront son application difficile et souvent désastreuse (20). Mentionnons à titre d'exemple la question du rôle des paysans dans la révolution, question non résolue par la révolution russe mais que Mao et les dirigeants du mouvement ouvrier chinois auront à résoudre en dépit et contre la 3e Internationale. Mentionnons aussi comme exemples l'appui du Parti communiste français au pacte Staline-Hitler de 1939-1941, alors que la France était en guerre ouverte, menacée d'occupation militaire par l'Allemagne ou encore le refus de la 3e Internationale de soutenir les révolutionnaires espagnols pendant la Guerre civile de 1936 à 1939. Mentionnons également les différences de vue sur la politique de front populaire appliquée à partir de 1935 par l'Internationale communiste mais qui était loin d'aller de soi pour les dirigeants du Parti communiste chinois, Mao en tête !

Les fronts populaires : derrière les survivants de la Commune, en mai 36, Léon Blum et Léon Jouhaux (socialistes), Benoît Frachon et Jacques Duclos (communistes).
À la fin de la 2e Guerre Mondiale, en 1944, Staline dissout la 3e Internationale, condition posée par Roosevelt (État-Unis) et Churchill (Angleterre) à des accords conduisant au partage du monde en zones d'influence. Ces accords eurent pour effet de sacrifier plusieurs mouvements socialistes et révolutionnaires (cas de la Grèce et de la Yougoslavie tout particulièrement).
Le partage du monde en zones d'influence rendra possible l'imposition de la direction des partis communistes dans plusieurs pays de l'Europe Centrale et de l'Est, tels l'Albanie, la Hongrie, la Tchéchoslovaquie, la Pologne... Après la 2e Guerre Mondiale, ce sont des régimes dits de « démocratie populaire » qui se forment dans ces pays.
Malgré le monolithisme de la 3e Internationale, certains partis ou dirigeants seront très critiques et sauront, en dépit de maints obstacles, apporter leur contribution à la lutte pour le socialisme. C'est ainsi que l'on peut parler de l'expérience du mouvement ouvrier allemand avec Rosa Luxembourg qui, dès le début de la révolution russe, saura signaler certaines faiblesses :

Rosa Luxembourg harangue la foule (1907).
« Le mérite impérissable des bolcheviques est d'avoir ouvert la voie au prolétariat international en prenant le pouvoir politique et en posant le problème pratique de la réalisation du socialisme...
« Le danger commence là où, faisant de nécessité vertu, ils cherchent à fixer dans tous les points de la théorie une tactique qui leur a été imposée par des conditions fatales et à la proposer au prolétariat international comme modèle de la tactique socialiste (21). »
C'est ainsi que l'on peut parler également de l'expérience du mouvement ouvrier italien avec Gramsci qui cherche, envers et contre tous les dirigeants de l'Internationale communiste, y compris ceux de son parti, une stratégie de lutte pour le socialisme propre à l'Occident : au contraire de l'Orient (sous-entendue la Russie), « en Occident, l'État n'est qu'une tranchée avancée, derrière laquelle se trouve une robuste chaîne de forteresses et de casemates... (22) »
En d'autres termes, le rôle de l'État dans les sociétés capitalistes avancées est beaucoup plus complexe et ramifié : la bourgeoisie impose sa domination, non seulement par la force, mais aussi par son hégémonie, c'est-à-dire par les valeurs et l'idéologie qu'elle réussit à faire valoir auprès des classes populaires. La bourgeoisie se maintient au pouvoir par le bloc social qu'elle réussit à construire autour d'elle. Le mouvement ouvrier, s'il veut vaincre, devra non seulement lutter avec tous les moyens à sa disposition mais aussi développer son hégémonie dans l'ensemble des classes populaires en travaillant à la constitution d'un nouveau bloc social anti-capitaliste.
Mais c'est la révolution chinoise et la pensée de Mao qui viendront, à leur tour, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de force, secouer la paralysie théorique et la torpeur du mouvement ouvrier international encore sous l'emprise du monolithisme stalinien.

|
|
Léon Trotsky à son arrivée à Mexico.
À la mort de Lénine, à l'intérieur du Parti bolchevique, des luttes de tendances se cristalisent, luttes qui se concluent par la prise en charge de la direction du Parti par Staline. Ce qui éclipse son principal adversaire, Trotsky. Mais la lutte entreprise par Trotsky et les différentes oppositions à Staline va durer quelques années jusqu'à son expulsion du Parti et son exil forcé en 1928.
Dirigeant de l'opposition de gauche au stalinisme, Trotsky mène la lutte sur plusieurs fronts mais principalement sur la question de la bureaucratisation du parti et de l'étouffement progressif des conseils ouvriers de même que sur l'internationalisme comme tâche centrale de la révolution russe.
Exilé en 1928, il tentera d'animer, en marge des partis communistes existants et de la 3e Internationale, ses sympathisants dans différents pays d'Europe et même en Amérique latine (au Mexique en particulier). En septembre 1938, une trentaine de militants venus de onze pays participent, dans la région parisienne, au Congrès de fondation de la 4e Internationale : ces militants ont tous en commun de s'opposer à l'emprise du stalinisme sur l'Union soviétique et sur les partis communistes dans les autres pays.
Aujourd'hui, après 40 ans d'existence, la 4e Internationale et ses sections, cherchent à se développer comme force politique à la gauche des sociaux-démocrates (2e Internationale) et des communistes à partir d'une perspective de lutte où les conseils ouvriers demeurent l'axe principal. Au dire de ses dirigeants, elle est présente dans une soixantaine de pays (23) et ses adhérents se chiffrent dans les quelques dizaines de milliers. Force est de constater qu'après 40 ans, le résultat demeure relativement mince.
Il faut cependant reconnaître aux militants trotskistes d'avoir été les premiers opposants de gauche aux partis communistes en pointant des problèmes réels : celui de la bureaucratisation des partis et des États dits socialistes, celui de la solidarité internationale conçue exclusivement comme instrument de défense inconditionnelle d'un État socialiste.
La naissance de la 4e Internationale a exprimé l'opposition courageuse de militants socialistes au détournement du socialisme par les partis communistes. Mais le trotskisme, comme courant socialiste, est demeuré figé dans le temps, comme fixé sur la révolution russe. C'est ainsi qu'après 60 ans de « socialisme » en URSS, il qualifie encore l'URSS d'État ouvrier dégénéré en misant encore de façon quasi-exclusive sur les conseils ouvriers (comme s'il s'agissait là de la seule forme possible de démocratie ouvrière dans le cadre d'un État socialiste). Il n'a pas su non plus développer d'explication vraiment satisfaisante du problème tant décrié de la bureaucratie : s'agit-il ou non d'une classe sociale ? d'où vient ce phénomène ?... Le trotskisme est aussi figé dans ses références idéologiques, ainsi n'accorde-t-il aucun crédit à la révolution chinoise et à la pensée de Mao. Son internationalisme est finalement lui aussi réducteur car il passe essentiellement par l'affiliation à la 4e Internationale. Or la construction d'une nouvelle internationale (la 4e Internationale se présentant comme Nouvelle Internationale) n'est pas à l'ordre du jour : si l'internationalisme passe par la recherche de convergences stratégiques, d'actions menées en commun entre les militants et forces socialistes de différents pays, il ne se confond pas avec une démarche d'affiliation à une internationale qui ne regrouperait finalement qu'un ensemble minuscule, qui n'aurait guère de chances de susciter l'élargissement de la solidarité internationale de classe (24)
Après la 2e Guerre Mondiale, le point principal d'ancrage de la lutte pour le socialisme tend à se déplacer de l'Europe vers l'Asie (Chine, Vietnam, Corée...). Mais ce déplacement vers l'Asie est néanmoins lié d'assez près à ce qui s'est passé en Europe pendant la guerre.
En effet l'Allemagne et l'Italie ont contracté en Asie une alliance privilégiée avec un pays qui avait, lui aussi, des visées impérialistes, le Japon. C'est en direction de la Chine que le Japon mettra en application sa volonté d'expansion.
|
|
|
Mao Tsé Toung à cheval dans le Shanxi en 1947. |
À l'origine de la révolution chinoise,c'est une lutte acharnée des paysans, sous la direction du Parti communiste et de Mao Tsé-Toung, contre l'impérialisme japonais, contre l'envahisseur japonais. Menée dans une perspective socialiste, par les forces populaires dirigées par Mao Tsé-Toung, cette lutte de libération nationale débouche en 1949 sur une véritable révolution économique et sociale : après la défaite du Japon, une lutte à finir s'engage entre, d'une côté les forces nationalistes bourgeoises, sous la direction de Tchang Kai Chek et , de l'autre, les forces populaires (ouvrières et paysannes) gagnées à la cause du socialisme. En 1949, la Chine nationaliste s'effondre et les communistes chinois proclament la République populaire de Chine. À partir de ce moment-là, la Chine conclut une étroite alliance avec l'URSS, soutient la lutte de la Corée du Nord et se montre favorable à Ho Chi-Minh, dirigeant de la lutte de libération nationale du Vietnam.
|
|
C'est à partir de cette nouvelle situation que s'opère en Chine une série de transformations sociales et économiques favorables aux paysans, aux ouvriers et au peuple en général. Tout comme pour la révolution russe, ou la révolution cubaine dix ans plus tard, on observe, d'un côté des changements importants des conditions de travail et de vie (éducation, santé, bien-être...) et de l'autre, une meilleure organisation des classes populaires (la presque totalité des travailleurs sont syndiqués, les femmes ont aussi leurs organisations...) dans les différentes sphères d'activités, meilleure organisation qui permet à ces classes populaires de transformer leurs aspirations en revendications concrètes et leurs revendications en réalisations concrètes. Ce qui n'est évidemment pas obtenu sans difficultés : problèmes avec la bureaucratie, contradictions à résoudre entre les différentes couches du peuple (entre ceux qui sont à la ville et ceux qui sont à la campagne...).
Mais qu'apporté de spécifique au projet socialiste la révolution chinoise? De cette révolution, retenons d'abord :
1) qu'elle a mis en relief le rôle actif et positif des paysans dans la luttepour le socialisme : à la faveur d'une guerre populaire de libérationnationale, les paysans ont été une force sociale directement impliquéedans le processus de construction du socialisme — ce qui allait àrencontre des conceptions dominantes dans le mouvement ouvrierinternational —.
Retenons ensuite de cette révolution :
2) la volonté explicite de trouver des solutions à des problèmes de fondauxquels la révolution russe n'avait pas répondu de façon satisfaisante :la question de la division entre villes et campagnes, la question de ladirection du parti et des méthodes bureaucratiques du travail du parti vis-à-vis des masses populaires et de leurs organisations.
En résumé on peut dire qu'en Chine, le projet socialiste a tenté d'opérer, si l'on peut dire ainsi, une révolution dans la révolution :
|
|
Toutefois, les 4 ou 5 dernières années révèlent des reculs importants, précisément sur les points où la révolution chinoise avait su faire progresser le projet socialiste : critique du rôle du parti et de l'Etat dans ses rapports aux organisations autonomes des masses populaires, décentralisation du pouvoir politique...
En fait, la critique du stalinisme en Chine est toujours demeurée empirique et partielle : elle a porté sur des points précis tels que la méthode de direction du parti, le refus d'un modèle autoritaire de développement à la campagne... Mais jamais l'ensemble du processus de retour en arrière du socialisme en URSS sous Staline n'a été analysé sous tous ses aspects ni critiqué de façon ouverte et publique. C'est ce qui peut, en partie, expliquer qu'aujourd'hui, on revienne en arrière : réaffirmation du rôle dirigeant du parti et de l'État sur les masses, rétablissement des hiérarchies dans les salaires... (26)
En Chine on a donc tenté à travers une révolution culturelle de résoudre la question du pouvoir ouvrier et populaire — tout comme ce fut le cas dans la Russie de 1917 et dans la Commune de Paris en 1871 —. Mais les formes, les conditions et les moyens de ce pouvoir autonome des masses demeurent encore à trouver. Pas plus là qu'ailleurs, il n'y a de modèle enfin trouvé. Mais là comme ailleurs il y a un apport particulier et une expérience à analyser pour en tirer toute la richesse.
D'autres expériences socialistes ont eu cours sur la scène internationale dans les 20 dernières années : les plus importantes ont sans doute été les révolutions cubaine (1959) et vietnamienne (1975). Dans un cas comme dans l'autre, deux peuples luttent contre la domination de l'impérialisme le plus puissant de l'après-guerre, les États-Unis d'Amérique.
Au cours des années '50, un mouvement de lutte armée s'engage contre la dictature de Batista. Les objectifs de départ de ce mouvement dirigé par Fidel Castro ne sont pas le socialisme mais bien le renversement de la dictature, l'instauration d'un régime démocratique et de dégagement de Cuba de l'emprise impérialiste américaine. Le 1er janvier 1959, l'armée rebelle prend le pouvoir à la Havane en détruisant le noyau de base de l'appareil d'État dictatorial, bourgeois et pro-impérialiste, qui était en place. Batista est défait et la guérilla sort victorieuse parce que la mobilisation des masses populaires l'avait accompagnée tout au long de la lutte. À partir de là, le Mouvement du 26 juillet, mouvement qui regroupe l'ensemble des tendances opposées à Batista mais dont la composante révolutionnaire joue un rôle décisif, entreprend la réalisation des premières tâches anticapitalistes. La première véritable réforme agraire de toute l'Amérique latine est ainsi mise en marche dès le début du processus révolutionnaire : élimination de la propriété terrienne, remise des terres aux paysans, organisation du commerce agricole sans intermédiaires capitalistes. Puis c'est la nationalisation des principales industries dans le cadre d'une mobilisation générale de tout le pays dans la défense de la révolution pour faire face à la contre-offensive des État-Unis, son blocus économique et ses interventions armées (attaque de la Baie des Cochons en 1961...). C'est également la lutte entreprise contre l'analphabétisme qui, en un peu plus d'un an, sera presque complètement éliminé (à cette date près de 25 % de la population ne savait ni lire, ni écrire).
Cette lutte de libération nationale entreprise contre l'impérialisme américain, à 90 milles seulement de ses côtes, fournira une nouvelle impulsion à de nombreux mouvements, groupes et militants dans toute l'Amérique latine. Dans les années '60, Cuba réactualise la révolution en débordant largement ses frontières : il produit ses effets jusque dans les pays capitalistes développés où une partie du mouvement étudiant et des jeunes en général découvre l'engagement politique à travers la solidarité avec Cuba et l'Amérique latine (et à travers la solidarité avec le peuple vietnamien en guerre).
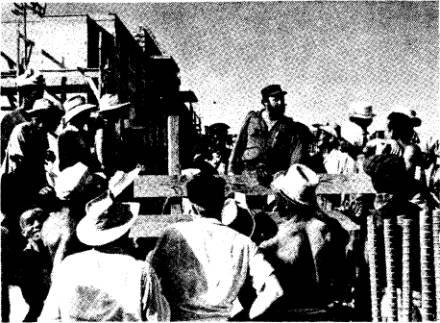
Fidel Castro avec les ouvriers d'un chantier de bâtiment.
Cet effet sur le mouvement ouvrier et populaire en Amérique latine et dans les pays capitalistes avancés n'est pas dû au hasard : la révolution cubaine, partie d'objectifs limités comme l'instauration d'un démocratie politique sur l'île, fait le choix de s'engager dans un processus de transformation sociale en profondeur en misant sur les masses populaires elles-mêmes. La constitution en 1960-61 de comités de défense de la révolution (C.D.R.) à travers le pays fournira au peuple cubain le cadre minimal requis pour participer activement au processus : l'éducation, la santé, l'habitation... l'ensemble des conditions de vie dans les quartiers sont l'objet d'une réorganisation à partir de ces comités. Puis l'organisation des travailleurs en syndicats sera généralisée, l'organisation des femmes dans tous les secteurs et dans tous les coins du pays dans le cadre d'une fédération nationale sera également à l'ordre du jour... Les années '60 seront aussi l'occasion d'un long débat économique sur la planification, la participation des travailleurs à ce plan, et la meilleure manière de contrer la bureaucratisation du développement économique, débat au cours duquel l'apport de Che Guevara sera central. Cuba des années '60 c'est aussi l'internationalisme conséquent, le soutien aux luttes en Amérique latine et dans le monde, l'importance vitale de « créer un, deux, trois Vietnam » pour disperser les énergies de l'adversaire (l'impérialisme U.S.A.) et ainsi l'affaiblir.
Toutefois, certaines faiblesses vont hypothéquer la révolution cubaine, hypothèque qui deviendra plus visible à partir des années '70 : 1) au début de sa révolution, Cuba avait su faire appel au soutien des pays du « bloc socialiste », URSS en tête, en conservant toute sa marge de manoeuvre dans la détermination de sa politique intérieure et internationale, particulièrement dans le débat économique initié par Guevara et dans la solidarité de Cuba avec les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine. Au fil des ans, des glissements progressifs s'opèrent cependant : l'approbation de l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS en 1968 marque un tournant sur les questions internationales tandis que l'établissement de stimulants matériels dans les entreprises (les travailleurs les plus productifs ont de meilleures facilités d'achat sur certains biens tels le réfrigérateur et la télévision), la remise à l'ordre du jour de la hiérarchie des salaires et des primes à la production indiquent au cours des années '70 que la politique économique se modifie au détriment de certains acquis.
Là, comme en Chine ou ailleurs, la lutte pour le socialisme n'est pas à l'abri de certains échecs, voire même de certains reculs importants. Mais à Cuba comme ailleurs il y a des tendances contradictoires qui sont à l'oeuvre et donc des possibilités de contrer ces reculs : la démocratisation syndicale, initiée en 1970-71, en fournit un bon exemple, car à partir de cette période les dirigeants syndicaux ne sont plus désignés, dans bon nombre d'entreprises, par le parti mais élus par les travailleurs, permettant ainsi une relative autonomie des organisations syndicales par rapport au parti.
|
|
Le Vietnam a d'abord été sous l'emprise du colonialisme français jusque dans les années '50, plus précisément jusqu'aux accords de Genève en 1954 qui divisait le Vietnam en deux (Vietnam nord, socialiste, et Vietnam sud) mais consacrait en même temps l'échec définitif de la France en Asie du Sud-Est. Les États-Unis n'allaient cependant pas tarder à prendre la relève en soutenant le régime sud-vietnamien. La lutte du Vietnam prend alors dans les années '60 une tournure différente : son adversaire est plus puissant, la portée de la lutte plus stratégique. Plus que jamais la lutte de libération nationale du Vietnam prend l'avant-scène sur le plan international. Après plus d'une décennie de lutte contre la domination américaine, le Vietnam réussit à vaincre la plus puissante machine de guerre de tous les temps ; 1975 marque un tournant qui rend possible la réunification du Nord et du Sud.
Dans la lutte pour le socialisme, la révolution vietnamienne s'apparente à la révolution cubaine et à la révolution chinoise : 1) elles ont en commun d'être des luttes de libération nationale (contre l'impérialisme) qui ont pris la forme d'une guerre populaire dans des pays dits du Tiers-Monde ; 2) elles ont en commun d'avoir, tour à tour,rejeté la politique de coexistence pacifique proposée par l'URSS et voulu, à la mesure de leurs moyens, développer une politique indépendante tant sur le plan national qu'international.
Ainsi pour le Vietnam, la guerre populaire a signifié la prise en charge directe par le peuple des différents niveaux de la lutte : réalisation d'une vaste réforme agraire, élimination de l'analphabétisme, constitution de communes populaires dans les zones libérées (du temps de la lutte contre la dictature de Thieu au Sud-Vietnam), la consolidation d'une armée populaire de libération... Et sur le plan international, la recherche de l'aide active autant de l'URSS que la Chine, sans alignement sur l'un ou l'autre de ces deux pôles.
Cependant, ces dernières années ont vu la remise en question de certaines politiques antérieures :
sur le plan international, un renforcement des liens du Vietnam avecl'URSS qui risque de lui faire perdre son indépendance politique. Mais làaussi les jeux ne sont pas faits définitivement...
Avons-nous, avec ces deux dernières expériences socialistes (cubaine et vietnamienne), fait le tour de l'histoire du socialisme dans le mouvement ouvrier international ? Oui et non. Il faut indiquer ici les limites de ce que nous avons présenté. Nous nous en sommes tenus :

Elles luttent dans l'armée de libération pour chasser les Américains de leur pays. Ce sera cette guerre jusqu'à la libération en 1975.

Il y a donc un certain nombre d'oublis volontaires qui ne doivent cependant pas échapper au lecteur :
Il faut aussi signaler certains échecs cuisants du mouvement ouvrier dans sa lutte pour le socialisme qui doivent faire l'objet de réflexions en profondeur — ce qui est cependant impossible dans le cadre de ce texte
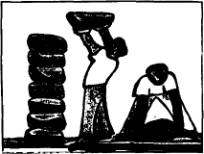
À partir de cet ensemble d'événements, de mouvements sociaux et de révolutions, de quoi disposons-nous pour cerner de plus près ce qu'est le projet socialiste?
En premier lieu, il nous faut conclure que le socialisme a été historiquement porté par la classe ouvrière, ses organisations syndicales, ses organes de pouvoir ouvrier et populaire et ses partis politiques, et que le socialisme est issu de forces sociales dirigées par les noyaux ouvriers, intellectuels et paysans les plus radicaux.
Ces forces sociales, par leur pensée et leur pratique, nous permettent aujourd'hui de disposer d'un ensemble de références historiques et idéologiques qui peuvent éclairer nos choix politiques, nos engagements, notre militantisme, notre lutte :
A. Un ensemble de références historiques qui nous indiquent certainesnécessités dans la lutte pour le socialisme, à savoir,
B. Un ensemble de références idéologiques sur lesquelles nous pourronsprendre appui, même si elles sont parfois contradictoires. La pensée deMarx, de Lénine, de Trotsky, de Gramsci, de Mao... peut inspirer notreréflexion. Par exemple, les notions d'hégémonie et de bloc socialintroduites par Gramsci sont susceptibles d'alimenter notre réflexion surla capacité les conditions et les moyens que doit avoir le mouvementouvrier dans sa lutte pour le socialisme dans des pays capitalistes avancés(c'est-à-dire où le niveau d'industrialisation est très développé, ladémocratie politique relativement enracinée dans la société...) (27)
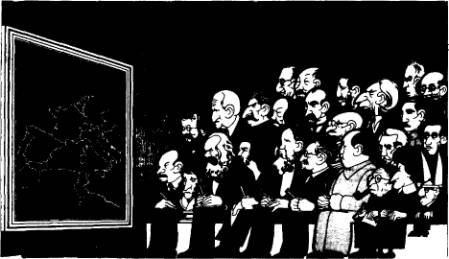
En second lieu, l'histoire du socialisme dans le mouvement ouvrier international nous révèle — une fois admis l'apport propre de chaque révolution ou mouvement social — la diversité des courants, voire les divergences profondes entre courants se rattachant au socialisme :
A. Avec la 2e Internationale devenue aujourd'hui l'Internationalesocialiste, la permanence dans bon nombre de pays (Suède, Allemagne,Angleterre...) d'un courant social-démocrate qui, depuis la 1ère GuerreMondiale, s'est inscrit dans un processus de dé-radicalisationprogressive, tombant souvent même dans le réformisme le plus plat. Entémoigne l'évolution du Parti social-démocrate allemand. (28)
B. Avec la 3e Internationale et la révolution russe, l'enracinement dansbon nombre de pays également d'un courant communiste pro-soviétique(France, Italie, Espagne, Portugal, Chili...). Ce courant, à bien deségards, est aujourd'hui contesté à gauche,(29)
C. Avec la 4e Internationale, c'est l'apparition d'un courant trotskistedans le mouvement ouvrier, qui cherche à se développer à la gauche dessociaux-démocrates et des communistes (pro-soviétiques). Existantdepuis 40 ans, ce courant est cependant resté figé dans le temps, commefixé sur la révolution russe vue sous un certain angle : Trotsky, lesconseils ouvriers et la bureaucratie, l'État ouvrier dégénéré...
D. Avec la rupture entre la Chine et l'U.R.S.S. au début des années '60l'apparition d'une variante du courant communiste pro-soviétique, lecourant "m-1" ou courant communiste pro-chinois et pro-albanais. Cecourant se réclame de l'héritage de la 3e Internationale et, toutparticulièrement, du stalinisme. Courant marginal dans la plupart despays où le mouvement ouvrier a de fortes traditions politiques à gauche(en France, en Italie, en Espagne, au Chili...), il a su déployer tous sestalents de reproducteur des erreurs les plus marquantes du mouvementcommuniste : suivisme sur les questions internationales, conceptiondogmatique du marxisme, reconnaissance du parti unique et de la théoriede la courroie de transmission...
De façon plus dynamique, on pourrait avancer la proposition suivante : le projet socialiste progresse par bonds. Après la Commune de Paris en 1871, c'est la révolution russe qui redonne au mouvement ouvrier son élan et des perspectives après une période de réformisme. Mais le stalinisme fait retomber pendant plus de 30 ans le projet socialiste dans l'étatisme en étouffant toute tentative d'instaurer une démocratie ouvrière et populaire dans les différentes sphères d'activités de la société. Cependant, à partir des années '60, la combinaison active de luttes antiimpérialistes dans les pays du « Tiers-Monde » (Vietnam, Cuba...) et d'une forte contestation sociale du système dans les pays capitalistes

Arrivée des étudiants aux usines Renault à Billancourt (mai 68).
occidentaux (mai 1968 en France, (30) l'automne chaud en Italie en 1969...) redonneront au projet socialiste de nouvelles perspectives, et la possibilité pour la gauche de se reconstituer en des termes nouveaux.
Une nouvelle gauche apparaît dans le mouvement ouvrier international suite à ces luttes anti-impérialistes dans le « Tiers-Monde » et à ces luttes sociales dans les pays capitalistes occidentaux. Cette gauche cherche à réouvrir les perspectives de lutte en sortant des sentiers battus par les courants antérieurs (« m-1 », trotskiste...) sur quatre points qui nous paraissent fondamentaux dans la lutte pour le socialisme :
A. La théorie marxiste : stimuler son renouvellement par la prise encharge de problèmes tels que l'organisation capitaliste du travail, laquestion nationale, l'oppression des femmes..., par l'ouverture auxmilitants qui ont une formation idéologique différente (cas des chrétiensde gauche par exemple), par la critique systématique de l'héritagestalinien qui considère la théorie marxiste comme un corps de doctrineachevé plutôt que comme une théorie qui s'enrichit constamment.
B. Les pratiques politiques et syndicales : stimuler leur renouvellementpar la remise en question de la tradition de la 2e et de la 3e Internationalequi séparent l'économique du politique et opèrent une divisionsupposément « naturelle » des tâches : la politique au parti,l'économique au syndicat, la lutte offensive par le parti, la lutte défensivepar le syndicat, le rôle d'avant-garde au parti, le rôle d'organisation demasse au syndicat. Et le présupposé qui va avec cela : une seule classe, unseul parti, un seul syndicat. (31)
C. L'internationalisme : stimuler le renouvellement de la conception etdes pratiques de solidarité internationale en refusant de subordonnercette conception et ces pratiques aux politiques d'un État-guide ou d'unparti-père, en prenant en compte la crise actuelle du projet socialiste(multiples courants...) et donc en refusant de reconnaître un pôle uniquede référence en cette matière, mais en appuyant tous le mouvements etorganisations qui ont une perspective de classe dans leur lutte contre lecapitalisme.
|
|
Nous avons jusqu'ici avancé des considérations d'ordre général sur le socialisme : rupture avec le capitalisme ou abolition de la propriété privée des moyens de production et direction des travailleurs sur la société à partir d'organes de pouvoir ouvrier et populaire. Examinons de plus près comment ces repères peuvent s'exprimer concrètement sur le plan économique.
Sur le plan économique, la propriété collective de l'ensemble des moyens de production est évidemment centrale (sans cela on laisse à la bourgeoisie des possibilités de se reconstituer). Comment cela se manifeste-t-il? Cela s'est fait jusqu'à maintenant par la nationalisation des entreprises, opération que seul l'État est en mesure de réaliser. C'est d'abord la nationalisation des secteurs-clefs de l'économie : on ne commence pas par les « beaneries », les petites « shops » de vêtements... Ce sont les mines, les entreprise de métallurgie, l'électricité, les banques... Donc, nationalisation de ce qui est le plus stratégique sur le plan économique et stimulation d'un développement encore plus large des services de caractère public tels que la santé, l'éducation... Mais c'est aussi la nationalisation des secteurs qui véhiculent l'idéologie capitaliste, c'est- à-dire la radio, la télévision, le cinéma, la presse écrite. L'expérience de l'Unité populaire au Chili, par exemple, nous enseigne que le fait que ces moyens aient été entre les mains de l'opposition bourgeoise a finalement pesé lourd en freinant constamment l'offensive du mouvement ouvrier sur ce plan-là.
|
|
Précisons que les nationalisations sont l'affaire, à partir d'un nouvel État, de toute la société et pas seulement celle des travailleurs dans chaque entreprise. Ce ne sont pas les travailleurs de ces entreprises, considérées séparément les unes des autres, qui en deviennent les propriétaires. La propriété de ces entreprises relève de l'État. Toutefois, les travailleurs en sont collectivement les administrateurs, les gestionnaires, les directeurs dans le cadre d'un plan national de développement. Ce qui veut dire que la valeur nouvelle créée, mis à part les salaires et les paiements d'amortissement pour la machinerie ou l'achat de matières premières, est affectée, d'une part à des dépenses sociales (éducation, santé, logement...) et, d'autre part, à des investissements industriels ou commerciaux nouveaux.
La différence à ce niveau entre une économie capitaliste et une économie socialiste, c'est que les investissements sociaux et ceux de caractère industriel et commercial ne sont pas décidés par une minorité mais bien par une majorité — les travailleurs organisés — dans le cadre d'un plan général de développement, ce qui permet que ces investissements soient faits en fonction, non pas des profits d'une minorité, mais bien en fonction des besoins économiques et sociaux de la population. C'est dans ce sens qu'un plan dans le cadre d'une économie socialiste tient compte du développement inégal des différentes régions et tente d'y remédier en déplaçant les pôles de développement (dans le cas du Québec, par exemple, c'est la décentralisation par rapport à Montréal qui s'imposerait).
En ce sens, la première différence fondamentale entre une société capitaliste et une société socialiste, c'est que les profits, qui étaient appropriés par les capitalistes auparavant, sont désormais des fonds qui doivent faire l'objet de décisions collectives : il faut donc un plan où se décide démocratiquement la répartition de ces fonds, en fonction des besoins, en tenant compte du développement inégal des différentes régions et secteurs...
Une économie socialiste suppose donc au point de départ la réalisation combinée de trois choses :
3) la prise en charge par les travailleurs, avec l'aide de l'État, del'élaboration et de la réalisation de cette planification à partird'organisations qui leur appartiennent et qui sont dûment constituées àcet effet. Ce contrôle par les travailleurs du développement économiquedoit aussi être complété par un contrôle populaire, par un contrôle desautres secteurs de la population qui sont également concernés par lesmesures prises au niveau économique.
Mentionnons immédiatement un problème auquel ont été confrontées les sociétés qui se disent socialistes : celui d'avoir réduit les rapports capitalistes de production à la propriété privée des moyens de production et donc à l'exploitation par l'extorsion aux travailleurs du fruit de leur travail, la plus-value. On a ainsi laissé de côté, dans l'analyse du système capitaliste, l'oppression ou la domination inhérente au système d'exploitation, la division entre le travail intellectuel et le travail manuel, entre cadres et exécutants (la forme la plus connue et la plus achevée de cette oppression, c'est le taylorisme). (33) La prise en charge par les travailleurs de l'élaboration du plan est très liée à la connaissance d'ensemble de l'entreprise et à la compétence (savoir technique) qu'auront ou que pourront avoir les travailleurs.
|
|
Il faut donc retenir :
C'est dans la mesure où ces trois éléments se renforcent mutuellement que l'on peut véritablement parler d'une société socialiste c'est-à-dire d'une société où la répartition de la plus-value s'effectue sur la base de choix conscients de la collectivité nationale et des différents collectifs d'entreprises, choix qui peuvent aussi aller dans le sens d'un questionnement de l'orientation générale de l'économie d'un pays (questionnement de l'impératif de la croissance, du développement industriel sans considération pour l'environnement...).
Mais le socialisme ne se réduit pas non plus à un État planificateur, à la participation des travailleurs à ce plan, et à la mise en oeuvre de réformes sociales (dans le domaine de l'éducation, de la santé...) liées à ce plan. C'est là l'idée limite que s'en font les sociaux-démocrates et une partie du mouvement communiste. L'autre aspect du socialisme concerne le pouvoir politique.

Le socialisme ce n'est évidemment pas qu'une nouvelle façon d'organiser l'économie, il faut aussi, en liaison directe avec ce qui se passe au plan économique, opérer une réorganisation/transformation complète au plan politique, en prenant en compte le problème permanent de toutes les expériences socialistes : la bureaucratisation de l'État.
Si, d'un côté, il est nécessaire d'avoir un État fort pour rendre possible l'abolition de la propriété privée des moyens de production à partir de nationalisations et d'un plan, il faut également que des forces travaillent au dépérissement de cet État, c'est -à-dire que se développent toutes les formes réalisables de démocratie directe des travailleurs. Ce développement du pouvoir ouvrier et populaire suppose la reconnaissance du droit à l'existence de plusieurs partis politiques à l'intérieur du mouvement ouvrier, l'indépendance des syndicats, le développement d'organes autonomes de contrôle ouvrier et populaire, la liberté d'expression dans les arts, les sciences...
Déjà, en 1918, Rosa Luxembourg signalait la pente que pouvait prendre la révolution russe dans les termes suivants :
« Mais si l'on étouffe la vie politique dans tout le pays, la paralysie gagne obligatoirement la vie dans les soviets (conseils ouvriers). Sans élections générales, sans liberté de presse et de réunion illimitée, sans une lutte d'opinion libre, la vie s'étiole dans toutes les institutions publiques, végète, et la bureaucratie demeure le seul élément actif » (34).
À la lumière de l'expérience russe (de sa dégénéresence) et de l'expérience de tous les pays qui se disent socialistes (la constitution d'une classe bureaucratique), à la lumière également de ce que Marx dans La Guerre civile en France et Lénine dans L'État et la Révolution avançaient sur le socialisme, il faut mettre en relief l'importance du développement de toutes les formes de démocratie directe des travailleurs et donc du pouvoir d'État émanant des masses et contrôlé par elles.
La question de la démocratie ouvrière, du pouvoir ouvrier et populaire est, dans la tradition marxiste tout comme dans les expériences de rupture avec le capitalisme (la Commune de Paris, la Révolution d'octobre...) partie constitutive de cette période nouvelle dans laquelle s'inscrit une société qui veut construire le socialisme. C'est le deuxième versant du projet socialiste : d'un côté, il faut un État fort pour lutter contre le capitalisme de même que des partis politiques pour indiquer une direction au processus de rupture, de l'autre, il faut des organes de pouvoir ouvrier et populaire indépendants de ces partis et de cet État évoluant en interaction avec ceux-ci.
Cette question du pouvoir ouvrier et populaire demeure finalement encore à résoudre malgré la tentative chinoise de révolution culturelle, la tentative yougoslave d'autogestion, la tentative vietnamienne d'instaurer des communes populaires et la tentative cubaine de constituer au niveau local et régional des organes de pouvoir populaire. Ces tentatives révèlent cependant la richesse et la profondeur de cette dimension dans la construction du socialisme. Elle révèle aussi que les régimes qui se disent socialistes ne le sont pas encore véritablement même s'ils ne sont plus des régimes capitalistes.
Finalement ' le projet socialiste fait aussi appel à l'organisation d'une véritable révolution culturelle, c'est-à-dire un ensemble de transformations qui permettent l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, l'égalité réelle entre les différentes couches de travailleurs (lutte contre la division entre travail intellectuel et travail manuel, lutte contre les écarts de salaire...), le développement d'une culture propre à la société socialiste (solidarité, égalité...). Il ne saurait donc y avoir de société socialiste si cette société n'arrive pas à prendre en charge la lutte contre l'oppression des femmes, la lutte contre la division entre travail manuel et intellectuel...
Il faut enfin indiquer que le socialisme est, dans le mouvement et la pensée marxiste, une société de transition entre le capitalisme et le communisme : l'objectif ultime, c'est de construire une société sans classe où les travailleurs associés librement disposeront de leurs moyens de production et du produit de leur travail dans l'intérêt de l'ensemble du peuple, abolition donc non seulement du capital mais aussi du travail salarié. Mais cette société, tout en étant de transition, doit opérer des tournants qualitatifs, à la fois sur les plans économique, politique et culturel en rendant possible :
Lors de leur congrès,de septembre '78, le syndicats de la CSN, dans la région de Québec, étaient invités par le président de leur Conseil central à s'ouvrir à l'idée du socialisme dans les termes suivants :
« Dans l'état actuel de nos connaissances, le socialisme est ce qui rend le mieux l'idée d'une société où les travailleurs ne seraient plus le jouet d'une minorité de patrons... une société où l'avenir nous appartiendrait... Il demeure évidemment difficile, pour beaucoup d'entre nous, d'adhérer à de telles affirmations, en raison de tout ce qu'on a entendu sur les pays socialistes. À ce sujet, nous devrions comprendre tout d'abord que nous, nous vivons dans des régimes capitalistes qui n'ont naturellement pas intérêt à nous faire voir les bons côtés du socialisme, un peu comme nos patrons n'ont pas intérêt à faire de la publicité sur les merveilles du syndicalisme. Il faudrait se dire également que les expériences socialistes sont vécues par du monde comme nous autres, ni plus fous, ni plus fins, avec des niveaux de conscience différents, avec leur qualités et leurs défauts et que ces expériences ont pris toutes sortes de couleurs. Cependant,les variantes et même les déviations du socialisme n'enlèvent rien à la richesse de l'idée fondamentale, de la même manière que les différentes applications et même les erreurs du syndicalisme ici n'enlèvent rien au fait que, dans un milieu de travail, c'est mieux d'avoir un syndicat que de ne pas en avoir (35). »
Cette affirmation du président du Conseil central de Québec (CSN) qui qui pourrait être à la fois l'introduction et la conclusion de ce dossier, illustre très bien que nous n'en sommes qu'à nos débuts sur cette question.
Après quelques décennies où il n'a pas été débattu du socialisme dans la presque totalité du mouvement ouvrier au Québec et au Canada, la fin des années '60 et le début des années '70 ont vu cette question être réintroduite, surtout au Québec. Plusieurs événements au Québec ont amené cette radicalisation idéologique et politique : la lutte pour le français langue de travail et d'enseignement, la lutte pour l'indépendance du Québec, la lutte contre l'occupation armée du Québec en 1970, la lutte du Front commun du secteur public et para-public en 1972, la publication d'une série de manifestes par les trois principales centrales syndicales... (36)
Plusieurs documents ont circulé et ont fait l'objet de débats à partir surtout de 1972-73. Certains, notamment à la CSN, ont permis d'identifier un certain nombre de points de repère pour rendre un projet socialiste réalisable au Québec :
1.La lutte contre l'oppression nationale et pour l'indépendance politiquedu Québec (considéré comme objectif constitutif d'un projet socialiste) ;
2. La lutte pour la construction d'une organisation politique detravailleurs ;
Le projet socialiste dans le mouvement ouvrier québécois demeure encore très général, il n'est partagé que par une partie seulement du mouvement et essentiellement par des organisations syndicales. Le mouvement ouvrier québécois demeure également relativement pauvre au niveau des stratégies de lutte pour le socialisme et des moyens pour y arriver (38).
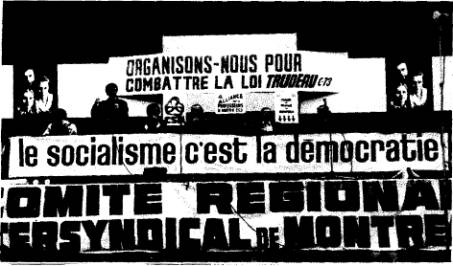
Les syndicats et la lutte pour le socialisme.
Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour, entre autres choses, approfondir les implications concrètes de la lutte pour le socialisme en plein coeur de l'Amérique du Nord en convergence avec les embryons du mouvement socialiste au Canada et aux État-Unis. Reste aussi à examiner de plus près les particularités de cette lutte ici :
Reste aussi à faire le bilan de la gauche au Québec depuis une quinzaine d'années (la gauche syndicale et populaire... et la gauche politique).
Telles sont quelques-unes des tâches que nous avons à relever comme militants, en nous inspirant de la lutte du mouvement ouvrier pour le socialisme, entamée il y a plus de 150 ans.
Appui d'associations de travailleurs à la lutte des Patriotes (1837)
Premiers écrits socialistes : Owen en Angleterre, Saint-Simon et Fourier en France...
Chevaliers du Travail (1882)
International Workers
of the World (1905)
Formation du Parti
ouvrier ( 1899) et du Parti social-démocrate (1911)
DANS LE MONDE
Manifeste du Parti communiste (1848)
Création de la 1re Internationale (1864-1876)
Commune de Paris (1871)
Fondation de la 2e Internationale (1889...)
PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1917)
AU QUEBEC/Canada
One Big Union (1919)
Formation du Parti communiste canadien (1921)
Formation d'un parti social-démocrate (le ' CCF en 1932 : ancêtre du NPD)
DANS LE MONDE
Rupture au sein de la 2e Internationale
Révolution d'octobre en Russie (1917)
Naissance des partis communistes et de la
3e Internationale (1919-1943)
Montée du fascisme en Italie (1922) et en
Allemagne (1933)
Guerre civile espagnole (1936-1939)
Fondation de la 4e Internationale (1938)
SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945)
AU QUEBEC/Canada
Courant indépendance et socialisme avec le P.S.Q., le M.L.P. et Parti-Pris, la L.S.O., F.L.P., (années '60)
FRAP, Front commun de 1972, Manifestes des centrales...
Naissance d'organisations « m-l » et trotskystes
DANS LE MONDE
Révolution chinoise (1949)
Révolution cubaine (1959)
Révolution vietnamienne (1953 et 1975)
Unité Populaire au Chili (1970-1973)
Libération nationale en Afrique australe : Guinée-Bissau, Mozambique, Angola
Luttes sociales dans les pays capitalistes occidentaux ; mai '68 en France, automne chaud en Italie (1969)
|
|
Le socialisme ne se construit pas à l'échelle de la société sans que les travailleurs, dans leur secteur, dans leur milieu, dans leur entreprise, n'entreprennent un processus qui va dans cette direction. En 1972, sous le gouvernement de l'Unité populaire du Chili,(39) avec quelques militants québécois, nous avons eu l'occasion de visiter une entreprise en voie d'autogestion, l'usine Montero de Santiago. Voici, en bref, ce que nous avons vu et ce que ces travailleurs nous ont raconté.
Montero est une usine de fabrication de meubles qui emploie 400 travailleurs (320 ouvriers et 80 employés de bureau). Cette usine, fondée en 1946, a appartenu à la famille Montero jusqu'à la fin de l'année 1970. En 1972, elle était en voie d'autogestion. Comment les travailleurs de cette usine en sont-ils arrivés là?
En 1967, les deux syndicats (celui des ouvriers et celui des employés de bureau) mènent une grève qui dure 44 jours. La grève est dure; les travailleurs retournent au travail sans avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Après cette grève-échec, un groupe de militants de l'usine commencent à se questionner sur le pourquoi de cet échec, mettant à contribution un professeur et quelques étudiants en sociologie de l'Université. La première question qui se pose est celle de savoir à quoi sert le syndicat. On pèse ses limites. De fil en aiguille, on se met à rebrasser l'organisation capitaliste de l'entreprise : qui fait les profits ? combien ? grâce à qui ? qui fixe les prix ? qui détermine les cadences du travail ?... pour conclure peu à peu à la nécessité pour les travailleurs, non seulement d'exiger de meilleurs salaires, mais d'en arriver à faire disparaître ce type d'organisation (avec des patrons, une hiérarchie dans l'entreprise, des écarts énormes de salaires entre ouvriers et employés, etc.). Ce qui fait dire à l'un d'eux : « Si aucun parti comme tel ne nous a aidés dans notre
réflexion, nous savons cependant que seule la réalisation du socialisme peut nous libérer ». On se met dès lors à l'action en contestant l'organisation du travail et la façon dont l'usine est gérée. Cela, par la publication d'un journal anomyme et en suscitant le débat lors des assemblées syndicales. Jusqu'au moment où l'U.P. prend le pouvoir, trois ans après cette grève. Entrée au pouvoir qui suscite dans plusieurs entreprises le boycottage de la production. À l'usine Montero c'est le cas :le patron menace de mettre à pied 50 travailleurs, il n'achète plus de matières premières et veut vendre sa machinerie pour aller investir ailleurs. Les syndicats font des démarches auprès du ministère de l'Économie pour que l'usine soit nationalisée. La lenteur des démarches auprès du ministère et la situation de crise à l'intérieur de l'usine amènent les ouvriers à vouloir agir rapidement : on décide de s'emparer de l'usine et de la faire fonctionner sans les patrons, ce qui entraînera par la suite la nationalisation.
|
|
Après plusieurs débats, en assemblée générale, pour donner à l'usine un nouveau statut, on en arrive à se donner une nouvelle conception de l'usine : « On considère que l'usine est la propriété de l'État, qu'elle doit être administrée par les travailleurs et qu'elle est au service du peuple chilien », nous dit un travailleur de l'usine.
Mais comment gérer l'usine sans patrons et sans contremaître? L'assemblée des travailleurs décide de constituer des comités de production dans chaque département (il y en a 5) et d'élire des travailleurs sur ces comités, quitte à les critiquer s'ils se comportent comme les anciens contremaîtres. Chaque département ayant élu des représentants, on met aussi sur pied un comité de coordination général, comprenant des membres des comités de production et des deux syndicats. Reste que, pour coordonner l'organisation du travail, il faut des compétences précises. L'ancien gérant général qui, dans tout le remue-ménage, s'est solidarisé avec les travailleurs, se voit confier de nouveau la tâche qu'il exerçait auparavant. Il est cependant contrôlé, désormais, par un conseil d'administration composé de sept personnes : un représentant de l'État et six travailleurs (deux élus par le syndicat ouvrier, deux élus par le syndicat des employés de bureau et deux élus par l'assemblée générale).
Et qu'est-ce que tout ça a permis de changer ? La réponse est immédiate : « Avec cette participation, personne ne reçoit plus d'ordres d'un contremaître. Cependant, les règlements que se sont donnés les travailleurs en assemblée générale doivent être respectés. Quatre personnes sont congédiées pour ne pas avoir voulu respecter les nouvelles règles du jeu. On élimine peu à peu les divisions entre employés et ouvriers : diminution de l'écart de salaires entre les deux catégories, on parle d'une fusion possible des deux syndicats... On a augmenté la productivité de 20 % et créé 60 % emplois. On a éliminé la concession privée de la cafétéria de l'usine et il existe un magasin en ville pour la vente des meubles qui étaient auparavant vendus par des commerces privés. On comprend qu'on travaille au service du pays et non au service d'un capitaliste ».
Par la suite, en circulant dans l'usine, nous demandons si les tâches les plus dures sont remplies par les mêmes travailleurs qu'auparavant. Nous apprenons que depuis un an, un système de rotation des tâches a été établi.
Que conclure, sinon qu'il s'agit là d'une entreprise où la conscience politique des travailleurs était particulièrement avancée. Ce que nous avons recueilli, c'est le témoignage d'une avant-garde. Ceci donne néanmoins une image concrète, bien que partielle, des possibilités effectives des travailleurs de gérer leurs entreprises lorsque certaines conditions de base sont remplies. Cette expérience révèle bien que, si les patrons ont toujours besoin des travailleurs, les travailleurs, eux, n'ont pas besoin de patrons.

|
|
Cette bibliographie sur la lutte pour le socialisme et sur le PROJET SOCIALISTE tel qu'il se dessine à travers l'histoire du mouvement ouvrier n'est évidemment pas complète. Néanmoins, nous vous présentons plus d'une quarantaine de titres sélectionnés sur la base des critères suivants :
1. Leur valeur scientifique, surtout du point de vue historique : une certaine rigueur dans l'exposé, une démonstration cohérente et méthodique...
2 Leur valeur politique d'un point de vue militant : contribution qui fait avancer la réflexion sur le thème développé, prise de position en faveur du socialisme sans partisanerie étroite...
3. Leur relative accessibilité : de lecture aisée.
Chacun des ouvrages proposés est accompagné d'un bref commentaire qui veut aller à l'essentiel, c'est-à-dire fournir des indications se rapportant aux critères ci-haut mentionnés. La bibliographie est présentée par thème de façon historique.
Marx, K., La guerre civile en France, Oeuvres choisies, Ed. du Progrès. Moscou, 1975, 60 p.
« La guerre civile en France » est un bilan de l'expérience de la Commune. Marx en conclut que la Commune est la forme enfin trouvée de l'émancipation de la classe ouvrière. Cette conclusion survient après qu'il ait clairement posé que la classe ouvrière ne peut se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État pour le faire fonctionner à son compte. Selon Marx, l'expérience de la Commune suggère en effet de briser l'Etat bourgeois et de lui substituer des organes de démocratie ouvrière (conseillers municipaux élus et révocables en tout temps, organisation armée du peuple...).
Revue Mouvement social, La Commune de 1871 (Acte du colloque de Paris en mai 1971), numéro spécial avril-juin 1972.
Une approche de la Commune par les meilleures historiens français spécialistes du mouvement ouvrier de cette période.
Rougerie, J., Paris libre (1871), Paris, 1971, Seuil, 288 p.
La plus récente mise au point d'un des meilleures spécialistes de la Commune.
La 1ère Internationale ou Association internationale des Travailleurs (A.I.T.) : 1864-1876
Labrousse, E., La première Internationale (l'institution, l'implantation, le rayonnement), Paris, Ed. du CNRS, 1969.
Écrit en collaboration sous la direction d'E. Labrousse, historien français, spécialiste du mouvement ouvrier européen du siècle dernier. Un des rares ouvrages en français qui analyse cette 1ère Internationale.
La 2e Internationale (1889-1914)
Kriegel, A., La 2e Internationale (1889-1814), dans Histoire générale du socialisme, sous la direction de J. Droz, tome 2, de 1875 à 1918, PUF, 1974, Paris, pp. 555 à 584, (disponible pour consultation au Centre de formation populaire).
En 30 pages, un tour d'horizon rapide de cette internationale par un historienne française connue pour ses ouvrages sur le mouvement communiste en France des origines jusqu'à nos jours (ex-militante communiste).
CFP, La social-démocratie dans l'histoire du mouvement ouvrier international, Y. Vaillancourt, 1978, 22 p.
CFP, Social-démocratie : l'Allemagne, P. Beaulne, 1978, 70 p. CFP, Social-démocratie : La Suède, C. Chatillon, 1978, 40 p.
Pour une analyse critique de la 2e Internationale à partir de la 2e Guerre Mondiale jusqu'à nos jours ; trois textes du Centre de formation populaire issus d'une réflexion collective et d'un débat sur ce thème en 1977.
La 3e Internationale ou Internationale communiste (1919-1943)
Claudin, F., La crise du mouvement communiste, Maspero, 1972, Paris, tome 1, 364 p., tome 2, 404 p.
F. Claudin a été pendant plus de 30 ans dirigeant de premier plan à l'intérieur du mouvement ouvrier espagnol. Il a été exclu du comité central du Parti communiste espagnol (PCE) et du Parti en 1964 pour critique de gauche. F. Claudin est l'auteur de la première analyse marxiste de l'histoire de la 3e Internationale. Il connaît ce dont il par le de par ses 30 années de militantisme à l'intérieur de ce mouvement. Il en parle durement et avec force : ses critiques sont incisives en posant, notamment, de façon frontale le problème du stalinisme. Son ouvrage est une analyse des différentes étapes et des tournants du mouvement communiste de 1919 jusqu'à la fin de la 2e Guerre Mondiale.
La 4e Internationale (1938-...)
Critique communiste, Actualité de Trotsky et 4e Internationale, numéro spécial de la revue, 4e trimestre 1978.
Ce numéro de la revue Critique communiste est une présentation de la 4e Internationale et de l'actualité de Trotsky par des dirigeants de cette organisation.
Les internationales (en général)
Kriegel, A., Les internationales ouvrières, Paris, PUF, 1964, Que sais-je? #1129, 125p.
Tour d'horizon rapide des trois internationales. Information historique précieuse mais appréciation politique désinvolte des hauts et des bas de l'internationalisme vécu à travers l'histoire des trois internationales.
PSU, Les bases de notre internationalisme, Paris, 1976, (disponible au centre de documentation de Solidarité Québec-Amérique latine)
En 10 pages, quelques conclusions politiques pour aujourd'hui à partir de l'expérience de chacune des internationales.

1. Point de vue des principaux dirigeants révolutionnaires de cette période Lénine, V., La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, Oeuvres choisies, tome 3, Ed. du Progrès, Moscou, 1975.
Au-delà de la polémique avec Kautsky, alors dirigeant du Parti social-démocrate allemand, Lénine réitère la nécessité de renverser l'État capitaliste par la force pour instaurer le pouvoir de la classe ouvrière sur la société et identifie les soviets (conseils ouvriers) comme étant la forme que revêt, en Russie, le pouvoir de la classe ouvrière.
Luxembourg, R., La révolution russe, Oeuvres II (écrits politiques, 1917-1918), Petite collection Maspero, #41, pp. 55 à 90.
Polémiquant d'abord avec Kautsky en insistant sur le caractère international de la révolution russe, Rosa Luxembourg en vient néanmoins à critiquer Lénine et Trotsky, leur signalant le danger d'étouffer toute vie politique (liberté de presse, d'association...) en dehors des soviets et du Parti si certaines mesures de circonstances deviennent des mesures permanentes. Mais elle insiste aussi sur les mérites de cette révolution qui a ouvert la voie au socialisme et qui l'a mis à l'ordre du jour dans l'ensemble du mouvement ouvrier européen et mondial.
Trotsky, L., Histoire de la révolution russe, Paris, Seuil, 1967, tome 1, La révolution de février, 512 p., tome 2, La révolution d'octobre, 768 p.
Écrit en exil entre 1929 et 1932, ce livre de Trotsky tente de reconstituer l'événement dans toute sa complexité en cherchant en même temps à dégager les lois et les règles d'une situation
révolutionnaire. Un des fils conducteurs de l'ouvrage est évidemment la lutte contre Staline, devenu dirigeant incontesté après la défaite de l'opposition de gauche en U.R.S.S. Cette lutte idéologique de Trotsky cherche à prendre appui sur Lénine.
2. Point de vue à partir de quelques analyses marxistes contemporaines
Bettelheim, C., Les luttes de classes en U.R.S.S., tome 1, portant sur la période 1917-1923, Seuil/Maspero, 1974, tome 2, portant sur la période 1923-1930, Seuil/Maspero, 1977.
Au terme d'une recherche de plus de 10 ans, une des premières analyses marxistes d'ensemble de l'histoire et de la réalité russe de la période de Lénine (1917-1923) et des débuts de la période stalinienne (1923-1930). Par un des meilleures économistes marxistes français. Une analyse qui prend directement appui sur certains acquis de l'expérience chinoise. Demeure difficile d'accès.
Claudin, F., L'eurocommunisme, Maspero, Cahiers libres, #336, pp. 69 à 83, 1977.
En une douzaine de pages, une synthèse critique de la portée et des limites de la révolution russe d'un point de vue marxiste.
Ferro, M., La révolution russe de 1917, Questions d'histoire, Flammarion, Paris, 1917.
En 100 pages la révolution russe au jour le jour pendant toute l'année 1917 par un historien spécialisé sur ce sujet.
Ferro, M., La révolution de 1917, Aubier/Montaigne, Paris, tome 1, 512 p. (1967), tome 2, 600 p. (1976).
Une étude historique fouillée avec une documentation très riche à l'appui. Une étude de la structure de classe du pouvoir qui contrebalance bien les études traditionnelles à partir de la « ligne » du Parti.
Linhart, R., Lénine, les paysans, Taylor, Seuil, 1976, 172 p.
Une analyse critique de deux points névralgiques de l'économie dans les premières années de la révolution d'octobre : la question paysanne et la question de l'organisation du travail industriel (Lénine et le taylorisme).
La Commune, La Révolution chinoise, numéro spécial de la revue La Commune #2, 1977, (disponible au centre de documentation de Solidarité Québec-Amérique latine), 56 pages.
Les acquis et les points faibles de la révolution chinoise présentés par une revue de la nouvelle gauche française qui a sympathisé avec la révolution chinoise sans tomber dans le suivisme inconditionnel à l'égard du PCC. Accent mis sur les acquis d'ordre idéologique (à partir des différents écrits de Mao) mais absence d'analyse de classes sociales au pouvoir et de la structure économique du pays.
Claudin, F., La crise du mouvement communiste, Maspero, tome 2, pp. 630 à 660.
Une mise en contexte historique et politique de la révolution chinoise (dans le cadre de l'Internationale communiste et de l'U.R.S.S. comme centre dirigeant du mouvement).
Bettelheim, C., Questions sur la Chine après la mort de Mao Tsé-Toung,
Maspero, économie et socialisme #35, 1978, 135 pages
Par l'auteur des Luttes de classes en U.R.S.S., une analyse critique de la Chine actuelle : le bond en arrière idéologique et politique qui s'accomplit depuis la fin de 1976.
Broué, P., La révolution espagnole (1931-1939), Champs/Flammarion, ESPAGNOLE Paris, 1973, 100 p.
La guerre civile espagnole au jour le jour par un historien de référence trotskiste.
Claudin, F., La crise du mouvement communiste, tome 1, pp. 238 à 285.
Le point de vue d'un historien marxiste qui a vécu la Guerre civile espagnole comme militant et qui montre les faiblesses d'un parti qui était le sien à l'époque (le PCE) et d'une internationale (l'Internationale communiste sous Staline) qui « manque le bateau » en allant à « contre-courant de la dynamique profonde de la révolution espagnole ».
Harnecker, M., Cuba : dictature ou démocratie?, Maspero, cahiers libres, (1959-...) #312-313, Paris, 1976, 232 p.
Une bonne présentation d'ensemble de la révolution cubaine par les Cubains eux-mêmes (il s'agit d'entrevues recueillies par un groupe de chercheurs et de journalistes auprès des militants à la base dans les différents secteurs de la société) doublée d'une postface de M. Harnecker qui fait le point sur les acquis de cette révolution à Cuba, « territoire libre d'Amérique » selon leur propre expression. Point de vue sympathique à la cause de Cuba mais sans analyse critique.
CEDETIM, Chili 1970-1972, Paris, février 1973, (disponible au Comité Québec-Chili), 22 p.
Une analyse du rapport de forces et de la mobilisation des masses populaires entre 1970 et 1973 sous le régime de l'Unité populaire.
Lotta Continua, La leçon chilienne, Temps modernes, #335, juin 1974,
Une excellente synthèse des enseignements à tirer de l'expériencechilienne mise en parallèle avec les révolutions russe, chinoise etvietnamienne par une organisation de la nouvelle gauche italienne.Une dizaine de pages.
Mattelart, A., La spirale, film de 2 hres 25
Excellent film qui analyse le Chili de l'Unité populaire et les forces sociales en présence au moment du coup d'État de 1973. Disponible en vidéo au Comité Québec-Chili.
Chesneaux, J., Le Vietnam, Petite collection Maspero #24 Paris, 1972, 190 p.
Par un historien des mouvements de libération nationale en Asie du Sud-est, un aperçu historique et politique du Vietnam jusqu'au début des années '70.
Campbell, B., Libération nationale et construction du socialisme en Afrique (Angola, Guinée-Bissau, Mozambique), Ed. Nouvelle Optique, Montréal, 1977, 150 p.
Une bonne introduction sur les mouvements de libération nationale en Afrique australe par une politicologue de l'Université du Québec à Montréal.
Jalée, P., Le projet socialiste (approche marxiste), Petite collection Maspero, #162, 1976, 180 p.
Une bonne introduction sur les principales caractéristiques économiques, politiques et culturelles du projet socialiste. Un point de vue défavorable sur Lénine, faiblement argumenté et en partie injustifié.
II Manifeste, Pouvoir et opposition dans les sociétés post-révolutionnaires,
Seuil/Combat, 1978, 300 p.
Une des premières réflexions d'ensemble sur les « socialismes existants ». Une des plus lucides aussi. Ce livre est le compte-rendu d'un colloque tenu en 1977 en Italie et organisé par le groupe II Manifeste. Il met à contribution F. Claudin, B. Trentin, C. Bettelheim, R. Rossanda et plusieurs autres qui ne sont pas les derniers venus pour poser les problèmes du socialisme aujourd'hui. À lire.
Piotte, J.M., Marxisme et pays socialistes, VLB éditeur, Montréal 1979, 177 p.
Un point de vue marxiste sur le marxisme et sur le socialisme qui secoue plusieurs « thèses » héritées de la 3e Internationale sur le parti, l'État socialiste, Lénine... Un questionnement audacieux et pertinent qui ne débouche cependant pas encore sur des alternatives. À lire
À ceux qui voudraient en savoir plus long sur le stalinisme mis en rapport avec le socialisme, nous suggérons :
1. Des analyses critiques qui vont en profondeur (mais qui demeurent difficiles de lecture) :
Bettelheim, C., Les luttes des classes en U.R.S.S. (1923-1930), tome 2 Seuil/Maspero, 1977.
Claudin, F., La crise du mouvement communiste,Maspero, Paris, 1972, 2 tomes.
2. Des introductions qui sont révélatrices :
Révolution et contre révolution en U.R.S.S., Cahiers révolution #3, Maspero, 1974, 64 p.
Un tour d'horizon de l'U.R.S.S. sous Staline par un collectif de militants (de la gauche révolutionnaire française) issus de mai 1968.
Ciliga, A., Au pays du mensonge déconcertant, Collection 10/18, Gallimard, 1932, (réédité en 1977), 250 p.
Membre du comité central du PC yougoslave, Ciliga se rend en Russie en 1926 pour étudier. Devenu en cours de route militant d'un groupe d'opposition de gauche,il est arrêté, emprisonné, puis déporté en Sibérie durant cinq ans. II est finalement expulsé en 1936. Un livre captivant qui se lit comme un roman. Témoignage lucide sur l'URSS sous la direction de Staline. Témoignage qui se double bien souvent de réflexions politiques sur la nature du régime, du parti, de la nouvelle classe dirigeante.
Semprun, J., Autobiographie de Federico Sanchez, Seuil, 1978, 320 p.
La critique des pratiques politiques staliniennes du Parti communiste espagnol (PCE), par un de ses anciens militants et dirigeants. Cette autobiographie est écrit dans un style romancé, sous la forme de témoignage et de réflexion politique en vrac. Incisif et provoquant.
CSN/CEQ Histoire du mouvement ouvrier au Québec (1825-1976),
Montréal, 1979.
150 ans de lutte de la classe ouvrière au Québec et au Canada contre le capitalisme. Un livre indispensable.
CSN, Ne comptons que sur nos propres moyens
CEQ, L'École au service de la classe dominante
Les manifestes des trois centrales syndicales écrits en 1972 dans le contexte du Front commun du secteur public et parapublic. Les premières prises de positions des organisations syndicales québécoises sur le capitalisme pris globalement : un saut qualitatif important au plan idéologique dans l'après-guerre au Québec.
Conseil Central de Montréal,(CSN), Le socialisme c'est la démocratie,
texte du Congrès de 1972.
Les grandes lignes d'un projet socialiste pour le Québec dans le prolongement de la réflexion amorcée par le manifeste Ne comptons que sur nos propres moyens.
CSN, Évaluation de la réflexion collective sur le document : « Ne comptons que sur nos propres moyens ». 1973.
Le rapport du comité d'orientation de la CSN sur le débat tenu dans la Centrale autour du manifeste Ne comptons que sur nos propres moyens. Un document précieux, encore plein d'actualité sous plusieurs aspects.