Mot du directeur
général
De Haïti à l'Ontario en
passant par le québec
Un message de paix lancé par
la la fondation kim phuc internationale
(Québec)
Le bénévolat et langue des
noirs du Québec
Femmes sans
frontières
Quand le professorat mène au
bénévolat
Aide aux femmes :
analphabètes et démunies de Docajou
Les partenaires de l'Association de la
Haute-Égypte
La part du dragon pour les
bénévoles
Dans le Centre du Québec, une
bouffée de la suisse
L'espéranto : Une langue et une
communauté basées sur la bonne
volonté
Escola Santa Cruz : Falando
portugês em Montreal
Les immigrants et le
bénévolat
Notes
- Samuel Montas, Le Conseil des organismes francophones de la
région de Durham
- Louise Gagné et Michel Filion, Communicateurs du Fauve,
Fondation Kim Phuc Internationale (Québec)
- Dan Philip et Marguerite Rurema, La Ligue des Noirs du
Québec
- Marina Twibanire, le personnel et les bénévoles,
Femmes sans frontières
- Omar Aktouf, professeur, École des Hautes Études
Commerciales
- Aline Laurent
- Marie-Claudette Ciriaque et Nerdy Pierre, Epmandok
- Rami Hamam, Partenaires de l'Association de la
Haute-Égypte pour l'éducation et le
développement
- Nancy Neamtan, Chantier de l'Économie sociale
- Sylvie Parent
- Sunny Lam, La course de bateaux-dragons
- Margrit Schmuki, Club de lutte suisse, Centre du
Québec
- Steve Brunelle
- Jessy Lapointe, Société québécoise
d'espéranto
- Joaquina Pires, Ville de Montréal
- Carol Ann Namur
- Le-An et Le-Nhung, Palais d'Orient
Organisme collaborateur
Ministre des Relations internationales, Programme d'invitation
et d'accueil de personnalités étrangères
Équipes techniques
Année 2000
Steve Brunelle, Chantal Breton, Pierre
Riley. BeauGraf communication
Présente édition
France Moreau, Pierre Riley, Mélanie Calieriez,
Aline Laurent, BeauGraf communication

La petite fille nue de cette photo tristement célèbre
est Kim Phuc Phan Thi à 9 ans.
Madame Kim Phuc Phan Thi, aujourd'hui âgée de 38 ans,
a gentiment accepté de poser pour la page couverture du cahier
« Bénévolat et Communautés culturelles
»
Page couverture : de gauche à droite, de haut
en bas
Le-An, Louise Gagné, Le-Nhung, Kim Phuc Phan Thi
Droits d'auteur
La reproduction de ce document, en tout ou en partie et par
quelque procédé que ce soit, est interdite. La
référence à certaines informations contenues dans ce
document est toutefois possible, à condition d'en indiquer la
source.
ISBN : 2-922722-03-1
Dépôt légal Bibliothèque nationale du
Québec
Bibliothèque nationale du
Canada

Samuel de Champlain et Mathieu De Coste en
1606

Pierre Riley
Irlandais de 5e génération
Directeur général
Fédération des centres d'action bénévole du
Québec
Samuel de Champlain est arrivé en Nouvelle-France en 1606.
Parmi les marins qui avaient traversé l'Atlantique avec lui,
se trouvait Mathieu De Coste. Samuel de Champlain faisait appel
à Mathieu De Coste lors de ses expéditions parce que ce
dernier était doué pour les langues. Il en connaissait
plusieurs dont le français et le micmac. C'était un homme
éduqué qui fut l'un des fondateurs de « l'Ordre du
bon temps », le plus vieux club au Canada.
Mathieu De Coste était noir
De Port-Royal en 1606 au Québec d'aujourd'hui, nos terres
ont toujours accueilli des citoyens à la peau plus ou moins
foncée et qui priaient dans des temples plutôt que dans
des églises. Certains ont installé leur famille, il y a
quelques . générations déjà. D'autres plus
récemment, ont fui des conditions horribles pour revendiquer
un statut de réfugiés. Qu'ils vivent ici depuis deux
siècles où qu'ils soient arrivés hier, nous disons
d'eux qu'ils sont membres de communautés culturelles. (Entre
nous, lors de nos recherches préparatoires pour la
rédaction de ce numéro, plusieurs immigrants vivant dans
la métropole citent les communautés chinoise,
haïtienne et juive et ajoutent « communauté
montréalaise » lorsqu'ils désignent les
blancs-francophones-catholiques).
Dans ce cahier, « Bénévolat et Communautés
culturelles », il sera question de ces nouveaux
Québécois qui donnent du temps. Au fil des prochains
articles, ils raconteront que leur engagement bénévole a
souvent favorisé leur intégration dans la communauté
d'accueil. Mais leur engagement prend des formes différentes.
Souvent, ils sont membres de groupes qui soutiennent des programmes
établis dans le pays qu'ils ont quitté. Il y a ceux aussi
qui veulent perpétuer leur culture d'origine au Québec et
qui veulent que leurs enfants n'oublient jamais la langue
maternelle, leurs danses, leurs chants. Ces bénévoles ont
déjà teinté nos organismes et nos organismes ont
influencé ce qu'ils sont.
Le hasard veut que lorsque nous écrivons ces mots, les deux
tours du World Trade Center viennent à peine de
s'écrouler... Voilà la bêtise humaine alimentée
par les incompréhensions de toutes sortes. En cette Année
internationale des bénévoles, souhaitons que nos
organismes offrent à chacun de nos bénévoles
l'occasion d'apprécier la différence et la
complémentarité de l'autre.
Heureux qui, comme Samuel Montas, a fait du
bénévolat
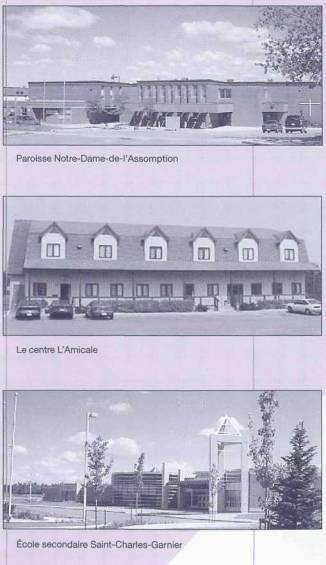
Je suis arrivé en Ontario en 1988 avec ma petite famille et
depuis je n'ai cessé de travailler dans le secteur du
bénévolat. J'ai continué à donner du temps
comme je l'ai fait lorsque j'ai immigré à Montréal.
Dès mon arrivée à Durham, j'ai offert mes services
comme bénévole à l'école de mes enfants et
c'est là que j'ai appris à connaître les gens et
leur milieu. Le bénévolat est un moyen très efficace
de faire la connaissance des gens, vivre plus près d'eux et
apprendre les us et coutumes du pays d'accueil. Grâce à
cette proximité, les immigrants apprennent à
connaître la communauté d'adoption et l'inverse est vrai
aussi. Précisons qu'ils ne sont peut-être pas nombreux,
mais il existe une bonne proportion de gens, en Ontario et
ailleurs, qui donnent de leur temps pour servir dans des organismes
à buts nonlucratifs et cela dans toutes communautés,
races et cultures confondues. Fait à noter, les
bénévoles immigrants sont peut-être plus jeunes et
plus instruits.
On a tendance à croire que les immigrants donnent moins de
temps bénévole ou prennent peu part aux travaux
communautaires. Bien au contraire, ils sont nombreux ceux qui comme
moi, le pratiquaient bien avant leur entrée au pays. Mais la
pratique du bénévolat prenait des formes différentes
dans leur pays d'origine. Il était loin d'être aussi bien
organisé qu'ici. C'était plutôt des initiatives
timides de groupes formés de jeunes et/ou d'adultes, fort
souvent appelés des clubs. Même que dans certains pays,
les regroupements de gens actifs donnant bénévolement des
services communautaires peuvent être interprétés
comme une action politique dirigée contre le régime en
place. Sauf lorsque les ONG sont officiellement reconnues... À
tire d'exemple, en Haïti, il y a le « combit ».
C'est une forme de bénévolat qui est la réunion d'un
groupe de gens vivant dans un quartier et qui exécute
collectivement un travail spécifique. Cela se passe le plus
souvent à la campagne entre les cultivateurs au cours des
périodes de récoltes et de semences.
Une fois arrivés au Canada, les immigrants, après une
période d'adaptation, participent grandement aux travaux
bénévoles d'organismes sans but lucratif,
particulièrement les organismes où leurs compatriotes en
sont les bénéficiaires immédiats. Cependant il y a
les immigrants qui ne participent pas et parfois ne peuvent le
faire. Ces derniers doivent travailler durement pour soutenir leur
famille, souvent restée au pays d'origine.
Le Canada est reconnu à travers le monde pour ses gens de
générosité, de charité et de compassion. Nous
sommes les premiers à offrir notre aide au niveau
international en temps de crises et de catastrophes naturelles. Cet
empressement fait en sorte que des milliers de gens arrivent au
pays comme immigrants et réfugiés politiques, à
cause de notre qualité de vie, de nos politiques sociales
et... de notre régime d'assurance santé. Ce pays
pourrait-il garder son image de pays généreux et
charitable sans l'apport des bénévoles? Aurait-il les
moyens de conserver sa politique sociale et son système de
santé sans un système de bénévolat efficace ?
Certainement non.
Ontario

par Samuel Montas
Je pourrais appliquer le même raisonnement pour le fait
français. Je me demande, parfois, ce que serait la
francophonie sans eux. Le français serait-il encore
parlé?
La région de Durham est située à l'est de
Toronto. La population actuelle de francophones serait de 9000,
dont la plus grande partie est localisée à Oshawa, soit
60 % dans la zone Oshawa/Whity. Au total, les francophones
constituent environ 3 % de la population. Lorsque je suis
arrivé, je ne pensais pas trouver une école
française et une communauté organisée. Mais vu les
conditions minoritaires des francophones, les défis sont
grands et les tâches à accomplir sont stimulantes. Ici on
ne prend rien pour acquis. Tout est à faire.
Au bout de quelques années, j'ai été élu
conseiller scolaire. Notre équipe partage la même vision
et les même objectifs : faire la promotion de la culture
française dans la région, accueillir les nouveaux
arrivants francophones du Québec et d'ailleurs, et
perpétuer la présence francophone. Ici le travail n'a pas
de couleur. C'est un chantier ouvert qui a un grand besoin
d'ouvriers. Tout le monde y contribue selon ses connaissances et
ses expériences personnelles. Comme membre d'une minorité
visible, je n'ai aucun problème à m'y intégrer et
à y travailler positivement. Bien sûr, il y aura toujours
une ou deux personnes plus réticentes, mais je ne m'en fais
pas outre mesure, puisque je sais qui je suis et ce qui me
motive.
La persévérance de notre conseil scolaire et notre
volonté de réussir et de doter notre communauté d'un
bien durable, représentatif, voilà ce qui nous a permis
d'obtenir du gouvernement de l'Ontario la construction de la
première école secondaire de langue française de la
région. Par la suite, au niveau provincial, les
Franco-Ontariens ont obtenu le droit d'administrer leurs conseils
scolaires catholiques et publics.
La population francophone est bien enracinée dans la
région de Durham puisqu'elle possède ses propres
institutions et de nombreux organismes sociaux et sportifs. À
Oshawa nous avons la paroisse Assomption de Notre Dame, et une
salle culturelle, L'Amicale, le centre culturel, le C.O.F.R.D.
(Conseil des Organismes Francophones de la Région de Durham),
l'école élémentaire catholique Corpus-Christi,
à Whitby, l'école secondaire Saint-Charles-Garnier,
à Ajax, l'école élémentaire
Notre-Dame-de-laJeunesse, l'école publique Antonine-Maillet
à Oshawa, et enfin un service de garderie dans chacune des
écoles, connu sous le nom Garderie Le Lucioles. Toutes ces
réalisations sont dues au travail acharné des milliers de
bénévoles de la région.
Voilà donc une histoire à succès, fruit du
bénévolat, dans la petite communauté francophone de
la région de Durham. De mon avis, tout va très bien au
niveau de l'administration des services bénévoles. Comme
président du conseil d'administration de C.O.F.R.D. et de
L'Amicale, je continuerai à donner le mieux de moi-même
pour défendre la cause de la francophonie dans la région,
en étroite collaboration avec les gens du milieu.
Au cours du 20e siècle, le secteur du bénévolat
s'est considérablement développé ; et actuellement,
il occupe une place importante dans notre infrastructure sociale.
Les statistiques concernant le bénévolat sont très
encourageantes et démontrent le caractère
généreux de notre population. On dénombre dans tout
le Canada 7,5 millions de bénévoles, consacrant chaque
année environ 1,1 milliard d'heures de services, pour une
valeur de 13 milliards de dollars. Ce sont là des chiffres qui
démontrent l'importance de ce secteur dans la vie quotidienne
des citoyens.
Au fil des années un changement radical s'est produit dans
le domaine du bénévolat. En effet, grâce au travail
acharné des bénévoles, ce secteur de services
publics a obtenu ses lettres de noblesse. Désormais, les
divers gouvernements participent en subventionnant des programmes
spécifiques liés au bénévolat. Le changement le
plus marqué est celui de la participation grandissante des
jeunes bénévoles dans des organismes de services
communautaires, car les employeurs reconnaissent l'importance de
cette expérience particulière. En Ontario, le
gouvernement, afin d'encourager le civisme et promouvoir les
valeurs d'entraide, exige que les élevés effectuent un
minimum de 40 heures de service communautaire. Les étudiants
doivent s'engager bénévolement pour obtenir leur
diplôme d'étude secondaire.
Comme immigrant, je crois qu'il est de mon devoir de participer
à ce grand chantier culturel et communautaire. Car chaque
jour, des hommes et des femmes travaillent dans l'ombre pour faire
aider ceux et celles qui ont besoin d'amour et de charité. Le
bénévolat est une école de la vie et aussi un moyen
de connaître le pays et ceux et celles qui l'habitent. C'est
une expérience enrichissante pour ceux et celles qui veulent
bâtir quelque chose de solide pour l'avenir et renforcer leurs
liens avec les différentes communautés.

De gauche à droite, les membres du conseil
d'administration de la Fondation Kim Phuc Internationale
(Québec) Mme Agathe Plamondon, Mme Louise
Angers, Mme Louise Gagné, Mme Kim Phuc
Phan Thi et M. Michel Filion.
Madame Kim Phuc Phan Thi, présidente de la Fondation Kim
Internationale et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO
pour une culture de la paix, a présenté au public, le 24
septembre dernier, sa Fondation Kim Phuc Internationale
(Québec). Lors de cette inauguration, les membres du conseil
d'administration ont été présentés.
En 1972, la photographie d'une petite fille de neuf ans, Kim
Phuc Phan Thi, fuyant une attaque au napalm au Sud Viêt-Nam a
saisi les éditeurs de journaux à travers le monde. Elle a
été publiée en évidence à la une des
premières éditions, accompagnée d'une histoire
dramatique en pleine évolution. Tous ceux qui la voyaient en
restaient bouleversés. C'est pourquoi aujourd'hui, madame Kim
tient tant à aider les enfants victimes des guerres et des
conflits armés.
Compte tenu de la situation actuelle qui persiste aux
États-Unis, la Fondation Kim Phuc Internationale (Québec)
a profité de son lancement pour promouvoir la paix dans le
monde. « Comme j'ai vécu la guerre, je connais la valeur
de la paix; comme j'ai vécu dans un régime communiste, je
connais la valeur de la liberté; comme j'ai souffert, je
connais l'importance de la guérison; comme j'ai vécu la
colère, je connais l'importance du pardon », a
déclaré madame Kim.
Il ne faut pas laisser souffrir les enfants, comme elle a
souffert, puisque ce sont d'innocentes victimes. Selon les Nations
Unies, les guerres en cours ont causé la mort de plus de deux
millions d'enfants. Six millions sont handicapés de façon
permanente et plusieurs millions ont été meurtris.
La Fondation Kim Phuc Internationale (Québec), un organisme
sans but lucratif, a donc été créée en cette
Année internationale des bénévoles, afin d'aider les
enfants en détresse, victimes de guerres et de conflits. Ses
membres s'engagent à fond dans l'implantation de la Fondation
Kim Phuc Internationale (Québec) et désirent sensibiliser
le public aux besoins des enfants et de leurs familles partout dans
le monde, comme près de nous. Ils tiennent à établir
des collaborations avec des intervenants qui viennent en aide
directement à ces enfants.
Le premier projet de la Fondation Kim Phuc Internationale
(Québec) se situe en Roumanie, en collaboration avec
Médecins du Monde. Il consiste à appuyer les
professionnels roumains du Centre de conseil de la Fondation pour
l'enfant de Bucarest. Il s'agit d'un centre de soins pour enfants
victimes de violence et de maltraitance, où des
spécialistes conseillent et forment une équipe
pluridisciplinaire pour la prise en charge médicale,
psychologique et sociale des enfants.
Le projet prévoit qu'un minimum de 150 à 200 enfants
violentés seront traités, ce qui représente de 600
à 900 consultations, au cours de l'année 2001. La prise
en charge globale est assumée par l'équipe des soignants
roumains auprès de qui Médecins du Monde apporte conseil
et formation professionnelle. Cette aide commence dès
l'urgence signalée au téléphone et inclut les
stratégies de sensibilisation auprès des familles, de la
communauté, de l'opinion publique et des médias, en guise
de prévention.
Toute l'équipe de la Fondation Kim Phuc Internationale
(Québec) s'investit bénévolement comme l'ont fait
jusqu'à présent les fondations de Chicago et de Toronto.
Elle met toutes ses énergies et son temps à
l'élaboration de projets qui seront réalisés à
travers le monde.
Le conseil d'administration est composé de madame Agathe
Plamondon, qui agit à titre de présidente; de monsieur
Michel Filion, qui occupe le poste de vice-président ; de Me
Michel Towner, qui a été nommé secrétaire; de
madame Louise Gagné, qui s'occupe de la trésorerie et qui
siège aussi sur le Comité de l'Année internationale
des bénévoles 2001 au Québec; ainsi que de madame
Louise Angers, qui est administratrice pour la région de
Québec.

Québec
La ministre d'État aux Relations internationales du
Québec et ministre responsable de la Francophonie, madame
Louise Beaudoin, également responsable du Secrétariat
à i'aide internationale, appuie les objectifs visés par
madame Kim et la Fondation Kim Phuc Internationale (Québec).
Lors du lancement de la Fondation, elle a annoncé une
subvention de 30000 $ qui servira à l'aide humanitaire en
Roumanie. L'équipe bénévole du Québec est donc
prête à recevoir des dons de toutes sortes, provenant
autant des individus, des organismes, des entreprises, du
gouvernement, que des associations.
Lors de la présentation de la Fondation Kim Phuc
Internationale (Québec), le site Internet de la Fondation Kim
Internationale a aussi été lancé. De nombreuses
personnes de Vidéotron ont participé activement à
l'élaboration de ce site, dont l'adresse est
www.kimfoundation.com. La Fondation Kim Internationale
souligne toute sa reconnaissance envers Vidéotron.
www.kimfoundation. com
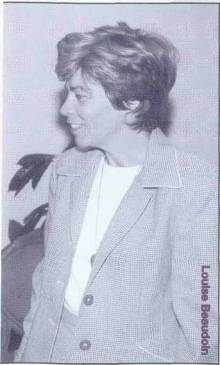

Récipiendaire du prix Hommage-bénévolat
Québec 2001. Région Montréal
C'est le moment propice de vous parler de l'organisme qui a fait
ses preuves dans la défense des droits de la personne et des
intérêts de la Communauté noire. Il s'agit de la
Ligue des Noirs du Québec, fondée en 1969. Elle est l'un
des porte-parole de la communauté noire en matière de la
défense des droits de la personne. Pour ne citer que quelques
exemples :
- La Ligue a organisé une conférence avec la CSN sur
l'année internationale de l'élimination de la
discrimination raciale et l'intégration de la Communauté
noire dans le milieu syndical.
- En ce qui concerne l'emploi, La Ligue appuie toutes les
initiatives tendant à faire disparaître la discrimination
au niveau de l'emploi. À ce titre, elle fait pression
auprès des différentes instances publiques et appuie
notamment tous les programmes d'accès à
l'égalité.
La Ligue des Noirs du Québec a comme objectifs de :
- Défendre les droits de la communauté et
représenter leurs intérêts.
- Servir d'instrument d'éducation populaire pour le respect
des droits des citoyens.
- Sensibiliser les gouvernements, les secteurs public,
para-public et privé à l'importance de donner des chances
et des opportunités égales à tous les
citoyens.
Parmi ses fondateurs figure Monsieur Dan Philip; à son
arrivée au Canada, il a constaté que la situation des
nouveaux immigrants était précaire. C'est ainsi qu'en
1969, il créa un organisme pour défendre la cause des
immigrants les plus démunis et ceux de la communauté
noire. Homme de cœur et d'action, il ne ménage aucun
effort pour intervenir pour la cause des jeunes et de toute
personne en difficulté.
Convaincu que la lutte pour les droits de la personne est le
seul chemin qui mène à une société plus juste,
il s'investit bénévolement en tenant compte du fait que
le bonheur de chaque individu fait le bonheur de toute la
société. Il a un penchant particulier pour les veuves et
les orphelins. Il demeure un phare d'alerte face aux
différentes formes de discrimination et abus de pouvoir qui se
manifestent quotidiennement dans nos sociétés.

Madame Twibanire est membre de « Femmes sans
frontières », un comité de l'Association des
handicapés multi-ethniques du Québec. Les membres de
Femmes sans frontières poursuivent les objectifs suivants
:
- Réduire leur isolement, développer leur estime
d'elle-même et leur sentiment d'appartenance au Québec,
société d'accueil.
- Développer la prise en charge (citoyenneté) par leur
connaissance des ressources mises à disposition du
système, des services, afin de pouvoir améliorer la
qualité de leur vie.
- Contribuer au changement de la société par leur
engagement dans des activités de promotion et de défense
des droits.
Les membres-bénévoles de Femmes sans frontières
sont de nationalités et de religions différentes.
Certaines ne parlent ni français, ni anglais. Mais elles
partagent toutes les préoccupations propres à leur
condition commune : être femme immigrante et handicapée.
Femmes sans frontières a identifié près de 60
montréalaises qui pourraient adhérer au groupe.
Présentement une vingtaine de femmes participent aux
activités. Elles se voient une fois par mois, l'accès
difficile au transport limitant les déplacements des membres.
Pour quelques unes, ces rencontres sont les seules occasions de
sorties.
Elles apprécient de se retrouver entre elles, le groupe
leur apportant un soutien moral. Elles se soucient les unes des
autres. C'est ainsi que grâce à l'intervention de Femmes
sans frontières, une dame haïtienne, en réadaptation
à Québec après une chirurgie, a pu se sortir de la
dépression dans laquelle elle avait sombré. Elle
s'était retrouvée seule là-bas, dans un motel, loin
de ses enfants. L'association a fait en sorte qu'elle soit
relogée en famille d'accueil. Suite à son
expérience, cette dame émettait le souhait que Femme sans
frontières fasse de l'accompagnement médical et
post-chirurgical, un dossier prioritaire.
Le quotidien de ces femmes est particulier. Leur bien-être
est lié au soutien donné par certains organismes et
ministères. Une part importante de leurs rencontres mensuelles
est consacrée à communiquer l'information que chacune des
membres a pu glaner un peu partout. Elles ont aussi formé un
sous-comité responsable d'inviter des conférenciers qui
viendront les entretenir sur des sujets qui les intéressent,
notamment les problèmes d'adaptation rencontrés dans le
pays d'accueil. Ces thèmes vont des papiers d'immigration au
transport adapté. (À cet effet, elles ont récemment
joué les délinquantes en manifestant devant les bureaux
du ministre Guy Chevrette, pour dénoncer l'inefficacité
des transports offerts aux personnes handicapées).
Quelques-unes des membres donnent du temps ailleurs dans
d'autres groupes communautaires. Elles racontent que leur
engagement bénévole garantit leur santé morale et
leur intégration dans la société
québécoise. Femmes sans frontières recommande
même de militer au sein de groupes de défense des droits
ou de siéger à des tables de réfugiés. Enfin,
cet automne débutera un atelier animé par l'une d'entre
elles : « À l'écoute de ses besoins : recherche de
pouvoir personnel ». Chacune sera invitée à
identifier et à réaliser ses rêves.
Elles n'ont pas toutes le vécu de la Madame Twibanire.
Reste qu'être invité à l'une des réunions de
Femmes sans frontières peut s'avérer une expérience
troublante. Pas parce qu'on discute avec des dames qui offrent de
leur temps bénévolement et qu'elles le font soit en
chaise roulante, soit avec un appareil auditif ou avec une canne
blanche. C'est troublant parce qu'on se rappelle toutes ses
journées où on s'est levé avec « un bouton
disgracieux » et que la fin du monde était presque
arrivée.
L'Association multiethnique des personnes handicapées du
Québec est une initiative de cuisine conduite par Madame
Luciana Soave. Italienne d'origine, venue s'installer au
Québec avec son fils handicapé, c'est à partir des
difficultés qu'elle a rencontrées comme femme immigrante
ne parlant pas français, qu'elle a fondé ce groupe. Le
message véhiculé est :
par Aline Laurent journaliste française
Algérie
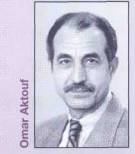
Omar Aktouf est un professeur émérite de management
à l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de
Montréal. Si la discipline qu'il enseigne peut, pour beaucoup,
s'avérer austère, Monsieur Aktouf la présente sous
un visage plus sensible, plus humain. En effet, le professeur s'est
forgé, au fil d'un parcours original et varié, une
renommée internationale en bâtissant une théorie
humaniste du management et de l'économie; pour Monsieur
Aktouf, il importe de placer l'être humain au centre des
réflexions et des discours économistes.
C'est donc en l'occurrence la défense de cette théorie
et l'ensemble de ses travaux qui lui ont donné la
notoriété qu'on lui connaît. Outre l'enseignement,
Monsieur Aktouf prononce de nombreuses conférences à
travers le monde. Comme l'impose un poste à l'université,
le professeur est chercheur et a de nombreux écrits à son
actif (livres, articles, etc.).
Né en 1944 en Algérie, Omar Aktouf connaît
rapidement l'exil, sa famille étant contrainte de quitter le
pays suite aux troubles qui s'y passent. La famille Aktouf vivra au
Maroc jusqu'à ce que l'Algérie obtienne son
indépendance, en 1962.
Par la suite, Monsieur Aktouf suit un parcours universitaire et
professionnel tout à fait diversifié. Avant de devenir
professeur de management, Omar Aktouf s'intéresse aux lettres,
à la philosophie, à la psychologie, à
l'économie et au management, autant de disciplines qui lui
permettront de concevoir la théorie qu'il défend
actuellement. Parallèlement, il occupe différents postes
de gestion et d'administration du personnel et de direction dans
plusieurs entreprises.
Aujourd'hui, tout en poursuivant l'enseignement et en s'adonnant
à des activités connexes (écriture,
conférences, etc.), Monsieur Aktouf a de nombreuses autres
occupations. En effet, le professeur est l'un des fondateurs du
groupe Humanisme et Gestion des HEC, groupe en faveur de
l'éducation et luttant contre l'analphabétisme.
Omar Aktouf n'hésite pas à partager son savoir en
participant plusieurs fois par an bénévolement à des
colloques et à des séminaires, en offrant des
conférences dans des pays à l'économie plus fragile
(Mexique, Tunisie, Colombie, Algérie...). De même, le
professeur a fait don de tous ses droits d'auteur au Fonds
humanisme et gestion des HEC, aidant ainsi de façon
considérable bon nombre d'étudiants. C'est également
dans ce souci de transfert de l'expertise que Monsieur Aktouf
écrit régulièrement des articles dans des journaux
ou des revues spécialisés en management. Fidèle
à son pays d'origine, il offre aussi son soutien à
l'association « Enfants d'Algérie » ainsi qu'à
la revue ' algérienne de Montréal « Alpha ».
Toujours à l'étranger, il est le directeur d'une
fondation colombienne dénommée Terra Nova, dont les
objectifs sont d'aider au développement des régions
paysannes de Colombie.
Enfin, l'engagement d'Omar Aktouf est présent à
travers sa participation aux actions de l'association
anti-mondialisation SALAMI (sit-in, « teach-in ») et son
appartenance bénévole à un groupe d'intellectuels et
d'anciens hauts responsables d'états (le Club d'Athènes)
développant une réflexion
anti-néolibéraliste.1
C'est à vous de vous prendre en main.
Afin d'accomplir sa mission auprès des personnes
handicapées des communautés ethnoculturelles, de celles
nouvellement arrivées et de leurs familles, l'Association
s'est donné les objectifs suivants :
- Promouvoir leurs droits et défendre leurs
intérêts
- Les conseiller et les orienter vers les ressources et services
; les soutenir dans leurs démarches ;
- Susciter et entretenir les échanges entre les personnes
handicapées et les parents afin de créer un réseau
d'entraide;
- Promouvoir des activités susceptibles de favoriser leur
intégration et leur participation, notamment dans le milieu
familial, communautaire, scolaire, social, économique,
professionnel et culturel ;
- Informer et former les intervenants, les professionnels et le
public sur les besoins très particuliers des personnes
handicapées d'origine ethnoculturelle et sur la
nécessité de rendre les services plus adéquats, afin
de favoriser leur adaptation et leur intégration.
Née pour servir, pour faire avancer l'humanité

Les femmes analphabètes et démunies de
Docajou se rassemblent sous le tonnelle pour les préparatifs
de la cérémonie d'ouverture le 29 avril
2001
Le 29 avril dernier, Epmandok annonçait à la
communauté haïtienne de Montréal que les femmes de
Docajou avaient inauguré leur nouveau centre
d'alphabétisation et une clinique de premiers soins.
Epmandok est un organisme humanitaire, sans but lucratif,
qui vient en aide aux femmes et aux enfants analphabètes et
démunis de Docajou. L'atteinte des objectifs se fait en partie
parce que Epmandok peut compter sur le dévouement de
bénévoles au Québec. Une Montréalaise,
Marie-Claudette Ciriaque, et tous ceux qui la soutiennent, mettent
beaucoup d'énergie à inculquer aux femmes de Docajou le
désir d'améliorer leurs conditions de vie.
Docajou est une petite localité rurale de la commune du
Belladère, Département du centre d'Haïti.
Marie-Claudette Ciriaque y est née. Son père en
était un leader estimé. « Le jugement de cet homme
était respecté par tous les citoyens de Docajou »
raconte Madame Ciriaque. À sa mort, la population s'est sentie
orpheline. Qui allait trouver les solutions à leurs
problèmes? Cet apitoiement a agacé MarieClaudette
Ciriaque. Pour sûr, son père n'aurait pas
apprécié l'abattement des citoyens de Docajou.
Déterminée, ce serait elle qui prendrait la relève.
En 1995, Marie-Claudette Ciriaque et les femmes de la place
créaient donc Epmandok.
Haïti est le pays le plus pauvre de la planète. Les
moyens dont disposent Epmandok sont en deçà des
besoins de l'association. MarieClaudette Ciriaque est à la
recherche constante de financement et d'aide de toutes sortes. Elle
' fait de la représentation partout, toutes communautés
culturelles confondues. Elle organise beaucoup d'activités
pour amasser de l'argent. Elle s'adjoint la collaboration
d'artistes et d'organismes haïtiens pour monter des spectacles
bénéfices. Elle va aussi chercher le partenariat de la
communauté montréalaise. Plus de 100 Québécois
lui prêtent main forte dans ses quêtes.

Marie-Claudette Ciriaque s'adresse aux dames du
Centre d'alphabétisation de Docajou lors de la
cérémonie d'ouverture le 29 avril 2001
On lui remet de l'argent, du matériel scolaire qui ne sert
plus, et diverses autres choses dont des services gratuits de
traduction français / créole. Epmandok est
enregistré ici et en Haïti, Toutefois c'est au
Québec que Marie-Claudette Ciriaque recherche des subventions.
Devant notre étonnement, elle explique qu'un dossier
d'intéressement a été remis à la première
dame de la République d'Haïti, Madame Préval, lors
de son dernier passage à Montréal. Epmandok est
dans l'attente d'une réponse. Toutefois, vue l'urgence des
tâches à accomplir, mieux vaut se tourner vers des
sources de financement aux rentrées plus rapides.
Marie-Claudette Ciriaque est d'une polyvalence remarquable. Elle
est détentrice d'un diplôme d'études secondaires en
secrétariat général mais souhaiterait être
davantage instruite, notamment en informatique. Elle a la
conviction que si elle était plus scolarisée, elle serait
davantage stratégique et ses efforts porteraient plus. Mais,
poursuit-elle, si j'étais plus intellectuelle, peut-être
que mes actions seraient des exercices de réflexion
sociologique. Et les femmes de Docajou ont des besoins tellement
pressants. Il faut avoir davantage une opinion sur la
reconstruction du centre communautaire détruit par l'ouragan
Georges en 1998 ou sur la recherche de médicaments pour les
victimes du viol de l'an dernier.

Marie-Claudette Ciriaque, assise, honorée lors
du Mois de l'Histoire des Noirs.

Consciente de disposer de peu de ressources, Marie-Claudette
Ciriaque limite son intervention a Docajou et se désole de ne
pouvoir aider Haïti en entier. Son dévouement à la
cause de Epmandok est quotidien. C'est pourquoi la ville de
Montréal l'honorait au printemps dernier lors du Mois de
l'Histoire des noirs. Lorsqu'on lui demande pourquoi ce
bénévolat, qui tient presque de la
vocation missionnaire, elle répond : Parce
que je suis née pour servir et pour faire avancer
l'humanité. Récemment lors d'une entrevue à la
télévision haïtienne, l'animateur lui demandait si
elle n'avait pas l'impression de s'être engagée dans un
tunnel sans fin, avec l'impossibilité de faire marche
arrière. Elle a réfléchi et a répondu à
l'animateur : « Non. Mais, a-t-elle ajouté, si je devais
me retirer de Epmandok, qui serait
la nouvelle MarieClaudette Ciriaque pour assurer la
continuité? »
Et elle termine en disant : AMEN

Pour l'éducation et le développement

En 1968, six immigrants égyptiens fondaient les Partenaires
de l'Association de la HauteÉgypte (PACHE), une corporation
ayant pour but de soutenir un organisme égyptien,
l'Association de la Haute-Égypte (ACHE). La mission de l'ACHE
est d'améliorer l'enseignement scolaire et de favoriser le
développement social en Haute-Égypte. Le fondateur de
TACHE avait la conviction profonde que la scolarisation des
Égyptiens les plus pauvres serait Tune des solutions pour
contrer les problèmes de pauvreté, d'ignorance et de
maladie. C'est ainsi que depuis plus de 30 ans, les
bénévoles montréalais de PACHE mènent des
campagnes de financement en organisant des activités, dont le
Bal du Fallah.
Les premiers immigrants égyptiens se sont installés au
Québec durant les années 60. Ils ont quitté leur
pays pour diverses raisons (désaccords religieux, politique,
etc.). Ces nouveaux Canado-Égyptiens étaient pour la
plupart de condition aisée et détenteurs de diplômes
universitaires. Ils avaient pour souvenirs une Égypte aux
réalités différentes; l'Égypte paysanne dont
les habitants, les fellahs2, connaissaient des vies difficiles, et
l'Égypte citadine, plus raffinée, et peut-être
insouciante quant au sort de ses nécessiteux.
Parti du Caire, un délégué de l'ACHE est venu
rencontrer la communauté égyptienne de Montréal. Il
émettait le souhait que tous « deviennent d'excellents
citoyens canadiens sans toutefois jamais oublier l'Égypte dans
leurs cœurs ». Sensible aux idéaux de TACHE, une
petite équipe de bénévoles créait PACHE. En
1969, ils ont amassé 500 $ et finançaient un premier
projet. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de dollars qui sont
recueillis par l'organisation.
Recueillir une pareille somme, et ceci presque entièrement
lors de la soirée du Bal du Fallah, est le privilège
d'une communauté bien nantie. Le programme-souvenir de
l'événement compte de nombreuses publicités et
messages payés par des gens d'affaires prospères et
connus. Ce sont là des signes que la communauté !
égyptienne est bien établie au Québec. Mais
malgré cette aisance, on veut réduire au minimum
les frais inhérents à l'organisation
d'activités, par souci d'envoyer le plus d'argent
en Égypte. Chacun
des aspects de la
planification des événements est assumé par
les bénévoles membres de PACHE, l'orga nisation ne
comptant aucun employé rémunéré à
son service.

À la lueur des sommes amassées, chaque
année, le conseil d'administration de PACHE
détermine le projet auquel il veut s'associer
(construction d'écoles, alphabétisation des fem
mes, travaux d'urbanisme, etc.). Les sommes recueillies sont
dirigées vers l'Égypte et sont assignées
à ce projet. PACHE a aussi intéressé à
ses entreprises des organismes québécois et canadiens qui
sont devenus des partenaires ponctuels pour des programmes
précis. Mentionnons entre autres l'ACDI, Jeunesse du Monde,
Carrefour solidarités internationales. Coopération
nord-sud en éducation, Développement et paix.
Comme plusieurs organismes issus des communautés
culturelles, à moyen terme, PACHE devra régler un
problème : la relève chez les Canado-Égyptiens de
seconde génération. Ces derniers sont nés ici et
leurs racines sont au Québec. Ils n'ont pas les souvenus
d'Égypte de leurs parents et se sentent moins interpellés
par les préoccupations de PACHE L'organisation a
déjà plus de 30 ans. Les membres qui la composent
souhaitent que lent œuvre se poursuive même lorsqu'ils
auront quitté. On songe envoyer en Haute-Égypte quelques
jeunes adultes afin des les sensibiliser à la cause. Une fois
sur place, pense-t-on, ils comprendront la nécessité de
continuer le travail de PACHE parce qu'ils auront mis des visages
et des noms à leurs frères et sœurs d'Égypte.
Deux jeunes personnes siègent également au conseil
d'administration à l'invitation des administrateurs
aînés.
Ce sont autant d'initiatives qui permettront à PACHE de
perpétuer les idéaux de l'organisation.
Rami Hamam


Nancy Neamtan. Présidente Chantier de l'Économie
sociale
« II existe des voies qu'un peu partout, dans les quartiers
des villes centrales, dans les régions, dans les
collectivités, des hommes et des femmes ont commencé
d'explorer. Ils ne demandent pas mieux que d'aller plus vite, plus
loin, en associant à leurs démarches un plus grand nombre
de nos concitoyens. Si, un peu partout et dans les milieux les plus
divers, le mot partenariat revient si souvent pour décrire ces
voies, c'est bien pour exprimer une vérité : la
solidarité peut nourrir l'innovation. En favorisant les
rapprochements autour de ce qui apparaît essentiel, elle donne
des formes concrètes à ce qu'on appelle la qualité
des milieux de vie. Elle donne des forces et des moyens qui rendent
possibles des audaces parfois insoupçonnées. Un milieu
solidaire peut faire de grandes choses [...] » Nancy Neamtan,
présidente Chantier de l'Économie sociale Extrait du
rapport Osons la solidarité
Dans le documentaire Vers une terre promise I Toward a Promised
Land (1997) de la cinéaste Ina Fichman, on voit cette
même Nancy Neamtan interprétant des pièces de
musique traditionnelle québécoise. Nancy Neamtan est
juive. Sa famille s'est installée au Québec voilà
plusieurs années et elle est de la deuxième
génération.
Nancy Neamtan vit Montréal. Elle est diplômée de
l'Université McGill en littérature anglaise et non pas en
économie comme le laisserait croire ses présentes
fonctions. Elle croit que son engagement bénévole lui a
permis de développer au fils des années les
compétences qui sont les siennes maintenant. Depuis longtemps,
elle œuvre au sein d'organismes se préoccupant de causes
sociales : coopérative alimentaire, organisation des droits
des assistés sociaux, associations de locataires, etc. «
À force de travailler dans des groupes qui cherchaient à
résoudre des problèmes sociaux, j'ai fini par
démystifier « l'économie » affirme-t-elle.
D'ailleurs, elle maîtrise si bien le sujet qu'elle est
invitée régulièrement lors de tribune publique. Son
opinion diffère parfois de celles de ses vis-à-vis
délégués par les institutions financières.
Aujourd'hui, elle est Présidente du Chantier de
l'économie sociale. Elle siège comme représentante
des organismes communautaires à la Commission des partenaires du marché du travail. Au nombre
de ses expériences, mentionnons aussi les postes occupés
comme directeure-générale du RESO (1989-96),
membre-fondatrice de l'Institut de formation en développement
économique communautaire, et membre du conseil
d'administration de Centraide (1992-1994).
Madame Neamtan est d'avis que l'économie est dictée
par nos choix faits en tant que société. «
L'économie n'est surtout pas un phénomène sur lequel
les citoyens ne peuvent exercer aucune influence »
ajoute-t-elle. La santé de notre communauté est
tributaire de rengagement des hommes et des femmes qui y vivent. Le
bénévolat dans des groupes communautaires contribue
certainement à améliorer la qualité de vie de
tous.
D'où lui viennent ses valeurs ? Sont-elles celles
véhiculés par la communauté juive ? « En partie
oui » réfléchit-elle à haute voix. Bien
entendu, on imagine davantage les dames juives participer à
des cocktails bénéfices dans les salons de
résidences somptueuses, mais il y a aussi des Neamtan qui
donne du temps dans des quartiers comme Saint-Henri. Les
pratiquants de la religion juive sont tenus de donner à la
communauté. (Certains ouvrages publiés annuellement
listent les dons en argent faits par les familles
réputées généreuses.) Nancy Neamtan, juive,
donne autrement et incite ses enfants à suivre ses traces.


Les courses de bateaux-dragons sont à la Chine ce que le hockey
est au Québec, c'est-à-dire un sport national. Elles
tirent leur origine d'un grand périple naval de 278 av. J.-C,
où des habitants d'un village chinois traversèrent la
rivière à bord de bateaux-dragons battant des coups de
gongs et tambours pour chasser les mauvais esprits et sauver
l'âme du poète patriotique Chu Yuan qui s'était
suicidé en se jetant dans cette rivière. Depuis,
les Chinois commémorent cet important moment de leur histoire
en organisant des courses de bateaux-dragons.
Et ce Festival International des courses de bateaux-dragons de
Montréal est également une occasion pour la
communauté chinoise de Montréal de se faire
connaître davantage et de tisser des liens avec les autres
communautés du Québec. De nombreux
québécois ayant
adopté des enfants chinois y assistent avec grand
intérêt afin d'offrir à leurs enfants une parcelle
de leur héritage ancestral.
Voici arrivé le grand momentum de la course. Deux grandes
associations de familles chinoises vont maintenant se mesurer
à des québécois et des améticains. L'annonceur
appelle au microphone les cinq prochaines équipes
participantes et tous attendent ce moment crucial de la course avec
impatience. Les paris vont bon train. Les pagayeurs
réchauffent leurs muscles.
Environ 113 équipes
participent, chaque année, à ce Festival
international des courses de bateaux-dragons de
Montréal, depuis maintenant 6 ans. Des équipes
réunissant des participants de diverses origines, des
québécois d'origine chinoise principalement bien
sûr, mais également des québécois de souche,
des américains et parfois même des compétiteurs
venant d'Europe et d'Asie. Des étudiants, des pompiers,
des banquiers, des grandes familles chinoises,
des associations diverses, des femmes
ayant vaincu un cancer du sein, etc., de même que de
nombreuses entreprises qui y ont aussi leur équipe :
Bombardier, Le Casino de Montréal, l'Institut de Cardiologie,
l'Hôpital Mont Sinaï, Motorola, Nortel Networks, Alis
Technologies, etc., bref, un événement réunissant
des individus de toutes origines ethniques, culturelles et de
divers secteurs d'activités.
L'annonceur appelle les équipes afin qu'elles se
réunissent et se préparent à la course.
Préalablement, au comptoir d'enregistrement, un responsable a
noté le nom de tous les participants. Côté
sécurité, un préposé dirige les équipes
vers leur quai et retient la foule des spectateurs aux abords du
bassin. Un fait est à noter : tous ces gestes sont
entièrement bénévoles.
Tous les yeux sont maintenant posés sur les pagayeurs qui
prennent place silencieusement dans les bateaux sous l'œil
protecteur du dragon. En effet, l'oeil du dragon à la proue
des bateaux est réputé protéger des mauvais esprits
grâce à une opération pratiquée lors
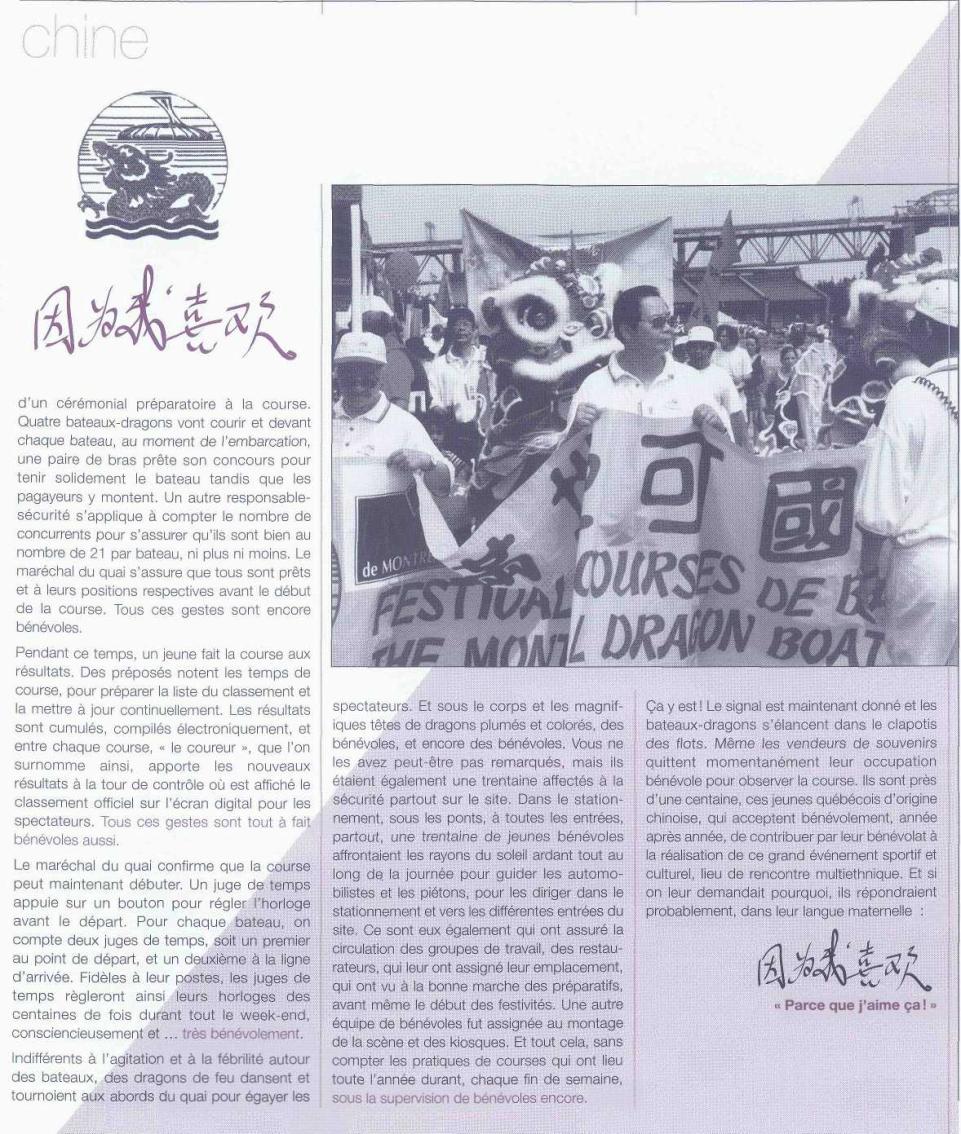
par Margrit Schmuki
Journaliste bénévole

Pourquoi quitter son pays natal, la Suisse, pour exercer le
métier d'agriculteur dans un pays étranger ?
Tout d'abord il faut comprendre que la Suisse occupe une
superficie qui est 38 fois plus petite que celle de la province du
Québec, qu'une grande partie de son territoire est couverte de
montagnes, que sa population est d'environ 6,5 millions d'habitants
et que le développement industriel et urbain prennent de plus
en plus de place. L'ensemble de ces conditions laisse bien peu de
place à l'agriculture et a incité plusieurs personnes du
domaine à quitter la Suisse pour se trouver du travail à
l'étranger. Entre les années 1950 et 1970, ces personnes
se sont surtout dirigées vers la Californie, le Wisconsin ou
l'Australie. Lorsqu'en 1975, les États-Unis ont fermé fa
porte aux immigrants européens, les gens se sont tournés
vers le Canada. Entre 1977 et 1995, plusieurs familles provenant de
la Suisse se sont établies sur des terres du Québec, de
l'Ontario, de l'Alberta et de partout au Canada. Lorsque nous
étions en Suisse, mon époux et moi travaillions sur une
terre que nous avions en location. Les contrats étaient d'une
durée de trois ans et nous nous trouvions dans une situation
qui nous ne garantissait aucune sécurité. Au début
des années 1980, une des solutions qui s'offraient à nous
était de quitter le pays pour l'étranger. Ce fut une
décision assez difficile qui nous a demandé
énormément de courage, puisque cela signifiait de quitter
ce que nous connaissions te mieux pour une terre, une culture et
une langue nouvelle. Mais l'idée d'être propriétaire
nous a grandement aidé à prendre notre décision.

Pour favoriser l'intégration, les combats de lutte
suisse
Au printemps 1983, cinq familles originaires de la Suisse ont
fondé le Club de Lutte Suisse du Centre du Québec. Au
cours des premières années, ils organisaient une
fête par année, l'occasion était parfaite pour nouer
des liens dans la communauté et assister à des
événements folkloriques et sportifs comme les
compétitions de lutte suisse. Ces fêtes sont
extrêmement appréciées par la communauté suisse
du Québec, puisqu'elles permettent de se rencontrer et de
faire de nouvelles connaissances. Ces événements ont
également permis des échanges intéressants avec la
communauté québécoise, puisque les jeunes ont
commencé à inviter les amis qu'ils avaient à
l'école et peu à peu les gens ont développé un
certain intérêt pour cet événement
rassembleur.
Pour organiser ces fêtes, il y a un comité de cinq
personnes qui travaillent à titre bénévole et qui
organisent quatre compétitions de lutte. Les lutteurs sont
récompensés par des prix de toute sorte allant de cloches
traditionnelles, à des meubles, tableaux, outils, etc. Ces
prix, qui attirent de plus en plus de jeunes de partout, sont
achetés avec l'argent rapporté par les commanditaires de
l'événement. Aux fêtes, nous servons des saucisses,
des grillades, des pâtisseries et des vins suisses. Tous les
profits occasionnés par ces ventes sont directement
réinvestis dans l'organisation et l'achat de prix pour les
prochains événements. À la compétition sportive
vient également s'ajouter le folklore. Tout au long de la
journée, il y a des prestations de Jodel (chant traditionnel),
de cor des alpes, d'accordéon, de cloches et de claquage de
fouet. Le soir, nous organisons une soirée amicale où
suisses et québécois se retrouvent pour chanter, danser
et fraterniser.
Perpétuer la tradition, perpétuer l'amitié
Nous espérons que le club pourra continuer à remplir
son rôle de rassembleur pour plusieurs années encore et
que les générations suivantes s'engageront à faire
du bénévolat. Il y a plusieurs de nos membres qui sont
également bénévoles dans d'autres clubs, comme les
jeunes ruraux, le comité international, la relève
agricole, etc. Pour nous, la plus grande récompense
réside dans le fait d'organiser un événement qui
plaît et qui réunit les gens.

L'espéranto n'est pas seulement une langue : c'est aussi le
lien qui unit une communauté évaluée à deux
millions de personnes disséminées sur les cinq
continents. La langue, l'histoire et la culture de l'espéranto
sont supportées, depuis maintenant 114 ans, par le levier
extraordinaire que représente l'engagement bénévole
des espérantophones locaux.

Par Jessy LaPointe. Secrétaire Société
québécoise d'espéranto

Pour de nombreux parents, la course du samedi matin succède à
celle des jours de semaine. Mais au lieu de déposer leurs
rejetons àl'école, ils les conduisent à la natation,
au karaté, à la gymnastique et autres activités du
genre. Or pour des centaines de jeunes Québécois,
le samedi est aussi consacré à l'étude.
Encadrés par des professeurs et des bénévoles, ces
écoliers de fin de semaine étudient la langue et sa
culture de leurs aînés. C'est le cas pour plusieurs
enfants d'origine portugaise qui fréquentent l'École du
samedi.
Lors d'une récente mission économique dans un
état américain, Monsieur Bernard Landry racontait qu'ils
étaient nombreux, les Québécois qui parlaient deux
et trois langues. Cette particularité est souvent le fait
d'enfants d'immigrants qui dès un très jeune âge
s'expriment dans la langue de leurs parents, mais également en
français et en anglais. Les deux enfants de Madame Joaquina
Pires, bénévole à l'école portugaise Santa
Cruz, ont cette chance.
Joaquina Pires occupe le poste de Conseillère en affaires
interculturelles de la Direction générale de la Division
des affaires interculturelles de la Ville de Montréal. Madame
Pires est d'origine portugaise, mais elle travaille au quotidien
avec l'ensemble de la centaine de communautés présentes
dans la métropole. C'est une ambassadrice éloquente de la
richesse qu'apporte la diversité culturelle. Mais encore plus
que son mandat à la ville de Montréal, elle a
intégré le discours professionnel à son quotidien.
Tous les samedis matins, elle assure bénévolement la
surveillance des petits qui se rendent à « L'école
du samedi ».
« Le gouvernement du Québec et le ministère de
l'Éducation, explique-t-elle, ont mis sur pied le progamme
d'enseignement des langues d'origine (PELO) ». En effet,
depuis 22 ans, PELO offre aux élèves des communautés
culturelles la possibilité d'améliorer la connaissance de
la langue et de la culture d'origine.
Ces cours sont dispensés strictement dans les régions
qui recensent un nombre suffisant d'élèves. Certains
groupes ethniques se sont montrés alertes à implanter ces
cours, leur poids démographique et le lobby exercé
justifiant qu'on leur fournisse les moyens de s'organiser. Les
cours ont lieu du lundi au vendredi, généralement avant
ou après les heures régulières. Les cours sont
assurés par des enseignants qui appliquent des programmes
financés et agréés par le ministère de
l'Éducation et les commissions scolaires.
Mais pour la communauté portugaise, c'est surtout la fin de
semaine que ça se passe. Du moins pour certains petits
québécois d'origine portugaise qui s'inscrivent à
l'école du samedi. Ces écoles existaient déjà
avant que le PELO ne soit créé et fonctionnent en
complémentarité du programme du gouvernement du
Québec. Actuellement, elles s'autofinancent à 100 %, bien
qu'il y a quelques années le gouvernement accordait un certain
appui financier. Chaque samedi matin, deux écoles primaires,
dont l'école Santa Cruz, qui abrite 22 classes de la
maternelle à la sixième année, et une école
secondaire sont fréquentées par les jeunes
Québécois qui apprennent la langue et la culture
portugaises. Quoique dispensés en milieu communautaire, ces
cours sont crédités au dossier académique. Certains
enfants fréquentent à la fois le cours du PELO et
l'école du samedi.
Pour rendre les écoles communautaires possibles, et ne
bénéficiant d'aucune subvention du gouvernement, des
frais d'inscription d'une centaine de dollars pour l'année
sont facturés aux élèves. Le budget va à payer
les enseignants et la location des locaux. Les salaires versés
sont minimes mais les professeurs sont là en partie parce
qu'ils adhèrent aux objectifs établis par le conseil
d'administration du centre communautaire, objectifs qui tiennent
compte des orientations prescrites par le comité de parents.
Le gouvernement portugais assure la formation des professeurs. Mais
pour garantir la viabilité des écoles communautaires et
par souci de saine gestion, 30 parents bénévoles à
raison de 6 heures / semaine, assurent l'encadrement des
écoliers.
Parfois, pense Madame Pires, la bonne marche des écoles
communautaires tout comme celle du programme PELO se construit sur
la motivation des parents, qui la transposent à leurs enfants.
Ce sont 4 heures additionnelles qui s'ajoutent à l'horaire des
écoliers... et de surcroît le samedi, comme pour les
élèves de l'école Santa Cruz. Des enfants arrivent
à trouver lourd ces périodes supplémentaires. C'est
peut être ce pourquoi les adolescents ont tendance à
décrocher. Ils veulent leur congé comme les
Québécois et il y a cet emploi de fin de semaine qu'ils
ont trouvé. Mais Madame Pires est d'avis qu'on peut maintenir
l'enthousiasme en expliquant ce que l'école peut leur
apporter.
Madame Pires raconte qu'il y a cette dame d'un autre âge
qui cuisine chaque fin de semaine des gâteaux pour la
collation des petits. Elle vend ses pâtisseries au prix
coûtant mais les offre gracieusement aux enfants qui
n'auraient pas déjeuné. Représentatives d'une
certaine réalité montréalaise, quelques familles de
la communauté éprouvent des difficultés
économiques. C'est pourquoi les parents bénévoles de
Santa Cruz organisent de temps à autres des activités de
financement et les argents amassés permettent l'inscription
des petits dont les parents n'auraient pas les moyens de
défrayer les frais de scolarité.


Le ministère de l'éducation également
De nombreuses recherches ont démontré l'effet
bénéfique de l'apprentissage et de la maîtrise de la
langue d'origine sur l'attitude de l'élève, sur son
développement affectif et cognitif ainsi que sur son estime de
lui-même. D'autres études sur les transferts
linguistiques ont démontré que la langue maternelle peut
faciliter l'apprentissage du français comme langue
seconde.
Les objectifs du programme d'enseignement de la langue
d'origine (PELO)
- Maintenir et améliorer les connaissances de base et les
habiletés langagières de l'élève
- Favoriser les attitudes propres à le rendre capable de
communiquer dans sa langue d'origine et d'apprécier sa culture
afin de renforcer son estime de lui-même et son sentiment
d'identité
- Offrir du support aux apprentissages d'élèves
immigrants en situation de grand retard scolaire
- Faciliter le dialogue interculturel par l'apprentissage d'une
troisième langue
Les effectifs d'élèves en 2000-2001 à la
Commission scolaire de Montréal
- 1910 élèves (86 % langue d'origine, 14 %
troisième langue)
- 28 écoles primaires (regroupement 1, 3, 5 et 6)
- 12 langues : arabe, cambodgien, chinois, créole, espagnol,
hindi, italien, laotien, portugais, tamoul, turc et vietnamien
- 106 groupes-classes
