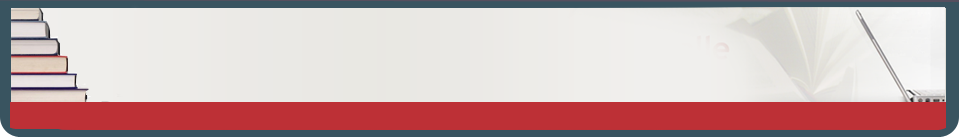- Introduction
- I. Une courte histoire de l'alphabétisation dans la baie des chaleurs
- L'éducation des adultes: d'hier a aujourd'hui
- Une rumeur...
- Entre l'alphabétisation et le développement communautaire [...]
- II. Une nouvelle approche de l'alphabétisation
- Canevas de l'alphabétisation/éducation populaire
- À la recherche de l'action
- Le S.E.A. et les C.E.P.
- L'espace d'un été
- Une question d'existence
- Le normatif
- III. Une expérience type: le comité d'éducation populaire de St-François
- Formation du CEP et débuts de l'alphabétisation
- Automne 81
- Portrait de famille
- Les étapes de l'alphabétisation
- L'atelier d'écriture et les débuts d'un réseau de communication
- En dehors des murs
- Les CEP et l'éducation populaire
- Conclusion
- Les différences au milieu de l'alphabétisation
- Bilan mitige des CEP
- L'alpha populaire et l'institution scolaire
- Tableaux
- I. Données sur les participants aux ateliers alpha par village
- II. Répartition des participants aux ateliers alpha, selon l'âge.
- III. Statut civil des participants
- IV. Statut des participants
- V. D'après le sexe, l'âge moyen des participants, selon le secteur
- VI. Les monitrices alpha des ateliers
- VII. Liste des comités d'éducation populaire par secteur
- Crédits
Introduction
À l'automne 80, je suis à Val Morin au colloque sur l'alphabétisation. L'expérience de la Commission scolaire du Témiscamingue retient mon attention: les comités locaux d'éducation des adultes semblent cette formule conviviale adaptée à une alphabétisation populaire en milieu rural. Je reviens à Québec où je complète quelques ébauches d'une recherche sur la pensée écologique.
En février 81, je suis sur la route qui me ramené en cette Gaspésie natale. À Rimouski, je m'arrête pour discuter d'animation avec un professeur de l'Université du Québec. Le problème, dit-il, c'est que les gens de chez-vous ils ne s'embarquent pas dans les projets. Il me suggère de commencer par une recherche sur cette passivité de la population.
Arrivé à Carleton, je rencontre le directeur du service de l'éducation des adultes de la Commission scolaire et le responsable du projet d'alphabétisation. Les difficultés d'une première expérience alpha ont remis en question les besoins d'écriture en cette région éloignée des centres urbains. Il me donne carte blanche pour faire redémarrer le projet sur de nouvelles bases.
Fort des idées autogestionnaires, croyant en la nécessité d'une réappropriation du social par la population et à la création d'une école populaire, je décide d'élargir l'expérimentation initiale à plusieurs villages. Ma volonté est moins d'imposer les paramètres du projet que de m'associer à la population et de permettre l'émergence d'une alphabétisation qui correspondrait à cette réalité rurale de la Gaspésie.
Ce que j'oublie un peu trop vite, c'est que le service de l'éducation des adultes (S.E.A.) est construit sur une tradition institutionnelle. Il n'y aura pas de problème au début parce qu'on croit plus ou moins à cette formule des comités d'éducation populaire (C.E.P.). Les résistances viendront lorsqu'on s'apercevra que les gens s'embarquent et qu'il faudra dorénavant composer avec les comités.
Mes rôles de développeur et de recherchiste me situent en marge des intérêts de l'institution. Pour plusieurs, je serai une force subversive qui ne travaille pas dans les intérêts de l'école. C'est là une contradiction de la recherche-action institutionnelle où l'on doit accepter cette situation précaire entre l'effigie du bureaucrate et celle de l'animateur intégré à la population.
Je me souviens de cette nuit du temps des Fêtes à Pointe-à-la-Garde, le village qui avait connu une première expérimentation douteuse en alphabétisation. L'Âge d'or avait organisé une soirée dansante avec prix de présence. Nous sommes dans la classe de l'école désaffectée, là où le S.E.A. donnait des cours de français. À deux heures du matin, le joueur de violon, le joueur d'accordéon et le chanteur se taisent. Il fait chaud. Il y a de la fumée, l'air est bleu. La salle est comble et les mots se croisent. Une bouteille roule sur le plancher, les autres sont vides et restent sur les tables, les goulots encore mouillés de la dernière gorgée.
Les lumières s'allument. Une femme âgée s'avance au micro. Les sueurs coulent entre ses seins. Elle exige le silence. Elle ne l'aura pas. C'est un gaillard de six pieds, un vaillant travailleur qui imposera sa voix, «Geneva Gin» aidant. Le numéro sort de la boîte. Un nom est crié, un homme se lève. Il s'avance, c'est l'éclat de rires. Un cri du fond de la salle: «Ôte-toi d'là, t'sais pas lire». Les fêtards se retiennent, il y a un silence. Le gagnant s'est retiré. C'était un ancien participant au cours de français.
I. Une courte histoire de l'alphabétisation dans la baie des chaleurs
La Gaspésie: un Québec rural qui garde un cran de retard sur le monde urbain de l'éducation. L'école du rang était loin et difficilement accessible. En hiver, plusieurs routes étaient souvent bloquées par les tempêtes de neige; au printemps, les chemins défonçaient et devenaient impraticables. À douze, treize ou quatorze ans, les jeunes travaillaient à la ferme, aux chantiers forestiers, au moulin de sciage.
La Loi de 1944 sur l'instruction obligatoire force les jeunes à demeurer un peu plus longtemps sur les bancs de l'école. L'école du rang et du village, quelques couvents, écoles normales et séminaires forment l'essentiel du système éducationnel. 1960, c'est la nationalisation de l'éducation; 1964, c'est la création des commissions scolaires locales (douze) pour l'enseignement primaire et des commissions scolaires régionale (trois françaises, une anglaise) pour l'enseignement secondaire: le chapelet des polyvalentes. Ces quatre commissions scolaires régionales (C.S.R.) ont le monopole de la diplomatique sur le territoire de la baie des Chaleurs: des ateliers de soudure, mécanique, menuiserie, art ménager, cuisine, foresterie, électricité forment les ouvriers peu spécialisés1, futurs chômeurs, assistés sociaux ou travailleurs de l'exil aux ghettos de la baie James et de l'Alberta.
L'éducation des adultes: d'hier a aujourd'hui
Dans le territoire de la Commission scolaire régionale de la baie des Chaleurs, les cours aux adultes ont débuté à la fin des années cinquante. Les agronomes de l'Union des cultivateurs catholiques avaient, dans quelques localités, organisé des cours aux agriculteurs. C'était la formation professionnelle, complétée par quelques cours de métiers du Centre de main d'œuvre. Les cours d'arts ménagers du ministère de l'Agriculture, le budget familial des caisses populaires, les loisirs du ministère de la Jeunesse et la préparation au mariage de l'Office des œuvres diocésaines complètent le tableau de l'éducation permanente d'avant 1962.
C'est à partir de cette date, avec l'animation sociale du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, que l'on oriente l'éducation dans une perspective scolarisante. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les autorités fédérales, instaure une formation «préemploi»: de la cinquième à la neuvième année. Les cours sont pour les adultes qui désirent accéder à la formation professionnelle. Les inspecteurs d'écoles et les commissions scolaires locales se chargent, jusqu'en 1965, des cours de préemploi.
En 1966, c'est la régionalisation de l'éducation permanente sous la tutelle de la Commission scolaire régionale de la baie des Chaleurs, qui couvre le territoire géopolitique du comté de Bonaventure: une quarantaine de municipalités et deux réserves indiennes sur un littoral de trois cent vingt kilomètres. Des cours de culture générale sont organisés: français, anglais et mathématiques. C'est une formation de base scolarisante qui ouvre la porte aux cours de préemploi. Les cours de culture populaire, c'est aussi arts plastiques, couture, art culinaire, chant et solfège, orientation des adultes, orientation des foyers, préparation au mariage...
Les plans du développement de l'éducation permanente proposent la scolarisation des assistés sociaux, des sans-emploi et des jeunes adultes ainsi que la formation d'un personnel féminin aux métiers de serveuse de table, cuisinière de restaurant et d'hôtel-bien paraître devant le tourisme-monitrice de terrains de jeux et aide familiale.
À temps partiel puis à plein temps, des responsables de secteur (entre cinq et neuf villages), assistés d'une secrétaire assument la gestion administrative et pédagogique d'un centre. Cette sous-régionalisation (quatre secteurs) a pour but de rendre fonctionnelle l'organisation des cours. Avec les années, de nouveaux cours et l'animation se sont ajoutés à la panoplie des activités offertes. Somme toute, le service de l'éducation des adultes (S.E.A.) a peu changé.
Le Collège d'enseignement général et professionnel de Gaspé, l'Université du Québec à Rimouski et la Télé-Université sont les derniers arrivés. À l'exception de Télé-Université, ils n'offrent pas de formation continue. Tous «vendent» des cours à la pièce. Il est difficile (sinon impossible) d'obtenir, sans l'exil, un diplôme du postsecondaire.
12% de la population de 15 ans et plus ont, en 1976, moins d'une cinquième année; 35% ont entre cinq et huit années de scolarité: des taux de sous-scolarisation nettement supérieurs aux moyennes provinciales et surtout aux régions urbaines. À l'Ile Jésus de Montréal, 3,7% ont moins d'une cinquième année; à Rimouski, ce taux est de 8,2%. De même, la population de 15 ans et plus de niveau primaire est, à l'Ile Jésus, de 23,7%, de 32,2% à Rimouski et de 47% dans Bonaventure. 2
Sauf un comité pour la défense des défavorisés (relié aux vétérans) et quelques associations de néo-ruraux artisans, les regroupements de locataires, de femmes, de jeunes, de chômeurs, de travailleurs peu et non spécialisés, de théâtre d'improvisation, les coopératives d'habitation, écologistes... sont quasi inexistants dans le comté de Bonaventure.
Les Fermières, les Filles d'Isabelle, les Dames de Sainte-Anne, les Chevaliers de Colomb, l'Âge d'or, l'Union des producteurs agricoles, les Lions, la Chambre de commerce sont les groupes «organisés» dans ce monde rural. Reliés (de près ou de loin) à l'Église et à sa morale, ils sont, pour la plupart, de mèche avec le S.E.A. dans le planning du plus grand nombre des activités d'«éducation populaire»: décoration de gâteaux, tricot, broderie, macramé, courtepointe, buffet froid, couture, lampes en papier de riz...
Au début des années soixante, les spécialistes en animation du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec avaient justifié la naissance de l'éducation permanente par la sous-scolarisation de la population du comté. La nationalisation de l'éducation et le réseau moderne des écoles devaient résoudre le problème de la formation de base. L'alphabétisation semblait chose réglée... jusqu'en 1978, l'année du colloque sur l'alphabétisation au Québec3: Val Morin ou la conscience des défavorisés.
Une rumeur...
1978 est marquée par deux événements majeurs: la volonté de la Commission scolaire de changer le «macramé power» et le colloque de Val Morin sur l'alphabétisation. En abandonnant le «macramé power»4, le S.E.A. perd une part importante de ses activités d'éducation populaire, dont la plus grosse partie du budget est affectée aux cours d'artisanat. Les «rumeurs» de la Direction générale de l'éducation des adultes sont l'occasion d'un nouveau questionnement sur l'éducation populaire. Le directeur du S.E.A. résumait ainsi ce tournant:
«On a senti un mouvement provincial; un vent qui venait nous dire qu'on faisait pas ça (éducation populaire), si bien que ça (...)
En même temps ou presque, on a commencé à recevoir la documentation de Jean-Paul Hautecoeur (...) Le colloque de Val Morin est venu compléter cette sensibilisation».
À une réunion du S.E.A., l'animateur qui revenait du colloque fait part des échanges de Val Morin. L'alphabétisation / conscientisation de Paolo Freire a retenu l'attention des intervenants parce que, dit-on, elle peut être intégrée à une stratégie globale d'animation. Le processus de l'alphabétisation devait conscientiser les analphabètes à la situation de sous-développement des villages et, en même temps, susciter un changement.
«Le but de l'éducateur n'est pas seulement d'apprendre quelque chose à son interlocuteur, mais de rechercher avec lui les moyens de transformer le monde dans lequel ils vivent».5
Entre l'alphabétisation et le développement communautaire [...]
Entre l'alphabétisation et le développement communautaire: Pointe-à-la-Garde
Pointe-à-la-Garde-un village à forte proportion d'une population «impopulaire»6 devient le territoire pilote d'une expérience d'alphabétisation menée par une équipe formée d'un animateur communautaire, d'une formatrice, d'un responsable de projet et d'un observateur.
L'alphabétisation / conscientisation, pour cette équipe, c'est la prise en charge, l'autonomie, le «réveil» jumelés aux apprentissages de la lecture, de l'écriture et du calcul. Le but avoué: permettre au S.E.A. de s'intégrer dans le milieu des démunis-par l'alphabétisation -et de canaliser des groupes de développement pour une refonte de l'économie locale-par l'animation -...
... «Une prise de conscience de leurs potentiels et de leurs possibilités, une prise de conscience aussi des problèmes existants afin qu'ils se conscientisent sur les moyens à prendre pour résoudre ces problèmes. Donc, ils parviennent a une plus grande autonomie et une plus grande indépendance, cela débouche sur une extériorisation (font part de leurs problèmes communs): faciliter la communication entre eux; susciter une vie sociale. De cette façon, ils découvrent leur force, leur pouvoir et l'importance du collectif, du regroupement».7
Le projet démarre. Les représentants de la bureaucratie scolaire s'adressent aux notables de la place: le maître de poste, l'épicier du coin, un professeur, la responsable du club de l'Âge d'or. Ils dressent une liste des analphabètes du village: une cinquantaine de noms y apparaissent. La deuxième étape, c'est la méthode «électrolux»: le porte à porte. La formatrice rencontre une quarantaine de personnes:
«Je rentrais dans les maisons, je me présentais et je les invitais à une soirée rencontre pour des cours de français».
Deux, puis quatre se présentent à l'ancien collège transformé en un centre communautaire qui regroupe le club de l'Âge d'or, la Caisse populaire, la salle de tissage pour les Fermières et un logement à prix réduit.
Les cours commencent et l'équipe du S.E.A. espère qu'il y aura un phénomène générateur de recrutement. En fait, il n'y aura que quatre participants pour toute la durée de l'expérience: trois ans!
Pour l'équipe, ces analphabètes acceptent leur situation, ils ne font pas d'effort pour s'en sortir. Après quelques visites sur le terrain, je serai à même de constater que les représentants de l'institution et les notables de la place entretiennent le même discours sur la classe impopulaire: lâcheté reliée à bien-être social, alcoolisme, ignorance, sans talent, saleté, prostitution, etc.
Cette perception de la classe impopulaire reliée à l'indétermination entre développement communautaire et alphabétisation sont, semble-t-il, au centre des difficultés de ce projet d'alphabétisation. En voulant tout faire d'un coup, on n'a pas fait d'alphabétisation ou si peu. Pour le S.E.A., l'alphabétisation est l'alibi pour entrer dans le milieu. Cet objectif est nourri des valeurs fortes en animation, mais aussi des clichés de la classe moyenne: prise en charge par le milieu de ses destinées; développer l'autonomie des participants; changer la façade des maisons parce que ça paraît mal...
«Le milieu du village est très malpropre, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire dans l'aménagement des parterres. Qu'est-ce que l'on doit faire pour que les cours soient belles? Qu'est-ce que l'on pourrait présenter à nos touristes pour les attirer?»8
Dans cette expérience, le S.E.A. fut incapable de se mettre au diapason des impopulaires et de tenir compte de leur réalité quotidienne.
L'éducation des adultes, au même titre que les polyvalentes et les écoles primaires, dessert de l'éducation pour les classes moyennes: le recalé au primaire en opposition à celui qui avance, le «drop out» du métier court en opposition à l'aspirant ingénieur, le «macramé power» en opposition aux impopulaires en alphabétisation. «À la pratique, on a bien dû reconnaître que l'école était inapte à conquérir toute la «clientèle» analphabète convoitée».9
Les inégalités sociales observées à l'école se retrouvent dans les ramifications subtiles de l'appareil d'éducation des adultes. Son discours idéologique est oppressif lorsqu'il se tourne vers les impopulaires. À l'image de «Madame Blancheville»10, il veut débarrasser la société d'une culture qu'il regarde avec dédain. Témoin cet extrait d'une réunion:
«En formation générale, c'est faux de dire qu'on fait seulement de la scolarisation. On apprend aux gens à se laver, à se tenir comme il faut au cinéma, à une assemblée publique, au restaurant...».
Un langage respectable, un code de la propreté, l'idéologie de la famille, du travail... sont imposés et diffusés par l'appareil d'éducation. Si l'Église a cédé (malgré elle) du terrain, le même langage, les mêmes contraintes, les mêmes finalités subsistent: ordre, propreté, prospérité, respect...
À l'automne 1980, le S.E.A. recevait de la Direction générale de l'éducation des adultes une subvention pour rechercher et implanter un modèle d'intervention chez les analphabètes en milieu rural défavorisé. Ce sera les débuts d'une recherche-action et d'une nouvelle orientation en alphabétisation.
II. Une nouvelle approche de l'alphabétisation
Le S.E.A. était devant un état de fait: la difficulté de rejoindre les analphabètes, les détenus, les sous-scolarisés, les Amérindiens, les travailleurs et travailleuses peu qualifiés, les chômeurs, les assistés- sociaux... Les populaires et impopulaires forment une part importante de la population globale. En ce sens, une minorité jouit de l'éducation.
Intervenant direct auprès de la population adulte, le S.E.A. se donne une priorité: l'alphabétisation. Le mandat sous-entend un objectif plus large: desservir les populaires et impopulaires. Il ne s'agit pas d'une entreprise «fasciste» qui consisterait à s'immiscer dans cette population pour l'obliger a apprendre, mais de lui fournir la possibilité de s'approprier les rudiments du pouvoir, du savoir.
Partir des populaires et impopulaires, de leurs pratiques et leurs couleurs pour l'affirmation de cette «économie politique» (esprit d'échange, de communautarisme, de soutien, d'entraide), c'est du même coup chercher à freiner l'appareil d'uniformisation et de «blanchissage», déséquilibrer l'école en tant que monopole de la transmission des savoirs en permettant et en valorisant l'émergence d'une «école» populaire:
«La question des alternatives à l'alphabétisation se pose maintenant en terme de transversalité et non de paralléléité, en gestes de subversion, en actes de transgression. C'est bien une œuvre d'artiste. Un grand jeu, en jouissance d'écriture! Mais avant, il y aura inversion de la honte, libération des paroles, délivrance. Le geste de l'écriture est la périphérie: au centre fermente la couleur».11
La participation de l'adulte à ce projet (autogéré) d'une école populaire suppose un changement radical dans l'idéologie et la gestion de l'éducation au S.E.A. Cette autogestion signifie concrètement: assurer aux individus, aux collectifs et aux communes le décisionnel, l'identification des désirs éducatifs, l'exécution et l'évaluation des programmes.
Les intervenants (S.E.A.) et les acteurs (population) créeraient un lieu d'autonomie où ils seraient sur un pied d'égalité. La gestion d'ensemble deviendrait collective: les politiques, les priorités, les décisions seraient l'œuvre d'un groupe en constante évolution.
Cette idée de remettre à la population un pouvoir cédé par elle à l'école fut l'une des difficultés fondamentales de cette recherche-action. L'école ne cède pas un pouvoir gagné petit à petit au cours des ans; la population n'est pas toujours prête à cette réappropriation du social dans la redéfinition de l'échange éducatif. Les intervenants du S.E.A. ne sont pas prêts ni volontaires à un détachement par rapport à leur propre institution. Cela suppose un apprentissage de part et d'autre et une volonté commune de sortir de l'idéologie institutionnelle.
Un S.E.A., c'est un organisme éducatif au sein d'une institution d'État: l'école. À ce titre, il est spécialement conçu pour appliquer des normes: un échantillon de boîtes où l'on intègre des étudiants lorsqu'ils répondent aux critères d'admissibilité. Un groupe en action, en évolution et en changement est une source d'insécurité qui a pour résultat la résistance des intervenants. Nous verrons comment le normatif fut développé au détriment d'une stratégie d'animation.
Canevas de l'alphabétisation/éducation populaire
Le projet consistait à amener la population à participer à l'élaboration d'un «plan global» d'éducation populaire. La volonté était d'entamer le «macramé power» à la faveur d'une éducation proche des manifestations de la vie en société: élargir aux catégories populaires et impopulaires une éducation réservée aux couches privilégiées; réaliser un rapport école-population où la deuxième est placée devant le défi d'imaginer une éducation populaire à son rythme, dans son langage, dans son village. L'école n'est plus décisive, mais devient collaboratrice à l'émergence de projets éducatifs du milieu.
Il fallait créer des groupes populaires voués exclusivement à l'éducation: des «comités d'éducation populaire». Composés des villageois, ils devaient refléter la réalité rurale (plusieurs kilomètres séparent les villages, quelques bouts de rang sont de véritables isolats culturels). La promiscuité rurale et l'identification à son village devaient être des assises au développement d'une éducation organique: une prise sur la réalité à l'intérieur de sa communauté d'identification.
Il ne s'agissait pas d'un projet d'alphabétisation fonctionnelle soumise aux normes et valeurs d'une culture de la papiérocratie: le chèque, la formule d'aide sociale et de chômage... ni d'une alphabétisation conscientisante, cette école de la gauche vouée à l'éclairage de l'exploitation capitaliste (l'ouvrier de la grande industrie, les quartiers ouvriers, le syndicalisme et l'identification à un groupe de travailleurs sont des réalités urbaines)... ni d'une alphabétisation scolarisante, ce souvenir de l'exclusion dans la course folle aux bonnes notes, aux «étoiles», aux réprimandes, aux intelligences, les aspects de la classe traditionnelle ou de la cruche à remplir des bonnes mœurs de la classe moyenne.
D'un côté, des personnes qui savent lire, écrire et calculer; de l'autre, des gens qui, pour différentes raisons-dans ce temps-là, on n'allait pas à l'école, l'école était trop loin, la maladie, le rejet par le réseau scolaire, etc.-sont analphabètes. Le projet: regrouper les lettrés et les illettrés sous un même toit, un lieu qui prendrait la forme d'un atelier. Une approche conviviale où l'on s'assoit autour d'une table pour effectuer différents exercices d'alphabétisation. Un langage qui ne trahit pas le code: un sens égal pour tout le monde. La monitrice et les participants savent ce eue veulent dire les mots du langage coloré du canton.
Pour éviter le rapport de domination entre langage cultivé et langage populaire, il fallait recréer l'atmosphère des soirées de bingo, des salles de pool, des soirées dansantes de l'Âge d'or, du chantier forestier où le raconteur tient la vedette, du bar où l'on se retrouve par «plaisir» tout en gardant un œil sur la serveuse!
Des personnes des milieux concernés seraient mieux placées pour dépister et recruter les futurs participants aux ateliers d'écriture. Dans ces petits villages de la Gaspésie, tout le monde se connaît ou presque. Au décès d'un communard, c'est tout le patelin qui se retrouve au salon funéraire!
Cette promiscuité rurale, l'image de soi, l'identification d'être moins que rien rendaient toutefois délicates les interventions d'alphabétisation en milieu rural. L'analphabétisme n'est pas apparent physiquement.
La participation à un atelier d'écriture, c'est la mise à nu, la dénonciation de son ignorance. Ce sont quatre cents, huit cents, mille, trois mille villageois qui constatent: «Savais-tu qu'y savait pas?» Cette mise à nu par la participation à des activités de lecture, d'écriture et de calcul ne devrait pas devenir une occasion de désenchantement. Les ateliers de culture populaire et impopulaire sont des lieux visant la valorisation de cette identité. C'est l'affirmation de la différence. C'est la confrontation d'une culture ignorée, bafouée et méprisée à une culture privilégiée qui définit par son discours (le seul vrai) les limites de la sociabilité.
Dans les ateliers, les participants devaient avoir plein pouvoir sur le programme pédagogique, la gestion du temps, l'organisation des lieux, des fêtes, des activités. Les contenus linguistiques devaient puiser dans l'imaginaire des participants: leurs occupations quotidiennes et la mémoire de leurs expériences culturelles. La langue ne devait plus être prisonnière dans la voie de l'exclusion mais libérée et sollicitée pour dire et écrire tout ce qu'a enregistré la «tête» d'une catégorie populaire et impopulaire.
Aux examens, contrôles et tests se substituerait la fête. Apprendre à lire et écrire change la perception de soi et du monde environnant. Des soupers, des voyages, des soirées avec musiciens locaux... sont dans cette logique d'une libération de la parole populaire.
À la recherche de l'action
Le S.E.A. décide d'un territoire pilote: sept mille habitants dans dix villages, dont Pointe-à-la-Garde qui avait connu une première expérience d'alphabétisation.
Nous sommes à l'hiver 81. Je suis convaincu de la formule «comité d'éducation populaire» pour remettre à la population un pouvoir récupéré par l'État. Après consultations (municipalités, CLSC, institutions scolaires) et analyse du milieu, il est confirmé qu'il n'y a pas de groupe populaire à vocation d'éducation. En l'espace d'un mois, neuf comités d'éducation populaire sont formés.
À l'aide d'une liste des organismes du territoire et de la complicité du personnel de l'éducation des adultes sont identifiées des personnes potentiellement intéressées par le projet des comités d'éducation populaire.
Par contact direct, je m'entretiens avec chaque personne ressource. Cette première rencontre est consacrée à la problématique analphabétisme/éducation populaire et comité d'éducation populaire. La personne ressource est invitée à une réunion de groupe et il arrive qu'elle amène un ou des amis.
Après quelques renseignements, je me fais recevoir ainsi par une personne ressource:
«Toi, tu procèdes pas comme il faut. J'ai déjà été commissaire d'école pis on rencontrait les gens. Si je savais pas lire peut-être que j'aimerais pas faire affaire avec celle-là (en consultant la liste).
À part de ça, tu vas avoir des gens qui sont poignes dans mille choses en même temps. Tu devras peut-être les motiver...
Moi, je te dis, si tu veux arriver a tes fins, il faut convoquer une assemblée publique».
Le lendemain, je reviens avec des crayons, du ruban adhésif, des grandes feuilles. Ainsi prend naissance «l'approche globale». Les bureaux de poste, les épiceries, les bars, les restaurants, les caisses populaires, les salles publiques deviennent des lieux d'affichage:
«Tout le monde sait lire et écrire sauf... Venez et invitez-le».
«Lecture, écriture, calcul, certains peuvent. D'autres ne peuvent pas. Donne-lui sa chance. Invite-le».
«2,500,000 Québécois ont des difficultés à lire, écrire et calculer... 600,000 ne savent pas écrire leur nom: avec eux et pour eux...»
Une lettre dans le bulletin paroissial est lue au prône:
«À tous ceux qui rencontrent des difficultés au niveau de la lecture, de l'écriture et/ou du calcul, aux autres intéressés par une nouvelle expérience d'éducation populaire et à celui qui connaît un ami, un frère, un parent, tu l'invites à notre réunion rencontre. Dis-lui qu'il n'est pas seul; qu'il y a des filles et des garçons, des jeunes et des vieux; des femmes qui veulent, après tant d'années, sortir de la maison; des hommes qui se retrouvaient dans les chantiers à l'âge de douze ans; d'autres demeuraient trop loin de l'école et...»12
«L'approche globale» est différente en ce sens que nous ne communiquons pas directement avec des personnes ressources. Une assemblée publique est convoquée où le S.E.A. invite l'ensemble des habitants de la communauté concernée.
Certains visages sont le souvenir du face à face, d'autres sont appelés par téléphone ou sont les invités de celui-ci ou celle-là. Dans deux villages, une partie des communards présents ont répondu à la campagne de sensibilisation.
Cinq, six, quinze, au plus fort une vingtaine de ces villageois sont au rendez-vous alpha. Le contact direct (8 fois) et l'approche globale (2 fois) sont appliqués aux dix petits villages de moins de mille cinq cents habitants du secteur Matapédia. Le S.E.A. concentre ses efforts dans cette zone parce que: Pointe-à-la-Garde avait connu l'expérience et qu'il fallait continuer; le territoire de la Commission scolaire régionale est trop grand pour le prendre d'un seul coup; c'est un projet pilote où il faut s'ajuster et se corriger continuellement.
Une brève présentation de l'analphabétisme pour ensuite laisser la parole à l'assemblée. Les gens imaginent des possibles, se souviennent d'un cas, identifient les analphabètes du village... Nous passons au visionnèrent d'un vidéo13 suivi d'une discussion.
À la fin de la réunion, les gens sont invités à participer à la formation d'un comité d'éducation populaire qui sera reconnu par le S.E.A. à la réception d'une lettre d'engagement pour la mise sur pied d'un groupe d'alphabétisation:
«Nous (...) les membres du comité d'éducation populaire de (...) nous nous engageons à donner six heures (minimum) par semaine en alphabétisation à compter du 12 mars.
Présentement, nous avons recruté huit analphabètes. Les ateliers se donneront au club de l'Âge d'or par Mme (...)
Mes salutations, »(...)
La première année (printemps 81), le comité est constitué des cercles alphabétisation, coordination et station. L'éducation populaire vient après: l'année scolaire 1981-82.
[Voir l'image pleine grandeur]

L'ensemble des cercles, constitués d'individus disparates forme le comité d'éducation populaire (CEP). Les cercles sont interreliés et une personne peut participer à plusieurs cercles. Cet organigramme a la prétention d'être autogestionnaire. Il laisse de côté les schèmes «président, secrétaire, trésorier» et permet de sensibiliser les membres du CEP au leadership, à l'appropriation des pouvoirs. En même temps, l'autogestion est une éducation au partage des responsabilités et à la création, par la population, d'une alternative populaire à l'école institutionnelle.
Le cercle alphabétisation est composé uniquement des monitrices-alpha. L'éducation populaire a emprunté deux formules: quelques personnes organisent cette activité ou l'ensemble des intervenants (moniteurs, publicistes, promoteurs...) en éducation populaire. La station est l'endroit de ceux et celles qui sont membres du CEP mais qui n'ont pas de tâche précise.
Le cercle coordination-gestion est celui de la «papiérocratie» rendue nécessaire par les échanges avec l'extérieur: S.E.A., M.E.Q., Caisse populaire, municipalité... Chaque cercle est autonome. Le rôle du personnel du S.E.A. devait être le support et l'aide aux actions des comités: animation, secrétariat, banque, soutien.
Le S.E.A. et les C.E.P.
Trois professionnels non enseignants se joignent à moi pour former une équipe d'animateurs. Avec un service de secrétariat, nous sommes le support du S.E.A. aux C.E.P.
Cette équipe n'est pas fonctionnelle. Deux animateurs sont à cent cinquante kilomètres des villages. En plus de la grande distance géophysique de la population-problèmes de communication et de suivi-cette formule est coûteuse en frais de déplacement. Le troisième animateur est responsable d'un centre d'éducation des adultes. Il appréhendait le travail d'animation et faisait peu de terrain. Un an avant cette recherche action, une équipe du CLSC avait reçu des boutades de la population. Le responsable de centre, alors professeur, participait, au nom du CLSC, à des réunions publiques sur l'éducation sexuelle. L'Église, en coalition avec la droite des villages, les avait reçus avec de la musique de messe, des chansons religieuses, des fourches à foin, des chaudrons et des cuillères... Dans les villages, le scénario se répétait et les réunions s'annulaient: l'équipe fut forcée d'abandonner!
Sur les neuf comités, trois ne pourront pas mettre sur pied un atelier alpha. Dans deux villages, la campagne de sensibilisation ne donne pas les résultats escomptés. Les gens qui se sont présentés à la réunion convoquée par les animateurs du S.E.A. sont plus ou moins intéressés par la formule du CEP. Le S.E.A. est-il mal perçu? La réunion fut-elle convoquée une mauvaise soirée?
À une réunion des animateurs, on s'est dit: «Il faut travailler avec les villages qui donnent des résultats. Des expériences bien menées auront un effet d'entraînement». Au troisième village, la monitrice recrute les participants, décide du lieu, débute les activités... Après quelques rencontres, elle déménage à Montréal. Le printemps est là et le CEP attendra l'automne pour relancer le projet.
L'expérience fut courte: trois mois. Les membres des CEP se réunissent au printemps pour une journée d'évaluation. Les monitrices alpha revendiquent: du matériel pédagogique, une plus grande accessibilité aux écoles paroissiales, une augmentation des budgets en alphabétisation (salaire des moniteurs), des moyens de transport pour les participants, des rencontres entre monitrices alpha du secteur, des soirées d'information (par village) avec le S.E.A. et les CEP.
Prenant connaissance des subventions accordées par le ministère de l'Éducation aux organismes volontaires d'éducation populaire, les CEP présentent des projets d'éducation populaire et des demandes d'accréditation. Ils auront les accréditations mais les budgets ne seront pas concédés la première année.
L'espace d'un été
Les CEP sont plus ou moins désorganisés. Ils dépendent de la Commission scolaire tant du point de vue économique qu'organisationnel. Ils dépendent de la commission scolaire pour l'animation, le budget, le support... Ils seront trois mois en inertie.
À la rentrée (septembre), je ne puis que constater une désorganisation du rapport S.E.A./CEP. Les intervenants du S.E.A., appuyés de la direction de la Commission scolaire ont ébranlé le processus dans lequel j'avais, auparavant, placé les CEP.
Le CEP n'est pas reconnu par la Commission scolaire. Cette situation le rend précaire: il ne peut recevoir d'argent pour l'éducation populaire. Une assemblée des commissaires14 suffirait à désavouer définitivement le CEP et ce serait la fin de la recherche-action. Septembre, octobre et novembre sera le temps nécessaire pour que, dit-on, à la Commission scolaire, on dépasse les craintes soulevées: les CEP iront-ils à l'encontre des finalités et buts de la Commission? Seront-ils des opposants aux commissaires? Comment contrôler les fonds publics?
Cette situation crée un état de confusion au sein du S.E.A. Un document intitulé «Formation socio-culturelle» fait abstraction de la recherche action avec les comités d'éducation populaire. Le S.E.A. relègue les CEP à l'alphabétisation jumelée aux cours de l'artisanat. La situation se résume ainsi: le S.E.A., parce qu'il ne peut percer les milieux populaires, s'associe les CEP en alphabétisation; la D.G.E.A. ne subventionnant plus les activités du «macramé power», le S.E.A. cède le parent pauvre au CEP. Ce que le S.E.A. ne réalisait pas à ce moment-là, c'est que l'éducation populaire (partie importante du budget...) serait en chute libre. En novembre, l'éducation populaire est tombée sous le seuil critique. Les professeurs de l'artisanat-les organisateurs de l'éducation populaire -ne sont plus au rendez-vous. Au S.E.A., on se demande comment sortir du marasme. Si le S.E.A. ne dépense pas ses heures/cours, il verra ses subventions diminuées. Les jobs sont en danger!
Alors les CEP-boudés jusque là-sont l'issue. Fin novembre, ils sont reconnus par l'assemblée des commissaires. Pour le S.E.A., la solution est simple: financer les CEP qui organiseront les cours de l'artisanat...
Les CEP n'ont rien changé dans les pratiques éducatives du S.E.A. À Matapédia, par exemple, on taxe de «réunionnette» l'animation auprès des CEP. Un professeur en disponibilité avait accepté le poste de responsable de centre de l'éducation des adultes sous cette condition: ne pas faire d'animation!
Les responsables de centre ne sont pas et ne seront probablement jamais des animateurs. Ce sont des gestionnaires qui ont de l'animation une image péjorative: «J'ai déjà vendu des chars, j'peux ben faire de l'animation» ou encore, «C'est un contrôle qui se fait par téléphone. Ma journée se termine à 4h30».
Faute de moyen budgétaire, le S.E.A. n'avait pas d'autre solution: les responsables de centre deviendraient les animateurs auprès des comités. À plusieurs reprises, ils ont désavoué le projet CEP. Lorsque le directeur leur demanda de faire de l'animation, ils acceptèrent à contrecœur et ce fut les débuts d'une opération séditieuse. On se cache derrière de fausses vérités, parce qu'on ne comprend pas les prémisses nécessaires à l'animation: position du problème, identification des leaders, évolution du groupe, définition d'objectifs à court terme... En conséquence, il n'y avait pas cette connivence recherchée entre CEP et S.E.A. Je prenais sur moi l'initiative de l'animation avec l'objectif de démontrer les possibilités associatives entre l'institution et les comités d'éducation populaire.
Une question d'existence
À l'automne débutent, dans les sept villages, les ateliers de lecture, d'écriture et de calcul. Suite à une tournée des CEP, je sentais chez les membres un certain désabusement devant l'accaparement de l'alphabétisation: les CEP comptent cinq à huit membres. Outre les deux monitrices en alphabétisation et une personne à la coordination-gestion, il reste deux à cinq individus qui sont les membres symboliques de l'existence du CEP. Je craignais leur éclatement.
Dans ma tournée auprès des CEP, je sensibilisais les membres à leur force de revendication et les informais de la position de la Commission scolaire. Il fallait s'opposer aux opérations séditieuses.
Les membres des CEP me percevaient comme leur porte-parole et le revendicateur auprès de l'institution. Ma première tâche fut de briser cette image. Je profitais de l'occasion pour démontrer la relativité des décisions de l'institutionnel-les absurdités du pouvoir-et la force de cohésion du groupe dans une situation de revendication.
Entre les villages, un réseau téléphonique s'est organisé. Les comités ont décidé d'écrire au directeur général de la Commission scolaire, au directeur du S.E.A., au responsable du centre. Les CEP appuyaient leurs revendications sur les accréditations obtenues du ministère de l'Éducation et sur les engagements du S.E.A. Ils demandèrent au S.E.A. une quote-part de son budget de formation socioculturelle. Trois lettres suffiront à faire bouger la machine.
Mon rapport à l'institution fut changé. L'on m'accusa de provocateur, de manipulateur... Le directeur de la polyvalente et le directeur-adjoint me convoquèrent: je ne travaillais plus pour les "intérêts" de la Commission scolaire et ils ne coin prenaient pas mon côté bavard. «Il y a des choses qu'on ne peut pas dire».
Finalement, les comités seront officiellement reconnus comme collaborateurs du S.E.A. en éducation populaire, les budgets seront accordés. Mais le S.E.A. ne se donnera pas de stratégie d'animation. La formation à la créativité, à l'imagination, à la critique des valeurs de classes et de la démagogie sont mises de côté. C'est le normatif qui compte.
Le normatif
Pour être accepté par la Commission scolaire, chaque comité doit, maintenant, obtenir une accréditation du ministère de l'Éducation. Les activités d'éducation populaire réalisées par les comités sont reconnues et financées au même titre que les activités d'éducation populaire* organisées par le service.
* Le service de l'éducation des adultes définit l'éducation populaire comme en ensemble d'activités non scolarisantes, qui permettent de poursuivre une démarche visant l'acquisition d'une plus grande autonomie de la personne.
Le S.E.A. accorde aux CEP deux types de subventions: éducation populaire et alphabétisation. Il s'agit, pour la première d'une somme de base de 500,00$ qui assure un nombre d'heures d'activités minimales et un montant de 0,75¢ par adulte sur le territoire couvert par le comité: un village. Par exemple, une paroisse qui compte une population de 750 habitants peut présenter des projets d'activités pour un montant de 1062,50$ (500 + (750 x 0,75¢) = 1062,50$)
Les comités présentent leurs intentions d'activités au S.E.A. Tous les projets soumis sont autorisés et les budgets sont accordés sur présentation des plans de chaque comité. Les intervenants du S.E.A. et les CEP produisent collectivement les pièces justificatives des dépenses: factures, rapports de rencontres, comptabilité, feuilles de présences, etc...
En alphabétisation, le CEP obtient 12,00$ de l'heure pour chaque heure d'atelier, de recrutement* et de préparation des activités pédagogiques.
* Le porte 3 porte est le 9eul recrutement subventionné.
Le CEP rétribue directement les moniteurs. Ça représente 10,00$ à 12,00$ de l'heure pour le moniteur alpha: un minimum de six heure s / semaine pour des ateliers qui débutent après la chasse (fin octobre) et se terminent avec les jardins (début mai). Sur présentation de factures, le S.E.A. défraie les coûts adjacents: café, souper communautaire, fête populaire, voyage... En éducation populaire, les moniteurs sont payés en regard du budget alloué à chaque activité. Le comité a la liberté (contrôlée) de la gestion de ses revenus et dépenses.
C'est le CEP qui engage les moniteurs appropriés aux différentes activités: un mécanicien pour la mécanique, un bûcheron pour la réparation de la scie mécanique, un menuisier pour la menuiserie... une personne qui sait lire et écrire pour les ateliers d'écriture. Dans les limites du comité, le diplôme, la reconnaissance étatique, la certification institutionnelle ne sont pas des critères d'embauche.
En alphabétisation, les monitrices sont mis à défi de créer leur matériel pédagogique. Le S.E.A. fournit les grammaires, les dictionnaires, les manuels de mathématiques; les monitrices ont sorti leurs anciens livres d'exercices, ont cogné à la porte de l'école et ont quémandé des livres didactiques pour enfants. Le travail: adapter les exercices à une pédagogie adulte.
Après un an et demi de travail sur le terrain, les monitrices ont demandé des cahiers ressources plus complets. Nous avons distribué du matériel «brut» de L'Arbralettre (un groupe Alpha de Sherbrooke), la série du Français 300 (méthode scolarisante pour adultes), le Recueil de scénarios de la C.S.R. du Témiscamingue et Alphabétisation en milieu rural, un cas type de la Coopérative des services multiples de Lanaudière. À ces contenus, ajoutons: des manuels d'histoire, de géographie, de mécanique, de menuiserie, des cartes géographiques, des horloges, des thermomètres et le tableau noir.
Les exercices sont composés de mots, de phrases, de calculs utilisés directement par le participant ou qui font partie de son milieu de vie: ses occupations, son village, son rang, sa ferme, ses enfants...
Une animation et des échanges entre monitrices complètent cette approche. Il s'agit de discussions dont l'objectif est de faciliter les relations entre monitrices et participants: intégrer les monitrices à un processus de compréhension de la relation aidant-aidé d'une part, et aider à la fabrication continue des outils pédagogiques d'autre part.
Notre crainte de voir les ateliers prendre la forme d'une «petite école» nous amenait à garder distants les spécialistes de la pédagogie. Certains résultats mitigés de quelques participants et l'insécurité des monitrices dans la fabrication du matériel pédagogique ont incité le S.E.A. à revenir sur cette position. Pour combler ce qui semble une faille à cette alphabétisation populaire, le S.E.A. a engagé (au moment d'écrire ces lignes) une animatrice avec une formation en psycho-pédagogie. Nous désirons la continuité d'une alphabétisation populaire mais l'embauche d'un pédagogue n'est pas sans poser le problème de la réappropriation scolaire (professionnelle) de l'alphabétisation...
III. Une expérience type: le comité d'éducation populaire de St-François
St-François est un petit village de l'arrière-pays, situé à 29 km de Matapédia. Il comptait neuf cent soixante-deux habitants en 1978. À part une petite scierie, il n'y a pas de catalyseur de l'économie. Il y avait, selon les statistiques de l'aide sociale (avril 1976), 13% de dossiers actifs; en novembre 1979, Statistique Canada dénombre 40% de chômeurs.15
Il y a deux clubs sociaux, deux groupes reliés au développement, deux comités voués à l'éducation, quatre organismes de services paramunicipaux, une caisse populaire, un bureau de poste, une école élémentaire, deux restaurants, trois bars, une salle municipale, une salle de quilles et pool.
Différentes raisons nous ont motivés à choisir ce lieu d'observation. C'est par un citoyen de St-François que nous avons remplacé le contact direct par l'approche globale. Les monitrices alpha sont les moins scolarisées (elles ont une septième année). En l'espace de quatre jours, une jeune analphabète a recruté quatorze individus pour un atelier d'écriture. Dans le rapport institution/groupe populaire, c'est ce comité qui, le premier, a eu des polémiques avec le S.E.A. Nous avons tenu compte des taux élevés d'aide sociale et d'assurance chômage dont le corollaire est l'analphabétisme.
Formation du CEP et débuts de l'alphabétisation
En mars 1981, au sous-sol de l'école élémentaire de St-François se présentent quatre personnes pour former le comité-un commissaire, une ancienne institutrice, une restauratrice, une ménagère-et cinq volontaires pour participer aux futurs ateliers d'écriture-un garagiste, une jeune fille qui avait été malade dans sa jeunesse, une autre qui gardait ses parents et deux ménagères qui s'informent si ça paye-ces dernières ne sont pas revenues!
La restauratrice se jumelle à une ancienne institutrice de l'école de rang. Quelques analphabètes ont été sensibilisés par la lecture de la lettre au prône. Ils participent à la soirée d'information et ils seront les maîtres d'œuvre du recrutement:
«Quand j'ai vu que c'était Irène pis Zita qui faisaient ça, j'ai téléphoné à mon oncle pis ma tante m'a donné des noms (...)
Quand les gens ne savaient pas trop, j'allais les voir (...) Pis y a pas juste moi qui a fait ça: Léonard, Gracieuse, Israël (...) Là, on s'appelait pis on appelait Irène et on y donnait les noms».
Les monitrices ont pensé tenir les ateliers au restaurant du village. Ils se déroulent au couvent. Les participants sont formés des jeunes sans emploi, quelques retraités, quelques chômeurs en attente de l'été, quatorze personnes recrutées en quatre jours.
Les monitrices sont préoccupées par l'aspect organisationnel: le local, les manuels, l'organisation du CEP, la pédagogie. Je les sensibilise aux dangers de la démagogie... Je les mets à défi de créer une atmosphère qui ne rappellera pas l'école aux participants. On part de cette prémisse: les communards sont capables de créer des lieux éducatifs au reflet de l'identité populaire; pour ce faire, ils ont besoin d'une sensibilisation/formation/ information aux valeurs des classes sociales et aux règles des cadres traditionnels de l'école.
Le S.E.A. est distant. La désinstitutionnalisation de l'éducation ne fait pas consensus entre les professionnels: la qualité, le professionnalisme, le corporatisme reviennent régulièrement dans les discussions.
Au printemps 81, les comités sont implantés. Les ateliers d'écriture peuvent débuter. L'observation, les entrevues, les rencontres ne commenceront qu'à l'automne.
Automne 81
Le comité de St-François comprend: trois ménagères, un commissaire, la directrice de l'école paroissiale, un ébéniste, un agriculteur, son amie, une ancienne institutrice, une jeune drop-out du Cégep. Outre l'alphabétisation, les gens sont répartis comme suit: trois à la coordination/gestion, quatre à l'éducation populaire et une à la station.
Au cercle alphabétisation, les activités ont été interrompues avec l'été. L'ancienne institutrice a donné sa démission (raisons personnelles et familiales). La restauratrice est restée et sa fille a remplacé l'institutrice. Une ménagère a complété l'équipe de monitrices.
Cette dernière est d'une grande famille de cultivateurs. Elle a complété sa septième année. Ils étaient douze et peu ont continué les études. «Très tôt, on se mariait ou on travaillait à la ferme». Son mari a eu quelques commerces qui ont plus ou moins marché. Aujourd'hui, il possède une disco-mobile. La restauratrice est, elle aussi, d'un milieu agricole. Tout comme sa compagne, elle a complété sa septième année. Ils étaient neuf. «Chez-nous, on n'a pas fait plus d'une septième année». Son mari était forgeron, le métier s'est dégradé, la forge a fermé et a fait place à un petit restaurant de village. Sa fille vient d'abandonner le Cégep: «J'avais l'impression d'y perdre mon temps». Elle ne sait pas de quoi sera fait demain. Elle veut prendre une expérience d'alphabétisation. Son rêve, c'est d'alphabétiser en Amérique du Sud.
Les deux premières monitrices sont impliquées dans les organismes suivants: Filles d'Isabelle, Fermières, artisanat, comité de développement, Secouristes St-Jean. La fille vient «d'arriver au pays». Elle trouve le temps long: ses amis n'y sont plus. Pour passer le temps, elle est serveuse au restaurant de sa mère et participe aux activités du CEP.
À l'automne 81 commence l'opération «second départ». Les monitrices s'occupent de recrutement: une note dans le bulletin paroissial, l'affichage à l'épicerie, au restaurant, au Bureau de poste ne donnent pas les résultats escomptés. Deux, puis trois des anciens sont rejoints. C'est insuffisant. Les monitrices feront du porte à porte. Aidées des anciens, elle rencontrent des nouveaux.
«On a rencontré les anciens et des nouveaux. Les gens nous donnaient des noms. Moi je connais tout le monde (...)
On se présentait, on disait: «On fait de l'alphabétisation; on a su que tu serais intéressée à participer à un atelier d'écriture».
Les gens sont réticents au début. On donne une description de ce qui se passe aux ateliers. À la fin, on l'invite à continuer avec nous autres. On l'attend pour le début des activités. On fixe une date de rencontre (...) Aujourd'hui, ils nous disent que c'est cette visite qui les a convaincus. Sans ça, ils ne seraient pas venus (...)
Pour la plupart, ils se sont présentés à la première rencontre. À part la maladie et les déménagements, ils ont continué de venir».
Il y a un autre recrutement informel. Les monitrices ont recruté directement dans leur rang. Ici, pas de stratégie, pas de méthode d'approche. Avec les siens, une monitrice fait part de sa nouvelle expérience. Les informations suscitent de l'intérêt chez les pairs. Entre l'information et l'adhésion, le fossé n'est pas grand, l'effort est minimisé:
«J'ai eu ces deux-là, une tante et une cousine. Je n'avais jamais eu l'intention d'aller là pour ça. Elles se sont offertes.
Je ne serais jamais allée les rencontrer pour les recruter. Je n'avais pas leurs noms. Je me suis dit: je ne peux pas les refuser même si c'est dans la parenté».
Quatre participants et une monitrice ont un lien direct de parenté (cousin, oncle, tante). Quatre participants ont des liens directs ou indirects entre eux (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre). Deux sont des amis de longue date. Un est voisin. Chaque monitrice connaît ses participants. Eux ne se connaissaient pas très bien. Ils s'étaient déjà croisés mais ne s'étaient pas adressés la parole: «On se connaît de même. On se connaît toute par icitte. On s'est déjà vu».
Portrait de famille
Simone est dans la vingtaine. Son père est cultivateur. Il est malade et ne peut travailler. Sa mère est nerveuse et frôle la dépression. Le revenu, c'est l'aide sociale pour tout le monde. Simone a cessé l'école en deuxième année. Elle a des troubles cardiaques et l'école en serait la cause (version de sa mère): un professeur l'aurait maltraitée. Dans la trentaine, Gracieuse et Pâquerette sont issues d'une famille de douze enfants. Le père était bûcheron et fermier. Il est aujourd'hui à sa retraite. Gracieuse a toujours eu des problèmes avec ses jambes. Jeune, elle ne peut se rendre à l'école. Elle abandonne en troisième année. Elle vit présentement avec son ami Biel. Parce qu'elle l'aime depuis cinq ans (vie commune), elle perd son revenu de l'aide sociale. Ensemble, ils apprennent à lire et écrire. Dans la quarantaine, Biel n'a jamais été à l'école. «Chez-nous, l'école était trop loin; à part ça, c'était toujours fermé». Il fait le métier de son père: bûcheron l'été, sur le chômage l'hiver. Pâquerette est mère de quatre enfants. Son mari ne travaille pas. L'aide sociale c'est, dit-elle, nettement insuffisant. Elle ne peut surmonter un état dépressif. Des tentatives de suicide se répètent, elle est fréquemment internée. Léonard et Berthe forment un couple dans la cinquantaine. Pour eux, le rire est facile, les histoires se succèdent. Les enfants travaillent «en ville à Montréal». Léonard est contrôleur de la coupe de bois du groupement forestier à qui il a cédé certaines parties de sa terre. L'hiver se passe à l'intérieur avec Berthe. Le chômage est le revenu de la saison froide. Paul est sur l'aide sociale. C'est un vieux garçon dans la cinquantaine. «L'école, on n'avait pas de temps à perdre là. J'ai arrêté en deuxième année». Paul a toujours été bûcheron. Dans le temps, il bûchait comme un forcené. Le mal de dos, l'arthrite ont cloué ce travailleur acharné. «À cinquante ans, dit-il, je suis un gars fini». Israël est dans la soixantaine. Il était bûcheron. Il ne travaille plus pour les même raisons que Paul. En attendant sa retraite, il retire l'aide sociale. Les fins de semaine, il arrondit les revenus en jouant de la musique avec sa femme dans les maisons privées. Il était en deuxième année lorsque la maîtresse lui donne un coup de «strap»16 en pleine figure: «J'ai renversé mon bureau, j'ai tiré ma chaise, j'étais en colère... Je n'ai plus remis les pieds à l'école». Roland, vingt et un an, c'est son père qui l'envoie. Il arrive de Montréal. Il cherchait du travail ou des cours, il est revenu bredouille... Pas tout à fait, parce qu'il a appris à sauter le métro: secret bien gardé. «Chez-nous, dit-il, on a rien appris à l'école. À Montréal, y m'ont dit: apprends à lire! J'étais facilement perdu. Je me suis dit «d'la marde», pis chu revenu en Gaspésie. Là chu icitte, pis c'est ben correct avec le B.S». Gaby est dans la quarantaine. C'est un vieux garçon. Il vit avec sa mère à la maison paternelle. En deuxième année, il fut renvoyé de l'école à cause de l'épilepsie. Son père lui apprend différents métiers: électricien, plombier, menuisier, bûcheron et mécanicien. Il bricole un peu de tout. Gaby sort rarement du village. Il n'a jamais travaillé, il retire l'aide sociale. Louisa va se coucher une nuit comme toutes les autres. Au petit matin, elle est transportée à l'hôpital. À l'urgence, on réalise qu'elle est paralysée. Un côté ne répond plus aux ordres du cerveau. Elle oublie tout: son nom, comment tenir une cuillère, manger, parler, écrire, lire... C'est aux ateliers d'écriture qu'elle réapprend le maintien du crayon et le contrôle de la parole... Fidèle c'est un ancien alcoolique. «Moi, j'ai été quarante années sans vivre. Là, je perdais ma femme». Il participe aux activités des Alcooliques anonymes. Apprendre à lire et écrire lui permet une plus grande intégration à ce groupe social. Fidèle est à sa retraite.
Tous ces gens se réunissent au vieux couvent, deux soirs par semaine pendant trois heures. Le vieux couvent de briques rouges appartient à la Commission scolaire locale17. Les sœurs qui s'occupent de la gestion y ont un appartement. Le reste est partagé entre le club de l'Âge d'or, les Alcooliques anonymes, un notaire et Passe-Partout (une activité pour les enfants du pré-scolaire). Ce local est utilisé par les participants de l'atelier d'écriture. C'est une grande classe avec un tableau noir et de larges fenêtres. Les pupitres ont été remplacés par de grandes tables.
Le CEP a fait des demandes pour obtenir un local réservé exclusivement aux ateliers d'écriture. La première réponse fut négative. Des demandes répétées ont finalement eu raison du notaire. L'objectif était de créer un lieu où les gens pourraient se rendre (en tout temps ou presque) pour échanger et continuer des exercices. Ce serait le début d'une école populaire. Or, l'accès est demeuré limité et les adultes-considérés ici en enfants -ne peuvent décorer ou aménager le local, chasse gardée de la bonne sœur et de la Commission scolaire. Pour cette dernière, l'école n'est pas un lieu de vie mais des locaux utilisés rationnellement-respect d'un horaire-aux fins éducatives et sociales. Pour les intervenants scolaires, l'alpha c'est ni plus ni moins qu'un cours de français.
Pour préparer les monitrices au travail d'alphabétisation, j'ai organisé deux types de session/formation: par village (mensuel) et pour le secteur (annuel). Les sessions ont pour but de faciliter l'appropriation du matériel alpha et la compréhension des objectifs d'une alphabétisation basée sur le langage.18
Les étapes de l'alphabétisation
La première étape me paraissait sous-jacente à la compréhension de l'idéolgie: le langage populaire devait être la matière des exercices, il fallait créer une atmosphère propice à l'échange de connaissances: reconnaître les acquis de chacun, enrayer le statut «savoir-vérité» relié au professeur et «ignorance = erreur» relié aux démunis. Le travail me paraissait simple: un individu, un langage, des exercices références et des exercices adaptés.
Une fois sur le plancher des vaches, comme on dit ici, les monitrices ont manqué d'outils concrets pour alphabétiser. L'évaluation des acquis s'est faite à tâtons. À l'exception de deux participants qui ne savaient presque rien, les trois monitrices ont eu de la difficulté à ajuster les exercices à chacun: trop difficiles ou trop faciles, les travaux décourageaient ou ennuyaient.
Une autre difficulté fut de passer d'un matériel pédagogique pour enfants à un matériel pour adultes. Une monitrice a utilisé un exercice de coloriage: les participants peignaient de différentes couleurs des lettres de l'alphabet! Ce travail entraîna un abandon: «Quand on m'a fait faire ça, j'm'ai dit: chu capable de colorer à la maison». Côté langage, même si certains mots n'étaient pas reliés au monde rural-métro, autoroute, avion, aéroport... les monitrices s'accomodaient assez bien de la transformation des contenus linguistiques.
Après quelques ateliers, je constatais un type de rapport qui pouvait contrarier l'atteinte des objectifs visés: les participants n'identifiaient pas les monitrices à un égal. Les stéréotypes du professeur et de la classe demeuraient forts dans leurs représentations de l'atelier. La correction, la préparation des exercices, le leadership accentuaient chez les participants cette image du professeur. Sans s'en apercevoir, les monitrices jouaient le jeu traditionnel du pouvoir. Il a fallu plusieurs semaines pour en arriver à briser les clichés de ces rapports sociaux: faire prendre conscience aux monitrices du rôle qui leur était voué; faire prendre conscience aux participants du rôle qu'ils attribuaient aux monitrices. Il a fallu modifier les visions mutuelles de chacun pour changer les jeux de rôles. À chaque semaine, je questionnais les monitrices sur cette dimension de leur tâche. Elles ont commencé à s'approprier le discours de «l'aidant», elles ont changé leurs rapports avec les participants: «C'est pas moi qui décide, c'est toi. Si vous aimez ça, vous me le dites», etc...
Quelques mois plus tard, je rencontrais un participant qui m'explique comment il présente l'atelier à un ami: «J'y ai dit: viens, tu vas voir que c'est pas gênant, pis si t'aimes pas ça, tu y diras à Blanche. On est pas obligé pis c'est nous qui décidons...»
L'atelier d'écriture et les débuts d'un réseau de communication
Un participant me demande s'il y a d'autres groupes comme celui de St-François. Je l'informe de l'existence des six ateliers dans les villages avoisinants. Sa curiosité et son enthousiasme «mitigé» me donnent l'idée de mettre sur pied un journal populaire. Le petit Journal, financé par le S.E.A., sera diffusé aux participants des ateliers, aux monitrices, aux membres des CEP et au personnel du S.E.A. L'objectif était de créer le dialogue entre les intervenants, les membres des CEP et- le S.E.A. Il invitait à la critique de l'éducation populaire et de l'alphabétisation.
Le petit Journal est devenu l'outil privilégié des monitrices et des participants aux ateliers d'écriture. Ce sont eux qui décident de son contenu: expérience des monitrices, vécu des participants, histoires folkloriques, récits des pratiques quotidiennes, recettes, chansons. Cette vocation première «d'outil d'échange» n'a pas changé, mais un usage inattendu d'outil pédagogique s'est ajouté.
Le petit Journal informe et sensibilise le personnel du S.E.A. et les membres; des CEP aux ateliers d'écriture. Il aide les analphabètes à sortir de l'isolement. C'est un outil pédagogique intéressant (exercices de lecture et récupération des contenus des ateliers), distribué directement dans les maisons par le courrier du roi. Son contenu reflète l'appropriation symbolique et l'identification renforcée, revalorisée de la culture populaire.
Extrait du: Le Petit Journal, vol. 1, no 6, mai 1982, p. 10
Ge vais vouis perliez au suget de la cabane a sucre. Pour commencé on prépare la moto-neige, et les raquettes et les chaudières. L'a je suis partis pour la cabane a sucre. La je rendu je me prépare pour entailler les érabres. Je souis nu pied de larbre je prend ma perceuse et leis percent pour avoir de l'eau érabre. Après une près lautre la ca y va. Ca picoche sa siffle et sa chante et sa jacasse sa va bien. ile sons bonne-humeur. En commencet sa va toujour sa ira pas toujours bien sur la fin. La misère commence les vaisseaux sont plains il faut rammassés l'eaus et transvidèr leau pour l'anmener a la cabanne a sucre je vais allumé le feu. Pour faire boullir il faut que leau diminue pour faire du sirop ét du sucre, un peu plus tord la misère commen. La neige est plus bonne, pour la moto-neige savense plus. ca défon et on pousse avec avec la moto-neige. La on travaille bien dure on tonpète les colice et les tabèrnaque le démon été arivé son amie son amie arrive a lui jai attendu perler il lui adit j'ei pas veu personne a seut que ge perlait je les avent pas veu, il rendu a la cabanne il étai pas male épluisé il assoit et la tete pas male basse et la y prend une petite bièrre pou san encouragé. le sirop commence. eitre a poin il sans dord. sa petite bier il avec pas faite. l'a le sirop a brûle qua qui sa réveillèr ilétait pas tros de bonhumeur. La sa res pas été fasile que sa famme aurait été it tate la boche. Le lent-demain soir sa les pas mal mieu. l'a on a fait une frifke après la frifke sais le souper pour le souper it avec du poison. Après le poissons sais la bière, un peu plus tard la veiller commence on a du fonne et on pas pensé au souper ou on a prit la ca dense plus entre hommes en semble ca it yva sais différen, dense avec les femmes l'a ca y va. ca chante et ca dense un peu plus tard le sucre et le poisson et la bière sa fait un mélange on été malade. La sa prit par desard avec les culettes a la main. La et avec plus de place a la toilette it en avec toujours de la toilette et de la cabanne a sucre. La il en avec de la tire sur la neige perconne a voulu en mengè, sai tout que ge savais sur la cabane a sucre. Ge vais arérté mais dicour plate, Mme Leblanc et Mme Boudreau et mon amie Reymon et mais autres amie on les aimes baucoup. Au Revoir et bonsoir a tous.
Israel
En dehors des murs
Ce CEP a procédé à différentes campagnes de sensibilisation et d'information sur l'alphabétisation: affichage, lecture d'une lettre au prône, assemblée publique, etc. Malgré ces démarches, les ateliers sont peu connus (de l'intérieur) par les citoyens. Un point retient l'attention: la faible scolarité des monitrices.
Les quelques villageois rencontrés me questionnent sur les critères d'embauché de ces dernières. Pour eux, ces gens sont incapables d'enseigner. Ils comprennent encore moins lorsqu'ils font référence aux exigences du ministère de l'Éducation pour les professeurs de l'école publique. Le pouvoir de l'école, de la diplomatique, du professionnalisme, du corporatisme est vivace. Il y a aussi de la jalousie parce que les monitrices sont rémunérées.
Le CEP et le S.E.A. n'ont rien fait officiellement pour neutraliser ces résistances dans le village. Jusqu'à maintenant, j'ai compté sur les résultats des apprentissages chez les participants. Prenons le cas type de Gaby.
Les villageois le considèrent en adulte-enfant: «un gars pas sérieux» de dire la propriétaire de l'épicerie. Ce n'est pas un secret pour personne: Gaby ne connaissait pas la différence entre un dix et un cinquante piastres, il ne pouvait lire les étiquettes, etc. À l'épicerie où les gars se ramassent l'avant-midi, il reçoit cette boutade: «C'est pour les niaiseux ces cours-là». Il a répondu: «O.K., c'est pour les niaiseux mais au moins ça déniaise». Il les a regardés en pleine face et s'est mis à rire. Les jours suivants, il se présentait en disant: «C'est le niaiseux qui arrive». Un bon jour, les gars lui ont dit: «Laisse tomber Gaby, on n'était pas sérieux». Avant les ateliers d'écriture, Gaby fuyait devant ces situations.
Les démonstrations vivantes feront disparaître un autre mythe: «Ces gens n'ont pas appris et ils n'apprendront rien». C'est là une autre croyance qui prend assise dans la dévalorisation des populaires et impopulaires, jumelée à l'image tronquée de l'école institutionnelle.
Les CEP et l'éducation populaire
Le cercle éducation populaire est le parallèle de l'alphabétisation. C'est le tandem qui forme le CEP. Au début, les membres des comités ne comprenaient pas le lien entre alphabétisation et éducation populaire. Certains n'avaient pas intégré l'idée des cercles et parlaient du comité alpha et du comité éducation populaire. Il fallait donc revenir à une étape antérieure et démontrer l'aspect de l'autonomie des cercles et de l'interdépendance du tout dans un même but: la réappropriation du social par-delà les technocrates de La bureaucratie et de l'institutionnel étatique.
Pour le responsable du centre de l'éducation des adultes, cette approche enlevait à la population le droit légitime de recevoir les services éducatifs du S.E.A. Il fallait faire comprendre à l'institution la nuance entre une offre de cours sélectionnés et le support à l'imaginaire social pour une définition organique de l'éducation populaire. C'est la problématique de la recherche-action «institutionnelle»: faire progresser deux groupes distincts vers un but commun.
Le S.E.A. a résisté sur cet aspect de l'éducation populaire. L'alphabétisation ne posait pas ce problème: il s'agissait ni plus ni moins d'un cours alternatif et d'une offre de services. La planification en formation socio-culturelle et le peu de support à l'animation venaient de cette mésentente sur le fond de la recherche-action. Plusieurs discussions n'ont pas changé la position des responsables de centre.
En janvier 82, je décidais de procéder à l'animation des CEP et de démontrer les possibilités de l'imaginaire social. La première étape fut de faire saisir à la population l'aspect global du CEP. Je fis une tournée d'information consacrée à l'organigramme du CEP. Une fois ceci assimilé, il fallait procéder à la deuxième étape: le défi de l'imaginaire jumelé à la connaissance du comité dans les villages. La stratégie fut de lancer les comités sur une étude des besoins éducatifs de chaque communauté. Les comités ont emprunté différentes approches: rencontres dans les maisons, questionnaires distribués à l'église ou par le courrier, assemblées publiques, affichage, boîtes à suggestions et échanges informels.
Les résultats compilés, j'étais en mesure de constater la place forte de l'institutionnel dans les représentations sociales de l'alphabétisation. Des monitrices avaient tendance à répéter l'école, et en éducation populaire le comité pouvait devenir une simple prolongation du S.E.A. Parmi les activités proposées par la population, plusieurs avaient déjà été offertes par le S.E.A.
Pour dépasser le viscère institutionnel, il fallait oublier le chemin traditionnel de la démocratie. Dans une société bureaucratique, cette procédure est devenue aléatoire. Mon travail d'animation fut donc orienté vers cette problématique: les faux désirs, ceux dictés par l'État et les vrais, ceux qui émergent de la population en considération des valeurs de classes et des démagogies.
Les CEP ont sélectionné leurs activités en les divisant en deux: les activités traditionnelles-boussole, alimentation naturelle, 3e âge, premiers soins, colloque populaire - et non traditionnelles - théâtre d'improvisation, colloque populaire, exploitation des ressources humaines et naturelles, études historiques.
L'éducation populaire libérée fut pour la population l'occasion de se réapproprier le réseau des échanges de connaissances: un bûcheron enseigne les principes de la scie mécanique; les villageois animent les ateliers de leur colloque; le fondateur de la coopérative locale d'alimentation expose les principes du coopératisme et par cette activité, on retrace les débuts de la colonisation de l'arrière-pays; un couple du troisième âge communique le difficile passage de travailleur à celui de retraité; une restauratrice résume quelques principes de gestion.
Les populaires «privilégiés» organisent et monopolisent le cercle éducation populaire. Les analphabètes (populaires et impopulaires) sont au cercle alphabétisation. L'intégration de ces deux groupes à une même structure éducationnelle - le CEP - devait (à plus ou moins long terme) permettre aux analphabètes une intégration aux activités de l'éducation populaire: les débuts de la post-alphabétisation.
À St-François, après deux ans et demi d'atelier d'écriture, les participants ont collaboré à une activité d'éducation populaire sur le rapport hommes-femmes (discussions après le visionnement d'un film), ils se sont intégrés à l'organisation d'un souper communautaire et ont participé à un théâtre d'improvisation. Au début, gênés, ils s'étaient placés en retrait au fond de la salle. Le travail en atelier a fait éclater les dernières résistances. Les monitrices ont intégré les participants et les ont associés aux populaires privilégiés.
Pour plusieurs, la parole s'est déliée et ce fut le commencement d'une insertion sociale.
Cette initiative demeure toutefois isolée et nous ne croyons pas réglées les questions de rapports de classes, de domination institutionnelle, d'autogestion populaire, de démocratisation de l'éducation.
Conclusion
«C'est une famille de bons à rien qui fait juste de boire de la bière, de chasser (...) y vivent dans une cabane, un vrai trou, pis ça sent mauvais le diable...»
Ces propos sont de Marcel, un ancien participant aux cours de français de Pointe-à-la-Garde. Il me décrivait son voisin. Au début de cette recherche, il y a de cela trois ans, quand je suis arrivé au bout du rang pour rencontrer Marcel, j'avais été surpris par cette distance qu'il prenait vis-à-vis son voisin. Ils étaient pourtant tous les deux analphabètes et vivaient de l'aide sociale complétée par quelques jobs en «dessous de la table» et d'une agriculture de survivance: jardin familial, lapins, poules, porcs, veaux. Bottes Kodiak, chemises rouges à carreaux, pantalons verts, casquettes à «palette de soleil» me donnaient l'impression d'avoir affaire à une même population. Au fil des mois, je commençais à découvrir des différences.
Marcel possédait une petite maison à deux étages. Au premier, il y avait la cuisine: un poêle à bois, une cuisinière électrique, des robinets conventionnels, des rideaux bien fixés aux fenêtres, un «set» de cuisine chromé aux bancs de plastique, de l'arborite rouge sur le comptoir. Le salon et la chambre des maîtres occupaient le devant de la maison. Au deuxième, on retrouvait les chambres des enfants et la toilette. À l'extérieur, une galerie donnait un air de grandeur à la maison. Un gazon était préservé par une clôture basse. À l'arrière, des «sheds» lardaient les animaux et le bois à l'abri; une place était réservée au jardin familial. Marcel avait construit sa maison et y habitait avec sa femme et le plus jeune qui ne s'était pas encore trouvé de l'emploi.
Quant à son voisin, il habitait avec sa femme et ses cinq enfants, une petite maison construite à proximité de la route. Le «shed» à bois était annexé à la maison; la porte donnait sur la cuisine; une pompe servait à amener l'eau dans un récipient creux; une truie19 chauffait la maison; la cuisinière flanquée au centre d'un mur faisait face à une planche de contre-plaqué apposée sur des madriers servant de table de cuisine avec des chaises disparates; les rideaux étaient à quelques fenêtres suspendus avec de la broche; la deuxième pièce servait de chambre à coucher partagée par les parents et les enfants. Des matelas étaient disposés sur le plancher pour les enfants; les parents couchaient sur un lit isolé par un rideau agrafé au plafond. À l'extérieur, de grandes herbes poussaient ici et là au travers de la terre battue. Derrière la maison, quatre autos étaient démantibulées: le «houd» arraché, les moteurs enlevés, les différentiels ouverts. Les seize roues étaient tournées vers le ciel dans l'attente d'un acheteur de vieux fer. Tandis que le soleil séchait les «penmans», les jeans, les chemises, les robes, les enfants se balançaient bien assis dans les pneus coupés en deux et suspendus à la branche d'un gros sapin. Au fond du terrain, on reconnaissait la chiotte et le jardin laissé en friche.
Marcel et son voisin ont une «économie culturelle» que j'appellerais communautarisme. Le salaire de l'État (l'aide sociale) est complété par une organisation du travail au noir:
«Quand j'ai construit ma maison, j'ai coupé le bois sur la terre de la Couronne. C'était Albert, pis John, pis mon fils Roger qui m'ont aidé à construire en échange de quoi je leur ai donné du bois».
De même, ils ont une morale de fer. Entre eux, il y a une intégrité qui, si elle est trahie, conduit à l'exclusion. De là l'expérience de la solidarité qui joue sur l'identité sociale et la conscience de leur différence d'avec la classe des privilégiés:
«Chez-nous, on a tous été envoyés au professionnel court. Les plus vieux ont doublé pis se sont faits battre par les professeurs. Papa nous a toujours dit de se méfier de ce gang là, parce que ce sont tous des crosseux».
Malgré un certain nombre de points communs, Marcel et son voisin sont dans des mondes différents: celui d'Apollon, de la mesure, de la forme, de la composition harmonieuse et Dionysos, le chaos, le démesuré, le difforme, le flux bouillonnant de la vie et de la frénésie sexuelle. Parce que nous vivons dans un monde de la mesure et de la forme, le voisin de Marcel est bafoué par les forces de l'ordre et du contrôle social. Il fait partie des impopulaires, des exclus:
«Chez-nous, on avait rien à manger. Papa buvait tout le temps, maman était souvent malade et dépressive et se chicanait avec le bonhomme. Très tôt, je changeais les couches et les lavais, je cuisinais et faisais le ménage. Papa ne me donnait jamais d'argent. Quelque fois l'épicier nous amenait de la bouffe et une fois par deux ou trois mois, on recevait une boîte de linge. Je n'ai jamais su d'où provenait la manne. Pour nous, ce que tu appelles les populaires et surtout les populaires privilégiés, c'étaient les crosseux qui volent le monde: les belles jobs, le gros char, la grosse maison, les gens de «bonnes mœurs» qui se prennent pour d'autres, le beau linge, le parfum (on les sentait venir de loin ), les grands mots pour rien dire...»
Quant à Marcel, il est à l'enseigne des populaires, de ceux qui ont le pouvoir de se donner un certain confort malgré le seuil de pauvreté. Ils ne sont pas exclus de tous les réseaux mais ne sont pas des éléments dynamiques dans les organismes locaux. Sous-scolarisés, les populaires sont assistés sociaux, chômeurs, travailleurs à temps partiel souvent non-syndiqués et bien exploités. Ils s'identifient parfois aux populaires privilégiés, même si ceux-ci les regardent d'un air douteux sans toutefois les renier complètement de leur milieu. Les populaires sont entre l'arbre et l'écorce, entre les impopulaires et les populaires privilégiés.
Mme Richard est secrétaire des Filles d'Isabelle, vice-présidente des Fermières, membre du comité des parents et coordonnatrice du comité d'éducation populaire. Son mari est propriétaire d'une petite épicerie et siège au conseil des commissaires20. Avec leur fille, ils vivent dans un bungalow à proximité de l'école secondaire. Leurs enfants travaillent ou poursuivent des études supérieures. Ils ne sont pas riches mais leurs implications dans différents organismes leur ouvrent les portes de pouvoirs locaux: éducation des adultes, municipalité, Centre local de services communautaires, polyvalente, etc. Même s'ils sont peu scolarisés — une quatrième et une septième primaire — ils ne s'identifient pas aux populaires et encore moins aux impopulaires. Pour eux, les gens qui "profitent" de l'aide sociale sont des lâches qui n'ont pas de cœur au ventre. Ils ne perdent pas leur temps à boire de la bière, ils sont dévoués pour le développement économique, culturel et religieux de leur village. Ils s'accomodent de la société et de ses infrastructures. Les professeurs et les fonctionnaires de l'État sont des alliés qui font de leur mieux. Nous désignons cette catégorie sociale les populaires privilégiés.
Les différences au milieu de l'alphabétisation
Mme Gérard est monitrice alpha. Elle aime le parfum, les colliers dorés, les boucles d'oreilles, les robes aux tissus légers, les souliers délicats... Elle est issue d'une grande famille. Son père était agriculteur. Elle a deux sœurs chez les nonnes; trois frères ont repris le bien paternel; un quatrième est propriétaire d'un magasin général; le dernier et le plus jeune est commis chez Eaton. Malgré quelques rondeurs, elle ne paraît pas avoir quarante-huit ans. Son histoire est simple: ses souvenirs de jeunesse remontent aux douceurs de la vie de campagne passée à la ferme. Elle a fréquenté l'école normale où elle a cessé ses études au neuvième secondaire. Elle s'est mariée très jeune et a eu cinq enfants. Les Dames chrétiennes et le comité d'éducation populaire sont, entre autres, les organismes qui retiennent le plus beau de son temps.
Ludger a vingt-deux ans. Il aime les motos et les voitures sports. Il a des tatouages sur les épaules et les bras: Harley Davidson et Trans Am encadrés d'un cœur transpercé d'une flèche. Il a trois frères. Un travaille à la baie James; un autre est à Calgary; le dernier est concierge à Montréal. Ses deux sœurs demeurent avec le même homme. Au temps des bleus21 son père travaillait sur la Voirie. Les rouges sont arrivés et il s'est acheté un taxi. Aux Olympiques, Ludger était monteur de lignes. Le stade terminé, il n'y avait plus de travail. Il est revenu en Gaspésie. Il a fait sa virée dans le Nord et dans l'Ouest pour finalement trouver un emploi à Nouvelle dans un moulin de sciage. «C'est vrai qu'avec une quatrième année, dit-il, on va pas loin». L'hiver prochain, si Ludger est «slacké», il prévoit aller bûcher. Il vit à la maison avec son père et sa mère. Il tue le temps à jouer au pool, à «spotter» les chevreuils l'automne, à braconner le saumon sous l'œil naïf des Américains et à nettoyer sa Trans-Am pour amener sa blonde aux vues.
Paul était bûcheron tout comme son père. Il vit entouré de la majorité de ses frères et sœurs dans une vallée qui porte leur nom de famille. Après avoir passé par le métier court ou long, les plus jeunes deviennent des bûcherons. Quelques-uns se sont ouverts des «shops» de mécanique derrière la maison. Les filles étudient l'art ménager du secondaire.
À douze ans, Paul ne voulait plus aller à l'école. Son père l'a amené bûcher. À dix-neuf ans, il se mariait. Il s'est construit une petite maison qu'il a agrandie aux besoins: les accouchements et les enfants qui grandissaient. Il en a eu cinq qui suivent les traces de la famille. À trente ans, Paul ne pouvait plus travailler et il a demandé l'aide sociale.
«La gang de calices, d'hosties pis de tabernacles. J'ai demandé de l'aide sociale, pis y m'ont refusé. J'ai ramassé les petits de mes frères Gérard, Dan, Ti-Guy pis les miens. J'ai descendu au bureau avec les onze flots. Je les ai fait assir dans le bureau du calice, pis j'y ai dit: t'as pas d'argent'. Correct, nourris ces enfants-là, moi j'm'en va ».
Paul sa femme, ses enfants sortent rarement. À part les courses de chevaux où le frère de Paul fait courrir son poulain, ils ne participent à aucune manifestation. La réparation des autos, des motoneiges, le bûchage de quelques cordes de bois, la rénovation de la couverture de la maison... sont les occupations quotidiennes.
Pour arrondir les fins du mois, il a commencé la récupération de vieilles automobiles qu'il vend en pièces détachées. Le passe-temps préféré de Paul, c'est quand il sort son violon et- qu'il s'installe sur le perron avec des amis et une bonne caisse de Molson froide...
Gaby a quarante-deux ans. Il est mécanicien au garage de René. Il a quitté l'école en cinquième primaire; il a appris la mécanique de son frère. Il se débrouille tant bien que mal malgré les trois mois qu'il passe chaque année sur le chômage. Il possède une petite maison qu'il repeint tous les trois ans. Il va à l'Église et est fier de sa fille qui termine son cours de commerce. Il met beaucoup d'espoir dans son garçon qui est fort en mathématiques. Le troisième sera mécanicien comme lui. À part quelques visites au terrain de baseball et a la patinoire, Gaby sort peu. Quant à sa femme, elle est Fille d'Isabelle et Dame chrétienne. Elle administre la paie de Gaby et s'occupe des devoirs des enfants.
Dans ce tableau d'analphabètes, la monitrice est socialement liée avec Gaby: le groupe des populaires de plus de trente-cinq ans.
L'éventail des implications sociales des populaires privilégiés les amène à se faire connaître des populaires: organisation des bingos aux profits de la fabrique, coordination et planification des soirées dansantes à la salle communautaire, préparation du carnaval, etc. Les populaires (de façon générale les plus âgés) ont des valeurs qui se marient avec l'idéologie des populaires privilégiés: le respect de l'Église et de sa morale, la reconnaissance de l'école, l'espoir en la mobilité sociale, le respect de la hiérarchie sociale, la valorisation de la cellule familiale, etc. Pour les populaires de plus de trente ans, le CEP est à l'exception près une formule concluante.
En complicité avec les pouvoirs locaux (école, municipalité, Centre de services sociaux, Bureau du développement économique, touriste...) les populaires privilégiés sont des entremetteurs dans l'organisation sociale, économique et culturelle de leur village. Les femmes22 sont placées sous le couvert de la neutralité politique et du statu quo économique domaines réservés aux hommes. Elles contrôlent pour une large part le champ du développement socio-culturel.
Bilan mitige des CEP
Dans la formule du CEP, les jeunes (Ludger) et les impopulaires (Paul) sont les laissés pour compte. Il s'agit d'une incompatibilité de classes sociales. Les jeunes analphabètes issus du milieu populaire et les impopulaires ont des difficultés à coexister avec les membres des CEP: les différences sont exclusives.
Les jeunes sous-scolarisés sont des étrangers aux réseaux des Filles d'Isabelle, des Dames de Ste-Anne, du Club des Lions, des Chevaliers de Colomb, du comité d'éducation populaire. Les jeunes populaires et sous-scolarisés sont dans les club de 4x4, les tournois de pool, les championnats du meilleur buveur de bière, les courses de motos et de vieilles voitures... Ils ne vont pas à l'Église; il ne participent pas aux réunions de la municipalité: ils ne siègent pas aux comités de développement touristique, culturel ou économique. Pour eux, l'atelier de lecture, d'écriture et de calcul de Mme Gérard c'est pour les vieux.
Les impopulaires sont coupés du monde électrifiant de «l'American Way of Life». Ils vivent au bout des rangs qui portent parfois leur nom. Leurs maisons sont déclarées taudis par les agents du développement social. Ce sont les pauvres. Ils n'ouvrent la porte qu'aux amis(es). Pour eux, l'autre monde, c'est la maison peinte, le gazon tondu, le char de l'année. La répression, c'est l'agent de l'aide sociale, le psychologue du CLSC, la police, le directeur d'école, le gérant de la Caisse, l'acheteur de bois... Le monde des autres, c'est les clubs sociaux, les hôtels, les brasseries, les restaurants, les cafés où ils ne se présentent que très rarement. On les voit à la taverne. Au dépanneur, ils achètent à crédit. Régulièrement, ils prennent un billet de la Loto et se rendent aux bingos, des taxes sur le rêve des pauvres.
S'ils se présentent aux ateliers de lecture, d'écriture et de calcul du CEP, les impopulaires et les jeunes laissent leur réalité sociale sur le parquet. Par le CEP, l'alternative complète ne se dessine pas.
Une approche organique ou conviviale ne suffit donc pas. Il faut des gens réellement engagés dans les luttes sociales. Ici, le langage ne peut trahir. Je me souviens d'avoir observé une monitrice qui avait de la difficulté à utiliser les phrases du type: «c'est cool», «c'est trippant», «mets-en»... Elle s'offusquait en entendant: «calice, j'ai de la misère», .«d'la marde saint ciboire, forme la porte»... Dans ce contexte, l'expression n'est pas facilitée. L'utilisation du langage rural — bateau, pêche, morue, montagne, chemin, coteau, côte, — et populaire — scie mécanique, corde de pitounes, Timberjack, épinette, guenille — ne suffit pas parce que tout ce qui modèle les caractéristiques et l'organisation socio-économique d'un peuple doit s'en doute passer par la langue. Le génie d'une langue est intimement lié au comportement physique du peuple qui la parle.
J'ai aussi remarqué que les monitrices utilisent deux langages. À la pause-café, les monitrices emploient des mots et des structures de phrases qui ont l'accent du village. Aux exercices, elles changent de ton: un nœud dans la gorge, leur rôle les ramène à la correction du langage. Le langage n'est plus le discours quotidien. Il se conforme a la réglementation de l'écriture. Pour les populaires qui s'intègrent à cette formule d'alphabétisation, le langage de l'apprentissage mine le langage populaire.
En paradoxe avec le langage populaire, l'écriture est un code fermé. Les gens sont aux ateliers pour apprendre ce code. Pourtant, il y a une place pour un code non-imposé par les classes dominantes. N'est-ce pas ce que font certains poètes? Le parler populaire peut être un langage de libération et canaliser le pouvoir de changement: transgresser l'arbitraire du code imposé par les classes dominantes.
Malgré tout, les ateliers de lecture, d'écriture et de calcul sont un milieu de vie. Des cuisines, des salons, des locaux communautaires, des vieux collèges et couvents, sont devenus des lieux de rencontres pour les populaires analphabètes avancés en âge23; des Dames chrétiennes, des bûcherons, des assistés sociaux, des chômeurs, des garagistes, des menuisiers, des camionneurs, des ménagères... Du travail individuel aux jeux collectifs, on passe par des récits où l'on se raconte les contraintes de l'analphabétisme et la vie quotidienne du milieu rural. On joue à l'école. Dans une cuisine de maison, les adultes s'adressent à la monitrice en disant: «mamselle». On vole le crayon du voisin, on pince la voisine, on cache le cahier de la monitrice. Les rires se sont substitués aux réprimandes. De son côté, la monitrice amène des gâteaux, du jus et du café pour célébrer les fêtes de chacun. Les cahiers sont pour la plupart bourrés de grands B pour «Bien» de TB pour «Très Bien». L'écriture rouge de la correction mime la petite école. Entre l'aliénation et la rigolade, c'est une caricature, inconsciente de l'école.
Cette «nouvelle école», on a tenté de la sortir de l'isolât culturel. Le Petit Journal et un réseau de correspondance avec L'Arbralettre ont permis aux participants de communiquer avec les différents ateliers des villages et régions du Québec. La cohésion sociale est encore très faible et même si les participants apprécient ce réseau au point de se fixer des rendez-vous pour l'été, toute cette aventure est à l'état embryonnaire.
Il suffirait de peu que le service d'éducation des adultes juge que Le Petit Journal a trop de fautes ou qu'il coûte trop cher (le tirage est passé du mensuel au bi-mensuel). Pourtant au S.E.A. de la baie des Chaleurs, les cinq personnes (cadres et conseillers pédagogiques) raflent environ 250,000,00$ seulement en salaires. Les monitrices alpha récoltent chacune de deux à trois milles dollars par année. Les bureaucrates ont les gros salaires, la sécurité du revenu, les assurances collectives, les bénéfices marginaux... Les CEP n'ont que de maigres subventions, aucune sécurité du revenu, aucun bénéfice marginal, aucune assurance collective.. Les CEP ont-ils d'autre choix que de gagner l'autonomie et chercher à déstabiliser le monopole institutionnel?
L'alpha populaire et l'institution scolaire
En milieu rural, une commission scolaire a le monopole et le contrôle total de l'éducation sur son territoire. L'éducation, c'est l'affaire des jobs et, en haut lieu, les déchirements pour l'appropriation de pouvoirs supérieurs. Tout changement qui vient d'en bas est une insécurité dans les perspectives de promotion sociale des professionnels de l'éducation.
C'était un des objectifs de cette recherche-action d'associer la population à une éducation populaire et autonome, à la transgression des activités traditionnelles du S.E.A. Cette idée ne fut jamais prise au sérieux par le S.E.A. Les responsables de centre constatent avec fierté que les CEP ne font que répéter l'éducation populaire du S.E.A. et du coup, garantissent les heures/cours.
Rappellons-nous les tentatives du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec24. D'une forme de développement intégré (comités de développement dans chaque village) l'on passa à une stratégie de rationalité instrumentale: technocrates, bureaucrates et spécialistes dictaient le développement selon une stratégie étrangère. Il en est de même pour l'éducation des adultes et un centre régional de développement économique.25
Au S.E.A., un problème qui ressort avec évidence, c'est cette incapacité de rejoindre ceux qui sont les moins scolarisés. On ne sait pas quelle pédagogie adopter avec eux. On ne s'est pas donné de pédagogie alternative. L'approche est adaptée — tout comme le réseau régulier de l'école secondaire — aux classes et aux milieux défavorisés.
À Pointe-à-la-Garde, le S.E.A. utilisait les méthodes conventionnelles: un professeur scolarisé, une sensibilisation et un recrutement par une sollicitation étrangère et une pédagogie «conscientisante» en référence à une stratégie conventionnelle de développement économique.
Après cette expérience et son échec relatif, on a voulu s'associer la population pour adapter la pédagogie aux analphabètes. On croyait que la formule du CEP permettrait l'émergence d'une pédagogie façonnée par le milieu. Pointe-à-la-Garde ne s'est pas embarquée dans cette formule. On a senti la population essoufflée d'une première expérience institutionnelle. On s'est donc tourné vers un autre village: St-François, dans l'arrière pays de Matapédia, devenait le village pilote d'une nouvelle approche.
Malgré certains gains pédagogiques en alpha, le CEP est plus près de l'institution que de la population des sous-scolarisés. Le CEP est une solution relative qui perce le milieu des populaires. Encadré par un S.E.A. qui semble incapable d'en faire autre chose que sa propre prolongation, le CEP peut devenir l'outil des populaires privilégiés: ce sont les gens de cette classe sociale qui ont le contrôle des budgets et des orientations du CEP.
Pour une réorientation de l'éducation, le S.E.A. devrait avoir des animateurs complices des intérêts des milieux impopulaires et des jeunes. Projet contradictoire au regard des priorités budgétaires et du personnel en place. Les conseillers pédagogiques et les cadres défendent leurs intérêts de classe, au même titre que les populaires privilégiés qui ont, par le CEP, prolongé le monopole institutionnel.
Pour aller, plus loin, il faut des intervenants qui sont en mesure de se faire accepter chez les impopulaires, un groupe social plus ou moins fermé; des gens qui sont conscients des luttes sociales que sous-entendent l'analphabétisme et l'alphabétisation; des individus qui ont un parti-pris favorable pour les jeunes sous-scolarisés et les impopulaires; des personnes qui replacent l'école dans son rôle «sélectionneur» intégré au système capitaliste et industriel; des moniteurs et monitrices qui auront une pratique de subversion des intérêts de la classe dominante.
Pour rejoindre les jeunes et les impopulaires, il faut des gens capables d'entrer dans une culture marginale avec ses règles, ses normes, ses ressources... Nous prendrions des chemins douteux en rapport à la tradition de l'éducation des adultes: inviter des membres des clans impopulaires à devenir moniteurs(trices) pour les siens; transposer l'alpha aux ateliers impopulaires du travail au noir (menuiserie, mécanique, débosselage); alphabétiser dans la vie quotidienne de l'isolat culturel des femmes au bout du rang... Il faut ouvrir des lieux éducatifs où les participants collaborent avec des personnes engagées (en opposition aux populaires privilégiées et aux bureaucrates des S.E.A.) à la gestion d'un centre de lecture, d'écriture et de calcul: des lieux qui ne soient pas sous la juridiction de l'Église ou du ministère de l'Éducation.
Pour sensibiliser à l'analphabétisme et à l'alphabétisation, on pourrait élaborer des fresques, utiliser des murs ou des panneaux pour des performances d'écriture populaire; utiliser la télévision pour un feuilleton où il y aurait des rôles d'analphabètes et un jeu-questionnaire qui utiliserait les lettres de l'alphabet et le langage populaire; amener à la radio des participants qui se raconteraient; publier des bandes dessinées dans les journaux, les dépliants des Clubs de 4x4, les affiches de publicité des tournois de pool, les championnats de buveurs de bière...
En corollaire à cette sensibilisation, une dénonciation s'impose: l'école qui n'est pas faite pour tout le monde. La déculpabilisation de l'analphabétisme doit passer par le procès de la classe dominante. Il faut dénoncer la réduction de l'analphabétisme à une déficience intellectuelle. J'ai, dans les ateliers, rencontré un analphabète qui divisait mentalement 20759 par 27, un qui était sculpteur, débosseleur, mécanicien, électricien, plombier, un autre travaillait le cuir... Et pensez à ces femmes qui confectionnent des chemises, des pantalons, qui tricottent des chandails et des bas, qui réussissent avec des maigres revenus à nourrir le mari et les quatre enfants...
Un projet d'alphabétisation populaire qui accepte de partir d'une culture marginale, fermée et plus ou moins délinquante se place dès le départ en marge et en délinquance. Dans le bercail de l'éducation institutionnalisée, une alphabétisation populaire est un mouton noir. La tendance forte est de le blanchir. Ce que nous proposons, c'est de le libérer.
Tableaux
I. Données sur les participants aux ateliers alpha par village
Données sur les participants aux ateliers alpha par village, selon le sexe et l'âge pour le territoire du service de l'éducation des adultes de la Baie des Chaleurs
| Hommes | Femmes | ||||||
|
- 30 ans |
30-50 |
50 et + |
-30 |
30-50 |
50 et + |
TOTAL |
|
|
St-François |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
3 |
11 |
|
Restigouche Sud Est |
1 |
3 |
4 |
||||
|
St-André |
2 |
2 |
2 |
9 |
15 |
||
|
Matapédia |
1 |
1 |
2 |
3 |
7 |
||
|
Pointe à la Croix |
5 |
5 |
10 |
||||
|
L'Ascension |
3 |
1 |
4 |
||||
|
St-Alexis |
2 |
1 |
3 |
2 |
8 |
||
|
Carleton * |
1 |
1 |
|||||
|
Bonaventure |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
||
|
Caplan |
1 |
1 |
2 |
1 |
5 |
||
|
Paspébiac |
1 |
1 |
2 |
4 |
|||
|
Total |
74 |
||||||
* Aide pédagogique individuelle, ce qui relativise le statut alpha
** Valeurs manquantes: 9
*** Grand total: 74 + 9= 83
II. Répartition des participants aux ateliers alpha, selon l'âge.
|
-30 |
18% |
|
30-50 |
27% |
|
51 et + |
55% |
III. Statut civil des participants
Pour le service de l'éducation des adultes de la Baie des Chaleurs, statut civil des participants selon qu'ils sont mariés, célibataires, séparés/divorcés, autre.
|
Mariés |
61% |
|
Célibataires |
19% |
|
Séparés/Divorcés |
7% |
|
Veuf/Veuve |
12% |
|
Autre |
1% |
|
Total |
100% |
IV. Statut des participants
Pour le service de l'éducation des adultes de la Baie des Chaleurs, statut des participants, selon qu'ils sont chômeurs, assistés sociaux, ménagères, retraités, ouvriers non-spécialisés, ouvriers spécialisés.
|
Assistés sociaux |
28% |
|
Chômeurs |
3% |
|
Ménagères |
32% |
|
Retraités |
23% |
|
Ouvriers non-spécialisés |
8% |
|
Ouvriers spécialisés |
3% |
|
Autre |
3% |
|
Total |
100% |
V. D'après le sexe, l'âge moyen des participants, selon le secteur
| Matapédia | Carleton | Paspébiac | Bonaventure | |
|
Hommes |
47 |
Donnée insuffisante |
35 |
42 |
|
Femmes |
51 |
Donnée insuffisante |
37 |
44 |
VI. Les monitrices alpha des ateliers
Les monitrices alpha des ateliers du secteur Baie des Chaleurs, selon le sexe, l'âge, la scolarité, le statut civil et les gains en alphabétisation
|
Groupes |
||||||
|
Sexe |
Âge |
Scolarité |
Statut civil |
Gains Alpha |
||
|
1 |
F |
52 |
7 |
M |
2 688,00 $ |
|
|
2 |
F |
36 |
9 |
M |
2 000,00 $ |
|
|
3 |
F |
54 |
15 |
M |
1 700,00 $ |
|
|
4 |
F |
50 |
13 |
Autre |
1 200,00 $ |
|
|
5 |
F |
49 |
7 |
Veuve |
380,00 $ |
|
|
6 |
F |
34 |
12 |
M |
2 100,00 $ |
|
|
7 |
F |
58 |
13 |
Veuve |
? |
|
|
8 |
F |
35 |
12 |
M |
3 500,00 $ |
|
|
9 |
F |
48 |
7 |
M |
2 688,00 $ |
|
|
10 |
F |
33 |
17 |
M |
2 060,00 $ |
|
|
1 |
F |
36 |
17 |
M |
192,00 $ |
|
|
1 |
F |
21 |
15 |
C |
369,00 $ |
|
|
1 |
F |
49 |
12 |
M |
369,00 $ |
|
|
1 |
F |
47 |
14 |
M |
369,00 $ |
|
|
2 |
F |
48 |
12 |
M |
720,00 $ |
|
|
1 |
F |
36 |
12 |
M |
? |
|
|
3 |
M |
65 |
12 |
M |
1 500,00 $ |
|
|
4 |
F |
46 |
10 |
M |
---- |
|
VII. Liste des comités d'éducation populaire par secteur
Secteur Paspébiac
Mme Délisca Lemoy
St-Jogues
Cté Bonaventure G0C 2Y0
Mme Raymonde Gignac
Paspébiac
Cté Bonaventure G0C 2K0
Mme Eléonore Briand
Port-Daniel
Cté Bonaventure G0C 2N0
Mme Paulette Joseph
C. P. 146 St-Godefroi
Cté Bonaventure G0C 3C0
Secteur Bonaventure
Mme Marjolaine C. Arsenault
C. P. 61 St-Elzéar
Cté Bonaventure G0C 2K0
Mme Diane Loubert
B.P. 566 Caplan
Cté Bonaventure G0C 1H0
Mme Sylvie Cayouette
C.P. 774
Bonaventure G0C 1E0
Comité de St-Siméon
a/s Mme Nicole Gallagher
Polyvalente
Bonaventure G0C 1E0
Secteur Carleton
Mme Nicole Gauvreau-Boucher
Maria
Cté Bonaventure G0C 1Y0
Mme Huguette Nadeau
115 rue Nadeau St-Orner
Cté Bonaventure G0C 2Z0
Mme Monique Girard
B.P. 23 Nouvelle Ouest
Cté Bonaventure G0C 2G0
Secteur Matapédia
Mme Alice Turbide
L'Ascension de Patapédia
Cté Bonaventure G0J 1R0
Mme Laurette Roy
St-François D'Assise
Cté Bonaventure G0J 2N0
Mme Gisèle H. Rivard
St-Alexis de Matapédia
Cté Bonaventure G0J 2E0
Mme Marie Létourneau
Matapédia
Cté Bonaventure G0J 1V0
Mme Olive Pelletier
St-André de Restigouche
Cté Bonaventure G0J 2G0
Mme Marie Lou Goudreau
Pointe à la Croix
Cté Bonaventure G0C 1L0
M. Patrick Fergusson
L'Alverne
Cté Bonaventure G0C 1X0
M. Vital Caissy
Pointe à la Garde
Cté Bonaventure G0C 2M0
M. Normand Bourdages
R. R. 2 Matapédia
Cté Bonaventure G0J 1V0
Crédits
Raymond Day
C.S.R. Baie des Chaleurs
Ce travail est le résultat d'une recherche action de trois ans subventionné par le service de recherche de la DGEA et supervisé par Jean-Paul Hautecoeur.
-
- 1 Au Québec, il y a deux types de formation professionnelle et deux types de spécialisation: les «ouvriers spécialisés» sont formés dans les institutions d'enseignement collégial et les «peu spécialisés» sont issus du réseau de l'enseignement secondaire.
- 2 Les trois régions sont comprises dans les territoires géopolitiques appelés «comté»; l'Ile Jésus est une région urbaine près d'un grand centre; Rimouski est mi-urbaine, mi-rurale; Bonaventure est rurale.
- 3 ALPHA 78, Compte rendu du séminaire (sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1979
- 4 «Macramé power» c'est l'artisanat-petits points, tricot, tissage, tricotage...-relié à une population privilégiée: la classe moyenne. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire au S.E.A. par contraste avec la «formation générale».
- 5 Paolo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1962, p. 9
- 6 Populaire et impopulaire sont employés pour désigner deux couches sociales d'une même réalité: la culture du pauvre. Les «populaires» et «impopulaires» ont les points communs suivants: sous scolarisation (0-9 ans), emploi précaire, santé chancelante; l'habitation, l'idéologie de la famille, de la classe moyenne et la morale religieuse en sont les distinctions. La catégorie populaire a un habitat avec une cuisine, un salon, des chambres simples ou partagées entre deux ou trois personnes; les gens vont à l'église et respectent ses règles; ils sont acceptés dans les organismes du milieu; la cellule familiale est respectée: père, mère, enfants. Ils sont souvent travailleurs à temps partiel ou sous-payés. La catégorie impopulaire a un habitat surpeuplé: une pièce séparée par un rideau sert de cuisine, salon, chambre à coucher pour quatre, cinq, six... personnes. Les gens ne vont pas à l'église et ignorent sa morale: cellule familiale, fidélité conjugale, travail... Ils sont rejetés des organismes du milieu; ils sont inscrits, pour la plupart, à l'aide sociale; ils sont les oppressés de la loi: l'auto n'est pas conforme, la maison insalubre, les enfants mal élevés, futurs délinquants... Lorsqu'ils ne sont pas mis à la porte ou "drop out", les «populaires» et «impopulaires» sont à l'école des «autres», orientés à 88,4%* vers les voies allégées et pratiques, le métier court ou long. C'est une typologie: elle ne conduit pas à un portrait de la réalité mais permet de dégager les caractères dominants d'une population étudiée.
* (Voir Caractéristiques des étudiants du professionnel à partir de l'analyse de leur cheminement scolaire, Secteur de la planification, MEQ, 1981, sommaire 13 p. - 7 Voir Projet d'alphabétisation, Commission scolaire régionale de la baie des Chaleurs, 30 mars 1979, p. 3
- 8 Voir «Essai d'alphabétisation rurale dans la baie des Chaleurs», dans Pratiques d'alphabétisation (sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1982, pp 333-395
- 9 Jean-Paul Hautecoeur, «L'alphabétisation et l'État: Quelle politique d'alphabétisation populaire?» dans Compte-rendu du séminaire-Alpha 80 (sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur) Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1981, p. 44
- 10 Publicité télévisée pour un détergent.
- 11 Cf Jean-Paul Hautecoeur, «Du blanchissage à la couleur: l'alphabétisation scolaire en question» Alpha 30 (sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur), Gouvernement du Québec, MEQ, DGEA, 1982, p. 45
- 12 Contenu de l'information/sensibilisation véhiculée à St-François d'Assise et L'Alverne.
- 13 Vidéo sur l'animation en alphabétisation à la Commission scolaire Jean-Talon: Une autre solitude (distribué par le MEQ-DGEA)
- 14 Les commissaires sont élus par la population; ils forment une assemblée des représentants des utilisateurs et sont les décisionnels.
- 15 Il n'y a pas de statistique sur les taux de scolarité de la population par village.
- 16 «strap»: ceinture de cuir, environ trois pouces de large, qui était utilisée à l'école pour battre les enfants.
- 17 La commission scolaire locale est responsable de l'enseignement primaire et des locaux scolaires dans les paroisses.
- 18 Présentement, il y a un suivi régulier par une animatrice dans les villages (secteur Matapédia) et des rencontres mensuelles avec les monitrices par secteur.
- 19 «truie» est un ancien baril de pétrole disposé sur le flanc et servant de poêle à bois.
- 20 Il pourrait tout aussi bien être: garagiste, agriculteur, travailleur de la construction, charpentier, ébéniste, pêcheur, garde-forestier, employé de la voirie, professeur du secondaire...
- 21 Les bleus: désignation traditionnelle du parti nationaliste, autrefois Union Nationale et maintenant Parti Québécois; les rouges: Parti libéral.
- 22 Les CEP sont formés majoritairement de femmes. Il y a cinq hommes pour environ deux cents femmes; elles ont une moyenne d'âge d'environ quarante ans.
- 23 Sur soixante participants dans le secteur Matapédia, nous ne comptons que quelques personnes de moins de trente ans.
- 24 Le Gouvernement du Canada par l'entremise de «Agriculture and Rural Development Act» (ARDA) a, au début des années soixante, investi des milliers de dollars dans le développement de l'Est du Québec et a créé le BAEQ.
- 25 Nous ne parlerons pas des parcs, de la fermeture des villages, de la déstabilisation des pêches et de l'agriculture...