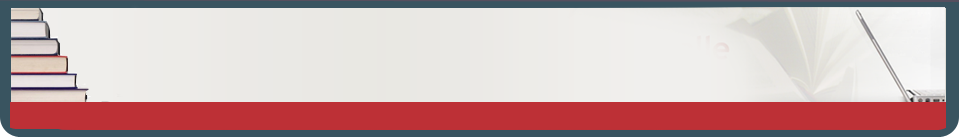- Les Etchemins... une région que j'apprivoise
- Les Etchemins
- Joseph-Damase Bégin
- L'Union Nationale et Maurice Duplessis
- Les frères Baillargeon
- Les magasins généraux
- Le Magasin Général de Sainte-Rose
- La conscription
- Les Trappistes
- Le bûcheron
- Le cordonnier
- Le forgeron
- La maîtresse d'école
- Le Groupe Alpha des Etchemins
- Crédits
Les Etchemins... une région que j'apprivoise
Le document, Les Etchemins... une région que j'apprivoise, est le fruit d'une démarche effectuée par les formatrices, les participantes et les participants du Groupe Alpha des Etchemins au cours de laquelle ils ont pu exploiter diverses thématiques reliées à leur région, soit la MRC des Etchemins : patrimoine, culture régionale, environnement et ressources naturelles.
Les textes qui composent ce document sont regroupés selon différents thèmes. En premier lieu, nous vous présentons les premiers habitants et certains personnages célèbres de la région : Les Etchemins, Joseph-Damase Bégin ainsi que Les frères Baillargeon. Nous ne pouvions parler de la MRC des Etchemins sans mentionner des faits et des lieux historiques que vous découvrirez en lisant : Les Magasins généraux, Le Magasin Général de Sainte-Rose et Les Trappistes. Quant aux textes Le bûcheron, Le cordonnier, Le forgeron et La maîtresse d'école, ils sont étroitement liés à la visite que nous avons faite au «Village des Défricheurs de Saint-Prosper», véritable musée où nous avons pu voir les outils et les habitations d'époque de ces valeureux travailleurs.
Finalement, nous désirons souligner la contribution de toute première importance des participantes et des participants du groupe qui ont collaboré à toutes les étapes de cette démarche collective : recherche documentaire, visites de sites culturels et historiques, rédaction et validation des textes.
Les Etchemins
Dès son arrivée en Amérique, en 1603, Champlain rencontra des Algonquins, des Montagnais et des Etchemins. C'est le 18 septembre 1604 qu'il fit la connaissance de Cabahis, un chef de la tribu des Etchemins, qui comptait à ce moment de 500 à 600 Amérindiens.
Certains historiens rapportent que les Abénaquis étaient souverains du pays entre le Richelieu et la Chaudière, alors que les Etchemins possédaient le territoire qui se situait entre la Chaudière et la Gaspésie. D'autres les considèrent plutôt comme une confédération de sept tribus différentes ayant des mœurs comparables et parlant toutes la même langue. Ils auraient habité le Maine, le New Hampshire, le Nouveau-Brunswick et les côtes de la Nouvelle-Écosse.
Parmi ces sept tribus, on retrouvait les Etemankiaks (ceux de la terre de la peau pour les raquettes) qui habitaient les terres en bordure des rivières Ste-Croix et St-Jean. Les Français les ont d'abord nommés Eteminquois et ensuite Etchemins.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les traces laissées chez nous par les Etchemins sont presque inexistantes, car ils ont très peu fréquenté notre territoire. Le lac Etchemin ne fut probablement qu'un lieu d'arrêt temporaire pour eux. Leur descendance vit actuellement sur des réserves au Nouveau-Brunswick.
Chez nous, plusieurs lieux et entreprises utilisent le nom «Etchemins». Notons particulièrement la Municipalité Régionale de Comté qui a choisi fièrement cette dénomination évoquant ainsi le souvenir des Etchemins.
Joseph-Damase Bégin
C'est à Ste-Germaine-du-Lac-Etchemin qu'est né, le 6 août 1900, Joseph-Damase Bégin. Il était le fils de Marie Turmel et de Damase Bégin, l'aîné d'une famille de dix enfants.
[Voir l'image pleine grandeur]

Après ses études primaires, Joseph-Damase termina son cours commercial au Collège de Lévis et poursuivit ensuite au cours classique en 1915. Tout au long de ces années, il s'initia au cinéma bien que la photographie l'intéressait depuis l'âge de dix ans. C'est avec la collaboration d'Orner Chabot qu'il signa son premier film «La fête de Ste-Anne».
En 1921, Jos.-D. devint agent d'assurances pour la National Life. En 1923, il fut huissier à la Cour supérieure et, en 1924, commissaire du même tribunal. En 1925, il se retrouva à la tête de la Cie Electrique et Pouvoir d'Eau du Lac-Etchemin où il réalisa un projet de barrage électrique. Il travailla ensuite chez un concessionnaire Ford de Beauceville. En 1926, fort de son expérience dans le milieu de l'automobile, il fonda avec son frère Florent, le garage Dorchester Automobiles. À cette époque, il était aussi président du Club de tennis, du Club automobile et du Cercle dramatique du Lac-Etchemin. En 1935, avec P. J. Tanguay, il inventa «l'allumeur éclair» servant à allumer les fournaises et les poêles. La petite entreprise «La compagnie Éclair enr.» employa trois personnes.
C'est le 25 novembre 1935, qu'il fit ses débuts en politique lorsqu'il remporta ses élections sous la bannière de l'Action libérale nationale de Paul Gouin. Maurice «Le Noblet» Duplessis de l'Union Nationale, en fit son organisateur en chef de 1940 à 1961. Pendant 16 ans, il fut ministre de la Colonisation dans les cabinets Duplessis, Sauvé et Barrette.
Joseph-Damase Bégin réalisa des projets signifiants pour son comté : l'obtention d'une section administrative du ministère de la Colonisation et du ministère des Transports, la construction de l'École Ménagère, de l'Institut La Mennais, du Sanatorium Bégin, de l'Hôtel le Manoir, des Presses Lithographiques et la fondation de La Voix du Sud et de la Caisse d'entraide économique de Dorchester. Il contribua également au développement du réseau routier et il instaura, à Ste-Germaine, un système téléphonique direct, à cadran, que seules les grandes villes de Montréal et Québec possédaient déjà.
En 1967, Jos.-D. Bégin devint maire de Lac-Etchemin. Durant son mandat, il fit construire une piste d'atterrissage et enrichit la bibliothèque municipale d'une impressionnante collection de livres.
Outre les films politiques, Jos.-D. tourna aussi une série de films sur les lieux étrangers qu'il avait visité : Miami, Haïti, la Jamaïque, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Inde, le Japon et bien d'autres. L'ensemble de ses ouvres cinématographiques fut déposé aux Archives nationales du Québec en 1986.
Joseph-Damase Bégin demeurera une figure légendaire chez nous. Il est le symbole de la persévérance et de la réussite. Depuis son départ de la scène publique, personne n'a encore réussi à lui succéder.
L'Union Nationale et Maurice Duplessis
Maurice «Le Noblet» Duplessis, personnage plutôt coloré, fut premier ministre du Québec de 1936 à 1939 et de nouveau, de 1944 jusqu'à sa mort en 1959.
Cet homme possédait un physique bien ordinaire et se coiffait d'un vieux chapeau afin, pensait-il, de se rapprocher du peuple. Duplessis avait très peu de divertissements à part le baseball et la musique. En fait, la politique et son parti, l'Union Nationale, prenaient tellement de place dans sa vie que ce célibataire se disait marié à sa province.
C'est en 1935 que l'Union Nationale fut créée à partir de l'alliance de l'Action libérale nationale et du parti Conservateur. Ce nouveau parti se voulait avant tout réformiste, cependant Duplessis, le chef au pouvoir, en fit plutôt une organisation conservatrice. On assista alors à l'arrivée d'un système de patronage à outrance, d'un nationalisme négatif et d'une loi anti-communiste «du Cadenas».
En 1960, alors que Jean Lesage était au pouvoir, l'Union Nationale connut des difficultés. Le parti devait désormais se réformer. C'est Daniel Johnson qui amorça cette réforme et, grâce à celle-ci, l'Union Nationale revint au pouvoir en 1966 et le conserva jusqu'en 1970. C'est en 1989 que l'Union Nationale disparut complètement de la carte politique.
Les frères Baillargeon
Originaires de Saint-Magloire, Jean, Charles, Adrien, Lionel, Paul et Antonio Baillargeon se sont fait connaître au Canada et aux États-Unis, de 1947 à 1976, grâce à leurs tours de force et à leur carrière de lutteurs professionnels.
Les frères Baillargeon avaient hérité de la force de leur mère, Maria Goulet. Elle mesurait 5 pieds 11 pouces, pesait 275 livres et était reconnue comme la femme la plus forte de sa région. Elle arrivait à lever de terre une enclume de forgeron pour la déposer ensuite sur un établi, et cela, simplement par une pression du bout des doigts.
Jean Baillargeon, l'aîné de la famille, débuta sa carrière en relevant un défi qui consistait à lever un poids. Il réussit cet exploit, ce qui lui permit de rencontrer un acrobate et un haltérophile. Ceux-ci l'invitèrent pour discuter d'entraînement et des différentes possibilités qui pourraient s'offrir à lui et à ses frères. Lorsque Jean commença à faire quelques démonstrations publiques de tours de force dans la région de Québec, ses frères décidèrent de se joindre à lui.
C'est dans les Cantons-de-l'Est et en Nouvelle-Angleterre, en 1947, que les frères Baillargeon ont présenté leur premier spectacle. Ils débutèrent leur entraînement à la lutte en 1949, à Worcester. Deux hommes forts, anciens lutteurs, les avaient initiés à ce métier. Ils mirent en pratique les conseils de leurs professeurs et entreprirent une carrière de lutteurs professionnels laissant de côté leurs fameux tours de force.
Les frères Baillargeon ont participé à plusieurs combats attirant de nombreuses foules. Toutefois, c'est Antonio, le cadet de la famille, qui connut la plus longue carrière, soit de 1949 à 1976, et plus que ses frères, il put jouir de la célébrité que procurait la télévision.
Ces hommes avaient choisi de profiter de l'incroyable force physique héritée de leur mère, en participant à des spectacles un peu partout en Amérique du Nord. Contrairement à d'autres hommes forts du passé, les frères Baillargeon étaient de véritables athlètes qui ont pratiqué avec succès la lutte professionnelle. Il n'est pas étonnant, encore aujourd'hui, que le nom «Baillargeon» soit synonyme de «force».
Les principaux tours de force des frères Baillargeon
Jean : Il soulevait un poids de 350 lbs (159 kg) avec le petit doigt.
Charles : Il tirait un autobus en passant un câble dans sa bouche.
Il a soulevé un poids de 670 lbs (305 kg) jusqu'au-dessus des genoux.
Adrien : Il soulevait une plate-forme portant 18 hommes (4500 lbs ou 2045 kg).
Il a remporté un championnat de tir au poignet au Japon.
Lionel : Il levait avec Paul une barre de 600 lbs (273 kg) à bout de bras.
Paul : Il montait un cheval de 1800 lbs (818 kg) dans un poteau.
Antonio : Il faisait une flexion complète et se redressait avec un poids de 600 lbs (273 kg) sur les épaules.
Les magasins généraux
C'est au XIXe siècle que l'on ouvrit les premiers magasins généraux. Ceux-ci devinrent essentiels pour les communautés rurales de ce temps alors que l'état des routes et les moyens de transport étaient restreints. C'est grâce à l'apparition des magasins généraux que les gens purent se procurer des biens et des services afin d'assurer leur survie et leur confort. L'argent étant rare, la majorité des cultivateurs achetaient à crédit pour leurs besoins immédiats et remboursaient une fois les récoltes terminées.
À cette époque, les difficultés d'approvisionnement compliquaient souvent l'instauration d'un magasin général. Étant donné l'état précaire des routes, ce sont les cultivateurs des environs qui fournissaient le magasin si les récoltes étaient suffisantes. Le commerçant devait aussi se rendre en ville avec sa voiture afin de compléter ses provisions. Il fallait donc attendre plusieurs années avant que le commerce possède un inventaire complet.
Le marchand général offrait une grande variété d'articles tels que : équipements agricoles, tissu, tabac, nourriture, etc. Dans plusieurs villages, le magasin général faisait également office de bureau de poste et de banque. Dans certains cas, un service hôtelier pouvait accueillir les étrangers. C'est au magasin général que se réunissaient les gens du village afin d'échanger sur divers sujets.
Avec la construction des chemins de fer, la distribution des marchandises dans les régions fut grandement facilitée, mais ces biens de consommation qui venaient de loin étaient plus dispendieux. Plusieurs marchands, peu fortunés, durent fermer leurs portes ou transformer leur magasin général en magasin spécialisé. En 1884, la sortie du catalogue Eaton qui offrait une multitude de produits disponibles par la poste, amplifia la disparition graduelle des magasins généraux.
Le Magasin Général de Sainte-Rose
Pierre King Provost arriva à Ste-Rose en 1894 et il y fonda le premier magasin général. Au début, les affaires n'étant pas fructueuses, Monsieur Provost dut laisser sa femme s'occuper du magasin pour aller «faire la drave» au printemps. C'est au fil des ans que les affaires s'améliorèrent graduellement.
Le Magasin Général de Ste-Rose, comme certains autres, dispensait divers services; on y offrait même l'hospitalité pour une nuit moyennant la somme de 0,25$. Bien entendu, on proposait également une grande variété de marchandises afin d'accommoder les gens de la colonie. En 1910, la construction du magasin fut enfin terminée, nous présentant le commerce tel qu'on peut le voir aujourd'hui.
En 1935, Monsieur Ovide Giguère devint propriétaire du commerce. Il y fit installer un poste d'essence de la compagnie White Rose. Cette compagnie lui avait fourni de la peinture afin de colorer la façade de son commerce. Monsieur Giguère décida de débuter par l'arrière, forçant ainsi la compagnie à lui redonner de la peinture pour terminer les autres murs. On peut donc conclure que la couleur jaune caractérisant ce magasin était associée à la compagnie White Rose et l'est d'ailleurs encore aujourd'hui.
Les gens de Ste-Rose se rencontraient souvent au magasin général qui servait également de lieu social. On s'y retrouvait pour échanger des nouvelles, pour discuter de politique ou pour parier aux cartes. Au deuxième étage, on pouvait assister à différents événements socioculturels, tels que des soirées dansantes, des spectacles d'animaux savants et des représentations cinématographiques. Plus tard, en 1942, déjeunes étudiants furent installés dans cette salle car leur école venait de brûler. Elle servit également de classe aux garçons, de 1958 à 1963. C'est en 1988 qu'on assista à la fermeture du Magasin Général de Ste-Rose alors que Monsieur Clermont Parent en était le propriétaire.
La conscription
Lors de la Grande Guerre, le premier ministre Borden annonçait, le 18 mai 1917, qu'on devait recourir à la conscription étant donné la situation catastrophique qui sévissait en Europe. C'est le 24 juillet de la même année qu'on adopta un projet de loi à la Chambre des communes ; le Canada était désormais sous les mesures de guerre. Le gouvernement appela aux armes tout homme sans enfant, célibataire ou veuf, âgé entre 20 et 34 ans. C'est à ce moment que plusieurs hommes prirent la décision de déserter.
C'est en 1918, qu'une police militaire fut créée afin de retrouver les déserteurs. On demandait à la population de dénoncer ces derniers en échange de primes. Au Magasin Général de Ste-Rose, des déserteurs se sont cachés dans les cloisons et c'est par un trou dans celles-ci qu'ils surveillaient les suspects, avec évidemment, l'aide du propriétaire.
Les Trappistes
Les Bénédictins ont grandement contribué à l'essor de la culture et de la civilisation, ainsi qu'au développement du bâtiment et de l'agriculture partout en Europe. C'est de cet ordre ecclésiastique que sont issus les Trappistes.
La première Trappe qui s'installa en Amérique du Nord se développa à Tracadie, en Nouvelle-Écosse, en 1825. Trente-sept ans plus tard, des Trappistes quittèrent cette province pour se rendre au Canton Langevin, afin d'y construire le monastère de Notre-Dame de la Trappe du Saint-Esprit.
C'est le Père André Leyen qui manifesta le désir de fonder un monastère au Bas-Canada en 1859. Malgré des refus et des oppositions répétés, il finit par obtenir la permission de réaliser son projet. Par contre, Mgr Baillargeon l'avisa que le défrichement des terres au Canada était difficile. Tout ce que l'archevêque du Québec pouvait lui offrir était sa bénédiction. Il inviterait aussi son peuple à les soutenir de leurs aumônes. Malgré ces avertissements, le Père André se rendit au Bas-Canada dans le but d'y construire une nouvelle maison. Il demanda alors au Père Jacques, son supérieur, quelques religieux pour l'aider à développer son projet.
Le 24 juin 1862, les locataires des lots 14 à 21 du canton Langevin renoncèrent à leurs droits en faveur des Trappistes. En cette même journée, les religieux venus de Tracadie partirent de Ste-Claire pour se rendre à Ste-Justine. Voilà que commençait la grande aventure! Les charrettes remplies de bagages s'arrêtèrent à Lac-Etchemin car la route se terminait là. Il fallut ensuite porter les provisions et les outils sur une distance d'environ 14 milles (23 km). Les voyageurs dormirent à la belle étoile, car aucun abri ne les attendait à leur arrivée. Dès le lendemain, une première cabane de branches et d'écorces fut construite, remplacée ensuite par un monastère en troncs d'arbres guère plus confortable.
Les religieux furent rapidement épuisés et découragés et le caractère difficile du Père André ne faisait qu'aggraver la situation, amenant même les paroissiens à cesser leur aide bénévole. On fit appel au supérieur du monastère du Petit-Clairvaux de Tracadie qui décida d'expatrier le Père André en Europe.
Le monastère de Notre-Dame de la Trappe du Saint-Esprit fut érigé canoniquement par Mgr Charles-François Baillargeon, le 14 juin 1863. Le Père François-Xavier de Brie fut nommé supérieur, le 20 juin de la même année. Après son installation on commença aussitôt la construction d'un monastère qui pourrait accueillir 80 religieux. Pour financer ce projet d'envergure, on organisa des collectes dans les diocèses de Québec et de Montréal qui rapportèrent une somme d'environ 10 000$. Le 18 juin 1863, arrivèrent d'Europe les sujets qui avaient été recrutés par le Père André.
La bâtisse avait la forme d'un quadrilatère et chacune de ses ailes mesurait 120 pieds (36 m). L'intérieur comprenait une église, une chapelle, une grande salle, une cuisine, un réfectoire et des chambres. On retrouvait aussi, dans ce même quadrilatère, une grange, une écurie et un hangar.
Le monastère de Ste-Justine accueillait des membres venus de la Belgique et du Québec. En 1864 ils étaient 15, en 1865 ils étaient 20 et, quatre ans plus tard, ils étaient 40.
Respectant les exigences de l'Ordre de Cîteau, les religieux se livraient aux activités spirituelles et aux travaux manuels. Ils poursuivaient la construction du monastère et le défrichement du sol. Chaque jour, ils célébraient la messe conventuelle et l'office divin tout en poursuivant l'étude de la théologie. Une grande paix régnait au sein de cette communauté.
Au cours de l'été 1862, un chemin reliant Lac-Etchemin et le monastère des Trappistes fut ouvert. Des lots avaient alors été vendus le long de ce sentier et le déboisement était déjà commencé pour plusieurs d'entre eux. Les colons avaient construit leur maison autour du monastère afin de former une mission et non loin de là, à deux milles (3,3 km), une chapelle avait été bâtie. La paroisse de Ste-Justine fut érigée canoniquement le 6 février 1890.
Malheureusement, le Père François-Xavier de Brie se retrouva devant des problèmes de taille. Il désirait une affiliation avec les monastères européens et des titres de propriété, alors que plusieurs moines ne pouvaient prendre position et l'appuyer dans ses demandes. Il décida donc d'en appeler à Rome. Sa requête ayant été faite trop tard, elle fut reportée à l'année suivante. Pendant ce temps d'attente, la vie au monastère se détériorait. Les moines étaient divisés et plusieurs d'entre eux se plaignaient à l'archevêque.
[Voir l'image pleine grandeur]

Ne pouvant tolérer davantage cette situation, le Père François-Xavier abandonna son projet sans attendre la réponse de Rome. Le 15 mai 1872, il dressa un bilan estimant la valeur des biens de la fondation à l'intention de Mgr Taschereau.
Le climat rigoureux, les durs travaux manuels et les rudes pénitences exigées par la règle avaient épuisé plusieurs religieux. En 1872, trois d'entre eux moururent de la tuberculose et deux autres furent atteints de cette maladie. Les quelque vingt religieux restant n'eurent d'autre choix que de quitter le monastère. Certains retournèrent en Europe ou à Tracadie, alors que d'autres se consacrèrent à leur ministère. Le Père François-Xavier demeura curé de la paroisse de Ste-Justine où il mourut le 23 mars 1885 après s'être consacré à sa vocation pendant 22 ans.
Le 2 juillet 1872, suite à une visite à la Trappe de Ste-Justine, l'archevêque décida d'abolir la fondation. Le 22 octobre 1872, les lots défrichés par les moines et les bâtisses furent vendus à Olivier Labbé, un cultivateur de St-Joseph de Beauce. On réserva, pour le curé, l'usage de l'Hôtellerie, un cheval et une vache. Tous les ornements du culte ainsi que la bibliothèque et les cloches furent gardés.
C'est en 1903 que fut détruit le dernier reliquat du monastère, soit la maison des étrangers qui avait servi autrefois d'hôtellerie. Le monastère fut peut-être un échec, mais n'oublions pas qu'il donna naissance à la paroisse de Ste-Justine.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le bûcheron
Le métier de bûcheron a été longtemps le gagne-pain de plusieurs hommes. Loin d'être facile, l'exploitation forestière exigeait autrefois que ces hommes s'exilent loin de leur famille et de leurs proches pendant de nombreux mois. Le départ pour les chantiers était pour la plupart d'entre eux l'unique moyen de pourvoir aux besoins de leur famille.
C'est vers la fin du mois d'août que l'engagement avait lieu et parfois un peu plus tôt pour ceux qui devaient construire le camp. Les travailleurs forestiers attendaient l'automne avec impatience pour reprendre leur métier et aller passer l'hiver en forêt. En général, ils s'y rendaient à pied ou en canot, leurs bagages sur le dos. C'était le cas pour les Beaucerons qui sont allés travailler dans les chantiers du Maine depuis les années 1890 jusqu'aux années 1920. Ils devaient parcourir plusieurs milles, parfois même jusqu'à trois cents milles (500 km) avant d'arriver au campement. Durant leur longue route, ces hommes demandaient l'hospitalité chez les familles américaines pour y passer la nuit.
À l'époque, même ceux qui prévoyaient devenir habitants voulaient, au moins une fois dans leur vie, «faire une run de chantier». C'était une étape très importante pour chacun d'eux. Le jeune homme accédait alors au monde adulte et pouvait ainsi rencontrer des travailleurs venant de différentes régions. Certains s'engageaient d'une saison à l'autre chez le même entrepreneur alors que d'autres se faisaient embaucher à l'entrée des chantiers. Dans les années 1800, on travaillait habituellement «à gages», c'est-à-dire à salaire fixe mensuel. Par la suite, dans les années 1900, on parlait plutôt de travail à forfait : plus on travaillait, plus on gagnait. Dans tous les chantiers, les hommes, étaient logés et nourris, mais les salaires variaient d'une région à l'autre. En 1916, un bûcheron travaillant sur les chantiers de Jackman gagnait 35$ par mois alors qu'à Trois-Rivières, un autre recevait 75$ pour trente jours d'ouvrage.
Pour les bûcherons déjà levés depuis cinq heures le matin, une journée d'ouvrage commençait à sept heures et se terminait à la noirceur. Souvent pour le dîner, on mangeait dans le bois : on allumait un feu et on faisait chauffer le thé et la nourriture qu'on avait apporté du camp. Le même menu revenait souvent : pain, lard ou cretons, tourtière, grillades de lard salé, «beans» avec de la mélasse et pommes de terre. Le soir, soit que l'on jouait aux cartes ou un conteur divertissait les hommes avec des histoires et à 9 heures, on se couchait. Le dimanche, on en profitait pour laver le linge à l'eau bouillante pour tuer les poux. L'hygiène est devenue plus importante vers les années 1945, car un inspecteur passait visiter les camps afin de s'assurer du respect de certains règlements.
Au début, l'abattage des arbres se faisait à la hache par deux bûcherons «coupeux» frappant à tour de rôle. Vers la fin du XIXe siècle, on utilisait plutôt le godendart, scie d'environ six pieds de long, actionnée elle aussi par deux hommes. Puis vers 1920, la sciotte ou «boxa» qui pouvait être actionnée par un seul homme, remplaça le godendart qui était plus difficile à mouvoir. En 1940, l'arrivée de la scie mécanique amena une importante révolution. Le métier de bûcheron ne fut plus jamais le même.
[Voir l'image pleine grandeur]

Dès que la neige se faisait trop haute, vers la mi-février ou en début mars, on devait cesser de bûcher. On se préparait pour faire le charroyage du bois. Seulement quelques bûcherons restaient alors pour faire la drave, car ce travail exigeait des aptitudes et de l'expérience spécifiques. La plupart des autres hommes rentrait donc à la maison afin de retrouver la famille qu'ils avaient quittée depuis l'automne.
Le cordonnier
Au 18e siècle, les cordonniers pratiquant leur métier étaient surtout des Britanniques venus s'installer au Québec. Ils étaient peu nombreux, mais avaient de l'expérience. Cependant, ce n'est qu'au 19e siècle qu'ils commencèrent à changer leurs pratiques traditionnelles.
Le travail du cordonnier vers 1700, consistait à réaliser de ses propres mains, la chaussure entière de la semelle jusqu'à l'empeigne. Il était à la fois tailleur, monteur, couturier, polisseur, etc. Jusqu'au 19e siècle, le cordonnier exécuta toutes ces étapes, et ce, sur commande de ses clients. Les cordonniers anglophones innovèrent avec de nouveaux modèles de chaussures, suivant ainsi la mode qui changeait d'un pays à l'autre. En ce temps, la mode était aux bottes militaires qui portaient souvent le nom de généraux célèbres.
Par la suite, à cause de la croissance des besoins du marché, le cordonnier a dû produire plus de chaussures et les mettre en vente en attendant le client. Certains avaient quelques employés; les plus importants durent adopter une méthode de travail différente qui consistait à donner à chaque employé, une opération spécialisée. Par exemple, l'un pouvait tailler le cuir, l'autre faire la couture de l'empeigne et de la tige, puis un autre le chevillage et la finition. Ainsi, les petites boutiques encore existantes fonctionnant avec le système artisanal côtoyaient le système commercial à l'intérieur duquel, plusieurs travailleurs participaient à la fabrication d'une même chaussure. Cette dernière façon de travailler permit aux cordonniers-marchands d'agrandir leur marché en exportant leurs produits à l'extérieur de la ville.
Tout prenait l'allure de manufacture. L'arrivée de la machine à coudre, en 1854, fut une véritable révolution, d'abord aux États-Unis, ensuite au Québec. C'est alors que la fabrique, caractérisée par la mécanisation et la machine à vapeur, prit la place des manufactures.
Aujourd'hui, le cordonnier n'est plus celui qui fabrique les chaussures, mais plutôt un savetier qui répare les chaussures usagées.
[Voir l'image pleine grandeur]

Le forgeron
Parmi tous les métiers se rattachant au travail du fer, celui de forgeron reste le plus populaire. S'occupant à la fois d'armurerie, de serrurerie, de clouterie, de taillanderie et de chaudronnerie, le forgeron était sans doute le plus polyvalent et le seul à ne pas dépendre des autres, car il pouvait lui-même fabriquer ses outils.
La boutique de forge était un lieu de rencontre où les habitants du village, comme ceux des rangs, se réunissaient pour bavarder et se raconter les dernières nouvelles.
Afin d'exercer son métier convenablement, le forgeron devait, en plus d'être outillé adéquatement, connaître l'art de bien contrôler le feu ainsi que les particularités des métaux. C'est à l'aide de plusieurs outils, qu'il pouvait répondre aux diverses demandes de ses clients : le foyer et ses accessoires, les tisonniers, la pelle à charbon, le baquet à eau et les trépieds en plus de l'enclume, des pinces, des marteaux, des étampes, des tranches, des ciseaux et des poinçons. C'est aussi en suivant un procédé à l'intérieur duquel trois étapes essentielles l'amenaient à la réalisation d'un produit fini, que le forgeron pouvait réaliser ses «œuvres». La première étape était le chauffage du fer, la seconde, le forgeage et finalement, le trempage.
La plus grande partie du travail du forgeron dépendait beaucoup de l'activité économique de la région. Si l'agriculture y était importante, le forgeron travaillait la plupart de son temps à ferrer les chevaux, à restaurer l'outillage agricole ou les diverses ferrures des bâtiments. Dans la Beauce par exemple, les forgerons fabriquaient beaucoup de feux et de «bouilleuses» pour les sucreries. Avec le temps, le forgeron a dû exploiter d'autres sources de revenus, car le progrès technique, la transformation énergétique et l'arrivée de l'acier ont rendu difficile la pratique de ce métier. Certains ont abandonné, d'autres se sont recyclés, pour plusieurs en mécaniciens. Ils ont transformé leur boutique de forge en garage suite à l'arrivée inévitable du moteur électrique et de la mécanisation des instruments aratoires, vers 1928. Une faible minorité, moins touchée par la nouvelle technologie, a difficilement continué en se perfectionnant dans la fabrication du fer «forgé» ornemental ou encore, un peu plus tard, vers 1940, en allant aux chantiers pour le temps que durait la coupe du bois ou le «halage». On l'appelait alors «forgeron ambulant». Ce furent là les dernières manifestations du travail de forgeron.
[Voir l'image pleine grandeur]

La maîtresse d'école
Autrefois, les enfants de la campagne ne fréquentaient pas l'école du village car il n'existait aucun moyen de transport. Afin d'éduquer le plus grand nombre possible d'enfants, on a construit dans les rangs des petites écoles appelées «écoles de rang». L'âme de ces modestes bâtiments était bien sûr la maîtresse d'école.
La maîtresse d'école attirait l'attention de tous les habitants du rang. Son arrivée était toujours très bien organisée et une fois installée, elle devait se faire accepter des résidents du coin. Hébergeant parfois les plus éloignés et se transformant souvent en mère nourricière à l'heure du dîner, elle servait aussi de confidente aux parents qui sollicitaient son aide. On la consultait pour différentes raisons. En lui confiant leurs enfants, les habitants du rang manifestaient leur estime et leur confiance envers celle qui représentait l'ordre et de qui on n'osait contester les décisions. Elle était sans aucun doute, une éducatrice pour tout le rang.
Davantage perçue comme une intellectuelle, la maîtresse d'école joignait les rangs des notables de la place plutôt que ceux des cultivateurs. Occupant le second rang, après le curé bien entendu, elle tenait un rôle très important «quant à la destinée des enfants». Tout comme le curé, elle devait faire sa visite annuelle chez les familles dont les enfants fréquentaient sa classe. Lors d'événements éprouvants chez des familles du rang tels un décès ou une maladie, la maîtresse d'école servait de substitut à la mère s'occupant alors des enfants. D'autre part, ses services étaient souvent retenus pour écrire une lettre, rédiger les adresses lors d'une noce ou d'un mariage, lire les instructions quant à l'utilisation d'un nouveau produit ou encore, participer à une quête pour le village. La renommée de l'école de rang découlait beaucoup de la personne qui la dirigeait.
Malgré tout son dévouement, la maîtresse d'école ne recevait qu'un bien piètre salaire. On disait que l'enseignement était une vocation à cause de la grandeur d'âme de plusieurs institutrices. Certaines se voyaient récompensées de leurs services par différentes marques d'attention. Parfois, elles recevaient même des cadeaux, par exemple, du sirop d'érable, des fruits, etc. Le dimanche, un habitant du rang se faisait un honneur de conduire la maîtresse d'école à l'église.
En plus de tout cela, l'institutrice devait faire preuve d'une souplesse d'esprit peu banale. Elle avait à plaire à la fois aux enfants, aux parents, au curé et au commissaire. Ses propos ne devaient jamais froisser quiconque, car elle risquait alors d'être renvoyée par le commissaire qui possédait beaucoup de pouvoir. Tous ses faits et gestes étaient scrutés par le village en entier.
[Voir l'image pleine grandeur]

Pour conclure, on peut dire que durant plus de 150 ans, plusieurs Québécois et Québécoises ont bénéficié des talents et du dévouement des maîtresses d'école pour compléter leurs études primaires ou pour apprendre à lire et à écrire. À partir du moment où les moyens de transport se sont améliorés, les écoles de rang ont commencé à disparaître peu à peu.
Le Groupe Alpha des Etchemins
Issu de la volonté du milieu de se doter d'un organisme communautaire offrant de la formation de base en lecture, en écriture et en calcul, Le Groupe Alpha des Etchemins a été mis sur pied en 1996.
Notre territoire d'intervention est immense. Nous offrons nos services à Lac-Etchemin sur les berges du lac du même nom et à St-Prosper. Depuis 1996, notre organisme est en constante évolution et nos activités de plus en plus diversifiées : alphabétisation, développement des compétences parentales, ateliers de raisonnement logique, informatique, projet IFPCA (Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d'alphabétisation)... Nos participants, l'essence même de l'organisme, ont su, avec le temps, tisser des liens entre eux et développer un sentiment d'appartenance au groupe. Nous participons activement à la vie communautaire de la région : projet d'aide à l'éveil à la lecture et à l'écriture, Centre communautaire et différentes tables de concertation. Pour tout dire, nous sommes une bien belle «gang».
Dans le cadre des projets IFPCA, le Groupe Alpha des Etchemins a déjà produit deux documents pédagogiques intitulés, Alpha et tradition orale, MRC des Etchemins et Partager son histoire, enrichir le monde, disponibles à nos bureaux.
Crédits
La réalisation de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière du Secrétariat national à l'alphabétisation dans le cadre du programme «Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d'alphabétisation».
Conception et recherche
Chantal Leclerc
Valérie Poulin
Rédaction, traitement de textes et mise en pages
Chantal Leclerc
Valérie Poulin
Lecture et correction d'épreuves
Sylvain Castonguay
Réjean Quirion
Francine Renaud
Illustrations
Le Maître de l'Illustration
Illustration de la page couverture
CLD des Etchemins
Impression
Le Maître de l'Illustration
Distribution
Groupe Alpha des Etchemins
201, rue Claude-Bilodeau, Suite postale #17
Lac-Etchemin (Québec)
Téléphone : (418) 625-2550
Télécopieur : (418) 625-2549
Courriel : alpha@sogetel.net
Nous tenons à remercier Monsieur Jérôme Vermette, agent culturel au CLD des Etchemins, pour ses judicieux conseils et pour le prêt de plusieurs documents historiques qui ont grandement facilité notre recherche.
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2004