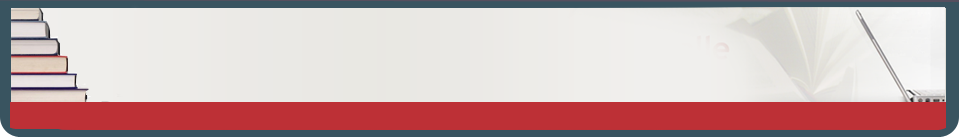- Présentation de COMSEP
- Historique de l'approche de conscientisation
- Présentation du projet
- Le théâtre populaire à COMSEP
- La démarche de l'animatrice
- Les ateliers
- Atelier 1: Apprendre à se connaître
- Atelier 2: Le corps, un langage peu connu
- Atelier 3: Découvrir les thèmes conscientisants
- Atelier 4: Écrire une pièce, pourquoi pas
- Ateliers 5 et 6
- Atelier 7: Début des pratiques et l'équipe technique au travail!
- Atelier 8: Pas besoin d'être une vedette pour jouer la comédie
- Atelier 9: Le trac de la pratique
- Atelier 10: Les derniers préparatifs avant la première
- Atelier 11: On joue!
- Atelier 12: C'est l'heure de l'évaluation
- Les témoignages
- Annexes
- Annexe 1 – Préparation des ateliers
- Annexe 2 – Exercices techniques
- Annexe 3 – Bureau d'aide sociale
- Annexe 3a – Bureau d'aide sociale
- Annexe 4 – Plan de la scène
- Annexe 5 – Accessoires
- Annexe 6 – Chanson d'Annette
- Annexe 6a – Cowboy des temps modernes
- Annexe 7 – Dépliant publicitaire
- Annexe 7a – Publicité dans les médias
- Annexe 8 – Aide sociale (plateau 1)
- Annexe 8a – Bar gai (plateau 2)
- Annexe 9 – Questionnaire d'entrevue
- Annexe 10 – Restaurant chic
- Annexe 10a – Chanson du camionneur
- Annexe 10b – Le harcèlement sexuel
- Annexe 10c – La communication
- Annexe 10d – Bar gai
- Annexe 10e – Le racisme
- Annexe 10f – Logements sociaux
- Annexe 10g – Intégration des personnes handicapées
- Annexe 11 – Mémoire déposé a la commission régionale de la Mauricie/Bois-Francs/Drummond sur l'avenir du Québec
- Documents déjà parus
- Crédits
Présentation de COMSEP
Le Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux gens à faible revenu de la région trifluvienne afin d'améliorer leurs conditions de vie.
Ses objectifs sont de regrouper les gens à faible revenu, de faire de l'alphabétisation et de l'éducation populaire autonomes et de représenter ses membres afin d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et de leurs valeurs. Plusieurs comités lui permettent de concrétiser ses objectifs: le comité APPUI (Action pour parents uniques informés), le théâtre populaire, la formation professionnelle, le collectif Femmes, le collectif Hommes, les cuisines collectives, le comptoir vestimentaire, le développement économique et finalement, l'Envol Alpha.
L'alphabétisation populaire est une approche polyvalente en éducation populaire autonome; sa spécificité tient à ses dimensions pédagogique et politique de même qu'à son engagement social, valeurs définies par le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec.1
Une des pratiques que notre organisme privilégie en alphabétisation est celle de l'approche de conscientisation, car elle permet véritablement la transformation des rapports sociaux.
Il est important de savoir que les ateliers d'alphabétisation-conscientisation occupent trois heures sur neuf par semaine. Les six autres heures sont partagées également entre des ateliers thématiques en éducation populaire et des ateliers de français. Pour les besoins du présent document, nous vous présentons seulement le volet alphabétisation-conscientisation.
Historique de l'approche de conscientisation
L'alphabétisation-conscientisation, telle que nous la pratiquons au Québec, est une adaptation des pratiques originaires de l'Amérique du Sud. C'est au Brésil, autour de 1960, que la pensée de Paulo Freire, philosophe, éducateur et militant, se concrétisa dans une expérience d'alphabétisation-conscientisation auprès d'une population vivant des situations d'exploitation économique, de domination politique et d'aliénation culturelle.
Paulo Freire prit comme point de départ les habitants des tavelas (bidonvilles) et tenta de leur apprendre à lire et à écrire à travers «l'univers vocabulaire» qui traduisait leur culture et leurs valeurs. Ainsi les habitants, en plus d'apprendre à lire et à écrire des mots, apprenaient à lire, à écrire et à analyser leur propre réalité afin d'agir sur la transformation de celle-ci. Ces expériences se réalisaient, non pas dans des classes conventionnelles, mais autour de «cercles de culture» significatifs aux personnes en apprentissage.
Les "cercles de culture" prirent une telle ampleur que le plan de Paulo Freire allait être projeté sur la scène fédérale pour devenir une campagne d'alphabétisation dans tout le Brésil. Récupéré par l'État, le plan prévoyait alphabétiser, en moins de deux ans, plus de deux millions de personnes analphabètes et accroître à 80 % le potentiel électoral. Un processus si menaçant pour les rapports de forces politiques qu'à la veille des élections, un coup d'État renversa le président Goulard. Paulo Freire, quant à lui, dut s'exiler au Chili. Les méthodes pédagogiques de Paulo Freire furent reprises par le gouvernement chilien, puis par d'autres pays d'Amérique latine.
L'approche de conscientisation a traversé les continents et a pris la forme des réalités à transformer. Les milieux urbains et ruraux de l'Amérique du Nord sont des lieux tout aussi susceptibles d'être conscientisés, car ils traduisent des rapports d'exploitation et d'oppression.
Au Québec, l'alphabétisation populaire est née en réaction au type d'alphabétisation pratiqué dans les commissions scolaires et qui ne correspond pas aux besoins de nombreuses personnes analphabètes.
Vues comme des interventions alternatives, les pratiques d'alphabétisation -conscientisation s'articulent autour des situations problématiques vécues par les personnes analphabètes. Ces dernières analysent ensemble une réalité afin d'entreprendre collectivement et individuellement des actions qui la transformeront.
Présentation du projet
Dans un souci toujours présent de développer de nouvelles pratiques qui permettront à nos participants et participantes d'améliorer leur potentiel en lecture, en écriture et en oral, les animatrices ont tenté l'expérience du théâtre. Depuis quelques années, la démarche de théâtre fait partie intégrante de notre programme d'alphabétisation populaire. À chaque année, une pièce est créée, des personnes en processus d'alphabétisation surmontent leurs peurs, améliorent leurs connaissances en français et réalisent un grand succès tant au niveau du box office que de la critique générale!!!
Aucun autre programme d'activité ne stimule autant nos participants et participantes à travailler hors des heures d'ateliers et à s'acharner autant à lire et à écrire des textes. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet d'une pièce de théâtre dans l'amélioration de l'estime de soi. Les personnes ayant participé à une telle démarche sont en mesure de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne.
Un autre objectif, non négligeable, est celui de conscientiser les spectateurs et spectatrices à des problématiques spécifiques. En effet, le choix des thèmes des pièces de théâtre est toujours relié à la conjoncture sociale, culturelle, politique et économique de la société québécoise. De plus, une attention particulière est portée à la qualité des relations hommes-femmes et à l'égalité des chances de chacun et de chacune dans la société.
Avant de terminer, j'aimerais en profiter pour souligner le travail remarquable de notre animatrice de théâtre, Marie-Josée.
Elle ne peut certes pas non plus compter les nombreuses nuits d'insomnie qu'elle a passées à créer des pièces ou à tenter de contrôler son trac pour que tout soit réussi lors de la représentation officielle. Elle est tellement passionnée qu'elle réussit à embarquer toute l'équipe de travail dans les projets les plus fous. Merci à Marie-Josée pour nous avoir fait vivre d'aussi grandes émotions au théâtre. Ses heures d'implication dans les démarches de création sont incomparables.
N'hésitez pas à lui téléphoner pour lui parler théâtre, vous en aurez pour des heures à l'entendre vous raconter ses anecdotes.
Nous espérons que vous aurez, vous-aussi, la piqûre du théâtre et que vous tenterez l'expérience avec les membres de votre groupe.
Sylvie Tardif
pour COMSEP
Le théâtre populaire à COMSEP
COMSEP est un organisme d'éducation populaire qui existe depuis 1986. Au fil des ans, l'équipe de COMSEP a développé différentes façons de faire vivre, aux personnes participant aux ateliers d'alphabétisation, des démarches de conscientisation. Le théâtre populaire fait donc partie des pratiques de l'organisme depuis son origine. Il est utilisé pour favoriser autant l'expression orale et écrite que les apprentissages ou le travail de conscientisation. Grâce à la collaboration d'une de ses intervenantes, qui faisait alors partie d'une troupe de théâtre, COMSEP a mis sur pied en 1986 son premier Comité théâtre, composé de 6 personnes: des travailleuses, des membres du conseil d'administration et une participante en alphabétisation. La première représentation théâtrale publique de l'organisme a été présentée dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 1989.
D'année en année, le comité théâtre est devenu une réalité permanente à COMSEP. De nombreuses personnes ont mis la main à la pâte: participantes et participants aux ateliers d'alphabétisation, membres des autres comités et personnel de COMSEP. Le théâtre constitue, à chaque année, un outil privilégié de conscientisation, pour les membres du comité bien sûr, mais aussi et surtout, pour le public qui assiste aux représentations de pièces à fort contenu conscientisant.
L'option-théâtre en alphabétisation, quant à elle, est née en 1992 d'une préoccupation de l'équipe de travail d'accentuer la participation des personnes analphabètes au niveau du théâtre. Les personnes qui participent aux ateliers d'alphabétisation peuvent choisir deux fois par année une option qui leur permettra, sur une période de quinze semaines, d'approfondir et d'améliorer leurs connaissances ou encore de développer de nouvelles habiletés. Voici quelques-unes des autres options possibles: solidarité internationale, condition féminine, condition masculine, premiers soins, alimentation. Ces activités optionnelles sont dispensées à raison de 3 heures par semaine en complément aux ateliers d'alphabétisation.
Les options se veulent une méthode alternative d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Étant donné le contexte et un investissement de soi accru (temps, énergie, etc.) dans un domaine particulier, il arrive très souvent que des individus qui éprouvent des blocages pédagogiques importants «débloquent» au cours de ces ateliers. Par exemple, une participante impliquée en option-théâtre travaillera le soir à apprendre ses textes et pratiquera plusieurs fois en dehors de ses ateliers d'alphabétisation. Chaque année, ces options portent sur une dizaine de thèmes, et chacun des groupes compte de 12 à 15 personnes.
Voici les réalisations de l'option-théâtre en alphabétisation:
1992: La déprime, pièce écrite par Denis Bouchard, Rémy Girard, Raymond Legault, Julie Vincent.
1993: J't'en passe un papier, pièce écrite par Danielle Allie, Johanne Létourneux et Yves Dagenais pour le Théâtre de La Cannerie.
1994: La destinée, écriture collective par les membres de l'option-théâtre réalisée dans le cadre de l'Année internationale de la Famille. Cette pièce relate le vécu de deux couples de jumeaux (un garçon et une fille), mélangés à la naissance et vivant dans des familles de
revenus différents. On peut y voir l'évolution de ces 4 personnes avec les hauts et les bas découlant de leur statut social.
1995: Création collective, écrite par les membres du groupe à partir du Mémoire présenté par COMSEP dans le cadre de la Commission régionale sur l'avenir du Québec. Ce Mémoire s'inspire du Cadre de référence du MÉPACQ (Mouvement d'éducation populaire et de l'action communautaire du Québec) et de la Charte d'un Québec populaire énoncée par Solidarité populaire Québec. La pièce est donc composée de plusieurs scènes qui présentent des situations relatives aux principes présentés dans le mémoire.
[Voir l'image pleine grandeur]

La démarche de l'animatrice
La disponibilité requise
L'animatrice de l'option-théâtre de COMSEP a beaucoup d'expérience dans ce domaine grâce à sa formation et son implication diversifiée en théâtre. Elle participe depuis le début aux deux activités: comité théâtre et option-théâtre.
Une telle démarche est quand même très accessible à une animatrice moins expérimentée. Cependant, la personne qui désire réaliser l'animation théâtrale décrite dans ce cahier doit savoir que cela demande un investissement de temps très important. Une première expérience nécessite de 150 à 180 heures pour la préparation et l'animation des ateliers, selon le nombre de rencontres (12 à 15).
Pour préparer la série d'ateliers décrite ici, l'animatrice actuelle a donc puisé dans son expérience personnelle et dans le matériel pédagogique utilisé au cours des années précédentes.
Les attitudes de l'animatrice
Pour réaliser et réussir ce genre d'ateliers, les attitudes de l'animatrice sont très importantes. Celle-ci doit faire preuve, comme nous le verrons au cours de la lecture du document, de beaucoup d'écoute et de respect des participantes et des participants. Son attitude doit aider ces personnes à utiliser l'humour, à s'exprimer librement et inciter les membres du groupe à respecter tout le monde.
Elle doit faire en sorte que toutes les personnes se sentent intégrées et également importantes dans la démarche.
Elle doit être capable de transmettre au groupe la conviction que tous les rôles et toutes les tâches techniques ont leur importance pour arriver à la réussite de la pièce.
Les objectifs généraux de la démarche
Le premier objectif de cette démarche est de favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par le biais du théâtre. Vient ensuite celui de faire naître chez les participantes et participants un sentiment de fierté et de confiance en eux. Les personnes analphabètes ont souvent tendance à minimiser leurs capacités à cause de leurs limites en lecture ou en écriture. De prime abord, jouer dans une pièce de théâtre ou en écrire une sont des rêves inaccessibles. Ce privilège semble réservé aux artistes! L'option-théâtre permet donc à ces personnes de découvrir qu'elles ont des talents cachés, et qu'il n'en tient qu'à elles de les exploiter. Lorsque les talents sont trop bien cachés, le contenu des ateliers permet de développer certaines habiletés. Le rêve devient donc graduellement réalité.
Un autre objectif consiste à réaliser une démarche de conscientisation par le biais du théâtre. Cette démarche est vécue par les personnes qui participent aux ateliers mais aussi par le public qui assiste à la présentation de la pièce.
La pédagogie
La pédagogie prendra différentes formes au cours des ateliers. Elle doit favoriser l'expression orale, l'expression corporelle et finalement l'expression écrite. L'animatrice doit, lorsqu'elle choisit les activités, tenir compte de ces dimensions, car elles faciliteront l'expression lors de la représentation (voir annexe 1). Les personnes qui veulent seulement faire partie de l'équipe technique doivent, comme les autres, participer aux différents exercices présentés par l'animatrice.
Les exercices choisis doivent aussi favoriser l'intégration des nouvelles personnes. Un certain nombre de participantes et de participants reviennent à l'option-théâtre depuis quelques années, même depuis le début. Les nouveaux venus ont parfois tendance à accorder aux anciens un certain statut en raison des performances théâtrales que ces derniers ont eu l'occasion de voir les années précédentes. L'animatrice doit dès le départ créer un climat de collaboration et d'entraide. Elle se servira des anciens pour introduire des exercices déjà connus et pour aider les personnes qui ont plus de difficulté sur le plan de la mémorisation.
L'apprentissage du français prend aussi une place importante à l'intérieur des ateliers. Lecture, écriture, compréhension de textes, recherche de mots difficiles, expression orale, sont autant d'outils qui permettent d'enrichir les acquis développés durant les ateliers d'alphabétisation proprement dits.
Finalement, la pédagogie doit aussi tenir compte du niveau d'apprentissage des personnes présentes. En préparant les exercices qui nécessitent lecture ou écriture, l'animatrice devra prévoir des mécanismes pour faciliter la participation des personnes analphabètes complètes. Elle devra aussi trouver des moyens pour favoriser le travail de mémorisation. À ce sujet, selon le niveau de difficulté des personnes, l'animatrice peut aussi utiliser la méthode de la «littérature de l'oreille» pour les aider à retenir leur texte. Cet outil de mémorisation est expliqué dans la description de l'atelier 7.
La planification des ateliers
L'activité de l'option-théâtre décrite dans le présent document s'est déroulée sur 12 rencontres, il est préférable d'élaborer la démarche en fonction de 15 ateliers. Cependant, les dernières répétitions se trouvent incluses dans les ateliers réguliers, et il est plus facile pour les personnes participantes de planifier leur emploi du temps. Selon les disponibilités du groupe, il peut être intéressant de réaliser des ateliers de plus de 3 heures. La cohésion du groupe s'en trouve raffermie, le travail d'écriture et de mémorisation s'effectue plus rapidement.
La démarche étant divisée en différentes phases, la planification peut donc aussi se faire par étape:
- Les premiers ateliers
L'animatrice choisit des exercices qui favorisent l'intégration des nouvelles personnes et qui permettent de développer graduellement des habiletés en théâtre. Elle prépare quelques exercices supplémentaires au cas où ceux qu'elle a prévus ne fonctionnent pas avec le présent groupe (voir annexe 2).
- L'écriture de la pièce
L'animatrice choisit un texte en rapport avec l'actualité qui a déjà été travaillé en ateliers d'alphabétisation. L'animatrice peut demander aux autres membres de l'équipe de travail de l'aider à faire le choix du texte. De cette façon, il y a plus de chance que le texte soit directement connecté avec les apprentissages et les éléments de conscientisation véhiculés dans les groupes d'alphabétisation populaire.
Dans le cas présent, le texte choisi est celui du Mémoire déposé par COMSEP dans le cadre de la Commission régionale sur l'avenir du Québec. Dans ce texte, on retrouve le projet de société québécoise souhaitée par les membres de l'organisme.
Il est plus facile de partir d'un texte déjà écrit que de partir d'une discussion plus large. Le texte permet aussi de réaliser une activité de lecture. Le thème développé dans le texte est important, car il doit servir de point de départ à la démarche de conscientisation.
Après l'écriture d'une première ébauche de la pièce par les participantes et participants, l'animatrice a effectué un travail de réécriture, surtout afin de transposer le texte sous forme de scénario. Elle a porté une attention particulière au contenu de façon à ne pas modifier les idées apportées par le groupe. Elle a questionné le groupe sur certains passages qui pourraient aller plus loin au niveau du message ou être écrit différemment pour faciliter le déroulement de la pièce.
Si l'animatrice en est à sa première expérience en théâtre, ou encore que le groupe n'est pas prêt à écrire lui-même une pièce, elle peut choisir un texte déjà écrit. À À ce moment-là, la démarche est bien différente jusqu'à l'étape de la distribution des rôles. Il faut remplacer l'étape d'écriture par un bon travail d'appropriation et de compréhension du texte, tant au niveau des idées que des mots inconnus. Il reste que la démarche d'écriture de la pièce par les membres du groupe s'avère de loin la plus intéressante et la plus profitable au point de vue pédagogique. Par contre, il est préférable de recourir à un texte déjà écrit lorsqu'il existe de sérieuses difficultés concernant l'échéancier ou la dynamique du groupe.
- La distribution des rôles et la mise en scène
Le travail de l'animatrice prend alors des allures de metteure en scène. Elle tient compte des capacités des personnes et de la dynamique dans le groupe pour planifier la distribution. Elle dresse une liste de ce qu'elle devra discuter avec l'équipe technique. Lors du chapitre qui traite du septième atelier, il est question d'un outil de mémorisation sur cassette appelé «littérature de l'oreille». Il est possible que la réalisation de cet outil fasse alors partie du travail de préparation de l'animatrice.
- La représentation
À cette étape-ci, l'animatrice a demandé la collaboration de ses collègues de travail pour soutenir les participantes et participants dans certains rôles et pour l'aspect technique.
L'animatrice a aussi plusieurs tâches techniques à réaliser avant la représentation (voir atelier 11). Elle se fait aider par l'équipe technique composée de membres de l'option-théâtre. Toutefois, dans le cas présent, l'équipe n'était pas assez nombreuse parce que la majorité des personnes participant à l'option-théâtre préféraient jouer un rôle.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les ateliers
Existe-t-il un conte pas bête écrit par un ancien enfant qui se souvient que les éléphants sont pas des humains mais juste des bêtes? Existe-t-il Une belle histoire qu'on peut raconter en famille qui dit l'amour et qui fourmille d'idées nouvelles et non de gloire? Existe-t-il une belle histoire?
Sylvain Lelièvre
Atelier 1: Apprendre à se connaître
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Présenter la démarche
- Faire connaissance
- Favoriser l'intégration des personnes n'ayant jamais participé à l'option-théâtre
- Permettre aux participantes et participants de prendre
- contact avec le théâtre-jeu
- Intégrer l'apprentissage du français dans la
- démarche
- Développer l'esprit d'équipe
Moyens:
- Jeu de connaissance
- Jeu de la balle de laine
- Jeu de l'objet mystérieux
- Mimes
Matériel requis:
- Balle de laine
- Objets de la vie quotidienne (coffre à crayons, balle, tasse, cahier, etc.)
- Bouts de papier, crayons et contenants
- Montre ou chronomètre
- Dictionnaire
Déroulement:
1. Introduction de la démarche de l'option-théâtre
L'animatrice explique comment vont se dérouler les ateliers. Elle insiste sur la qualité de l'atmosphère en mentionnant que, dès le départ, le respect des autres et l'esprit d'équipe sont essentiels pour arriver à jouer une pièce de théâtre et ce, dans les délais prévus. L'humour prendra beaucoup de place, car il facilitera l'implication de chaque personne. Par contre, il ne faut pas oublier que la limite de l'humour se situe là où commence le respect des autres.
2. Jeu de connaissance
Le jeu consiste à ce qu'une première personne se nomme; la deuxième nomme la précédente et ajoute son propre nom; la troisième nomme les deux premières et se nomme; ainsi de suite jusqu'à la personne qui a commencé. Celle-ci reprend les noms de tout le monde. L'animatrice peut désigner une ou deux autres personnes pour renommer tout le monde autour de la table en prenant soin de ne pas intimider une personne trop gênée.
3. Jeu de la balle de laine
La première personne qui joue tient le bout de laine. Elle dit pourquoi elle s'est inscrite à l'option-théâtre, si elle a déjà fait du théâtre avant et si oui, dans quelle(s) pièce(s) elle a joué. Selon les personnes qui composent le groupe, l'animatrice peut commencer l'exercice pour donner le ton. Elle lance ensuite la balle à une autre personne tout en continuant de tenir son bout de laine. La personne suivante répond aux mêmes questions et lance ensuite la balle à une autre personne sans oublier de tenir un bout de laine. Ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait répondu aux questions. À la fin du jeu, les participantes et participants ont tracé une forme ressemblant à une toile d'araignée. L'animatrice revient sur le fait que les membres du groupe devront faire preuve d'esprit d'équipe et de solidarité pour réussir la démarche et tisser entre eux une toile solide.
[Voir l'image pleine grandeur]

4. Jeu de l'objet mystérieux
Les participantes et participants se placent debout en cercle. L'animatrice dépose au centre du cercle un objet quelconque. Elle demande aux personnes présentes de faire preuve de créativité et d'imaginer que l'objet placé au milieu du cercle est autre chose que ce qu'il est réellement. Lorsqu'un membre du groupe a une idée, il s'avance spontanément, prend l'objet et mime sa nouvelle fonction. Par exemple, une cuillère peut devenir un téléphone, un peigne, un bâton de golf, etc. Les autres participantes et participants doivent découvrir le nouvel objet mimé. Lorsqu'ils réussissent, l'objet est déposé au centre et une autre personne vient lui donner une nouvelle identité. Quand l'inspiration manque et si le temps le permet, l'animatrice reprend le même jeu avec un autre objet.
Cet exercice permet de commencer à utiliser son corps, à se dérouiller l'imagination et à s'exprimer devant le groupe.
5. Mimes
L'animatrice divise le groupe en équipes de 4 ou 5 personnes, en prenant soin de mêler les nouveaux et les anciens, les timides et les moins timides. Le jeu de mimes se déroule en trois étapes:
- Première étape
Chaque personne doit écrire, sur un bout de papier, une phrase courte qui représente une action et la déposer dans le bocal de son équipe. Les personnes qui ont de la difficulté à écrire sont aidées par les autres membres de leur équipe. L'animatrice distribue les bocaux de chacune des équipes à une autre équipe. À tour de rôle, chaque participante et participant mime aux autres membres de son équipe une phrase tirée du nouveau bocal. Ils doivent deviner la phrase dans un laps de temps de 2 minutes.
2 minutes. Lorsque l'équipe devine la phrase, elle marque un point. On passe ensuite à l'équipe suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les personnes aient réalisé un mime.
- Deuxième étape
On refait le même exercice, mais cette fois-ci, les participantes et participants inscrivent seulement un mot sur le bout de papier. La recherche dans le dictionnaire n'est permise que seulement pour trouver l'orthographe d'un mot et non pour trouver un mot difficile. La durée du mime est de 1 minute seulement.
- Troisième étape
Même exercice avec des mots plus difficiles.
Commentaires
Pour la première fois depuis que l'option-théâtre existe à COMSEP, le groupe était composé majoritairement d'hommes. L'animatrice a dû porter une attention particulière à cette situation, car les hommes ayant culturellement plus de difficulté à transmettre leurs émotions, ils avaient tendance à rigoler pour contrer cette difficulté. De leur côté, les femmes s'impatientaient de cette attitude. Le premier atelier est très important pour la création du climat et de la dynamique du groupe.
Pour les mimes, les gens ont été portés à choisir spontanément les personnes qui avaient déjà fait du théâtre pour commencer. Ces dernières bénéficiaient d'un certain statut dans le groupe. Elles ont été très importantes pour favoriser l'intégration des nouvelles personnes et pour rassurer les autres quant à leur capacité de participer à la démarche.
Au niveau de l'apprentissage du français, les participantes et participants ont eu à formuler des phrases courtes, à écrire correctement et à lire des phrases et des mots. Dans le jeu des mimes, l'aspect compétition a favorisé la recherche de mots difficiles. Voici quelques exemples de mots qui ont été trouvés: sarcophage, bistouri, lentilles cornéennes, sismographe, nitroglycérine, extincteur.
La compétition a aussi permis de développer l'esprit d'équipe. Au dernier tour, les équipes cherchaient des mots de plus en plus difficiles pour éviter que les autres équipes trouvent le mot. Il a donc fallu que les personnes plus avancées dans l'équipe aident celles qui éprouvaient des difficultés dans la recherche de mots compliqués. Lorsque des éléments de compétition sont introduits dans la démarche, l'animatrice doit s'assurer qu'il s'agit d'une saine compétition.
Atelier 2: Le corps, un langage peu connu
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Favoriser l'apprentissage du français par la recherche de vocabulaire
- Apprendre à se déplacer dans un espace donné
- Initier les participantes et participants à communiquer des émotions sans utiliser la parole
Moyens:
- Jeu «Mon corps est une balle»
- Les états d'âme
- La lettre
Matériel requis
- Lettres de l'alphabet sur des feuilles 81/2X11
- Bouts de papier
- Cahiers de bord (cahiers)
- Tableau, craie
- Enveloppe avec feuille blanche
- Dictionnaire
Déroulement:
1. Mon corps est une balle- Première étape
L'animatrice demande aux personnes présentes de choisir individuellement 5 mots de 3, de 4, 5, 6 et 7 lettres respectivement. Chaque personne lit ses mots et l'animatrice les écrit au tableau par colonnes, selon le nombre de lettres. Les participantes et participants cherchent les mots difficiles dans le dictionnaire. Les personnes éprouvant des difficultés à chercher se font aider par les autres.
- Deuxième étape
Le groupe se divise au hasard (par tirage) en 3 équipes de 5 personnes. Chaque équipe écrit 5 mots, parmi ceux qui sont écrits au tableau, sur des bouts de papier. Chaque papier est plié en deux et on écrit sur le dessus du papier combien de lettres contient ce mot.
- Troisième étape
Le groupe délimite son territoire et dispose des lettres de l'alphabet sur le plancher. (Il faut mettre plus de voyelles que de consonnes)
Une personne est désignée dans chaque équipe. Ces personnes pigent chacune un mot qui contient le même nombre de lettres. Elles deviennent alors des balles. En épelant le mot dans leur tête, elles doivent simultanément sauter d'une lettre à l'autre.
Au même moment, les autres membres de l'équipe épellent le mot à haute voix pour le deviner. La première équipe qui termine et découvre son mot reçoit un point. L'exercice se termine lorsque tous les membres de l'équipe sont passés. L'équipe qui a le plus de points gagne.
[Voir l'image pleine grandeur]

2. Distribution du cahier de bord
Chaque personne reçoit un cahier de bord dans lequel elle pourra consigner les différents exercices qui nécessitent de l'écriture. Le cahier peut être distribué au cours du premier atelier si le déroulement le permet. Le cahier de bord permet d'assurer le suivi entre les ateliers, particulièrement lorsque la période d'écriture de la pièce commence.
3. Les états d'âme- Première étape
Chaque personne écrit individuellement dans son cahier de bord des états d'âme connus, par exemple: joie, peur, amour, peine, gêne, etc. L'animatrice fait un tour de table pour connaître les idées ressorties et les écrit au tableau.
- Deuxième étape
Les participantes et participants se placent debout et en cercle. L'animatrice nomme un des états d'âme inscrits au tableau. Sans parler, les personnes doivent mimer un état d'âme, faire passer les émotions. Si les membres du groupe sont plus gênés ou moins à l'aise dans l'expression des émotions, l'animatrice peut leur demander de se placer face au mur. Chaque personne se trouve alors à mimer l'émotion pour elle-même.
4. La lettre
De nouveau, le groupe se place en cercle. L'animatrice demande aux participantes et participants de penser (sans parler) à un moment heureux dans leur vie. Elle les amène à intérioriser un sentiment de joie.
À tour de rôle, chaque personne reçoit une feuille blanche pliée dans une enveloppe. Elle doit ouvrir l'enveloppe, prendre la lettre et faire comme si elle recevait une bonne nouvelle, toujours sans parler.
Lorsque tout le monde a reçu la lettre, les participantes et participants partagent les moments heureux auxquels ils ont pensé pour se préparer à l'exercice.
Si l'animatrice sent que le groupe est prêt, elle peut reprendre l'exercice avec un événement malheureux. Par contre, cela peut être un peu prématuré lors d'un deuxième atelier.
5. Évaluation de l'atelier
L'animatrice demande aux personnes présentes de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu au cours de l'atelier. Cette étape est importante, puisque le groupe a été pour la première fois en contact avec l'expression des émotions.
Commentaires
L'exercice de la balle peut être exigeant pour des personnes plus âgées ou en mauvaise condition physique. Si c'est le cas dans le groupe, il faudrait peut-être penser à une adaptation de l'exercice. Par exemple, on peut utiliser une méthode inspirée de l'émission de télévision «Fort Boyard». Cela consiste à déposer des objets sur les lettres plutôt que de sauter. Même si le jeu se déroule rapidement, il s'agit un exercice physique moins exigeant.
Au niveau de l'expression des émotions, il est très important de respecter les personnes. Il peut arriver qu'une personne ne se sente pas capable de participer à cette activité. Il s'agit de la rassurer et de lui indiquer qu'elle pourra le faire lors d'un prochain atelier au moment où elle se sentira prête. Quelques hommes du groupe ont eu plus de difficulté à exprimer des émotions. L'animation doit permettre l'expression de cette difficulté sans la tourner en ridicule.
Étant donné la dynamique du groupe, l'aspect de compétition a aidé au déroulement. Cependant, la majorité des exercices peuvent se faire sans qu'il y ait compétition. C'est à l'animatrice de juger selon la composition du groupe.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 3: Découvrir les thèmes conscientisants
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Favoriser l'apprentissage du français par la lecture et la compréhension de texte
- Dégager, par un texte de réflexion, des éléments de la vie quotidienne qui pourront être repris dans la pièce de théâtre
- Prendre contact avec le théâtre par l'improvisation Amorcer l'élaboration du contenu de la pièce
Moyens:
- Mots par analogie
- Jeu de l'objet mystérieux
- Lecture d'un texte de réflexion
- Improvisation
Matériel requis:
- Objets de la vie quotidienne (brosse à cheveux, livre, crayons, etc.)
- Texte de réflexion (Mémoire présenté à la Commission régionale sur l'avenir du Québec)
- Tableau, craie
- Bouts de papier
- Boîte
- Montre ou chronomètre
- Cahiers de bord
- Dictionnaire
Déroulement:
1. Période de réchauffement
- Mots par analogie
Les personnes présentes se placent debout et en cercle. L'animatrice dit un mot. En disant ce mot, elle frappe dans ses mains en faisant un mouvement comme pour passer le mot à la personne qui est à côté d'elle. Cette personne dit un autre mot auquel le mot qu'elle vient de recevoir lui fait penser en faisant elle aussi le geste de le passer à la personne voisine. Ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait dit un mot. Lorsque le jeu se déroule et qu'une personne ne peut dire un mot, elle doit se retirer du cercle. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Le jeu peut être repris quelques fois, jusqu'à ce que l'animatrice voit que le groupe est prêt à passer à un autre exercice.
- Jeu de l'objet mystérieux
Cet exercice a déjà été expliqué dans le premier atelier à la page 25. Il est suggéré de le reprendre parce que les participantes et participants se sentent rapidement à l'aise avec cet exercice. Il est souhaitable de prendre des objets différents de la première fois.
2. Lecture d'un texte de réflexion
Étant donné que la période allouée à l'option-théâtre pour réaliser une pièce est très courte, il faut que l'animatrice apporte des suggestions de réflexion qui mèneront plus rapidement à un sujet de pièce. Ce sujet doit se rapprocher des préoccupations des personnes qui composent le groupe. Il peut être en rapport avec l'actualité. À titre d'exemple, lors de l'Année internationale de la Famille, la pièce portait sur différentes facettes de la famille d'aujourd'hui. Le sujet choisi doit s'inscrire dans une démarche de conscientisation.
Pour la présente démarche les participantes et participants ont lu à tour de rôle les grandes lignes du Mémoire déposé par COMSEP devant la Commission régionale sur l'avenir du Québec2 (voir annexe 11).
Au moment de la lecture du texte, les personnes se sont entraidées et ont lu plus ou moins longtemps selon leurs difficultés. Après la lecture, l'animatrice a repris chacun des sept principes énoncés dans le Mémoire. Elle a demandé aux participantes et participants de donner des exemples de la vie quotidienne relatifs à ces principes. Elles les a notés au tableau pour pouvoir les utiliser à l'étape suivante.
3. Improvisation
Le groupe était divisé en équipes de 3 personnes. En se basant sur les exemples trouvés à partir des principes, les équipes ont écrit des sujets d'improvisation sur des bouts de papier qu'ils ont déposés dans une boîte. Les équipes ont réalisé des improvisations à tour de rôle, selon le thème pigé au hasard par l'animatrice. Chaque équipe avait 30 secondes pour se préparer et 2 minutes pour réaliser son «impro». Selon le temps disponible, la période d'improvisation peut être plus ou moins longue. Les thèmes non utilisés lors du présent atelier ont servi à l'atelier suivant.
Si le temps le permet, il est préférable de revenir sur les situations ou les personnages vus dans l'improvisation. Le groupe dégage alors ce qui pourrait être repris dans la pièce. Les personnes consignent ces informations dans leur cahier de bord.
Commentaires
Lors du choix des thèmes d'improvisation, il a été plus facile pour le groupe de trouver des situations vécues par des personnes assistées sociales, cette réalité étant plus proche de la leur. Bon nombre (environ le tiers) des suggestions d'improvisation n'avaient aucun rapport avec le thème de la discussion. Les consignes relatives aux thèmes de l'improvisation gagnent à être claires de façon à se rapprocher davantage du sujet.
Atelier 4: Écrire une pièce, pourquoi pas
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Favoriser l'apprentissage du français oral
- Donner une vue d'ensemble de ce qu'est une pièce de théâtre (jeu de scène, décors, éclairage, etc)
- Prendre conscience de l'importance des aspects techniques d'une pièce
- S'approprier les énoncés de principes pour être en mesure de les traduire en pièce de théâtre
- Poursuivre l'élaboration du contenu de la pièce
Moyens:
- Visionnement de pièces de théâtre
- Improvisation
Matériel requis:
- Pièces de théâtre sur vidéo-cassette
- Magnétoscope et téléviseur
- Thèmes d'improvisation recueillis lors du dernier atelier
- Montre ou chronomètre
- Cahiers de bord
Déroulement:
1. Visionnement de pièces de théâtre
Les personnes présentes ont visionné des pièces de théâtre déjà jouées à COMSEP. Si le groupe n'a jamais joué de pièce, on peut visionner une ou des pièces jouées par des actrices et des acteurs professionnels.
De temps à autre, l'animatrice arrêtait le vidéo pour insister sur un des aspects techniques: interruptions de lumière, éclairage spécial, follow spot, plateaux différents selon le lieu où se situe la scène, disposition des décors, couleurs, bande sonore, musique, etc.
2. Improvisation- Première étape
Le groupe a fait un retour sur les improvisations réalisées lors de l'atelier précédent. Les personnes ont choisi les improvisations qui pouvaient être intéressantes à reprendre dans la pièce. Le groupe n'avait pas eu le temps de faire cette démarche lors de l'atelier précédent. Si c'est déjà fait, l'animatrice passe directement à l'étape suivante.
- Deuxième étape
Le groupe a repris les trois équipes formées lors de l'atelier précédent. On a repris les improvisations à partir des thèmes déjà trouvés lors du dernier atelier. Chaque équipe avait 30 secondes pour se préparer et 2 minutes pour réaliser son «impro». À la suggestion du groupe, la discussion, plutôt que d'être située à la fin, suivait chacune des improvisations. La discussion visait à faire ressortir les problématiques présentes dans la scène. Elle visait aussi à ajouter les éléments pouvant permettre de pousser plus loin l'analyse, de voir comment la scène pourrait se dérouler de façon à passer un message au public.
Il est très important que l'animatrice situe bien les objectifs de cette discussion. Il ne s'agit pas de critiquer le jeu des actrices et acteurs, mais d'aller plus loin dans le contenu afin de favoriser l'écriture de la pièce. Les personnes qui observent le jeu ont comme mandat de faire une analyse critique positive de ce qu'elles ont vu dans l'improvisation. Il est souvent plus facile d'avoir des idées quand on est à l'extérieur du jeu que dans le feu de l'action.
Quelques suggestions de questions à poser au groupe:
- Quel message a-t-on voulu passer dans cette impro?
- Quels sont les personnages importants à conserver?
- Comment aurions-nous pu aller plus loin pour amener les gens à mieux prendre conscience de la problématique?
- Comment l'impro peut-elle nous mener vers une solution du problème?
Les participantes et participants notent dans leur cahier de bord respectif les éléments de l'improvisation qu'ils désirent conserver.
Commentaires
Au niveau de l'improvisation, le groupe s'est beaucoup amélioré. Dans la majorité des cas, les équipes prenaient le temps d'établir les personnages et écoutaient plus ce que chaque personne avait à dire.
Le retour immédiat sur chacune des improvisations était une excellente idée. Cela a permis d'aller très loin au niveau de l'analyse et du contenu possible des différentes scènes qui seront présentées dans la pièce.
Le fait que les participantes et participants de l'option-théâtre participaient aussi à des ateliers d'alphabétisation-conscientisation a favorisé la discussion sur différents sujets.
Par contre, il ne faut pas oublier que l'option-théâtre est elle-même une démarche de conscientisation. Il se peut, comme il est arrivé pendant le présent atelier, que les sujets discutés soulèvent de vives discussions entre les personnes. Le document de réflexion choisi pour amener le groupe à écrire une pièce de théâtre fait état de sept principes fondamentaux en éducation populaire. Le premier de ces principes portait sur l'égalité hommes-femmes. On se rappelle que le groupe se composait d'une majorité d'hommes (10 hommes et 5 femmes). Quelques-uns des hommes ont profité de la discussion pour remettre en question l'approche féministe prônée par COMSEP. Les femmes quant à elles, ont réagi vivement aux propos de leurs confrères. La discussion a été virulente mais productive en ce sens que le groupe a été capable, par la suite, de traiter de thèmes qui touchent directement les femmes comme le harcèlement sexuel, les milieux de garde, l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, la violence conjugale et l'intégration des femmes dans des métiers non-traditionnels.
[Voir l'image pleine grandeur]

Ateliers 5 et 63: L'écriture facilitée par l'improvisation
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Favoriser l'apprentissage du français par l'écriture et la création littéraire
- Permettre aux participantes et participants de découvrir leur capacité d'écrire une pièce de théâtre
- Écrire une première ébauche de la pièce
Moyens:
- Écriture collective
Matériel requis:
- Tableau, craie
- Cahiers de bord
- Dictionnaire
Déroulement:
1. Synthèse de l'improvisation
Le groupe a relevé les scènes et les personnages qu'il désirait conserver dans la pièce. L'animatrice a écrit les thèmes retenus au tableau. Ce sont:
- Logements sociaux;
- Garderie et communication homme-femme;
- Intégration des personnes handicapées;
- Homosexualité;
- Implication dans un groupe communautaire;
- Harcèlement sexuel;
- Bureau d'aide sociale;
- Racisme.
Les sept principes mentionnés dans le Mémoire, utilisés pour susciter la réflexion, ont amené le groupe à choisir une diversité intéressante de sujets d'improvisation. À cette étape-ci de la démarche, il est apparu évident pour l'animatrice et pour le groupe qu'il serait difficile d'écrire un texte continu sur un seul thème. L'animatrice a suggéré au groupe d'écrire une pièce composée de courtes scènes portant chacune sur un thème. Les participantes et participants ont accepté de procéder de cette façon, d'autant que ceci pouvait faciliter le travail d'écriture.
Pour compléter la pièce, les personnes présentes ont décidé d'y ajouter, au début ou à la fin, un hommage à une dame qui avait joué avec le groupe l'année précédente. Cette dame qui avait tenu à vivre toute la démarche malgré des problèmes de santé, est décédée quelques jours après la représentation de la pièce.
2. Écriture collective
L'animatrice a divisé elle-même le groupe en 3 équipes de 5 personnes de façon à équilibrer les équipes. Dans chacune des équipes, on devait retrouver des personnes qui ont une certaine facilité au niveau de l'écriture, des personnes qui ont bien compris les situations présentées dans les improvisations de façon à pouvoir les ramener à l'équipe pour les inclure dans la pièce et des personnes qui font preuve d'imagination afin de compléter les scénarios amorcés dans les thèmes d'improvisation.
Chaque équipe avait à choisir un des thèmes déjà mentionnés. Les personnes plus habiles en écriture se sont chargées d'écrire les idées de l'équipe dans un des cahiers de bord. Le groupe s'est entendu pour que chacune des scènes comporte un élément de solution à la problématique présentée. Selon les habiletés présentes dans l'équipe, celle-ci pouvait choisir entre deux styles d'écriture: écriture d'un scénario comme pour une pièce de théâtre avec les répliques de chacun des personnages ou élaboration des grandes lignes de l'histoire. Dans le cas des équipes qui ont choisi le deuxième style d'écriture (ce qui a été majoritairement le cas dans ce groupe), l'animatrice a dû réécrire la scène sous forme de scénario. Un exemple du travail d'écriture réalisé par une des équipes figure en annexe 3 de façon à permettre la comparaison avec le scénario final de la pièce.
La séance d'écriture collective s'est étendue sur deux ateliers. Lorsqu'une équipe avait terminé d'écrire sur un thème, elle en choisissait un autre, jusqu'à ce que tous les thèmes soient épuisés. Encore un fois, il est très important que l'animatrice soit à l'écoute du groupe et des individus parce qu'il peut arriver que quelqu'un préfère travailler seul à l'écriture d'un texte, ou encore que les membres d'une équipe éprouvent de la difficulté à travailler ensemble.
Pour cette partie des ateliers, il serait intéressant que l'animatrice puisse compter sur la collaboration de collègues de travail. La présence d'une animatrice par sous-groupe pourrait favoriser l'expression de tous les membres. Tout en faisant bien attention que les idées écrites soient bien celles des participantes et participants de l'équipe (et non les siennes), l'animatrice peut aider l'équipe à clarifier le message qu'elle veut transmettre aux spectatrices et spectateurs lors de la représentation. Ceci permet d'aller un peu plus loin dans la démarche de conscientisation.
Commentaires
Les liens entre les ateliers où les participantes et participants ont fait de l'impro et ceux où ils ont écrit les scénarios se sont très bien tissés. Les gens sont restés fidèles aux thèmes et aux personnages qu'ils avaient considérés importants au moment de l'improvisation. Les membres du groupe avaient beaucoup d'imagination. Cela a été une grande réussite pour eux de réaliser qu'ils pouvaient écrire une pièce de théâtre malgré leurs limites au niveau de l'écriture. Plus les personnes se sentent impliquées dans l'écriture, plus elles sentent que la pièce leur appartient vraiment.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 7: Début des pratiques et l'équipe technique au travail!
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Distribuer les rôles
- Favoriser l'apprentissage du français par la lecture et l'expression orale
- Développer les capacités de mémorisation Intégrer graduellement les différents jeux de scène
- Élaborer les tâches au niveau technique
- Intégrer la musique dans la pièce
Moyens:
- Formation de l'équipe technique
- Distribution des rôles
- Réajustements de textes
- Répétition des textes
- Travail en sous-groupes
Matériel requis:
- Texte de la pièce reformulé par l'animatrice
- Texte des 2 chansons
- Meubles de la salle où se tient l'atelier, comme éléments de décors
- Cahiers de bord
Déroulement:
1. Formation de l'équipe technique
L'animatrice a vérifié quelles étaient les personnes qui ne voulaient pas jouer dans la pièce mais qui désiraient faire partie de l'équipe technique.
Elle a demandé à ces personnes si elles accepteraient de jouer comme figurants dans la première scène, ce qu'elles ont accepté.
2. Distribution des rôles- Attitudes de l'animatrice
La distribution des rôles doit se faire avec beaucoup de respect pour les participantes et les participants. L'animatrice doit, par son attitude et par sa façon de distribuer les rôles, faire comprendre au groupe que tous les rôles (même petits) sont importants et que toutes les actrices et acteurs ont leur place dans la pièce. Avant l'atelier, lorsqu'elle pense à la distribution des rôles, elle doit tenir compte de certains facteurs.
D'abord elle devra penser à la capacité des personnes à mémoriser un texte plus ou moins long. Il faut éviter de placer la personne en situation d'échec, car elle ne voudra plus participer à l'option-théâtre.
Ensuite, elle doit tenir compte des interactions à l'intérieur du groupe. La façon de distribuer les rôles doit éviter de donner prise à des conflits ou d'inciter le groupe à utiliser un personnage pour rire de quelqu'un, le mépriser ou lui faire sentir qu'il n'est pas apprécié dans le groupe. Elle doit aussi tenir compte du vécu personnel de chacun. Par exemple, il peut être difficile pour une femme qui éprouve des problèmes conjugaux de jouer le rôle d'une femme victime de violence.
Dans la distribution des rôles, l'animatrice doit faire en sorte que l'expérience soit une réussite. Elle doit s'efforcer de distribuer les rôles en fonction des capacités d'apprentissage et d'interprétation de chacun. Une personne qui subira un échec important sur scène sera peu intéressée à revenir à l'option-théâtre et risque d'éprouver des problèmes d'estime de soi, ce qui est plus grave. Un échec peut aussi limiter ses futurs apprentissages en alphabétisation. Cette personne peut même décider de ne plus revenir ni en théâtre, ni en alphabétisation.
- Distribution des rôles
Comme il s'agissait d'une création collective divisée en plusieurs parties, l'animatrice a décidé de procéder graduellement à la distribution des rôles. Concrètement, durant cet atelier, le groupe s'est attaqué particulièrement à la première scène. Il s'agit d'une scène un peu compliquée, car tout le monde y joue. Elle comporte aussi plusieurs déplacements.
3. Répétition de la première scène
Les participantes et participants se sont assis en cercle. L'animatrice a procédé à la distribution des rôles pour la scène. Les participantes et participants ont effectué une première lecture du texte à haute voix, mais sans intonation. Lorsqu'une personne avait de la difficulté à lire, l'animatrice lisait la phrase une première fois et la personne la répétait. Le rythme d'élocution a de l'importance à cette étape-ci de la démarche. L'objectif est de prendre contact avec le texte et de le mémoriser. Par la répétition de la phrase, l'effort de la personne est placé davantage sur la mémorisation que sur la lecture. C'est aussi un encouragement pour la personne. Le groupe a repris la lecture du texte à quelques reprises.
Lorsque les participantes et participants commençaient à posséder un peu mieux le texte, le groupe a repris la scène avec les déplacements. On a délimité d'abord le territoire et placé des décors sommaires. Dans la première scène, il y a une porte d'entrée, une salle d'attente et un comptoir où sont installées trois préposées à l'accueil des personnes bénéficiaires de l'aide sociale dans un Centre Travail Québec.
Le groupe a repris plusieurs fois la scène, car elle comporte de nombreux déplacements, et l'ordre d'entrée des personnages a beaucoup d'importance, il a fallu que l'animatrice réajuste un peu le texte en fonction de ces entrées. Elle a ensuite terminé la répétition de la première scène en soulevant les points positifs.
*****
Outil de mémorisation pour les personnes éprouvant plus de difficultés:
Dans ce groupe, il n'y avait pas de personne analphabète complète, seulement quelques-unes qui avaient de la difficulté à lire. Lorsque l'animatrice constate qu'une personne a de grandes difficultés à lire ou encore à mémoriser son texte, elle se sert d'un cassette audio sur laquelle elle enregistre les extraits de la pièce qui concernent cette personne. Cette méthode est appelée «littérature de l'oreille».
Dans la première partie de la cassette, les extraits sont joués avec des voix différentes pour chacun des personnages. L'animatrice peut demander l'aide de ses collègues de travail pour que la participante ou le participant puisse mémoriser ses répliques ainsi que le moment où il doit les donner.
Dans la seconde partie, les extraits sont repris en laissant des moments de silence pour que la personne puisse donner sa réplique.
Cette méthode permet d'intensifier et de poursuivre le travail de mémorisation à l'extérieur des ateliers.
*****
4. Travail en sous-groupes
L'animatrice a demandé aux gens de former deux sous-groupes: les principaux comédiens et comédiennes de la première scène et les autres membres du groupe.
Le premier sous-groupe a continué la répétition. L'animatrice a pris quelques minutes pour camper les personnages et orienter les intonations. Ce sous-groupe a continué seul son travail.
Elle a discuté ensuite avec le deuxième sous-groupe certains aspects techniques de la pièce:
- le texte d'une des scènes: l'animatrice a soumis au sous-groupe le texte d'une des scènes qui avait besoin d'être modifié pour faciliter la réalisation des décors et les déplacements. Les personnes ont fait quelques suggestions qui ont été reprises par l'animatrice dans la reformulation du texte;
- les décors: le sous-groupe a repris chacune des scènes en pensant aux décors. Comme les scènes se déroulent dans des lieux différents, on a prévu quatre plages de jeux (voir annexe 4). Les décors se composaient de trois principaux plateaux: un bureau, un bar-restaurant et une cuisine. La quatrième plage de jeu se situait à lavant-scène;
[Voir l'image pleine grandeur]

- le déroulement: une fois les décors installés «sur papier», le sous-groupe a proposé le déroulement de la pièce tel qu'il se retrouve dans le texte en annexe 10;
- les accessoires: les membres de ce sous-groupe ont repris encore une fois chacune des scènes de façon à dresser une liste de tous les accessoires (pas les costumes) nécessaires. Une telle liste doit comprendre les accessoires qui composent les décors dans leurs moindres détails ainsi que les accessoires nécessaires pour le jeu des comédiennes et comédiens (une liste des accessoires nécessaires pour une des scènes figure en annexe 5);
- la musique: un musicien qui collabore à l'option-théâtre depuis plusieurs années était présent lors de cet atelier. Il a discuté de la musique et des chansons qui venaient agrémenter la pièce. Les personnes ont souhaité que, comme pour les années passées, il y ait de la musique entre chacune des scènes. Cela favorise le passage psychologique d'une scène à l'autre et cela facilite aussi les changements de costumes et de décors. De cette façon, la pièce ne présente pas de temps mort.
À cette rencontre, les membres du sous-groupe ont aussi informé le musicien qu'ils souhaitaient introduire quatre chansons dans la pièce. Deux d'entre elles étaient déjà planifiées: la chanson en hommage à Annette dont les participantes et les participants avaient déjà ébauché une bonne partie du texte, et la chanson de cowboy dans la scène du restaurant chic. Finalement, seules ces deux chansons ont été conservées par le groupe, car le temps ne permettait pas de créer et de mémoriser les deux autres (voir annexe 6).
Commentaires
Cet atelier a été un de grande excitation, car les participantes et participants commençaient à toucher aux résultats de leur travail. La pièce prenait chair, se concrétisait. Il y avait beaucoup d'entraide dans le groupe. Les personnes les plus expérimentées sécurisaient les autres, les aidaient à mémoriser leur texte et à trouver la bonne intonation. Les personnes les plus gênées se sont bien intégrées au groupe.
NOTE IMPORTANTE: Si l'animatrice désire jouer dans la pièce, elle doit se réserver un ou des rôles mineurs, car elle a un gros travail de supervision et de soutien à faire le jour de la représentation.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 8: Pas besoin d'être une vedette pour jouer la comédie
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Distribuer les rôles
- Favoriser l'apprentissage du français par la lecture et l'expression orale
- Développer les capacités de mémorisation Intégrer graduellement les différents jeux de scène
Moyens:
- Suite de la distribution des rôles
- Répétition des textes
- Retour sur le déroulement de l'atelier
Matériel requis:
- Texte de la pièce
- Meubles et accessoires disponibles dans la salle
Déroulement:
1. Suite de la distribution des rôles
L'animatrice a repassé l'ensemble des scènes et a procédé à la distribution des rôles sauf pour la première scène, car c'était déjà fait. Elle a informé le groupe que des personnes de l'extérieur viendraient se joindre à eux pour jouer la pièce. Celles-ci étaient connues des participantes et participants, car elles participaient aux pièces de l'option-théâtre depuis plusieurs années. Ces nouvelles personnes allaient participer à quelques répétitions prévues à l'extérieur des ateliers de façon à ce que tout le monde puisse pratiquer ensemble.
2. Répétition des textes
Durant cet atelier, les répétitions se sont déroulées en 3 phases:
- La première scène
L'animatrice a repris la répétition de la première scène avec les déplacements. Il a fallu encore une fois préciser l'ordre d'entrée en scène, car il correspond à l'ordre dans lequel les personnes sont appelées au comptoir des préposées. L'animatrice a introduit la question des costumes, qui allait être reprise de façon plus élaborée à l'atelier suivant. Elle a souligné que les personnes qui entrent et sortent de la salle d'attente à tour de rôle devaient prévoir 3 costumes différents, car elles jouent effectivement des personnages différents.
L'animatrice a dû remonter le moral des troupes, car les gens pensaient que s'ils passaient autant de temps sur chacune des scènes, ils ne seraient jamais prêts pour jouer la pièce à la date prévue. L'animatrice les a rassurés en disant que cette scène est la plus difficile de toute la pièce. Une fois celle-ci intégrée, les autres seraient plus faciles.
- Les autres scènes
Pour la suite de l'atelier, les gens ont répété par petits groupes de 2 ou 3 personnes selon qu'ils jouaient ensemble dans l'une ou l'autre scène. Les petits groupes ont pu se modifier en cours de route pour permettre à d'autres personnes de se donner la réplique si, bien sûr, elles avaient à jouer avec d'autres pendant la pièce. Dans un tel atelier, il est intéressant pour l'animatrice d'être aidée par des collègues qui partagent le travail avec les petits groupes en donnant la réplique, en précisant les intonations et en favorisant la mémorisation des personnes ayant plus de difficulté à lire, comme il a été expliqué dans la description de l'atelier précédent. Dans le cas présent, l'animatrice était soutenue par une stagiaire de passage à COMSEP et la personne responsable de la rédaction de ce document.
- La pièce en continue
L'animatrice a demandé au groupe de reprendre la pièce du début à la fin. S'il manque des personnes (en l'occurrence les personnes de l'extérieur qui ne seraient pas disponibles lors des ateliers), l'animatrice peut prendre la place des personnes absentes ou demander aux personnes qui sont venues l'aider de participer à la répétition en jouant l'un ou l'autre rôle. À plusieurs reprises, l'animatrice a demandé de reprendre une partie du texte pour ajuster l'intonation, suggérer des déplacements ou des gestes à ajouter à l'expression orale.
3. Retour sur le déroulement de l'atelier
L'animatrice a terminé l'atelier en félicitant tout le monde pour le travail accompli. Elle a souligné les points positifs de l'atelier et les éléments à travailler la prochaine fois. Elle a aussi offert ses services pour répéter avec les personnes qui aimeraient le faire individuellement, en dehors des ateliers.
Commentaires
Comme il a déjà été dit, les participantes et participants s'inquiétaient de l'ampleur du texte. Les résultats lors de la représentation témoigne pourtant de leur capacité à passer au travers. En cours de route, ils ont besoin de beaucoup d'encouragement.
De plus, il faut être prudent en ce qui concerne la participation de personnes de l'extérieur. Dans le cas présent, cette participation a causé peu de problèmes, si ce n'est que les personnes n'étaient pas disponibles à l'heure des ateliers. Des répétitions en dehors des ateliers ont pallié cette difficulté. Les personnes qui se sont ajoutées à l'équipe de comédiennes et comédiens étaient déjà connues de la majorité d'entre eux. Plusieurs avaient déjà fait du théâtre ensemble.
Il est très intéressant de choisir des personnes qui ont déjà de l'expérience en théâtre, car elles peuvent aider durant la pièce. S'il y a un blanc de mémoire ou un problème technique, des personnes plus expérimentées en théâtre auront plus de facilité à garder le cours du texte. Mais il faut aussi voir à ce que ces personnes soient respectueuses des personnes qui éprouvent des difficultés, et qu'il doit être qu'elles viennent pour aider le groupe et non se mettre en évidence elles-mêmes.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 9: Le trac de la pratique
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Favoriser l'apprentissage du français par la lecture et l'expression orale
- Améliorer le jeu de scène des comédiennes et comédiens
- Stimuler la confiance des participantes et des participants dans leur capacité de jouer la pièce et de bien la jouer
Moyens:
- Répétition de la pièce en petits groupes et en grands groupes
- Calendrier des pratiques
Matériel requis:
- Texte de la pièce
- Meubles et accessoires disponibles dans la salle
Déroulement:
1. Répétition en petits groupes
Tel que décrit à l'atelier 8, les participantes et participants ont répété les différentes scènes en petits groupes avec l'aide de l'animatrice et de deux personnes de l'extérieur.
2. Répétition en grand groupe
L'animatrice a demandé au groupe de reprendre la pièce depuis le début. Elle a précisé encore une fois les intonations et les déplacements. Elle a largement tenu compte des suggestions faites par les membres du groupe. Elle a repris les scènes jusqu'à ce que les actrices et acteurs de cette scène se sentent à l'aise de la jouer.
La scène du «Bar gai» a fait l'objet d'une attention particulière au cours de cet atelier. La scène se déroule à 2 endroits en même temps, ce qui rend le jeu un peu plus compliqué. De plus, les personnages étant un peu plus caricaturés que dans les autres scènes, l'animatrice a dû aider davantage les comédiens à s'approprier leurs rôles et les expressions qui conviennent.
3. Calendrier des pratiques
Comme la date de fa représentation approchait à grand pas, quelques répétitions supplémentaires ont été nécessaires. L'animatrice a discuté avec le groupe des disponibilités de chacun et fixe 5 rencontres supplémentaires. Les personnes de l'extérieur de l'option-théâtre qui devaient jouer aussi dans la pièce ont été présentes à 2 occasions pour pratiquer avec le groupe. Une sixième répétition a été prévue le jour même de la représentation et devait servir de répétition générale.
Commentaires
Au fur et à mesure que la pièce approchait, le groupe devenait plus nerveux, particulièrement les personnes qui avaient déjà joué et qui se sentaient moins prêtes que les autres années. L'animatrice les a rassurées en disant qu'elle se souvenait avoir entendu les mêmes commentaires l'an précédente. Pourtant la pièce a été très bien réussie.
L'intérêt des participantes et des participants en option-théâtre est très très grand. Il serait difficile, presqu'impossible de demander aux personnes impliquées à l'intérieur d'autres options ou d'autres activités d'alphabétisation de COMSEP de donner autant de temps. Les heures supplémentaires allouées aux répétitions individuelles ou en groupe ne sont jamais perçues comme une surcharge.
Les animatrices en alphabétisation ont constaté que plusieurs membres du groupe apportent leurs textes pour répéter durant les pauses des ateliers. Souvent, ils vont laisser tomber d'autres engagements pour ne pas manquer une répétition.
Atelier 10: Les derniers préparatifs avant la première
(3 heures)
Objectifs spécifiques:
- Faire le point sur les derniers aspects techniques
- Favoriser l'apprentissage du français par l'expression orale
- Impliquer les participantes et participants dans la promotion de la pièce
- Terminer le travail de mise en scène
Moyens:
- Présentation du dépliant publicitaire
- Distribution des laissez-passer
- Vérification des accessoires
- Liste des costumes
- Répétition de la pièce
Matériel requis:
- Texte de la pièce
- Meubles et accessoires disponibles
- Dépliant publicitaire
- Laissez-passer
- Cahiers de bord
Déroulement:
1. Présentation du dépliant publicitaire
L'animatrice a proposé au groupe une ébauche du dépliant qui sera donné lors de la représentation de la pièce. Quelques corrections ont été apportées dans le déroulement de la pièce. Les participantes et participants ont vérifié que tous les noms des membres du groupe étaient bien indiqués.
L'animatrice a demandé l'approbation du groupe concernant l'absence de titre. Le dépliant fait mention d'une création collective. Les gens ont trouvé l'idée excellente étant donné que le contenu comprenait des thèmes différents à chacune des scènes (voir annexe 7).
2. Distribution des laissez-passer
Les membres du groupe ont évalué le nombre de personnes qu'ils désiraient inviter à la présentation de la création collective. L'animatrice a distribué le nombre de laissez-passer correspondant. Elle a souligné que le nombre de places étant limité, il était important que les participantes et participants rapportent les laissez-passer non utilisés.
3. Vérification des accessoires
L'animatrice a repris la liste d'accessoires déjà constituée. Elle a indiqué ceux qui étaient déjà disponibles à COMSEP. Elle a demandé aux personnes présentes d'apporter les objets manquant. Elle a pris en note le nom des volontaires afin de leur rafraîchir la mémoire en cas de besoin.
4. Liste des costumes
Les participantes et participants étaient responsables de trouver et d'apporter leurs costumes pour chacune des scènes qu'ils avaient à jouer. Comme il y a un comptoir vestimentaire à COMSEP, les gens pouvaient y trouver les articles qu'ils ne possédaient pas déjà à la maison. Si l'organisme n'a pas lui-même de comptoir vestimentaire, les comédiennes et comédiens peuvent s'adresser à un comptoir situé dans leur municipalité. La visite au comptoir peut se faire en groupe et constituer, avec l'élaboration de la liste des costumes, un atelier en soi.
Pour dresser la liste des costumes, l'animatrice a repris les scènes une à une. Les membres du groupe ont fait des suggestions sur le genre de costumes qu'ils pourraient eux-mêmes porter ou sur ceux qui pourraient être portés par les autres. Ils se sont entendus sur la saison au cours de laquelle se déroule chaque scène pour que tout le monde soit dans le même ton. Par exemple, la première scène du bureau d'aide sociale se déroule au printemps. Ceci permet aux comédiennes et comédiens qui ont à revenir plusieurs fois sur la scène (pour donner l'effet du grand nombre de personnes qui circulent dans la salle d'attente) d'ajouter un manteau, un chapeau, un foulard ou encore de retirer un vêtement pour donner l'impression qu'il s'agit de personnes différentes.
Commentaires
Cet atelier s'est déroulé dans l'euphorie. La crainte de manquer son coup et le plaisir procuré par l'approche du grand jour se mêlaient. Le choix des costumes manquants au comptoir vestimentaire a été un moment agréable de collaboration entre les personnes. On se faisait des suggestions, on recherchait l'approbation des autres ou de l'animatrice. Encore une fois, l'attitude de celle-ci est très importante. Elle doit faire sentir à chacun qu'elle est disponible et qu'elle prend tous les rôles au sérieux.
D'autre part, il est préférable que la pièce porte un titre, car il est plus facile pour les participantes et participants de s'y référer, d'en parler avec d'autres ou entre eux. Le terme «création collective» ne fait pas nécessairement partie de leur vocabulaire courant.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 11: On joue!
Objectifs spécifiques:
- Conscientiser la population en général à des problématiques sociales
- Permettre aux personnes participant à l'option-théâtre de présenter le fruit de leurs efforts
Moyens:
- Organisation technique
- Répétition générale
- Présentation de la création collective
Matériel requis:
- Décors, accessoires
- Exemplaires du texte pour chaque personne
- Participant au bon déroulement de la pièce
- Feuilles de coulisses
- Appareil photo et photographe
- Caméra vidéo (si possible)
Déroulement:
1. L'avant-midi: les aspects techniques
Seule la présence des participantes et participants de l'équipe technique était nécessaire à ce moment-là. L'équipe technique et l'animatrice ont revu et préparé un certain nombre de choses en prévision de la répétition générale en après-midi:
- les décors et les accessoires: les membres de l'équipe technique ont installé les décors et les accessoires de scène de façon à ce qu'il y ait le moins de changements possible pendant la pièce. Ils ont vérifié, à partir de feuilles installées dans les coulisses, que rien ne manquait. Une ou deux personnes se sont chargées de trouver les quelques objets manquant pendant l'heure du dîner. L'équipe a revu chacune des scènes et prévu comment les petits changements de décors seraient effectués pendant la représentation.
- les éclairages: le Centre culturel de Trois-Rivières fournit ses propres techniciens lorsqu'il il y a location de la salle de spectacle. Dans le cas où il ne serait pas possible d'utiliser les techniciens rattachés au lieu de représentation, il est très important de trouver des éclairagistes d'expérience, non seulement pour la réussite du spectacle, mais aussi pour que les comédiennes et comédiens ne soient pas déconcentrés par des jeux de lumière manques.
L'animatrice avait préalablement préparé un texte de la pièce annoté à l'intention du technicien afin de lui indiquer les éclairages nécessaires. L'équipe technique et l'animatrice ont revu avec le technicien à l'éclairage chacune des scènes. Un ou des membres de l'équipe technique se tenaient sur la scène et indiquaient les éclairages et les sons au moment exact où ils étaient requis et ce, pour chacun des tableaux. - les consignes de coulisses: l'animatrice a préparé une série de feuilles explicatives de ce qui doit se passer dans les coulisses pendant la représentation. Ces feuilles sont très précieuses, car elles facilitent le bon déroulement de la pièce. Elles permettent aux membres du personnel de COMSEP qui donnent un coup de main dans les coulisses de savoir exactement quoi faire, même s'ils n'ont pas participé aux répétitions. On trouve sur ces feuilles trois types de consignes (voir annexe 8): accessoires et décors, entrée des comédiennes et comédiens et changements de costumes dans la salle d'habillage des femmes et dans celle des hommes. Chaque type de consignes est repris neuf fois de façon à voir rapidement chacune des neuf scènes différentes. Il n'y avait pas de feuille pour la dixième scène, car il s'agissait d'une chanson à laquelle participe tout le groupe. Elle se déroulait simplement à l'avant-scène, et les comédiennes et comédiens y portaient leur dernier costume.
2. L'après-midi: la générale
Tout le monde - équipe technique, comédiennes et comédiens - étaient présents. Cinq membres du personnel ou du conseil d'administration de COMSEP se sont ajoutés à titre d'aide dans les coulisses, en plus des cinq personnes qui avaient déjà une expérience théâtrale et qui venaient compléter la distribution pour sécuriser et soutenir les participantes et participants de l'option-théâtre.
Des cinq personnes de COMSEP qui complétaient l'équipe technique, l'une était habilleuse, deux étaient souffleuses, et les deux autres se tenaient dans les coulisses à chacune des entrées de la scène de façon à aider aux entrées des comédiennes et comédiens et aux changements rapides de costumes et de décors.
Les comédiennes et comédiens ont joué la pièce en entier. L'animatrice a fait des commentaires entre chacune des scènes. Elle a souligné les bons coups, suggéré quelques améliorations ou petits ajustements et vu avec l'équipe technique à ce que les changements de décors se passent bien. La solidarité et la complicité du groupe sont très utiles le jour de la représentation; c'est ce qui permet de réussir malgré les quelques petits accrochages qui peuvent survenir.
Si le temps le permet, il peut être intéressant de jouer la pièce deux fois: une première en faisant des arrêts systématiques chaque fois qu'il y a une correction à apporter, la seconde pour jouer la pièce tout d'un trait et juger de l'effet global.
Depuis plusieurs années, les participantes et participants à l'option-théâtre mangent ensemble avant la représentation. Cette coutume permet de garder l'ambiance et la cohésion au sein du groupe.
3. Le soir: la présentation de la création collective
L'équipe technique doit prévoir deux personnes à l'accueil pour recueillir les laissez-passer et distribuer les programmes. Si elle est assez nombreuse, l'équipe technique peut choisir ces personnes en son sein. Sinon, l'animatrice fait appel à des membres de l'organisme.
La présentation de la pièce commence dans la fébrilité. Les personnes aidantes dans les coulisses prennent toute leur importance, car elles devront parer à toutes éventualités. Les souffleuses doivent être excellentes pour sécuriser et souffler la réplique rapidement, si nécessaire. Elles doivent absolument être présentes aux dernières répétitions parce que les comédiennes et comédiens ne reçoivent pas les répliques de la même façon. Par exemple, certaines personnes ont besoin que la souffleuse fasse du mot à mot, alors que d'autres se contentent d'un mot-clé reflétant le sens du texte.
Commentaires
Si les ressources financières de l'organisme le permettent, il est préférable que la générale ne se fasse pas dans la même journée. De cette façon, le groupe a le temps de réagir si quelque chose cloche. Cela permet aussi aux actrices et aux acteurs qui ont eu de la difficulté à la générale de pratiquer encore un peu. Ce délai entre la générale et la représentation n'est cependant pas obligatoire. Si la générale est manquée, ce n'est pas dramatique non plus. Il ne faut pas annuler ou reporter la pièce pour autant. La générale est justement là pour permettre de faire les derniers ajustements. «Générale pourrie, spectacle réussi.»
Ne pas oublier que la souffleuse est une aide technique très importante. Si c'est possible, cette personne devrait participer aux deux ou trois dernières répétitions. Les actrices et acteurs peuvent ainsi s'habituer à sa voix et apprendre à la regarder discrètement, s'ils ont besoin d'elle durant la représentation.
La simplicité des décors est aussi très importante. Autant que possible, tous les décors doivent être sur la scène afin d'éviter les grands changements entre les scènes.
Les rires et applaudissements font partie de la pièce. Il est important que pendant les répétitions ou les ateliers comme tels, l'animatrice touche un mot à ce sujet. Les comédiennes et comédiens doivent savoir qu'il faut attendre un peu avant de donner la réplique lorsque le public rit ou applaudit.
Même si cela n'a pas été nécessaire cette fois-ci, il serait bon de prévoir une ou deux personnes connaissant le texte de façon à prendre la relève au pied levé, si jamais une comédienne ou un comédien était absent pour une raison ou pour une autre: maladie, trac, problèmes personnels, etc.
La présentation de la création collective a été extraordinaire. Il y a eu très peu de difficultés en cours de route. C'est une expérience extrêmement enrichissante que de vivre un tel moment avec des gens qui, ayant surmonté des problèmes de lecture et d'écriture deviennent auteurs et acteurs. Quelle joie de partager leur courage et leur fierté et surtout de voir grandir leur confiance personnelle grâce à la réussite d'une telle expérience! Les personnes ayant participé à la pièce sont très fières du résultat. Immédiatement après la pièce, ils étaient entourés de leur famille et de leurs amis. Ce n'est qu'en vivant le feeling d'une pièce de théâtre qu'on peut sentir toute la magie qui nous enveloppe une fois le défi relevé.
Avant la représentation de la pièce, il est très important de bien préciser que tout le monde doit rester jusqu'à la fin pour ramasser les décors. Plus les personnes sont nombreuses, plus le ramassage se fait rapidement. Il est aussi préférable de ne pas attendre au lendemain pour aller chercher les décors, parce que l'animatrice risque de se retrouver avec seulement quelques personnes.
[Voir l'image pleine grandeur]

Atelier 12: C'est l'heure de l'évaluation
Objectifs spécifiques:
- Évaluer l'ensemble des ateliers
- Permettre aux participantes et participants et à l'animatrice de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu durant la représentation
- Accentuer la prise de conscience amorcée chez les participantes et participants de leur potentiel et de leur capacité à écrire des textes et à jouer une pièce de théâtre
Moyens:
- Visionnement de la cassette vidéo de la pièce
- Évaluation orale de la démarche et expression du vécu de comédiennes et comédiens
Matériel requis:
- Magnétoscope et téléviseur
- Photographies des participantes et des participants
Déroulement:
1. Visionnement de la cassette vidéo
Rires, commentaires et complicité allaient de pair durant cet exercice. Les remarques plus critiques visaient à aider les gens à s'améliorer au cas où ils auraient l'intention de jouer dans une autre pièce, ce qui était le cas pour la majorité des personnes présentes lors de cet atelier. Le visionnement de la cassette vidéo est un outil fort intéressant pour permettre à l'animatrice de féliciter chaque personne, de souligner les points forts de chacun et de soulever les aspects techniques qui devront être améliorés une prochaine fois.
2. Évaluation orale de la démarche et expression du vécu
Les personnes présentes ont apporté leurs commentaires sur les points suivants:
- leur vécu personnel de comédiens et de comédiennes;
- les apprentissages réalisés et les capacités développées au cours de la démarche;
- les différents aspects de la vie de groupe durant les ateliers et au cours de la représentation de la pièce;
- le contenu de la pièce elle-même en termes de qualité d'écriture et de capacité de transmettre un message au public;
- les aspects techniques de la représentation;
- autres commentaires généraux.
Commentaires
Les commentaires soulevés ici sont ceux des personnes présentes au moment de l'évaluation de la démarche et des ateliers.
- Au niveau de la pièce:
Les gens ont été très contents du résultat final. Ils ont discuté avec les spectatrices et spectateurs de leur entourage. Ils ont pu constater que le message a bien passé. Ils ont reçu des compliments sur la qualité d'écriture de la pièce. Les personnes présentes à la représentation ont beaucoup apprécié l'ajout de chansons, particulièrement l'hommage à Annette, bien connue dans l'entourage de COMSEP.
- Au niveau personnel:
Les participantes et participants ont été très contents de leur performance personnelle. Ils ont eu beaucoup de plaisir à jouer cette pièce. Ils ont souligné leur surprise et leur fierté d'avoir écrit et joué une pièce de théâtre d'une telle qualité.
Les nouvelles personnes ont dit s'être très bien senties à l'intérieur du groupe. L'intégration a été facile. Elles n'ont pas vécu de différence entre les anciens et les nouveaux. L'option-théâtre leur a permis des apprentissages différents des ateliers d'alphabétisation. Elles savent maintenant comment se passe une pièce de théâtre dans toutes ses étapes.
- Au niveau du groupe:
Comme il a déjà été dit, l'intégration des nouvelles personnes s'est faite sans difficultés. Il y a eu une bonne implication de tout le monde dès le départ. Sur scène, les comédiens et comédiennes ont rapidement senti la cohésion du groupe. Il y a eu beaucoup d'entraide durant la pièce et durant les répétitions.
- Au niveau technique:
La participation du public a été excellente: plus de 200 personnes étaient présentes dans la salle. Les personnes chargées d'apporter des accessoires ont bien rempli leurs responsabilités.
Le principal problème soulevé par le groupe concerne le nombre de répétitions. Les gens ont senti ce manque lors de la générale et même durant la pièce. Le fait de ne pas se sentir en possession du texte a créé de l'insécurité qui aurait pu être diminuée par un plus grand nombre de répétitions avec le groupe et avec les personnes de l'extérieur qui se sont ajoutées à la distribution. L'enregistrement des chansons sur cassette en aurait facilité la mémorisation.
L'équipe technique n'était pas suffisamment nombreuse. Il aurait fallu plus de personnes et plus de temps afin de réduire les responsabilités de l'animatrice au cours des derniers jours avant la représentation. Ce sont principalement ces deux dernières raisons qui amènent l'animatrice à suggérer que les ateliers se déroulent sur quinze semaines plutôt que sur douze.
[Voir l'image pleine grandeur]

Les témoignages
Entrevues avec les participantes et les participants
Afin de recueillir les témoignages des personnes qui participent à l'option-théâtre, des entrevues avec chacune d'elles ont été réalisées. Celles qui en étaient à leur première expérience ont été interrogées après la représentation de la pièce tandis que celles qui avaient déjà joué l'ont été au cours de l'un ou l'autre des ateliers. Un canevas de questionnaire se trouve en annexe 9.
Chacune des entrevues a d'abord été retranscrite le plus fidèlement possible. De cette retranscription, l'auteure du présent document a choisi des passages de chacun de ces témoignages. Le choix a été fait en fonction de présenter des éléments différents de la démarche ou de faire ressortir ce qui apparaissait comme étant le plus important pour chacune des personnes interrogées.
Afin de faciliter la lecture, les témoignages ont été réécrits dans un bon français qui diffère un peu du français parlé. Par contre, une attention particulière a été portée afin de rester fidèle aux propos tenus par les participantes et les participants eux-mêmes.
Chers comédiens et comédiennes, la parole est à vous!
«Dans l'option-théâtre, j'aime tout ce qu'on partage ensemble parce que des fois c'est drôle, des fois c'est triste. On est comme une grande famille. On vit les mêmes émotions, on partage les émotions de l'autre. Ça m'a valorisée, ça m'a dégênée. Je suis plus capable de foncer dans la vie, d'avancer. Avant, j'aurais eu peur de m'impliquer. Maintenant, je suis aux cuisines collectives, représentante de groupe et vice-présidente du conseil d'administration de COMSEP.»
Lise
«Je suis allée à l'option-théâtre parce que j'étais gênée et que j'avais besoin de me défouler. Dans le théâtre, c'est le meilleur moyen. Dans ma famille, il y a des problèmes d'Alzheimer. Tu te dis que peut-être tu vas être comme eux autres. Tu veux te rappeler tout le temps. Je pense que c'est pour ça que je cherche à continuer le théâtre. C'est pour cultiver ma mémoire.»
Andrée
«La première fois que je suis venu, j'ai joué un rôle tout de suite et j'ai aimé ça. Avant, je ne savais pas lire, ni écrire. Je m'achetais le journal mais je ne savais pas lire. Depuis que je viens ici, j'ai appris à lire pas mal, puis je dialogue plus. J'aide aussi Marie-Josée à organiser des affaires, comme la cabane à sucre.»
Denis
«En venant ici, je voulais vivre l'expérience de jouer dans une pièce de théâtre. En plus de jouer la pièce, ce que j'aime le plus c'est de pratiquer parce qu'on est tout le groupe ensemble puis on a du plaisir. Ce qui est bon, c'est que personne va rire d'un autre. Si on se trompe, on fait des blagues mais pas plus.»
Maurice
«Quand je suis sur scène, c'est magique! Avant, j'ai le trac. J'ai des papillons dans l'estomac. Je reste pas en place, mais sur la scène, c'est magique! Venir à l'option-théâtre, ça me valorise. Ça te donne que tu es plus sûre de toi. Ça te montre que toi aussi tu es capable de faire quelque chose dans la vie. Maintenant, je m'affirme mieux.»
Hélène
«Sur le coup, c'est sûr que la première pièce que tu joues, tu crains. Tu as peur de faire des gaffes, tu as peur de tout. Un coup que tu as fait une pièce, tu es prêt à te rembarquer tout de suite. Avant ça, je ne savais pas lire et écrire. Là, je peux me débrouiller. Avant, tu me disais de quoi, puis ça ne rentrait pas tout de suite. Aujourd'hui, ça va rentrer bien plus parce que j'écoute qu'est-ce qu'on me dit»
Roger
«Monter sur la scène, ça me faisait peur. En partant, je me suis dit: " je vais juste monter le décor en arrière. " Je ne voulais pas jouer en avant. J'ai pas eu le choix. Marie-Josée m'a donné une couple de rôles. Je suis fier de moi. J'aurais pas pensé être capable. J'ai été capable de bien des affaires. J'ai beaucoup aimé écrire la pièce, comment ça c'est passé. On avait tous un petit peu d'idées. Là un autre donnait une idée. Moi je l'écrivais.»
Michel
«J'ai embarqué parce que je voulais essayer ça, le théâtre. Ça n'a pas été difficile. Ça a cliqué tout de suite avec la gang. On s'est tenu toute la gang ensemble, tout le long. Ce que j'ai aimé le plus, ce sont les rôles que j'ai joués. La pièce du bar gai, c'était frustrant' J'aimais pas les gais. Mais plus j'embarquais dans mon rôle, plus je changeais d'idée. Pour la première année, j'ai bien aimé ça.»
Michel
«Ça été la plus belle journée de ma vie! J'ai "trippé" en masse! Au début, c'était affreux! J'ai pogné la chienne, mais pas longtemps. Après, j'ai embarqué plus dans mon rôle. Depuis que je fais du théâtre, je suis plus embarqué dans un autre mouvement. Je m'implique plus à l'accueil et ailleurs. Je suis pas mal moins gêné qu'avant. J'ai même joué dans une pièce de théâtre à un congrès.»
Gaétan
«J'ai bien aimé ça. J'aurais aimé réembarquer si j'avais pu.»
Jeanette
[Voir l'image pleine grandeur]

Annexes
Annexe 1 – Préparation des ateliers
[Voir l'image pleine grandeur]

[Voir l'image pleine grandeur]

Annexe 2 – Exercices techniques
À tour de rôle, chacun improvise un court message publicitaire devant une caméra imaginaire4.
- Le groupe est dispersé dans l'espace. Chacun est une graine qui pousse et devient une fleur. Tous poussent ensemble.
- Répartis en deux cercles concentriques, marcher sur un rythme donné. L'animateur (trice) désigne une personne qui doit, à son signal, changer de cercle et s'intégrer à l'autre sans perturber la marche.
- Le groupe est assis en cercle. L'un donne à son visage une expression particulière que son voisin de droite reprend, puis ce voisin donne à son tour à son visage une expression particulière que son voisin de droite reprend ainsi de suite jusqu'à ce que le cercle soit complété.
- Chacun choisit au sort le nom de l'autre. Après une courte entrevue avec ce dernier, il porte un toast en son honneur devant tout le groupe.
Annexe 3 – Bureau d'aide sociale
Voici un exemple de texte rédigé par les participants.
Marc va faire une demande d'aide sociale.
À l'arrivée de Marc au bureau, il s'assoit à côté d'une personne. La personne lui demande a tu pris un numéro? Marc répond non et va se chercher un numéro quand son numéro fut nommé il se rendait voir l'agent: Marc lui demande un formulaire mais: Marc à des difficultés à écrire et à lire: Marc: demande à son agent de lui aider à remplir sa demande: l'agent lui répond d'un ton sec je n'ais pas le temps fait toi aider par les personnes qui attend ici: Marc voyons donc c'est gênant de demander aux personnes pour me faire aider à remplir ma demande, c'est à vous de m'aider vous êtes payer pour ça: l'agent lui répond pour l'instant j'ai d'autre personne à racontré, si tu veux rester au bureau je vais t'aider plus tard en attendant assis toi dans la salle d'attente après quelques temps l'agent en passé plusieurs rendez-vous: Marc crit après l'agent je suis tanné d'attendre et qu'il n'y plus personne dans la salle d'attente et je veux passer pour faire remplir ma demande: L'agent commence à lui poser des questions s'il avait en sa possession son baptistère, le bail, permis de conduire, livret de caisse etc: Marc répond je n'ais rien de cela: L'agent lui répond tu reviendras demain.
Annexe 3a – Bureau d'aide sociale
Voici le texte retravaillé par les animatrices.
Il y a trois personnes assises dans la salle d'attente. 2 guichets avec un agent et une agente d'aide sociale.
Marc entre et va s'asseoir à côté de la personne no1.
Tout de suite après, trois personnes entrent et vont chercher un billet.
Roger: Personne 1: (à Marc) Vous n'avez pas pris de numéro.
Marc: Non pourquoi?
Denis: Personne 1: Parce qu'il passe les personnes arrivées en premier d'abord.
Marc: Mais je suis arrivé avant ces trois personnes-là.
Denis: Personne 2: Pas de numéro, pas de preuve.
Marc se lève et va chercher un billet.
La personne 1 est demandée (no 31)
Marc: J'ai laissé les petits à la halte-garderie. Ça va me coûter un bras
Personne 2: (fait signe que oui)
Robert: (no 32) Personne 2 va au guichet.
Marc: C'est ma première demande. Je ne me sens pas tellement bien.
André: Personne 3: On ne s'habitue jamais.
Hélène: Personne 4: J'espère que vous allez avoir une personne gentille. Moi, mon agent n'est pas de tout repos.
Michel: J'ai perdu mon emploi. Les coupures, vous savez!
Hélène: Ça fait 4 ans qui m'font rouler sur des projets. J'ai eu un PDE, un EXTRA, j'ai même eu un PAIE pis y m'ont pas gardé. Maintenant, je veux me recycler. J'veux faire une formation professionnelle pour être camionneur. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Michel: Ah! Pas moi! J'veux retourner travailler le plus vite possible.
Maurice: Personne 5: Fait son entrée et va se chercher un billet.
Lise: No 33: Personne 3 se lève pour se rendre au guichet.
Marc: J'ai perdu mon emploi. Les coupures vous savez?
Hélène: Personne 4: Ça fait quatre ans moi. Pis là y me font rouler sur des projets. PDE, Extra, j'ai même eu un Paie. Y m'ont
Marc: Pis moi je fais quoi?
Agente: Allez vous asseoir. Je vais aller vous aider quand je vais avoir une minute.
Marc: O.K.
Musique rapide
Tout s'agite dans la salle d'attente.
Stroboscope si possible. C'est comme si on voyait un film au rythme accéléré.
Beaucoup de personnes se prennent un billet et vont s'asseoir, se présentent au comptoir et sortent. Les mêmes personnes peuvent repasser plus d'une fois en changeant de veste ou d'accessoires.
Tout s'arrête et les agents-es ferment leur guichet un après l'autre en se souhaitant bonsoir.
Marc est dans la salle d'attente tout triste.
Son agente passe enfin avec son manteau sur le bras.
Marc: Madame, Madame. C'est mon tour.
Agente: (Qui fait un air, comme si elle l'avait oublié) Oh! oui, avez- vous votre Baptistère, votre bail, permis de conduire, livret de caisse.
Marc: Heu! non.
Agente: Eh ben y va falloir revenir demain.
(Black)
Bong!
Musique
Chaque personne passe rapidement une après l'autre. Elles prennent un ticket, vont s'asseoir, se relèvent et vont chercher une feuille aux agents-tes.
Annexe 4 – Plan de la scène
1 - Bureau
2 - restaurant
3 - Cuisine
Annexe 5 – Accessoires
1. Aide sociale- distributrice de billets
- grande table
- 3 chaises
- feuilles (questionnaires)
- poser la banderole du bureau d'aide sociale
2. Bar gai
- bar
- bouteilles de bières vides
- bouteilles de boisson
- cabaret
- jus de pomme ou .5
- pichet
- verre de bière
- tissus pour bar
3. La communication
- nappe
- 1 table
- 4 chaises
- beurre d'arachide
- confiture
- pain
- jus ou lait -téléphone
4. Les logements sociaux
- 2 bureaux (1 grand et 1 petit)
- 3 chaises
- 2 piles de feuilles (sur le grand et le petit)
- banderole «logements sociaux»
5. Intégration des personnes handicapées
- table
- 3 chaises
- Nappe
- pot de fleur
6. Les camionneurs
- 1 micro
- 2 tables
- 6 chaises
- 2 nappes
- vaisselle et ustensiles
- 2 chandelles
7. Harcèlement sexuel
- 2 téléphones
- 2 dactylo
- 4 bureaux
- 6 chaises (3 au bureau du patron)
- pile de feuilles
- livres
- paravent
- poser la banderole «Bureau d'assurance»
8. le racisme
plateau 2
- 2 chaises
- table
- nappe
- téléphone public
plateau 3
- 1 téléphone
- 2tasses
- 3 chaises
- nappe
9. Chanson
Annexe 6 – Chanson d'Annette
Chère Annette notre amie
En hommage à ton sourire
Maintenant que tu es partie
Voici une chanson pour nous réunir
Tu as joué dans la destinée
Quelques jours avant ton départ
Tout au long de ton voyage
Tu vis Annette dans nos pensées
Ton sourire illumine toujours
Nos erreurs et nos amours
Tout au long de ton voyage
On voit Annette ton visage
Sylvain Pagé
Annexe 6a – Cowboy des temps modernes
- Arrivé dans une ville, Après une longue route
Un trucker qui s'fatigue, Pour aller jusqu'au bout
Après des kilomètres, Y'a l'goût de r'faire sa vie
Cowboy des temps modernes, 1 2 3 4 pis y'é r'parti - Assis su'l coin d'un bar, Y'pense à sa guitare
Musique pleine de poussière, Romance à la caissière
Après une coupe de toune, Y'a l'goût de r'faire sa vie
Cowboy des temps modernes, 1 2 3 4 d'la poésie - Rendu au bout du chemin, Son sac plein de souvenir
Y laisse son truck pis y prend l'train, A'ec sa guitare pleine de soupir
Après une route qui mène, Au tournant de sa vie
Cowboy des temps modernes, 1 2 3 4 pis y'é r'parti
Sylvain Pagé
Annexe 7 – Dépliant publicitaire
[Voir l'image pleine grandeur]

L'Option-théâtre de COMSEP présente
Une Création collective
Date: 5 juin 1995
Heure: 79h30
Lieu: Centre culturel de Trois-Rivières
Prix d'entrée: Gratuit
Déroulement de la soirée
- Chanson
- Aide sociale
- Bar gai
- Chanson
- La communication
- Les logements sociaux
- Les camionneurs
- Intégration des personnes handicapées
- Harcèlement
- Restaurant chic
- Le racisme
- Chanson
Équipe de conception de la pièce
Marie-Josée Tardif
Roger Pépin
Danielle Forest
Gaétan Simard
Andrée Alarie
Robert Lemay
Lise Desbiens
Maurice Patry
Hélène Lefebvre
Michel Pépin
Thérèse Fecteau
Jeannette Fecteau
Marc Janvier
Denis Pépin
Michel Pépin
Musique
Sylvain Page
Marc Cavanagh
Pierre Drainville
Collaborateurs et collaboratrices
Line Perreault
Robert Tardif
Serge Richard
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé de près ou de loin à la pièce
Annexe 7a – Publicité dans les médias
[Voir l'image pleine grandeur]

Annexe 8 – Aide sociale (plateau 1)
1- Aide sociale (plateau 1)
Accessoires et décors:
- Distributrice de billets
- 3 bureaux
- 9 chaises
- Feuilles (Questionnaires)
- Poser la banderole pour le bureau d'aide sociale
Annexe 8a – Bar gai (plateau 2)
Entrée des comédiens:
- Serge Richard (Déjà sur place)
- Robert Tardif (Déjà sur place)
- Gaétan Simard (Entrée: «Ça va être ta cousine je suppose»)
- Michel Brissette (Entrée: «Moi j'aime mieux des aventures»)
- Michel Pépin
Annexe 9 – Questionnaire d'entrevue
Témoignages des participantes et des participants
- Dans quelles pièces as-tu joué avant?
- Pourquoi t'es-tu inscrit la première fois à l'option-théâtre?
- Qu'est-ce que ça t'a apporté?
- Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Le moins?
- Par rapport au groupe, comment ça s'est passé?
- As-tu aimé la partie écriture de la pièce?
- Est-ce que l'option-théâtre t'a aidé pour l'amélioration de la lecture et de l'écriture?
- Est-ce que cette expérience t'a permis de t'impliquer plus au niveau des autres comités de COMSEP?
- Si tu avais à convaincre quelqu'un de venir à l'option-théâtre, qu'est-ce que tu lui dirais?
- Qu'est-ce que les gens qui te connaissent disent lorsqu'ils te voient jouer?
Selon la réponse donnée par la personne, l'ordre des questions peut avoir été changé à l'occasion. Souvent, il a aussi été nécessaire de poser des questions supplémentaires pour amener les participantes et participants à être plus explicites dans leurs réponses.
Annexe 10 – Restaurant chic
- Chantera.
- Quatre camionneurs.
- Serveuse gaffe - Un placier (jeans, pourboire).
- Table de personnes plus chics (lèvent le nez sur les autres).
- Insalubrité dans la cuisine.
- Guitariste.
La table de personnes riches déjà sur place.
Un couple très bien habillé.
Un camionneur arrive.
Homme: Regarde là-bas.
Femme: Pourquoi?
Homme: Y as-tu vu l'allure.
Femme: Monsieur, venez ici s'il vous plaît.
Placier: Oui Madame.
Femme: Regardez là-bas, avez-vous vu ce... ce... ce...
Le placier relève le nez et se dirige vers l'homme en question.
Placier: Qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas dans le bon restaurant?
Cowboy: J'étais un habitué avant que ça change de propriétaire.
Placier: Ça, c'était avant, Monsieur.
Cowboy: Prenez-ça (lui glisse le pourboire).
Le placier sourit.
Deux camionneurs et une camionneuse arrivent.
Cowboy: Par ici, par ici.
Placier: (Pour aller parler au cowboy). Il lui refile un autre pourboire.
Les personnes chics se lèvent et sortent.
Deux autres personnes prennent leur place.
Jo: Va voir, le musicien lui parle dans l'oreille.
Fait un signe du doigt (pointe).
Le cowboy devine et fait un signe de doigt comme un fusil.
Il s'installe et chante.
Annexe 10a – Chanson du camionneur
Retourne à sa place et donne une tape sur l'épaule à son copain.
Gini: Je savais pas que tu chantais.
Fred: T'es pas pire.
Jo: Pis toi Gini, qu'est-ce qui arrive avec ton groupe là...
Gini: Ça va, mais on a quand même besoin de monde pour nous aider.
Cowboy: Moi, je suis prêt à donner du temps.
Fred: Moi, je suis bien prêt, mais j'aimerais ça savoir dans quoi je m'embarque?
Gini: Ben moi, il faut que j'aille chercher des livres et des meubles pour le groupe d'éducation populaire.
Jo: Cé quoi ça un groupe d'éducation populaire?
Gini: C'est un groupe pour apprendre à lire et à écrire, pour faire du théâtre, y'a un comptoir vestimentaire. En fait, c'est beaucoup de monde qui se met ensemble pour améliorer leurs conditions de vie.
Cowboy: O.K. cé beau, viens-t'en, on va aller t'aider.
Annexe 10b – Le harcèlement sexuel
Gaétan, Denis, Yves, Michel, Hélène
La scène se passe dans un bureau d'assurance.
Personnages:
La réceptionniste: Claudina Ladouce
Les autres secrétaires: Brigitte, Marie-Josée
Le patron: Yvon Latulipe
Deux de ses amis: Roberto Lavigne, Rosaire Guy
Le patron est dans son bureau. Robert Lavigne arrive. Il est reçu par la réceptionniste.
Claudina: Bonjour, est-ce que je peux vous aider?
R. Lavigne: Oui. Bonjour. Je voudrais voir M. Latulipe
Claudina téléphone au patron M. Latulipe.
Claudina: M. Lavigne voudrait vous voir.
Patron: Je l'attends, fais-le entrer dans mon bureau.
Claudina: Suivez-moi M. Lavigne.
Lavigne et Latulipe se serrent la main.
Lavigne: Ouais, j'espère que ce n'est pas cette secrétaire-là que tu veux amener en fin de semaine parce que la pêche sera pas trop bonne.
Latulipe: Non, non, aie pas peur. J'ai deux autres belles secrétaires.
Claudina (au tél.): M. Guy est arrivé.
Latulipe: Fais-le entrer, nous l'attendons.
Les trois hommes se serrent la main.
Guy: As-tu résussi à convaincre ta femme de te laisser partir en voyage?
Latulipe: Oui, pas de problème, j'ai monté un beau bateau à ma femme. Elle m'a cru.
Lavigne: C'est parfait...
Claudina: M. Latulipe, voulez-vous signer ces papiers-là, c'est urgent!
Latulipe: Claudina Ladouce, je t'ai déjà dit de ne pas me déranger lorsqu'il y a quelqu'un dans mon bureau. Reviens plus tard!
Lavigne: Bon, ben , mon Latulipe, vas-tu nous les monter tes belles secrétaires!
Latulipe (au tél.): Brigitte, veux-tu m'apporter le dossier de monsieur Turcotte.
Brigitte frappe et entre dans le bureau.
Brigitte: Je m'excuse monsieur. Je ne trouve pas le dossier de M. Turcotte.
Latulipe: Ah! oui, c'est vrai. Il doit être dans cette pile de dossier. Peux-tu le trouver pour moi?
Pendant ce temps, les hommes la regardent avec un regard intéressé. Brigitte trouve le dossier, le donne à son patron et sort.
Latulipe: Pis, les gars qu'est-ce que vous en pensez?
Guy: Cé pas pire.
Latulipe: Attendez de voir l'autre secrétaire!
Latulipe (au tél.): Marie-Josée, peux-tu venir ici une minute?
Marie-Josée entre dans le bureau.
Latulipe: Apporte-nous trois cafés avec des biscuits.
Marie-Josée sort. Claudina revient.
Claudina: M. Latulipe...
Latulipe: Écoute ben, Ladouce, si tu viens encore me déranger ça va être ta dernière journée de travail.
Claudina sort.
Guy: Bon ben, moi, je pense que c'est la deuxième que tu devrais amener avec nous autres.
Latulipe: Je vais lui en parler.
Marie-Josée revient avec le café. Elle distribue le café. Le patron s'adresse à elle.
Les deux amis s'en vont. À la fin de la journée Marie-Josée revient dans le bureau du patron
Latulipe: Marie-Josée, j'organise une fin de semaine de pêche avec mes deux amis, veux-tu nous accompagner?
Marie-Josée: Je suis déjà occupée pour la fin de semaine.
Latulipe: Ça serait mieux pour toi que tu acceptes mon invitation. Ça pourrait t'aider à avoir une augmentation de salaire.
Marie-Josée: Je vais y penser; je vais vous répondre demain.
Elle va rejoindre ses collègues.
Les trois secrétaires se parlent. Marie-Josée ne se sent pas bien. Elle a l'air triste
Brigitte: Voyons, Marie-Josée, t'as pas l'air dans ton assiette ce matin!
Marie-Josée: Le patron veut que j'aille en fin de semaine de pêche avec ses amis.
J'ai peur de perdre mon emploi si je dis non. Pouvez-vous m'aider?
Claudina: Moi, je ne peux pas m'en mêler, ça fait plusieurs fois que Latulipe me dit que je vais perdre ma job.
Elle se retire.
Brigitte: J'ai une idée.
Elle lui parle à l'oreille. Marie-Josée va dans le bureau du patron.
Marie-Josée: J'ai ben pensé à mon affaire. Je ne veux pas aller à la pêche avec vous.
Latulipe: Penses-y, Marie-Josée, ça pourrait rapporter ben des avantages ça
là!
Marie-Josée: Si je refuse, qu'est-ce qui va m'arriver?
Latulipe: Tu pourrais perdre ta job. Y a plein de femmes qui demanderaient pas mieux que de prendre ta place.
Marie-Josée: Je ne peux vraiment pas accepter.
Latulipe: Si c'est comme ça, c'est ta dernière journée de travail aujourd'hui.
Marie-Josée: C'est comme vous voulez, M. Latulipe.
Marie-Josée sort. Brigitte et Marie-Josée reviennent dans le bureau.
Brigitte: M. Latulipe, on aurait quelque chose à vous faire écouter avant d'aller porter plainte à... (Elle lui montre la petite enregistreuse.)
Brigitte fait partir l'enregistrement.
BONG!
(BLACK)
Annexe 10c – La communication
Mère: (fait des rôties)
Deux petits arrivent
Enfant 1: Bonjour Maman
Enfant 2: Salut
Mère: Bonjour, avez-vous bien dormi?
Enfant 1: Oui
Enfant 2: Oui
Père: Bonjour, j'aurai pas le temps de déjeuner ce matin.
Mère: As-tu entendu le bruit cette nuit.
Père: Ben oui c'est ben effrayant.
Mère: Y'a traitait de toutes sortes de noms.
Père: Des choses qu'on peut pas répéter devant les enfants. Je trouve ça inconcevable. Je me demande ce qui peut se passer dans leur tête.
Mère: Moi, je trouve ça ben lâche.
Père: La prochaine fois, je téléphone à la police.
Le mari sort.
Mère: Bon vite les enfants on va être en retard.
Elle sort avec les enfants et juste avant de sortir.
Mère: Chéri, n'oublie pas d'aller chercher les enfants à la garderie.
(Au milieu de la phrase on entend une chasse de toilette. Flush)
(Black)
9h plus tard.
La mère entre de son travail, elle a l'air bien fatigué. Elle regarde sa montre et a l'air inquiète.
On entend en coulisse.
Homme: Ma ptite crisse t'as pas compris ce que je t'ai dit hier soir.
Femme: Tu changes d'idée tout le temps. T'es jamais content de rien.
Homme: Tu me cherches ou quoi? Je vais t'en câlisser une que tu vas te souvenir longtemps.
Femme: Tu peux frapper, je ne les sens même pas tes coups.
On entend du bruit en coulisse.
Homme: Je vais te tuer p'tite garce.
Mère: Elle prend le téléphone.
Mère: Vite répondez, répondez. Y va la tuer.
Mère: Qu'est-ce que je vais leur dire moi? Peux-tu me dire de quoi je me mêle moi?
Mère: Oui bonjour Monsieur Lesieur. C'est Ginette en bas. Vous allez bien?
Mère: Non, non pas de problème. Je voulais seulement savoir si vous avez besoin d'un relevé du coût du loyer pour vos impôts.
Mère: Ah oui! mon mari vous l'a déjà donné. Ah bon, un manque de communication.
Mère: Ça va me faire ça de moins à faire.
Mère: Bon ben je ne vous dérangerai pas plus longtemps.
Mère: Du bruit. Non, non ça doit être bien isolé.
Mère: Pas de problème. Merci du renseignement. Bonjour.
Mère: (Regarde par la fenêtre) Peux-tu me dire ce qu'ils font?
Mère: (Cherche un numéro de téléphone dans l'annuaire et signale.)
Annexe 10d – Bar gai
Deux gars entrent et se tiennent par le bras.
Guy: L'as-tu refait la décoration du salon de ta mère en fin de semaine?
Michel: Oui. J'ai commencé. On a fait les plans. Mais on est pas rendu ben loin. Ma mère arrivait pas à se décider entre le vert pis le mauve.
Guy: Ah non! Ça veut dire que tu vas prendre une autre fin de semaine. Pis moi là dedans je m'ennuie quand tu n'es pas là.
Michel: C'est toujours pas de ma faute.
Guy: Ben des fois je me le demande. Cette fois là c'est ta mère. Pis avant, c'était ta sœur. Pis la prochaine fois, ça va être ta cousine je suppose.
Michel: Qu'est-ce que tu veux insinuer? (Luc fait son entrée)
Michel: Salut Luc. Tu tombes justement bien.
Guy: Tu trouves toujours le moyen de t'en sortir à bon compte.
Luc: Êtes-vous en pleine chicane?
Guy: Ben non. C'est juste parce que je l'aime. Je m'ennuie quand y'é pas là.
Luc: Ah! L'amour! Moi, je laisse ça aux autres. (Il rigole)
Michel lui fait des gros yeux derrière le dos de Luc.
Luc: C'est ben trop compliqué. Moi j'aime mieux des aventures.
Deux autres gars font leur entrée.
Mario: J'ai soif.
Stef: Moi aussi. Ça va nous faire du bien avant de redescendre.
Mario: Moi, je vais en prendre juste une. Je conduis. C'était toute une partie. On les a enfin battu ces Tigres de Montréal.
Stef: Y'avaient plus l'air de chatons que d'autre chose aujourd'hui. (Elle rigole.)
Mario: C'est nous autres qu'y a joué comme des pros. Faut quand même l'admettre.
Mario: (Les yeux ronds) Regarde-là.
Stef: Quoi? Où?
Mario: Ben, là.
Stef: Oui, pis?
Mario: Des tapettes.
Stef: Ben oui. Je le sais, c'est moi qui t'a amené ici.
Mario: (Geste de recul) Pourquoi?
Stef: Le propriétaire. C'est mon ami.
Mario: T'as une grande comme ami.
Stef: Premièrement, c'est pas une grande. Pis deuxièmement, oui c'est mon ami.
Mario: Comment tu l'as connu?
Stef: Y jouait dans la ligue l'année passé. Y'a eu des petits problèmes de santé. Y devait revenir l'année prochaine.
Mario: Ben moi, je vais débarquer. Je prendrai pas ma douche avec des tapettes.
Stef: (En riant) Trop tard!
Mario: T'en es une.
Stef: Ben non, pas moi mais Jean.
Mario: Jean. Ah mon Dieu! Moi qui y a passé mon shampooing cette semaine!
Stef: Énerve-toi pas, y' cruise pas tout ce qui bouge
Stef: Alex est en couple avec le même gars depuis 15 ans. Pis sont fidèle et heureux. Je connais ben des couples hétéro qui peuvent pas en dire autant. Prends toi.
Mario: Commence pas. C'est pas de ma faute si je suis célibataire, j'attends la bonne.
Stef: Mon ami propriétaire, y'é ben stable lui aussi. Même que Brigitte a les aime beaucoup. Des fois, y nous invitent à passer des fins de semaine à leur chalet. On a assez de fun là.
Mario: Ouin, dans le fond. Tu te sens ben ici toi?
Stef: Ben oui. Pis avec toi y'a pas de danger. Ils doivent penser que t'es mon chum!
Mario: Fais pas de farce plate.
Stef: On dirait que tu t'amuses pu.
Serveur: Prenez-vous autre chose?
Michel: Une autre pour moi.
Serveur: Quand ça va être mon tour a moi? Tu me fais monter mes bas.
Guy: Coudon toi.
Serveur: Ça va t'arriver de le perdre. Tu vois lui. C'est lui qui l'avait en fin de semaine passée.
Guy: C'est quoi qui raconte-là lui?
Luc: Tu dis rien, Michel.
Guy: (Hors de lui) Ça ne se passera pas comme ça . (Il se lève et donne une gifle à Michel et sort)
Mario: Pis, qu'est-ce que tu en dis toi pis tes belles théories?
Stef: J'ai pas changé d'idée. On est dans un bar. Ça peut arriver dans n'importe quel bar. Je suis d'accord avec toi. Y en a des grandes folles mais sont pas tous comme ça. Pis c'est des personnes comme nous autres qui ont une orientation sexuelle différente. C'est tout.
Michel passe derrière Mario et lui fait les yeux doux.
Mario: Bon, je dis pus un mot.
Stef: Fais donc ça. Moi, je vais aller au toilette.
Mario: Non
Stef: Je peux pu aller pisser asteur.
Mario: Tu me laisseras pas tout seul ici.
Stef: J'ai envie.
Mario: Tu pisseras sur le bord de l'autoroute
Bong!
(Black)
Annexe 10e – Le racisme
Mohamed est assis avec Simon au restaurant. Mohamed est découragé.
Simon: T'as ben l'air découragé qu'est-ce qui se passe?
Mohamed: Tu sais Line, la fille sympathique qui était ici mardi passé.
Simon: Oui, oui.
Mohamed: Elle veut déménager.
Simon: Jusque-là, ça va.
Mohamed: Je suis déjà allé chez elle. Pis elle a un super bel appartement.
Simon: Pis toi, tu veux le louer.
Mohamed: C'est ça.
Simon: Je vois pas le problème.
Mohamed: Arrête de m'interrompre, pis je vais tout t'expliquer.
Simon: Motus. (Il fait semblant de fermer une fermeture éclair sur sa bouche.)
Mohamed: Line a m'a dit: «Va voir mon propriétaire. Y'a pas eu le temps de le mettre à louer, je lui ai annoncé mon départ aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Poulin.» Je me suis dit, c'est juste une question de formalité.
Simon: Pis là, t'es allé. Pis le logement était moins beau que tu pensais.
Mohamed: Ben non. Le propriétaire m'a dit qu'il était loué.
Simon: Si il est déjà loué, c'est qu'il n'était pas pour toi.
Mohamed: Mais tu comprends rien ma parole.
Simon: Faut croire que non.
Mohamed: Il ne veut pas me louer à cause de la couleur de ma peau.
Simon: Non. Je ne te crois pas.
Mohamed: Je te le dis. Peux-tu me rendre service?
Simon: Oui, mais quoi? (téléphone)
Mohamed: Oui, bonjour, l'avez-vous rejointe, la personne en question.
M. Poulin: Oui, elle a changé d'idée. Le loyer est pour vous.
Mohamed: Je suis bien content.
M. Poulin: Passez demain matin signer le bail.
Mohamed: Sans faute. Merci, bonjour.
M. Poulin: À demain.
Mohamed: M. Poulin, vous n'aurez pas à le regretter.
M. Poulin: Je l'espère. Bonjour.
Mohamed: Bonjour. (Les deux gars dansent de joie)
Annexe 10f – Logements sociaux
Robert: Réceptionniste, gentil face au monde mais...
Maurice: Secrétaire, très sévère, injuste, bourré de préjugés.
Mohamed: Se présente pour avoir un loyer. Explique sa cause (il est noir). Immigrant.
François: Vient faire une demande pour avoir un loyer à prix modique.
Marie: Demande un loyer. La cause: elle garde sa mère handicapée, veut que son problème soit pris en considération pour que son dossier avance le plus rapidement possible, puisqu'elle déménage en juillet à cause de la maladie de sa mère.
Paul: Ex-travailleur dans un moulin à papier, il est sur l'aide sociale depuis un an et demi. Père de trois enfants, n'est plus capable de joindre les deux bouts avec son loyer actuel qui est de 600 $ non chauffé, non éclairé. Après demande faite depuis 3 mois, vient demander explication à sa cause.
Lise: Femme célibataire avec un enfant en bas âge. À la recherche d'un loyer à faible revenu (prix modique). Au moment de la demande, il y a 25 personnes avant elle qui ont fait la même demande, mais cependant c'est elle qui aura la priorité.
Suite: Discussion entre Maurice et Robert, au sujet des personnes inscrites sur la liste. Pourquoi ne donnerions-nous pas la chance à cette jolie femme avec un enfant. On pourra obtenir d'elle, plus tard, des faveurs spéciales.
Musique Logements sociaux
Robert: Est installé à son bureau et reçoit les personnes.
Maurice: Il a son bureau un peu retiré avec une pile de feuilles que lui remet Robert.
François: (Attend que Robert ait fini de discuter avec Maurice, qui le retient.)
Robert: Bonjour
François: Bonjour, je viens pour un loyer à prix modique.
Robert: Oui, Monsieur (en sortant un questionnaire). Remplissez-moi ça.
François: Où?
Robert: Dans la salle à côté. Juste ici.
Robert: Madame.
Marie: J'ai absolument besoin d'un loyer.
Maurice: (Il crie) Tout le monde ici a besoin d'un loyer.
Robert: (Il sourit et semble mal à l'aise)
Marie: Mais moi, y'a du nouveau dans ma vie.
Robert: Oui?
Marie: Ma mère est tombée malade, elle est invalide. Elle a besoin d'un loyer adapté.
Robert: Avez-vous les papiers du médecin?
Marie: Oui, tenez. (Elle lui donne les papiers)
Robert: Pouvez-vous remplir cette formule? Vous avez juste à passer à côté ici.
Marie: C'est combien de temps d'attente?
Robert: Ça dépend, si on a un loyer de libre qui vous convient. Ça dépend du nombre de chambres que vous avez besoin. Ça dépend de l'installation que votre mère a besoin. Ça dépend...
Maurice: Ça dépend si je t'aime la face ou pas!...
Marie: Qu'est-ce qu'il veut dire?
Robert: Rien, rien.
Marie: En général...
Robert: Entre un mois et trois ans.
Marie: Trois ans!!! (fort)
Maurice: Si ça continue comme ça...(Robert lui fait signe de se taire)
Marie sort, déçue.
Robert: Bonjour!
Paul: Je suis venu y a six mois. Je ne sais pas si vous me reconnaissez?
Robert: Oui, oui... Vous avez trois enfants pis vous êtes un ex-travailleur de la PFCP.
Paul: Oui, c'est moi. Je viens voir où on en est avec mon dossier parce que ça fait un an et demi que je suis sur l'aide sociale. Avec mon loyer de 600 $ non chauffé, non éclairé, je vous dis que nous avons de la misère.
Robert: (Cherche dans sa pile) Je ne trouve pas votre dossier, je ne comprends pas... Laissez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous téléphoner aussitôt que j'aurai des nouvelles.
Paul: Bon bien, j'espère que ça ne sera pas trop long, bonjour!
Paul sort.
Robert: Bonjour!
Robert: Coudon Maurice, je ne trouve pas le dossier de Paul Emond. Ça te dit-tu quelque chose?
Maurice: Le gars qui était là tantôt? Oui, je n'ai pas activé son dossier parce que je n'aime pas sa face pis les ex-travailleurs de la PFCP, je ne les aime pas non plus.
Robert: Pourquoi?
Maurice: Pour rien, c'est comme ça.
Robert: Tu n'as pas le droit, je vais te dénoncer.
Maurice: Fais ça, pis moi, je raconte que tu as gonflé tes frais de repas, OK!
Robert: J'ai fait ça juste une fois!
Maurice: Une fois de trop...
Robert: Pis Paul Émond?
Maurice: Retourne travailler, je vais y penser.
Robert revient les épaules basses. Robert: Bonjour madame, je peux vous aider?
Maurice relève la tête pour la regarder
Lise: Oui, je viens de laisser mon mari y'a pas longtemps, ma fille pis moi, on a de la misère à arriver.
Maurice s'avance doucement.
Robert: Vous venez pour un logement?
(Maurice parle à l'oreille de Robert)
Robert: On peut pas faire ça!
Maurice: Laisse Robert, va en arrière, t'as sûrement d'autres travaux (en le poussant doucement).
Robert sort découragé.
Maurice: Excusez-moi Madame, j'ai entendu ce que vous disiez. Nous allons en avoir un très bientôt qui va se libérer.
Lise: Vous êtes sûr? Je me suis fait dire que je pouvais attendre jusqu'à trois ans.
Maurice: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des beaux yeux comme les vôtres.
(black)
musique
Annexe 10g – Intégration des personnes handicapées
Une classe régulière où il y aurait un handicapé; les adolescents se moquent de Roger l'handicapé en lui faisant des grimaces à cause de la façon dont il mange et de son comportement.
Christian: Un élève qui tente de se lier d'amitié avec Roger.
Roger et Christian: Après la classe, au retour à la maison, deux adultes passent des commentaires désobligeants et changent de trottoir à la vue de Roger.
Les parents de Christian ont des préjugés parce qu'il s'occupe de Roger. Il a bien de la peine à la suite de cela.
Mais Christian essaie de faire comprendre à ses parents qu'ils ont l'air bornés. Petit à petit, les parents de Christian acceptent de plus en plus Roger.
Deux ado:
- 1er dit a l'autre -Regardez donc lui il est tout croche comme un mongol Ha! Ha!
- 2e -As-tu vu s'il est laid.
Roger: Arrêtez donc de rire, aussi comptez-vous chanceux d'être bien corrects.
Christian revient de l'école avec son nouvel ami Roger. On entend en coulisse des adolescents.
Voix off 1: Regardez-le donc lui, il est tout croche comme un mongol, ha! ha! ha! Voix off 2: As-tu vu si y'é laid. Christian entre de reculons.
Christian: Vous êtes mieux de le laisser tranquille, j'ai ma ceinture verte en judo. En tout cas, y'est ben plus intelligent que vous autres. Comptez-vous chanceux d'être correct vous autres.
Roger: Arrête, arrête, y'en valent même pas la peine.
Christian: Je te dis qu'ils ne te connaissent pas pour parler de même.
Roger: Je suis habitué. Moi j'aime mieux être avec mes amis-es qui sont comme moi.
Christian: Mais pourquoi y t'ont mis dans ma classe?
Roger: Y'appelle ça «intégration».
Christian: Comment?
Roger: Intégration.
Christian: Intégration.
Roger: Oui
Christian: Une chance, sinon, je ne t'aurais jamais connu.
Roger: Oui, es-tu certain que tes parents veulent que j'aille chez toi?
Christian: Oui, oui. Tu vas voir, sont ben cools.
Ils sortent de l'autre côté de la scène.
(BLACK)
La mère est dans la cuisine. Christian et Roger arrivent.
Christian: Salut M'man
Mère: Allô mon grand. (Elle est de dos).
Christian: (En tirant sur Roger) J'ai quelqu'un à te présenter.
La mère se retourne et est très surprise, elle n'ose dire un mot.
Christian: Mon nouvel ami Roger.
Mère: Y m'entend-tu?
Christian: Y'é pas sourd, voyons. Papa viens voir. J'aimerais te présenter mon nouvel ami que j'aimerais amener avec nous au chalet la fin de semaine prochaine.
Roger fait de grand signe que non.
Le père entre et paraît surpris. Il reprend son sang-froid et salue Roger.
Père: Bonjour, ça va bien? Bienvenue chez nous mon garçon.
Roger: Bonjour, Monsieur, Merci
Le père regarde Christian.
Père: Qu'est-ce qu'il dit?
Christian: (Fâché) Bonjour et merci monsieur.
Roger: Bon ben, je dois y aller ma mère va commencer à s'inquiéter.
Il sort.
Christian: Bye à demain. Je vais aller te chercher.
Père: Christian, à quoi t'as pensé. T'aurais dû nous prévenir avant de l'amener.
Mère: Pis pour la fin de semaine on va y penser.
Christian: Ça, c'est le comble. Je n'ai jamais eu si honte de ma vie.
- Mes parents qui n'ont pas de préjugés.
- Y faut accepter tout le monde.
- Accepter les différences.
- Être bon et généreux.
- C'est pas ça que vous m'avez enseigné?
- Depuis quand on doit réfléchir pour amener un de mes amis au chalet?
- C'est parce qu'il n'a pas eu la chance de venir au monde avec un beau corps comme nous autres. C'est ça, hein? C'est ça?
- Y'a la paralysie cérébrale, mais ça fait pas de lui un monstre. C'est le gars le plus gentil que je connaisse.
Père: Christian ça suffit. On est tes parents, tu vas nous parler mieux que ça.
Christian: Ça, c'est le bout du bout. (Il sort fâché)
Mère: Y'a un peu raison.
Père: Je le sais, mais ce n'est pas une raison pour nous parler de cette façon.
Mère: Ben non, mais je ne l'avais jamais vu fâché comme ça.
Père: En tout cas, pas après des personnes. Peut-être après une game de hockey perdue.
Mère: J'ai été ben surprise. Je le sais ce qu'on a toujours dit, mais je n'avais jamais approché une personne handicapée de ma vie.
Père: J'ai pas été mieux. On l'aime tellement Christian, on voudrait ce qu'il y a de meilleur pour lui. Pis là, on a pas eu le temps de réfléchir, nos préjugés ont pris le dessus.
Mère: C'est une bonne leçon pour nous.
Christian arrive.
Christian: Je veux m'excuser pour mon comportement de tantôt.
Mère: T'as pas bien agi en criant après nous, mais t'avais bien raison dans ce que tu as dit.
Père: Nous autres aussi, on s'excuse. Pis ton ami va être le bienvenu au chalet.
Mère: Pis tu peux l'inviter à la maison quand tu veux.
Christian: Merci P'a. Merci M'am, je lui avais dit que vous étiez cool.
(BLACK)
Annexe 11 – Mémoire déposé a la commission régionale de la Mauricie/Bois-Francs/Drummond sur l'avenir du Québec
Par
C.O.M.S.E.P.
Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire
749, St-Maurice
Trois-Rivières (Québec) G9A 3P5
Téléphone: (819) 378-6963
Télécopieur: (819) 378-0628
Porte-parole: Sylvie Tardif, coordonnatrice
HIVER 1995
Principe #1: Des principes égalitaires entre les hommes et les femmes.
Nous voulons une société qui cesse d'opprimer la moitié de sa population. Dans la société que nous prônons, le sexe d'une personne ne déterminera plus son statut social, ni économique. Les femmes sont proportionnellement représentées dans toutes les structures administratives et de pouvoir. Aucune violence envers les femmes ne sera tolérée.
Nous voulons une société qui incluera dans sa charte des droits et libertés un chapitre spécifique aux droits des femmes; une reconnaissance formelle de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Nous voulons une société qui ne tolère d'aucune façon le sexisme et la violence sous toutes leurs formes. L'État doit être porteur et promoteur de ces valeurs.
L'État doit:
- Adopter une politique de tolérance zéro face à la violence conjugale;
- Abolir la pornographie;
- Établir un programme d'éducation sexuelle dans le respect des femmes afin d'éliminer le mépris, les attitudes sexistes et la violence à leur égard.
Nous voulons uni État qui assurera une participation égale des hommes et des femmes dans les institutions politiques, un partage équitable des postes administratifs et de pouvoir.
Les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes se concrétisent à la maison, au travail, sur le terrain économique, dans tous les lieux de pouvoir.
L'autonomie financière est une condition à leur égalité.
L'État devra:
- Instaurer une politique en matière d'équité salariale;
- Éliminer la précarité de l'emploi que vivent les femmes;
- Favoriser la pleine participation des femmes au marché du travail par la mise en place de services de garde de qualité, accessibles et gratuits et particulièrement pour les femmes cheffes de famille;
- Reconnaître d'autres formes de contributions sociales que le travail salarié dont la prise en charge des enfants et des personnes vulnérables;
- Reconnaître le travail des femmes au foyer. À ce titre, nous souhaitons que les allocations familiales ne soient pas établies en fonction du revenu familial mais plutôt à partir du principe de l'universalité
Nous voulons une société qui permettra à toutes les femmes de vivre décemment et d'atteindre minimalement le seuil de pauvreté.
L'État devra:
- Améliorer la sécurité du revenu;
- Améliorer des programmes d'aide aux familles;
- Soutenir par des programmes d'aide les femmes cheffes de famille;
- Augmenter les revenus pour les femmes vieillissantes;
- Augmenter le salaire minimum.
Nous voulons une société qui reconnaîtra financièrement le travail des groupes de femmes et l'apport des femmes au développement économique et social de notre société.
Nous voulons une société qui portera une attention particulière aux femmes plus isolées des milieux ruraux. L'État se doit de mettre en place des mécanismes qui permettront à ces femmes d'accéder aux mêmes droits, services et ressources que les femmes vivant dans les milieux urbains.
L'État doit soutenir les groupes populaires, communautaires et de femmes qui contribuent largement à sortir ces femmes de l'isolement.
Nous voulons qu'un État québécois reconnaisse les problèmes que vivent les femmes immigrantes et réfugiées. L'État devra accueillir les femmes victimes de violence et ne pas déporter les femmes immigrantes vivant ici, parrainées par un conjoint qu'elles doivent quitter pour cause de violence.
Principe #2: Une société juste sur les plans économique et social.
Nous voulons une société économiquement et socialement juste où la distribution des richesses et l'organisation du travail permettent l'épanouissement de tous et toutes, individuellement et collectivement. Une société où le plein-emploi, des politiques fiscales équitables, un système d'éducation accessible et des politiques sociales équitables seront au cœur du développement des personnes et des collectivités.
Nous voulons aussi une société où la dignité de la personne doit primer en premier. Par personne, nous entendons toutes les personnes. La dignité de la personne implique de définir et de promouvoir ses libertés et ses droits fondamentaux. La dignité implique aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les droits à mieux reconnaître et à protéger figurent:
- Le droit à des services de santé et à des services sociaux universels, accessibles et gratuits;
- Le droit à l'alphabétisation, à la formation générale et professionnelle universelle, accessible et gratuite;
- Le droit à un logement décent à un prix abordable;
- Le droit à un revenu décent, garanti soit par le travail, soit par des transferts fiscaux;
- Le droit à un emploi de qualité.
Nous voulons aussi une économie plus humaine et plus orientée vers la réalisation d'objectifs de développement humain. Il est important que les citoyens et citoyennes de chacune des régions du Québec puissent contrôler le développement économique de leur région. Une économie plus humaine, c'est aussi de démocratiser les entreprises et accroître le contrôle des travailleuses et des travailleurs sur les lieux de travail. L'État devra favoriser des moyens alternatifs de développer l'économie sociale et promouvoir la formule coopérative. Il soutiendra le développement socio-économique local et régional ainsi que les initiatives communautaires.
Les entreprises ont, elles aussi, des droits sociaux qu'elles doivent être tenues d'assumer dans l'intérêt de la collectivité, en outre, d'abaisser les critères d'embauche qui excluent toute la population analphabète.
L'État devra développer des programmes de formation professionnelle de qualité et non discriminatoire. La formation professionnelle doit être accessible à toute personne voulant accéder au marché du travail.
L'État devra améliorer la sécurité du revenu et permettre aux personnes d'atteindre minimalement le seuil de pauvreté.
Nous voulons une société où la fiscalité sera progressive. Cela veut dire qu'on doit exiger plus de ceux et de celles qui ont plus de moyens. Nous voulons une fiscalité universelle qui exige une contribution équilibrée et nécessaire entre la contribution des entreprises et celle des particuliers. Les entreprises doivent aussi contribuer au financement des services communs par la fiscalité.
Nous souhaitons aussi la fin des traités de libre-échange et de l'Aléna parce que ces traités appauvrissent encore plus les personnes plus démunies et les travailleurs-euses des pays impliqués.
Société plus juste socialement.
Nous affirmons la nécessité de développer un réseau public de santé accessible, universel et gratuit, dans lequel l'accent devra porter sur la prévention. En ce sens, l'action à privilégier consiste à agir sur les conditions de vie en tenant compte des aspects environnementaux, économiques, politiques et culturels. De plus, il faut établir un système de santé adéquat en région.
Nous voulons une société qui offrira, des services supplémentaires gratuits et accessibles destinés plus particulièrement à sortir les gens de l'exclusion économique et sociale. C'est le cas entre autres des personnes analphabètes, personnes handicapées, de nouveaux immigrants-es, des personnes assistées sociales et des personnes âgées.
L'Éducation est nécessaire à la démocratie. Ainsi, nous soutenons que tous et toutes doivent y avoir accès. Le système d'éducation doit favoriser la transmission du savoir et des valeurs communes. Il doit favoriser l'ouverture d'esprit et le sens critique pour former des personnes autonomes et responsables. Les connaissances doivent lier théorie et pratique. Les adultes doivent aussi avoir accès à l'éducation qu'il s'agisse d'alphabétisation, de formation générale et professionnelle ou d'éducation populaire.
Voici quelques exemples qui permettront d'améliorer le système d'éducation actuel:
- Développer une politique globale en alphabétisation qui repose sur le droit au choix du lieu de formation pour les personnes analphabètes entre le réseau institutionnel et le réseau populaire.
- Enlever toute contrainte limitant le temps d'apprentissage des personnes analphabètes (ex: 2 000 heures dans les commissions scolaires et dans la mesure rattrapage scolaire du ministère de la Sécurité du Revenu) .
- Apporter des corrections au système d'enseignement primaire et secondaire pour faire une place réelle à des jeunes ayant des démarches d'apprentissages différentes.
- Mettre en place des mesures de prévention pour les enfants de 0 à 6 ans au niveau des familles.
- Abolir les frais de scolarité afin de permettre aux gens à faible revenu d'accéder aux études de niveau supérieur.
Principe #3: Une société démocratique.
Nous voulons une société qui véhicule une véritable démocratie tant dans sa représentation politique que dans ses structures et qui se dote des outils nécessaires favorisant le droit de parole. Une société qui respecte l'autonomie des régions et prône un réel développement régional. Cette société sera respectueuse de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Nous voulons dans une nouvelle société des conditions pour l'exercice de la démocratie.
- Des espaces démocratiques qui permettent à tous les citoyens et citoyennes d'exercer leurs droits, d'assumer leurs responsabilités, de prendre davantage la parole et de participer pleinement à l'exercice du pouvoir dans le plus de lieux possible:
- Dans le milieu de vie local (école, travail, quartier);
- Aux divers niveaux national, régional, municipal, local de la vie politique en se prononçant sur les questions d'éducation, de santé, de services sociaux, de développement économique, social et culturel;
- Dans les institutions économiques en favorisant davantage celle dont la gestion est démocratique par exemple le mouvement coopératif.
L'État se doit de rendre accessible l'exercice de ces pouvoirs par des mécanismes facilitant la participation des personnes analphabètes à ces espaces démocratiques.
De l'éducation démocratique: L'éducation populaire agit comme mécanisme de prévention des problèmes sociaux. Elle contre l'exclusion, contribue à la solidarité sociale et favorise l'expression de la culture populaire.
Pour que la démocratie existe, on doit éduquer davantage à la démocratie, à l'école, dans les médias, dans les milieux de travail et dans les organisations syndicales et populaires.
L'État devra reconnaître l'éducation populaire comme moyen de promouvoir la démocratie. Les groupes populaires et communautaires sont des lieux de renforcement de la démocratie, ils méritent que l'État reconnaisse leur compétence, respecte leur autonomie et augmente leur financement.
Des outils démocratiques: Une société démocratique se dotera d'outils nécessaires à une participation pleine et entière à la vie sociale, économique, politique et culturelle.
L'accès à l'information compréhensible est une condition pour que s'exerce la démocratie et un droit pour les citoyens et citoyennes. Des médias accessibles seront des lieux d'information, de formation et d'échanges.
L'État devra reconnaître le droit à l'information incluant des outils adaptés pour les personnes analphabètes.
Par exemple, d'ajouter sur les bulletins de vote des photos des candidats et candidates permettrait aux personnes analphabètes d'exercer leur devoir de citoyens et citoyennes.
Un régime représentatif: L'amélioration de la démocratie dans notre système politique devrait passer par l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel pour permettre la représentation politique de divers courants d'opinion.
Un régime plus démocratique permettrait la représentation équitable des hommes et des femmes de toutes couches sociales dans les institutions politiques et publiques.
Une bureaucratie plus humaine. La démocratie se vit aussi dans nos rapports au quotidien. L'État se doit de traiter le plus humainement possible les citoyens et citoyennes dans leurs rapports avec les institutions et appareils de gestion de l'État.
L'État doit respecter la vie privée des citoyens et citoyennes par exemple:
- En empêchant toute intrusion gouvernementale ou des entreprises dans la vie privée des personnes (listes informatisées, banques de données).
- Abolition de toutes les mesures répressives, entre autres, contre les personnes assistées sociales.
- Mettre fin au contrôle des grandes corporations sur la santé, la justice, etc.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes: Une société démocratique respecte les droits des Québécois et Québécoises de décider de leur avenir mais aussi des peuples autochtones de contrôler économiquement et politiquement leur territoire et leur avenir.
Chaque nation a le droit de définir des normes qui lui sont propres. Cependant, les droits nationaux ne doivent entraîner aucune discrimination ni exclusion à l'égard des droits de la personne. Cela vaut en particulier pour le droit des femmes québécoises et autochtones.
L'autodétermination des peuples autochtones dans toutes ses dimensions (politique, économique, sociale et territoriale) devra être négociée d'égal à égal où il sera important d'arriver avec une résolution satisfaisante des revendications d'un peuple dans un esprit d'ouverture et de respect pour leur culture et leur histoire. Dans la reconnaissance de ce droit, l'État québécois doit jouer un rôle dans la valorisation de la culture autochtone autant à l'école que dans la société. Il doit permettre d'assurer la transmission de la connaissance des cultures et l'apport des autochtones à la culture québécoise.
L'État doit promouvoir le dialogue entre les deux peuples en vue d'en arriver à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre et briser les préjugés défavorables entre les peuples.
Principe #4: Une société non violente.
Nous voulons une société où la guerre ne représente pas la solution privilégiée aux conflits entre les pays ou les individus. Une société qui soit ouverte sur le monde et qui respecte le droit à l'intégrité physique et psychologique des personnes.
Nous désirons que soit éliminée toute forme de violence dans notre environnement immédiat et dans notre pays. Que cesse plus particulièrement la violence faite aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées afin que ces personnes puissent vivre en toute sécurité sans être sous la domination de quiconque.
La violence se manifeste également entre les pays, il est primordial que notre société milite en faveur du pacifisme, de la démilitarisation et l'abandon du conflit armé comme solution aux litiges.
Finalement, nous militons en faveur d'une société prônant des valeurs de paix et d'harmonie entre les pays et les nations. À cet égard, la non-ingérence militaire, le partage équitable des ressources de la planète, le respect des droits humains et l'aide internationale nous apparaissent comme étant des prémisses importantes à une co-existence pacifique.
Voici quelques exemples d'actions pour une société non-violente:
- Responsabiliser les médias et surtout la télévision par rapport au contenu des émissions;
- Combattre les stéréotypes violents qui sont valorisés;
- Limiter l'accès aux armes à feu;
- Éliminer toutes les armes nucléaires;
- Reconvertir les budgets militaires à des fins socialement utiles;
- Soutenir les groupes qui travaillent sur les questions internationales.
Principe #5: Une société non-discriminatoire
Nous voulons une société qui favorise l'intégration des communautés culturelles tout comme leur plein épanouissement en leur accordant les mêmes droits que l'ensemble de la population. Une société qui rejette catégoriquement le racisme, le sexisme et l'oppression. Une société qui prône le respect des collectivités et des individus peu importe la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, la condition physique, psychologique et économique. Conséquemment, une société qui prône le respect des organisations et des moyens et lieux d'expression collective.
Nous désirons une société où la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression doit être protégée aussi bien à l'égard des pouvoirs publics qu'à l'égard des grandes entreprises. Cette liberté ne peut être limitée que dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des droits fondamentaux.
L'État devra protéger la liberté des parents de transmettre à leurs enfants la langue maternelle de leur choix.
La minorité anglophone participe à la démocratie québécoise et au développement du Québec. Elle a des droits historiques et des institutions qu'elle doit pouvoir maintenir tout comme elle doit pouvoir développer sa langue et sa culture.
La construction d'une identité nationale commune suppose des mesures d'intégration à la société québécoise. Elle ne suppose pas l'assimilation, c'est-à-dire l'effacement de la culture propre des personnes immigrantes.
Toutes les citoyennes et les citoyens devront être sur le même pied d'égalité quelle que soit leur origine, leur langue maternelle ou leur croyance religieuse.
Nous voulons une société qui refusera les attaques verbales, physiques, sociales ou économiques face aux femmes, aux autochtones, aux communautés culturelles, aux minorités religieuses, aux personnes handicapées, aux gais et aux lesbiennes.
L'État devra voir à éliminer toute forme de discrimination à l'égard des personnes et des couples homosexuels.
Voici quelques exemples d'actions pour promouvoir une société non-discriminatoire:
- Favoriser une éducation et des politiques pour contrer le racisme;
- Mettre en place des structures d'accueil pour les immigrants et immigrantes;
- Reconnaître les expériences acquises à l'extérieur du pays;
- Valoriser et intégrer les personnes handicapées dans la société;
- Mettre sur pied des programmes éducatifs préparant la population à l'accueil et à l'intégration de la population immigrante.
Principe #6: Un environnement sain
La société dans laquelle nous voulons vivre doit mettre ses priorités sur des politiques de respect et de protection de l'environnement où le développement socio-économique des collectivités et des personnes se fasse en harmonie avec la nature.
L'État devra de toute urgence mettre en place des solutions offrant des ressources humaines et financières afin de réparer les torts causés par la surexploitation des ressources naturelles.
Par exemple, il faudra que l'État priorise:
- Le reboisement de nos forêts et cesser la coupe à blanc;
- Le nettoyage des sites contenant des déchets toxiques;
- La dépollution des grands cours d'eau.
Nous voulons une société qui optera pour des choix axés sur le développement qui ne se fasse pas au détriment de la nature.
Par exemple, l'État devra prioriser:
- Mettre en place des politiques de conservation d'énergie;
- Favoriser le développement durable;
- Investir dans la technologie douce (non au nucléaire);
- Imposer le respect des lois par les entreprises et industries;
- Favoriser l'implantation d'industries non polluantes;
- Établir des politiques de cueillette sélective.
Nous voulons une société dont la qualité doit se refléter aussi dans les villes. Par exemple, il faudra que l'État se préoccupe de: -Façonner le développement urbain dans le respect de la nature; -Multiplier les parcs publics;
- Privilégier un système de transport en commun accessible;
- Faire valoir le co-voiturage;
- Développer des réseaux de pistes cyclables.
Principe #7: Des plaisirs pour mieux vivre...
Nous voulons une société où chaque personne, autonome, a droit et accès à la culture, aux divertissements, aux loisirs, bref, aux petits plaisirs de la vie. S'éclater pour son propre épanouissement... mais dans le respect d'autrui.
La société doit rendre les loisirs et la culture accessibles à tous et à toutes.
L'État doit tenir compte des populations plus pauvres afin qu'elles puissent aussi profiter des loisirs et de la culture.
Par exemple, l'État devra:
- Élargir les possibilités et l'accès aux loisirs et vacances;
- Subventionner davantage la culture et les loisirs;
- Valoriser la culture des milieux populaires;
- Diminuer le coût d'accès aux bibliothèques;
- Permettre aux personnes à faible revenu de bénéficier de tarifs réduits;
- Rendre accessible (transport en commun) tous les lieux de villégiature pour les personnes à faible revenu.
Documents déjà parus
Volet 1: Démocratie: droit ou privilège
Volet 2: Défendre ses droits face à l'aide sociale
Volet 3: Les femmes et l'alphabétisation
Volet 4: Les médias...l'envers de la médaille
Volet 5: Nos programmes sociaux: des acquis à protéger
Volet 6: Pouvoir de...pouvoir sur...
Volet 7: Le tabagisme
Volet 8: Le théâtre: pratique alternative en alphabétisation populaire
À paraître:
Volet 9: Alimentation Santé-gorgée
En vente à
[Voir l'image pleine grandeur]

COMSEP
Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire
749, rue St-Maurice,
Trois-Rivières (Québec) G9A 3P5
Téléphone: 378-6963
Crédits
Le présent document constitue le huitième volet d'une série portant sur des pratiques de conscientisation.
La réalisation de ce document a été rendue possible grâce au programme «Initiatives fédérales-provinciales conjointes en alphabétisation» du Secrétariat d'État à l'alphabétisation.
L'équipe de COMSEP qui a participé à la conception de la démarche, à la création des outils pédagogiques et à la rédaction du présent document était composée de
Danielle Forest
Marie-Josée Tardif
Le comité de lecture était composé de
Denise Carbonneau
Manon Claveau
Sylvie Lafond
Lise St-Germain
Sylvie Tardif
Nous tenons à souligner l'apport précieux
des participants et participantes,
des musiciens
et de Louise Loranger, stagiaire.
Un merci spécial à Adalbert Couture pour la prise des photos, à Créacom pour le graphisme, à Karine Beaulieu pour la mise en pages et à Louis Ménard pour la correction du document.
L'équipe de COMSEP