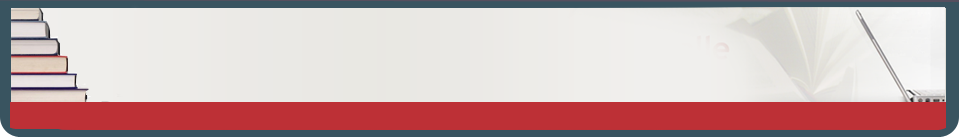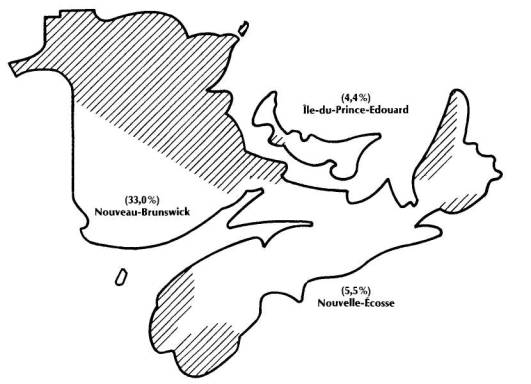Anglophones/Francophones |
|||
|
Université de Moncton |
166/3862 |
soit |
4,2% anglophone |
|
Université Sainte-Anne |
82/76 |
soit |
52,0% anglophone |
|
University of New Brunswick |
6790/348 |
soit |
5,1% francophone |
|
Saint Thomas University |
1174/39 |
soit |
3,3% francophone |
|
Mount Allison University |
1696/10 |
soit |
0,5% francophone |
TABLEAU II : Les institutions postsecondaires
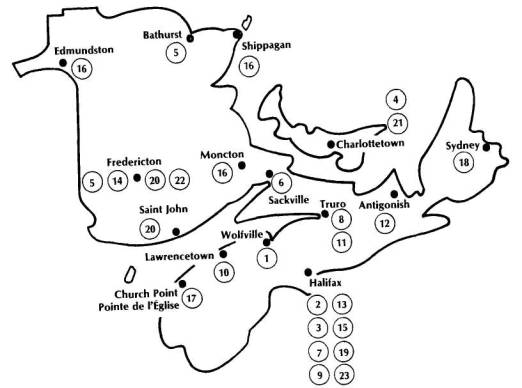
Légende:
- Acadia University
- Atlantic School of Theology
- Dalhousie University
- Holland College
- Maritime Forest Ranger School (Fredericton & Bathurst)
- Mount Allison University
- Mount St. Vincent University
- Nova Scotia Agricultural College
- Nova Scotia College of Art & Design
- Nova Scotia Land Survey Institute
- Nova Scotia Teachers College
- St. Francis Xavier University
- Saint Mary's University
- St. Thomas University
- Technical University of Nova Scotia
- Université de Moncton (Moncton, Edmunston & Shippagan)
- Université Sainte-Anne
- University College of Cape Breton
- University of King's College
- University of New Brunswick (Fredericton & Saint John)
- University of Prince Edward Island
- New Brunswick Community College/college communautaire du NouveauBrunswick (Head Office/Siège social) Campuses/Campus: Bathurst, Campbellton, Edmunston, Grand Falls/Grand Sault, Moncton, Saint John & Woodstock
- Nova Scotia Institute of Technology
TABLEAU III : Programmes du 2e cycle actuels et projetés dans les Maritimes |
|||
Programmes |
en anglais |
Actuels en français |
Projetés pour la période 84-87 |
|
Éducation |
|
|
|
|
Éducation |
X |
X |
|
|
Éducation physique |
X |
|
X |
|
Arts visuels |
|
|
|
|
Arts visuels |
X |
|
|
|
Humanités |
|
|
|
|
Études classiques |
X |
|
|
|
Langues modernes et litt. |
X |
|
|
|
Littérature comparée |
|
|
X |
|
Anglais |
X |
|
|
|
Français |
X |
X |
|
|
Histoire et études régionales |
X |
X |
|
|
Philosophie |
X |
X(tp) |
X |
|
Sciences bibliothécaires |
X |
|
|
|
Théologie |
X |
|
|
|
Sciences sociales |
|
|
|
|
Anthropologie |
X |
|
|
|
Études acadiennes |
|
|
X |
|
MAA |
X |
X |
XXX |
|
MAP |
X |
X |
|
|
Économique |
X |
X |
|
|
Droit |
X |
|
|
|
Environnement |
X |
|
X |
|
Science politique |
X |
|
|
|
Psychologie |
X |
X |
|
|
Services sociaux |
X |
Q |
X |
|
Sociologie |
X |
|
|
|
Sciences agricoles/biologiques |
|
|
|
|
Biochimie |
X |
|
X |
|
Biologie |
X |
X |
|
|
Sciences ménagères |
|
X |
|
|
Science des vivres |
X |
|
|
|
Professions de la santé |
|
|
|
|
Art dentaire |
X |
|
|
|
Sciences médicales |
X |
|
|
|
Pharmacie |
X |
|
|
|
Sciences infirmières |
X |
|
|
|
Audiologie et orthophonie |
X |
Q |
|
|
Génie et sciences appliquées |
|
|
|
|
Architecture |
X |
|
|
|
Génie |
X |
X |
|
|
Sciences forestières |
X |
|
|
|
Mathématiques/Sciences physiques |
|
|
|
|
Informatique |
X |
|
|
|
Mathématique |
X |
|
|
|
Chimie |
X |
X |
|
|
Géologie |
X |
|
|
|
Physique |
X |
X |
|
|
Nota Bene: Q signifie programme disponible par l'entente Québec- N.-B. |
|||
TABLEAU IV |
||||||||||||||||
|
Programmes contingentés |
||||||||||||||||
|
Historique des inscriptions des étudiants du Nouveau-Brunswick au Québec |
||||||||||||||||
|
Discipline |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
|
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
|
Médecine |
11 |
16 |
22 |
34 |
33 |
19 |
19 |
22 |
23 |
24 |
29 |
35 |
38 |
43 |
49 |
53 |
|
Art dentaire |
|
|
|
|
|
15 |
17 |
18 |
21 |
19 |
19 |
21 |
19 |
14 |
14 |
9 |
|
Médecine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vétérinaire |
|
|
|
|
|
2 |
4 |
6 |
7 |
7 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
7 |
|
Pharmacie |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
12 |
11 |
10 |
9 |
10 |
12 |
15 |
13 |
12 |
|
Hygiène |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dentaire |
|
|
|
|
|
- |
- |
1 |
- |
1 |
- |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
|
Service |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
social |
|
|
|
|
|
2 |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Génie agricole |
|
|
|
|
|
6 |
18 |
21 |
15 |
7 |
10 |
6 |
3 |
- |
3 |
3 |
|
Audiologie/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
orthophonie |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
|
Ergothérapie |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
5 |
7 |
8 |
|
Physiothérapie |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
3 |
7 |
8 |
8 |
|
Optométrie |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
6 |
8 |
6 |
|
Total |
11 |
16 |
22 |
34 |
33 |
45 |
65 |
80 |
78 |
68 |
72 |
84 |
89 |
% |
113 |
112 |
|
TABLEAU V |
|||||
|
Inscriptions en génie |
|||||
|
|
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
|
University of New Brunswick |
|||||
|
Total |
1054 |
1164 |
1261 |
1269 |
1297 |
|
Francophone |
104 |
106 |
106 |
107 |
98 |
|
Université de Moncton |
|||||
|
Total |
165 |
192 |
211 |
235 |
221 |
|
Anglophone |
0 |
2 |
3 |
2 |
1 |
|
TABLEAU VI |
||||||
|
Inscriptions en informatique (1er cycle) |
||||||
|
|
|
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
|
University of New Brunswick |
||||||
|
Total |
|
269 |
343 |
444 |
463 |
514 |
|
Francophone |
|
24 |
36 |
35 |
43 |
41 |
|
Université de Moncton |
||||||
|
Total |
|
0 |
80 |
138 |
185 |
161 |
|
Anglophone |
|
0 |
2 |
5 |
5 |
6 |
|
TABLEAU VII |
|||||||||||
|
Inscriptions en droit |
|||||||||||
|
|
1971 |
1974 |
1975 1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
|
1972 |
1975 |
1976 1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
|
|
University of New Brunswick |
|||||||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
223 |
211 |
201 |
197 |
197 |
|
Francophone |
16-19 |
18 |
9 5 |
4 |
1 |
2 |
8 |
7 |
7 |
5 |
4 |
|
Université de Moncton |
|
|
|
|
|
|
59 |
60 |
48 |
58 |
64 |
|
Total |
|
|
|
|
|
|
67 |
72 |
62 |
69 |
73 |
|
Anglophone |
|
|
|
|
|
|
8 |
12 |
14 |
11 |
9 |
|
TABLEAU VIII |
|||||
|
Inscriptions en sciences forestières |
|||||
|
|
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
|
University of New Brunswick |
|||||
|
Total |
291 |
273 |
287 |
264 |
231 |
|
Francophone |
8 |
10 |
10 |
8 |
12 |
|
TABLEAU IX |
|||||||||||
|
Demandes d'admission par des étudiants francophones aux programmes d'instruction juridique offerts par les établissements des Maritimes: |
|||||||||||
|
|
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
|
|
University of New Brunswick |
20 |
29 |
31 |
31 |
N/A |
33* |
31 |
14 |
10 |
17 |
|
|
Université de Moncton |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
102 |
72 |
|
|
Dalhousie University |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
Étudiants francophones admis aux programmes d'instruction juridique dans les Maritimes: |
|
||||||||||
|
University of New Brunswick |
16 |
19 |
19 |
18 |
N/A |
9* |
5 |
4 |
1 |
2 |
|
|
Université de Moncton |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
61 |
43 |
|
|
(inscrits) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(31) |
(34) |
(29) |
|
Dalhousie University |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
*Au cours de l'année académique 1976-77, l'University of New Brunswick a offert des cours en langue française. |
|||||||||||
L'impact négatif de l'arrivée des élèves d'immersion
par Claire Beauchemin
À titre de commentatrice, je veux aborder l'un des points soulevés par monsieur Schweiger, à savoir l'impact de l'arrivée des premiers diplômés des écoles d'immersion dans les programmes universitaires en langue française.
Parmi les participants à ce colloque, certains s'intéressent principalement aux étudiants de l'école d'immersion, d'autres aux étudiants francophones de langue maternelle française3, tandis que d'autres se préoccupent davantage de l'aspect administratif de l'intégration des «immergés» dans les programmes universitaires destinés aux francophones. Par ailleurs, la province d'origine des participants, et plus précisément le caractère linguistique de leur institution, conjugué à la force démographique respective des deux groupes linguistiques qui la fréquentent, rendent compte de réalités différentes perçues et vécues par chacun. Conséquemment, les perspectives diffèrent en fonction de ces éléments.
Je tiens donc à préciser que la perspective que j'adopte se rapporte spécifiquement à l'épanouissement culturel et linguistique des francophones au sein des institutions bilingues de l'Ontario: mes commentaires se limitent à cette réalité.
J'avouerai dès maintenant que je partage l'hésitation dont parlait monsieur Schweiger devant l'intégration pure et simple des «immergés» dans les cours universitaires créés à l'intention des francophones. On sait qu'en Ontario, le nombre d'élèves inscrits aux écoles d'immersion s'avère très important et même, qu'il va croissant. Présentement, ce nombre équivaut à celui des élèves inscrits dans les écoles de langue française. Bien sûr, nous devons nous réjouir à l'idée que les anglophones apprennent le français. Cependant, cette constatation doit être présente à l'esprit dans l'étude de la question qui nous préoccupe. Il me paraît essentiel que les francophones se penchent sur certains résultats de recherche en rapport avec la performance des «immergés», afin que leur intégration éventuelle se réalise en tenant compte des conséquences qui en résulteront inévitablement.
La question doit être abordée à deux niveaux, à savoir l'impact quantitatif et l'impact qualitatif de l'intégration des «immergés» aux cours et aux programmes en français.
On peut concevoir de grands avantages à l'idée que les élèves des écoles d'immersion vont s'inscrire aux programmes en français offerts par les universités bilingues de l'Ontario. En effet, un nombre plus grand d'étudiants permettra d'offrir plus de cours en français car la gamme de cours offerts est en fonction des effectifs. En sciences par exemple, on peut concevoir que tout le programme, et non seulement un nombre limité de cours, pourra être offert grâce à l'arrivée des «immergés».
Cependant, cet avantage quantitatif doitil constituer notre seul guide dans l'étude du problème? L'épanouissement de l'éducation postsecondaire de la minorité francoontarienne doit-il être dépendant de la venue des anglophones des cours d'immersion?
À mon avis, l'impact quantitatif comporte des limites: on ne saurait préconiser l'intégration pure et simple des «immergés» sans tenir compte de l'impact qualitatif d'une telle mesure auprès des francophones.
On peut se demander si les étudiants issus des écoles d'immersion ont une compétence linguistique équivalente à celle des francophones, ainsi que l'affirment assez souvent certains adeptes de l'immersion. Selon Richmond (1984), même si ces étudiants «ont tendance à se croire parfaitement bilingues» (p. 114), ceux-ci ne ressemblent guère aux superétudiants que l'on croyait former par le biais des écoles d'immersion. Un nombre croissant de recherches corroborent ce point de vue. À l'appui, je rappellerai quelques résultats de recherche.* Richmond (1984) a comparé les résultats au test de classement chez trois groupes: 1) les anglophones ayant suivi un programme traditionnel, 2) les anglophones ayant suivi un programme d'immersion et 3) les francophones:
«(...) les résultats du groupe d'immersion (...) se trouvent bien plus proches de ceux du groupe traditionnel que de ceux des francophones. Ces mêmes résultats se répètent aussi au niveau de chacun des sous-tests», (p. 114)
Puis il ajoute que «les anciens des programmes d'immersion ont un avantage assez fort sur le groupe traditionnel, bien qu'ils se situent assez loin du niveau linguistique des francophones» (p. 114). Je renvois les lecteurs qui s'intéressent à l'article de l'auteur. Il suffit de dire ici que le mythe selon lequel les étudiants issus des écoles d'immersion possèdent une compétence en français équivalente et même parfois supérieure à celle des francophones n'a que peu de fondement. D'autres chercheurs (Baetens-Beardsmore, 1982; Mougeon, Heller, Beniak et Canale, 1984; Harley, 1984; Swain et Lapkin, 1984; etc.) ont également signalé les limites de l'immersion. À cet effet, le linguiste G. Bibeau (1984) écrivait: «L'immersion (...) a beaucoup promis, (elle) a beaucoup donné, mais (elle) n'a pas permis de rendre les enfants aussi bilingues qu'on l'espérait.» (p. 114).
Comment expliquer cette situation? Il semblerait qu'après avoir atteint le stade de l'apprentissage de la langue qui leur permet de se faire comprendre par leur enseignant et par les autres élèves, les «immergés» ne cherchent pas à atteindre un seuil de compétence comparable à celui des francophones, faute de motivation sociale suffisamment forte: la valeur instrumentale de la langue semble suffire dans la majorité des cas.
Il est également intéressant de s'arrêter sur le comportement langagier du professeur qui enseigne à des étudiants éprouvant des difficultés linguistiques. Dans une expérience d'apprentissage de la langue seconde à l'université, par le truchement de l'enseignement d'une discipline, soit la psychologie, on a constaté (à l'examen du cours enregistré sur ruban magnétoscopique et à l'aide d'autres données) que le professeur ajustait automatiquement sa langue à celle de ses étudiants, afin de leur faciliter la transmission du contenu du cours (voir Edwards, Wesche et al. 1984). Or, si les «immergés» se trouvaient intégrés au groupe des étudiants francophones au sein des mêmes cours universitaires, cette adaptation, voire simplification artificielle de la langue du professeur, ne se produirait-elle pas tout autant? Les francophones alors souffriraient inévitablement de cet appauvrissement linguistique.
Mougeon, Heller, Beniak et Canale (1984) ont comparé la compétence linguistique de trois groupes d'élèves franco-ontariens à savoir 1) les franco-dominants, lesquels communiquent souvent ou toujours en français au foyer, 2) les anglo-dominants, lesquels communiquent souvent ou toujours en anglais au foyer et 3) les bilingues, lesquels communiquent aussi souvent, ou presque aussi souvent, dans une langue que dans l'autre. Par ailleurs, ces auteurs citent quatre études4 dans lesquelles on a comparé le français parlé des élèves francophones à celui des élèves d'immersion et ils affirment que: «Dans les quatre cas, on a pu constater qu'à niveau de scolarité égal, les élèves d'immersion commettaient plus d'erreurs que les anglo-dominants et à plus forte raison que les francodominants et les bilingues», (p. 327) Plus loin, ils ajoutent :
«(...) les enseignants sont d'avis qu'ils (les anglo-dominants) ont un effet retardant sur les franco-dominants pour ce qui est de l'apprentissage du français et des autres matières», (p. 346) Or, si les anglo-dominants on un effet retardant sur les franco-dominants, à plus forte raison les «immergés», si l'on se rappelle d'une part leur performance linguistique (voir les quatre recherches relevées par Mougeon et al.) et d'autre part, les résultats enregistrés par Richmond.
S'il est un domaine universitaire qui nécessite une protection linguistique, c'est bien celui de la formation des enseignants. Depuis quelques années, le nombre d'anglophones qui demandent (et qui obtiennent!) l'admission au programme menant au brevet d'enseignement de l'Ontario va croissant. Nous avons eu maintes fois l'occasion de constater que la qualité linguistique laisse beaucoup à désirer de même que l'engagement envers le fait francophone. Nous ne saurions nous montrer trop exigeants à l'endroit des candidats qui se destinent à l'enseignement auprès des élèves francophones dans les écoles primaires et secondaires de l'Ontario. Et que dire de la transmission des valeurs culturelles francophones... Les enseignants qui participent au projet éducatif des écoles de langue maternelle française ont comme mandat moral de faciliter l'intégration culturelle des élèves dans le milieu francoontarien. Et pour qu'ils puissent aider les élèves à s'intégrer à leur groupe linguistique minoritaire, ils doivent eux-mêmes «habiter» cette langue et cette culture.
En conclusion, j'admets que l'intégration des «immergés» peut vraisemblablement se faire dans les universités bilingues. Cependant, il faut trouver une formule qui le permette sans que les francophones en soient les victimes, comme dans les écoles mixtes de l'Ontario.
Ce qu'il faut bien comprendre des remarques que j'ai formulées au sujet de la compétence linguistique des «immergés», ce n'est pas simplement le fait qu'ils commettent des erreurs ou qu'ils soient les seuls à le faire. Les études les plus élémentaires en linguistique permettent de se rendre à l'évidence que les francophones eux aussi en commettent: il en est ainsi dans toutes les langues. Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est le fait que chez les «immergés», dont il est ici question, le français demeure une langue seconde et que ces derniers se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur langue maternelle. Or, dans un cours universitaire où les francophones se trouveraient réunis avec les anglophones, ce serait faire preuve d'un grand optimisme que de croire que la langue de communication serait le français. Dès que les étudiants seraient laissés à eux-mêmes, dans le contexte d'une institution bilingue où les francophones sont démographiquement minoritaires, la langue d'échange deviendrait l'anglais. Du reste, c'est déjà le cas présentement dans un cours qui s'adresse à des enseignants qui se destinent à l'enseignement du français en immersion.
Pouvons-nous donc fermer les yeux devant les conséquences que subiraient inévitablement les francophones dans leur milieu universitaire? L'épanouissement culturel et linguistique des Franco-Ontariens pourrait-il être favorisé par l'intégration des «immergés» aux cours universitaires en français? Permettez-moi d'en douter. Devonsnous, en tant que groupe linguistique minoritaire, accepter cette mesure comme solution à l'élargissement de la gamme des cours et des programmes en français? Je ne le crois pas. Je suis plutôt d'avis que des programmes d'accès à l'égalité doivent être mis sur pied, afin de corriger les lacunes du passé et de promouvoir la qualité de l'éducation universitaire des Franco-Ontariens.
Appendice
Références
BAETENS-BEARDSMORE, H. Bilingualism : Basic Principles. Clevedon, Avon: Tieto Ltd., 1982.
BENIAK, E. MOUGEON, R. et CANALE, M. Compléments infinitifs des verbes de mouvement en français ontarien, dans Linguistische Berichte, vol. 64, 1979, pp. 34-49.
BENIAK, E. MOUGEON, R. et COTÉ, N. Acquisition of French Pronominal Verbs by Groups of Young Monolingual and Bilingual Canadian Students, dans The Sixth Lacus Forum, sous la direction de J. Copeland et P. Davis. Columbia, South Carolina: Hornbeam Press, 1980.
BIBEAU, G. Tout ce qui brille..., dans Langue et Soc/été, No. 12, 1984, pp. 46-49.
CANALE, M., MOUGEON, R. et BENIAK, E. «Acquisition of some Grammatical Elements in English and French by Monolingual and Bilingual Canadian Students», dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 34, no. 3, 1978, pp. 505-524.
EDWARDS, H., WESCHE, M., KRASHEN, S., CLÉMENT, R. et KRUIDENIER, B. Second Language Acquisition Through SubjectMatter Learning: A Study of Sheltered Psychology Classes at the University of Ottawa, dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 41, No. 2, 1984, pp. 268-282.
HARLEY, B. Mais apprennent-ils vraiment le français? dans Langue et Soc/été, No. 12, 1984, pp. 57-63.
MOUGEON, R., HELLER, M., BENIAK, E. et CANALE, M. Acquisition et enseignement du français en situation minoritaire : le cas des Franco-Ontariens, dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 41, No. 2,1984, pp. 315-335.
RICHMOND, J. «Superétudiants ou superproblème?», dans La Revue de l'Université Laurentienne, vol. 17, No. 1, 1984, pp. 113-119.
SWAIN, M. et LAPKIN, S. Evaluating Bilingual Education : A Canadian Case Study, Clevedon, Avon: Multilingual Matters Ltd., 1982.
L 'engagement «français» des élèves de l'immersion n'est pas de la frime
par Janice Sargent
J'ai le plaisir de représenter devant vous une association nationale de parents, Canadian Parents for French, dont le but est de promouvoir, à travers le Canada, l'étude du français comme langue seconde.
La F.F.H.Q. et notre association se sont déjà mis d'accord l'année dernière pour signer une entente afin de promouvoir l'étude du français, à tous les niveaux scolaires, au Canada.
Canadian Parents for French est une organisation qui fut fondée en 1977 par un groupe de 35 parents; elle compte aujourd'hui plus de 7,000 familles membres. Elle a appuyé, dans toutes les provinces du Canada, l'enseignement aux enfants du français, langue seconde. L'énorme succès du phénomène de l'immersion est dû en bonne partie aux efforts de cette association à travers le pays, aux niveaux local et provincial.
Récemment, Canadian Parents for French s'est intéressé en particulier aux études postsecondaires. Ici à Ottawa, par exemple, M. Russ McGillivray, éducateur bien connu de la région, a effectué pour notre chapitre local du CPF un sondage auprès des étudiants en immersion du niveau secondaire (11e et 12e années), pour préciser les attentes de ces élèves dans la perspective d'études universitaires. Plus de la moitié des répondants ont dit qu'ils voudraient continuer à maintenir leur langue seconde, ou à poursuivre, au moins en partie, leurs études en français au niveau universitaire.
Ces élèves reconnaissent qu'ils ont besoin de suivre des cours dans leur deuxième langue s'ils veulent devenir vraiment bilingues. Tandis qu'ils sont, d'après l'étude de M. McGillivray, confiants de pouvoir parler et de comprendre le français à la sortie du secondaire, ils ont moins confiance en leur capacité de «l'écrit et de la grammaire».
L'idée que ces étudiants puissent, au niveau universitaire, suivre des cours offerts en français dans leur domaine choisi revêt néanmoins beaucoup d'attrait. Mais ils hésitent, étant donné leurs «carences» dans leur langue seconde, à faire des études universitaires entièrement en français.
Les universités pourront-elles s'adapter à ce nouveau groupe? Voudront-elles, par exemple, et comme le fait déjà l'Université d'Ottawa, offrir la possibilité de suivre des cours en français mais d'écrire, si on le préfère, les examens en anglais? Offriront-elles des programmes vraiment bilingues, c'est-àdire où on aurait le choix, en se spécialisant dans un certain domaine, de suivre quelquesuns de ses cours dans la langue seconde tout en suivant d'autres dans sa langue première?
Les institutions universitaires anglophones auront à s'adapter autant - et même plus - que celles de langue française, et devraient faire un effort non seulement pour accueillir les diplômés des cours d'immersion, mais aussi pour attirer des étudiants francophones qui voudraient éventuellement poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution de langue anglaise, tout en conservant leur langue maternelle.
Même au niveau élémentaire en Ontario, les chercheurs ont noté chez les enfants en immersion, une plus grande tolérance envers
les minorités, et une plus grande estime des différents groupes linguistiques et culturels qui forment notre grand pays. À mon avis, il y aurait grand intérêt à consolider nos gains, tout en respectant les différences entre les deux grands groupes culturels du Canada. On doit travailler d'un commun accord à l'amélioration des services éducatifs en français pour tous les jeunes Canadiens, afin d'offrir des services bilingues au public dans nos communautés locales.
Résumé de la discussion
Répondant à la prise de position de madame Beauchemin, certains participants à cet atelier affirment que peu importe les dangers (qu'on peut toujours amoindrir, à leur avis), l'admission des étudiants anglophones des cours d'immersion dans les institutions francophones est nécessaire pour deux raisons: d'abord, ils permettent d'augmenter les effectifs des étudiants, surtout dans l'ouest canadien où le nombre d'étudiants de langue française est peu élevé; ensuite, il est sain que deux langues et deux cultures s'interinfluencent. Les professeurs André Obadia, de l'Université Simon Fraser, et Bernard St-Jacques, de l'Université de Colombie-Britannique, estiment d'ailleurs à cet égard que les études citées par madame Beauchemin ne disent pas tout.
Dans la discussion et l'échange animé qui suivit, on fit valoir que l'on ne peut s'opposer, dans un système de libertés politiques et sociales comme le nôtre, à ce que des gens «bien intentionnés» dans leur désir d'apprentissage de la langue et de la culture de langue française, soient admis dans nos institutions. On devrait cependant s'assurer que leur intégration s'effectue de façon à respecter les valeurs et la culture des étudiants de langue maternelle française.
On souligne également que des études sont en cours, à la Faculté d'éducation, de l'Université d'Ottawa, sur la compétence linguistique des étudiants anglophones ayant suivi le cours d'immersion en français. Le rapport du groupe de travail chargé de cette recherche est prévu pour juin 1986. Il devrait apporter plus de lumière sur la question.
Enfin, il a été mentionné qu'on a noté - ailleurs que dans les endroits où ont été effectuées les études citées par madame Beauchemin - que le français parlé d'un bon nombre d'anglophones était,dans bien des cas, fort acceptable. C'est pourquoi on a besoin d'études plus fouillées, comparant les milieux, les institutions et les individus.
B- Les programmes collégiaux
Cet atelier visait à effectuer une réflexion sur l'intégration (possible, souhaitable?) des programmes des collèges et de ceux du ministère de l'Emploi et de l'Immigration. Les participants ont eu à se pencher sur une question d'importance: la formation, reliée à l'ensemble des emplois disponibles sur le marché, est-elle possible?
Madame Adrienne McLaughlin, viceprésidente à l'enseignement au Collège Algonquin, dresse la liste des programmes et ententes possibles entre les collèges communautaires. Elle fait état des progrès accomplis récemment et souligne qu'il s'agit d'un dossier chaud à la direction concernée au ministère de l'Emploi.
Monsieur Gérard Raymond, directeur de l'Institut de technologie de Bathurst, note que le S.P.P.C. (Système de protection des professions au Canada) constitue un outil important pour connaître l'offre et la demande de main d'oeuvre malgré le fait que ce système comporte parfois des retards de dix mois.
Quant à M. Alcide Gour, doyen au Collège Cambrian de Sudbury, il estime que les collèges communautaires devront faire preuve de plus de flexibilité et devront offrir dorénavant des programmes donnant accès à des emplois vraiment disponibles. Il ajoute que l'aide de l'entreprise privée sera nécessaire si l'on veut adapter les programmes aux changements du milieu.
De nouveaux défis
par Adrienne McLaughlin
Introduction
Le rapport Apprendre à gagner sa vie au Canada nous souligne que: «Tandis que le Canada marche à grands pas vers les progrès technologiques, l'une des infrastructures les plus importantes, l'éducation, court de graves dangers.»
D'après ce rapport, le système de travail va changer, les aptitudes actuelles seront moins en demande et de nouvelles aptitudes verront le jour de plus en plus rapidement. «Les aptitudes acquises pendant la jeunesse ne restent sans doute pas valables pendant toute la vie» nous dit-on. Le recyclage, le perfectionnement et la mise à jour deviendront des éléments inhérents à la vie.
Nous savons aussi que des boulversements surviendront dans le marché du travail. Le nombre d'emplois diminuera sensiblement dans le secteur de la fabrication; il diminuera légèrement dans celui de l'agriculture; il augmentera considérablement dans celui des services. Cinquante pour cent des emplois du secteur des services seront liés à la collecte de renseignements, à la gestion et à la diffusion de l'information.
On prévoit qu'en l'an 2000, 75% des «unités» familiales auront deux revenus et tous les quatre ou cinq ans, l'un des partenaires cherchera à acquérir de nouvelles connaissances et compétences, rendues nécessaires par les progrès technologiques et les changements du marché de l'emploi.
Un autre rapport intitulé Apprendre: un défi pour la vie, publié en mars 1984, recommande, entre autres, les mesures suivantes: le congé-éducation payé; le soutien aux personnes défavorisées en matière d'éducation; la levée des obstacles à l'éducation des
adultes; la création de postes de délégués à l'éducation dans les milieux de travail; la création de conseils locaux de formation.
1) Impact des changements
Je voudrais vous communiquer mes impressions sur l'incidence que tous ces changements auront sur les collèges communautaires, et voir avec vous comment nous pouvons faire face à ce nouveau défi.
Disons tout d'abord que les collèges communautaires, relativement jeunes, ne sont pas encore devenus trop rigides ni trop structurés. Ils sont en bonne position pour faire face à ces changements. Voici comment j'envisage ces changements.
Un nombre croissant d'adultes chercheront à s'instruire, afin d'acquérir de nouvelles compétences. La formation de base, c'est-àdire apprendre à lire, à écrire, à compter, à communiquer et à résoudre des problèmes, prendra une importance primordiale pour que la personne puisse par la suite avoir accès à la formation à divers moments de sa vie et dans diverses circonstances.
Il faudra réorganiser et restructurer les programmes d'éducation pour les adapter aux besoins et aux modes d'apprentissage des adultes qui auront besoin de recyclage. Les programmes d'éducation devront être variés, tant au niveau des modes d'enseignement que des locaux, pour répondre aux besoins des étudiants adultes qui n'ont pas toujours la possibilité de se rendre dans un établissement donné, ou pour lesquels l'établissement ne possède pas les installations ou l'équipement nécessaire et aussi pour promouvoir le concept de formation et d'éducation continue.
L'horaire des cours devra être modifié pour répondre aux besoins d'une nouvelle clientèle qu'on ne peut intégrer dans l'horaire courant de 9 à 17 heures. Notre conception de l'étudiant doit changer: de l'être plutôt passif qui ne faisait que gober des données, il devient un participant actif qui doit se soumettre à un apprentissage permanent, étalé sur toute sa vie, afin d'acquérir diverses compétences qui lui permettront de survivre dans un milieu complexe. Autrefois, les étudiants étaient des élèves à court terme; leur programme d'études s'étalait sur une période relativement courte, alors que leur formation devait durer toute leur vie (carrière). Aujourd'hui, les étudiants sont plutôt des élèves à long terme; ce sont des employés qui ont des besoins d'apprentissage permanents ou supplémentaires liés directement à leur travail.
Le rôle du professeur doit également changer. Lui qui était une source d'information et de connaissances sera désormais chargé de motiver et de conseiller l'étudiant; de l'aider à établir et à atteindre ses objectifs, en déterminant et en organisant les activités d'apprentissage dont il a besoin. Les ressources devront être affectées à des activités telles que le perfectionnement et l'adaptation des programmes d'études existants; l'établissement de nouvelles méthodes d'enseignement; la création de nouveaux programmes; la coordination des activités scolaires avec celles du secteur privé, afin de procurer aux étudiants une expérience de travail sérieuse et valable; et la mise au point de services de soutien essentiels, sans lesquels la participation de l'étudiant adulte risque d'être compromise (exemples: allocations pour déplacements, frais de garde...)
Les collèges communautaires de l'Ontario peuvent-ils relever ces défis? Je crois que oui. En fait, ils ont déjà un bon nombre de caractéristiques qui pourraient, si on les exploite adéquatement, fort bien répondre aux besoins nouveaux en matière d'éducation. Ces caractéristiques sont les suivantes: - parmi les 22 collèges de l'Ontario, il y en a 6, bien répartis à travers la province, qui permettent aux étudiants du secondaire et aux adultes d'avoir accès à cet enseignement en français;
- La collection impressionnante de programmes, tant généraux que spécialisés, qu'il est possible de modifier et d'adapter aux besoins: changements du milieu de travail et d'une clientèle faite d'adultes et de jeunes;
- Une relation bien établie avec le monde de l'industrie;
- Un mécanisme de mise au point et de prestation de programmes (faits sur mesure) pour répondre aux besoins précis de l'industrie;
- Un système d'éducation permanente très réussi, axé sur les besoins des adultes;
- Un système de services de soutien souple: orientation professionnelle, aide financière, centres de documentation;
- Une expérience assez étendue et fructueuse dans le domaine des stages, de l'expérience de travail et de la formation en utilisant un modèle d'éducation coopérative;
- De nombreux contacts et ressources dans la collectivité par l'intermédiaire des comités consultatifs sur les programmes;
- Une longue et heureuse expérience de coopération avec l'industrie et les conseils locaux de formation dans la mise sur pied de programmes de formation tels que les programmes f.c.i, et o.e.p.o.;
- Un milieu attrayant pour l'étudiant adulte grâce à la variété des activités, à la diversité de la population étudiante et à l'accent placé sur l'acquisition d'habiletés axées directement sur le milieu de travail;
- La compétence et la réussite de nombreux collèges dans la prestation d'activités éducatives à divers endroits de la collectivité (plutôt qu'à un campus donné).
2) De nouvelles voies
Je voudrais formuler quelques recommandations visant à assurer un soutien aux collèges communautaires dans leurs efforts de réponse aux nouveau défis.
Dans la subvention qui leur est accordée, les collèges devraient recevoir des fonds destinés à des activités de création: création de nouveaux modes d'enseignement (plus souples et moins dépendants des limites d'espace et de temps); création de méthodes d'apprentissage individualisées; créations de nouveaux programmes.
Les nombreux programmes de formation existants, tels que les cours préparatoires à la formation professionnelle (C.P.F.P.), la préparation fondamentale à l'emploi (P.F.E.), la préparation élémentaire à un emploi (P.F.E.) et le programme de formation technique (P.F.T.) devraient être réunis en un seul programme de formation à l'emploi.
Ce programme serait réparti en modules et serait basé sur les aptitudes à compter, à lire, à écrire, à communiquer, à résoudre des problèmes. Pour chacun des modules, on mettrait au point des unités d'apprentissage que les étudiants pourraient utiliser par euxmêmes. Ces modules seraient adaptés à l'enseignement à distance, pouvant tirer profit de différents supports, par exemple les télécommunications.
Un module centré sur les aptitudes nécessaires à la carrière deviendrait partie intégrante du programme, afin de permettre à l'étudiant adulte de planifier une formation ultérieure ou à celui qui n'a pas encore fait de choix. L'admission au programme se ferait à intervalles réguliers pendant l'année ou même continuellement.
L'étudiant pourraient avancer à son propre rythme, dans une limite de temps globale. On instaurerait un système d'exemptions pour divers modules, afin que soient reconnues les connaissances déjà acquises à l'école ou par l'expérience de vie.
Les programmes d'études centrés sur les aptitudes à acquérir en vue de carrières précises, tels que les cours de techniques du génie électronique, de montage électronique de précision, d'opération de microordinateurs et de programmation d'ordinateurs devraient être également offerts par modules, comprendre seulement des cours ayant trait aux aptitudes à acquérir et une certaine expérience de travail, être offerts là où réside le besoin de main d'oeuvre, être offerts de façon rationnelle à travers la province, afin d'éviter le chevauchement et le double emploi et, admettre des étudiants fréquemment au cours de l'année, et même continuellement.
Dans ce cas également, ils devraient permettre à l'étudiant d'avancer à son propre rythme dans une limite de temps globale et pourraient aussi comporter un système d'exemptions pour divers modules, afin que soient reconnues les connaissances déjà acquises, à l'école ou par l'expérience de vie.
Le ministère pourrait mettre au point un mécanisme de financement qui reconnaîtrait la valeur éducative et le coût des composantes de programme telles que la formation, en utilisant le modèle d'éducation coopératif, l'expérience de travail, etc.; les établissements d'enseignement administreraient les fonds reçus et les redistribueraient aux organismes et aux industries chargés de fournir l'expérience. Les ministères provinciaux et fédéraux devraient reconnaître, dans leur financement, que les programmes et services (faits sur mesure) offerts aux adultes entraînent un accroissement de services individualisés et, par conséquent, un besoin de ressources supplémentaires.
Il faudrait éclaircir le mandat des deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, afin que les ressources disponibles soient utilisées de façon complémentaire (O.E.P.O., Accès Carrière). Grâce à un financement spécial, les programmes postsecondaires, quelle que soit leur durée, pourraient être offerts aux adultes qui ont besoin de recyclage. Quatre ou cinq projets pilotes pourraient être financés en vue de mettre au point l'enseignement à distance de programmes ou de modules choisis, à l'aide de divers supports technologiques tels que les télécommunications, l'ordinateur, la correspondance, le satellite.
Les collèges devraient établir des mécanismes de communication avec les délégués à l'éducation que l'on se propose de nommer sur les lieux de travail.
Pour garder leur emploi, les enseignants des collèges communautaires devraient se recycler en connaissances techniques en retournant dans le monde de l'industrie. Les collèges pourraient établir des programmes d'échange entre les professeurs et les spécialistes de l'industrie, afin de se tenir à jour.
Conclusion
J'affirme que nous pouvons relever les nombreux défis qui nous attendent. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir comment nous reconnaîtrons les compétences dont auront besoin les jeunes gens et les adultes de l'an 2010.
On doit cependant se demander si l'on devrait procéder en identifiant les besoins d'abord, la clientèle ensuite.
Cela va mieux, mais tout n'est pas parfait
par Gérard Raymond
Tout d'abord, je dois être d'accord, de façon générale, avec la présentation de madame McLaughlin. J'aimerais cependant soulever la question de disponibilité des emplois versus la formation sous un autre angle.
Je voudrais mentionner que le système de projection des professions au Canada (S.P.P.C.) est un outil important et constitue une bonne estimation de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre. Les projections du S.P.P.C. sont basées sur l'information provenant du monde des affaires, des milieux financiers, des gouvernements, des maisons d'enseignement, des entreprises, des syndicats et autres organismes.
Certaines difficultés sont éprouvées actuellement au niveau du S.P.P.C.; lorsque l'information est compilée, il est parfois déjà tard. En fait, dans plusieurs cas, 9 à 10 mois de formation se sont écoulés.
Pour les francophones, ça veut dire quoi? Et bien d'abord, les anglophones sont plus nombreux que nous. En grande partie, l'industrie est gérée par des anglophones. Cela rend nos chances moindres. On ne peut pas se permettre de former des francophones dans les domaines où il n'y a pas d'ouvertures. Il ne faut pas oublier que les anglophones sont plus nombreux à postuler les mêmes emplois. En conséquence, le S.P.P.C. devra être plus précis pour permettre aux francophones de minimiser les difficultés dans leur quête d'emplois.
Le S.P.P.C. manque également de coordination au niveau des renseignements. L'analyse n'est pas assez efficace et on y traite du court terme sans être assez précis en vertu du long terme. Dans certains cas, cela prend deux à trois ans pour que le gouvernement réagisse à des propositions concernant les besoins de main-d'oeuvre. Dans d'autres cas, l'influence politique joue un rôle dans la mise sur pied de certains programmes de formation, dans certaines des provinces où les francophones sont minoritaires. Cette influence, dans un contexte où nos représentants sont minoritaires, a un effet négatif sur l'équilibre formation versus les emplois disponibles pour les francophones.
Un autre facteur à considérer par rapport à cet équilibre est celui de la mobilité des employeurs. Concernant la situation économique que nous connaissons et le fait que dans plusieurs cas il y a deux revenus par famille, la mobilité est rendue plus difficile. Cela limite l'avancement ou les chances d'emplois.
Dans certaines provinces, l'industrie se retrouve dans des localités à majorité anglophone. Au Nouveau-Brunswick par exemple, la concentration des industries se retrouve au sud de la province, occasionnant des analyses et des sondages qui sont influencés par ce fait. Ce facteur ne rétablit donc pas l'équilibre avec les francophones du nord.
Encore un autre facteur à considérer est celui de la rentabilité des programmes de formation. Puisque nous sommes moins nombreux, il en coûte plus cher pour mettre sur pied des programmes de formation professionnelle et technique. C'est donc un facteur qui n'avantage pas les francophones.
La situation devrait cependant s'améliorer avec la venue de la révolution de l'information. En fait, je crois que la formation reliée à l'ensemble des emplois disponibles va se réaliser. Comment? D'abord les techniques du S.P.P.C., prenant en considération les taux de croissance, les taux d'inflation, la croissance de l'emploi, les perspectives économiques, la ventilation industrielle, le nombre d'intervenants, le nombre de finissants, leur compétence, la migration des travailleurs spécialisés, vont s'améliorer par la venue de l'informatique qui deviendra de plus en plus sophistiquée et à jour.
En plus, la formation deviendra plus généralisée. Par exemple dans le secteur de l'électronique, une formation de base permetà l'étudiant d'accéder au marché du travail pour ensuite revenir se spécialiser dans le tra domaine des ordinateurs, de l'instrumentation industrielle, des communications ou de l'électronique industrielle. Avec une telle flexibilité, il deviendra plus facile d'établir l'équilibre formation versus l'ensemble des emplois disponibles sur le marché du travail.
Des transformations importantes viennent vite. En ce sens, le gouvernement fédéral avec ses nouvelles initiatives visera à promouvoir les programmes qui répondent à une activité industrielle en voie de changement. Il faut donc faire pression pour que les francophones aient accès égal à ces programmes de formation et qu'on puisse non seulement avoir nôtre part, mais maintenir nos programmes en français. Et cela même s'ils coûtent chers!
En conséquence, il faut que les francophones mettent en place le plus tôt possible des mécanismes (ou des infrastructures) qui leur permettent d'avoir accès aux emplois disponibles.
Nous devons réaliser que nous sommes à la frontière d'un virage technologique, de la révolution de l'information. Des transformations importantes dans le monde de la formation devront être perçues dans l'affirmative si l'on veut répondre aux besoins de la maind'oeuvre de l'industrie de demain. Avec ces outils de base, nous serons plus en mesure d'envisager et de répondre à la demande de main-d'oeuvre de façon efficace et équitable.
Résumé de la discussion
Les participants ne manquent pas de commenter les données présentées. Ils encouragent la Fédération des francophones hors Québec à faire pression auprès du ministère fédéral de l'Emploi et de l'Immigration afin que des cours en formation professionnelle soient accessibles aux francophones hors Québec et que des mécanismes soient prévus afin que des négociations suivies aient lieu sur des dossiers comme l'enseignement individualisé, la création d'un réseau de communications permettant de mettre en commun les ressources humaines et techniques ainsi que l'établissement de banques de données sur le matériel didactique disponible aux enseignants francophones.
On évoque aussi la nécessité d'établir un programme de recherche concerté par une sorte de consortium regroupant les institutions d'enseignement collégial fréquentées par les francophones hors Québec. On propose également de chercher, dans les plus brefs délais, à voir à la création de comités provinciaux pour assurer à la base la mise sur pied d'un tel consortium.
Quant aux programmes de formation qui existent à l'heure actuelle, il serait souhaitable qu'ils soient mis à jour, qu'ils soient mieux «vendus» quand ils connaissent un certain succès dans certaines institutions et, finalement, qu'ils permettent une meilleure et plus rapide adaptation des diplômés de langue française aux besoins du marché.
DINER-CAUSERIE
L'avenir des minorités francophones: pour le Canada, un engagement à enrichir; pour le Québec, une réconciliation indispensable
Monsieur Jean-Louis Roy, directeur, Le Devoir
À cette occasion, la F.F.H.Q. a remis son prix Painchaud-Léger au DEVOIR «pour son importante contribution à la vie des communautés francophones partout au Canada. » Depuis les origines du Canada contemporain, la question du statut des minorités francophones hors Québec a occupé et occupe toujours une place centrale dans notre vie politique.
Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Comment ces communautés minoritaires se sont-elles développées ces vingt-cinq dernières années? Quelles sont les tâches qui s'imposent pour l'avenir? C'est ce bilan que j'aimerais parcourir avec vous, actif et passif, rétroactif et prospectif.
Dans un grand nombre de secteurs, ce bilan est favorable. Dans d'autres, il est toujours tragiquement déficitaire. On doit noter que le Québec n'aura été que de peu de soutien ces dernières années, faute d'une politique engagée, cohérente et constante. Il existe des domaines comme l'enseignement postsecondaire où la province majoritairement francophone pourrait et devrait jouer un rôle constructif et bienfaiteur.
- Nous parlons du devenir de communautés minoritaires où vivent plus de trois quart de millions de personnes, ce qui représente en fait un nombre supérieur à la population de quatre provinces canadiennes.
- Nous parlons du devenir de communautés minoritaires qui, conjuguées au Québec, donne sa pleine dimension au concept et à la réalité de la dualité canadienne, concept et réalité dont on ne s'éloigne jamais sans péril dans l'aménagement de notre régime politique.
- Nous parlons d'une catégorie spécifique de la société canadienne, catégorie que reconnaît nommément et spécifiquement la loi fondamentale de notre fédération.
Politiquement et en un certain sens, juridiquement, ces minorités prises comme un ensemble et liées au Québec participent à l'une des deux majorités canadiennes.
Comment comprendre autrement et expliquer les efforts déployés depuis un quart de siècle pour renouveler notre compréhension de leur situation, notre connaissance de leurs besoins et notre appui à leur développement? Comment comprendre autrement et expliquer leur incessante recherche d'un statut qui leur permette de durer et de se développer?
L'actif que nous devons consolider et enrichir est plus significatif qu'on ne le croit généralement.
La question qui nous réunit est l'une de celles qui a le plus évolué chez-nous depuis un quart de siècle. Nous devons prendre acte de cette évolution. Il serait en effet ennuyeux au plan de la connaissance, injuste au plan intellectuel, désincarné au plan politique, de l'aborder avec une problématique vieillie et en conséquence éloignée des faits. Les acquis apparaissent substantiels.
- Un colloque comme le nôtre aurait été impensable il y a 25 ans. Si quelques esprits visionnaires s'étaient lancés alors dans une pareille aventure, la base de leurs travaux aurait été infiniment plus mince que celle qui nous sert de référence et d'appui.
- Le caractère bilingue du Canada est plus solidement établi que jamais et notamment au plan constitutionnel.
- La Loi fédérale sur les langues officielles a porté loin le changement. Elle a produit des résultats importants dans l'ensemble du pays. Mais ce qui reste à faire pour en fixer les ultimes conséquences dans les faits, les institutions et nos vies, exigera l'engagement de générations successives.
- Nos tribunaux ont raffiné les textes constitutionnels et dégagé des voies vers l'égalité linguistique. La reconnaissance par la Cour d'appel de l'Ontario du droit pour la minorité à gérer ses propres écoles en plus de créer un précédent de taille, a redressé une injustice qui minait la survie de la minorité francophone. Le jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Forest a corrigé la plus scandaleuse transgression constitutionnelle de notre histoire.
- Les droits des minorités, comme je l'ai rappelé, ont acquis une reconnaissance constitutionnelle sans précédent. La province du Nouveau-Brunswick, ce premier territoire acadien, est officiellement bilingue. Le Manitoba l'est officiellement redevenu. Vous conviendrez cependant que le siècle perdu a changé la nature des choses pour la minorité de cette province.
- De nombreuses lois provinciales ont élargi partout les structures, les services et les investissements publics.
- Tout observateur un peu impartial reconnaîtra le changement de nature qui s'est opéré au Canada dans les investissements publics pour le développement des minorités, la consolidation et l'élargissement aussi des services qui leur sont offerts. Entre 1970 et 1982, le gouvernement du Canada a investi $1,8 milliard pour l'enseignement dans la langue des minorités.
- Les technologies nouvelles ont été mises à contribution. Elles rendront possibles des entreprises jusqu'ici bloquées, le nombre étant insuffisant pour les justifier.
- L'intérêt pour la langue française continue à s'élargir. À l'échelle du pays, le nombre d'inscriptions des jeunes anglophones dans les écoles d'immersion était de150,000 pour l'année 1984-85.
Bref, la lutte constante des minorités, l'effort de modernisation du Québec et le renouvellement de la politique fédérale depuis vingt ans en matière des droits minoritaires n'ont pas été vains. Des progrès ont été accomplis, des réseaux constitués, des réflexes créés.
Voilà l'oeuvre qui doit être complétée là où elle vit déjà, amorcée là où les résistances n'ont pas encore été vaincues.
Telle est la tâche des prochaines années: parfaire et créer les institutions de la francophonie canadienne hors Québec.
Même si cet actif n'est pas négligeable, le passif demeure lourd.
- La population francophone du Canada a connu une décroissance marquée entre 1961 et 1981, de 28,1 % à 25,7%. Le pourcentage des francophones qui abandonnent la langue française dans leur vie quotidienne a connu une croissance inquiétante entre 1971 et 1981, de 29,6% à 32,8%.
- Trop souvent encore, nous sommes témoins de manifestations réprouvant le droit des francophones à l'existence.
- La participation des francophones hors Québec aux études postsecondaires est partout moins forte que celle des majorités au sein desquelles elles vivent.
De la Nouvelle-Écosse à la ColombieBritannique, la carte de la scolarisation des minorités francophones est désolante. Elle est en fait une carte du sous-développement. Le retard est partout significatif, partout révélateur aussi d'une disparité profonde et historique, d'une discrimination systématique d'une ampleur considérable, force de déclin et d'appauvrissement.
Ces structures nouvelles ne sont pas susceptibles à elles seules et partout de faire la jonction entre la culture et la vie quotidienne, de créer un niveau d'excellence, cet aimant indispensable pour attirer et retenir les clientèles, de faire contrepoids à l'immense pression de la langue et des sollicitations diverses en provenance de la force majoritaire. Si ces structures surgissaient demain sur l'ensemble du territoire , et dans des conditions favorables tant à l'est qu'à l'ouest, il nous faudrait saluer un départ bien davantage qu'un point d'arrivée. Mais, malgré ces réserves, les institutions scolaires constituent, à n'en point douter, ce minimum indispensable dont le premier effet serait de libérer les minorités d'une lutte séculaire, dont le coût est proprement inestimable. Destinées par elles, dirigées par elles, ajustées par elles, ces institutions seraient plus susceptibles de faire le plein des jeunes générations, de stopper le décrochage chronique actuel, de promouvoir le recyclage et de devenir des centres de formation permanente dont les minorités ont un si évident besoin.
Mais le scolaire n'est pas à lui seul susceptible d'assurer le développement. C'est bien dans le degré d'affinité entre le milieu scolaire et la société ambiante que se dessine la différence entre la simple survie et le développement. D'où la nécessaire complémentarité entre le réseau scolaire et d'autres réseaux, sociaux, culturels et économiques.
J'ai cherché à établir un bilan qui soit près des réalités, qui tienne compte de l'évolution réelle du pays.
Ce bilan vous est connu.
Il est insuffisant pour satisfaire aux impératifs du développement économique des minorités, pour répondre à leurs droits et par rapport aux exigences incompressibles de la dualité canadienne.
Mais comment parfaire et créer les institutions de la francophonie canadienne hors Québec?
Est-ce là une tâche possible?
Est-ce là une tâche ajustée au possible historique?
L'évolution qui s'est produite au cours des vingt-cinq dernières années justifie un optimisme limité. La force constitutionnelle, l'évolution du statut des langues, les mouvements législatifs, les investissements publics convergent. Cet ensemble d'éléments exprime et consolide une direction qui a commencé à changer le destin des minorités. La tâche doit être complétée.
Le pays pourrait-il revenir sur ces engagements? Pourrait-il devenir autre chose que ce qu'il a commencé à être après tant de
décennies d'attente et de luttes si souvent perdues?
J'estime que le pays pourrait emprunter cette voie de la régression et notamment à la faveur des questions soulevées par l'équilibre des finances publiques. Il pourrait subtilement revenir sur ses engagements, réduire ses investissements dans ce domaine et laisser se perdre les acquis récents dans la longue durée.
Voilà où nous conduirait l'érosion de la volonté politique au niveau du gouvernement fédéral quant à l'avenir des minorités francophones du pays. Voilà où nous conduirait tout retard dans la réconciliation qui s'impose entre le Québec et les minorités francophones canadiennes.
Aucun scénario visant le développement des communautés francophones hors Québec n'est pensable sans ces deux prérequis.
La question des minorités constitue, dans l'ensemble des problèmes qui confrontent le gouvernement de la fédération, une question de nature particulière puisqu'elle se situe dans ce domaine privilégié que je nommerai le territoire intérieur du pays.
Ce territoire doit être revendiqué et défendu.
Certes, on peut imaginer des modèles différenciés de protection. Mais aucun recul dans les engagements, aucune forme dissimulée de retrait dans les investissements ne sauraient être tolérés. Si de tels mouvements devaient se produire, nous devrions alors les combattre comme on défend un territoire stratégique, pied à pied, quartier après quartier.
Je pose, en second lieu, la réconciliation du Québec avec les minorités francophones canadiennes comme tout à fait indispensable dans la conjoncture présente.
Dans un monde où les frontières ont largement perdu leur signification, dans un monde où la francophonie demeure un pari risqué, un pari qui pourrait être perdu dans le premier siècle du prochain millénaire, l'absence d'une politique québécoise des minorités francophones canadiennes constitue une absurdité historique et un scandale politique.
Mis à part des accolades stratégiques, quelques programmes ponctuels et des initiatives limitées prises par certaines institutions, Québec n'a aucune politique cohérente et constante visant le soutien et le support aux projets et aux institutions minoritaires.
Cette insensibilité est contraire aux traditions profondes du Québec, contraire aussi à ses intérêts immédiats et à moyen terme. Je ne trouve aucune justification à cette froide indifférence pour cette francophonie immédiate, fragments dans de nombreux cas du peuple québécois lui-même.
On nous dit que le Conseil des ministres du gouvernement québécois serait saisi dans les prochains jours d'un tel projet politique. Nous l'accueillerons et l'analyserons avec grand intérêt. Mais sera du domaine de l'inacceptable tout projet dont la motivation serait de pallier à la mise à l'écart de l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982. La statégie serait vraiment grosse. Personne ne devrait en être dupe. Toute politique québécoise d'appui aux institutions minoritaires ne doit pas être dissociée du maintien de l'article 23. Elle doit en être le complément.
À notre avis, une politique québécoise en ce domaine devrait comprendre notamment:
- des formules d'accord avec les autres gouvernements, formules qui ne soient pas dépendantes du concept de réciprocité. Ce concept et la politique qu'il inspire doivent l'un et l'autre être relégués aux oubliettes; à moins de consentir à pénaliser des victimes innocentes, à moins de consentir au troc des droits des minorités. Le progrès et l'évolution des sociétés ne s'accomplissent pas de cette manière;
- les initiatives d'appui aux institutions postsecondaires des minorités et particulièrement dans les domaines des technologies nouvelles et des sciences de la santé;
- la définition d'un cadre de coopération pour les institutions québécoises d'enseignement supérieur et leurs correspondants dans les communautés francophones du pays;
- la création d'un institut québécois de recherche sur les minorités francophones au Canada;
- des prévisions budgétaires pour permettre de mesurer le volume et le rythme prévus de l'effort consenti.
Nous sommes réunis ici pour essayer d'imaginer l'avenir, pour réfléchir à certains scénarios visant des formules d'aide aux communautés francophones hors Québec et notamment dans le domaine de l'enseignement postsecondaire.
S'il est vrai, comme l'ont démontré de nombreuses recherches, que le niveau de scolarisation des francophones hors Québec est intimement lié à l'accès aux études secondaires et postsecondaires en français, la question qui nous rassemble vise donc le coeur des choses: la survie même des minorités.
En guise de conclusion, je vous propose quelques pistes de réflexion susceptibles de consolider et d'élargir ce qui existe déjà et d'identifier des entreprises nécessaires et possibles.
Au plan politique, j'ai déjà signalé l'importance de la contribution du gouvernement canadien et la nécessité d'une politique québécoise de réconciliation et d'appui aux communautés francophones hors Québec.
Mais le développement de l'enseignement postsecondaire en français hors Québec suppose aussi une volonté politique au niveau des gouvernements provinciaux. Cette volonté politique doit se manifester notamment dans les domaines suivants:
- renforcement dans chaque ministère de l'Éducation des structures visant le service aux minorités francophones et réévaluation du statut de ceux qui en sont responsables, là où cela s'impose. À l'exception des provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, et dans ce dernier cas d'une manière partielle, la situation actuelle apparaît partout insuffisante;
- la gestion des gouvernements scolaires locaux, l'obtention de budgets de rattrapage et la mise en place de programmes d'action positive constituent partout des priorités évidentes.
À l'est et à l'ouest, à Moncton et dans les institutions de la grande région des Prairies, bien que les situations soient proprement incomparables, l'obtention de budgets de rattrapage et la nécessité de programmes d'action positive répondent l'une et l'autre à la nécessité de combler des retards notoires. Ces derniers sont communs et notamment dans les secteurs des sciences et des technologies, des sciences de la santé et de l'administration.
Dans la province de l'Ontario, qui est à la fois la plus riche du pays et celle qui compte la plus populeuse minorité francophone, un récent diagnostic a fait apparaître de nouveau l'ampleur du problème que pose le retard des francophones à l'accès aux études postsecondaires.
La Commission Bovey n'a pas cherché à dissimuler une situation injuste et inacceptable. En effet, le taux d'inscription des FrancoOntariens aux études universitaires est inférieur de plus de 50% au taux d'inscription des autres Ontariens. La solution à ce problème, conclut le rapport, requerra des investissements nouveaux et majeurs.
Au plan des institutions elles-mêmes, un fait domine, troublant et significatif. Hors du Québec, il n'y a pas, à quelques exceptions près, de très grandes institutions postsecondaires unilingues francophones.
L'Université de Moncton constitue un cas d'exception, d'où son importance pour l'est du pays, les Acadiens et la francophonie canadienne tout entière.
Mes amis Acadiens me permettront de citer ici l'un des chercheurs les plus actifs de cette institution. Dans un document préparé pour ce colloque, ce dernier rappelait l'immense fossé, à tous les points de vue: équipements, recherche, faiblesse des infrastructures qui existe toujours entre l'Université de Moncton et les autres établissements d'enseignement supérieur anglophones de l'est du Canada.
L'expérience conduite en NouvelleÉcosse à la Pointe-de-l'Église fait de l'Université Sainte-Anne une pièce indispensable dans le réseau des institutions francophones hors Québec.
Au centre du pays, dans la province où nous sommes, il n'y a pas d'institution d'enseignement postsecondaire unilingue française. Chacun de nous connaît la situation qui prévaut à l'Université d'Ottawa et à l'Université Laurentienne. Chacun de nous apprécie aussi à sa juste valeur les efforts déployés et les résultats obtenus par le Collège Glendon affilié à York University.
Ce n'est certes pas réduire arbitrairement l'ampleur du service historique rendu à la francophonie canadienne et spécialement à la minorité franco-ontarienne que de signaler la nécessité absolue de rééquilibrer, dans le cas de l'université Laurentienne, de consolider dans le cas de l'Université d'Ottawa, les rapports entre les deux composantes linguistiques. De fixer aussi des critères qui assurent dans le long terme la viabilité et le développement dans toutes les disciplines de cette dualité affichée officiellement sur une réalité qui ne lui ressemble pas.
Celui qui se scandaliserait de l'absence d'une grande institution universitaire francophone dans la province la plus riche du Canada et où vit la plus importante minorité francophone, serait-il si éloigné des exigences canadiennes les plus pressantes?
Notre traversée du pays nous conduit dans cette grande région de l'ouest. Certains affirment qu'elle doit être dotée, selon des modalités particulières, d'un centre universitaire regroupant les services existants et disposant de ressources pour développer de nouveaux programmes et notamment dans des spécialités qui refléteraient les besoins et les réalités de l'ouest du Canada. Ce projet est-il possible? Est-il viable?
Ce qui précède fait apparaître une véritable situation d'urgence. Si on croit vraiment à l'avenir de l'enseignement postsecondaire en français hors Québec, on devra planifier son développement et les investissements requis.
Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral devraient, par l'intermédiaire du Conseil des ministres de l'Éducation ou tout autre mécanisme approprié, formuler les objectifs et les modalités d'application de l'entreprise pour les dix prochaines années. De plus, une conférence publique annuelle devrait être convoquée pour vérifier l'évolution des choses et poser les diagnostics et les correctifs qui s'imposent. Autrement, celui qui dans dix ans établirait le bilan que je viens de tracer, sera forcé de relater l'histoire d'une régression.
Il faudrait une capacité d'ignorance exceptionnelle pour envisager les tâches qui s'imposent avec une espérance qui ne soit pas troublée. Il faudrait la même capacité pour croire avec la foi du charbonnier que le temps, les ressources et la détermination convergeront finalement pour enfin faire justice à des communautés humaines marquées par des décennies de sous-développement, de privations cumulatives et de discrimination violente.
Mais quelles sont donc les voies qui nous sont ouvertes à nous Franco-Canadiens et qui ne s'accompagnent pas d'espérances troublées?
À l'échelle du pays et à celle de la francophonie mondiale, le Québec partage votre destin, c'est-à-dire votre espérance de durée dans l'histoire, votre recherche des moyens de préserver et d'enrichir ce que vous êtes. Et votre échec pourrait bien déclencher son propre déclin, sa lente absorption dans la marginalité.
Cinquième séance de travail (en plénière) : Thème V: Pour un financement optimal
Le financement de l'enseignement supérieur est complexe puisqu'il implique les deux paliers majeurs de gouvernement au Canada. Il existe également, outre les fonds habituels de fonctionnement des institutions, des crédits additionnels dans des domaines comme le bilinguisme, des programmes spéciaux (de mise en marché, par exemple)...
Sous forme de panel, trois intervenants sont appelés à présenter leur vision de la situation. Chacun examine à sa façon des questions du genre «quel contrôle peut exercer «l'autorité» des institutions sur l'allocation des priorités budgétaires internes par rapport aux décisions politiques?»; «quelle structure de concertation faudrait-il envisager pour obtenir un plus grand développement régional?»; «comment peut-on atteindre une maximisation de l'aide gouvernementale?»
Madame Lise Brisson-Noreau, du Secrétariat d'État, présente au nom de M. David Cameron, sous-secretaire d'État (Aide à l'éducation), un résumé des différents moyens utilisés par le gouvernement canadien pour aider à défrayer les coûts de l'enseignement postsecondaire au pays. Elle souligne qu'il dépense plus de $5 milliards annuellement et ne manque pas de noter l'importante contribution du rapport Johnson qui devrait enrichir les discussions sur le financement de l'enseignement postsecondaire.
Madame Roseann Runte, recteur de l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, se penche pour sa part sur les difficultés de joindre les deux bouts avec les fonds disponibles à l'heure actuelle et souligne qu'il faut être débrouillard pour être en même temps économe, excellent, innovateur et minoritaire. Elle affirme que l'éducation est le remède contre le sous-développement des francophones hors Québec.
Monsieur Claude Lacombe, agent des relations avec les universités au ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, prétend qu'on a tort de croire que ce sont les autorités fédérales qui subventionnent l'ensemble des activités des institutions postsecondaires. Il signale que la notion du bilinguisme est beaucoup plus positive aujourd'hui, même en Ontario.
Pour un financement optimal
par David R. Cameron (présenté par madame Lise Brisson-Noreau)
Introduction
La présente a pour but d'énoncer les différents moyens par lesquels le gouvernement canadien aide financièrement les provinces à défrayer les coûts de l'enseignement postsecondaire, et plus particulièrement ceux de l'enseignement postsecondaire en langue française. Nul n'est besoin de rappeler ici qu'il s'agit bien d'aider les provinces puisque ce sont elles, en vertu de notre Constitution, qui sont responsables de l'éducation. Par ailleurs, tout en vous faisant part des divers programmes d'aide financière, je vous ferai part des initiatives du gouvernement canadien pour en arriver à un financement optimal.
Au total, le gouvernement canadien dépense plus de 5 milliards de dollars par année au titre de l'enseignement postsecondaire. Je m'attarderai sur les principaux volets de cette aide, et sur le financement de base accordé aux collèges et universités par l'intermédiaire des gouvernements provinciaux, et les ententes fédérales-provinciales sur les langues officielles dans l'enseignement.
En ce qui concerne le financement de base des collèges et universités, c'est suite à la deuxième guerre mondiale que le gouvernement canadien s'est mis véritablement à contribuer de façon significative aux coûts de fonctionnement des collèges et universités au Canada et ce, afin d'assurer un enseignement accessible et de qualité. Les modalités de paiement ont évolué depuis ce temps: pendant une vingtaine d'années, le gouvernement versait directement son aide aux universités; puis, de 1967 à 1977, les contributions fédérales furent versées aux gouvernements provinciaux en fonction des dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement postsecondaire (universités, collèges, et dernières années du secondaire dans certaines provinces). Enfin, depuis 1977, c'est par le biais du financement des programmes établis, regroupant l'enseignement postsecondaire, les soins médicaux et l'assurancehospitalisation, aux termes de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, que l'aide financière est accordée. Quatre points importants à retenir en ce qui concerne cette aide:
- elle se chiffre cette année à plus de 4,5 milliards de dollars sous forme de transferts de points d'impôt et de paiements en espèces. Elle représente le principal mécanisme par lequel le gouvernement canadien appuie l'enseignement postsecondaire;
- elle est allouée uniquement sur la base de la population provinciale (il s'agit d'un montant égal per capita pour toutes les provinces) ;
- elle est accordée de façon inconditionnelle - quoique le but de ces contributions soit d'appuyer l'enseignement postsecondaire - il n'existe aucune exigence légale liant les provinces à les utiliser à cette fin;
- elle croît d'année en année au même rythme que l'économie, c'est-à-dire que le facteur de progression est basé sur le produit national brut (hormis les années d'application de la politique des 6 et 5% en 1983-1984 et 1984-1985) et l'évolution démographique. Pour ce qui est de cette année financière, 1985-1986, l'augmentation totale sera de 7,4%.
Il convient de noter que le niveau de cette aide n'est pas relié aux subventions provinciales aux collèges et universités.
Il apparaît évident que la loi de 1977 permit au gouvernement canadien de contrôler ses dépenses et de les planifier à long terme tout en assurant l'autonomie des provinces et leur flexibilité en matière d'enseignement postsecondaire. Le gouvernement dût perdre toutefois avec cette loi le lien qui existait auparavant entre l'aide fédérale et les coûts totaux entraînés par la prestation de l'enseignement postsecondaire.
Où en sommes-nous aujourd'hui? Le Secrétaire d'État, l'honorable Walter McLean, a déjà indiqué qu'il jugeait important de continuer à aider les provinces à maintenir leurs réseaux respectifs de collèges et d'universités et ce, pour le développement économique, social et culturel du Canada. Toutefois, il croit qu'il y aurait lieu d'explorer les moyens de rétablir un lien entre l'aide fédérale et les subventions provinciales aux collèges et universités tout en respectant la compétence provinciale en matière d'éducation. Également, M. McLean a communiqué sa volonté de doter la recherche universitaire de mécanismes d'appui adéquats, et son désir qu'on le conseille sur les façons dont le gouvernement canadien pourrait contribuer à la fondation et au développement de centres d'excellence qui seraient rattachés à nos universités.
1) le rapport johnson et la situation actuelle
Dans ce contexte, et en vue de nourrir les discussions sur ces questions, M. McLean a déposé, il y a près de deux mois, le 14 mars dernier, à la Chambre des communes, le rapport d'un consultant indépendant, M. Al Johnson, intitulé «Pour une meilleure orientation du financement de l'enseignement postsecondaire et de la recherche par le gouvernement du Canada».
Dans son rapport, M. Johnson analyse les problèmes de notre système postsecondaire et comment ceux-ci sont reliés aux modalités de subventions actuelles. En particulier, il note à l'échelle nationale, l'écart de 2% en moyenne, au fil des ans depuis 1977, entre le taux d'augmentation des transferts fiscaux au titre de l'enseignement postsecondaire et le taux de croissance des subventions provinciales aux universités et collèges, et la proportion croissante de la partie fédérale des subventions provinciales aux institutions postsecondaires (elle serait passée de 69% en 1977-1978 à 80% en 1984-1985 tandis que la «portion purement provinciale» aurait baissé de 31% à 20% en moyenne).
M. Johnson recommande dans son rapport que le taux d'augmentation des transferts fiscaux et celui des subventions provinciales soient harmonisés. Plus précisément, il recommande que le gouvernement fédéral respecte «les priorités des provinces en matière d'enseignement postsecondaire en augmentant ses transferts fiscaux en fonction du taux d'augmentation des subventions de la province aux universités et collèges jusqu'à concurrence des taux de croissance du PNB». L'autre volet principal de son rapport touche à la recherche subventionnée et les centres d'excellence. Il recommande une réaffectation de fonds en vue d'accorder des crédits supplémentaires aux conseils de recherche pour leur permettre de financer les coûts indirects de la recherche qu'ils subventionnent. En ce qui concerne les centres d'excellence, il recommande la formation d'un comité d'élites chargé de proposer au gouvernement un mécanisme pour le financement d'un certain nombre sélectionné de centres d'excellence de classe internationale.
Il convient que je souligne ici que le rapport représente les vues personnelles de M. Johnson communiquées au Secrétaire d'État. M. McLean, en rendant public le rapport Johnson, a annoncé son ferme souhait que le rapport enrichisse les discussions déjà entamées sur le financement de l'enseignement postsecondaire tant entre les gouvernements fédéral et provinciaux que dans les établissements d'enseignement, chez les étudiants, les groupes intéressés et le public en général.
2) le processus permanent de consultation
Le Secrétaire d'État attache une grande importance au processus de consultation pour en arriver à de meilleurs arrangements pour le financement de l'enseignement postsecondaire, pour en arriver, en quelque sorte, à «un financement optimal». Ainsi, M. McLean a déjà rencontré à deux reprises le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) depuis cet automne et une troisième rencontre est prévue pour la fin de ce mois. Également, M. McLean prend connaissance des points de vue que lui communiquent les représentants des universités et des collèges, les divers groupes intéressés et le grand public.
Vous m'excuserez de m'être tant attardé sur le financement de base accordé par le gouvernement canadien mais il représente à lui seul plus de 80% de l'aide fédérale au titre de l'enseignement postsecondaire et il constitue, par conséquent, le principal mécanisme d'appui fédéral à nos collèges et universités, tant de langue française que de langue anglaise.
Ceci étant dit, l'enseignement en langue française bénéficie d'une source additionnelle de revenu du gouvernement canadien, modeste, soit, mais non négligeable, celle provenant des ententes fédérales-provinciales sur les langues officielles dans l'enseignement.
Depuis 1970, suite aux recommandations sur l'éducation de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, le gouvernement fédéral aide les provinces à offrir l'enseignement dans la langue de la minorité officielle et celui de langue seconde officielle. De 1970-1971 à 1982-1983, l'aide fédérale s'est chiffrée à 1,8 milliard de dollars.
Comme vous le savez sans doute, pour remplacer les anciennes ententes, en décembre 1983, le Secrétaire d'État signait avec le président du Conseil des ministres de l'Education (Canada) un nouveau protocole d'ententes relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde.
Ce protocole, d'une durée initiale de trois ans (de 1983-1984 à 1985-1986), s'est vu allouer le budget suivant:
190M$ pour la première année;
200M$ et 210M$ pour les deux années subséquentes
Le Secrétaire d'État, je suis heureux de pouvoir vous l'annoncer, vient d'informer ses collègues provinciaux que le Cabinet a autorisé une prolongation de deux ans (soit 19861987 et 1987-1988) du protocole et que le budget a été augmenté de 3%.
Cette prolongation permettra d'assurer une plus grande stabilité aux programmes et rendra possible une planification à plus long terme et ce, autant de la part des provinces et des territoires que de la part du fédéral.
3) le «fonctionnement» du nouveau protocole
Le protocole constitue un cadre général à l'intérieur duquel se négocie une entente bilatérale avec chaque province et territoire. Une aide financière est prévue pour les catégories de dépenses suivantes: infrastructure, élaboration et développement de programmes, formation et perfectionnement des enseignants et appui aux étudiants.
D'abord, dans la catégorie «Appui à l'infrastructure», une contribution minimum est accordée au titre de programme et activités en cours sous forme de paiements calculés en fonction du nombre d'étudiants inscrits à un programme d'enseignement dans la langue de la minorité ou d'enseignement de la langue seconde.
À l'intérieur de cette catégorie, une contribution est accordée aux provinces pour les institutions postsecondaires bilingues ou qui offrent un enseignement dans la langue de la minorité (anglais au Québec et français dans les autres provinces). Cette aide est calculée en fonction de la subvention de fonctionnement accordée à ces établissements par les provinces. Vous serez intéressés de savoir que, pour 1984-1985, sur une somme totale de 157M$ versée à l'infrastructure, un montant de 29,3M$ a été accordé à ces différentes institutions postsecondaires au Canada (voir tableau en annexe). De plus, dans certaines provinces, suite à des ententes particulières entre les deux paliers de gouvernement, une part plus grande de nos contributions à ces provinces est allée au niveau postsecondaire, et ce, en fonction des coûts supplémentaires démontrés par les provinces. C'est le cas du Nouveau-Brunswick où un montant supplémentaire d'environ 8M$ a été consacré au postsecondaire et du Manitoba où 546000$ de plus a été versé aux institutions postsecondaires.
Dans la catégorie «Élaboration et développement de programmes», une aide financière est accordée pour l'expansion de programmes en cours et le développement et la mise en oeuvre de nouveaux programmes. Sous cette catégorie, il appartient à chaque province et territoire de soumettre au gouvernement fédéral, pour approbation, les projets qu'il entend privilégier. Ces projets sont généralement financés à 50% par le fédéral, la province ou l'institution assurant l'autre partie du financement. Plusieurs projets et activités soumis chaque année touchent le niveau postsecondaire. Ainsi, en 1984-1985, un montant de 23M$ a été consacré à cette catégorie et de ce montant, 6,2M$ ont servi à financer des projets touchant le postsecondaire. À titre d'exemples, j'aimerais mentionner quelques projets importants: les programmes d'éducation permanente à la Faculté Saint-Jean, le programme d'administration publique à l'Université de Moncton, celui d'administration des affaires à l'Université Sainte-Anne, des cours en informatique au Collège communautaire de Saint-Boniface, de même que la mise sur pied de plusieurs nouveaux cours dans les institutions de l'Ontario. Vous trouverez en annexe une liste plus détaillée de ces projets.
J'aimerais souligner que, à l'intérieur de cette catégorie, nous privilégions les projets ponctuels qui ont une durée limitée. Le financement accordé ici est complémentaire à celui accordé sous l'infrastructure et par le financement des programmes établis qui visent, eux, le soutien des programmes et activités en cours.
Sous la catégorie «Formation et perfectionnement des enseignants», des bourses individuelles sont accordées par les autorités provinciales et territoriales pour des ateliers et des stages de formation s'adressant à des professeurs de langue officielle.
Finalement, sous «l'Appui aux étudiants», des bourses sont accordées à des étudiants de niveau postsecondaire, soit pour leur permettre d'étudier dans leur langue maternelle, soit pour leur permettre d'étudier dans leur langue seconde. Ces bourses, tout comme celles accordées aux enseignants, sont payées à 100% par le gouvernement fédéral.
Quelques chiffres pour illustrer. En 19841985, une somme totale de 8M$ a permis d'accorder:
4 481 bourses pour les enseignants; 3 065 bourses à des étudiants de niveau postsecondaire pour leur permettre de poursuivre leurs études dans leur langue maternelle et 772 bourses pour la langue seconde; 110 allocations de déplacement ont été données à des étudiants de niveau postsecondaire pour leur permettre de défrayer le coût d'un voyage entre leur domicile et l'institution où ils peuvent poursuivre leurs études dans leur langue maternelle.
Le protocole prévoit également le financement à 100% par le gouvernement fédéral de deux programmes nationaux que les provinces administrent en collaboration avec le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada). Il s'agit des programmes de bourses de cours d'été de langues et de celui de moniteurs de langues officielles.
Dans le premier cas, on permet à chaque été à environ 7 000 étudiants de niveau postsecondaire de suivre, à travers le Canada, des stages d'immersion de six semaines dans leur langue seconde officielle. Également, des jeunes francophones de l'extérieur du Québec peuvent participer à des stages leur permettant d'approfondir leurs connaissances de leur langue maternelle. Budget 1985-1986: 9508409$.
Dans le cadre du programme de moniteurs, plus de 1 000 étudiants de niveau postsecondaire aident tous les ans, tout en poursuivant leurs études, des professeurs d'anglais, langue seconde ou de français, langue première et seconde, à tous les paliers du système scolaire. Le programme prévoit également un certain nombre de postes de moniteurs à temps plein affectés dans des régions rurales ou semi-urbaines. Budget 1985-1986: 6153600$.
Compte tenu du titre de notre atelier, Pour un financement optimal, je me permettrai de partager avec vous quelques-unes des améliorations les plus marquantes du protocole et des ententes bilatérales par rapport aux ententes précédentes:
- en vertu des nouvelles ententes, d'énormes gains ont été réalisés en ce qui concerne l'imputabilité des contributions fédérales. Le gouvernement fédéral avait en effet été énormément critiqué au cours des ententes précédentes par de nombreux députés et groupes, tels la F.F.H.Q. et ses chapitres provinciaux, pour la manque d'imputabilité des contributions qui étaient alors versées. Selon les nouvelles ententes, le gouvernement canadien et les gouvernements provinciaux se sont entendus sur des dispositions visant une meilleure imputabilité. Notamment, les provinces ont accepté de fournir des informations sur les contributions qui leur sont octroyées;
- à présent, les contributions fédérales sont identifiées selon qu'elles sont accordées au titre de l'enseignement dans la langue de la minorité ou celui de la langue seconde. L'immersion et l'enseignement en français, langue première constituent deux composantes distinctes. Cela aussi était un changement souhaité par le public concerné;
- le texte du protocole des ententes bilatérales et des mises à jour annuelles sont à la disposition du public. Tous et toutes ont ainsi la possibilité de contester/revendiquer à partir de données concrètes.
Je pourrais également citer la redistribution des fonds vers les provinces ayant le plus grand besoin de développement suite à l'utilisation de contributions moyennes nationales par étudiant et un certain décalage des fonds au profit du développement de nouveaux programmes par rapport au maintien de programmes, et le fait que, ces dernières années, certains projets pilotes desservant la minorité francophone ont acquis un statut permanent. De plus, dans le cadre des nouvelles ententes, le Secrétaire d'État, ayant invité les provinces à soumettre des projets visant tout particulièrement l'institutionnalisation des services d'enseignement en français hors Québec à tous les niveaux, y compris le postsecondaire et l'éducation permanente, a accordé des fonds supplémentaires au titre de nombreux projets ayant cet objectif.
Je vous fais part de ces améliorations car elles reflètent notre souci constant d'aller vers un financement optimal. Également, elles témoignent de l'importance des efforts de groupes intéressés qui ont su nous montrer là où des améliorations étaient désirables. Ce travail doit continuer car on peut toujours mieux faire, il y a toujours quelque chose à améliorer.
Ainsi, par exemple et pour lancer le débat, voici quelques questions que nous pouvons nous poser:
- l'importance relative à accorder au maintien des programmes en comparaison de celle accordée au développement;
- les bourses aux étudiants pourraient-elles être utilisées d'une autre façon?;
- le dédoublement de services dans certains domaines par rapport à la spécialisation;
- y aurait-il lieu de favoriser encore davantage la concertation entre les établissements francophones?;
- l'enseignement à distance devrait-il être exploité davantage comme moyen d'enseignement?;
- les nouvelles technologies sont-elles utilisées suffisamment?
4 d'autres mécanismes
Vous ayant décrit les deux principaux mécanismes par lesquels l'enseignement postsecondaire en français se trouve appuyé financièrement par le gouvernement canadien, j'aimerais brièvement citer les autres mécanismes d'appui possibles.
- Le programme de perfectionnement linguistique, complément en quelque sorte des ententes fédérales-provinciales sur les langues officielles dans l'enseignement, avec son budget de 893 000 $ pour 1985-1986, permet d'accorder de l'aide financière à des associations ou des institutions pour des projets d'envergure nationale touchant la collecte et la diffusion d'information ou le développement des méthodes d'enseignement des langues officielles. Un bel exemple de projet financé dans le cadre de ce programme: le présent colloque. Un autre projet important avec lequel nous avons été associés: le projet de diffusion de cours par télé-conférence, mené par l'Université d'Ottawa, qui a permis à l'Université Ste-Anne, l'Université de Moncton, le Collège universitaire de St-Boniface et la Faculté St-Jean de recevoir en même temps des cours diffusés de l'Université d'Ottawa. Un cours a également été diffusé de l'Université de Moncton.
- Le programme de communautés de langue officielle que beaucoup d'entre vous connaissent et qui, avec son budget annuel de l'ordre de 25M$, a pour but d'aider les minorités de langue officielle à maintenir leur langue et leur culture dans tous les domaines de la vie, y compris l'éducation.
- Le programme d'études canadiennes, dont le budget est de 3,7M$ par année, vise à encourager les Canadiens à mieux connaître leur pays, grâce à des projets et activités mis sur pied par des associations nationales, des groupes du secteur privé (organismes non gouvernementaux, institutions et entreprises),
ainsi que par des particuliers. Quelques projets au niveau postsecondaire qui ont été financés: le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa a reçu une subvention de 131 000$ pour compléter le manuscrit du «Dictionnaire de l'Amérique française»; le Centre d'études sur les langues, les arts et les traditions populaires des francophones en Amérique du Nord de l'Université Laval a reçu une contribution pour la production d'un volume intitulé «Quatre siècles d'identité canadienne» destiné à l'enseignement postsecondaire.
- Plus de 500M$ sont accordés à la recherche dans nos universités de langue anglaise et française à travers le pays par le biais des conseils nationaux de recherche.
- Enfin, le programme national de prêts aux étudiants, dont le budget s'élève à plus de 260M$ cette année, facilite l'accès aux études postsecondaires et accorde aux étudiants une plus grande latitude dans le choix d'un établissement d'enseignement au Canada, peu importe où il se trouve. À noter que le Québec ne participe pas à ce programme mais reçoit, à titre de compensation, des paiements de remplacement pour administrer son propre programme de prêts.
Conclusion
Les mécanismes d'aide sont ainsi bien nombreux. Nous nous trouvons dans une période de remise en question, de recherche pour un financement optimal aussi bien pour ce qui est du financement de base accordé aux provinces pour les universités et les collèges, que du financement de la recherche et de centres d'excellence, et du financement des programmes de langues officielles dans l'enseignement pour ne citer que quelques exemples. Nous accueillons toute suggestion en vue d'améliorer les mécanismes actuels et le cas échéant, d'en élaborer des nouveaux.
Langues officielles dans l'enseignement 1984-1985
Exemples de projets spécifiques financés au niveau postsecondaire
Nouvelle-Écosse |
|
|
Université Sainte-Anne: |
|
|
-Laboratoire de phonétique |
27500$ |
|
-Nouvelles acquisitions pour la mise à jour du matériel de la bibliothèque |
30000$ |
|
-Introduction de nouvelles techniques en éducation |
30800$ |
|
-Programme en informatique des affaires |
44000$ |
|
-Implantation de la dernière année du baccalauréat en administration |
40225$ |
|
-Théâtre/Centre culturel |
400000$ |
Nouveau-Brunswick |
|
|
Ministère des Collèges communautaires |
|
|
-Planification et coordination de programmes et d'opérations |
283645$ |
|
-Mise en place de l'infrastructure administrative |
39005$ |
|
Collèges communautaires du NouveauBrunswick, Campus de Bathurst: |
|
|
-Développement du Campus de Bathurst |
794957$ |
|
Collèges communautaires du NouveauBrunswick, Campus du Sud-Est: |
|
|
-Mise sur pied d'un campus dans la région de Moncton |
862716$ |
|
Université de Moncton: |
|
|
-Mise sur pied d'un programme de baccalauréat en sciences forestières |
324000$ |
|
-Développement du programme d'administration publique |
330654$ |
|
Université de Moncton, Campus de Shippagan: |
|
|
-Construction d'une résidence |
297500$ |
|
-Expansion de la cafétéria |
50000$ |
Ontario |
|
|
Collège Algonquin, Canadore, Cambrian, Northern et Niagara: |
|
|
-Élaboration de matériel d'apprentissage en français |
58828$ |
|
-Élaboration de nouveaux cours et services en français |
127000$ |
|
Université d'Ottawa, Université Laurentienne, Collège de Hearst, Université York (le Collège Glendon), Université de Sudbury et Université St-Paul: -Élaboration de nouveaux cours en français |
384000$ |
|
Cours donnés en français dans 15 collèges d'arts appliqués et de technologie |
242293$ |
Manitoba |
|
|
Collège commmunautaire de Saint-Boniface: |
|
|
-Cours d'éducation aux adultes |
120180$ |
|
Saskatchewan Université de Regina: -Élaboration d'un programme menant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement en français |
100000$ |
Alberta |
|
|
Université de l'Alberta, Faculté Saint-Jean: |
|
|
-Service de référence à la bibliothèque |
36820$ |
|
-École d'éducation permanente |
206000$ |
Colombie-Britannique: |
|
|
Université Simon Fraser: |
|
|
-Élargissement de la formation dispensée aux professeurs du programme-cadre et des programmes d'immersion en français |
131980$ |
|
-Utilisation d'ordinateurs dans le cadre du programme de formation des professeurs |
60000$ |
|
Université de la Colombie-Britannique: -Élargissement de la formation dispensée aux professeurs du programme-cadre et des programmes d'immersion en français |
16593$ |
Langues officielles dans l'enseignement 1984-1985
Contributions de soutien aux institutions postsecondaires francophones ou bilingues
|
|
Montant accordé |
|
Montantaccordé |
Nouvelle-Écosse |
-Université d'Ottawa |
2182 344$ |
|
|
-Université Sainte-Anne |
110121$ |
-York University |
53 661$ |
|
Nouveau-Brunswick |
|
-Collège Dominicain de Philosophie et Théologie |
5134$ |
|
-Université de Moncton |
1578 673$ |
||
|
École de foresterie des Maritimes |
10159$ |
-Collège Algonquin |
472731$ |
|
-Collège Cambrian |
168 675$ |
||
|
Collèges communautaires |
-Collège Niagara |
17 621$ |
|
|
-Campus d'Edmunston |
89864$ |
-Collège Northern |
61822$ |
|
-Campus de Grand Falls |
39 659$ |
-Collège St. Lawrence |
30 308$ |
|
-Campus de Bathurst |
290 597$ |
-Collège de Tech. Agricole d'Alfred |
94432$ |
|
-Campus de Campbellton |
64436$ |
||
|
-Campus du Sud-Est Québec |
8 659$ |
-Collège Canadore |
26 683 $ |
Manitoba |
|||
|
Bishop University |
378188$ |
-Collège Saint-Boniface |
149 327$ |
|
-McGill University |
7 390 334$ |
Saskatchewan |
|
|
-Concordia University |
5 350 834$ |
-University of Regina |
22 048$ |
|
-CEGEP |
10309480$ |
Alberta |
|
Ontario |
Faculté St-Jean |
116083$ |
|
|
-Laurentien University |
224 693$ |
|
|
|
-Collège de Hearst |
32 872$ |
Total |
29 329269$ |
La recherche de l'excellence
par Roseann Runte
Introduction
Ceux d'entre vous qui me connaissent, ont sans doute trouvé, comme moi, extraordinaire de voir mon nom au programme de cet atelier. J'ai plutôt l'âme d'une poète et l'entraînement d'une littéraire, d'une historienne. Et comme je vous adresse la parole à l'heure de la messe dominicale, il semblerait plus séant de vous entretenir d'un sujet qui se prête plus à des pensées sinon pieuses, du moins plus philosophiques que les finances ou notre manque de finances.
Mais les organisateurs du colloque avaient sans doute une raison pour avoir mis mon nom dans cette section. Peut-être ont-ils entendu dire que l'Université Sainte-Anne et son recteur ont connu quelques succès en ramassant des fonds capitaux? Je n'ai fait que mon devoir, mais ce n'était pas facile. Heureusement que la poésie et l'histoire m'ont appuyée. Pourquoi la poésie? À part la rime riche, il y a toujours l'inspiration. Et l'histoire? Il y a deux ans, j'ai édité avec une étudiante quelques manuscrits datant des années 1680 à 1700. Leurs auteurs, vos arrière-grand-pères, furent parmi les premiers colons canadiens. L'un d'eux, un simple soldat, écrivait son exaspération contre son sergent qui l'avait obligé à marcher derrière le wagon qui portait des barils de clous, à ramasser les clous qui s'échappaient et à compter tous les clous à la fin de la journée. Et ce, à cause de la pénurie, non seulement de clous, mais d'à peu près tout dans cette colonie. Lire de pareils textes fut un bon entraînement pour le rectorat. Car pénurie il y a! Si nous arrivons à la fin de l'année sans que les comptes financiers soient barbouillés d'encre rouge, c'est que les Acadiens sont débrouillards et qu'à la Pointe-de-l'Église, nous n'avons pas l'habitude de mettre beaucoup de lard dans notre râpure.
1) le systeme de financement
Dans un passé plus récent, on a beaucoup parlé du financement des universités, une responsabilité provinciale à laquelle le gouvernement fédéral contribue. La forme que pourrait prendre cette contribution a été beaucoup discutée. Une proposition préconisait l'aide directe aux étudiants et aux étudiantes. Ce système de financement n'aiderait pas les petites universités francophones hors Québec et pourrait même nous conduire à fermer nos portes.
L'idée, plus récente, de créer des centres d'excellence est meilleure. C'est une excellente stratégie nationale qui contribuera à l'élimination de la duplication inutile, de l'éparpillement et de la dilution de nos talents et de nos ressources. Mais est-ce que nous, les universités francophones - petites, pauvres, en état de pénurie - pouvons nous qualifier pour de tels centres d'excellence? Nous rêvons tous que oui. Mais je pense que l'argent ainsi dirigé ira à Toronto, à Laval, à l'Université de la Colombie-Britannique, à McGill. L'excellence entraîne l'excellence.
À titre d'exemple, n'oubliez pas qu'avant d'avoir un excellent programme en informatique qui pourrait se qualifier et obtenir des fonds additionnels, il faut acheter l'ordinateur! Et cette année, à l'Université SainteAnne, nous avons le même ordinateur dont se servent les grandes universités anglophones de l'est. Cette année. L'année prochaine, ce ne sera plus vrai. Les universités anglophones auront acheté un super-ordinateur. L'université francophone retournera au Moyen Age électronique. Mais, me direz-vous, nous pouvons être excellents en linguistique, en langues, en lettres. Je vous réponds que ces domaines ne reçoivent pas autant de fonds que d'autres. Et, est-ce que nous allons faire progresser la francophonie avec des centres d'excellence dans les domaines scientifiques et techniques de l'avenir principalement anglophones?
Le programme d'aide aux petites universités protégera quelque peu les petites universités francophones, mais il va peut-être falloir augmenter le programme d'appui financier aux universités de langue minoritaire.
J'aimerais vous inviter à faire le budget général d'une université avec moi. Le problème est évidemment celui des fonds. Il n'y a que deux solutions: diminuer les dépenses ou augmenter les revenus.
Il est difficile de diminuer les dépenses. À peu près 75% du budget est consacré aux salaires et pour garder notre personnel, il faut augmenter les salaires. L'université paie en général moins bien que l'entreprise privée. Le chauffage et l'éclairage coûtent plus cher chaque année. Le prix du matériel ne diminue pas et nous ne pouvons pas beaucoup épargner en comptant des clous! Les universités pourraient baisser les intérêts qu'elles paient si elles avaient l'argent pour acquitter des dettes. Enfin, et plusieurs personnes l'ont déjà mentionné, gérer une institution de langue minoritaire coûte plus cher.
Nous pouvons essayer d'augmenter les revenus. En augmentant les frais de scolarité, nous risquons de perdre des étudiants. Il faut aussi reconnaître que les frais de scolarité représentent moins de 15% des revenus de l'université, donc une très petite somme. L'université peut essayer de faire payer les services qu'elle rend à la communauté et les installations qu'elle lui offre: la piscine, la patinoire, le gymnase, etc. Si elle essaie de faire payer les services de consultation, par exemple, les employés qui rendent ces services réclament cet argent pour le consultant qui est en général syndiqué. Si l'université essaie de gagner de l'argent avec la location de ses installations, le public proteste en disant que ces installations n'existent que grâce aux impôts qu'il a payés. Il ne veut pas y contribuer une deuxième fois, même si ce n'est que pour maintenir l'édifice. Il faut évidemment essayer de changer cette attitude. Le public ne semble pas exiger que le prix de l'acier de Sydney Steel soit baissé parce que cette compagnie a reçu de l'aide du gouvernement.
Les universités peuvent chercher des dons des compagnies, des fondations et des individus. Ces dons sont en général, et malheureusement, désignés pour des buts spécifiques et limités. Le recteur peut aller chercher de l'équipement pour le département des sciences et revenir avec du goudron. C'est très bien et tout est utile. Mais le don ne peut pas constituer la base du budget.
L'université peut négocier des contrats avec le gouvernement ou des corporations tout en tenant compte de sa taille, de sa capacité et de sa vocation linguistique minoritaire qui peut la désavantager.
L'université peut essayer de bien placer son argent en augmentant le taux d'intérêt reçu. Mais il faut d'abord avoir de l'argent à placer.
Il y a enfin la créativité budgétaire. On peut essayer de trouver une nouvelle manière de compter des clous. Si l'on a des rochers dans le jardin et on n'a pas assez d'argent pour les faire sauter à la dynamite ou pour les faire enterrer, on peut toujours créer un jardin japonais. Mais le nombre de jardins japonais dont on peut se servir est limité!
Il y a enfin l'argent qui nous est accordé par le gouvernement, envers lequel nous sommes très reconnaissants et sans lequel nous ne pourrions survivre.
Parmi les programmes du Secrétariat d'État, j'aimerais que l'on développe un programme de bourses d'échange pour étudiants et pour professeurs. Il est plus facile actuellement d'aller en Europe ou au Québec que d'échanger avec d'autres régions francophones minoritaires. Un tel programme ne coûterait pas cher car les participants pourraient garder les mêmes frais et les mêmes salaires que dans leurs institutions d'origine. Il faudrait trouver seulement les frais de déplacement et d'organisation. Les programmes d'échange aident à combattre les distances et les différences qui nous séparent au Canada.
J'aimerais également voir un programme pour le développement du personnel des petites universités francophones qui sont isolées et qui ont proportionnellement moins de professeurs qui détiennent le doctorat que les universités de langue majoritaire. Il faut encourager le corps professoral dans ces institutions à augmenter ses qualifications, à viser l'excellence.
J'aimerais remercier le Secrétaire d'État pour le programme des projets spéciaux. S'il m'était permis de rêver un petit peu, pas en couleur, mais en noir et blanc, j'admettrais au programme des projets très spéciaux d'une durée de plus de trois ans. Il y a certains projets qui ne s'autofinanceront jamais et qui seront toujours d'une grande importance pour l'éducation postsecondaire en français.
Les publications en traduction et en pédagogie relèvent actuellement de deux programmes du CRSH et du Conseil des Arts. Les projets dans ces domaines sont d'un grand intérêt pour les universités francophones hors Québec et nous aimerions voir s'établir un fonds de publication à cette fin.
Nous aimerions également un programme qui admettrait les frais d'amélioration de l'équipement, des livres et des revues à la bibliothèque.
Mais si nous voulons que le gouvernement établisse des programmes qui favorisent nos institutions, il faudrait que nous les appuyions nous-mêmes. Si nous voulons élever le taux de participation universitaire des francophones, nous devrons leur offrir de meilleures bourses. Si chaque Acadien de la Nouvelle-Écosse donnait 100$ à un fonds de bourse, nous n'aurions pas besoin de demander plus - les revenus paieraient la scolarité de chaque Acadien inscrit à l'Université Sainte-Anne.
C'est un défi, un défi qui pourrait se répéter dans chaque province du pays. Nous avons reçu de l'aide de l'Église, du gouvernement et de nos voisins anglophones. Avant de nous tourner ailleurs, je crois qu'il nous incombe d'appuyer nos institutions nousmêmes. Et je sais que vous y croyez aussi.
Aujourd'hui, on nous dit que les francophones sont sous-développés dans le domaine de l'éducation postsecondaire. Cela n'a pas toujours été le cas. Au dix-huitième siècle, le taux de la population qui pouvait lire et écrire en Acadie était plus élevé que celui de toutes les provinces françaises de France. Et en Nouvelle-Écosse, il y eut non seulement un collège pour garçons, mais également un collège pour femmes. Ces collèges étaient fondés bien avant l'Université Harvard et ils se sont épanouis, comme l'Université Sainte-Anne, établie un peu plus tard, en dépit de la loi provinciale qui interdisait toute instruction dans une langue autre que l'anglais. L'éducation postsecondaire en français au Canada a une longue et difficilemais très belle histoire. Il nous incombe de contribuer d'abord à son présent, pour assurer ensuite son avenir.
Il y a deux siècles, Diderot écrivait un essai sur les femmes qui n'étaient pas encore libérées à l'époque. Il affirmait que l'unique voie à suivre pour obtenir leurs droits était celle de l'éducation. Il ajoutait que l'éducation est la clé à la liberté et à la pleine participation à la société. Ce que Diderot a dit des femmes s'applique aux francophones hors Québec. Je crois fermement que l'éducation est le remède contre le sous-développement des francophones hors Québec. Notre investissement dans l'éducation, dans la jeunesse, est notre contribution à un meilleur avenir pour nous tous.
Les provinces font aussi leur part
par Claude Lacombe
Introduction
Cette présentation décrit le cadre institutionnel ontarien pour l'enseignement postsecondaire, ainsi que les méthodes de financement, l'environnement politique, social et administratif actuel. Je conclurai avec quelques réflexions personnelles sur l'avenir, ses défis et ses possibilités.
1- le cadre institutionnel
En Ontario, il existe, pour les francophones, deux universités (Laurentienne, Ottawa), deux collèges universitaires (Hearst, Clendon), six collèges d'art appliqués et de technologie (Algonquin, Cambrian, Canadore, Niagara, Northern, St-Laurent).
La philosophie du gouvernement ontarien a toujours été d'offrir l'éducation en français dans un cadre institutionnel bilingue, bien que certains programmes soient offerts complètement en français. Le financement des opérations vient en majeure partie du gouvernement (80% ou plus). Nous connaissons tous le débat actuel sur la participation du fédéral aux programmes établis, d'ailleurs actuellement en révision. En Ontario, notons que les fonds disponibles sont distribués avec l'aide des conseils consultatifs (Conseil des affaires universitaires de l'Ontario - OCUA, et Conseil de l'éducation franco-ontarienne - CEFO).
Il existe évidemment une différence entre les méthodes de financement des universités et des collèges. Les principes de base sont similaires cependant. La formule générale est basée sur les inscriptions des années précédentes. Nous établissons également une moyenne pour amortir les variations annuelles. Nous avions développé jadis une formule encourageant la compétition interinstitutionnelle, afin d'accroître les inscriptions.
Une modification récente de la formule tend d'ailleurs à décourager cette compétition qui, dans une situation de contraintes budgétaires, affecte la qualité de l'enseignement. Les institutions reçoivent le financement de base et des subventions additionnelles en reconnaissance des coûts créés par la politique de bilinguisme institutionnel. Les programmes peuvent être offerts, en parallèle dans chaque langue, ou dans un cadre bilingue (seuls certains cours étant offerts en français).
En ce qui a trait aux universités, le calcul des coûts additionnels est fait par l'OCUA périodiquement (5-6 ans) sur la base des dépenses réelles au cours des années précédentes. C'est en fait un ajustement aprèscoup qui a lieu. Les universités s'en sont plaint dans le passé. Mais pour compenser, le ministère a un autre programme de subventions pour le développement et la mise en oeuvre de nouveaux cours, ainsi que des programmes dont les fonds sont distribués sur recommandation du CEFO.
Quelques chiffres: la subvention au bilinguisme, en 1984-85, était de 13,8$ millions. Il s'agit d'une importante augmentation (x 4 en dollars courants en 10 ans, x 2 en dollars constants). L'aide à la création de nouveaux cours, en 1984-85, totalisait 768 000$.
Pour ce qui est des collèges, les subventions au bilinguisme sont distribuées sur la base d'un budget soumis par les collèges chaque année. Une vérification est faite, aprèscoup, pour s'assurer que les fonds ont été dépensés en accord avec le budget. Notons que le financement de nouveaux cours est inclus dans ce budget.
Donnons, comme tantôt, quelques chiffres.
La subvention en 1984-85, atteignait 5,6$ millions, une bonne augmentation sur 10 ans (x 3 en dollars courants, x 1,5 en dollars constants). En plus de ces subventions, il existe une série de programmes spéciaux financés grâce au soutien fédéral du Secrétariat d'État. Ces programmes répondent à des besoins spécifiques pour l'éducation en français et l'enseignement du français, langue seconde.
2- la conjoncture politique, sociale et administrative
II existe des contraintes fiscales pour tous les niveaux de gouvernement et le déclin de la priorité de l'enseignement postsecondaire, au niveau politique, n'est peut-être qu'une simple réaction contre les efforts trop accentués de la décennie précédente.
Le diplôme est toujours considéré indispensable, mais il n'est pas tout. Il n'est qu'un point de départ d'une carrière. Les carrières dans le monde du travail ne se conforment pas aux attentes des diplômés; il existe en effet actuellement une surqualification et un sous-emploi. Ce qu'on pourrait appeler le déclin démographique aura un impact sur les inscriptions, impact compensé par les changements dans les conditions requises pour l'obtention du diplôme secondaire. Ces divers éléments créent une certaine insécurité qui souvent conduit à une rigidité structurelle, alors que la flexibilité, l'innovation, l'adaptabilité seraient indispensables.
En Ontario, la perception du concept de bilinguisme est devenue très positive. Ce changement est dû, selon moi, aux efforts de groupes comme «Canadian Parents for French». Cette nouvelle situation signifie que le bilinguisme individuel n'est plus uniquement le privilège, ou le fardeau, des francophones. Il en résulte aussi que l'avantage social des francophones, dû à leur bilinguisme, va peut-être disparaître. Le nombre d'étudiants francophones va probablement commencer à décroître bientôt et il sera difficile pour les institutions d'innover et de mettre en oeuvre de nouvelles initiatives. En fait depuis 1980, les inscriptions dans les cours et programmes en français déclinent dans toutes les universités bilingues. Une seule exception: le Collège universitaire Glendon.
L'arrivée d'étudiants anglophones venant des programmes d'immersion pourrait aider certaines institutions si, bien sûr, ils s'inscrivent dans des programmes bilingues. Et, à cet égard, le rôle des gouvernements va continuer à être crucial, surtout du point de vue financier, pour garantir les acquis. Et le gouvernement fédéral, qui a pratiquement gelé ses subventions au bilinguisme depuis 5 ans, va devoir réexaminer ses politiques.
L'image schématique que je vous ai donné peut paraître pessimiste. En période de crise cependant, on fait souvent beaucoup de progrès. Pour l'avenir de la communauté francophone en Ontario, il va falloir se préoccuper, non seulement de la quantité des services disponibles, mais aussi de leur qualité et de leur pertinence. Par pertinence, on entend adaptation aux besoins du monde du travail, car il faut que les diplômés francophones puissent trouver du travail dans leur domaine d'études. Il faudra continuer à affirmer son existence pour s'assurer que les progrès des dernières années ne seront pas perdus. La compétition avec les anglophones bilingues va créer des pressions sur les francophones, et l'excellence professionnelle va devenir un critère de succès plus important que le bilinguisme. Les administrateurs des institutions bilingues devront s'assurer de la qualité des programmes offerts en français pour attirer les étudiants à l'avenir.
Comme les fonds supplémentaires venant du gouvernement ont peu de chance d'augmenter, il va falloir recourir à d'autres méthodes pour maintenir la qualité de l'enseignement en français. Il faudra utiliser les ressources d'une façon plus efficace (ce qui va forcer les gestionnaires à des décisions difficiles) et coordonner la programmation au niveau de la province et du pays!
En Ontario, la commission Bovey a recommandé un fonds spécial de soutien à la coopération interinstitutionnelle pour l'enseignement en français. Cette coopération pourrait permettre la rationalisation des programmes bilingues et en français et elle pourrait obliger certains étudiants à voyager davantage, d'où l'importance des bourses d'études du gouvernement fédéral.
Conclusion
Je pense que la coopération entre institutions bilingues pourrait contribuer à en faire un groupe de pression significatif si elles présentent un front uni. Cette coopération entre institutions pourrait peut-être convaincre le gouvernement du besoin d'aide financière pour certains projets conjoints. La coopération peut aussi avoir existé avec les institutions anglophones désirant offrir des cours en français pour les étudiants d'immersion (équivalence de crédits, détachement de professeurs, etc..) La coopération permet d'éviter les situations de type «dilemme du prisonnier».
Les institutions pourraient être tentées de laisser le gouvernement prendre les décisions difficiles; par ailleurs, chaque fois que cela arrive, elles abdiquent un peu de leur autonomie. Le gouvernement n'aime pas avoir à prendre de telles décisions (ou encore jouer un rôle d'arbitre) et sera plus favorable aux institutions qui assument leurs responsabilités de gestion. Je laisse en réflexion trois mots d'ordre pour l'avenir: excellence académique, responsabilité financière et coopération. Et au niveau individuel, avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de saisir les occasions qui se présentent.
Résumé de la discussion
Les participants à cette plénière ont tenu à obtenir des précisions sur l'invitation faite par la représentante du Secrétariat d'État, i.e. faire parvenir des commentaires, individuels ou collectifs, sur les propositions du Rapport Johnson. On fitsavoir qu'il fallait se presser, car la décision quant aux nouveaux programmes, se prendrait bientôt.
On souligne aussi qu'il n'était pas facile de savoir si les deniers des autorités fédérales, après avoir emprunté tous les dédales administratifs, à la fois au sein des administrations provinciales et au sein des bureaucraties universitaires ou collégiales, parvenaient aux bons récipiendaires et étaient utilisés aux fins prescrites. Les agents du gouvernement fédéral, a-t-on soulevé, devraient exiger des comptes plus serrés, surtout en ce qui a trait à la promotion du bilinguisme!
Enfin, certains participants ne manquèrent pas de déplorer les périodes d'austérité sévère imposées par des gouvernements provinciaux aux institutions universitaires. L'exemple de la Colombie-Britannique fut cité, tout comme celui de l'Ontario, deux provinces qui n'ont cessé depuis cinq ans de diminuer leur aide totale à l'enseignement postsecondaire. À cet égard, il faut remercier l'auteur du rapport sur le financement de l'enseignement postsecondaire (M. Johnson), d'avoir attiré l'attention sur les fonds utilisés par certaines provinces, non pas à ce dossier, mais pour l'administration générale provinciale.
Sixieme séance de travail : thème VI: La préparation du matériel didactique et le développement professionnel continu
A- En milieu universitaire
Les participants à cette séance de travail font une analyse des moyens à envisager pour assurer, à partir des réussites dans certains domaines, une préparation d'un matériel didactique adéquat et qui correspond à la spécificité du milieu francophone, tout en permettant une saine intégration à l'environnement global de la société.
Le professeur André Obadia, de l'Université Simon Fraser, parle des mécanismes instaurés en Colombie-Britannique pour le développement du français: création d'un stage pédagogique de douze mois pour la formation des professeurs d'immersion en français, introduction d'un système vidéo-disque, cours estival pour les professeurs actuels, diplôme de premier cycle, publication de la revue Contact à l'intention des professeurs de français.
Madame Claudette Tardif, de la Faculté Saint-Jean, de l'Université de l'Alberta, souligne qu'il n'y a pas d'université de langue française en Alberta, et cela entraîne des problèmes nombreux, comme ceux d'une pénurie de textes, d'une surcharge de travail pour les professeurs actuels, d'un manque de sous pour développer davantage le système de télé-conférence introduit pour l'enseignement à distance. Elle propose qu'on mette sur pied des mécanismes pour que les ressources financières allouées par les gouvernements soient d'abord acheminées vers la publication ou l'achat de matériel didactique, et vers un réseau de communication entre les chercheurs francophones en milieu minoritaire.
M. Louis Malenfant, de la Faculté d'éducation de l'Université de Moncton, insiste pour sa part sur l'aspect humain de la question, la formation pédagogique des professeurs. Il suggère que l'on conçoive des programmes en fonction des besoins des gens, que l'on améliore les programmes existants pour en tenir compte et, finalement, que la formation continue passe de la parole à l'acte par une coopération interprovinciale, des ateliers pédagogiques et une concertation à bâtir entre chercheurs.
Pour de nouveaux départs
par Claudette Tardif
Introduction
Étant donné la complexité de cette question, je ne tenterai pas de vous offrir une analyse détaillée et complète, mais je partagerai avec vous mes réflexions et mes sentiments, ainsi que quelques recommandations qui permettront aux universités de mieux répondre à la spécificité du milieu francophone. Je trouve particulièrement difficile de répondre à cette question, parce que je dois envisager le problème à deux niveaux: celui de l'enseignant en salle de classe face aux besoins des élèves, et celui de la formation des enseignants et de leurs besoins en milieu universitaire. ]e dois, comme personne impliquée dans la formation des enseignants, réfléchir sur ma pratique pédagogique au niveau de la formation de ces enseignants et je dois bien connaître le milieu dans lequel ces futurs enseignants seront appelés à oeuvrer.
Afin de créer des services, des programmes et un matériel didactique qui seront appropriés et qui correspondront à la spécificité d'un milieu francophone, il est important de faire l'analyse de ce milieu. Je dois bien comprendre la réalité francophone de mon milieu. Je dois savoir où sont les francophones, je dois connaître leur histoire, connaître la configuration socio-culturelle et politico-économique du milieu, l'étendue de leur langue parlée et de leur langue écrite.
1- le cas albertain
Dans mon milieu en Alberta, avant 1983, le ministère de l'Éducation ne faisait pas la différence entre l'éducation en français pour francophones et l'éducation en français pour anglophones. Il existe donc plusieurs situations où les enfants francophones sont regroupés dans des classes avec des enfants anglophones. Avec l'adoption de l'article 23 de la Charte, cette situation commence à changer. Deux écoles francophones publiques ont ouvert leurs portes en septembre 1984, une à Edmonton, l'autre à Calgary. Il faut dire que les enseignants qui enseignent dans des classes ou des écoles francophones sont minoritaires. Leur rôle est bien particulier. Comme le disait un de mes collègues, monsieur Alain Nogue, ces enseignants seront appelés à être en même temps:
«...des enseignants, des animateurs socio-culturels, des modèles de langue, des pionniers, des missionnaires et des chercheurs... Comme enseignants, ils auront la lourde responsabilité de créer des situations d'apprentissage qui permettront au jeune Franco-Albertain d'atteindre l'excellence... Ils devront être des animateurs socio-culturels parce que les jeunes ont besoin de bien se connaître, de savoir qui étaient leurs ancêtres, d'apprendre leur façon de voir la réalité... Ils devront être des modèles du bon parler, parce que la qualité du français de leurs élèves dépendra, en grande partie, de la qualité de la leur... Ils seront appelés à être des pionniers et des missionnaires dans un domaine qui n'a reçu droit de cité que cette année. En participant à une expérience nouvelle (l'école francophone), ils devront agir comme chercheurs, tenant compte des variables du milieu scolaire, de la programmation, des stratégies d'enseignement et de bien mesurer le dosage de leur enseignement linguistique et culturel...» (Nogue, 1985: 19-20).
Il s'agit donc de préparer un personnel qui verra à l'épanouissement de la culture de l'enfant francophone, non seulement dans le domaine de l'enseignement, mais aussi dans ceux de l'administration, dans les services gouvernementaux, para-scolaires et d'unités sanitaires. Il y a une forte demande de personnes bilingues dans tous ces secteurs. L'université est déjà appelée à répondre aux demandes de cours en français pour adultes désirant apprendre le français, et pour francophones voulant améliorer leur connaissance de la langue. De plus en plus, les universités doivent offrir des cours traitant des techniques de l'enseignement aux adultes.
Nous pouvons alors nous poser la question : comment pouvons-nous améliorer en milieu universitaire, par une meilleure formation, le rendement de ce personnel? Il est évident, par ce qui a été dit, qu'il faut permettre à ces personnes de prendre conscience de ce qu'est l'éducation des francophones en milieu minoritaire, de prendre conscience du contexte socio-culturel et politique. Quelles en sont les implications au niveau postsecondaire? J'aimerais vous parler d'implications dans trois domaines: celui des valeurs éducatives et culturelles, celui du matériel didactique et celui de la création de nouveaux cours et programmes.
2- les valeurs éducatives et culturelles
Par valeurs éducatives et culturelles, j'entends «la qualité des idéaux sociaux et personnels que l'éducation véhicule ou devrait véhiculer chez nous» (Lévesque, 1982:7). Le milieu universitaire de langue française a un double rôle: 1) de former des personnes qui pensent, qui réfléchissent et qui questionnent, et aussi 2) de former des personnes qui puissent bien connaître et bien apprécier la réalité canadienne-française.
Le fait d'avoir choisi d'étudier en français au niveau postsecondaire est déjà significatif.
La langue d'enseignement au niveau postsecondaire, comme à l'école élémentaire et secondaire, joue un très grand rôle dans la formation de l'étudiant. Chaque langue offre une différente vision du monde. Selon Desjarlais :
«L'identité culturelle (véhiculée principalement par la langue) est une nécessité psychologique qui fournit à un individu des instruments d'action; c'est un mode de pensée, c'est une méthode, c'est une vision du monde, qui, ajoutés à ceux des autres cultures, donnent de l'homme et de la vie une définition plus globale et plus enrichie (Desjarlais, 1983:13).»
Il s'agit de créer une âme francophone à l'université. Ce qui importe avant tout, c'est que les jeunes soient convaincus qu'on peut et qu'on doit être fier de parler en français et que c'est une façon de vivre dans le monde. Selon Ghislaine Roquet:
«II ne suffit pas qu'une collectivité bénéficie de l'instruction en français, il faut aussi qu'elle vive dans un milieu culturel francophone... Qu'elle crée elle-même et qu'elle réalise des oeuvres culturelles dans ces modes d'expression, qu'elle puisse les échanger avec d'autres groupes francophones et même avec l'ensemble de la communauté francophone.» (Roquet.1982:5).
3- le matériel didactique
La disponibilité de matériel didactique en français crée également des soucis, et au niveau universitaire et au niveau des salles de classe. La pénurie de textes et de livres de références, ainsi que tout autre matériel d'ordre pédagogique en français et s'appliquant à tous les programmes d'études, est un problème réel. Selon Cantacuzene:
«Le fond du problème de la langue française est un problème de qualité, de dynamisme et donc de rayonnement de la pensée et des réalisations des Français (et des francophones).
Aujourd'hui, la masse des gens, lorsqu'elle a les moyens de s'éduquer, veut accéder à la culture qui vit, aux technologies et à la science qui se créent: on apprend donc l'anglais qui rend le plus de services...» (Cantacuzene, 1984: 93).
Les ouvrages scientifiques publiés en français diminuent de plus en plus et, dans certaines disciplines, sont presque inexistants. Je vous donne un exemple. Lorsque je fais le choix des textes scientifiques en français (e.g. psychologie de l'éducation) pour mes étudiants universitaires, je suis souvent mis en face d'un dilemme. Si je devais choisir des textes en anglais, j'aurais l'embarras du choix. Pour trouver des textes équivalents en français, je dois fouiller les bibliothèques et les catalogues des maisons d'édition pour arriver à trouver des ouvrages scientifiques convenables. Souvent, je suis obligée de choisir des textes de la France, qui ne correspondent pas aux réalités scolaires et culturelles des étudiants; des textes qui utilisent souvent un langage trop sophistiqué pour la majorité de nos étudiants, et qui organisent le contenu des connaissances selon un mode de pensée qui diffère de la conception nord-américaine. Ou bien, je dois choisir des textes écrits en anglais (surtout américains).
À défaut de texte, comme professeur, je dois traduire, adapter et faire la synthèse de l'information, provenant de plusieurs sources de référence. Il est souvent nécessaire que j'organise mes notes de cours, sous forme convenable, afin de les remettre aux étudiants. J'oserais dire que toute la question du matériel pédagogique est un grand problème dans les universités francophones, parce qu'elle demande un investissement énorme de temps et d'énergie de la part du professeur. La recherche du matériel didactique en français engendre du travail supplémentaire pour le professeur en milieu universitaire francophone.
Il faut aussi considérer l'effet de l'arrivée des étudiants anglophones, provenant des classes d'immersion, dans les universités francophones. Cela exigera l'adaptation de nos cours et, possiblement, de nos cadres pédagogiques.
Dans la formation d'un personnel enseignant oeuvrant en français, il serait bon de mettre sur pied des cours qui traiteraient plus particulièrement de la réalité francophone au Canada. Par exemple, les enseignants devraient avoir une formation en psychologie de l'enfant en milieu minoritaire, en psycholinguistique (facteurs qui entrent en jeu chez le francophone dans l'acquisition de sa langue), en histoire de la francophonie du milieu, dans la politique de bilinguisme et dans la culture et la civilisation canadiennefrançaise. Pour les enseignants déjà en salle de classe, il est bon d'envisager des cours de perfectionnement: méthodologie de l'enseignement de la langue, techniques d'animation culturelle, psychologie de l'acquisition et l'enseignement des langues. La Faculté SaintJean est à l'étape de la planification d'un diplôme supérieur pour enseignants et conseillers pédagogiques qui veulent approfondir leurs connaissances dans la sphère de l'éducation en français. Il va sans dire que l'obtention de ce diplôme exigera davantage en ressources humaines, matérielles et financières. Il faudra convaincre les administrateurs de notre université et nos membres élus au Parlement de la nécessité d'un programme de deuxième cycle en français.
Afin de répondre aux besoins de leur milieu, les universités devront offrir des services, des cours et des programmes qui s'intègrent davantage au milieu culturel et qui offrent plus de souplesse que jadis. Le concept de la télé-conférence est un excellent moyen de rendre des cours plus accessibles aux enseignants et d'éviter la dispersion des ressources.
Conclusion
Je termine avec quelques recommandations qui visent l'amélioration du rendement des universités francophones en ce qui a trait à la formation d'un personnel pour les milieux d'enseignement en français.
Il faut espérer que les ressources financières accordées aux universités pour la recherche soient davantage accordées en fonction du développement de matériel didactique, de cours et de programmes qui correspondent à la réalité francophone. Par exemple:
- encourager plus de recherches appliquées, dans les domaines des sciences humaines et sociales (subvention de recherche);
- faire une analyse du matériel didactique, en fonction des besoins linguistiques et culturels des francophones;
- identifier le matériel didactique au niveau postsecondaire qui reflète la réalité canadienne-française;
- encourager les professeurs, qui oeuvrent dans le domaine de la formation des maîtres, à rédiger du matériel didactique. On pourrait alléger le problème du manque de matériel didactique en donnant plus d'encouragement aux projets de recherche qui visent la composition et la rédaction de documents de curriculum et de méthodologie, traitant de la didactique de l'enseignement du français en milieu minoritaire et de l'enseignement du français en situation d'immersion;
- encourager des projets de recherche ayant trait aux facteurs qui influencent le maintien du français en milieu minoritaire.
Nous devons également établir des nouveaux cours et des programmes qui reflètent la réalité francophone en milieu minoritaire. Afin d'éviter la dispersion des ressources ou leur dédoublement, il faudrait voir aux possibilités d'établir une concertation interinstitutionnelle. Nous ne pouvons pas faire tout, tout seuls.
Enfin, il faudrait créer un réseau de communication des divers chercheurs francophones en milieu minoritaire, afin de diffuser les travaux de ces chercheurs, en améliorant les conditions de diffusion. Est-il possible de mettre sur pied plus de journaux de qualité pour les chercheurs francophones? En réfléchissant sur l'utilisation du français comme langue scientifique, Chadli fait la déclaration
suivante:
«L'avenir du français scientifique me paraît fondé essentiellement sur la qualité de la recherche en langue française et sur son impact sur la communauté scientifique internationale. Il dépendra également, outre la diffusion des travaux, de l'engagement des autorités et des chercheurs français à maintenir et à promouvoir leur langue d'origine comme moyen de communication et véhicule des découvertes récentes» (Chaldi, 1984:131-132).
Références
Cantacuzene, J. 1984. «Langage, technologie et rayonnement,» Perspectives universitaires, 2(1):81-97.
Chadli, A. 1984. «Réflexions sur l'utilisation du français comme langue scientifique en Tunisie,» Perspectives universitaires, 2 (1): 129-132.
Desjarlais, L. 1983. «L'école française,» Revue de l'Association canadienne d'éducation de langue française, 12 (3).
Lévesque, G. 1982. «Les valeurs éducatives et l'évolution du Québec» Revue de l'Association canadienne d'éducation de langue française, 11 (1): 7-8.
Nogue, A., 1985. «La sirène de l'immersion est déchue,» Notre langue et notre culture, 12 (1): 3-21.
Roquet, G. 1982. «Facteurs qui influencent l'expansion de la langue française au Canada», Revue de l'Association canadienne d'éducation de langue française, 11 (1) : 3-6.
Résumé de la discussion
Les participants de cet atelier sont d'accord avec le message des trois membres du panel. Le matériel didactique en langue française est rare pour nos étudiants et nos professeurs. On souligne cependant qu'il serait souhaitable, plutôt que de se servir de matériel inadéquat, d'utiliser les ressources de la France. Il y a, souligne-t-on, des consulats ou des maisons de la France un peu partout sur le territoire canadien. Les gens qui y travaillent seraient certes heureux de nous faire connaître leurs publications, dont la qualité de la langue est indéniable. Nous pourrions adapter le contenu à nos réalités.
On ne manque pas de noter également que l'enseignement à distance, mis en place en Alberta et en Ontario, pourrait se servir des expériences mises à l'essai au Québec. Des représentants de l'Université du Québec se disent prêts à collaborer à cet égard. Ils soulignent qu'il y aurait des avantages pour tous: diminution des coûts par étudiant, nondédoublement, analyse des réussites et échecs...
B- En milieu collégial
Les francophones hors Québec ne reçoivent peut-être pas leur juste part des subventions accordées pour le développement du matériel didactique et pour le perfectionnement du personnel enseignant. Le président de cette séance de travail, M. Alcide Gour, du Collège Cambrian, affirme que les autorités fédérales accordent 2,2$ milliards pour la formation professionnelle dans les collèges communautaires. Or, de cette somme, aucun montant n'est prévu pour la formation en langue française.
Madame Raymonde Hanson, doyenne au Collège Algonquin, parle de l'expérience PERPERFRA, menée en collaboration par les professeurs des collèges, les dirigeants du ministère ontarien des Collèges et Universités et les deniers du Secrétariat d'État. Il s'agit de sessions, locales ou régionales, visant à mettre à jour les connaissances, dans des domaines spécialisés, à l'intention des participants, par des échanges mutuels de renseignements. Elle note que les enseignants ont fait la preuve qu'ils voulaient améliorer tout autant leur façon d'enseigner que leur contenu pédagogique.
Madame Nicole Brodeur, de la Direction générale de l'enseignement collégial au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, du gouvernement du Québec, fait le point sur les expériences québécoises, en soulignant qu'il existe quatre programmes, à l'intention des usagers des Cégeps. Ce sont les programmes de subventions à la production de matériel didactique, les programmes de perfectionnement et de recyclage destinés aux enseignants, les programmes de subventions à la recherche pédagogique et ceux, finalement, des échanges professionnels. Elle se dit intéressée à augmenter la portée de ces programmes et estime qu'ils pourraient avoir des retombées sur les institutions hors Québec.
Le modèle ontarien
par Raymonde Hanson
Introduction
La préparation du matériel didactique et la formation du personnel enseignant sont, à mon avis, si étroitement reliées qu'il est difficile de dire quel élément est la force motrice - un personnel enseignant bien formé qui identifie la nécessité de préparation de matériel didactique... ou l'inverse. D'emblée, on reconnaît qu'il y a un besoin de matériel didactique que l'enseignant doit préparer et qui, par le fait même, demande une formation spécialisée.
Je veux vous entretenir de ces deux aspects de l'enseignement au niveau collégial en Ontario: la formation du personnel enseignant et la préparation de matériel didactique.
1- Le perfectionnement
Les activités de développement professionnel à l'intention du personnel d'expression française des C.A.A.T. sont subventionnées depuis 1979 à partir d'un fonds accordé par le Secrétariat d'État connu sous le nom de PERPERFRA- Perfectionnement du personnel francophone.
Les activités parrainées par PERPERFRA se regroupent en 2 grandes catégories: d'une part, des activités provinciales qui sont organisées par le ministère des Collèges et des Universités (les seuls frais encourus par les collèges sont ceux du déplacement), d'autre part, des activités collégiales qui regroupent des sessions locales ou régionales organisées pour un collège ou un groupe de collèges, une participation à des conférences, ateliers, séminaires ou autres et des visites à d'autres institutions postsecondaires, j'ajoute que pour les activités collégiales, PERPERFRA défraie 75% des coûts et le collège 25%.
Chaque collège soumet ses projets en ordre de priorité mais, au niveau du ministère, la préférence est accordée aux projets et aux individus qui en font la demande pour une première fois. Le but de PERPERFRA est de favoriser le développement professionnel du personnel enseignant francophone et d'assurer une mise à jour de leurs connaissances.
En 1983-84, 875 personnes ont bénéficié de subventions de PERPERFRA pour parfaire leurs connaissances dans leur champ d'expertise ou d'autres champs connexes. D'ailleurs, depuis 1981, PERPERFRA a parrainé la participation de 2534 francophones à des activités diverses, pour un montant global de 426000$.
La mise à jour des connaissances est faite par le truchement d'ateliers et de séminaires. Cependant PERPERFRA ne supporte pas des projets d'études tel un cours crédité à l'université ou dans un institut spécialisé.
Un régime de bourses à l'intention des enseignants des modules scolaires de langue française est cependant disponible pour poursuivre des études au niveau du baccalauréat, du 2e et du 3e cycle. Je me dois ici de souligner cette merveilleuse initiative du Secrétariat d'État et du ministère des Collèges et des Universités. Mais qu'arrivera-t-il si, un jour, cette manne venait à ne plus tomber des cieux bleus d'Ottawa et de Toronto? Les institutions post-secondaires voudront-elles et pourront-elles identifier des sommes pour le perfectionnement du personnel enseignant francophone? Quelles sont les solutions et les moyens à envisager pour assurer une continuité dans ce domaine? Ce sera à vous de mettre de l'avant vos idées.
Ceci m'amène à la 2e tranche de ma présentation : la préparation du matériel didactique. Mes commentaires se limiteront toutefois à mon expérience au Collège Algonquin.
2- Le matériel didactique
Comme c'est la pratique pour le perfectionnement du personnel enseignant francophone, le ministère des Collèges et Universités offre de l'aide financière aux collèges désignés bilingues pour le développement du matériel didactique en langue française. Depuis 1983, le fonds de création de matériel didactique en français a permis de subventionner 48 projets (pour une somme de 265000$).
Le but de ce fonds est d'encourager l'élaboration d'outils d'apprentissage en langue française. Ce fonds est conçu principalement pour répondre aux besoins du matériel d'apprentissage dans les domaines plus spécialisés. On entend par matériel d'apprentissage en langue française tout matériel conçu pour faciliter l'apprentissage - soit livres, cahiers de travail, manuels de laboratoire, logiciels, matériel audio-visuel. Ce matériel d'apprentissage peut être destiné soit aux étudiants, soit aux enseignants.
La difficulté chez nous, comme partout ailleurs je suppose, est tout d'abord d'inciter les enseignants à soumettre des projets pour des fonds provenants du ministère, puis de mener ces projets à une fin. D'autre part, une autre difficulté, et non la moindre, est d'inciter l'emploi de ce matériel didactique en français, une fois disponible.
Les raisons d'être et la nature du matériel didactique en français tiennent à l'identification des besoins spécifiques du milieu de l'enseignement en français. Pour comprendre le concept de création du matériel didactique en français, il m'apparaît essentiel de vous référer d'abord à ces besoins et de voir ensuite comment, de par sa nature, le matériel didactique en français peut répondre à ces besoins.
Pour identifier les besoins auxquels veut répondre le matériel didactique en français, il suffit de rappeler les lacunes et les difficultés qui nous sont toutes déjà familières et de penser au faible impact des ressources didactiques - bibliothèque, audio-visuel, enseignement assisté par ordinateur - sur les pratiques pédagogiques de l'éducation en français au niveau collégial.
3- En français d'abord et avant tout
Si le Collège Algonquin, ou toute autre institution postsecondaire, offre des programmes et des cours en français, ne faut-il pas s'attendre à ce que les étudiants francophones désirent recevoir tout leur enseignement en français et avoir à leur disposition le matériel didactique nécessaire? L'idéal n'est-il pas que les étudiants inscrits à un programme en français puissent trouver tout le matériel didactique qu'ils désirent dans cette langue?
Un de nos premiers soucis, au Collège Algonquin, est de procurer aux étudiants francophones un apprentissage entièrement dans leur propre langue. Il doit y avoir une cohérence entre la langue des étudiants, le mode d'enseignement et le matériel didactique. Le manuel de classe, comme instrument de travail pour les étudiants et le professeur, se doit donc d'être en français. Le même principe de cohérence vaut pour le matériel audio-visuel utilisé en classe ainsi que pour le matériel disponible au centre de documentation. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, les études des étudiants francophones sont, par le fait même, grandement facilitées.
De plus, le matériel didactique en français doit permettre aux étudiants d'améliorer leur langue, tant du point de vue de la syntaxe que de celui du vocabulaire général. Les étudiants devront aussi apprendre à connaître le vocabulaire technique en français. Il est essentiel que les étudiants puissent maîtriser ce vocabulaire technique lors de leur séjour au collège, car c'est probablement la seule chance qu'ils auront de le faire.
J'aimerais, si vous le permettez, ajouter les remarques suivantes. La pertinence du matériel didactique en français a parfois été difficile à démontrer, surtout dans le contexte nord-américain. D'ailleurs, elle le demeure toujours dans certains domaines! De plus, la compréhension par les étudiants, du matériel didactique en français est parfois difficile: vocabulaire technique, style de l'écriture, présentation du document. Toutefois, ces difficultés ne sont pas insurmontables et ne devraient pas servir d'excuses pour la nonutilisation du matériel didactique en français. Mais attention toutefois! Cela n'implique pas que les étudiants francophones ne doivent pas connaître l'anglais. Il est important de se souvenir que le matériel didactique en français ne vient pas rendre inutile la documentation disponible en anglais. Celle-ci demeure toujours un outil de travail complémentaire important, même pour les étudiants qui poursuivent leurs études en français.
Il demeure, néanmoins, qu'une étude au Collège Algonquin en 1982 révélait que le matériel didactique en français est mal connu et peu utilisé par les étudiants, les professeurs et même les gestionnaires. Les documents et les services existent pourtant, comme les moyens de les connaître, de les obtenir et de s'en servir, car ils sont souvent largement diffusés. Cependant, entre l'administrateur qui doit prendre une décision, l'enseignant qui veut expérimenter une méthode, l'étudiant qui approfondit un sujet, entre ces trois utilisateurs principaux d'une part, et le matériel didactique en français, d'autre part, force est de reconnaître une faille, un hiatus. D'où le besoin d'une analyse et d'une synthèse des moyens de favoriser non seulement l'innovation et la création du matériel didactique en français, mais également son utilisation.
Ces dernières années, un climat favorisant le bilan et la consolidation a caractérisé l'approche des collèges communautaires face à l'enseignement en français: études, orientations, énoncés de politiques, révisions de programmes et identification de priorités; ces discours me paraissent particulièrement significatifs de la réalité du matériel didactique en français dans le réseau des collèges communautaires. Il faut souligner toutefois les nombreux problèmes qui restent à résoudre: le perfectionnement des enseignants, la relation entre l'enseignement général et professionnel, la formation de base, la pédagogie de l'enseignement professionnel, etc. Il faut également déplorer le fait que, malheureusement, la communauté francophone des collèges soit peu intéressée à la pédagogie, sans parler, bien sûr, de la création ou l'innovation de matériel didactique en français.
Quelles raisons peut-on invoquer pour expliquer cette attitude des francophones?
- Une méconnaissance des services offerts?
- Une incompréhension de la nécessité de créer du matériel didactique en français par les responsables?
- La plus grande difficulté à remplacer le personnel enseignant en français d'une façon temporaire?
- Le manque de connaissances ou de formation nécessaire pour créer du matériel didactique en français?
- Un manque d'intérêt ou de motivation?
Dans un avenir assez rapproché, les collèges devront ajuster leurs pratiques pédagogiques traditionnelles à de nouveaux élèves et explorer des méthodes d'enseignement et d'apprentissage mieux appropriées face à l'essor de l'enseignement professionnel, à la diversification des programmes et au recours toujours croissant à la technologie, et il ne faut pas l'oublier, les contraintes budgétaires! Serons-nous capables de relever le défi?
Je désire, maintenant, partager avec vous le cheminement déjà fait au Collège Algonquin pour seconder l'accès au matériel didactique en français.
Depuis 1978, le centre de documentation a maintenu une moyenne constante d'environ 16 à 20% des nouvelles acquisitions pour l'achat de livres et de périodiques en langue française ou bilingues; également, une plus grande quantité de documents audio-visuels en français est maintenant disponible, grâce à l'arrivée de nouveaux fournisseurs, particulièrement du Québec, et à une accessibilité plus facile.
Le centre de documentation publie mensuellement, depuis 1981, une liste automatisée bilingue, de toutes ses nouvelles acquisitions (livres, périodiques, publications officielles, documents audio-visuels). De plus un catalogue qui regroupe l'ensemble de la documentation en langue française et anglaise que possède le centre de documentation est disponible sur microfiches depuis 1982; ce catalogue ne comprend toutefois pas l'ensemble des fonds de collections de tous les collèges bilingues de la province.
L'enrichissement du centre bibliographique, en ce qui a trait au matériel didactique en français, la préparation et la publication de dépisteurs en français, la publicité sur les services offerts, ainsi que l'augmentation du nombre de francophones capables de travailler en français et la bilinguisation du personnel continuent à faire partie des objectifs courants du centre de documentation.
D'ailleurs, afin de faciliter et d'augmenter les contacts (essentiels pour la connaissance réciproque du matériel didactique en français) entre les professeurs et les étudiants d'une part, et le centre de documentation d'autre part, ce dernier a nommé des responsables bilingues pour le choix et l'utilisation de la documentation disponible; ainsi les bibliothécaires de référence travaillent depuis 1979 auprès des étudiants et des professeurs.
Malheureusement, il n'existe aucune étude d'ensemble approfondie et aucune statistique au sujet de l'utilisation du matériel didactique en français au Collège Algonquin. Cependant, ma connaissance générale de la situation actuelle me permet d'affirmer que l'utilisation du matériel didactique en français au Collège Algonquin est plus importante dans certains domaines qu'elle ne l'était auparavant, mais qu'elle demeure, néanmoins, inférieure comparativement à l'utilisation du matériel didactique en anglais. Il n'en reste pas moins que seul un projet de recherche d'envergure peut identifier les effets positifs de la disponibilité de matériel didactique en français auprès des étudiants et des enseignants.
En plus des argents disponibles en provenance du ministère, le collège, entre 1978 et 1984, a mis à la disposition du corps enseignant, des argents pour la création de matériel didactique en français et en anglais par l'intermédiaire d'un conseil de création. À partir de ces fonds, plusieurs projets en français ont été subventionnés.
L'impression de manuels en français par l'organisme attitré du collège, Média Algonquin, a sensiblement augmenté au cours des dernières années. Depuis 1976, sur un total de 530 titres publiés par Média Algonquin, il y a eu 206 titres en français.
On doit nécessairement attribuer, en partie, la création de ces manuels au fonds provenant du ministère des Collèges et des Universités, du Secrétariat d'État et du collège.
La librairie du collège a également fait des efforts tangibles pour améliorer le service aux francophones. Les relations entre la librairie du collège et les éditeurs francophones sont bien établies, grâce, particulièrement, à la présence d'une personne bilingue plein temps qui possède une meilleure connaissance du marché du livre en français et qui est responsable spécifiquement de l'achat des manuels de classe en français. On nous dit que les choses vont maintenant tellement bien que les délais de livraison sont souvent plus courts pour les textes francophones que pour les textes anglophones.
De plus, on pratique au collège le parallélisme français-anglais lorsque l'on subventionne le manuel en français. C'est-à-dire, le collège paie la différence entre les coûts du manuel en anglais et ceux du manuel en français si ceux-ci excèdent 7,00$. Mais cette pratique d'accorder des subsides aux manuels de classe en français risque de disparaître puisque le prix des textes en anglais a eu tendance à augmenter tandis que celui des textes en français s'est maintenu stable, de telle sorte que la différence est maintenant presque minime; d'ailleurs la librairie ne dispose plus que de 5000$ de subvention par année pour tous les volumes en français du collège. Mais une autre question se pose maintenant: doit-on subventionner un manuel en français pour lequel il n'existe pas d'équivalent en anglais?
Conclusion
Voilà les «faits de la réalité» du matériel didactique en français dans le contexte des collèges communautaires en Ontario et plus spécifiquement au Collège Algonquin.
Vous en conviendrez avec moi que les professeurs sont la clé de la création et de l'utilisation du matériel didactique français. Ces derniers, cependant doivent être supportés par un éventail de services qui doivent répondre aux besoins des usagers francophones.
Les demandes faites pour obtenir des fonds pour la création de matériel didactique français démontrent l'intérêt de la part des enseignants.
Il faut cependant que les institutions et les agences gouvernementales, provinciales et fédérales, maintiennent cette poussée et l'on peut cultiver ce momentum en mettant en application les cinq recommandations suivantes.
- il existe chez les enseignants francophones des individus inventifs, créateurs; il importe, au plus haut point, de les dépister et de leur procurer des conditions favorables à la création.
- il existe aussi chez les enseignants francophones un bon nombre d'individus qui exercent une critique pénétrante de la réalité éducative, qui sont prêts à collaborer à une innovation, mais qui ne partiront pas seuls en croisade; leur contribution à l'innovation peut être inestimable, pourvu qu'on leur procure les conditions nécessaires: du temps, des moyens d'expression et des liens avec d'autres catégories de personnes intéressées à la création, etc.
- il faut également reconnaître qu'à l'égard du matériel didactique en français, le rôle de l'utilisateur est, d'une certaine façon, le seul rôle absolument nécessaire; et si la formation de celui-ci laisse à désirer, il importe de la compléter - les innovations qu'on propose à cet utilisateur peuvent certes y contribuer, pourvu qu'on évite les complications inutiles et qu'on sache graduer les difficultés, comme de bons maîtres et de bons livres savent parfois le faire, sans brûler les étapes.
- il existe dans le système collégial un «besoin criant» d'identifier les innovations pédagogiques disponibles dans le milieu collégial et à l'extérieur de celui-ci, afin de dissuader toute tendance à toujours «réinventer la roue».
- et finalement, puisque mes énoncés précédents sur la réalité du matériel didactique français vous portent sans doute à penser que les innovations pédagogiques ont généralement été produites, une à la fois, selon les besoins perçus par les diverses composantes du milieu collégial et moyennant les ressources disponibles hic et nunc, plutôt qu'en fonction d'une rigoureuse planification d'ensemble je vous confirme qu'une telle perception est juste, mais qu'elle devrait clairement être remplacée par une politique privilégiant une planification à long terme et s'inspirant de considérations pédagogiques qui reflètent les besoins des différents milieux collégiaux.
Le modèle québécois
par Nicole Brodeur
Introduction
Je désire remercier la Fédération des francophones hors Québec de m'avoir invitée à ce colloque. Je suis d'abord heureuse de venir partager avec d'autres collègues préoccupés par l'enseignement collégial nos expériences québécoises. Ce plaisir est accentué pour une Franco-Ontarienne d'origine, née sur les bords du Lac Témiscamingue et qui a entrepris ses études primaires dans une école dite «séparée». Enfin, comme représentante du gouvernement québécois, je tiens à vous témoigner l'intérêt et la volonté de celui-ci à assister les francophones hors Québec dans leurs efforts pour se donner des services éducatifs qui correspondent à la spécificité de milieux francophones.
Cet atelier porte la préparation du matériel didactique et le développement professionnel continu. J'aborderai le sujet en décrivant les moyens utilisés pour favoriser le développement pédagogique dans les collèges publics du Québec. Nous avons favorisé une approche diversifiée. Quatre catégories de programmes ont été mis en place à cet effet, depuis la création des cégeps: les programmes de subventions à la production de matériel didactique; les programmes de perfectionnement et de recyclage destinés aux professeurs; les programmes de subventions à la recherche pédagogique et disciplinaire, spécifiquement destinés aux professeurs des collèges; divers programmes d'échanges professionnels tels la coopération avec d'autres pays et d'autres provinces, la tenue de colloques.
Il y a lieu, avant de traiter de chacune de ces catégories de rappeler quelques caractéristiques des collèges du Québec. Ils sont constitués en un réseau d'établissements (publics et privés5) dispensant des programmes d'enseignement conduisant, pour la majorité, à des diplômes décernés par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, sur recommandation de leur conseil d'administration respectif. Il s'agit donc de programmes dits nationaux ou d'État. Ces programmes sont d'une durée de deux ans pour ceux qui mènent à l'université et d'une durée qui varie entre deux et trois ans pour les programmes professionnels qui conduisent au marché du travail. Ils sont élaborés et révisés par des comités pédagogiques qui regroupent des professeurs représentant tous les collèges concernés par ces programmes, en concertation avec des comités consultatifs provenant du monde du travail, des corporations professionnelles, des universités. C'est le ministère qui approuve les programmes, en fin de processus.
1- Le matériel didactique
La direction générale de l'enseignement collégial offre aux collèges trois programmes de subventions à la production de documents didactiques; matériel didactique écrit; matériel didactique audio-visuel; matériel didactique informatisé.
Ces trois programmes sont complétés par des prix d'encouragement à la publication de matériel didactique et une exposition itinérante. Le service du développement de matériel didactique gère ces programmes qui représenteront environ 3 millions de dollars en 1985-1986. Ce service qui réunit environ vingt-cinq personnes, assure aussi une expertise technique aux collèges engagés dans des projets de production.
L'absence chronique de manuels en français et adaptés au contexte nord-américain pour l'enseignement technique est bien connue de tous; elle est toutefois déplorée plus vivement par les étudiants et les professeurs du secteur professionnel au collégial.
Conscient du problème, le ministère de l'Éducation a prévu, en 1978, dans son «Projet du gouvernement à l'endroit des cégeps», des mesures susceptibles de fournir à la clientèle de ce secteur, le matériel didactique de base en français, essentiel à la formation des étudiants.
L'objectif étant de permettre à l'étudiant la possibilité de s'instruire dans sa langue, la solution envisagée pour certains cours peut être la traduction d'un volume en anglais. Cependant, à cause des difficultés à obtenir, dans plusieurs cas, les droits d'auteur nécessaires à la traduction et parce qu'il faut encourager la production par des professeurs québécois, la rédaction de manuels originaux reste toujours la solution privilégiée.
Ce programme, réservé au secteur professionnel du collégial, est en marche depuis 1978-1979 et le ministère y a consacré un budget annuel moyen de quelque 600000$. Après des débuts plutôt lents, le programme va bon train6.
Un comité de la documentation didactique écrite où siègent des représentants des collèges (administrateurs, professionnels nonenseignants et professeurs) désignés par la Fédération des cégeps et des représentants de la Direction générale de l'enseignement collégial voit à :
- identifier les champs de l'enseignement collégial pour lesquels on reconnaît une carence majeure en matériel didactique pertinent en langue française;
- établir un plan de production qui tienne compte des priorités et des ressources matérielles et humaines.
L'audio-visuel faisant partie des principaux choix pédagogiques faits par les collèges, le ministère a voulu mettre au service du réseau collégial des ressources humaines et financières pour favoriser la production de documents audio-visuels originaux qui soient adaptés aux besoins des professeurs québécois.
Comme plusieurs collèges ont déjà formé des équipes de production efficaces et se sont dotés d'équipements importants, ce programme d'aide à la production audio-visuelle permet d'accroître la rentabilité de ces ressources. Par ailleurs, un autre aspect de ce programme est certainement d'aider les collèges moins favorisés en termes d'équipements ou de personnel, à développer des structures et à acquérir une expérience de production.
L'application de ce programme comprend deux temps forts: d'une part, l'inventaire des besoins et la formulation des projets où les collèges sont les seuls impliqués; d'autre part, l'acceptation et la réalisation des projets où les collèges et notre service du développement de matériel didactique sont impliqués selon leur compétence respective.
D'une façon générale, il appartient aux collèges d'exprimer leurs besoins dans le cadre de champs prioritaires et de critères qualitatifs. Cette expertise des collèges est faite, selon le cas, à partir de plusieurs intervenants: les professeurs par leurs plans de cours, les comités pédagogiques provinciaux lors de la rédaction des guides pédagogiques, les collèges lors de l'établissement de leurs objectifs et leurs priorités, enfin, la Direction générale de l'enseignement collégial par sa planification du développement du réseau et de ses activités de soutien à ce même réseau.
Chaque intervenant participant à l'inventaire des besoins peut formuler un projet qui pourra être l'expression d'un besoin de documents audio-visuels devant être conçus et réalisés par un ou des collèges, en coproduction avec notre direction.
Ce programme qui existe depuis sept ans a permis la réalisation d'environ cent cinquante productions avec un budget annuel de 200000$.
Depuis 1983-1984, il existe pour l'enseignement collégial un plan quinquennal de développement de la micro-informatique à des fins pédagogiques. Ce plan comprend plusieurs volets: introduction de la microinformatique dans les programmes de formation, logiciels, équipements, perfectionnement, recherche. Le volet «logiciels» porte sur la production et les achats regroupés de logiciels coûteux (système de gestion de base de données, système comptable, système-auteur). Le programme d'aide à la production de matériel didactique informatisé vise à produire et à rendre accessible aux collèges des logiciels de qualité et à développer une expertise quant aux divers aspects de la production de ce type de matériel didactique (techniques, pédagogiques et administratifs).
Il s'agit d'un programme nouveau auquel sera consacré plus de 2 millions de dollars en 1985-1986.
Nous avons institué le prix d'encouragement (prix du ministre) à la production de matériel didactique. Il existe une abondante production d'une qualité exceptionnelle à l'intérieur des collèges et dans les maisons d'édition du Québec. Le désir de sortir ce matériel de l'ombre, d'en souligner la qualité, d'en faciliter la diffusion, de même que le désir d'encourager les professeurs à produire, sont à l'origine du concours (il existe depuis 1978-1979).
Le ministère a remis en marche une exposition itinérante. On y retrouve l'ensemble des projets soumis au concours des prix d'encouragement et des productions subventionnées par le ministère. Cette exposition permet de faire connaître dans tout le réseau collégial et par là également augmenter le nombre d'auteurs qui soumettront leur candidature au concours des prix d'encouragement et ce, tant pour le matériel didactique écrit, audio-visuel qu'informatisé.
2- Les programmes de perfectionnement et de recyclage destinés aux professeurs
Les programmes de perfectionnement et de recyclage destinés aux professeurs des collèges relèvent de deux catégories: une première reliée à des dispositions contenues dans les conventions collectives; une seconde qui est constituée par des programmes de subventions gérés par le ministère.
Les dispositions des conventions collectives prévoient un budget local de perfectionnement alloué au per capita: ce budget tient compte de l'éloignement des centres universitaires (1,6 M$ pour le réseau). Les conventions prévoient aussi un programme de recyclage professionnel d'une durée de 2 ans pour les professeurs mis en disponibilité dans leur discipline. Les professeurs permanents bénéficient de la sécurité d'emploi. Ces deux programmes représenteront 4,4 M$ en 1985-1986.
Il existe trois programmes de subventions gouvernementaux qui totalisent un peu plus de 1 million de dollars:
- le programme de perfectionnement collectif destiné surtout aux professeurs mais ouvert également aux autres catégories de personnel. Priorité est accordée depuis quelques années aux projets centrés sur le développement de la micro-informatique;
- le programme de stages en entreprise destiné aux professeurs de l'enseignement professionnel ;
- le programme de formation des éducateurs d'adultes. Ce programme débutera en 1985-1986 et vise la formation des professeurs venant de l'entreprise.
Lorsqu'on traite de la formation et du perfectionnement des professeurs des collèges du Québec, on ne saurait passer sous silence le programme PERFORMA qui est entièrement pris en charge par près d'une quarantaine de collèges, avec la participation de l'Université de Sherbrooke. Il s'agit d'un modèle plutôt unique, où le perfectionnement réalisé dans les établissements mêmes sont crédités. Centré d'abord sur le perfectionnement pédagogique, PERFORMA s'oriente maintenant vers le perfectionnement disciplinaire.
3- les programmes de subventions a la recherche pédagogique et a la recherche disciplinaire
Souvent implicite et parfois oubliée, la recherche au niveau de l'enseignement collégial est devenue explicite en 1980 avec la publication du Livre blanc du gouvernement sur une politique québécoise de la recherche.
La nature et les pratiques du corps professoral ont permis d'abord la réalisation de projets de recherches pédagogiques. Depuis 1972, le Programme de subvention à l'innovation pédagogique (1,1 M$ en 1985-1986) permet la réalisation annuelle d'une trentaine de projets.
En 1981, les enseignants des collèges ont également eu accès à la recherche disciplinaire et technologique dans le cadre d'un programme protégé (1 M$) et de plusieurs autres volets du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche. Ils y participent depuis trois ans et réalisent en moyenne une trentaine de projets par année.
L'implication récente dans les collèges d'une douzaine de centres spécialisés dans certains secteurs-clés de l'économie québécoise, a aussi largement contribué au développement de la recherche appliquée dans les collèges. Les centres spécialisés ont aussi des mandats d'animation, d'aide technique et d'information auprès des entreprises qui relèvent de leur secteur respectif. Ces centres reçoivent des subventions d'encadrement (3 M$).
Depuis quelques mois, le ministère a entrepris, en relation avec ses partenaires dans le réseau, d'élaborer un document d'orientation du développement de la recherche dans les collèges. Le ministère qui consent déjà des ressources financières, humaines et matérielles à la réalisation de projets de recherche entend reconnaître un modèle de recherche correspondant aux responsabilités particulières des cégeps de demain.
4- les divers programmes d'échanges professionnels
La coopération avec d'autres pays et avec le reste du Canada favorise le ressourcement professionnel des professeurs. Du côté des pays européens, la coopération s'est principalement développée avec la France, puis de façon plus modeste avec la Belgique. La coopération avec les États-Unis a démarré récemment. Au Canada, c'est surtout avec l'Ontario que les projets sont nombreux (échanges de professeurs, d'étudiants, etc.). Des démarches sont en cours pour développer la coopération avec les collèges du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
La direction générale de l'enseignement collégial subventionne annuellement la tenue de quelques colloques organisés par les comités pédagogiques de professeurs, suivant les priorités de développement des programmes d'enseignement.
Le programme de soutien au transfert des ressources scientifiques vers l'entreprise permet aux professeurs chercheurs d'effectuer des stages dans des entreprises. Ce programme (1,5 M$) n'existe que depuis un an et est ouvert tant aux professeurs des universités qu'à ceux des collèges. Ce sont ces derniers toutefois qui en ont le plus largement bénéficié. Les entreprises, de leur côté, paraissent tirer profit de cet apport de ressources scientifiques.
Conclusion
Durant l'année en cours, des efforts ont été consentis à une meilleure harmonisation de ces diverses catégories de programmes. Ces efforts devront être poursuivis afin d'optimiser les ressources consenties et de s'assurer que ces programmes contribuent aux objectifs de développement pédagogique, professionnel et scientifique pour lesquels ils ont été mis en place.
Résumé de la discussion
Les participants reconnaissent l'importance de mettre à la disposition des enseignants des programmes de formation continue. Ils appuient les efforts effectués au Québec et en Ontario, mais ils ajoutent que la volonté des enseignants doit être soutenue par des conditions adéquates, conditions qu'il faut sans cesse améliorer!
On aimerait que des équipes de travail interprovinciales soient mises sur pied afin qu'on puisse profiter de l'expertise des uns et des autres. On souligne qu'il semble y avoir un désir de coopération entre les agences provinciales et que les institutions d'enseignement seraient heureuses de se joindre à de nouveaux mécanismes de concertation.
Enfin, pour la formation professionnelle des francophones hors Québec, on estime qu'un front commun de tous les intéressés est nécessaire afin qu'on précise (et adopte) une politique prévoyant l'attribution de fonds nationaux spécifiques aux enseignants de langue française.
Plénière et conclusion du colloque
L'assemblée plénière, présidée par M. Clinton Archibald, coordonnateur du colloque, n'avait pas pour but de faire adopter à la hâte une série de résolutions qui ne seraient que des voeux pieux.
Cependant, le professeur Gérard Étienne, de l'Université de Moncton, a «re-tablé», pour la plénière, les deux recommandations qu'il avait déjà proposées, lors de son exposé: d'abord, qu'un comité, mis sur pied par la F.F.H.Q., examine les moyens de structurer une concertation interinstitutionnelle afin de faire bénéficier chacune des communautés des avantages de l'enseignement à distance en français; ensuite, qu'un comité pluridisciplinaire permanent de la F.F.H.Q., avec des liens étroits avec le Secrétariat d'État, se penche sur toutes les questions d'ordre académique, financier et administratif relatives à l'enseignement postsecondaire en français, à l'extérieur du Québec. L'assemblée a dit souhaiter que les dirigeants de la fédération et des responsables du Secrétariat d'État se penchent sur ces deux propositions.
Au nom de la Fédération des jeunes Canadiens-Français, M. Jean-Pierre Maisonneuve a proposé qu'on publie dans les Actes du colloque, pour considération de la part des dirigeants de la F.F.H.Q., un ensemble de recommandations préparées par les jeunes participants au colloque. Ces propositions qui traitent, selon les thèmes majeurs du colloque, de l'accessibilité aux études postsecondaires, de l'éducation permanente, des programmes de qualité et de financement, sont reproduites in extenso à la fin du présent document.
On a proposé également la formation d'un réseau de télé-conférence, «à la grandeur du pays». On aimerait également que les institutions d'enseignement postsecondaire hors Québec réaffirment le principe suivant: les programmes de formation pédagogique doivent contenir des éléments de l'identité culturelle de la minorité de langue française. Les contenus des programmes nouveaux doivent aussi, estime-t-on, tenir compte des compétences et expériences des enseignants, tout autant que des besoins de la, ou des communautés.
On a également dit souhaiter que la F.F.H.Q. collabore à l'étude commencée à l'Université d'Ottawa sur les cours d'immersion en français, en Ontario, et qu'elle insiste pour qu'on étudie comparativement la même question pour tout le reste du pays. Dans la même veine, elle devrait chercher des moyens, de concert avec les autorités gouvernementales et les représentants des institutions postsecondaires hors Québec, d'accentuer la coopération entre les membres de l'Association canadienne de formation des maîtres.
Présentation du prix painchaud-léger
Lors du colloque, la Fédération des francophones hors Québec a décerné au journal Le Devoir son deuxième prix PainchaudLéger. Le directeur du journal créé par Henri Bourassa, M. Jean-Louis Roy, a accepté la plaque commémorant cet honneur.
Le professeur Clinton Archibald, coordonnateur du colloque, a rappelé, au nom de la F.F.H.Q., la courte histoire du prix Painchaud-Léger. Il a également souligné l'apport du Devoir à la cause des francophones hors Québec. Nous reproduisons ici les mots de présentation de ce prix.
Le prix painchaud-léger
C'est le 10 novembre 1984 que la F.F.H.Q. a créé ce prix afin d'honorer périodiquement la contribution de chercheurs, d'analystes ou même d'acteurs (politiques et autres) qui aident non seulement à faire connaître les minorités de langue française au Canada (à l'extérieur du Québec), mais qui cherchent également des solutions à l'amélioration de leur sort collectif.
Le premier prix a été décerné à l'écrivainhistorien Mason Wade dont les écrits sur les Canadiens-Français et la dualité canadienne ont dévoilé des talents quasi inégalés à ce jour. C'était lors du premier colloque des chercheurs sur la minorité de langue française hors Québec.
Qui sont Robert Painchaud et Jules Léger?
Robert Painchaud est né à Saint-Boniface en 1941. Il était historien à l'université de Winnipeg. Chercheur dévoué, il eut l'idée d'un centre pouvant conduire à la concertation des chercheurs de l'ouest. Il a écrit de nombreux essais sur l'Église et le mouvement des francophones dans l'ouest canadien, sur les métis, sur le peuplement et le développement des communautés francophones, sur les luttes scolaires des minorités de langue française.
Jules Léger, d'origine acadienne, mais né aux États-Unis, fut l'un des fondateurs de l'Association des historiens de l'Atlantique. Professeur à l'Université de Moncton, sa contribution à la compréhension de la spécificité acadienne s'étend sur un axe qui couvre des écrits remarquables (Les Acadiens et la guerre de Sept-Ans) tout autant qu'une participation active à des commissions scientifiques, comme celle des monuments et sites historiques.
Messieurs Painchaud et Léger sont morts en même temps, le 23 juin 1978, lorsque l'avion qui les transportait comme membres de la Commission canadienne des Musées s'écrasa lors d'un voyage officiel dans les provinces de l'Atlantique.
Le texte de présentation au journal le Devoir
La Fédération des francophones hors Québec est heureuse de décerner au journal Le Devoir son deuxième prix Painchaud-Léger.
Le Devoir, par son goût pour l'excellence et par sa compréhension du sort des minorités de langue française au Canada, symbolise pour les autres médias et pour nous, un modèle à imiter. La qualité de ses textes de fond, son combat incessant pour l'amélioration du devenir de nos communautés, ainsi que sa passion à défendre la justice pour tous ont fait du journal Le Devoir un cas unique. Et cela depuis 75 ans!
Ottawa, 11 mai 1985 (remis au directeur, monsieur Jean-Louis Roy)
«Pour assurer le triomphe des idées sur les appétits, du bien public sur l'esprit de parti, il n'y a qu'un moyen: réveiller dans le peuple, et surtout dans les classes dirigeantes, le sentiment du devoir public sous toutes ses formes...» (Henri Bourassa, 10 janvier 1910)
Résolutions des jeunes participants (au nom de la Fédération des jeunes Canadiens-Français)
1- l'accessibilité aux études postsecondaires
A)
ATTENDU QUE le taux de participation aux études postsecondaires des francophones hors Québec, et ce tant au niveau des études de premier, deuxième et troisième cycle, demeure inférieur à la moyenne canadienne;
ATTENDU QUE le niveau des revenus des communautés francophones hors Québec demeure inférieur à la moyenne canadienne;
ATTENDU QUE les étudiants francophones hors Québec doivent dans plusieurs cas quitter leur province d'origine afin de poursuivre des études postsecondaires;
IL EST RÉSOLU qu'une refonte du système d'aide financière destinée aux francophones hors Québec soit effectuée par le Secrétariat d'État en collaboration avec les instances provinciales concernées;
IL EST RÉSOLU que cette refonte débouche à un accroissement substantiel des bourses allouées aux étudiants et plus particulièrement à ceux inscrits dans des programmes jugés prioritaires en regard du développement des communautés francophones hors Québec, en prenant en considération la hausse du coût de la vie et des frais de scolarité;
IL EST RÉSOLU que cette refonte contienne des dispositions spéciales afin de faciliter les déplacements pour fin d'études;
IL EST RÉSOLU que les programmes d'aide financière qui découleront de cette refonte soient publicises en collaboration avec les organismes francophones hors Québec;
B.
ATTENDU QUE les institutions d'enseignement situées à l'extérieur du Québec offrant des programmes à caractère scientifique dans la langue de Shakespeare;
ATTENDU QUE les institutions québécoises offrant des programmes dans la langue de Molière recrutent prioritairement des étudiantes issu(e)s de leur propre province;
IL EST RÉSOLU que la mise sur pied d'un réseau pan-canadien d'institutions d'enseignement collégial et universitaire soit planifié et négocié afin d'offrir intégralement des programmes dans les secteurs suivants:
- génie;
- science de la santé;
- technologie;
- services sociaux et communautaires.
IL EST RÉSOLU que des négociations soient entamées afin d'en arriver à des ententes relatives au transfert des crédits académiques d'une institution à l'autre;
C.
ATTENDU QUE les institutions postsecondaires doivent manifester une plus grande ouverture à l'égard du marché du travail;
ATTENDU Qu'une distinction quelque peu artificielle existe entre les collèges et les universités en ce qui a trait à leur mission respective;
IL EST RÉSOLU qu'une attention particulière soit accordée au concept de collège universitaire polyvalent.
2- éducation permanente
A.
ATTENDU QUE le phénomène de l'analphabétisme propre aux communautés francophones hors Québec constitue un obstacle de taille à la poursuite des études postsecondaires ;
IL EST RÉSOLU que les institutions d'enseignement consacrent des ressources significatives afin de résorber cette situation;
ATTENDU QUE les anglophones issus des programmes d'immersion constituent une clientèle potentielle pour nos institutions postsecondaires;
IL EST RÉSOLU que nous acceptions chaleureusement ces diplômés de niveau secondaire à l'intérieur d'institutions homogènes de langue française, en autant que tous acceptent que ces institutions soient francophones de coeur et de culture.
3- pour des programmes de qualité
A.
ATTENDU QUE l'affectation des ressources humaines et matérielles destinées au développement de matériel pédagogique et à l'utilisation des nouvelles technologies éducatives s'avèrent plutôt limitée;
IL EST RÉSOLU qu'un programme de recherche et d'intervention soit initié, un consortium regroupant les institutions d'enseignement fréquentées par les francophones hors Québec dans le but de pallier aux insuffisances existantes;
B.
ATTENDU QUE l'université est un lieu privilégié d'épanouissement social et culturel;
ATTENDU QUE l'implication au niveau étudiant apporte un meilleur épanouissement ;
IL EST RÉSOLU que toutes les universités à travers le Canada suivent l'exemple de l'Université Laval offrant des crédits pour l'implication étudiante.
4- le financement
ATTENDU QUE la Fédération des francophones hors Québec a initié une réflexion sur la question du financement des programmes de langues officielles dans l'enseignement, avec la publication de son rapport «À la recherche du milliard»;
IL EST RÉSOLU que la Fédération des francophones hors Québec réclame auprès du gouvernement fédéral l'élaboration de meilleures garanties en ce qui a trait à l'utilisation effective des sommes destinées au développement de programmes en français au niveau postsecondaire;
IL EST RÉSOLU que la Fédération des francophones hors Québec demande au Secrétariat d'État de compléter le rapport Johnson en y ajoutant une annexe relative à l'utilisation des fonds destinés pour le secteur francophone à l'extérieur du Québec.
Participants
|
Andrew, Caroline Science politique Université d'Ottawa, Ontario
Arbez, Gilbert Fédération des jeunes Canadiens-Français Ottawa, Ontario
Archambault, René Éducation pour la minorité francophone Ministère de l'Éducation Cravelbourg, Saskatchewan
Archibald, Clinton Politiques et management publics Faculté d'administration Université d'Ottawa, Ontario
Arsenault, Georges University of Prince Edward Island Charlottetown, I.-P.-E.
AuCoin, Jean-Roland Élaboration des programmes en français Ministère de l'Éducation Halifax, N.-Ecosse
Beaty, Stuart Bureau du Commissaire aux langues officielles Ottawa, Ontario
Beauchemin, Claire Université Laurentienne Sudbury, Ontario
Beaulieu, Claudette Éducation permanente Université de Moncton, N.-B. |
Beauregard, Élise Admissions Collège Algonquin Ottawa, Ontario
Bédard, Donat Expositions itinérantes Gouvernement du Québec
Bélanger, Denis Comité de travail, Centre de main-d'oeuvre Collège Northern Timmins, Ontario
Bélanger, Mignonne Fédération des femmes Canadiennes-Françaises Ottawa, Ontario
Bélanger-Cowie, Rosanne Fédération des femmes Canadiennes-Françaises Ottawa, Ontario
Bérubé, Rhéal Développement universitaire Centre universitaire de Moncton, N.-B.
Bilodeau, Florent Collège Mathieu Gravelbourg, Saskatchewan
Blanchard-Boudreau, Mireille Orientation professionnelle pour les femmes Collège Bathurst, N.-B.
Blouin, Charles University of Prince Edward Island Charlottetown, I.-P.-E.
Bourque, Jacqueline S.A.l.C. Gouvernement du Québec |
Bourque, Maurice Programmes en français Fédération canadienne des enseignants Ottawa, Ontario
Boyd, Robin Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Brassard, André Services en français Collège St-Laurent Cornwall, Ontario
Brisson-Noreau, Lise Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Brodeur, Nicole Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie Gouvernement du Québec
Brossard, Monique École secondaire Charlebois Ottawa, Ontario
Brun, Orner Société des Acadiens du Nouveau-Bru nswick
Carrier, Denis Vice-recteur adjoint à l'enseignement et à la recherche, Université d'Ottawa, Ontario
Charbonneau, Paul Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador |
(SUITE)
|
Chevrier, Richard Bureau du Commissaire aux langues officielles Ottawa, Ontario
Dallaire, Margot Collège Cambrian Sudbury, Ontario
Daniel, John Recteur, Université Laurentienne Sudbury, Ontario
D'Augerot-Arend, Sylvie Études pluridisciplinaires Collège universitaire Glendon, Toronto, Ontario
DeMuy, Guylaine ACFO Ottawa-Carleton Ottawa, Ontario
D'Entremont, Danielle Fédération acadienne de la Nouvelle-Ecosse
Desjardins, Pierre-Marcel Fédération des jeunes Canadiens-Français Dieppe, N.-B.
Dignard, Serge Éducation permanente Université Laurentienne Sudbury, Ontario
Dionne, Raoul Faculté des Arts Université de Moncton, N.-B.
Doiron, Roger F.F.H.Q. Ottawa, Ontario
Douville, Lucie Bureau du Commissaire aux langues officielles Edmonton, Alberta
Drainville, Bernard Fédération des étudiants de l'Ontario Toronto Ontario |
Dubé, Roxanne Université d'Ottawa, Ontario
Dubois, Gustave Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan, Régina
Duguay, Huguette Société St-Thomas d'Aquin Summerside, l.-P.-E.
Dumont, Donald Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
Duprey, Donald TV Ontario Toronto, Ontario
Etienne, Gérard Communications Université de Moncton, N.-B.
Filion, Jacqueline Collège Georgian Barrie, Ontario
Finn, Gérard Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Finn, Jean-Guy Sous-ministre, ministère des Collèges communautaires Frédéricton, N.-B.
Fortier, D'Iberville Commissaire aux langues officielles Ottawa, Ontario
Fortin, Denis Services en français Collège Northern Timmins, Ontario
Fortin, Toussaint Doyen des études de premier cycle, Université du Québec à Hull |
Frappier, Roger Collège de technologie agricole et alimentaire d'Alfred, Ontario
Friolet, Yseult Fédération des Franco-Colombiens Vancouver, C.-B.
Gagnon,Jean Institut canadien de recherche sur le développement régional Université de Moncton, N.-B.
Gagnon, Renaud Sciences de l'éducation Université du Québec à Chicoutimi, Québec
Gallant, Marius Ass. des conseillers scolaires du Nouveau-Brunswick Atholville, N.-B.
Garand, Linda Fédération des jeunes Canadiens-Français Ottawa, Ontario
Garigue, Philippe Collège universitaire Glendon, Toronto, Ontario
Gédéon, Jacques Directeur de l'information CBOFT Radio-Canada Ottawa, Ontario
Gélineau, Guy Vice-recteur U.Q.U.A.M. Montréal, Québec
Gervais, Gaétan Directeur de l'enseignement en français Université Laurentienne Sudbury, Ontario |
(SUITE)
|
Gilbert, Fernand A.C.F.O. Ottawa, Ontario
Gillmore, Allan Ass. des Univ. et Collèges du Canada, Ottawa, Ontario
Goldenberg, Mark Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Guindon, Raymond Collège Northern Timmins, Ontario
Guindon, René A.C.F.O. Ottawa, Ontario
Gour, Alcide Collège Cambrian Sudbury, Ontario
Hamel, Bruno Université de Moncton, N.-B.
Hanson, Raymonde Sciences de la santé Collège Algonquin Ottawa, Ontario
Hébert, Gérard Fédération canadienne des Sciences sociales Ottawa, Ontario
Hébert, Raymond Collège universitaire St-Boniface, Manitoba
Henderson, Sandra Association des Franco-Yukonnais Whitehorse, Yukon
Héroux, Gilbert Collège universitaire de Hearst, Ontario
Isabelle, Laurent Ancien directeur du collège Algonquin Ottawa, Ontario |
Jutras, Daniel Association canadienne d'Éducation de langue française, Sillery, Québec
Kempo, Olga Études québécoises Collège Capilano Vancouver, C.-B.
Lacombe, Claude Ministère des Collèges et Universités, Toronto, Ontario
Lacombe, Trefflé Commission de la Fonction publique, Ottawa, Ontario
Lafontant, Jean Sociologie Collège St-Boniface, Manitoba
Laforêt, René Expositions itinérantes Gouvernement du Québec
Lalande, Gilles Sous-commissaire aux langues officielles Ottawa, Ontario
Lalonde, André Centre d'études bilingues Université de Régina, Saskatchewan
Lalonde, Roger Calgary, Alberta
Landry, Alain Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Landry, Monique Secrétaire parlementaire Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Lapointe, Jean Sociologie Université d'Ottawa, Ontario |
Lapointe, Maryse Fédération des jeunes Canadiens-Français Edmonton, Alberta
Larocque, Gabriel Collège Canadore North Bay, Ontario
Lavoie, Pauline Fédération des jeunes Canadiens-Français Ottawa, Ontario
Leblanc, Claude Fédération des jeunes Canadiens-Français, N.-B.
Le Blanc, Gilles Fédération acadienne de la Nouvelle-Ecosse
Le Blanc, Jean-CLaude Bureau du Commissaire aux langues officielles Ottawa, Ontario
LeBlanc, Lomer Collège d'Edmunston, N.-B.
Le Blanc, Ronald Département d'économie Université de Moncton, N.-B.
Légère, Robert Association canadienne des professeurs d'universités Ottawa, Ontario
Leibu, Ygal U.Q.A.M. Montréal, Québec
Lemoyne, Hilaire Secrétariat d'État Ottawa, Ontario
Lepage, André-Pierre Sciences de la santé Collège Algonquin Ottawa, Ontario |
(SUITE)
|
Lévesque, Jacqueline Association des Enseignantes/Enseignants franco-ontariens Ottawa, Ontario
Lortie, Gilles Société franco-manitobaine St-Boniface
Loveless, Glenn Ministère de l'Éducation St-Jean, Terre-Neuve
Luke, Michael Département de français Université Memorial St-Jean, T.-N.
MacDonald, Paule Canadian Parents for French, Vancouver, C.-B.
Mclntyre, Gérard Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) Toronto, Ontario
McLaughlin, Adrienne Collège Algonquin Ottawa, Ontario
McLaughlin, Yvonne Association des conseillers scolaires, Moncton, N.-B.
McLean, Walter (Honorable) Secrétaire d'État du Canada Ottawa, Ontario
McMahon, Frank Faculté St-Jean Université de l'Aberta, Edmonton
Maisonneuve, Jean-Pierre Fédération des jeunes Canadiens-Français Ottawa, Ontario
Malette, Claude Gouvernement du Québec Secrétariat aux affaires in ter-gouvernementales canadiennes |
Malenfant, Louis Sciences de l'éducation Université de Moncton, N.-B.
Mann-Trofimenkoff, Susan Université d'Ottawa, Ontario
Marchildon, Michel Fédération des jeunes Canadiens-Français Régina, Saskatchewan
Mayrand, Robert Collège Algonquin Ottawa, Ontario
Merzisen, Yves Littérature québécoise Collège Caribou Kamloops, C.-B.
Messier, Jean Université du Québec à Hull
Michaud, Renée Université de l'Alberta Edmonton
Neatby, Jacqueline Promotion des services en français en Ontario Ottawa, Ontario
Nogue, Alain Association canadienne-française de l'Alberta
Obadia, André Faculté d'éducation Université Simon Fraser Barnaby, C.-B.
Ouellette, Jocelyne Bureau du Québec à Ottawa, Ontario
Paquet, Gilles Faculté d'administration Université d'Ottawa, Ontario |
Patry, Pierre Coopération extérieure Montréal, Québec
Paulhus, Marcel Collège de technologie agricole et alimentaire d'Alfred, Ontario
Pelletier, Pierre Éducation permanente Université d'Ottawa, Ontario
Poirier, Lionel Faculté d'arts appliqués Collège Algonquin Ottawa, Ontario
Potvin, Monique Direction Jeunesse Ottawa, Ontario
Préfontaine, Marielle Enseignement et recherche Université de Moncton, N.-B.
Rabinovitch, Robert Sous-secrétaire d'État Ottawa, Ontario
Raymond, Gérard Collège communautaire de Bathurst, N.B.
Régimbald, Wilda Collège Northern Timmins, Ontario
Robard, Andrée Chimie, Biochimie et physique, Collège Algonquin Ottawa, Ontario
Robichaud, Gary Fédération des jeunes Canadiens-Français île-du-Prince-Edouard
Robichaud, Jean-Marc Ministère de l'Enseignement supérieur du Québec
|
(SUITE)
|
Roy, Guy Bureau de l'éducation française Winnipeg, Manitoba
Roy, Jean-Louis Journal Le Devoir Montréal, Québec
Roy, Luc Fédération des jeunes Canadiens-Français St-Boniface, Manitoba
Ruest, Paul Collège St-Boniface, Manitoba
Runte, Roseann Université Ste-Anne, Pointe-de-l'Église, N.-E.
Ryan, Claudette Retour au travail Collège Algonquin Ottawa, Ontario
St-Denis, Yves F.F.H.Q. Samson, Real Département de pédagogie Université Ste-Anne, N.-E.
Sargent, Janice Canadian Parents for French, Ottawa, Ontario
Savard, Pierre Centre de recherche en civilisation canadienne-française Université d'Ottawa, Ontario |
Schweiger, Helmut Commission de l'enseignement supérieur des Maritimes Frédéricton, N.-B.
Shapiro, Bernard Ontario Insitute for Studies in Education, Toronto, Ontario
Socque, Marcel Bureau du Québec à Ottawa, Ontario St-Jacques, Bernard Département of Linguistics University of B.C., Vancouver
St-Louis, Natalie Fédération des jeunes Canadiens-Français Moncton, N.-B.
Tardif, Claudette Programme de pédagogie Faculté St-Jean Université de l'Alberta, Edmonton
Thomas, Mireille Département de français Université Memorial St-Jean, T.-N. |
Tremblay, Onésime Conseil de l'éducation franco-ontarienne Toronto, Ontario
Vachon, Diane Fédération des femmes canadiennes-françaises Ottawa, Ontario
Vachon, Roger Conseil consultatif de langue française Collège Northern Timmins, Ontario
Vienneau, Jean-Guy Faculté d'éducation Université de Moncton, N.-B.
Vigeant, Nicole Collège Niagara Welland, Ontario
Watters, Jean Éducation permanente Faculté St-Jean Université de l'Alberta, Edmonton
Whelan, Marcia Société St-Thomas d'Aquin Summerside, I.-P.-E
Wilhem, Bernard Département de français Université de Régina, Saskatchewan |
DU BUREAU DE LA F.F.H.Q.
Gareau, Céline
Kemp, Johanne
Larocque, Manon
Marcoux, Roland
Morin, Jacinthe
Paiement, René-Marie