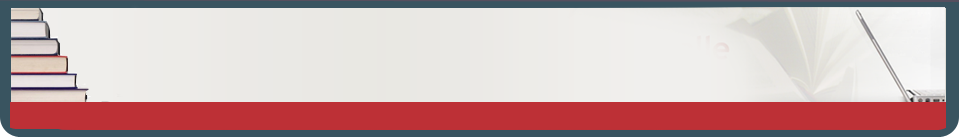DES COMMUNAUTÉS EN ACTION
Politique de développement global à l'égard des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire
|
|
FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ET ACADIENNE du Canada
Document présenté
au président du Conseil privé, ministre des Affaires intergouvernementales et ministre responsable des langues officielles
l'honorable Stéphane Dion
Ottawa, mai 2002
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
À la suite du discours du Trône du 30 janvier 2001, où le gouvernement canadien renouvelait son engagement à l'égard des communautés minoritaires de langue officielle et du renforcement de la culture et de la langue françaises, le président du Conseil privé et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Stéphane Dion, a été nommé à la fonction de responsable des langues officielles. Présentement, le ministre élabore un cadre d'action pour renforcer l'appui accordé aux communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, ce que nous espérons être une véritable politique de développement global. Nous pourrions résumer en une seule phrase toute la mesure de nos aspirations à l'égard de nos attentes envers le gouvernement fédéral : travailler en amont plutôt qu'en aval; cesser d'être en réaction aux demandes répétées des communautés francophones et acadiennes et être véritablement proactif dans notre propre développement.
Notre démarche vise à appuyer les efforts du ministre à formuler un cadre d'action qui réponde, entre autres, aux besoins et aux aspirations des communautés francophones minoritaires. Si leurs besoins varient, toutes partagent une aspiration commune : celle de pouvoir vivre et se développer en français partout au Canada.
Dans cette perspective, la politique de développement global proposée comprend des mesures politiques qui visent à renforcer le régime d'application de la Loi sur les langues officielles ainsi qu'un cadre d'action pour chacun des différents secteurs d'intervention jugés prioritaires par les communautés francophones et acadiennes, mais non pas exclusifs, tels que les arts et la culture, les communications, le développement communautaire, le développement économique et l'employabilité, l'éducation, la francophonie internationale, l'immigration, la justice et, enfin, la santé.
Avec la collaboration d'organismes francophones porte-parole de ces secteurs, nous soumettons une démarche appropriée à chacun des secteurs en matière d'action. À cet effet, nous avons donc identifié pour chacun des neuf secteurs concernés les principes sur lesquels repose la responsabilité du gouvernement fédéral à l'égard du secteur en question, un diagnostic de la situation actuelle pour chaque secteur, des propositions d'objectifs à atteindre pour le gouvernement fédéral, et des pistes d'action à entreprendre mutuellement (communautés et ministères et/ou agences gouvernementales).
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada encourage donc fortement le ministre à élaborer une politique de développement global de la francophonie canadienne, afin que son cadre d'action englobe des mesures qui viendront activer de front les divers leviers de développement communautaire.
LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES
La FCFA du Canada reconnaît les bienfaits d'un accroissement du bilinguisme partout au pays, mais pour les communautés, leur épanouissement passe d'abord et avant tout par l'acquisition, d'une manière permanente, d'institutions et de services qui leur permettront de vivre et de se développer en français.
La FCFA du Canada estime donc que le cadre d'action fédéral devrait mettre l'accent plus spécifiquement sur le renforcement et la promotion des institutions et des infrastructures communautaires francophones. Ces deux volets doivent nécessairement s'entrecroiser puisqu'ils sont interdépendants : les communautés peuvent grandement bénéficier d'un accroissement du bilinguisme au Canada, mais en revanche, les Canadiennes et les Canadiens n'auront plus grand intérêt à devenir bilingues le jour où les communautés francophones et acadiennes auront cessé de s'épanouir, faute d'avoir pu se développer efficacement.
Le leadership du gouvernement fédéral doit s'exercer afin que les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire puissent vivre dans leur propre langue dans leur milieu en tant que communautés fortes, dynamiques et inclusives, participer pleinement à tous les secteurs de la société canadienne et assurer leur développement à long terme.
L'IMPORTANCE D'UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT GLOBAL
Le cadre d'action doit reposer sur une politique de développement global de la francophonie canadienne, politique qui viendrait préciser et clarifier l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des communautés, ainsi que la portée des obligations énoncées à la Partie VII de la Loi sur les langues officielles.
À ce jour, la Loi sur les langues officielles s'est avérée insuffisante pour assurer la permanence des diverses initiatives instaurées pour appuyer le développement des communautés. Les mesures en ce sens dépendent encore trop souvent du simple intérêt ou de la volonté des dirigeants en place, et sont menacées de sombrer dans l'oubli avec le départ des personnes qui les ont amorcées. L'un des grands défis de la politique de développement global consiste à enrayer la précarité des acquis et à garantir une certaine pérennité, sinon la continuité des programmes d'appui destinés aux communautés francophones.
Une politique de développement global doit relever un autre défi important : réorienter l'approche fédérale pour qu'elle se fonde non plus sur la réalisation de projets épars, comme c'est actuellement le cas, mais plutôt sur une action concertée qui inciterait les ministères et organismes gouvernementaux à intégrer les considérations relatives au développement des communautés au moment même où ils élaborent leurs politiques et leurs programmes ministériels.
L'idée n'est pas nouvelle. Deux ans après sa création en 1975, la FCFA du Canada, alors la Fédération des francophones hors Québec, identifiait dans son manifeste, Les héritiers de Lord Durham, une politique globale du gouvernement fédéral comme étant la condition essentielle à l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire :
« Cet étalage public et définitif de notre désillusion collective pourra sembler brutal. Pourtant toutes nos communautés la vivent. Toutes se sont penchées sur leurs besoins réels. Toutes ont défini les conditions minimales sans lesquelles elles ne pourront plus résister longtemps aux pressions du milieu ambiant. Ces conditions minimales devront se traduire par une politique globale, précise, cohérente, et définitive de développement des communautés de langue et de culture françaises. Voilà le critère ultime du jugement que l'on portera sur ce pays.» Les héritiers de Lord Durham, FFHQ, vol. 1, 1977, p. 13
En 1993, la FCFA du Canada réitérait sa demande auprès du gouvernement fédéral en lui transmettant un document intitulé À la recherche d'une politique de développement de la francophonie.
L'égalité linguistique est un élément fondamental de la structure même du Canada. Les francophones ont participé à la fondation du pays, ont contribué à son développement et continuent d'y jouer un rôle actif et important. Les communautés francophones sont présentes dans toutes les provinces et tous les territoires. Comme il y a vingt-cinq ans, chacune des communautés francophones et acadiennes du Canada connaît ses réels besoins en matière de développement que l'on peut retrouver dans chaque plan de développement global respectif ainsi que dans les plans de développement nationaux de certains secteurs. Le gouvernement fédéral doit s'en inspirer.
UNE VISION COMMUNE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
Les droits constitutionnels des communautés francophones et acadiennes sont de plus en plus reconnus par la Constitution, par les tribunaux et par les législateurs. Le paragraphe 16(3) représente l'expression constitutionnelle de cette réalité. Tous les parlements provinciaux et territoriaux ont des obligations constitutionnelles à l'égard des communautés francophones et acadiennes, ne serait-ce qu'en matière d'éducation et de droit à des établissements d'instruction publique gérés par les communautés. Le Parlement du Canada a aussi ses propres responsabilités constitutionnelles. De plus, le Parlement s'est doté d'une loi, la Loi sur les langues officielles, qui quasi constitutionnalise plusieurs droits très précis et donne ainsi au gouvernement fédéral des obligations d'agir, voire des obligations de résultats.
Également, les récents arrêts de la Cour suprême du Canada confirment, notamment dans le Renvoi sur la sécession du Québec ainsi que dans les arrêts Beaulac et Arsenault-Cameron, que toute interprétation d'un droit linguistique doit se faire en fonction de l'objet de ce droit. Par exemple, l'article 23 de la Charte traite du droit à l'instruction et à la gestion, mais son objet est réparateur en ce que l'article 23 doit remédier à des injustices passées et cherche ainsi à corriger ces situations d'injustice.
Aussi, on indique clairement dans l'arrêt Beaulac que les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. La plus haute instance du pays ajoute qu'il existe une égalité réelle des droits linguistiques et que cette égalité réelle a une signification. « Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l'État. » La Cour suprême du Canada poursuit sa pensée en indiquant que dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
De multiples observateurs l'ont remarqué : les gestionnaires de la fonction publique, pris dans leur ensemble, comprennent mal les articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. Nombre d'entre eux n'y lisent que des exigences relatives à la prestation de services dans les deux langues officielles. Nul doute que, comme leurs concitoyens, la majorité des gestionnaires chérissent la dualité linguistique qui distingue fondamentalement la fédération canadienne. Toutefois, ils considèrent généralement que la promotion de cette dualité relève principalement du ministère du Patrimoine canadien.
Les politiques et les programmes formulés par les divers ministères et organismes se fondent généralement sur une vision du Canada où la dualité linguistique s'articule bien plus autour de pôles géographiques (Canada anglais -Québec français) que de pôles véritablement linguistiques (composés de communautés variées, dispersées à travers le pays).
Il y a à peine un an, plusieurs organisations représentatives de la diversité canadienne adhéraient à une vision commune de la société canadienne au moment de la signature d'un pacte d'amitié qui venait conclure la tournée du groupe de travail Dialogue mis sur pied par la FCFA du Canada. Cette vision de la société canadienne se rapporte essentiellement au concept de la citoyenneté, élément de solidarité de premier ordre, et elle peut être définie de différentes façons. Elle est influencée par des réalités historiques, géographiques, socio-politiques, juridiques, économiques et autres. À la lumière des constats qu'il a dressés au cours de sa tournée nationale, le groupe de travail Dialogue proposait une vision de la société canadienne axée sur trois principes interdépendants, soit l'équité, la diversité et la communauté.
Équité
Respecter le principe de l'équité, c'est offrir à chaque citoyen et citoyenne de la société canadienne toutes les chances possibles afin que tous parviennent à des résultats égaux, peu importe leur condition. Du principe de l'équité découle notamment l'asymétrie des moyens : le régime de péréquation et l'universalité des services de soins de santé en sont des exemples d'application.
Diversité
Appuyer le principe de la diversité, c'est reconnaître que l'interaction entre les diverses composantes d'une société entraîne de meilleurs résultats. C'est aussi encourager l'idée que différentes perspectives permettent une prise de décision plus juste et éclairée dans le respect des spécificités raciales, linguistiques, culturelles, religieuses, régionales, etc. Au Canada, la diversité est ancrée dans la Constitution, notamment par les articles traitant des langues officielles, du multiculturalisme et des peuples autochtones.
Communauté
La communauté, c'est la cohabitation de la diversité et de l'équité. C'est adhérer, en tant que citoyens et citoyennes, à des valeurs sociales communes et assumer ses responsabilités individuelles et collectives en contribuant au développement de la société canadienne. Le principe de la communauté est en redéfinition constante.
La solidarité intercommunautaire et le respect mutuel, comme valeurs communes, se sont ajoutés à l'énoncé du groupe de travail Dialogue. Pour nous des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, être citoyens canadiens, c'est vivre pleinement notre francophonie dans le respect et l'ouverture aux autres, tout en étant conscients que les langues officielles sont un gage de l'identité canadienne.
Le cadre d'action doit clairement énoncer la vision du Canada sur laquelle les décideurs doivent se fonder lorsqu'ils formulent leurs programmes et leurs politiques : une société pluraliste qui réunit deux communautés de langue officielle et au sein de laquelle les francophones vivant à l'extérieur du Québec ne sont pas des citoyens de second plan; une société qui reconnaît aux francophones qui y vivent le droit quasi constitutionnel de se développer et de s'épanouir dans leur langue. Cela signifie, au bas mot, que les francophones puissent profiter des politiques et des programmes fédéraux aussi pleinement que leurs concitoyennes et concitoyens de la majorité anglophone.
TENIR COMPTE DES BESOINS DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DÈS L'ÉLABORATION DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES
Pourtant, l'élaboration de politiques et de programmes applicables à l'extérieur du Québec se fonde généralement sur le seul examen des besoins de la population majoritaire anglophone. Le cadre d'action doit clairement indiquer aux décideurs qu'ils ne doivent plus négliger les besoins de la communauté minoritaire de langue officielle lorsqu'ils conçoivent leurs politiques et leurs programmes. Ces derniers devraient dorénavant tenter de répondre aux besoins, souvent fort différents, des deux communautés de langue officielle : la majoritaire ET la minoritaire.
Le cadre d'action doit faire en sorte que la promotion et l'épanouissement des minorités linguistiques se fassent aux étapes initiales de l'élaboration des politiques et des programmes plutôt qu'après coup. Trop souvent, la responsabilité d'assurer que les programmes, les politiques et l'attribution des fonds tiennent comptent des besoins des communautés dépend uniquement de celles-ci qui doivent réagir à un fait accompli plutôt que de participer à l'étape de l'idéation. Face à des programmes qui sont mal adaptés à leur situation, les communautés n'ont d'autre choix que de réagir en toute dernière ligne pour exprimer leurs besoins et elles se voient fréquemment opposer une fin de non-recevoir.
La FCFA du Canada considère qu'il revient au Cabinet et au Parlement d'exercer une pression pour inciter les hauts fonctionnaires de tous les ministères à s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Constitution canadienne, mais aussi en vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles. Lorsqu'une politique ou un programme est envisagé, les gestionnaires de l'État devraient être tenus d'en orienter un volet vers les minorités francophones et acadiennes, pour que la politique ou le programme en question soit adapté à leur situation particulière et que leurs membres puissent en profiter pleinement. De telles pressions seront beaucoup plus efficaces si elles émanent des plus hautes instances du pouvoir que si elles proviennent d'un seul ministère comme Patrimoine Canada ou, a fortiori, des seules communautés.
On demande désormais à tous les gestionnaires fédéraux de modifier leurs politiques et leurs programmes pour tenir compte des incidences de la Charte. De la même manière, le cadre d'action devrait empêcher qu'on puisse prendre des décisions effectives sur les programmes et les politiques sans tenir compte de leurs conséquences sur les communautés linguistiques. Lorsque de telles conséquences existent (en fonction de critères préétablis qui devraient être énoncés dans le cadre d'action), les mémoires soumis au Cabinet concernant une initiative susceptible d'influencer le développement des communautés devraient inclure une évaluation des besoins des deux communautés, soit la majoritaire et la minoritaire de langue officielle.
Afin de prendre en considération les besoins des communautés francophones dès l'élaboration des politiques et des programmes, un système de soutien pour la prise en compte des besoins des communautés devrait être mis sur pied en collaboration avec les organismes francophones concernés pour appuyer les gestionnaires à cet égard.
L'INTÉGRATION DE MÉCANISMES DE CONSULTATION
Un tel système de soutien à la collecte et à l'examen des renseignements pertinents devrait comporter un mécanisme de consultation auprès des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Il convient de souligner qu'il ne s'agit nullement d'alourdir le processus décisionnel outre mesure, mais de tenir compte des besoins des communautés dans les prises de décisions gouvernementales.
Le mécanisme servirait à informer les communautés concernées de l'initiative envisagée, des impératifs politiques, des priorités et des objectifs ministériels, pour qu'elles puissent ajuster leurs démarches en conséquence. Le mécanisme permettrait aussi aux communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire d'expliquer en quoi et pourquoi l'initiative devrait être adaptée, et il leur donnerait l'occasion de faire valoir leurs préoccupations pour qu'elles puissent être prises en compte par les décideurs.
L'apport des organismes de la francophonie en milieu minoritaire est essentiel au travail des gestionnaires de l'État dans la perspective de la prise en compte des besoins des communautés. Au fil des ans, les communautés se sont constituées en réseaux bien développés, tant sur les plans régionaux que sectoriels. Elles se sont dotées d'instances spécialisées dans les domaines les plus névralgiques de leur développement, tels que l'éducation, le développement communautaire, le développement économique, les arts et la culture, etc. Le gouvernement fédéral a tout avantage à tirer profit de cette expertise pour s'informer des préoccupations et des priorités des communautés dans chacun de ces secteurs, dans chacune des régions du Canada.
La FCFA du Canada est fort consciente des multiples contraintes auxquelles les dirigeants des ministères font face dans l'élaboration de leurs politiques et de leurs programmes. Mais si le gouvernement a réellement l'intention de renforcer son appui aux communautés, il doit reconnaître que ses ministères et organismes ne réussiront jamais à le faire s'ils ne sont pas au fait des besoins particuliers auxquels ils ont l'obligation de répondre et de la capacité des communautés à donner suite aux initiatives qui les concernent.
MIEUX ENCADRER LA MISE EN OEUVRE DE LA PARTIE VII DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Le cadre d'action devrait permettre de corriger les problèmes de mise en œuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles : d'une part, en clarifiant et en expliquant clairement aux hauts fonctionnaires la portée de leurs obligations et, d'autre part, en instaurant des mesures d'imputabilité pour les inciter à s'y conformer. À cet égard, nous croyons que le Conseil privé a un rôle crucial à jouer en ce qui touche la responsabilité du gouvernement fédéral à l'égard du cadre d'action qui sera proposé.
Plusieurs avenues méritent d'être explorées. Les critères d'évaluation de rendement des ministères et de leurs dirigeants pourraient par exemple tenir compte de leur performance à l'égard de la Partie VII. Le cadre d'action devrait, en outre, envisager la possibilité d'inclure un régime de retrait qui obligerait les ministères qui n'adaptent pas leurs initiatives aux besoins des communautés à mettre à la disposition de ces dernières, directement ou indirectement, les sommes nécessaires pour qu'elles puissent, elles aussi, pleinement bénéficier de l'initiative en question. Il s'agirait, ni plus ni moins, d'une sorte de dévolution vers les communautés.
Une des options que le gouvernement fédéral peut certainement envisager, en fonction des conditions mêmes de l'Entente sur l'union sociale du 4 février 1999, est de pourvoir un financement direct à des organismes afin de voir aux soins de santé, à l'éducation postsecondaire, à l'aide sociale, aux services sociaux ou à tout ce qui touche la petite enfance. Cela va également dans le sens des recommandations du rapport du Groupe de travail sur les transformations gouvernementales et les langues officielles de janvier 1999 qui prévoit, par le truchement de projets-pilotes, la possibilité d'établir des partenariats avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire en vue de la prestation de certains services par ces dernières.
De plus, lorsqu'il agit dans un champ de compétence provincial, le gouvernement fédéral devrait prévoir un programme ou des directives spécifiques, adaptées aux besoins des communautés francophones et acadiennes. Pour les fins de la discussion, établissons le parallèle avec la question de la gestion scolaire. Nous savons que l'éducation est de compétence provinciale. Nous savons aussi que le gouvernement fédéral octroie des fonds aux provinces et aux territoires, par l'entremise de son pouvoir fédéral de dépenser, afin que les provinces et les territoires accordent la gestion scolaire à leurs communautés minoritaires. Or, il est conséquent pour le gouvernement fédéral, en mettant en place des objectifs pancanadiens sur de nouveaux programmes sociaux, de prévoir un financement adéquat pour les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire. En d'autres termes, la province ou le territoire pourrait se voir accorder une dévolution dans un domaine social particulier ou gérer un nouveau programme. Ce faisant, le gouvernement fédéral assumerait en parallèle un financement adéquat pour les communautés, comme c'est le cas pour la gestion scolaire. De plus, l'Entente de février 1999 sur l'union sociale canadienne permet justement ce genre d'initiative du gouvernement fédéral.
MÉCANISME D'IMPUTABILITÉ
Afin d'être réellement efficace, le cadre d'action doit impérativement comporter un mécanisme d'imputabilité. Concernant la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, le ministère de la Justice du gouvernement fédéral a une interprétation avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. On y dit que cette partie est un engagement sérieux et solennel, certes, du gouvernement, mais qui ne crée ni de droits, ni d'obligations de la part du gouvernement. Pour des raisons évidentes, nous ne partageons pas cette opinion.
Cela dit, afin d'éviter de nous retrouver devant les tribunaux encore une fois - processus beaucoup trop long et coûteux pour tous, surtout pour nos communautés - et afin d'éviter de nous retrouver dans une impasse, le cadre d'action doit prévoir dès maintenant des mesures précises d'imputabilité des actions du gouvernement fédéral. Le Rapport du Groupe de travail sur les transformations gouvernementales et les langues officielles pour le compte du Conseil du Trésor, précité, mentionnait expressément l'importance de prévoir un tel régime d'imputabilité devant le Parlement :
« Dans le cas des transformations gouvernementales qui sont déjà chose faite, le Groupe de travail partage la préoccupation des organismes porte-parole des communautés de langue officielle en situation minoritaire quant au respect des dispositions applicables en matière de langues officielles. Nous considérons que le gouvernement doit se pencher attentivement sur le régime d'imputabilité en place et voir comment il est appliqué. » Maintenir le cap : La dualité linguistique au défi des transformations gouvernementales, SCT, 1999, p. 44
Au minimum, une agence centrale telle que le Conseil privé devrait répondre au Parlement quant aux actions entreprises dans la poursuite des objectifs visés par le cadre d'action. Selon un rapport préparé par le professeur Donald J. Savoie, au mois de juin 1996, le Comité mixte permanent des langues officielles concluait qu'il était nécessaire d'agir rapidement pour renforcer la mise en œuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles et il a formulé des recommandations visant une plus grande participation des organismes centraux. De plus, dans un rapport sur la mise en œuvre de la Partie VII, aussi en date de 1996, le professeur Savoie mentionne que le commissaire aux langues officielles fait des recommandations « sur un large éventail de questions concernant l'appareil gouvernemental, allant du rôle véritable du Bureau du Conseil privé dans la mise en œuvre de la Partie VII à celui du Secrétariat du Conseil du Trésor dans les pratiques d'approvisionnement du gouvernement fédéral. »1
Nous pouvons nous demander à quoi bien servirait d'obtenir une politique de développement global si le gouvernement, au gré de sa volonté du jour, décide d'en changer les règles du jeu. Les communautés francophones et acadiennes savent depuis longtemps, trop longtemps, comment il importe de pouvoir compter sur des garanties solides lorsque vient le temps de mettre en œuvre nos droits. Rappelons encore une fois que nous ne parlons pas nécessairement de droits linguistiques, mais de droits comme citoyens.
Rien n'empêche le gouvernement de proposer un règlement en fonction de la Partie VII. Après tout, il existe bien un règlement qui édicte les directives à suivre dans le cas de la Partie IV. Un tel règlement aurait l'avantage de ne pas avoir à revoir la Loi sur les langues officielles devant le Parlement canadien comme le propose le sénateur Jean-Robert Gauthier avec son projet de loi S-32. Comprenons-nous bien cependant. Nous appuyons toujours les démarches en faveur du projet de loi S-32 puisque nos communautés ne croient plus aux changements tant souhaités lors de l'entrée en vigueur de la Partie VII en 1988.
Un tel règlement pourrait, nous croyons, clarifier la portée de l'engagement du gouvernement fédéral et de ses institutions. Le règlement pourrait, par exemple, identifier les institutions clés qui seraient associées au cadre d'action du gouvernement. De plus, il serait souhaitable d'exiger, dans un tel règlement, les conditions précises que doivent remplir ces institutions afin de bien performer à l'intérieur des paramètres établis dans le cadre d'action. En somme, le règlement pourrait être le cadre d'action du gouvernement fédéral tout simplement. Les institutions seraient, comme nous le proposons, redevables auprès d'une agence centrale que nous souhaitons être le Conseil privé.
ORIENTATIONS ET POLITIQUES
Le regretté sénateur Jean-Maurice Simard, dans son rapport De la coupe aux lèvres : un coup de cœur se fait attendre, publié au mois de novembre 1999, recommandait la nomination d'un ministre d'État au développement des communautés de langue officielle qui aurait la responsabilité particulière d'assurer le respect de la Loi constitutionnelle de 1982 et d'orchestrer la mise en œuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles à l'échelle de l'ensemble du gouvernement, en plus d'encadrer l'élaboration et l'exécution des programmes d'appui au développement des communautés.
Le sénateur Simard proposait également la création d'un groupe au sein du Bureau du Conseil privé qui aurait pour mandat d'assumer le leadership et l'imputabilité de la stratégie gouvernementale et d'orchestrer l'action de l'ensemble du gouvernement.
Toujours au mois de novembre 1999, le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, monsieur Mel Cappe, confiait un mandat renouvelé au Comité des sous-ministres responsables des langues officielles (CSMLO). Depuis cette date, le mandat élargi et renforcé du CSMLO s'articule autour de six piliers dont celui de l'évaluation générale du dossier des langues officielles et la définition des orientations communes quant aux politiques du gouvernement à cet égard. Présidé par le sous-ministre des Affaires intergouvernementales, le CSMLO reçoit son mandat du greffier du Conseil privé au nom de la collectivité des sous-ministres, et c'est à lui qu'il est imputable quant aux différents aspects de son mandat.
Au niveau ministériel, il nous semble tout à fait pertinent que le ministre responsable des langues officielles, qui est de surcroît le président du Conseil privé, soit responsable des orientations et des politiques du gouvernement fédéral à l'égard des langues officielles. Le Premier ministre lui a confié des responsabilités accrues en matière de langues officielles, soit de coordonner certains dossiers de nature transversale et d'appuyer les ministres ayant des responsabilités sectorielles dans le domaine des langues officielles. Dans sa fonction, le ministre préside un groupe de référence ministériel sur les langues officielles. Pour que son mandat soit complet et réel, il faudrait que le ministre puisse aussi diriger l'élaboration des objectifs stratégiques et des grandes initiatives gouvernementales afin de s'assurer que ceux-ci aient des incidences positives, réelles et structurantes sur le développement des communautés francophones et acadiennes du Canada.
Il ne s'agit nullement que le ministre se substitue aux responsabilités des ministères et agences gouvernementales dans la gestion de leurs programmes respectifs. Au contraire, chaque ministère et agence gouvernementale doit s'acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les langues officielles.
La mission du ministre serait d'assurer un leadership intégré qui permettrait la convergence des orientations et des politiques du gouvernement fédéral à l'égard des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, tout en assumant la responsabilité de susciter et d'encourager une plus grande imputabilité collective de l'appareil gouvernemental quant à son engagement à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français dans la société canadienne ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire partout au pays. Afin d'assurer aux communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire que le gouvernement fédéral prend cet engagement très au sérieux, mais aussi, et surtout, afin de lier les prochains gouvernements, cette responsabilité serait garantie par un règlement tel que mentionné précédemment.
LE DIALOGUE
L'histoire du Canada nous a appris dès ses origines que les rapports entre les trois grandes communautés (francophone, anglophone et autochtone) joueraient un rôle important dans l'évolution du pays. Les relations entre les différentes communautés linguistiques habitant au pays ont grandement contribué à façonner les multiples identités canadiennes.
S'il est vrai que le Canada est un pays fondé sur la diversité, il n'en reste pas moins que des défis importants se posent sur le plan des relations entre les divers groupes qui le composent.
Il nous apparaît à propos de relever certains facteurs qui semblent exercer une influence prédominante. Inéluctablement, les événements et la conjoncture politique des dernières décennies ont joué un rôle déterminant dans le développement des idées et de la culture politique des Canadiens et des Canadiennes. L'adoption de la Loi sur les langues officielles (1969) - qui fut révisée en 1988 -, le rapatriement de la Constitution canadienne (1982), l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (1982), les impasses constitutionnelles liées aux Accords du lac Meech (1987) et de Charlottetown (1992), les référendums sur la souveraineté du Québec de 1980 et de 1995 ainsi que la mise en œuvre de la Loi sur le multiculturalisme (1988) sont autant d'événements qui ont marqué à divers degrés le paysage politique canadien et qui ont, par ricochet, influencé la nature et la dynamique des relations entre les différentes composantes de la société canadienne.
La présence de régionalismes dans la culture politique canadienne est par ailleurs manifeste partout au pays. Le fort sentiment d'appartenance qui se dégage des identités régionales affecte énormément les perceptions et les idées politiques qu'ont les Canadiens et Canadiennes d'eux-mêmes et de leurs concitoyens et concitoyennes des autres régions du pays. Dans une certaine mesure, cela contribue aussi à la richesse du pays. La présence et la manifestation de ces régionalismes s'observent également à travers les différents partis politiques représentés à la Chambre des communes. Il s'agit sans aucun doute d'un autre exemple qui illustre bien la diversité canadienne.
Nous sommes d'avis qu'il existe actuellement un niveau relativement élevé d'acceptation de la dualité linguistique au Canada. Nombreux sont les témoignages d'individus et de groupes non francophones qui ont reconnu la légitimité de la dualité linguistique au pays et qui y ont vu un appui à la diversité. La forte croissance du taux de bilinguisme parmi les anglophones, telle que démontrée dans les statistiques et les divers témoignages d'intervenants de toutes les communautés linguistiques, vient confirmer cette opinion.
Par contre, une majorité de Canadiens et de Canadiennes connaissent mal la réalité des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire.
Que ce soit les anglophones, les communautés ethnoculturelles ou les autochtones, ces groupes ont une faible connaissance de la francophonie canadienne, d'autant plus que cette connaissance se limite trop souvent au Québec.
Aussi, pour accroître leur épanouissement et leur développement, les communautés francophones en situation minoritaire doivent devenir des communautés de plus en plus ouvertes. L'apport des francophiles et des groupes ethnoculturels francophones à la vitalité de la francophonie canadienne doit donc être reconnu et plus valorisé.
Le cadre de gestion et de responsabilisation des Programmes d'appui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien vise à ce que la dualité linguistique soit reconnue et valorisée par l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Mais il semble que cela soit nettement insuffisant. Il nous apparaît donc important que le gouvernement fédéral s'approprie la responsabilité de favoriser le dialogue des cultures au Canada en mettant sur pied des mesures qui permettront une gestion intégrée de ses politiques et de ses programmes pour mieux appuyer les initiatives de rapprochement intercommunautaire qui ont pour but de mettre en valeur la richesse de la diversité canadienne ainsi que la grande contribution des communautés francophones et acadiennes à celle-là.
LES ARTS ET LA CULTURE
Cette section est un condensé du Plan de développement global de la Table Arts et culture de la francophonie canadienne qui s'inspire des huit plans de développement stratégiques des organismes culturels et artistiques membres de la Table Arts et culture. Vous pouvez obtenir la version complète du plan de développement global et les huit plans de développement sectoriels dans la section Publications du site de la Fédération culturelle canadienne-française à l'adresse www.francoculture.ca/fccf ou en communiquant avec la Fédération culturelle canadienne-française au (613) 241-8770.
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Secteurs d'intervention et programmes
- Appui aux communautés de langue officielle
- Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Patrimoine canadien
-
Conseil des Arts du Canada
-
Centre national des Arts
-
Société Radio-Canada
-
Téléfilm Canada
-
Office national du film du Canada
-
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
-
Fonds canadien de la musique
-
Fonds canadien des câblodistributeurs
-
Musicaction
-
Affaires étrangères et Commerce international
Situation actuelle
La Table Arts et Culture incarne, à travers les huit organismes qui la composent, une organisation assez imposante. Cette organisation peut se subdiviser en deux grands secteurs : le secteur artistique, qui regroupe principalement les activités de création, de production et de diffusion d'objets artistiques (spectacles, œuvres d'art, produits culturels); et le secteur culturel, qui regroupe principalement les activités d'animation culturelle, de promotion et de diffusion de la culture dans les communautés.
Le secteur artistique comporte cinq grands volets : théâtre, édition, chanson-musique, arts visuels, cinéma et télévision, sous lesquels on peut dénombrer au-delà d'une cinquantaine d'entreprises (théâtres, maisons d'édition, galeries et centres d'art, maisons de production musicale et télévisuelle, gérance d'artistes) et plusieurs centaines d'artistes professionnels. Le secteur culturel réunit pour sa part plus d'une centaine de structures culturelles locales, telles que centres culturels, sociétés ou comités culturels, centres communautaires, etc., auxquelles s'ajoutent une variété d'événements ou de manifestations culturelles, comme les festivals, les galas ou les carnavals, qui contribuent autrement à animer une vie artistique et culturelle en français.
Cette organisation se complète enfin d'un certain nombre d'organismes provinciaux/territoriaux et d'organismes nationaux qui permettent d'assurer la représentation et la concertation du secteur à différents niveaux. Ces organismes, qui forment l'architecture de la Fédération culturelle canadienne-française, comprennent onze organismes provinciaux/territoriaux et cinq plates-formes artistiques nationales. Il s'y ajoute deux autres plates-formes (Réseau national des galas de la chanson et Regroupement des organismes culturels) qui viennent, avec la FCCF, former la Table Arts et Culture.
Dans l'ensemble, le secteur artistique et culturel apparaît donc en assez bonne position aujourd'hui, même s'il reste confronté à un certain nombre de difficultés chroniques.
Au nombre des forces ou des acquis, on peut souligner :
- l'importance et la qualité de la création artistique;
- l'existence dans certains secteurs d'une infrastructure de production et decommercialisation significative et crédible;
- la présence d'un important réseau de structures communautaires;
- l'obtention d'une visibilité et d'une reconnaissance tangible sur la scèneculturelle nationale;
- l'établissement de nombreux partenariats entre les communautés et avec leQuébec;
- la crédibilité du secteur auprès d'un ensemble d'institutions fédérales.
Au nombre des limites ou des faiblesses, soulignons :
- le plafonnement du financement public globalement accessible au secteur;
- le manque d'appui des gouvernements provinciaux et municipaux;
- l'absence d'infrastructures et d'outils de développement, particulièrementdans certains domaines (par ex. chanson-musique, arts visuels);
- le manque de base industrielle et la vulnérabilité que cela entraîne pour lesecteur;
- l'essoufflement du secteur culturel.
Dans un certain sens, le secteur artistique et culturel peut ainsi paraître à la croisée des chemins. D'un côté, il affiche un dynamisme qui lui permettrait d'envisager un véritable « décollage » au cours des prochaines années, en lui donnant accès aux ressources et aux réseaux établis à l'échelle nationale. De l'autre côté, il accumule des faiblesses qui pourraient dangereusement compromettre son développement à long terme. Le défi posé aux représentants de la Table Arts et Culture est de déterminer comment ils pourraient surmonter ces faiblesses pour assurer au secteur le maximum de son envol.
Objectifs à atteindre
Dans le contexte dressé précédemment, les représentants du secteur artistique et culturel identifient six grands enjeux qui devraient guider leurs actions au cours des prochaines années.
Le positionnement sur la scène culturelle canadienne
Beaucoup d'efforts ont été investis ces dernières années par le milieu canadien-français pour se faire reconnaître des instances culturelles fédérales et pouvoir accéder « équitablement » aux fonds et aux programmes qu'elles gèrent.2L'initiative la plus notable est sans doute l'Entente de collaboration multipartite signée par la FCCF avec le Conseil des Arts du Canada, le Centre national des Arts, le ministère du Patrimoine canadien et Radio-Canada; mais on pourrait en citer beaucoup d'autres (par ex. protocoles d'entente dans les secteurs du théâtre et de l'édition, démarches auprès de Musicaction, etc.) qui se reflètent aujourd'hui dans un ensemble de résultats palpables.
Cependant, le fait est que le Canada français reste encore trop souvent oublié dans la vision culturelle fédérale, fondée sur la reconnaissance de deux entités linguistiques : le Canada anglophone et le Québec francophone. La Fédération culturelle canadienne-française l'éprouvait encore récemment, en devant insister pour se faire inviter à siéger à la Coalition pour la diversité culturelle et pour se faire consulter dans le cadre des discussions entourant la Politique canadienne des arts et l'établissement du programme « Communautés canadiennes de la culture ».
Certains progrès ont tout de même été accomplis ces dernières années, au sein d'institutions ou de programmes ciblés par les représentants du milieu artistique et culturel (par ex. Musicaction, Téléfilm). Toutefois, ces progrès sont lents et reposent encore trop souvent sur la bonne volonté des individus, au lieu de s'appuyer sur des mécanismes ou des réflexes intégrés à la culture de l'organisme.
L'accroissement du financement public
Le sous-financement des structures et des activités artistiques et culturelles au sein des communautés reste une autre préoccupation fondamentale. Bien qu'il ne touche pas également l'ensemble des secteurs, il est à peu près perceptible dans tous les domaines d'activité. Il est particulièrement sensible au sein de certains secteurs artistiques, comme les arts visuels ou la chanson-musique, mais aussi au sein du secteur culturel où il affecte un grand nombre de structures culturelles locales (centres culturels, sociétés culturelles).
Plusieurs facteurs se conjuguent à ce niveau pour faire obstacle aux représentants des communautés francophones. À la difficulté d'accès aux ressources fédérales, soulignée précédemment, s'ajoute la faiblesse des autres sources publiques, provinciales ou municipales, généralement accessibles aux milieux canadiens-français. Le fait est que, si l'on compare la situation des communautés avec celle du Québec (francophone), les fonds accessibles à ces deux paliers sont incomparablement moindres pour les organismes comme pour les artistes francophones à l'extérieur du Québec.
Or, malgré l'apport des programmes de langue officielle du ministère du Patrimoine canadien, le financement fédéral est loin de compenser ces écarts. Il se pose donc, dans certains secteurs, un problème aigu de financement qui entrave sérieusement les possibilités de développement (par ex. chanson-musique, arts visuels, développement culturel).
Le développement des possibilités de diffusion et de commercialisation
Le milieu canadien-français ne peut pas non plus soutenir durablement une importante activité de création s'il n'a pas les moyens d'en assurer la diffusion. Il s'agit d'abord d'un enjeu social ou communautaire : à quoi bon produire des œuvres si elles n'ont pas la possibilité de circuler et de rejoindre le public? Les organismes gouvernementaux qui contribuent à soutenir l'activité artistique n'ont cessé de soulever cette question.3 Mais il s'agit aussi d'un enjeu économique.
Dans les secteurs dits « industriels » comme l'édition, la chanson, le film et la télévision, la commercialisation des produits est une clé essentielle pour pouvoir développer des projets et des activités. Elle devient en même temps un barème de plus en plus important pour mesurer la « performance » des entreprises.
Or, les moyens de diffusion accessibles aux créateurs et aux diffuseurs restent limités. Dans le domaine des arts de la scène, certains développements ont été faits ces dernières années avec l'ouverture de quelques salles (Ottawa, Sudbury, Edmonton) et la relance des réseaux (Réseau Ontario, Coup de cœur, Les Voyagements), mais ils sont loin de combler tous les besoins. Il en va de même dans le domaine de l'édition et de la chanson-musique où la mise sur pied de structures de distribution (Livres, Disques, Etc., Distribution Plages, Distribution APCM) reste encore fragile. D'autres secteurs connaissent une situation encore plus problématique : les arts visuels, d'abord, où les structures de diffusion (centres d'artistes, galeries) sont extrêmement minimes et n'offrent que très peu d'accès aux réseaux publics et commerciaux, mais aussi, de façon différente, le secteur du film et de la télévision qui ne peut compter actuellement sur aucune structure de distribution domestique.
Beaucoup reste donc à faire pour assurer aux représentants du milieu canadien-français la possibilité de faire circuler leurs œuvres et leurs produits et, aussi, de rejoindre les publics ou les marchés qu'ils visent.
L'obtention d'une plus grande visibilité publique
Le développement des possibilités de diffusion va de pair avec une reconnaissance et une visibilité publique. Les éditeurs et les distributeurs de disques ont beau pouvoir placer leurs disques sur les rayons des libraires ou des disquaires, cela ne leur donne pas grand-chose si ces produits ne sont pas connus et demandés du public. De même, les compagnies de théâtre, les producteurs de films et les artistes visuels n'ont aucune chance d'accéder à des réseaux importants s'ils n'ont pas la possibilité de montrer leurs œuvres aux personnes qui en détiennent la clé. Or, là aussi, les représentants des communautés francophones se butent à plusieurs difficultés : absence ou manque d'intérêt des médias, distance critique des grands centres, exclusion des organismes ou des réseaux vitaux du secteur, etc.
Avec le concours de l'Entente de collaboration multipartite, plusieurs « bons coups » ont été réalisés à ce niveau au cours des dernières années. Mentionnons, entre autres, la tenue des 15 Jours de la dramaturgie des régions à Ottawa et du Symposium d'arts visuels à Moncton, les campagnes répétées des éditeurs canadiens-français au Québec, la mise sur pied du Bureau de promotion à Montréal, l'inclusion de la Société Radio-Canada dans les signataires de l'Entente de collaboration multipartite (ouvrant la voie à plusieurs partenariats intéressants). Il est incontestable que ces activités ont contribué à faire connaître les réalisations du milieu canadien-français et ont permis d'ouvrir des portes à ses représentants. Beaucoup reste cependant à faire pour assurer à la création canadienne-française une visibilité suffisante et lui permettre de s'imposer sur la scène nationale, voire internationale.
Le développement artistique et professionnel
En même temps qu'il s'attelle à élargir ses possibilités de diffusion et de rayonnement, le milieu artistique doit continuer à se renouveler et à produire des ressources capables de soutenir son développement. Cette question a eu tendance à être un peu occultée en raison des enjeux qui se manifestaient sur d'autres plans, mais elle reste présente dans la plupart des domaines. Le théâtre a été l'un des secteurs à l'éprouver récemment avec les 15 Jours de la dramaturgie des régions, en constatant l'importance non seulement de manifester, mais de soutenir la création : l'institution des Chantiers théâtre, en alternance avec les 15 Jours, illustre bien cette préoccupation.
Dans le secteur de la chanson, l'intérêt pour la « relève » n'est pas nouveau et suscite, depuis de nombreuses années, la tenue de galas de la chanson à travers le pays. On réalise toutefois qu'il manque peut-être un maillon entre le dépistage assuré par ces galas et l'accès au marché professionnel. On identifie également des besoins de formation dans d'autres sphères de l'industrie : agents d'artistes, producteurs, distributeurs, diffuseurs, etc. Même chose dans le domaine du film et de la vidéo ou encore dans le domaine des arts visuels où l'absence d'infrastructures se double souvent de l'absence de ressources professionnelles (par ex. conservateurs et galeristes, critiques d'art, etc.).
La faiblesse des structures d'enseignement dans les communautés ne facilite pas la tâche. En dehors de Moncton et d'Ottawa qui abritent des programmes universitaires en arts, les possibilités de formation sont limitées.4 Même là, les programmes existants ne sont pas toujours tournés vers les besoins de développement du milieu. Mais des solutions sont tout de même envisageables, avec la participation ou non des institutions existantes.
La participation de la communauté
Enfin, le secteur artistique et culturel peut difficilement se développer tout seul, indépendamment de la communauté dans laquelle il s'inscrit. Non seulement il puise dans la communauté une partie de sa raison d'être, mais il a besoin de la communauté pour soutenir son existence, que ce soit à travers la consommation qu'elle fait de ses œuvres, l'appui financier qu'elle lui apporte, la priorité qu'elle y accorde sur la scène politique, etc.
Cette relation, qui était particulièrement dynamique il y a une ou deux décennies, a subi, dans les dernières années, un important recul. D'un côté, les structures culturelles qui étaient bien enracinées dans le milieu communautaire (par ex. centres culturels et communautaires, sociétés culturelles, réseaux de spectacles) ont connu, avec les coupures gouvernementales, d'importantes difficultés financières qui se manifestent aujourd'hui dans une forme d'essoufflement. De l'autre côté, le développement de la création artistique a conduit, dans le même temps, les artistes à s'éloigner de la communauté pour chercher à entrer dans les réseaux établis sur la scène nationale ou internationale. Il en résulte un fossé qui est tout autant dommageable au milieu artistique (limite des possibilités de diffusion, manque d'appui communautaire) qu'aux communautés (appauvrissement de la vie culturelle locale).
Sensibilisée à cette question, la FCCF engageait, il y a quelques années, une réflexion sur les structures culturelles locales 5qui a mené, récemment, à la mise sur pied d'une Table de concertation sur le développement culturel. Le Regroupement des organismes culturels (ROC) est membre de cette Table. La FCCF engageait aussi une importante initiative pour relancer le développement de réseaux régionaux de diffusion de spectacles. Enfin, elle prenait diverses actions pour tenter de sensibiliser les communautés à l'importance du développement culturel dans leur milieu. L'impact de ces actions reste toutefois limité et semble demander une initiative plus large pour transformer la situation.
Pistes d'action
Les enjeux précédents conduisent la Table Arts et Culture à retenir neuf priorités :
Intensifier la représentation politique
Les actions de représentation menées ces dernières années par la FCCF et quelques plates-formes nationales (par ex. ATFC, RÉCF, APFC) ont généralement porté fruit, en permettant de positionner plus favorablement le milieu canadien-français au sein de certaines institutions fédérales (par ex. Conseil des Arts du Canada, Patrimoine canadien, Radio-Canada, Téléfilm, Fonds canadien de télévision) et d'organismes nationaux (par ex. ANEL, Musicaction, Coalition pour la diversité culturelle). Ces actions semblent essentielles pour permettre aux communautés de profiter pleinement des programmes fédéraux, mais aussi de prendre pied dans les arcanes de l'industrie. Elles devraient donc en ce sens viser toutes les agences et couvrir toutes les disciplines.
Négocier de nouveaux fonds
Tout en travaillant à accroître l'accès aux sources de financement existantes, les représentants du milieu canadien-français ont aussi besoin de dégager de nouvelles avenues financières pour répondre aux besoins particuliers de certains secteurs ou compenser la faiblesse des appuis provinciaux et municipaux. Les démarches entourant l'Entente multipartite ont ainsi montré l'importance d'établir un fonds de levier qui pourrait aider le démarrage de projets structurants. Les discussions du ROC conduisent aussi à proposer la création d'un fonds national d'animation culturelle. D'autres avenues seraient également à explorer, avec le PICLO ou encore à l'intérieur des ententes fédérales-provinciales (ententes sur l'éducation, ententes sur la promotion des langues officielles).
Compléter l'infrastructure artistique
Malgré les progrès accomplis dans le secteur théâtral, particulièrement au chapitre des infrastructures artistiques, l'état des infrastructures existantes reste problématique. Dans le domaine théâtral, d'abord, cinq projets majeurs sont actuellement sur la table et attendent principalement l'accès à du financement pour se concrétiser.6 Dans le domaine des arts visuels, d'importantes lacunes sont également soulignées par les représentants du secteur 7qui identifient plusieurs projets importants dans des communautés clés (par ex. Ottawa, Toronto, Winnipeg). Enfin, le secteur culturel exprime depuis de nombreuses années le besoin d'équiper et de professionnaliser un ensemble de structures d'accueil (par ex. salles de spectacles, galeries communautaires). L'aboutissement de ces projets exige donc une initiative importante, qui pourrait être soutenue par chacun des secteurs concernés, mais aussi s'inscrire à l'intérieur d'une plate-forme globale (par ex. selon le modèle de l'Entente multipartite?).
Mettre en place des structures de commercialisation
À la suite d'une étude sur la distribution des produits durables,8 plusieurs projets importants ont été lancés dans ce domaine. Les deux principaux sont l'entreprise de vente directe, Livres, Disques, Etc., mise sur pied par le Regroupement des éditeurs canadiens-français, et le Bureau de promotion à Montréal, établi par la FCCF avec le concours des secteurs de l'édition et de la chanson-musique. On pourrait citer aussi certaines initiatives dans le domaine de l'industrie musicale, comme la relance de Distribution APCM ou la mise sur pied d'ANIMusique.
Toutes ces initiatives doivent donc être soutenues. Elles pourraient se compléter d'actions similaires dans d'autres secteurs, comme le secteur du cinéma et de la télévision (mise en place d'une structure de distribution).
Établir des circuits d'échange et de diffusion
Les projets lancés ces dernières années ont démontré leur pertinence. Ils demandent toutefois, eux aussi, d'être soutenus pour s'établir de façon durable, de même que pour élargir leur impact et leur rayonnement en direction du public. Les initiatives visées comprennent d'abord la consolidation de certaines initiatives récentes : Les Voyagements (théâtre), le réseau Coup de cœur (chanson-musique), L'Échangeur (arts visuels).
Elles comprennent aussi le développement des réseaux de diffusion régionaux (Atlantique, Ontario, Ouest), l'accès à certaines vitrines (participation à la Bourse Rideau, à la Franco-Fête) et la mise en place d'un corridor national de diffusion qui ouvre la porte à l'international en permettant une forme de réciprocité. Des démarches doivent toutefois être entreprises pour s'assurer que ces actions reçoivent l'appui de certains partenaires fédéraux et obtiennent un financement conséquent (par ex. Programme d'initiatives culturelles/PIC).
Soutenir des occasions de visibilité
Venant appuyer les initiatives précédentes, plusieurs projets ont contribué ces dernières années à mettre la création canadienne-française « sur la carte » et à lui permettre ainsi de se frayer un chemin au sein de certains réseaux stratégiques. On pense d'abord aux 15 Jours de la dramaturgie des régions et au Symposium d'art actuel à Moncton, mais aussi à des initiatives de moindre envergure comme la création d'un Masque de la production canadienne (Soirée des masques) ou la mise en valeur des artistes canadiens-français à la Bourse Rideau (Fenêtre sur la création canadienne-française). Il apparaît essentiel de soutenir ces activités en trouvant les moyens de leur assurer une forme permanente de financement (par ex. les 15 Jours de la dramaturgie).
Soutenir des programmes de formation et de perfectionnement
Peu d'initiatives ont été amorcées jusqu'à présent dans ce domaine. La mise sur pied du Réseau des galas de la chanson francophone amène à vouloir établir un programme qui permettrait d'assurer aux lauréats une « marche » supplémentaire vers le milieu professionnel. Un besoin et des possibilités analogues sont identifiés dans le secteur du film et de la vidéo par l'Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC). Des approches doivent donc être faites pour tenter de donner forme à ces projets. Plusieurs partenaires potentiels sont déjà identifiés, parmi lesquels il y a le ministère du Développement des ressources humaines et le Conseil des ressources humaines dans le secteur culturel (CRHSC).
Relancer le développement culturel dans les communautés
Le déclin de l'action culturelle dans les communautés invite à concevoir une action énergique qui permettrait de réanimer les structures culturelles existantes et de créer une certaine mobilisation communautaire autour de quelques projets d'envergure. Cette action aurait notamment pour but de recréer les liens entre les représentants de la communauté artistique et le public francophone dans ces communautés. Elle devrait aussi permettre d'apporter des solutions au financement et au fonctionnement des structures culturelles existantes. Il serait évidemment très important que le secteur artistique soit associé de près à cette démarche.
Consolider les plates-formes nationales
Finalement, pour réaliser ces actions, il apparaît essentiel que le milieu artistique et culturel ait les moyens de se concerter et qu'il puisse compter sur des organismes efficaces dans chaque secteur. En se basant sur l'expérience acquise par l'ATFC et le RÉCF, on voudrait donc consolider les cinq plates-formes artistiques (AGAVF, ANIM, APFC, ATFC, RÉCF) et leur assurer des moyens de fonctionnement adéquats. On voudrait aussi confirmer le rôle clé de la FCCF et sécuriser son financement, au même titre que d'autres organisations culturelles nationales, comme la Conférence canadienne des arts. Enfin, on voudrait être en mesure de soutenir, dans le secteur culturel, certaines plates-formes stratégiques comme le ROC, mais aussi le Réseau national des galas de la chanson francophone et, peut-être, d'autres réseaux à venir (par ex. réseau des festivals, réseau des diffuseurs de spectacles).
LES COMMUNICATIONS
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Patrimoine canadien
-
Société Radio-Canada
-
Téléfilm Canada
-
Office national du film du Canada
-
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
-
Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
-
Communication Canada
-
Industrie Canada
Selon la Loi sur la radiodiffusion, article 3 de la Politique canadienne de
radiodiffusion :
3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
d) le système canadien de radiodiffusion devrait : servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
[■■■] par sa programmation et les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique [...].
Politique de communication du gouvernement du Canada, avril 2002 : Dans toutes les communications, les institutions doivent respecter l'égalité de statut des deux langues officielles, tel qu'il est établi par la Charte canadienne des droits et libertés et comme y donnent effet la Loi sur les langues officielles et le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestations des services.
Principaux résultats visés
• Les communautés francophones et anglophones disposent du plus grandchoix possible de médias de communication qui, collectivement, remplissentadéquatement les rôles suivants :
- Un miroir dans lequel une communauté peut se reconnaître;
- Un accès aux autres communautés francophones à l'extérieur du Québec;
- Une vitrine servant aux communautés francophones en milieu minoritaire à se faire connaître auprès des francophones du Québec et des francophiles partout au Canada;
- Un moyen d'intégration des nouveaux arrivants francophones et francophiles au Canada;
- Un rayonnement de la vitalité de la francophonie canadienne à l'étranger.
L'ensemble du gouvernement fédéral et des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire sont partenaires à part entière dans ledéveloppement des outils de communication desservant ces communautés.
Situation actuelle
Secteur communautaire
Les médias communautaires de langue française sont en général très populaires auprès de leur public cible, atteignant des taux d'écoute et de rayonnement souvent impressionnants.
L'appui des deux associations nationales francophones dans le domaine des médias (Association de la presse francophone et l'Alliance des radios communautaires du Canada) contribue grandement à l'éclosion et au maintien de nouveaux médias d'information.
Près d'une trentaine d'hebdomadaires, bimensuels ou mensuels, ainsi que deux quotidiens, sont actuellement produits dans nos communautés. L'Association de la presse francophone et son agence de placement publicitaire OPSCOM appuient le développement et le maintien de la plupart de ceux-ci, à l'exception des quotidiens. Presque sans exception, les journaux francophones publiés ailleurs qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick sont constitués en organismes à but non lucratif. Le nombre de ces publications est resté à peu près stable au cours des dernières années, mais plusieurs d'entre elles ont des problèmes de rentabilité, notamment à cause de la faiblesse de leur base d'annonceurs réguliers. Cependant, il existe encore des communautés qui ont le potentiel de soutenir un journal communautaire mensuel ou bimensuel, surtout en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
Les politiques du programme d'aide aux publications du ministère du Patrimoine canadien et les politiques de la Société canadienne des postes ont un impact important sur la presse communautaire francophone. La nature des marchés francophones fait en sorte que plusieurs journaux ne bénéficient pas du programme d'aide aux publications.
Il y a actuellement un total de 18 radios communautaires en ondes dans les communautés francophones et acadiennes du pays, presque toutes implantées au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Aussi, quatorze autres sont en implantation, dont plusieurs pourraient entrer en ondes au cours des trois à cinq prochaines années.
L'attitude du CRTC, le manque d'expertise technique au niveau communautaire, le peu de placements publicitaires de la part du gouvernement fédéral et le manque de fréquences FM disponibles sont quatre des obstacles qui ralentissent actuellement la croissance du réseau des radios communautaires. En effet, depuis quelques années, le CRTC s'est mis à allouer les dernières fréquences de qualité disponibles dans plusieurs grands centres, fermant ainsi la porte à l'implantation de stations communautaires de langue française.
Secteur public
D'après de nouvelles directives du CRTC, la télévision de Radio-Canada devrait bientôt être distribuée dans les derniers endroits au pays où il est impossible de recevoir la chaîne par câble. La principale chaîne de télévision publique est cependant souvent critiquée pour son engagement chancelant à présenter la réalité de la francophonie de tout le Canada à l'ensemble de ses téléspectateurs.
L'ajout du service de RDI en 1995 a rendu accessibles à tout le pays des émissions régionales de nouvelles et d'affaires publiques, qui font souvent état des défis et des réussites de nos communautés.
Cependant, les conditions de licences accordées par le CRTC n'en font pas une chaîne à distribution obligatoire pour les câblodistributeurs et RDI n'a pas réussi à vendre sa programmation partout au pays (20 % des abonnés du câble à l'extérieur du Québec n'y ont toujours pas accès). De plus, la programmation régionale est souvent mise de côté pour faire place à de longues émissions spéciales. Par exemple, l'Ontario en direct a été pratiquement retiré de l'horaire pendant quatre mois après les attentats du 11 septembre 2001.
Les coupures et le financement instable accordé à Radio-Canada/CBC a entraîné un recul quant à l'information locale dans nos communautés et le départ de nombreux artisans qualifiés.
ARTV est maintenant disponible, en mode numérique ou analogique, sur une bonne partie du territoire canadien. Cependant, la licence de cette chaîne spécialisée de la SRC ne prévoit que des obligations imprécises à l'égard du reflet des communautés francophones et acadiennes dans sa programmation.
La composante francophone de la chaîne éducative de l'Ontario, TFO, est maintenant distribuée sur presque tout le territoire de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Le refus du CRTC d'accorder une distribution obligatoire au Québec, les coûts importants d'une diffusion en différé dans l'Ouest canadien, et des coupures à son financement par le gouvernement de l'Ontario limitent sa croissance.
En radio, la première chaîne de la SRC continue d'étendre son rayonnement, étant maintenant disponible à plus de la moitié des francophones et francophiles de chacune des provinces et territoires à l'extérieur du Québec. Notons qu'une portion significative de ses émissions nationales est produite dans nos communautés.
D'autre part, la SRC a déposé cet hiver un ambitieux projet d'expansion de sa chaîne culturelle dans une dizaine de communautés. Elle ne peut être captée actuellement qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, de façon conventionnelle et par télévision satellite sur une grande partie du territoire.
Secteur privé
Depuis 1998, TVA a le statut de chaîne nationale à distribution obligatoire sur les grands systèmes de câblodistribution et s'est rapidement taillé une part de marché significative dans nos communautés, notamment au Manitoba. TVA remplit les obligations énumérées dans sa licence mais, dans l'information autant que dans les dramatiques, la visibilité accordée à nos communautés est relativement faible pour l'instant.
La plupart des 21 nouveaux services spécialisés de langue française approuvés par le CRTC sont maintenant en ondes, très majoritairement sur la grille des services numériques. Ces canaux augmentent le choix offert aux téléspectateurs francophones, mais n'ont aucune obligation (ou intérêt semble-t-il) à offrir un reflet de la francophonie canadienne.
En ce qui concerne la radio, la contribution du système privé se limite à huit stations privées au Nouveau-Brunswick et en Ontario.
Nouvelles technologies
Le taux d'utilisation des nouvelles technologies chez les Canadiens francophones (44 %) est nettement plus bas que pour les anglophones (58 %). L'accès à ces technologies semble être un problème pour une partie de la population des deux langues, mais les francophones rencontrent également une insatisfaction face à la quantité d'informations disponibles dans leur langue sur Internet, une situation qui n'existe pas pour les anglophones.
Depuis 1999, divers groupes, de même que la Commissaire aux langues officielles, réclament une stratégie intégrée du gouvernement fédéral à l'égard de la présence et de la qualité de contenus et de services en français sur Internet et des mécanismes de contrôle appropriés.
Objectifs à atteindre
Accroissement du nombre de radios communautaires et normalisation de leur financement
Étant donné l'intérêt de nos communautés pour ce type de médias d'expression et d'information, favoriser le développement de nouvelles radios communautaires et aider celles qui existent à renouveler leur équipement.
Pour ce faire, des moyens de financement solides et continus doivent être mis en place, tant au niveau de l'achat de publicité que des programmes d'appui financier.
Renforcement de la presse écrite
Assurer une plus grande stabilité financière aux publications francophones et faciliter la mise sur pied de nouvelles publications dans les communautés qui n'en ont pas, notamment par une reconnaissance de leur rôle comme l'un des véhicules publicitaires privilégiés de nos communautés pour les agences et ministères fédéraux.
Renforcement de la présence des communautés francophones et acadiennes sur Internet
Augmentation des contenus disponibles en langue française. Cela passe par la production directe de contenu (incluant la numérisation de contenu existant dans d'autres médiums) et des efforts supplémentaires au niveau de la traduction de contenu existant. Il est également nécessaire de favoriser l'augmentation du contenu présentant un reflet de nos communautés.
Renforcement des industries linguistiques, incluant la mise à niveau des systèmes informatiques gouvernementaux pour qu'ils intègrent le critère linguistique, le développement des outils automatiques de traduction et l'appui stratégique aux industries de la langue.
Clarification de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des communautés de langue officielle dans le domaine des communications
Comme dans d'autres domaines d'activité, des désaccords existent entre les organismes de la communauté et les ministères et agences du gouvernement quant à l'application de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles et son impact sur d'autres textes législatifs, notamment la Loi sur la radiodiffusion. Certains aménagements législatifs et administratifs sont donc nécessaires pour clarifier la situation.
Augmentation de l'écoute des chaînes de radio et de télévision de langue française par les francophones de nos communautés
Le gouvernement du Canada doit appuyer les communautés francophones et acadiennes dans leurs efforts de sensibilisation et d'information pour augmenter l'écoute et la lecture des médias francophones, tant auprès des gens de leurs propres communautés qu'auprès des francophiles du pays.
Pistes d'action
- Assurer l'application de la Partie VII de la Loi sur les langues officiellesaux politiques du Programme d'aide aux publications du ministère duPatrimoine canadien.
- Reconnaissance par les ministères et agences fédérales de l'importancedes médias francophones communautaires (radios et journaux) pour leplacement publicitaire. Voir à l'application diligente de la Politique decommunication du gouvernement du Canada énoncée par le Conseil duTrésor.
- Rendre disponible une aide financière pour les organismes francophonesqui veulent mettre sur pied des publications francophones dans desmarchés non desservis.
- Intensifier la collaboration existante entre la Société Radio-Canada et lesradios communautaires des communautés francophones et acadiennespour faciliter l'implantation de nouvelles radios et, dans certains cas,augmenter le rayonnement des stations existantes.
- Parallèlement à la mesure précédente, le bassin d'expertise technique deRadio-Canada pourrait être un appui important à l'implantation denouvelles stations si une politique en ce sens était mise en place.
- S'assurer que la Partie VII de la Loi sur les langues officielles s'appliquedans toute sa force dans les opérations et les délibérations du CRTC.Cela inclut la mise sur pied d'un mécanisme de concertation entre lescommunautés de langue officielle et le CRTC.
- Le ministère du Patrimoine canadien, en collaboration avec IndustrieCanada, le CRTC et l'ARC du Canada, devrait réserver des fréquencesFM à l'implantation de radios communautaires. La Société Radio-Canadaa déjà bénéficié d'une mesure semblable dans le cadre de son pland'allotissement à long terme, alors que le CRTC évitait d'allouer desfréquences que la SRC comptait utiliser pour de nouvelles stations.
- La Société Radio-Canada doit pouvoir bénéficier d'un financement stableet adéquat. Ses budgets consacrés à la production locale en milieuminoritaire et le budget du service radiophonique de Radio-Canada allouéaux partenariats et échanges avec les communautés devraient êtrebonifiés.
- Création d'un fonds d'expression locale financé en partie par les radiosprivées pour soutenir une programmation éducative de qualité chez lesradios communautaires. Un fonds similaire existe déjà du côté de latélévision.
- Le programme d'aide aux radios communautaires en milieu minoritairedevrait être reconduit et une évaluation réaliste des besoins devrait êtreeffectuée. Avec la mise en ondes éventuelle de plusieurs radioscommunautaires au cours des prochaines années et le renouvellement del'équipement de production et de diffusion des stations existantes quis'annonce, il pourrait être nécessaire de prévoir une bonification duprogramme et la précision des critères de financement. Le programmedevrait être reconduit pour au moins cinq ans.
- Reconnaissance par les ministères et agences fédérales de l'importancedes médias francophones communautaires (radios et journaux) pour leplacement publicitaire. Voir à l'application diligente de la Politique decommunication du gouvernement du Canada énoncée par le Conseil duTrésor.
- Assurer qu'il y aura un organisme permanent dont le mandat serait defaire la promotion des chaînes de langue française auprès descommunautés francophones et acadiennes du Canada, travaillant encollaboration avec les groupes représentant ces communautés. Cemandat pourrait être confié à un organisme existant, par exemple unorganisme administrant des programmes financés en partie par lescâblodistributeurs tel Téléfilm Canada ou à un nouvel organisme.
- Rendre disponible une aide financière pour les organismes francophonesdans le but de préparer leurs représentations auprès du CRTC et entreprendre des recherches dans le domaine des médias communautaires francophones (écrits et électroniques) en milieu minoritaire.
- Un comité réunissant la communauté et des personnes-ressources dePatrimoine canadien devrait être formé pour étudier l'implantationéventuelle d'une ou de plusieurs chaînes de télévision s'adressantspécifiquement aux francophones et francophiles de l'extérieur duQuébec.
- Un comité consultatif devrait être mis sur pied par Industrie Canada pourétudier les questions reliées à la place des langues officielles sur Internet.
- Un cadre de gouvernance cohérent, continu et intégré afin de renforcer ladualité linguistique sur Internet, devrait être mis en place par le Conseil duTrésor, en particulier dans le cadre du projet Gouvernement en direct.
- Tous les programmes de financement servant à appuyer la production decontenus canadiens sur Internet devraient tenir compte du principe de ladualité linguistique et du reflet des communautés de langue officielle. Lamoitié du financement engagé par les ministères et agences dugouvernement pour la production de contenus sur les sites Web dugouvernement devrait être réservée à la production de contenus enfrançais.
- Le portail du gouvernement canadien Place du Canada et d'autres sitesd'information de base sur le Canada devraient comporter une section qui,construite en partenariat avec des institutions des communautés, invite lesinternautes à se familiariser avec l'histoire, la culture, les réalisations et lavitalité des communautés francophones et acadiennes du Canada.
- Davantage d'investissements doivent être faits au niveau de lanumérisation des contenus culturels canadiens dans les deux languesofficielles.
- Le Conseil du Trésor devrait voir à la mise à niveau de tous les postes detravail du gouvernement pour s'assurer qu'ils pourront fonctionnerpleinement dans les deux langues, avant 2005.
- Industrie Canada devrait concerter les acteurs clés de l'industrie et lesministères à vocation économique pour contribuer à l'essor des industries canadiennes de la langue.
- Les appels d'offres de Travaux publics et Services gouvernementauxCanada concernant le matériel informatique devraient spécifier quel'équipement, les logiciels, les manuels et les services de formation doivent être offerts dans les deux langues officielles.
- Travaux publics et Services gouvernement aux Canada devraient rendre disponible une trousse d'outils incluant des outils technolinguistiques de traduction et de navigation.
- Que le gouvernement du Canada favorise la nomination de personnes enprovenance des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire à des fonctions de membres des conseils d'administration des diverses agences gouvernementales relatives au domaine des communications.
LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Secteurs d'intervention et programmes
Développement communautaire
- Appui aux communautés de langue officielle
- Ententes fédérales-provinciales/territoriales en matière de services dansla langue de la minorité
- Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle
Principaux résultats visés
- Les communautés francophones et anglophones en situation minoritairepeuvent vivre dans leur propre langue dans leur milieu, en tant quecommunautés fortes, dynamiques et inclusives, participer pleinement àtous les secteurs de la société canadienne, et assurer leur développementà long terme.
- Des programmes et services provinciaux et territoriaux dans la langue dela minorité sont accessibles et comparables à ceux offerts à la majoritédans des domaines stratégiques prioritaires.
- L'ensemble du gouvernement fédéral et les communautés francophoneset anglophones en situation minoritaire sont partenaires à part entièredans le développement durable de ces communautés.
Situation actuelle
Appui aux communautés de langue officielle
Mandat
Appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec et anglophones au Québec).
Clientèle / Aire d'intervention
Quelque 350 associations sans but lucratif représentatives des communautés de langue officielle œuvrant dans divers secteurs d'activité, notamment la représentation, l'animation, la promotion, la sensibilisation, la culture, les jeunes, les femmes, l'éducation, les communications (presse et radio communautaire), la prestation de services, etc.
Appui et financement
Subventions et contributions accordées pour appuyer le fonctionnement de base et des projets spéciaux en fonction des priorités de la communauté et des fonds disponibles.
Critères d'admissibilité
Des ententes ont été conclues avec les organismes nationaux ainsi qu'avec les communautés dans chaque province et territoire quant aux modalités de livraison du programme.
Ententes fédérales-provinciales/territoriales
Mandat
Aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à appuyer le développement des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire (les francophones à l'extérieur du Québec et les anglophones au Québec) en offrant à ces communautés des services en français et en anglais dans des domaines autres que l'éducation.
Clientèle / Aire d'intervention
Les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Appui et financement
Le ministère encourage les provinces et les territoires à mettre sur pied des services ou à améliorer ceux qui existent dans les domaines qui touchent de près les collectivités minoritaires de langue officielle (par ex. la santé, l'économie, la justice, les services sociaux et les loisirs) et à promouvoir la reconnaissance des deux langues officielles et leur utilisation. Les coûts sont habituellement répartis dans une proportion de 50/50 entre les ministères participants.
Critères d'admissibilité
Les coûts reliés à la planification, à la recherche, au développement et à la mise en œuvre sont admissibles, alors que les coûts reliés aux dépenses d'immobilisation, à l'acquisition de matériel et au remplacement du personnel en formation linguistique sont habituellement exclus.
L'aide accordée par le ministère s'applique uniquement à la période initiale de mise en place d'un projet; il ne peut s'agir de financement permanent ou continu. Le Canada et la province ou le territoire conviennent de la période de financement de chaque mesure ou projet. Pour ce qui est du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral s'est engagé à assumer la totalité des dépenses occasionnées par la prestation de services en français.
Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle (PICLO)
Cette initiative de 5,5 M$ par année sur cinq ans veut encourager et stimuler les partenariats entre les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLO) et les organismes fédéraux. Elle vise à s'assurer que les programmes, les politiques et les services de ces organismes tiennent compte des besoins et des réalités des communautés de langue officielle afin de soutenir leur développement. À cette fin, le PICLO offre un financement complémentaire aux contributions des autres organismes fédéraux.
Cette initiative est aussi destinée à aider les associations qui représentent les communautés de langue officielle en situation minoritaire à mieux connaître les programmes et les services du gouvernement canadien et à mieux s'en prévaloir.
Les objectifs du PICLO sont les suivants :
Appuyer des activités qui contribuent au développement global des communautés dans une perspective de développement durable et d'accroissement du dynamisme des deux communautés de langue officielle en situation minoritaire.
Favoriser l'accès aux services et aux programmes offerts par les organismes fédéraux, mieux les faire connaître et permettre au gouvernement fédéral de mieux comprendre les besoins et les réalités des communautés de langue officielle afin d'en tenir compte dans la révision des programmes et services existants ou dans l'élaboration de nouveaux programmes et services.
Créer un effet structurant9 sur la culture organisationnelle des partenaires fédéraux et communautaires.
Servir de levier financier afin de favoriser l'établissement de partenariats durables et de nouveaux modes de collaboration.
Objectifs à atteindre
Le ministère du Patrimoine canadien, par son mandat d'appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, joue un rôle de premier plan en appui aux communautés de langue officielle.
Le ministère du Patrimoine canadien et les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada s'entendent mutuellement sur l'importance d'établir un partenariat qui aura comme objectif d'appuyer les communautés à assurer la prise en charge de leur développement.
Le ministère du Patrimoine canadien et les communautés francophones et acadiennes en milieu minoritaire s'entendent pour développer des mécanismes visant à accentuer l'interaction et la coopération entre eux, pour assurer le développement et l'amélioration de la vitalité de ces communautés.
Cette prise en charge est définie comme étant la capacité des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire de pouvoir faire des choix en matière de priorités de développement avec, notamment, l'appui financier et technique du gouvernement canadien par l'entremise, entre autres, du ministère du Patrimoine canadien.
Le partenariat entre le ministère du Patrimoine canadien et les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada repose sur les valeurs suivantes : la confiance, le respect, la concertation, la recherche d'une vision commune du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la transparence.
Le gouvernement fédéral a une responsabilité continue et permanente d'inciter et d'encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la progression vers l'égalité des deux langues officielles (et dans la progression vers de véritables partenariats avec leurs communautés francophones et acadiennes) par un engagement financier récurrent.
Pistes d'action
Le ministère du Patrimoine canadien et les porte-parole des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada établissent mutuellement un mécanisme permanent de concertation, afin de s'assurer que les besoins des communautés soient considérés. Les initiatives du gouvernement fédéral à l'égard des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire comprenant entre autres le Programme d'appui aux langues officielles (PALO), les ententes fédérales-provinciales/territoriales et le Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle (PICLO), y seraient présentées, étudiées et discutées. Des ajustements pourraient y être suggérés, selon le cas.
Le ministère du Patrimoine canadien s'assure que les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada soient consultées activement sur toute question pouvant avoir un impact sur leur développement, en particulier en ce qui a trait à la négociation et à la gestion des ententes Canada-communautés et des ententes fédérales-provinciales qui concernent le développement des communautés. Dans ce dernier cas, il veille à mettre sur pied les mécanismes d'imputabilité nécessaires à cette fin.
Le ministère du Patrimoine canadien considère les plans de développement global des communautés de langue officielle en situation minoritaire comme étant les documents de référence au sujet des besoins des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire en matière de développement et dans la planification de la mise en œuvre de leur développement respectif.
Le ministère du Patrimoine canadien a une approche asymétrique du développement de chacune des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire qui tienne compte des besoins et des priorités de développement spécifiques à chacune d'entre elles.
Les bureaux régionaux du ministère du Patrimoine canadien ont un rôle plus stratégique et la marge de manœuvre nécessaire pour appuyer les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire dans leur région respective et leur point de vue est considéré.
Le ministère du Patrimoine canadien établit des normes de service en ce qui a trait au traitement des demandes de financement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada.
Le ministère du Patrimoine canadien favorise l'adoption d'une politique de développement global par le gouvernement fédéral afin d'appuyer pleinement le développement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada.
Le ministère du Patrimoine canadien informe les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire des initiatives du gouvernement fédéral (interministériel et intraministériel) et il appuie leurs démarches auprès des autres ministères qui pourraient contribuer à leur développement.
Les gouvernements provinciaux/territoriaux doivent aussi devenir des partenaires dans le développement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire et, à cette fin, il est crucial d'assurer un financement récurrent dans le cadre des ententes fédérales provinciales/territoriales.
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOYABILITÉ
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Développement des ressources humaines Canada
-
Agence de promotion économique du Canada atlantique
-
Agriculture et Agroalimentaire Canada
-
Banque de développement du Canada
-
Diversification de l'économie de l'Ouest
-
Industrie Canada
-
Patrimoine canadien
-
Secrétariat du Conseil du Trésor
-
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
-
Affaires indiennes et du Nord
Autre considération
La reconnaissance des communautés francophones et acadiennes comme clientèle cible.
Situation actuelle
Le diagnostic sectoriel
Partenariats stratégiques
Au mois de novembre 1999, le Comité national de développement des ressources humaines de la francophonie canadienne (CNDRHFC) a adopté son premier plan stratégique triennal. Ce plan, qui comprend entre autres les orientations stratégiques et un plan d'action paritaire, a établi la fondation et les lignes directrices des travaux du CNDRHFC jusqu'à son échéance prévue au mois de novembre 2002.
Depuis lors, la majorité des objectifs fixés dans ce plan ont été atteints. Les autres sont en voie de l'être. Nous pouvons compter sur un Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE) établi dans chacune des provinces et des territoires. Les RDÉE disposent, pour la plupart, d'agents de développement pour chacun des secteurs ciblés du CNDRHFC qui sont :
- Le développement rural;
- Le tourisme;
- L'économie du savoir;
- L'intégration des jeunes dans l'économie.
Pour chacun de ces secteurs, les RDÉE élaborent et mettent en œuvre une planification stratégique et ils identifient des partenaires des différents paliers de gouvernements et du secteur privé. Ainsi, à partir de 1997 avec l'entente de l'Île-du-Prince-Édouard, des protocoles d'entente fédérale-provinciale-communauté ont été conclus dans diverses provinces. Dans certains cas, il s'agit d'ententes générales sur le développement économique, tandis que dans d'autres, il peut s'agir d'ententes sectorielles, tel le tourisme, etc.
Deux ministères membres du Comité (Agriculture et Agroalimentaire Canada et Patrimoine canadien) font équipe pour soutenir la création de l'Initiative de planification communautaire pour les groupes de langue minoritaire des régions rurales agricoles, qui est une des principales stratégies de la planification sectorielle en développement rural du Comité. Les RDÉE, le Comité et AAC ont conclu à cet effet un protocole d'entente pour assurer la mise en œuvre de l'Initiative.
Un partenariat avec le réseau TVA et des maisons de production indépendantes de la francophonie canadienne a été conclu pour produire l'émission hebdomadaire Via-TVA, consacrée aux francophones de l'extérieur du Québec et donnant forme au corridor touristique francophone pancanadien.
Le Comité a mis en place une stratégie de concertation sectorielle permettant aux agents de développement des quatre secteurs prioritaires du Comité de se rencontrer et d'harmoniser leurs efforts de développement économique.
Défis particuliers
La prolongation du fonds d'appui pour les deux prochaines années a été plus difficile à obtenir que prévu. La crise interne que DRHC a connue en 2000 a eu des effets directs sur ce prolongement. Ce ministère, dont la mission est le développement des ressources humaines, est dans l'obligation de resserrer les critères de ses programmes. Le financement du fonds d'appui provient du Partenariat du marché du travail et les critères sont explicites en ce qui a trait aux activités admissibles. Lors de l'annonce par le ministre Pettigrew, en 1999, le fonds avait été élaboré dans une perspective d'appui au développement économique. La seconde vague des accords de contribution du fonds d'appui nous oblige à opérer un retrait stratégique et à réorienter notre façon de faire.
Nous remarquons également un recul dans la façon que DRHC gère le fonds d'appui depuis la crise interne. Il semblerait que ce ministère ait oublié de transiger avec les communautés comme elle le faisait auparavant, c'est-à-dire en la considérant comme une clientèle cible. Cette reconnaissance est fondamentale pour le succès de la planification du Comité et vise l'ensemble des ministères. Cette séquence de négociation nous a convaincus de l'importance de créer, pour notre secteur, un programme interministériel adapté spécifiquement à nos besoins. Cela nous a permis également de constater que DRHC a joué un rôle de pionnier dans le développement du CNDRHFC. Diversification de l'économie de l'Ouest, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Patrimoine canadien ont contribué positivement au succès du Comité, mais à une moindre échelle que DRHC. Cependant, d'autres ministères membres du Comité ont été plutôt discrets jusqu'à ce jour dans leur appui pour la mise en œuvre de la planification stratégique du Comité, d'où l'importance de se doter d'une direction stratégique visant à consolider le financement pour la mise en œuvre de la planification stratégique du Comité.
Plusieurs activités d'évaluation ont été menées au cours du processus dans le but de mesurer les progrès. La vision, les missions et les directions stratégiques qui suivent ont été adoptées par le CNDRHFC lors de sa réunion régulière de mars dernier.
Objectifs à atteindre
Vision commune
Enrichir l'environnement lié au développement socio-économique des communautés francophones et acadiennes en assumant un leadership dans la réalisation de ses stratégies novatrices.
Mission communautaire
Orienter et stimuler, en collaboration avec ses partenaires régionaux, provinciaux et territoriaux, la prise en charge stratégique du développement économique des communautés francophones et acadiennes dans le but d'augmenter la création d'entreprises et d'emplois durables.
Mission gouvernementale
Conseiller les ministères et agences fédérales à vocation socio-économique pour s'assurer que leurs programmes et leurs politiques soient adaptés ou créés en fonction des besoins spécifiques des communautés francophones et acadiennes en matière de développement économique et d'employabilité.
Pistes d'action
Direction stratégique n° 1
Investir de façon importante et constante dans le développement et le perfectionnement des ressources humaines associées à l'œuvre du CNDRHFC (interne).
Objectifs stratégiques
- Accroître les connaissances et les habilités en matière de développement économique communautaire;
- Accentuer l'acquisition des nouvelles compétences relatives à l'employabilité;
- Augmenter le niveau de compétences en technologies de l'information et des communications.
Direction stratégique n° 2
Identifier et consolider les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation des plans stratégiques national, régionaux, provinciaux et territoriaux (interne).
Objectifs stratégiques
- Affecter les ressources humaines et matérielles nécessaires à« l'opérationnalisation » de la planification stratégique quinquennale;
- Créer un fonds interministériel pour le financement à long terme de lamise en œuvre de la planification stratégique;
- Maximiser l'atteinte des résultats dans les travaux du CNDRHFC.
Direction stratégique n° 3
Nourrir et mettre en pratique au sein du CNDRHFC une culture organisationnelle axée sur la création d'alliances et de partenariats d'affaires ciblés (interne/externe).
Objectifs stratégiques
- Réaliser des alliances et des partenariats stratégiques dans la mise enœuvre du plan stratégique quinquennal du CNDRHFC;
- Favoriser les initiatives issues de la planification stratégique duCNDRHFC ayant un financement interministériel et/ou privé;
- Faciliter l'élaboration de stratégies régionales de développement socio-économique complémentaires aux stratégies nationales, provinciales etterritoriales.
Direction stratégique n° 4
Maximiser la valeur du réseau pancanadien d'intervenants socio-économiques du CNDRHFC (interne/externe).
Objectifs stratégiques
- Canaliser les forces économiques du réseau des intervenants;
- Faire reconnaître les résultats et la valeur ajoutée de l'oeuvre du CNDRHFC;
- Intégrer au maximum l'utilisation des TIC dans les travaux du CNDRHFC (réseau Gazel.ca).
Direction stratégique n° 5
Valoriser l'excellence et l'innovation de l'œuvre des intervenants socio-économiques des communautés francophones et acadiennes (interne/externe).
Objectifs stratégiques
- Reconnaître publiquement la contribution d'intervenants socio-économiques en matière d'excellence et d'innovation;
- Favoriser les initiatives issues de la planification stratégique du CNDRHFC faisant preuve d'excellence et d'innovation;
- Valoriser l'utilisation des TIC en français dans le monde des affaires.
Direction stratégique n° 6
Orienter les recherches en matière de développement socio-économique des communautés francophones et acadiennes (interne/externe).
Objectifs stratégiques
- Assurer la création et la mise à jour de profils socio-économiques détaillésdes communautés francophones et acadiennes;
- Appliquer les résultats des recherches en matière de développementsocio-économique dans les travaux du CNDRHFC;
- Arrimer les démarches stratégiques sectorielles du CNDRHFC dans lesgrandes tendances socio-économiques nationales et internationales.
Direction stratégique n° 7
Que le ministère des Affaires indiennes et du Nord (MAINC) contribue à l'épanouissement communautaire des francophones du Nord et à leur développement économique.
Objectifs stratégiques
- Assurer la reconnaissance, par le ministère et son personnel, des minorités francophones des trois territoires canadiens comme clientèlescibles du MAINC, notamment par leur intégration à la liste des ministères,organismes et agences devant prioriser l'actualisation des articles 41 et42 de la partie VII de la Loi sur les langues officielles;
- Dans cette perspective, produire un plan d'action optimal, en consultationavec les communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;
- Pourvoir de ressources (humaines et financières) adéquates lesprogrammes existants en matière de développement économique, notamment le programme d'infrastructure;
- Adapter ces programmes aux besoins des communautés francophonesdu Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;
- Créer et mettre en œuvre des programmes complémentaires correspondant aux besoins des communautés francophones du Yukon,des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
L'ÉDUCATION
Principes
L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés : Permettre aux communautés francophones et acadiennes de pouvoir faire instruire leurs enfants dans des écoles homogènes francophones et gérées par la minorité, le cas échéant.
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada finance l'éducation en langue française, pourtant de compétence provinciale, à travers notamment le Programme des langues officielles dans l'enseignement, le PLOE. Le principal reproche pouvant être fait à cette pratique demeure le manque d'imputabilité des gouvernements provinciaux à l'égard des sommes fournies qui ne vont pas nécessairement et automatiquement vers l'éducation en langue française.
Principaux intervenants gouvernementaux
Patrimoine canadien
Gouvernements provinciaux et territoriaux
Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC)
La Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles crée des obligations spécifiques au ministre du Patrimoine canadien à l'égard du domaine de l'éducation, bien que ce dernier soit de compétence exclusivement provinciale (hormis ce qui touche les populations autochtones et les familles des militaires canadiens). Notons les principaux articles :
43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu'il estime indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :
d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones et, notamment, à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;
45. Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d'accords avec les gouvernements provinciaux en vue d'assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l'instruction, dans les deux langues officielles.
Programme des langues officielles dans l'enseignement (PLOE)
Le gouvernement fédéral, par l'entremise de ce programme, verse une aide financière de près de 300 M$ annuellement aux provinces et aux territoires pour les aider à offrir aux jeunes des communautés minoritaires de langue officielle l'accès à une éducation dans leur langue. Ce programme est en place depuis 1972, bien avant l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il n'est pas inutile de rappeler non plus que le gouvernement fédéral s'intéresse de plus en plus à l'enseignement postsecondaire en français dans des domaines de pointe, comme la santé, où la formation hors Québec reste à parfaire. Nous pensons ici au financement accordé à l'Université d'Ottawa dans le domaine de la santé ou encore à l'octroi de 10 M$ sur quatre ans accordé, en 2001, à l'Université de Moncton.
Programme des moniteurs de langue officielle (compris dans le PLOE)
Le mandat est d'offrir l'occasion aux jeunes de niveau postsecondaire de travailler comme moniteurs à temps plein ou à temps partiel dans une salle de classe avec un enseignant ou une enseignante, afin d'enrichir les cours de français langue seconde ou langue maternelle.
Ce programme est administré par le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) en collaboration avec le ministère de l'Éducation ou le ministère responsable de l'enseignement postsecondaire des provinces et territoires.
Programme de bourses d'été de langues (compris dans le PLOE)
Le mandat est d'offrir aux jeunes Canadiens et Canadiennes la chance d'apprendre leur seconde langue officielle ou, dans le cas des minorités francophones, de perfectionner leur langue maternelle. Les bourses sont accordées à des étudiants et étudiantes d'un bout à l'autre du pays afin qu'ils puissent suivre un cours d'immersion de cinq semaines en français ou en anglais pendant l'été, dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé.
Ce programme est administré par le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada), en collaboration avec le ministère de l'Éducation ou le ministère responsable de l'enseignement postsecondaire des provinces et territoires.
Principaux résultats visés
- Assurer aux communautés francophones et acadiennes la pleine mise en œuvre de la gestion scolaire telle qu'édictée par l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et sa jurisprudence;
- Permettre aux élèves francophones, et donc aux écoles et aux conseilsscolaires, d'être mieux outillés afin d'assurer qu'ils reçoivent une éducation dequalité égale à celle des élèves de la majorité ou, autrement dit, que la notionde gestion scolaire soit basée sur l'équivalence des résultats;
- Outiller les communautés francophones et acadiennes afin de voir aumaintien et au renforcement de la vitalité linguistique des communautésfrancophones en milieu minoritaire et assurer :
- le maintien et l'augmentation de l'usage du français comme langue maternelle dans les familles endogames et l'inscription de leurs enfants dans les écoles de langue française;
- le développement et l'augmentation de l'usage du français comme langue de choix dans les familles exogames et l'inscription de leurs enfants dans les écoles de langue française;
- le développement et le maintien d'attitudes positives chez la majorité concernant la présence du fait français dans le milieu et l'augmentation de l'usage du français comme langue d'enrichissement personnel.
Situation actuelle
Il existe des livres, des études, des mémoires de maîtrise ainsi que de nombreux articles décrivant mieux que nous pourrions le faire en quelques pages tout le portrait de l'éducation en milieu minoritaire au Canada. Mentionnons les principaux points seulement.
Le droit à la gestion, par les francophones minoritaires du pays, de leurs écoles et de leurs systèmes scolaires est désormais garanti à divers niveaux depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi et surtout après de nombreuses batailles épiques devant les tribunaux canadiens. À la suite de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et des nombreux jugements de la Cour suprême du Canada, notamment la cause Mahé en 1990 et, tout dernièrement, l'arrêt Arsenault-Cameron en faveur des parents francophones de Summerside en 2000, la gestion scolaire de langue française est devenue un sujet hautement prioritaire pour le développement de la francophonie canadienne. Malheureusement, on doit encore, dans certaines provinces, aller devant les tribunaux pour permettre la mise en place d'écoles de langue française ainsi que l'obtention de la pleine gestion scolaire.
Pour plusieurs francophones du pays, l'accès aux écoles françaises, la gestion de ces écoles et la création de centres scolaires communautaires arrivent à un moment où la communauté est déjà très disséminée, affaiblie et, malheureusement, assimilée. D'aucuns remarquent que la proportion des enfants des ayants droit qui sont effectivement inscrits dans les écoles qui desservent la minorité francophone n'atteint pas la moitié de ceux qui pourraient y être inscrits. La Commissaire aux langues officielles a d'ailleurs déjà publié un rapport portant sur cette question, en mars 2001, intitulé Droits, écoles et communautés: un plan pour renforcer les effectifs des écoles de langue française en milieu minoritaire.
Le taux d'exogamie est en moyenne de 42 % en 1996. Chez ces familles, le taux de rétention du français est, pour la plupart du temps, inférieur à 20 %. Cela explique en grande partie le petit nombre d'élèves issus de ces familles qui fréquentent l'école de la minorité francophone. Si l'exogamie et le faible taux de natalité chez les francophones se maintiennent, certaines écoles de la minorité devront fermer leurs portes, faute de clientèle.
Comme le nombre d'élèves francophones est sensiblement à la baisse, il devient de plus en plus difficile d'assurer des infrastructures scolaires permettant la facilité d'accès, la diversité des programmes, la qualité et la quantité des installations ainsi que la variété des activités parascolaires que l'on retrouve dans les écoles de la majorité. Il n'est pas inutile de souligner que, grosso modo, les écoles de la minorité reçoivent à quelques dollars près le même financement que les écoles de la majorité, bien que les besoins ne soient évidemment pas les mêmes, ce qui pose un énorme problème pour les communautés. Le financement des écoles étant principalement basé sur le principe du per capita, les écoles de la minorité, où les nombres sont moins nombreux, se trouvent nettement désavantagées en comparaison aux écoles de la majorité, y compris les écoles d'immersion. Aussi, les écoles de la minorité se trouvent dépourvues de spécialistes en orthophonie, en psychologie, en soutien aux familles, en musique, en éducation physique, pour ne nommer que ces quelques champs et disciplines, sans compter toutes les activités parascolaires, y compris les équipes de sport. La Cour suprême du Canada a bien expliqué, dans l'arrêt Beaulac, qu'une égalité réelle a une signification. Cela signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l'État.
Dans les communautés francophones et acadiennes, l'école d'immersion jouit encore d'une réputation démesurée. Plusieurs parents francophones y voient une occasion d'intégrer la culture anglaise tout en assurant un haut degré de valorisation de la langue et de la culture françaises. Ainsi, le choix de l'école de la majorité et du programme d'immersion française est souvent vu, à tort, comme garant du bilinguisme chez l'enfant alors que, dans les faits, ce choix des parents garantit plutôt l'assimilation à court terme.
Dans les écoles de langue française et les centres scolaires communautaires (seulement 4 sur 661 écoles…), l'enseignement se fait en français et l'école est un foyer de culture française. Il s'agit d'un lieu, l'école, où la transmission de l'identité et des valeurs francophones est extrêmement importante. Mais souvent, les comportements langagiers des élèves entre eux reflètent davantage le milieu social ambiant que celui de l'école. Par ailleurs, les élèves de ces écoles françaises ont :
- Un rendement en français nettement supérieur à celui des élèves, francophones ou anglophones, issus des programmes d'immersion;
- Un rendement en anglais similaire à celui des élèves anglophones, lorsqu'ils vivent dans un milieu anglo-dominant;
- Un rendement en anglais supérieur à leur rendement en français.
Nous savons que la scolarisation maximale en français, et ce, malgré un financement inadéquat, produit le bilinguisme le plus élevé, autant pour les élèves issus des familles exogames que pour ceux issus des familles endogames.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler un principe fondamental. En privant les enfants de l'accès à des écoles de la minorité, où il n'y a pas équivalence des résultats, on assure que les enfants de ces enfants ne pourront pas se prévaloir de l'article 23 de la Charte et, donc, on permet que les nombres d'ayants droit diminuent dramatiquement année après année.
Ententes fédérales - provinciales/territoriales en éducation
De nombreuses études ont été réalisées sur la question des sommes allouées par le gouvernement fédéral, dans le cadre du PLOE, aux gouvernements provinciaux et territoriaux. La principale critique tient à l'imputabilité de ces gouvernements. Non seulement des milliards de dollars ont-ils été octroyés depuis 1972 mais, malheureusement, les communautés sont forcées de se questionner sur la façon dont ces sommes ont été distribuées. Des gouvernements provinciaux, comme la Nouvelle-Écosse il y a quelques années, ont avoué que ces sommes n'avaient pas été investies pour l'éducation de la francophonie minoritaire.
Pourtant, nous semblons perdre de vue un aspect fondamental. Les citoyens francophones de ce pays sont aussi des payeurs de taxes et d'impôts. Ces mêmes citoyens sont en droit de pouvoir compter sur l'État afin de financer l'instruction de leurs enfants. Qui plus est, depuis l'avènement de la Charte, ces mêmes citoyens ont acquis une protection supplémentaire, une mesure réparatrice (dixit la Cour suprême du Canada dans les arrêts Mahé et Arsenault-Cameron), qui leur permet non seulement d'envoyer leurs enfants dans des écoles de la minorité mais, en plus, de pouvoir contrôler ces écoles.
Que reste-il? Des batailles épiques encore actuellement devant les tribunaux pour faire reconnaître, à la pièce, ce que nous savons tous déjà mais ne pouvons faire appliquer par les gouvernements. De plus, nous n'avons aucune assurance que les sommes investies par le gouvernement fédéral vont directement dans le domaine de l'éducation en milieu minoritaire.
Bien souvent, d'aucuns justifient l'ignorance du gouvernement fédéral à l'égard des sommes octroyées en éducation aux provinces sous le prétexte erroné qu'il s'agit d'une question de compétence provinciale et que le fédéral ne peut avoir préséance en éducation. Il ne s'agit pas de compétence, mais bien plus d'imputabilité élémentaire à l'égard des fonds publics. Après tout, la santé est également un champ de compétence provinciale, mais rien n'empêche le gouvernement fédéral de légiférer et de réclamer le respect de cinq principes avant tout transfert d'argent dans le domaine de la santé. Pourquoi n'en ferait-il pas autant dans le domaine de l'éducation? Il y a lieu de se questionner à cet égard, à savoir si le gouvernement fédéral, devant la complexité du milieu de l'éducation, ne connaît pas, tout simplement, un désintérêt face à cette question pourtant fondamentale de l'avenir des communautés francophones et acadiennes.
Si, d'une part, les provinces et territoires ne peuvent garantir que l'argent reçu par le gouvernement fédéral ira directement au profit de la minorité et si, d'autre part, le gouvernement fédéral ne veut pas chercher à obtenir cette garantie, alors il nous faut explorer de nouvelles avenues afin que le gouvernement fédéral puisse assumer son leadership en la matière. Leadership doit ici vouloir dire efficacité.
Enfin, ce n'est pas tout de financer les écoles de la minorité. Encore faut-il travailler en amont plutôt qu'en aval. En effet, de nombreuses études, dont celle de la Commissaire aux langues officielles au mois de mars 2001, citée précédemment, font état de la difficulté pour les écoles de la minorité d'aller chercher les enfants des ayants droit d'une part et, d'autre part, les enfants issus des couples exogames.
Voilà pourquoi il est si nécessaire d'accorder une très grande importance à la petite enfance. Il nous faut pouvoir aller chercher le premier enfant de ces familles endogames et exogames. On parle ici de centres de la petite enfance tels que les garderies ou encore les maternelles. Il importe de pouvoir convaincre ces parents de l'utilité et du bénéfice que ces enfants retireront en allant dans les écoles françaises. Ici encore, il sera question d'assurer une égalité réelle entre une éducation dans l'école de la majorité et une éducation dans celle de la minorité.
Objectifs à atteindre
Assurer une éducation basée sur l'équivalence des résultats
Comme nous l'avons vu, les élèves de la minorité francophone doivent pouvoir recevoir une éducation de qualité égale à celle des élèves de la majorité. Cela ne veut pas dire, naturellement, que le financement doit être égal. Si cela devait être le cas, c'est malheureusement la situation qui prévaut à l'heure actuelle, cela veut dire que les écoles de la minorité reçoivent le même financement que les écoles de la majorité, soit en fonction du per capita. Cette façon de procéder désavantage grandement les écoles de la minorité, ces dernières n'ayant tout simplement pas les nombres nécessaires pour assurer à leurs élèves un accès à une éducation de qualité égale à celle des élèves de la majorité ou même des écoles d'immersion. Une école ne se résume pas simplement en un lieu d'apprentissage, mais aussi en fonction des besoins en matière d'activités parascolaires.
Accroissement du nombre d'inscriptions d'élèves issus des couples endogames dans les écoles de la minorité
Comme nous l'avons vu, il est de la première importance, pour la survie des communautés minoritaires francophones, de pouvoir compter sur ses propres membres afin de remplir les écoles de la minorité.
Accroissement du nombre d'inscriptions d'élèves issus des couples exogames dans les écoles de la minorité
Un sage a déjà dit une fois que nous ne pouvions pas empêcher un cœur d'aimer. Aussi, la réalité est qu'il y a de plus en plus de couples exogames au Canada. Comme il est de la première importance d'assurer non seulement la survie, mais le développement des communautés francophones et acadiennes, il incombe à ces communautés, avec l'aide des gouvernements, de prendre les moyens appropriés pour aller chercher les enfants issus de ces couples.
Imputabilité des sommes octroyées dans le cadre du PLOE
Tout citoyen canadien a le droit de savoir exactement où l'argent de ses impôts est dépensé. Les communautés francophones et acadiennes applaudissent le fait que des sommes soient octroyées aux gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le cadre du PLOE. Cependant, il est du devoir du gouvernement fédéral de s'assurer que les sommes ainsi octroyées sont réellement destinés à l'éducation en milieu minoritaire francophone.
Collaboration entre les écoles françaises et les écoles d'immersion
Assurer la coopération entre les francophones et les francophiles du Canada dans le domaine de l'éducation, en privilégiant des liens de coopération et de collaboration plus étroits entre les réseaux francophones et francophiles.
Pistes d'action
Tout d'abord, il y a lieu d'indiquer qu'il existe de multiples solutions que ce document n'a pas la prétention de vouloir résumer, au risque d'escamoter un pan complet du développement de l'enfant, allant du préscolaire au postsecondaire, et même la formation aux adultes. Chose certaine, le secteur du développement de l'enfant dépasse largement le secteur propre à l'éducation, car l'importance de ce développement de l'enfant comprend aussi tout ce qui touche la petite enfance et le préscolaire. Les pistes d'action qui suivent doivent être retravaillées en fonction des besoins de développement de ces enfants, pris au sens le plus large possible. Il nous tarde de voir le gouvernement fédéral assurer un leadership en la matière en ne tenant plus pour acquis que seules les provinces vont se charger du domaine de l'éducation. Il ressort que l'approche concertée, comme en toute chose, demeure l'action la plus concrète et la plus utile que le gouvernement fédéral doit prendre afin d'assurer réellement le plein développement et l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes, comme le prévoit aussi la Loi sur les langues officielles.
- De concert avec les organismes communautaires œuvrant dans ledomaine de l'éducation en milieu minoritaire, il importe pour legouvernement fédéral de se doter d'une stratégie proactive dans ledomaine de l'éducation. Ainsi, il y aurait certes lieu de créer un comitéconjoint entre Patrimoine canadien et des représentants des organismesci-nommés, afin de développer non pas les besoins, mais les orientationset les priorités de développement.
- Ces priorités peuvent prendre diverses formes, mais elles devrontimpérativement englober bien plus que l'éducation aux niveaux primaire etsecondaire. Ces priorités devront comprendre un plan précis à l'égard dela petite enfance ainsi qu'à l'égard des couples exogames notamment.
- Pour assurer une qualité égale en éducation, ce qui comprend aussi uneégalité des résultats, il faut prévoir des installations physiques de qualitéégale ainsi qu'un curriculum de qualité égale tout en assurant le transportdes élèves. À cet égard, il est nécessaire de discuter avec lesresponsables de l'éducation des provinces et des territoires afin decoordonner des actions précises propres à chaque région. Comme noussavons que les lois et les particularités diffèrent d'une province et d'un territoire à l'autre, nous proposons la mise en place d'un comité, un lieucommun où le gouvernement fédéral, le gouvernement de laprovince/territoire et les conseils scolaires pourront repenser toutel'approche selon chaque province et territoire.
- Nonobstant l'objectif 3, le gouvernement fédéral devrait financerdirectement les conseils scolaires francophones en milieu minoritaire aulieu d'envoyer tout l'argent aux gouvernements des provinces et desterritoires. De cette façon, il y aurait une réelle garantie que les fondsoctroyés serviraient au bénéfice des communautés. L'Entente sur l'unionsociale entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennespermet justement au gouvernement fédéral d'agir de cette façon.
- Le gouvernement fédéral doit prendre les moyens pour assurer sonleadership dans le domaine de l'éducation en créant un nouveau
Programme de francisation et de renforcement linguistique (plan déjà proposé par la Commission nationale des parents francophones ainsi que par la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français). Ce nouveau programme pourrait prévoir, par exemple, quelques initiatives qui pourraient s'illustrer comme suit :
• Initiatives centrées sur la famille
- Activités de communication et d'information permettant aux couples de comprendre les fondements du bilinguisme et les meilleures pratiques de transmission d'habiletés orales et écrites en français;
- Activités appuyant le développement d'attitudes positives dans le couple concernant le bilinguisme de leurs enfants dans un contexte minoritaire;
- Soutien linguistique et culturel des couples formés d'un parent titulaire et de leur famille dès la fondation du couple;
- Activités appuyant le choix des familles endogames et exogames à vivre en français dans leur cellule familiale.
• Initiatives faisant le lien entre l'école et la famille
- Activités appuyant des stratégies pour recruter le plus d'ayants droit que possible;
- Activités appuyant les parties non francophones des couples exogames qui désirent acquérir certains fondements de la langue française;
- Activités communautaires appuyant l'accueil des familles exogames dans les écoles françaises et dans les institutions communautaires.
• Initiatives faisant le lien entre l'école, la famille et lacommunauté
- Activités de réseautage permettant un renforcement mutuel entre les activités dans les domaines sociaux, de la santé, de l'économie et de la culture d'une part, et les activités de francisation et de renforcement linguistique d'autre part;
- Activités de promotion du fait français dans la langue de la majorité;
- Activités d'intégration des nouveaux Canadiens aux communautés francophones minoritaires.
• Initiatives visant la majorité
- Activités de sensibilisation auprès de la majorité concernant la contribution vitale de la minorité linguistique afin de développer des attitudes positives face au fait français dans les provinces et territoires.
LA FRANCOPHONIE INTERNATIONALE
Principes
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
-
Secrétariat à la Francophonie
-
Agence canadienne de développement international
-
Patrimoine canadien
Autres considérations
Les relations internationales sont clairement de juridiction fédérale;
Le gouvernement fédéral participe activement au réseau de la Francophonie internationale;
À l'exception du Nouveau-Brunswick, le fédéral est le seul gouvernement à qui les francophones de l'extérieur du Québec peuvent s'adresser en matière de francophonie internationale;
Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de plusieurs ministères et agences, appuie l'exportation et le commerce international;
De la SEE à la CCC, en passant par l'ACDI et le MAECI, jusqu'à la BDC et Stratégis, le fédéral offre de nombreux services aux exportateurs.
Situation actuelle
La francophonie internationale
Malgré le Sommet de Moncton et les Jeux de la Francophonie d'Ottawa-Hull, le travail de plusieurs regroupements, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, la Société nationale de l'Acadie (SNA) et le Forum Ontario - Francophonie Mondiale (FOFM), la francophonie canadienne de l'extérieur du Québec demeure relativement peu connue au sein de la francophonie mondiale.
La reconnaissance de l'expertise d'organisations en provenance des communautés francophones et acadiennes par les ministères et les agences du gouvernement du Canada
Par exemple, même si les PME québécoises reconnaissent pleinement l'expertise et le réseau du FOFM, les fonctionnaires et les attachés politiques fédéraux continuent à le considérer comme un organisme 41-42.
L'origine
Un peu partout dans le monde, nos entrepreneurs ontariens ou manitobains, par exemple, continuent à se faire poser la question suivante, à savoir dans quelle région du Québec se trouve l'Ontario ou le Manitoba.
En ce qui a trait à l'exportation, on note quatre défis majeurs :
- Les services d'appui du gouvernement fédéral envers l'exportationsont très centrés sur la grande entreprise. À l'ACDI, à la SEE, à laCCC, à Commerce extérieur, etc., si vous êtes une PME, vous n'êtes pasvue très sérieusement. Les entrepreneurs perdent patience et, n'ayantpas accès aux lobbyistes internes des grandes entreprises, abandonnenttout simplement. Pourtant, la presque totalité des entreprisesfrancophones de l'extérieur du Québec sont des PME. Et plus de 90 %des entreprises canadiennes qui exportent sont des PME.
- Les services linguistiques. Dans plusieurs ministères dits« commerciaux », les services en français sont atroces dès que vouspassez les services de première ligne. Nous encourageons quiconque àessayer de trouver, à l'extérieur du Québec, un spécialiste de l'Amériquelatine qui parle français à Industrie Canada, à l'ACDI et à la SEE, sansparler de la CCC qui est un univers «anglo-saxon».
- L'absence d'agences économiques régionales dans l'Est et le CentreSud-Ouest de l'Ontario où résident plus de 40 % des entrepreneursfrancophones hors Québec. Prenons l'exemple d'une entreprised'Ottawa qui veut exporter et celui d'une entreprise un kilomètre plus àl'Est en Outaouais. Cette dernière reçoit l'appui de plusieurs programmes
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
québécois et de Développement économique Canada, l'agence fédérale. La PME d'Ottawa n'a accès à aucun programme provincial (à moins d'exporter aux É.-U.) et à aucune agence fédérale. Autrement dit, en matière d'exportation, la PME québécoise est nettement avantagée.
- Le complexe « Patrimoine canadien ». L'organisation de toutévénement d'affaires en français à l'extérieur du Québec exige des effortsnettement supérieurs aux événements en anglais partout au pays ou enfrançais au Québec. Alors que DRHC, DEC, Industrie Canada, MAECI,Commerce extérieur et l'ACDI se précipitent pour appuyer cesévénements, lorsqu'on leur parle d'un événement en français à l'extérieurdu Québec, on nous répond que c'est le ministère du Patrimoine canadienqui s'occupe de cela. D'un autre côté, au ministère du Patrimoinecanadien, on nous dit que l'on ne s'occupe pas d'économie.
- Le manque d'intérêt pour la francophonie. Les ministères et agenceséconomiques, à l'exception de l'ACDI, ne prennent pas au sérieux lesPME, et même les grandes entreprises intéressées à exporter au sein dela francophonie, particulièrement en Afrique. Suivant l'idéologie duministre responsable, le développement économique africain est, selon lecas, plus ou moins pris au sérieux.
Objectifs à atteindre et pistes d'action
Voici les trois pistes d'action/objectifs que nous identifions :
Promotion
Elle devrait se faire à trois niveaux et par l'intermédiaire d'une organisation ayant des antennes partout au pays.
- Promotion de la francophonie canadienne au sein de la francophoniemondiale, particulièrement de ses agences « opérateurs ». Il est essentielde faire connaître son existence, son expertise et son offre de services.
- Promotion de la francophonie internationale au sein de la francophoniecanadienne. Elle est plus connue, mais elle est souvent vue commedistante, pauvre et arriérée, si bien que les yeux de la francophoniecanadienne (organismes, entreprises, institutions, etc.) se tournentrarement vers elle.
- Une promotion plus ciblée auprès des exportateurs de produits et servicespotentiels. Beaucoup de services développés par les minoritésfrancophones sont très adaptables aux besoins de pays endéveloppement.
Reconnaissance
Cette reconnaissance devrait se faire aux niveaux suivants :
- Patrimoine canadien : La DGPALO est centrée sur le Canada, ce qui estnormal. Cependant, des efforts sont rarement faits pour appuyer desprojets qui, tout en se réalisant en partie à l'extérieur du Canada, ont unimpact certain sur les communautés. Pourtant, si la francophoniecanadienne n'exporte pas ses produits et services, comment fera-t-onpour créer des emplois en français au sein de la francophonie? D'autrepart, le PICLO exclut le financement de tout projet international, et aucuneffort conséquent n'est fait par les fonctionnaires de DGPALO et duPICLO pour appuyer la promotion de projets venant de la francophoniecanadienne et présentés à d'autres ministères ou agences. Le meilleurexemple est évidemment l'échec de l'effort du Patrimoine canadien lors duBiennum de 1999.
- Patrimoine canadien : Une reconnaissance concrète par Patrimoinecanadien du rôle clé que peuvent jouer les communautés francophones etacadiennes est essentielle.
- ACDI : L'ACDI n'est pas soumise à 41-42, et même si nous comprenonsque les ressources de l'ACDI sont ciblées vers l'extérieur du pays, il n'enreste pas moins que cette dernière doit choisir des partenaires, desfournisseurs et des opérateurs au Canada. En ce sens, l'ACDI devrait êtresoumise à 41-42.
- Autres ministères et agences : Même si l'interministériel a fait de grandspas durant les cinq dernières années, beaucoup reste à faire, et ce,particulièrement au sein des ministères et agences tournés versl'économie, l'exportation et l'international où les services en français, lesprogrammes répondant aux besoins des Franco-Canadiens et lareconnaissance du rôle que ces derniers peuvent jouer sont rares, sinonliés à un ministre francophone en poste et ouvert à la francophoniecanadienne.
Appui
Trop souvent, la francophonie canadienne de l'extérieur du Québec a dû se tourner vers des « fonds spéciaux », des comités gouvernement-communauté et/ou des institutions/organismes distincts. Toutefois, c'est probablement la seule solution efficiente. En ce sens, les meilleures approches seraient probablement la mise sur pied d'organisations nationales avec budgets correspondants visant :
- la promotion à l'international;
- l'appui aux projets internationaux des communautés;
- la formation et l'accompagnement d'individus et d'organisations vers des projets, des activités et des stratégies touchant la francophonie mondiale.
Enfin, en ce qui concerne l'appui, il est nécessaire de combler le vide béant laissé par l'absence d'agences de développement économique régionales dans l'Est et le Centre Sud-Ouest de l'Ontario. L'affectation de fonds à un organisme économique existant comblerait ce vide.
L'IMMIGRATION
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Citoyenneté et Immigration Canada
-
Patrimoine canadien
-
Développement des ressources humaines Canada
-
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
-
Conseil privé
-
Gouvernements provinciaux et territoriaux
La nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés s'engage, à l'article 3.b.1), à favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada.
3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :
b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada ;
Plus loin, au paragraphe (3) du même article , on prévoit les passages suivants :
(3) L'interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :
d) d'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada ;
Principaux résultats visés
- Faciliter la promotion des communautés francophones et acadiennes àl'étranger;
- Favoriser le recrutement, la sélection et l'intégration de nouveaux arrivantsau sein des communautés francophones et acadiennes;
- Augmenter le nombre de nouveaux arrivants francophones qui choisissentde s'établir dans les communautés francophones et acadiennes;
- Tenir compte des intérêts des communautés francophones en situationminoritaire lors de l'élaboration des politiques et des programmes deCitoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Situation actuelle
Le Canada compte sur l'immigration pour augmenter sa population, rencontrer ses besoins en main d'œuvre et en expertise technique et professionnelle et bénéficier de la richesse de la diversité culturelle qu'apportent les nouveaux arrivants. Jusqu'à présent, les immigrants sont plutôt venus enrichir les rangs de la majorité, et les communautés francophones et acadiennes ont très peu bénéficié des avantages de l'immigration.
Cette question préoccupe les communautés francophones et acadiennes depuis plusieurs années. Déjà en 1991, la FCFA du Canada publiait une étude de Stacy Churchill et de Isabel Kaprielian-Churchill, intitulée Face au pluralisme, dont l'un des objectifs était d'explorer la question de l'accueil des nouveaux arrivants par les communautés et les institutions des communautés francophones et acadiennes.
En 1999, la FCFA du Canada lançait son projet Dialogue dont les objectifs étaient de :
- Mettre en valeur et promouvoir les communautés francophones etacadiennes du Canada;
- Créer des liens durables entre les communautés francophones etacadiennes du Canada et les autres composantes de la sociétécanadienne, soit les francophones du Québec, les anglophones, lespeuples autochtones et les communautés ethnoculturelles;
Développer des avenues qui permettront aux communautés francophones et acadiennes d'agir aux niveaux national et international.
Dialogue visait aussi à actualiser le discours et les actions de la FCFA du Canada et à réévaluer le positionnement des communautés francophones et acadiennes à l'égard des autres composantes de la société canadienne.
Dans le volet Relations avec les communautés ethnoculturelles de son rapport intitulé Parlons-nous, le groupe de travail Dialogue recommande entre autres :
« Que la FCFA du Canada et ses associations membres entament une réflexion sur les implications liées au concept de communautés ouvertes dans le but de proposer des moyens d'action visant à favoriser une meilleure intégration des nouveaux arrivants. »
Selon les données du recensement de 1996 de Statistique Canada, 39 280 personnes de langue maternelle française, nées à l'extérieur du Canada, vivaient dans les provinces canadiennes autres que le Québec. De plus, entre 1991 et 1996, 2 800 nouveaux arrivants qui se sont établis dans les provinces autres que le Québec ne connaissaient que le français à leur arrivée au pays alors que 38 978 connaissaient l'anglais et le français. Entre 1996 et 1999, 6 408 nouveaux arrivants francophones et 13 611 immigrants qui déclaraient connaître les deux langues officielles se sont établis dans les provinces autres que le Québec. Nous souhaitons que ces nombres augmentent dans les années à venir et que les nouveaux arrivants francophones puissent venir enrichir et augmenter les rangs des communautés francophones en situation minoritaire.
Au cours des deux prochaines années, un plan d'action qui vise à mieux accueillir les nouveaux arrivants francophones qui choisissent de s'établir dans les régions canadiennes où le français est la langue de la minorité et à faciliter leur intégration dans les communautés francophones de ces régions, devrait être articulé dans une démarche conjointe entre les communautés francophones et acadiennes, les groupes ethnoculturels et Citoyenneté et Immigration Canada.
De plus, un projet visant à évaluer la capacité d'accueil dans 6 communautés francophones et acadiennes a récemment été mis sur pied. Ce projet permettra de nourrir la réflexion autour du plan d'action en identifiant d'une part les besoins et les services existants et, d'autre part, en suggérant des pistes de solutions afin de permettre aux communautés d'être mieux outillées pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants dont la langue maternelle ou la première langue officielle est le français doivent pouvoir être informés de l'existence de la communauté francophone en situation minoritaire à l'intérieur de la société d'accueil où ils ont choisi de s'établir et trouver dans ces communautés francophones les services dont ils ont besoin pour un accueil et une intégration réussis.
Objectifs à atteindre
Les communautés francophones et acadiennes sont sensibilisées aux bénéfices de l'immigration et ouvertes à la diversité.
Les communautés francophones et acadiennes ont les infrastructures nécessaires pour bien accueillir et intégrer les nouveaux arrivants francophones.
Les ambassades et les consulats canadiens à l'étranger sont en mesure d'informer les immigrants potentiels au sujet des communautés francophones et acadiennes.
Les centres d'excellence de Métropolis font des recherches reliées à l'immigration dans les communautés francophones et acadiennes.
Pistes d'action
Les ministères fédéraux et les communautés francophones et acadiennes collaborent à :
- L'élaboration d'une stratégie pour sensibiliser les communautésfrancophones en situation minoritaire aux enjeux reliés à l'immigration etpour accroître leur capacité d'accueil;
- L'élaboration d'une stratégie de sensibilisation des employés, desfournisseurs de services et des clients de CIC au Canada et à l'étrangerdu caractère bilingue du Canada, des résultats souhaités en matièred'immigration ainsi qu'à la présence de collectivités de langue officielle ensituation minoritaire dans chaque province et territoire, pour accroîtrel'établissement d'immigrants au sein des communautés francophones ensituation minoritaire;
- L'élaboration d'une stratégie pour assurer la liaison avec lescommunautés et acadiennes afin de faciliter leur participation aux activitéset aux consultations publiques de CIC afin d'accroître leur expertise dansle domaine de l'immigration;
- L'élaboration d'une stratégie de promotion, de recrutement et de sélectionpour augmenter le nombre d'immigrants qui choisiront de s'établir au seindes communautés francophones et acadiennes.
Les ministères et les communautés francophones et acadiennes participent à :
- La mise en œuvre d'une nouvelle stratégie d'intégration des immigrantsau sein des communautés francophones et acadiennes;
- L'identification d'études et de recherches sur les enjeux reliés àl'immigration au sein des communautés francophones et acadiennes.
LA JUSTICE
Principes
L'objectif de la Loi sur les langues officielles : Favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement.
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
Administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO)
Ce programme relève à la fois du ministère de la Justice a
-
Ministère de la Justice
-
Procureur général du Canada
-
Patrimoine canadien
-
Gouvernements provinciaux et territoriaux
-
Conseil canadien de la magistrature
insi que du ministère du Patrimoine canadien. Le président du PAJLO est le sous-ministre délégué à la Justice, Me Mario Dion. Le mandat de ce programme est de contribuer à la promotion et à l'amélioration de l'administration de la justice dans les deux langues officielles de manière à ce que les citoyennes et les citoyens canadiens puissent exercer leurs droits dans les deux langues officielles. Tout organisme canadien sans but lucratif œuvrant dans le domaine juridique peut recourir au PAJLO pourvu que le projet présenté réponde à l'objectif établi, soit de concevoir ou de développer, dans une perspective de concertation, les outils et les moyens qui permettront aux citoyennes et aux citoyens canadiens d'exercer leurs droits dans les deux langues officielles.
Le PAJLO est un programme unique qui se consacre à la création d'outils juridiques et jurilinguistiques destinés aux juristes canadiens qui desservent les justiciables membres des communautés minoritaires de langue officielle.
L'engagement du ministère de la Justice envers le PAJLO et le réseau des organismes qui en font partie illustre bien cette double clientèle, justiciables et juristes, à laquelle le ministère s'adresse. Le PAJLO existe maintenant depuis vingt ans.
Malgré toute l'importance accordée au PAJLO, il semble régner une certaine confusion au niveau de son orientation générale. Autrefois, les rencontres du PAJLO se déroulaient deux fois par année. Depuis quelques années, il n'existe qu'une seule rencontre annuelle. Il importe de préciser que les gouvernements provinciaux font également partie du PAJLO tout comme d'autres organismes non gouvernementaux qui œuvrent dans le domaine juridique.
Programme de contestation judiciaire du Canada (PCJ)
Le Programme de contestation judiciaire du Canada est un organisme à but non lucratif complètement indépendant du gouvernement fédéral dont le mandat est d'octroyer des sommes d'argent à des individus ou à des groupes qui veulent contester une législation, un règlement, une politique ou une directive allant à l'encontre des droits linguistiques ou des droits à l'égalité prévus par la Charte canadienne des droits et libertés. Le financement provient du ministère du Patrimoine canadien à raison d'une contribution annuelle de 2,75 M$.
Le Programme finance les causes invoquant les droits linguistiques au niveau fédéral ou provincial, garantis par la Constitution du Canada. Sont également financées les causes contestant les lois, les politiques ou pratiques fédérales fondées sur l'article 15 (égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les causes ne sont financées que si elles sont susceptibles de modifier une loi, une politique ou une pratique de manière à ce que celle-ci respecte les droits linguistiques ou les droits à l'égalité.
Le ministère de la Justice a, officiellement, pour mission de :
- seconder le ministre dans la tâche d'assurer, au Canada, l'existence d'unesociété juste et respectueuse des lois, pourvue d'un système judiciaire efficace, équitable et accessible à tous;
- fournir des conseils et autres services juridiques de grande qualité augouvernement ainsi qu'aux ministères et organismes clients;
- promouvoir le respect des droits et libertés, de la loi et de la Constitution.
Principaux résultats visés
• Favoriser l'utilisation équitable de l'anglais et du français devant les tribunaux canadiens.
• Permettre aux justiciables francophones de pouvoir ester en justice10 en français lorsqu'il est question du champ de compétence du gouvernement fédéral.
Situation actuelle
Il est indéniable que le secteur juridique a été et est toujours d'une ampleur considérable pour le développement et l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes. Les gains les plus significatifs des communautés francophones et acadiennes au cours des vingt dernières années l'ont été grâce à de nombreuses victoires judiciaires. Nous n'avons qu'à penser aux arrêts Mahé, Renvoi sur la Loi sur l'éducation du Manitoba, Arsenault-Cameron en éducation. Gardons en tête les affaires Viola, Devinat, Beaulac et, plus récemment, Charlebois et Montfort pour nous convaincre de l'impact majeur que peut avoir le développement d'une jurisprudence forte, basée sur une interprétation large et libérale des droits linguistiques prévus par la Constitution canadienne et par la Loi sur les langues officielles.
Nous retrouvons des associations de juristes d'expression française de common law dans sept provinces canadiennes, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Ces associations sont chapeautées par un organisme national, la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law (FAJEF).
La mission de la FAJEF consiste principalement à favoriser la mise en place, dans toutes les provinces et tous les territoires, d'une utilisation équitable de l'anglais et du français dans les tribunaux fédéraux, provinciaux et territoriaux. De même, la Fédération poursuit également l'objectif de convaincre les différents gouvernements de nommer des juges bilingues qui soient capables d'entendre des litiges en français.
Le Commissariat aux langues officielles a rendu publiques, au cours des dernières années, trois études concernant l'accès à la justice. Dans chacune de ces études, des recommandations visant à améliorer la situation sont adressées au ministère de la Justice. Ces trois études sont les suivantes :
L'Étude de 1995 sur l'utilisation équitable du français et de l'anglais devant les tribunaux au Canada : Cette étude met principalement l'accent sur la mise en œuvre des droits linguistiques en matière criminelle (articles 530 et 530.1 du Code criminel) par les tribunaux provinciaux. Elle traite également un peu de la mise en œuvre des droits linguistiques en matière civile devant les tribunaux provinciaux (en vertu de dispositions constitutionnelles ou de législations provinciales) et devant les tribunaux fédéraux (en vertu de la partie III de la LLO).
L'Étude de 1999 sur l'utilisation équitable du français et de l'anglais devant les tribunaux fédéraux et devant les tribunaux administratifs fédéraux qui exercent des fonctions quasi judiciaires : Cette étude met l'accent sur la mise en œuvre des droits linguistiques en matière civile devant les tribunaux fédéraux (partie III de la LLO).
L'Étude de 2000 sur les représentants de la Couronne : Cette étude met l'accent sur la nécessité pour le ministère de la Justice de s'assurer que ses obligations linguistiques, tant en matière civile (partie III de la LLO) qu'en matière criminelle (art.530 et 530.1 du Code criminel), seront respectées lorsqu'il choisit de faire appel à un avocat de pratique privée pour le représenter.
Il faut bien comprendre que les possibilités d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les procédures judiciaires varient considérablement d'une province ou d'un territoire à un autre. Cela se comprend aisément, étant donné l'application inégale des garanties constitutionnelles et aussi le fait que la compétence législative à l'égard des tribunaux, civils ou en matière criminelle, est partagée entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives provinciales. Les études des Commissaires aux langues officielles qui se sont succédés nous permettent de tracer quelques constats.
En matière criminelle, le gouvernement fédéral a l'obligation législative, prévue aux articles 530 et ss. du Code criminel, de prévoir des procès en français pour tout accusé, et ce, partout au pays. Malheureusement, la pleine mise en œuvre de ces droits reste à accomplir dans plusieurs régions. Par exemple, les accusés ne sont souvent pas informés de leurs droits linguistiques, et ce, même lorsque représentés par un avocat. Les études de 1995 et 2000 notent aussi une absence fréquente de l'offre active pour ce qui touche les services dans la langue de la minorité. L'interprétation est bien souvent inadéquate. Enfin, outre les procureurs représentant la Couronne qui ne parlent pas toujours le français, ni ne le comprennent, la capacité bilingue des cours provinciales est sérieusement mise en doute.
Toujours en ce qui concerne la responsabilité fédérale en matière civile devant les tribunaux fédéraux, les obligations linguistiques prévues dans la Partie III de la Loi sur les langues officielles sont directement applicables, en théorie, à tout tribunal administratif ou judiciaire fédéral. Les procédures varient considérablement d'un tribunal à un autre. Le public n'est pas informé de ses droits, ce qui résulte d'une absence d'offre active. L'étude de 1999 dénote également des problèmes de capacité bilingue des tribunaux et une application hasardeuse en ce qui a trait à la politique de traduction des documents.
À cela, il est permis d'ajouter qu'il est encore, en 2002, impensable dans certaines provinces de pouvoir divorcer en français ou encore de pouvoir recourir à la Loi sur la faillite en français au pays. Pourtant, ce sont là deux lois de compétence fédérale qui touchent directement bien des citoyens canadiens, y compris des citoyens de langue française.
En matière civile, il faut reconnaître que ce ne sont pas toutes les provinces qui offrent les mêmes protections linguistiques. Aussi, l'étude de 1995 note une très grande disparité entre les provinces en ce qui concerne l'utilisation du français. Non seulement le public n'est pas informé de ses droits, lorsqu'il en a, mais on dénote une absence presque totale d'offre active en la matière.
Les associations de juristes travaillent activement sur le terrain afin de faciliter l'embauche de personnel ayant des capacités bilingues ou encore la nomination de juges bilingues, mais les résultats sont loin d'être convaincants.
Le rôle du ministère de la Justice comme conseiller juridique
Le ministère de la Justice émet des opinions quant à l'interprétation des lois canadiennes pour le bénéfice de ses clients, soit les autres ministères et agences gouvernementales fédérales. En somme, le ministère de la Justice est le conseiller juridique du gouvernement fédéral et de ses ministères. Il revient au Procureur général du Canada, entité distincte en soi, de représenter l'intérêt du gouvernement fédéral et, donc, de ses clients devant les tribunaux.
La Loi sur les langues officielles établit clairement, en son article 82, que certaines parties de la Loi ont un caractère quasi constitutionnel. La jurisprudence récente, dont l'arrêt Viola, laisse croire que l'ensemble de la Loi aurait également un caractère quasi constitutionnel, dont la Partie VII. Depuis l'arrêt Beaulac de la Cour suprême du Canada, les communautés francophones et acadiennes sont en droit de s'attendre à ce que le conseiller juridique du gouvernement fédéral, c'est-à-dire le ministère de la Justice, l'informe sur la nature exacte du droit, en ce que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation large et libérale en fonction de l'objet du droit en question. Toute interprétation dite restrictive doit être écartée. De plus, comme la Loi sur les langues officielles a un caractère quasi constitutionnel et a ainsi une primauté sur les autres lois fédérales, le gouvernement fédéral et ses institutions doivent en prendre acte.
En ce qui concerne plus particulièrement l'interprétation concernant la portée des articles 41, 42 et 43 de la Loi sur les langues officielles, à savoir si ces articles ont un caractère exécutoire ou simplement déclaratoire, le ministère de la Justice n'a pas changé d'opinion juridique. Pourtant, depuis l'arrêt Beaulac, où l'on consacre de façon définitive que l'interprétation des droits linguistiques doivent être faits en fonction de l'objet de ces droits, les communautés francophones et acadiennes auraient été en droit de s'attendre à plus d'ouverture quant à l'interprétation de ces droits. D'autant que l'objet des droits prévus par la Partie VII de la Loi sur les langues officielles (du moins, cela peut se plaider) est justement de nature réparatrice et vise un engagement formel du gouvernement fédéral en faveur de la protection, mais aussi en faveur de l'épanouissement des collectivités minoritaires de langue officielle.
Objectifs à atteindre
Assurer la pleine accessibilité à la justice en français devant les tribunaux fédéraux
Malgré tous les efforts déployés par le ministère de la Justice, il semble manquer ce que la Commissaire aux langues officielles qualifie d'engagement ferme du gouvernement fédéral envers l'égalité d'accès à la justice dans les deux langues officielles. Il ne s'agit pas ici seulement du ministère de la Justice, mais bien de l'ensemble du gouvernement et de ses institutions. En effet, de nombreux tribunaux administratifs ne relèvent pas seulement du ministère de la Justice et, de ce fait, doivent aussi permettre aux justiciables francophones d'avoir un accès égal à la justice.
Assurer l'accessibilité à la justice en français devant les tribunaux canadiens
Comme dans le domaine de l'éducation, le gouvernement doit faire preuve de leadership pour tout ce qui touche l'accessibilité à la justice en français dans les tribunaux relevant de la compétence provinciale. Il devient assez ironique pour les communautés francophones et acadiennes que, d'un côté, les contestations judiciaires ont permis de faire progresser le développement et l'épanouissement des communautés, mais que, de l'autre, on ne puisse s'adresser devant les tribunaux dans sa propre langue afin d'obtenir ce qui, dans une société démocratique, apparaît comme l'un des droits les plus fondamentaux, ester en justice.
Clarifier l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des principes jurisprudentiels portant sur les droits linguistiques contenus dans la Constitution canadienne ainsi que dans la Loi sur les langues officielles
L'ensemble du gouvernement fédéral et de ses institutions doivent prendre acte de la jurisprudence récente en matière de droits linguistiques. Cela veut dire concrètement que, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles. Le gouvernement et ses institutions doivent également prendre acte que les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Il existe une égalité réelle des droits linguistiques et cette égalité réelle a une signification. Cette égalité signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l'État. De plus, depuis le Renvoi sur la sécession (et les arrêts Montfort, notamment celui de la Cour d'appel, le confirment), il est établi qu'il existe un principe directeur fondamental à la Constitution canadienne qui est la protection des minorités. Ce principe non écrit lie les gouvernements et peut avoir une force normative puissante.
Permettre l'édification soutenue d'une jurisprudence solide basée sur la Loi sur les langues officielles
Comme les droits linguistiques constitutionnels, les droits prévus dans la Loi sur les langues officielles sont de très grande importance pour les communautés francophones et acadiennes. Il existe une jurisprudence intéressante et prometteuse en ce qui concerne la Loi. Cependant, lorsque la Commissaire ne peut, pour une raison ou une autre, défendre de son propre chef un plaignant, ce dernier doit alors se tourner vers les tribunaux et se retrouve, bien souvent, seul et démuni. Il serait dès lors souhaitable que le Programme de contestation judiciaire puisse financer des causes portant sur la Loi sur les langues officielles.
Pistes d'action
- Le rôle du ministère de la Justice du Canada, au-delà de toutes lesconsidérations, est de faire preuve de leadership pour tout ce qui touchel'accès à la justice en français pour les justiciables de partout au pays.Cela se traduit par la mise en place de réels partenariats avec lesorganismes représentant les associations de juristes, mais aussi avec lesorganismes porte-parole des communautés francophones et acadiennes.En ce moment, de nouvelles études ont cours, notamment celle portantsur l'état des lieux qui se veut une réponse aux études du Commissariataux langues officielles. Depuis 1995, voilà maintenant sept années, que legouvernement fédéral n'a pas encore clairement proposé de solutions auxproblèmes décriés dans ces études.
- Il importe de pouvoir créer un comité consultatif conjoint, organismescommunautaires représentant les juristes d'expression française etorganismes porte-parole des communautés, avec le ministère de laJustice, afin de se doter d'un plan d'action clair et précis établissant lesbesoins, mais surtout les priorités d'action de l'ensemble dugouvernement fédéral. Les priorités surtout, puisque les besoins ont étédéjà analysés par les différentes études du Commissariat aux languesofficielles. Ces études sont présentement analysées par le ministère de laJustice même. Ce plan devra ensuite faire partie prenante du plan d'actionsouhaité par les communautés francophones et acadiennes.
- Il est clair que le ministère de la Justice détient un rôle clé lorsqu'il estquestion d'émettre des avis concernant les langues officielles. Cependant,nous l'avons vu, l'interprétation large et libérale, en conformité avec lesprincipes jurisprudentiels, devrait être la norme. La responsabilitépremière du ministère, comme l'indique sa mission, est de promouvoir lerespect des droits et libertés, de la loi et de la Constitution. Aussi, les avis du ministère de la Justice à ses « clients » devraient refléter ces principes jurisprudentiels que nous évoquions précédemment.
- De plus, le gouvernement fédéral devrait prévoir, pour la formation descadres supérieurs de la fonction publique, des cours spécifiques reliés auxlangues officielles. Il importe de rappeler à ces nouveaux décideurs nonseulement l'état actuel du droit en la matière et, donc, des obligationsgouvernementales qui en découlent, mais aussi l'importance du conceptde la dualité linguistique comme fondement de base du pays canadienainsi que l'importance du principe non écrit de la Constitution canadienneen faveur de la protection des minorités.
- De concert avec le Programme de contestation judiciaire du Canada, leministère du Patrimoine canadien devrait proposer au cabinet de modifierl'accord de contribution qui lie le programme au gouvernement fédéral afinde lui permettre le financement de causes portant exclusivement sur la Loisur les langues officielles et ses règlements, ce qui lui est interdit en cemoment. De telles possibilités seraient souhaitables afin que lesjusticiables puissent enfin avoir recours à l'aide financière du Programmeen cas de contestation d'une décision d'une agence ou institutionfédérale, si le Commissariat aux langues officielles ne prend pas sur lui lerecours, comme le prévoit la Loi.
- Naturellement, le gouvernement fédéral doit prendre acte de toutel'importance qu'il doit accorder à la nomination de juges bilingues quipeuvent desservir toute la population canadienne. La possibilité qu'ont lesjusticiables de pouvoir avoir accès à la justice en français commence biensouvent par la nomination de juges ayant les capacités non seulement deles entendre, mais aussi de la comprendre.
- Enfin, le gouvernement fédéral, par l'entremise du ministère du Patrimoinecanadien, devrait, de concert avec le Programme de contestationjudiciaire du Canada, entrevoir la possibilité de doter cet organisme d'unfinancement stable et à long terme, sous la forme d'une fondation; ceprojet est sous étude au Programme de contestation judiciaire depuis sonretour en février 1995.
LA SANTÉ
Ce document est un condensé du Rapport du Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire soumis au ministre fédéral de la Santé en septembre 2001. Vous pouvez obtenir la version complète de ce rapport à l'adresse www.forumsante.ca ou en communiquant avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada au (613)241-7600.
Principes
Stratégie fédérale d'appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le gouvernement du Canada a approuvé, en août 1994, l'établissement d'un cadre de responsabilité pour la mise en œuvre des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles. En vertu de l'article 41, le gouvernement fédéral s'engage à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne, ainsi qu'à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet engagement vise non seulement à faire en sorte que ces communautés aient accès à des services dans leur langue, mais aussi que toutes les institutions fédérales participent activement à leur développement et à leur épanouissement.
Principaux intervenants gouvernementaux
-
Santé Canada
-
Gouvernements provinciaux et territoriaux
Autres considérations
La santé est une juridiction provinciale/territoriale.
La Loi canadienne sur la santé identifie les conditions de contribution pécuniaire du gouvernement fédéral à chaque province/territoire en fonction des conditions suivantes : a) la gestion publique; b) l'intégralité; c) l'universalité; d) la transférabilité et e) l'accessibilité.
Situation actuelle
Le système de santé est au cœur de l'union sociale canadienne. Il est le symbole des valeurs de justice sociale et de partage qui caractérisent notre pays. Pourtant, plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes d'expression française n'ont aucunement ou ont rarement accès à des services de santé dans leur langue lorsqu'ils vivent dans des provinces ou territoires où le français n'est pas la langue de la majorité.
Tout comme l'éducation, la santé est une responsabilité d'abord provinciale ou territoriale. Quelques provinces, encore peu nombreuses, ont entrepris des mesures visant à offrir des services de santé en français à leur communauté francophone. On peut mentionner l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui, à cause de l'importance de leur population francophone, ont mis sur pied certaines infrastructures et offrent un certain nombre de services de santé en français.
Le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard ont aussi récemment entrepris des mesures en ce sens. À la différence du secteur de l'éducation cependant, ces mesures ont été entreprises à l'initiative unique des provinces et sans une aide systématique du gouvernement fédéral qui, bien avant l'adoption de la Charte en 1982, a eu une politique et un programme d'appui aux provinces et territoires désireux d'améliorer l'éducation en français.
Certaines initiatives, surtout dans les domaines de la promotion de la santé, sont menées par des organismes communautaires. Certaines peuvent parfois bénéficier d'un appui de Santé Canada dans le cadre de programmes qui n'ont pas été conçus pour répondre aux besoins particuliers des communautés francophones en situation minoritaire. En fait, les organismes francophones ne réussissent que rarement, et avec beaucoup de difficulté, à s'inscrire dans le cadre de ces programmes. C'est d'ailleurs ce qui a incité le ministre fédéral de la Santé à créer, en avril 2000, le Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire afin d'obtenir un meilleur arrimage des programmes de son ministère aux réalités et besoins de ces communautés.
Objectifs à atteindre
Le comité recommande au ministre fédéral de la Santé d'adopter une stratégie globale afin de permettre au million de francophones canadiens vivant en situation minoritaire d'améliorer leur état de santé individuel et collectif par un meilleur accès aux services de santé dans leur langue maternelle. Cette stratégie comporterait plusieurs initiatives, qui doivent toutes être intimement liées les unes aux autres pour former un tout cohérent.
Pistes d'action
Le plan d'action proposé par le Comité consultatif prévoit des interventions dans cinq grands domaines :
Le réseautage est à la base de la stratégie proposée par le comité. Il permettra une véritable appropriation du dossier par la communauté. Sans cette appropriation, les initiatives même les mieux intentionnées risquent de ne pas produire les effets escomptés parce qu'elles n'auront pas bénéficié de l'appui communautaire nécessaire à leur succès.
Les réseaux regrouperaient autour d'une même table les partenaires intéressés tels que la communauté, les professionnels de la santé, les établissements de formation, les établissements de santé et les décideurs politiques afin d'établir des stratégies d'amélioration des soins de santé en français, appuyer ou réaliser des initiatives menant à un meilleur accès, sensibiliser la communauté et les intervenants à l'importance de services de santé en français, favoriser l'engagement de la communauté.
Un réseau national favorisera quant à lui la coopération entre les réseaux provinciaux et territoriaux en suscitant l'échange d'informations et de pratiques exemplaires, appuiera la création de réseaux dans certaines régions, mènera des démarches auprès des instances nationales.
Parce qu'on y a recours en situation de vulnérabilité, il est important d'avoir des lieux d'accueil où l'on sera sûr que le service sera dispensé en français, qu'une personne n'aura pas à insister pour obtenir un service en français.
Le comité recommande que l'accent soit mis sur les soins primaires parce que la communication entre l'intervenant et l'usager y revêt une importance particulière. De nombreux modèles de prestation de services existent dans nos systèmes de santé : médecins pratiquant seuls ou en clinique, avec ou sans l'appui d'autres professionnels de la santé, ligne info-santé, centre de santé communautaire, etc.
Des communautés différentes choisiront forcément des modèles différents en fonction de leurs besoins. Ce sont les réseaux régionaux qui établiront ces priorités, adaptées à la réalité de leur communauté. L'aspect le plus important, c'est probablement que ces initiatives soient compatibles avec le système de santé de la province ou du territoire concerné, qu'elles s'inscrivent dans le continuum de soins.
La disponibilité de personnel compétent est évidemment un ingrédient essentiel pour l'amélioration des soins de santé en français. Le nombre d'inscriptions dans les programmes de formation en santé est insuffisant pour pallier la pénurie de professionnels de la santé pouvant s'exprimer en français. Il faudrait tripler ou même quadrupler le nombre d'inscriptions dans les programmes de formation en santé.
Le lieu et la langue de formation sont deux facteurs importants de l'équation. L'expérience démontre que les futurs professionnels de la santé ont tendance à ne pas revenir dans leur région d'origine lorsqu'ils fréquentent un établissement de formation loin de leur domicile. Ceux et celles qui étudient dans un établissement anglophone pratiquent quant à eux rarement en français par la suite.
Il est donc crucial que les programmes de formation, par la voie de stages pratiques, favorisent un contact le plus fréquent et le plus long possible de l'étudiant ou de l'étudiante avec sa région d'origine. Les expériences telles que le Partenariat Acadie-Université de Sherbrooke ou le Centre national de formation en santé, situé à Ottawa, ont déjà ouvert la voie dans cette direction.
Il est urgent d'étendre la portée de ces expériences en mettant à contribution les acquis qui existent dans nos communautés, tels que les institutions postsecondaires universitaires ou collégiales et les établissements de soins dans un Consortium pancanadien de formation qui fera la promotion des carrières en santé, assurera une offre adéquate de programmes et verra au renforcement des structures d'accueil pour ceux et celles qui s'inscriront à des programmes de formation collégiale ou universitaire en sciences de la santé.
À l'heure actuelle, nous manquons d'information stratégique sur les communautés francophones en situation minoritaire qui nous permettraient d'établir des stratégies sanitaires ciblées sur le plan régional ou local. On connaît mal les habitudes de vie liées à la santé des francophones, telles que l'alimentation, l'activité physique, le tabagisme ou leur utilisation des services de santé.
Connaître davantage l'état de santé des populations permettrait de mieux cibler les programmes et les infrastructures à mettre en place, de même que les campagnes de promotion de la santé ou de prévention des maladies.
La mise sur pied d'une chaire de recherche, le développement des capacités de recherche des partenaires du consortium pancanadien pour la formation, le réseautage des chercheurs sont autant de moyens de créer un cadre de recherche pour la cueillette et l'analyse de données pertinentes et fiables sur les communautés dans le but de mieux orienter les actions à prendre.
Pour desservir les communautés éloignées ou ne comptant qu'un petit nombre de francophones, l'utilisation des nouvelles technologies peut offrir des avenues intéressantes. Le développement de l'inforoute de la santé permettra de communiquer rapidement et efficacement par le son, l'image et la transmission de données avec un grand nombre de points de service partout au pays.
Cette infrastructure pourra également être utilisée pour offrir des occasions de perfectionnement professionnel au personnel médical de régions isolées en leur permettant de participer à des activités de formation par voie électronique. L'établissement de meilleurs réseaux de communication facilitera également l'échange de renseignements sur des patients francophones entre diverses institutions, assurant un meilleur suivi de l'usager dans le système de santé.
Ce plan d'action a été validé par les différents intervenants lors d'un colloque réunissant près de 250 personnes de toutes les régions du pays, en novembre 2001 à Moncton. Après ce colloque, plusieurs réseaux ont commencé à se constituer.
CONCLUSION
Le but du présent document ne consiste pas à réclamer seulement un accroissement des ressources consacrées au seul programme fédéral des langues officielles. La FCFA du Canada requiert aussi une utilisation plus judicieuse de ces ressources, en modifiant l'approche adoptée par le gouvernement pour concrétiser son appui aux communautés francophones vivant en situation minoritaire.
Le cadre d'action doit veiller à ce que les gestionnaires s'acquittent de leurs responsabilités constitutionnelles et légales et comprennent mieux les besoins des communautés, tout en s'assurant qu'ils en tiennent compte lorsqu'ils prennent des décisions qui les concernent, surtout ceux qui œuvrent dans le champ des grands axes de développement communautaire. Une politique de développement global, appuyant ces grands axes de développement de front, permettra de réellement stimuler le développement des communautés.
Une politique de développement global permettra enfin aux communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire de prendre acte d'une nouvelle volonté ferme et résolue du gouvernement à l'égard de son engagement à favoriser le développement et l'épanouissement des communautés. Cette politique permettra au gouvernement fédéral d'être plus efficace et cohérent dans sa gestion quotidienne et régulière puisque cette dernière se fera de concert avec les besoins et les priorités de développement clairement établis par les communautés. Enfin, une telle politique enrichira le gouvernement puisqu'elle lui permettra de travailler en amont plutôt qu'en aval, d'être un gouvernement proactif et non en attente de réactions malheureusement trop souvent négatives.
Dans cette perspective, le leadership du gouvernement fédéral doit s'exercer afin que les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire puissent vivre dans leur propre langue dans leur milieu, en tant que communautés fortes, dynamiques et inclusives, participer pleinement à tous les secteurs de la société canadienne, et assurer leur développement à long terme.
REMERCIEMENTS
La FCFA du Canada tient à remercier les organismes suivants pour leur précieuse participation au contenu du présent document : la Fédération culturelle canadienne-française, la Table Arts et Culture, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français, l'Association canadienne d'éducation de langue française, la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law, le Comité national de développement des ressources humaines de la francophonie canadienne, le Forum Ontario - Francophonie Mondiale, l'Association de la presse francophone, l'Alliance des radios communautaires du Canada, le Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire de Santé Canada, le Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada - communautés francophones en situation minoritaire.