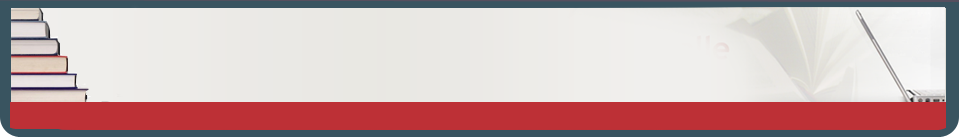Lise Gervais
Avril 1997
Rapport de recherche
Centre de formation populaire
ASSISTANTE DE RECHERCHE
Marlène Théberge
COCHERCHEURS (par ordre alphabétique)
Line St-Amour
RÉVISION LINGUISTIQUE
Marie Letellier
MISE EN PAGE ET GRAPHISME
France Clavette
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec 2e trimestre 1997 ISBN 2-920111-28-0
Éditeur:
Centre de formation populaire 3575, boul. St-Laurent, bur. 406 MONTRÉAL (Québec) H2X 2T7 Téléphone : 514-842-2548. Télécopieur: 514-842-1417 Courriel : cfp@jonction.net
Table des matières
Remerciements
Nous tenons tout d'abord à remercier le Service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal qui a subventionné cette recherche par le biais du programme PAFAC, et son volet « recherche dans le cadre du Service aux collectivités ». Nous remercions tout particulièrement M. Vincent van Schendel, du même service, pour son soutien constant, entre autres au moment de la préparation et de la présentation de notre protocole de recherche.
Nous tenons également à remercier l'École de Service social de l'Université de Montréal, et plus spécifiquement son directeur, M. Jean Panet-Raymond, pour le soutien financier complémentaire qui nous a permis de démarrer plus rapidement notre recherche.
En ce qui a trait à la participation même à la recherche, nous tenons à remercier tous les organismes communautaires qui ont bien voulu assumer la participation active d'un de leurs intervenants1. Il va sans dire qu'un remerciement particulier va à la collaboration continue de l'équipe et des membres du conseil d'administration du Centre de formation populaire. Nous pensons tout particulièrement ici à France Clavette, Michelle Duval et Lorraine Guay.
Plusieurs autres personnes nous ont apporté leur aide à divers moments. En espérant n'oublier personne, nous voudrions remercier plus particulièrement Isabelle Gentès, Marie Letellier et Pierre-Yves Lévesque.
Introduction
Cette recherche porte sur les pratiques communautaires dans le champ de la santé et des services sociaux au Québec, au moment même où ce champ est traversé par une réforme majeure amorcée en 1992. Cette réforme régionalise les services et les soins, tout en visant initialement une réorganisation par programmes à l'intérieur de chaque région administrative (Programmes régionaux d'organisation des services-PROS). Parallèlement, elle reconnaît explicitement les organismes communautaires comme étant des partenaires tant dans l'organisation des services que dans les structures décisionnelles régionales (ex. : les conseils d'administration des régies régionales). Le partenariat devient donc dans un tel contexte le mot clé de cette réforme qui vise ultimement à placer le citoyen au centre des soins et des services.
Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes penchés, après quatre années d'expérimentations, de réflexions et de débats, sur certaines pratiques communautaires qui nous apparaissaient touchées dans leurs fondements par divers enjeux portés par cette réforme. Rappelons que le mouvement communautaire, québécois comme montréalais, adhère à une vision globale de la santé et des services sociaux. Conséquemment, il se refuse à compartimenter les services, à étiqueter et à découper les gens par problématiques, facteurs de risques ou populations cibles. Le mouvement communautaire affirme vouloir intervenir sur la personne, perçue comme un tout, en l'aidant à identifier et à mieux répondre à ses besoins (RIOCM, 1994 a et b). Toutefois la dynamique partenariale telle qu'elle s'est développée ces dernières années soulève de multiples enjeux qui peuvent ébranler les fondements historiques de l'intervention communautaire, que ce soit par rapport au financement, à l'autonomie des pratiques et à la prise en compte de la spécificité du communautaire2, à l'accentuation de la spécialisation et de la professionnalisation du milieu communautaire.
Ces enjeux, et bien d'autres, ont été à divers titres repris au cours des dernières années dans divers travaux et documents. Que ce soit par rapport à la place ou à la reconnaissance du communautaire dans la réforme de la santé et des services sociaux (Table des Regroupements, 1993; PanetRaymond, 1994; Parazelli, 1992); au partenariat déjà amorcé dans certains secteurs tels que la santé mentale (White, Mercier, Dorvil et Juteau, 1992; Gagné et Dorvil, 1994; Lamoureux, 1994), ou plus largement, dans l'ensemble du territoire du Québec (Table des regroupements, 1995); aux possibles vertus (Vaillancourt, 1994) ou risques (White, 1994) de l'intersectorialité et de la communautarisation des rapports sociaux. Toutefois, aucune recherche ne s'est intéressée spécifiquement aux pratiques sous l'angle de leur dynamique quotidienne en ce qui a trait aux services, aux activités des groupes, aux connaissances des praticiens dans l'intervention directe. C'est donc ce sur quoi nous avons choisi de nous pencher dans le cadre de cette recherche.
Comme la « redéfinition » des rapports sociaux entre les différents acteurs concernés par ce champ du social prend corps à l'intérieur d'un processus de régionalisation, cette recherche se centre sur la dynamique propre au territoire de la Régie régionale de Montréal-centre. Elle porte plus particulièrement sur les pratiques d'intervention sociale de deux secteurs du milieu communautaire montréalais, les secteurs jeunesse et familles3, et plus spécifiquement elle s'intéresse au point de vue d'intervenants expérimentés issus de ces secteurs.
Deux grands objectifs ont balisé l'ensemble de cette démarche qui n'avait aucune prétention evaluative. Avec notre premier objectif, nous voulions cerner, sur la base de l'expérience acquise par les intervenants, ce qui caractérise actuellement les pratiques des secteurs communautaires s'adressant aux jeunes et aux familles, tant à ce qui a trait aux activités et aux services offerts qu'à l'expertise et aux savoirs développés au fil des ans. Le deuxième objectif visait à saisir la façon dont les intervenants communautaires de ces deux secteurs d'étude se sentent interpellés par l'actuelle régionalisation et ses récentes retombées telles que les priorités régionales, les formes diverses de représentation, l'approche intersectorielle, la régionalisation des services et la réallocation des budgets.
Nous cherchions donc avec ces deux objectifs à nous donner une meilleure compréhension de la dynamique actuelle dans le champ de la santé et des services sociaux, du point de vue de certains acteurs privilégiés issus du monde communautaire. Il est à noter que nous étions intéressés à connaître le point de vue des intervenants et non le point de vue officiel des groupes dans lesquels ils travaillent. Nous voulions saisir le regard et l'analyse de femmes et d'hommes impliqués depuis plusieurs années dans le mouvement communautaire. Pour atteindre ces objectifs, le choix méthodologique de cette recherche exploratoire s'est arrêté sur une stratégie de " recherche coopérative " (Co-Operative Inquiry, Reason, 1994 a et b), c'est-à-dire un type de recherche qualitative qui relève du courant des enquêtes participatives et qui valorise une participation plus directe des sujets dans l'ensemble de la démarche de recherche.
Ce courant a d'importantes assises dans les pays anglo-saxons où il existe sous diverses formes depuis maintenant plus d'un quart de siècle (Reason, 1988; 1994 a et b; Park et al., 1993; Finn, 1994). Ce courant rejoint d'autres courants de recherche de nature qualitative qui, depuis quinze ans au moins, questionnent les paradigmes et les approches méthodologiques dominant les sciences sociales (Guba et Lincoln, 1985 et 1989; Patton, 1990: Strauss et Corbin, 1991). Par le passé, une stratégie de recherche coopérative a souvent été utilisée avec des praticiens des services publics afin d'explorer avec eux leurs pratiques à l'intérieur d'une démarche qui se fait presque toujours en groupe et qui s'étend généralement sur quelques mois {Reason, 1994 a). Ces conditions se trouvent réunies dans la présente recherche.
Au cours des dernières années, les intervenants communautaires ont développé une expertise et des savoirs dans divers champs d'intervention sociale. Ils sont donc eux-mêmes porteurs et producteurs de connaissances par rapport à notre objet de recherche. Il arrive souvent que le contexte propre à l'intervention limite sérieusement les possibilités pour ces intervenants de pouvoir, seuls ou avec d'autres, faire le point sur leurs pratiques. Dans l'optique de cette méthode, les Intervenants communautaires deviennent donc les cochercheurs. Sous forme de rencontres de groupe, ici nous avons formé deux groupes en respectant la dynamique inhérente à chaque secteur, les intervenants s'engagent à faire la synthèse et l'analyse de leur expérience avec les chercheurs qui initient la recherche. Ces derniers se positionnent comme étant ceux qui facilitent l'organisation de la recherche, qui en construisent le cadre général de travail. Pour les fins de ce texte, ce sont les chercheurs proposeurs tandis que les intervenants sont identifiés comme des cochercheurs.
Au point de départ, afin d'amorcer le travail avec les deux groupes de chercheurs, nous avions des propositions de recherche. Ces propositions de recherche qui permettent d'amorcer la démarche de groupe. Elles font état des « connaissances initiales » (« primarily propositional knowing »). C'est ce qui enclenche une démarche qui permet d'évoluer de ces propositions initiales, formulées ici par les chercheurs proposeurs, vers de nouvelles connaissances, de nouvelles propositions, qui émergent de la démarche (« new propositional knowing ») (Reason, 1994 a : 42-43; 1994 b : 326327). Les propositions de départ sont donc temporaires. Avec les rencontres, elles se complexfient et se transforment, tout en donnant naissance à d'autres propositions. C'est ce que nous verrons au chapitre 3. Les propositions initiales s'articulent ainsi:
- la pratique quotidienne des intervenants des secteurs à l'étude est de plus en plus définie par des contraintes extérieures, liées aux demandes étatiques dans un difficile contexte budgétaire;
- la reconnaissance du communautaire par l'Etat et son intégration dans la nouvelle dynamique de partenariat amènent les intervenants des secteurs jeunesse et familles à modifier d'eux-mêmes diverses dimensions de leurs pratiques (clientèles, services, modes d'intervention);
- les savoirs des intervenants des secteurs à l'étude sont de plus en plus teintés des savoirs propres au réseau institutionnel.
Nous avons formé nos groupes de recherche en sollicitant un bon nombre d'organismes ou d'intervenants de la région (une cinquantaine au total). Nous voulions au maximum dix personnes par groupe, des intervenants qui avaient au moins cinq années d'expérience dans leur secteur de travail actuel. Ces attributs nous apparaissaient essentiels pour faciliter la démarche. Finalement, sept personnes ont poursuivi la démarche dans chaque groupe. Les intervenants du groupe jeunes travaillent dans ce secteur depuis onze ans en moyenne. Ce groupe réunit deux femmes et cinq hommes dont l'âge varie entre 28 et 48 ans. Une forte majorité de ces intervenants occupe un poste de coordination. Ils peuvent être considérés comme des permanents. Ils proviennent de divers types d'intervention (travail de rue, hébergement, centre pour jeunes, etc.).
Les cochercheurs du groupe familles travaillent dans leur secteur depuis dix ans en moyenne. Le groupe est composé de cinq femmes et de deux hommes dont la moyenne d'âge se situe entre 38 et 49 ans. Ici aussi, une majorité occupe un poste de coordination bien que ces intervenants soient appelés à plus de polyvalence, à plus de travail direct auprès des personnes desservies, et que leur « permanence » soit plus relative, plus fragile que celle des intervenants auprès des Jeunes. Ils proviennent de diverses formes d'intervention (petite enfance, multi-services, pour femmes seulement, etc.).
Dans l'ensemble, les intervenants des deux groupes ont plusieurs années d'expérience de travail dans le réseau communautaire (entre 7 et 25 ans) et le tiers d'entre eux ont déjà travaillé dans le réseau institutionnel pour une durée moyenne d'un an. Quelques-uns sont plus fortement impliqués dans les débats régionaux sans que personne ne siège par exemple au CA de la Régie. Dans ce cadre, ils peuvent siéger à un comité de travail ou un comité aviseur, avec d'autres partenaires tels des gens de la Santé publique. Ils peuvent aussi s'impliquer plus directement dans les instances et comités du Regroupement intersectoriel des organismes communautaire de Montréal RIOCM.
Les deux démarches de groupe se sont déroulées sur cinq rencontres, généralement tenues avec trois semaines d'écart, le temps de permettre aux chercheurs proposeurs de rendre accessible, par un premier traitement, le matériau issu de la rencontre précédente. La dernière rencontre s'est faite suite à un plus long délai, afin de faciliter le travail de condensation de l'ensemble des données ainsi que la production de tableaux synthèse (Huberman et Miles, 1991). La démarche de recherche s'est étendue de mars 1996 à septembre de la même année, donc sur une période de six mois. Chaque rencontre a donné lieu à un travail de préparation et d'animation de la part des chercheurs proposeurs afin de faciliter l'accès aux données de la rencontre précédente et l'exploration de nouvelles dimensions par les cochercheurs.
La présentation de ce rapport se divise en trois chapitres. Le chapitre 1 permettra au lecteur de se familiariser d'abord avec la régionalisation dans le champ de la santé et des services sociaux; par la suite, nous nous intéresserons à la dynamique d'ensemble qui s'est développée entre le mouvement communautaire montréalais et la Régie régionale de Montréal-centre. Ce chapitre présentera succinctement les secteurs à l'étude. Il est produit par les chercheurs proposeurs. Dans la chapitre 2, nous présenterons, regroupés en six sections, les principaux résultats issus de cette démarche de recherche. C'est le coeur de ce rapport et la partie la plus collée aux contenus des rencontres. Validé par les cochercheurs, il doit donc être lu comme étant très proche de ce qui ressort de la démarche et dans l'esprit même de la démarche. En tant que chercheurs proposeurs, nous nous devions de rester collés au discours, aux perceptions et à l'analyse qui se dégagent des diverses rencontres. Notre statut ne nous permettait pas de remodeler ce chapitre à notre guise. Enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous reprendrons, en les bonifiant, les propositions de recherche initiales et nous présenterons une nouvelle proposition, issue de la démarche et validée par les deux groupes. C'est donc un chapitre plus analytique qui permet de débattre les propositions initiales, avec les cochercheurs, sur la base du contenu qui émerge du chapitre 2.
1. Nouvelle loi, nouveaux acteurs!
Dans les pages qui vont suivre, nous présenterons d'abord succinctement les principaux éléments touchant à la réforme de la santé et des services sociaux. Par la suite, nous nous intéresserons plus précisément aux réactions, prises de positions diverses, modalités organisationnelles issues du monde communautaire québécois mais surtout montréalais face à cette réforme. Enfin, nous présenterons ce qui caractérise principalement les deux secteurs participant à l'étude. Nous tenons à souligner que ce premier chapitre est le fruit du travail des chercheurs proposeurs. Il doit donc être pris pour ce qu'il est, une mise en contexte permettant de bien situer la nature des propos des chapitres subséquents.
La réorganisation des services de santé et des services sociaux s'amorce officiellement en septembre 1991, suite à la sanction du projet de Loi 120, qui propose une révision complète de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que certaines modifications concernant la Loi sur l'assurancemaladie et la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie. Cette loi, qui est devenue la Loi sur les services de santé et les services sociaux, fait suite entre autres aux travaux de la Commission Rochon, mise sur pied au milieu des années 80, pour étudier notre système de santé et de services sociaux vingt-cinq ans après sa constitution. Cette commission, soulignons-le, suscita une forte mobilisation du mouvement communautaire québécois, comme en témoigne le fait que près de la moitié des 800 mémoires (300) qui y furent déposés provenaient du milieu communautaire (Lamoureux, 1994 : 71).
Cette révision touche particulièrement les objectifs fondamentaux du régime de services de santé et des services sociaux et tout particulièrement les droits des usagers à ces services. Le principal objectif de la nouvelle loi vise à réorganiser le système de santé et des services sociaux afin de favoriser le déplacement des structures administratives dans un cadre plus décentralisé, ce qui doit à la fois faciliter une plus grande démocratisation et un plus grand partenariat dans l'administration des services de santé et des services sociaux, tout en jugulant l'accroissement des dépenses dans ces domaines. Dans un tel cadre, les organismes communautaires étaient pour la première fols interpellés « formellement » par l'État en raison des services historiquement dispensés.
Sans aller aussi loin que le préconisait la Commission Rochon, qui entre autres favorisait des régies élues au suffrage universel et dotées d'un pouvoir de taxation, la Loi 120 met en place de nouvelles structures régionales, beaucoup plus développées qu'antérieurement, qu'elle nomme « Régies régionales ». Au nombre de dix-sept, dont une cri et une inuit, elles ont le mandat de voir à la planification et à l'organisation des services de santé et des services sociaux sur leur territoire. Les régies régionales sont aujourd'hui les interlocuteurs des établissements de leur territoire, un changement Important pour ces derniers, habitués qu'ils étaient à transiger directement avec Québec. Par contre, Québec se réserve le contrôle du cadre budgétaire, compte tenu que les régies régionales ne disposent d'aucun pouvoir de taxation. Dès le départ, cette limite fait dire à certains acteurs qu'il ne s'agit point d'un réel processus de régionalisation mais plutôt d'une simple déconcentration des services, accompagnée des pouvoirs de gestion immédiats qui leurs sont rattachés.
Cette impression de fausse régionalisation est d'une certaine manière renforcée par la Politique de Santé et de bien-être issue de la réforme. La Politique identifie dix-neuf priorités, accompagnées d'objectifs précis avec des résultats à atteindre plus six stratégies d'action. Perçue par certains comme un atout afin de maintenir une certaine cohésion à l'échelle de la province, cette Politique est aussi dénoncée par d'autres comme une preuve supplémentaire de l'absence réelle de régionalisation. Car dans les faits, si les régies ont le pouvoir et la responsabilité de déterminer leurs priorités régionales, elles doivent le faire dans le cadre des objectifs de la politique santé bien-être.
La Loi 120 ainsi que la politique santé bien-être désignent les groupes communautaires comme des dispensateurs de services et à ce titre les groupes sont soumis à de nouvelles règles, telles celle d'être évalués par les régies régionales. Mais plus encore, la nouvelle Loi considère les groupes comme des partenaires à part entière. Dans les faits, les divers acteurs institutionnels doivent maintenant composer avec le communautaire, au même titre qu'avec leurs autres partenaires. Ce nouveau statut se concrétise par une place formelle pour le secteur communautaire aux diverses instances appelées à prendre des décisions : les CA des régies avec, à Montréal, un poste désigné au comité administratif; dans l'organisation et dans la planification des services; dans divers comités de travail tels les comités sur les priorités régionales, les comités aviseurs sur les réallocations et ceux formés sur le virage ambulatoire.
Un tel appel à la concertation des différents acteurs s'appuie sur un modèle partenarial présent dans notre société depuis quelques années (White, Mercier, Dorvil et Juteau, 1992; Gagné et Dorvil, 1994; Lamoureux, 1994). Un tel modèle se développe Ici en terreau fertile car il semble rejoindre les multiples revendications de groupes de citoyens désireux d'être partie prenante des décisions prises par l'État dans le champ de la santé et des services sociaux. La reconnaissance dans la loi actuelle de la santé et des services sociaux des organismes communautaires cornme partenaires peut donc apparaître à première vue comme socialement progressiste. Elle sous-tend une reconnaissance politique et l'apport de ressources, dans une conjoncture socioéconomique extrêmement perturbée.
Les réactions du monde communautaire
Cette réforme, en reconnaissant explicitement les organismes communautaires comme partie intégrante du développement actuel et futur des services de santé et des services sociaux, se trouve à modifier la dynamique des rapports sociaux telle qu'elle s'est constituée historiquement entre l'État et les organismes communautaires, tout particulièrement ici ceux qui s'inscrivent en partie ou en totalité dans le champ de la santé et des services sociaux. Suite à une longue bataille pour une plus grande reconnaissance, une portion importante du mouvement communautaire est alors promue au rang de partenaire du réseau institutionnel dans le champ de la santé et des services sociaux. De chien de garde historique, et parfois d'adversaire de l'État à une époque où les rapports sociaux étaient plus conflictuels (Lamoureux, 1994), de nombreux organismes accèdent alors à une ère nouvelle, qualifiée de « partenariale ».
En fait, cette forme nouvelle de rapport entre l'État et le monde communautaire, sans nécessairement constituer une rupture avec les décennies antérieures, nous semble représenter un certain virage par rapport à celles-ci. La décennie qui précède, celle des années quatrevingt, une période où l'on voit éclore en très grand nombre des groupes de services dans le champ de la santé et des services sociaux (femmes, jeunes, santé mentale, etc), bien que distincte de la période très militante des années soixante-dix, nous semble encore porteuse d'une perspective revendicatrice, et traversée par une lecture conflictuelle des rapports à l'État.
Durant les années quatre-vingt, s'affirme alors dans le monde communautaire l'existence d'une culture propre, et ce même dans les pratiques de services. Certains parlent d'approche globale pour qualifier ce qui distingue le mouvement communautaire du réseau public, dans ses services à la population. Ainsi, l'approche globale réfère d'abord à l'approche utilisée lorsque l'on travaille à soutenir un individu face à ses besoins multiples. À ce niveau, «les organismes communautaires cherchent à éviter la fragmentation et la spécialisation des interventions et développent à cette fin diverses formes de polyvalence » (Comité ministériel, 1995 :15).
Mais l'approche globale nous semble cependant dépasser la perspective du cas à cas. La culture du communautaire, au plan des pratiques avec la population, reste marquée par une propension à élargir et à collectiviser les problèmes, « donc à Intervenir directement sur les conditions de vie socioéconomique » (p. 15). Dans cette perspective, « le service n'est pas une fin en soi. Il est une réponse à un besoin précis mais il est également étroitement imbriqué au travail d'information participation responsabilisation mobilisation » (p. 16). En ce sens, mêmes les secteurs qui se développent autour des besoins de populations spécifiques (ex. : femmes, Jeunes) portent toujours une perspective, sinon d'action collective (Fournier et Gagnon, 1991), à tout le moins une vision globale des enjeux sociaux (René, 1991).
Perdure donc au sein d'une partie non négligeable du mouvement communautaire québécois, au moment où s'enclenche le processus de régionalisation, une volonté de continuer à marquer ses pratiques au sceau d'attributs qui dépassent le service bien fait et qui renvoient aux fondements de l'action sociale, soit la promotion de valeurs de solidarité, d'autonomie, de démocratie et de justice sociale (Lamoureux, Lavoie, Mayer et Panet-Raymond, 1996 : p.85 et ss,). Des attributs qui qualifient aussi les rapports Internes aux groupes, leur « culture organisationnelle », idéalement tendue vers un équilibre participatif et démocratique, où prédominent des idéaux de vie et des valeurs d'entraide qui ne sont pas sans marquer le type de gestion privilégiée (Guberman et al., 1994).
Au moment de l'annonce de la reconnaissance du communautaire qui laisse entrevoir un nouveau type de rapport entre l'État et le communautaire, celui de partenaire, une partie importante du monde communautaire est sur le qui-vive. Tout au long des consultations qui ont précédé l'adoption de la Loi 120, de nombreux groupes de Montréal sont de prime abord très critiques, pour ne pas dire carrément opposés au processus de régionalisation. En ce qui a trait aux secteurs à l'étude, c'est particulièrement le cas des groupes jeunesse, plus directement mobilisés, parce que mieux organisés que les groupes familles. Contrairement à plusieurs régions du Québec, où les groupes revendiquent depuis longtemps une décentralisation vers les régions, ceux de Montréal, forts de contacts directs avec Québec, ne voient pas nécessairement d'un bon oeil une telle reconfiguration. Ils craignent, dans ces circonstances, de perdre certains acquis historiques. Une majorité de groupes sont très sceptiques face à la participation du communautaire aux structures décisionnelles. Ils anticipent qu'en participant les groupes vont perdre leur marge de manoeuvre et leur indépendance. En étant dorénavant inclus dans le système, ils croient qu'ils ne pourront plus être « critiques face au système », du moins tel qu'auparavant.
Nonobstant les multiples revendications et dénonciations diverses, la Loi 120 est finalement adoptée en septembre 1991. Les groupes font face à une nouvelle réalité. Dans ce contexte, ils vont participer aux instances mais ils se promettent de ne pas perdre leur esprit critique. S'amorce l'ère de ce que J. Lamoureux qualifie de « coopération conflictuelle et de participation contradictoire » pour désigner la façon dont les rapports se vivront à l'intérieur de ce grand partenariat (1994 : 185).
Les groupes communautaires de Montréal avaient déjà leurs structures de regroupement et de concertation propres, que l'on pense à la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP), aux instances régionales de certains groupes nationaux (maisons de Jeunes, centres de femmes) ainsi qu'à des regroupements sectoriels comme le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR en santé mentale), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM). Malgré ces nombreux regroupements, aucun n'était bien sûr suffisamment rassembleur pour parler au nom de tous les groupes de Montréal. L'implantation des régies régionales a exigé des groupes communautaires montréalais de repenser leur mode d'organisation et de représentation.
Dans ce contexte, il fallut rapidement faire face au processus électoral et répondre à l'urgence de se concerter afin de désigner les élus du communautaire au collège électoral et au conseil d'administration de la Régie4. Pour l'ensemble du Québec la Table des regroupements provinciaux, qui comptait alors treize regroupements (et plus tard le double), a entrepris une tournée de sensibilisation sur les enjeux de la réforme, organisant une première rencontre avec les groupes de Montréal. Par la suite, la TROVEP de Montréal, en collaboration avec d'autres regroupements sectoriels prit l'initiative, au printemps 1992, de mettre sur pied une coalition qui se voulait alors temporaire.
Cette coalition visait trois objectifs : s'assurer de la plus grande participation possible des groupes au processus électoral: trouver les personnes les plus aptes à représenter les groupes aux instances de la Régie; faire en sorte que les élus se sentent imputables non seulement à leurs groupes d'origine mais à l'ensemble des groupes communautaires de Montréal. La coalition joua son rôle, vingt-neuf des trente personnes élues au premier collège électoral des groupes communautaires étant issues de la liste présentée par la coalition. Rapidement l'idée d'une coalition permanente fait son chemin. Elle fut mise sur pied en mars 92, et incorporée en avril 93 pour devenir le RIOCM, avec l'adoption des statuts et règlements en décembre 95. Aujourd'hui, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) comprend environ 200 membres.
Les membres actifs du RIOCM s'attellent ensuite à plusieurs dossiers : alimenter et suivre les travaux du conseil d'administration de la Régie; faire des représentations auprès de la Régie afin que le RIOCM soit reconnu comme l'interlocuteur représentant des groupes communautaires de Montréal; élaborer une base de revendications et d'adhésion commune. Ainsi, après plusieurs mois de travail et une vaste consultation, le RIOCM adopte, lors de l'assemblée générale tenue le 28 Janvier 1994, la plate-forme de revendications communes. Ce document sert d'une part de base d'unité et d'adhésion des groupes au RIOCM. Il définit certains principes qui guideront le RIOCM dans ses prises de positions publiques et ses revendications auprès de la Régie. À titre d'illustration, voici les principes concernant la reconnaissance des groupes : « importance de la présence d'organismes communautaires autonomes autour d'une réalité commune; mettre un terme à la reconnaissance "communautaire" d'organismes créés par des institutions; liberté des organismes communautaires de déterminer le cadre de leur action; voir reconnaître la spécificité des organismes communautaires; liberté des organismes d'établir les limites de leur bénévolat » (Plate-forme de revendications communes, page 7).
Concrètement, le RIOCM devient l'Interlocuteur à la Régie régionale de Montréal-centre en ce qui concerne les groupes communautaires. La Régie finance même cette nouvelle structure de concertation, et ce une année avant que le Ministère ne débloque des fonds à cette fin. Durant l'année 1994, un groupe de travail conjoint est mis sur pied afin d'élaborer une politique de relation entre les organismes communautaires et la Régie régionnale de Montréal-centre pour donner plus d'impact à la plateforme de revendications communes. La tâche de ce groupe de travail se continue encore au moment où nous écrivons ces lignes.
L'arrivée de ce nouveau regroupement ne se fait toutefois pas sans heurts. Malgré une volonté ferme de s'appuyer sur les regroupements existants tout en évitant de jouer dans les plates-bandes des divers secteurs, perdure une crainte manifeste chez un certain nombre de groupes et d'intervenants. Les groupes doivent entre autres chercher à définir ce qui relève dorénavant des secteurs et ce qui est de la responsabilité du RIOCM. Ce dernier doit aussi stimuler et susciter l'organisation des groupes par secteur, particulièrement en ce qui concerne les secteurs peu développés, comme c'est le cas pour les groupes familles. Enfin, l'existence même du RIOCM questionne et transforme les rapports avec les regroupements provinciaux existants. C'est un nouvel acteur dont on doit tenir compte, sur le territoire de la régie régionale la plus populeuse, que ce soit en termes d'habitants ou de groupes communautaires existants.
Les groupes familles
Nous sommes ici en face d'un secteur peu homogène. Ainsi nous retrouvons dans ce secteur des organismes ayant un champ d'intervention très large, s'adressant par exemple à l'ensemble des familles, tandis que d'autres ont développé une intervention plus pointue, telle la périnatalité. les 0-6 ans, les femmes divorcées. Leurs pratiques varieront donc en conséquence, allant de services de soutien en première ligne, à l'organisation d'activités diverses, que ce soit sous forme d'ateliers, de rencontres de groupes, ou de soirées d'information dans le milieu, la communauté.
Les groupes familles sont aussi d'origines diverses. Plusieurs organismes sont issus des besoins du milieu. Toutefois, bien que nés de la base depuis plusieurs années, ils sont néanmoins bousculés par les priorités multiples des différents paliers de gouvernements. C'est entre autres la situation vécue par certains organismes oeuvrant en périnatalité et en contexte de pauvreté. De ces priorités gouvernementales naîtront également d'autres organismes communautaires; dans ce contexte, ils seront plus ou moins issus des besoins identifiés dans et par le milieu ainsi que pris en charge par celui-ci (donc ne respectant pas les principes du RIOCM). Il existe donc une grande différence entre les divers groupes familles, tant en ce qui a trait au nombre d'années d'existence que par rapport à leurs origines et à leurs liens avec leur communauté d'appartenance.
Pour ce qui est du financement, soulignons l'absence de plan triennal avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour assurer le fonctionnement de base de ces organismes. Pour leur majorité, les groupes familles composent avec un financement morcelé et relativement aléatoire, qui passe généralement par un important financement par programme. Pensons par exemple au programme PACE (Programme d'aide communautaire à l'enfance), un programme fédéral mais qui est géré par Québec et dont le côté plus ou moins récurrent représente un danger pour la survie et le développement des groupes autonomes (réf. : chap. 2.3).
Historiquement, les groupes familles rejoints par le RIOCM sont individuellement moins regroupés comparativement à d'autres secteurs tels celui des femmes ou de la santé mentale. C'est souvent la dynamique locale qui a la priorité, bien que cela n'exclut nullement qu'il y ait eu antérieurement des échanges entre certains d'entre eux. En fait, certains groupes familles ont participé ces dernières années à des activités du RIOCM. Ils se sont aussi rencontrés dans le cadre des activités du programme PACE pour la petite enfance. Mais aucune organisation nationale ne semble correspondre aux attentes d'une majorité d'organismes familles qui s'identifient beaucoup plus à la mouvance du mouvement communautaire organisé qu'à celle du secteur familial identifié parfois par certains comme étant plus « traditionnel »5.
Toutefois, le secteur famille se transforme au moment où il est fortement interpellé par l'une des priorités régionales « les tout petits ». En effet, suite à l'identification de cette priorité régionale, les groupes qui travaillent en partie ou en totalité avec les jeunes enfants et leurs parents (priorité no 1) ont été propulsés malgré eux à l'avant-scène. Ce facteur externe les pousse à accélérer le processus d'organisation et d'Identification afin de mieux faire front commun face aux demandes de la Régie régionale, liées entre autres à un nouvel apport budgétaire. Ainsi, durant la première moitié de 96, un sondage a été fait auprès d'une cinquantaine d'organismes familles pour vérifier leur intérêt à se regrouper. Près d'une trentaine de groupes y ont répondu. Les résultats de ce sondage confirment la nécessité de se regrouper et de se donner des assises communes. Dans ce contexte, les rapports avec le RIOCM iront aussi en s'intensifiant, le regroupement jouant un rôle de facilitateur, en faisant entre autres circuler l'information dans le secteur.
Les groupes jeunesse
Les organismes Jeunesse existent depuis plusieurs années. Le plus vieil organisme du groupe jeunes, le Carrefour communautaire de Rosemont l'Entre-Gens, a été fondé en 1949. Les derniers-nés, tels les organismes de travail de rue, ont fait leur apparition dans les dix dernières années. Malgré des histoires différentes, les groupes Jeunesse sont considérés comme étant très critiques face aux services publics et à l'État. Si les groupes les plus anciens, entre autres le Carrefour communautaire de Rosemont l'EntreGens et le Bureau de consultation jeunesse, sont nés pour répondre à des besoins d'information et d'intervention non comblés à leur époque (ex. : sexualité, drogue), avec les années, à l'image des courants idéologiques dominants, ils se sont radicalises. En ce qui concerne les groupes les plus récents, tels les organismes de travail de rue, ils se sont mis sur pied pour répondre à des demandes pressantes mais non comblées par le réseau public. Pensons aux Jeunes de la rue, et à leurs besoins multiples d'écoute, de soutien et d'accompagnement.
Les regroupements d'organismes Jeunesse se sont créés à la fin des années 70, début des années 80 (le Regroupement des maisons de jeunes du Québec RMJQ; le Regroupement des maisons d'hébergement jeunesse du Québec RMHJQ; le Regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec ROCAJQ). Visant la reconnaissance des pratiques originales des groupes communautaires jeunesses, ces regroupements ont surtout oeuvré sur la scène provinciale. Cette recherche de reconnaissance passe d'abord par une quête d'identité et d'auto-définition. Les groupes Jeunesse sont dans les premiers à s'être dotés de structures organisationnelles plus formelles, entre autres par le biais de cadres de référence et de codes d'éthique, en fonction de leur champ de pratiques. Si les groupes familles sont aujourd'hui dans une phase d'affirmation d'identité et de définition de leur spécificité, les groupes jeunesse pour leur part semblent viser la stabilité.
Forts d'un financement généralement plus régulier que les groupes familles, les groupes Jeunesse étaient parmi les plus virulents opposants à la réforme. Suite à l'adoption de la loi, les positions se sont diversifiées. D'un côté, le RMJQ et le RMHJQ avaient joint dès sa fondation la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Ils ont continué à être activement présents dans cette structure. De l'autre, le ROCAJQ, qui pour sa part avait hésité longtemps considérant cette adhésion comme une abdication face à la lutte contre la réforme, a depuis rejoint la Table des regroupements provinciaux. Ses groupes de base participent aux activités du RIOCM. Ce chapitre de présentation terminé, nous vous invitons à plonger au coeur de notre recherche, le chapitre 2, qui présente dans les détails le point de vue des intervenants sur leurs pratiques en contexte de régionalisation.
2. L'état des pratiques communautaires : les perceptions dominantes des cochercheurs
Le chapitre qui précède nous a permis de bien saisir le contexte dans lequel se déroule la régionalisation à Montréal. Nos cochercheurs vivant quotidiennement dans ce contexte. Ils sont donc confrontés à plusieurs des aléas qui traversent présentement le processus de régionalisation. Dans les pages qui vont suivre, nous leur laisserons la parole. Ils nous parleront de leurs pratiques telles que vécues dans ce contexte et dans la conjoncture socio-économique qui l'accompagne.
Rappelons que cette recherche n'a aucune prétention évaluative. Elle se veut l'exploration d'une réalité en mutation à partir des perceptions partagées collectivement par deux groupes d'acteurs concernés par des transformations qui touchent leurs pratiques quotidiennes. En ce sens, les traits qui ressortent dans ces pages ne sont pas uniquement liés aux effets d'une régionalisation encore trop récente pour en faire une évaluation plus formelle par le biais d'une méthodologie mieux adaptée à de telles fins. Ce que nous y retrouvons, ce sont les perceptions générées par l'expérience de femmes et d'hommes qui interviennent dans le cadre de la régionalisation en santé et services sociaux, et dans la conjoncture qui lui sert de toile de fond. Aussi, il ne faut pas se surprendre que leurs propos naviguent en de multiples eaux, au gré de l'appropriation collective qu'a permis notre démarche coopérative de recherche.
Le contenu de ce chapitre, qui représente le coeur du matériau de recherche, nous l'avons collectivement ramassé tout au long de deux démarches de cinq rencontres par groupe de cochercheurs. Nous voulons essentiellement rendre compte des éléments dominants qui se dégagent de ces deux démarches. Nous avons choisi d'en faire une présentation commune parce qu'il ressort que les propos tenus dans les deux groupes se rejoignent à bien des égards, malgré quelques différences que nous soulignerons au passage. N'oublions pas qu'il s'agit de deux démarches que nous avons volontairement faites en parallèle, afin Justement de pouvoir procéder à leur comparaison.
Qu'il soit également souligné que ce chapitre présente un cumul du matériau recueilli durant les cinq rencontres pour chacun des deux groupes à l'étude. Les traits dominants ne sont donc pas présentés selon leur ordre d'émergence, qui peut de toute façon varier d'un groupe à l'autre. Il fallait dans la rédaction du rapport prendre en compte tant la récurrence des idées au long de la démarche que l'ordre d'émergence au fil des rencontres.
Quelques constats généraux
Lorsque les cochercheurs sont appelés à partager leurs points de vue sur l'état actuel de leurs pratiques, deux idées maîtresses fortement associées ressortent et englobent l'ensemble de leur discours : complexité organisationnelle et encadrement technobureaucratique. L'organisation des régies régionales, et plus particulièrement celle de Montréal, renforce et complexifie l'encadrement techno-bureaucratique des organismes communautaires oeuvrant dans le domaine des services de santé et des services sociaux. Ainsi, pour réaliser son mandat, la Régie régionale de Montréal met en place de nouvelles structures de gestion et de représentation qui s'ajoutent souvent à celles déjà existantes. Bien que chacune de ces structures joue un rôle particulier, plusieurs d'entre elles doivent permettre d'établir les passerelles nécessaires pour regrouper tous les acteurs interpellés, c'està-dire la population, les établissements institutionnels ainsi que les organismes communautaires.
Selon les cochercheurs, l'ajout de nouvelles sphères de gestion, d'administration et de représentation, toutes à caractère fortement techno-bureaucratique, tend non seulement à alourdir la dynamique régionale mais aussi à la complexifier. Par exemple, les nombreuses divisions et sous-divisions administratives internes, jumelées aux nombreux déplacements de personnel, rendent plus difficiles encore les relations
entre les organismes communautaires et la Régie régionale. Aussi, les cochercheurs mentionnent qu'il est difficile de savoir à qui s'adresser à cause de la mobilité et des nombreux changements dans l'organisation du travail à l'intérieur du réseau institutionnel.
En fait tout au long de la recherche, les cochercheurs ont démontré que cette complexité organisationnelle et cette forme d'encadrement technocratique génèrent une lecture pratiquement « monstrueuse » de la présente réalité des secteurs communautaires jeunes et familles6. Ce portrait synthèse tel que décrit par les cochercheurs se révèle, et ce pour les participants eux-mêmes, particulièrement difficile à cerner, à saisir, conséquence de la démesure des informations qu'il contient. Bonifié au fil des rencontres, ce portrait doit être traduit maintenant en langage simplifié pour définir un peu plus clairement l'étendue des perceptions de nos cochercheurs sur la régionalisation et son contexte.
Pour ce faire, nous avons fait ressortir six traits dominants du discours des cochercheurs, répartis
en six sections distinctes :
- une expérience partenariale difficile;
- des relations nouvelles entre les groupes communautaires;
- un financement toujours laborieux;
- des services de plus en plus sollicités;
- des transformations dans la gestion des tâches;
- une définition des pratiques d'intervention communautaire.
Au fil du texte, nous avons souligné, autant que possible, les liens existant entre les divers traits. Il est aussi important de mentionner que ce portrait reflète une certaine réalité, celle vue et comprise par les cochercheurs à une période précise, soit les printemps et automne 1996. Rappelons, comme l'ont souligné certains cochercheurs, que « par rapport à beaucoup de choses, comme l'approche de partenariat, il y a de la mouvance et une incidence terrible sur nos pratiques » (Groupe familles, R.-5, p.9). Déjà au moment où vous lirez ces lignes, ce portrait se sera donc un tant soit peu transformé.
2.1 Une expérience partenariale difficile
«Il y a là une question de respect de l'identité des deux institutions, qu'elles soient communautaire ou publique. »
(Gr. jeunes, R2, p. 20 )
Rappelons d'abord que les cochercheurs sont soit des coordonnateurs de groupe, soit des intervenants qui travaillent quotidiennement avec la population rejointe par leur organisme. Les perceptions majoritaires qui se dégagent des groupes de recherche peuvent être regroupées en deux grands blocs : le rapport aux institutions régionales, que ce soit la Régie régionale ou la Santé publique; la dynamique plus au ras du sol, entre intervenants communautaires et institutionnels. Enfin, nous soulignerons en terminant, quelques différences au plan local.
Dans un premier temps, les cochercheurs insistent sur la place qu'occupent dans leur agenda les formes multiples de représentation régionale. Ils sont régulièrement sollicités pour participer à de multiples activités de représentation, réunions, comités divers. Dans ce cadre, les deux groupes de cochercheurs s'entendent pour dénoncer les difficultés et les incohérences rencontrées en pratique avec les principaux acteurs institutionnels et les difficiles négociations qui se dégagent de l'expérience partenariale prise dans une perspective régionale. En toile de
fond, comme élément explicatif, ressort le décalage culturel évident entre les institutions concernées et le monde communautaire. Ce décalage reflète les assises particulières des milieux concernés, l'un recevant son mandat de l'État et l'autre plus directement de ses membres. Ce décalage entraîne souvent des prises de position divergentes dans les dossiers abordés par les partenaires.
Un premier degré de frustration est exprimé : les cochercheurs ont le sentiment de piétiner, de devoir recommencer, d'être continuellement en train d'expliquer la mission de leur organisme. D'une certaine manière, Ils se sentent piégés dans cet engrenage inévitable de la représentation et de la concertation « obligées », jouant le Jeu des institutions, avec ce que cela exige en termes de surplus de temps et d'énergie, d'ajouts à leurs tâches régulières déjà fortement chargées. En fait, certains cochercheurs diront qu'ils ont le sentiment de faire un travail autre que celui pour lequel ils ont été engagés. Ils ont parfois l'impression de devoir faire des représentations avant tout pour aller chercher l'argent nécessaire, mais généralement non suffisant, pour le bon fonctionnement de leur organisme. En quelque sorte, de «faire la pute», même s'ils sont « tannés, écœurés » !
Mais la frustration des cochercheurs s'accentue lorsqu'ils constatent que le milieu institutionnel reconnaît fort peu le milieu communautaire et son expertise : « si tu ne fonctionnes pas comme le réseau, on n'a pas de respect pour toi (...) Aussitôt que tu sors de leur façon de faire, ils sont en résistance. » (Gr. jeunes, R-2, p. 18). Les cochercheurs se plaignent de ce que concrètement, il n'y a guère de partage réel de pouvoir. Conséquemment, dans les deux secteurs d'étude, certains cochercheurs partagent une double impression : d'un côté Ils ont le sentiment d'être exclus des décisions importantes, lesquelles sont souvent prises avant la concertation avec les organismes communautaires. Ils ont donc alors l'impression de se retrouver devant le fait accompli : « la réalité, actuellement, c'est qu'il y a une tentative de contourner les organismes communautaires par des alliances inter-instttutionnelles » (Gr. familles, R-5, p.9). D'autre part, lorsqu'ils sont consultés, se dégage de leurs propos le sentiment que les solutions préconisées reflètent rarement la dite consultation : « on est dans le décor. Ils nous consultent C'est une pièce de théâtre. Il y a consultation, mais ils te reviennent avec la solution issue des consultations... et elle ne concorde pas avec ce qu'on leur avait dit en consultation "Cela n'a pas de bon sens" » (Gr. jeunes, R-4, p.43).
Dans l'ensemble, mais soulignons que cela n'a pas fait l'unanimité chez les cochercheurs. il semble que les récriminations face à l'état du partenariat avec les principales instances régionales soient d'abord dirigées vers les institutions, et non vers ceux et celles qui y travaillent. Généralement, en ce qui a trait aux personnes travaillant dans ces établissements, mises à part certaines exceptions, les cochercheurs soulignent que ce n'est pas « vraiment leur faute », qu'ils ont des mandats à respecter, bien que l'attitude de certains peut parfois être « méprisante même si le terme est trop fort ».
Malgré ces limites, les cochercheurs notent, ce sera notre deuxième point, que ce nouveau partenariat rapporte parfois des dividendes. Elles sont plus manifestes horizontalement, tout particulièrement dans l'intensification et l'amélioration des rapports entre certains intervenants du réseau public et certains groupes communautaires. C'est du moins sous cet aspect que les perceptions les plus positives ressortent des démarches de recherche. Certains cochercheurs parlent « d'atomes crochus» qui peuvent se développer entre des intervenants des deux milieux.
essentiellement lorsque des intervenants du réseau public ont développé des affinités avec l'approche communautaire. De telles alliances se révèlent parfois très utiles. C'est entre autres le cas à l'occasion de références au réseau public de personnes venant chercher de l'aide dans les organismes communautaires. S'il y a « alliance », c'est donc d'abord entre intervenants que ça se passe, en fonction des besoins de leur clientèle. On dit référer à un intervenant du réseau en qui l'on a confiance, plutôt qu'à l'institution comme telle : « ce n'est pas au CLSC que tu envoies le jeune, c'est à l'intervenant, à la psychologue » (Gr. Jeunes, R-2, p.9).
Soulignons toutefois que les contacts pour créer des alliances sont souvent à recommencer à cause de la mobilité et de l'instabilité des postes de travail dans le réseau public. C'est donc parfois beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Des cochercheurs soulignent également que des alliances avec les intervenants du réseau institutionnel peuvent aussi s'avérer très longues à créer, reflétant une forte résistance de part et d'autre. Enfin, compte tenu de l'ampleur du territoire de la Régie régionale de Montréalcentre, on souligne la grande disparité à l'intérieur même des sous-régions desservies, et des établissements qui la composent. Ce qui amène d'autres cochercheurs à dire que la réalité vécue dans l'une ou l'autre des sousrégions de Montréal ne peut être généralisée à l'ensemble de la région montréalaise : « cela reflè te que même si l'on est sur l'île de Montréal, il y a une énorme disparité entre les sous-régions. D'ailleurs. « on ne souhaite pas que cela se répande ailleurs ! » (Gr. familles, R-5. p. 11)
Globalement, l'approche partenariale alourdit donc le travail quotidien des intervenants communautaires. Elle camoufle et maintient des rapports de pouvoir inégaux sous le couvert de ce qui parfois apparaît comme une pseudo-concertation, en niant les différences culturelles, politiques, économiques et sociales des milieux institutionnels et communautaires. Malgré tout plusieurs cochercheurs admettent que l'approche partenariale peut aussi apporter certains gains pour les organismes communautaires concernés, que ce soit sous forme de financement, de collaboration, d'amélioration des services et de travail dans le quartier. Elle favorise également un échange et une possibilité de communication entre les différents acteurs oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ainsi, pour les cochercheurs du groupe jeunes, « la Régie ré gionale de Montréal commence à reconnaître le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) comme une instance incontournable, quand on parle de collaboration avec le communautaire » (Gr. jeunes, R-2, p. 14).
2.2 Les relations nouvelles entre groupes communautaires
« La régionalisation amène l'enjeu de se regrouper pour faire valoir nos points de vue, les raisons d'être des organismes communautaires. »
(Gr. jeunes R-1 p.2)
La régionalisation accentue et transforme l'approche partenariale et la concertation avec les établissements du réseau institutionnel. Parallèlement, elle génère aussi de nombreuses occasions de rencontre et de concertation entre les organismes communautaires. Dans cette partie, nous présentons les propos des cochercheurs concernant les rapports entretenus au niveau intersectoriel et sectoriel, en lien avec le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal RIOCM, qui regroupe, au début de 1997, quinze secteurs d'intervention communautaire.
Les multiples facettes du partenariat avec le réseau public exigent donc du communautaire un investissement considérable en terme de temps et d'énergie. Or, la dynamique régionale intensifie aussi les rapports inter-groupes, que ce soit à l'intérieur des secteurs ou entre les secteurs. Il se crée donc un autre espace de rapports, qui engendre lui aussi ces lieux et ces temps d'échange, ce qui n'allège en rien l'agenda des intervenants concernés.
Pour ce qui est des rapports entre les différents secteurs du mouvement communautaire montréalais, les cochercheurs considèrent que le RIOCM joue un rôle prépondérant dans les rapports avec la Régie régionale de Montréal et ses principales constituantes. À titre d'exemple, les cochercheurs rappellent que dans le cadre de la réorganisation du réseau et des réallocations budgétaires, le rôle du RIOCM deviendra centred au niveau des comités aviseurs. La mise en place des comités de travail dont certains ont pour but de mieux saisir la portée de tous ces changements, tant au niveau du fonctionnement régional qu'au niveau du financement, est également soulignée comme un des aspects intéressants du travail du RIOCM. Pour les cochercheurs, ces nombreuses occasions de concertation favorisent les échanges inter-groupes et inter-secteurs. Elles facilitent le partage des connaissances et des expertises, alimentant ainsi davantage le savoir des groupes et des intervenants présents. C'est un apport pour le développement et la consolidation de l'identité communautaire.
Ces rencontres inter-groupes peuvent donc devenir des lieux et des moments essentiels pour la survie même d'un organisme, compte tenu des informations souvent cruciales qui y circulent. En quelque sorte, elles équipent les groupes face à la dynamique partenariale régionale et ses enjeux. En fait foi, comme le soulignent des cochercheurs, la création de la table regroupant les centres de quartiers (groupes multi), qui se sont vus obligés de se structurer et de se définir justement parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les catégories prédéterminées par la Régie régionale.
Pour ce qui est de l'organisation par secteur, l'exemple du secteur familles est intéressant. Au début de 1996, les groupes familles sont peu organisés au sein du RIOCM. De toute manière, il n'y a pas de réelle concertation de secteur : « d'après son nom, c'est le regroupement intersectoriel mais le secteur familles n'y est pas représenté. Le secteur familles existe mais les organismes y siègent à titre individuel. Il n'y a pas de regroupement familles » (Gr. familles, R-4, p.21). En fait, que ce soit au sein du RIOCM ou en-dehors, de nombreux groupes familles sont absents des regroupements existants.
Pour nos cochercheurs, les groupes familles sont pourtant en quête d'une identité commune, d'une ligne idéologique directrice qui leur permettraient de vraiment se regrouper sous un même chapeau. L'amorce d'une organisation régionale soulignée au chapitre 1 illustre ce phénomène. Les cochercheurs du groupe familles ont d'ailleurs beaucoup insisté sur le besoin de se bâtir un espace d'appartenance dans un contexte où ils doivent faire la preuve que leurs pratiques sont incontournables :
« chez les groupes familes, il y a tellement de lieux de concertation qu'on pourrait dire que, finalement, la concertation est inexistante 1 (...) Au niveau de la pratique, de la philosophie de l'intervention, il n'y a aucun regroupement qui nous regroupe. Quand on est en recherche d'identité et de systématisation de ce qu'on fait, on est pas mal tous un peu mêlé : ça va peut-être avec la situation de la famille... En tout cas, on n'a pas de point commun pour se regrouper encore ! »
(groupe familles, R-4, p. 11. 15 et 23).
Le regroupement des groupes familles s'avère donc assez difficile. L'isolement, le manque de cohésion, de définition d'une pratique commune ainsi que la diversification des problématiques liées à la famille, sont des éléments qui influencent fortement la faible identité collective des organismes de ce secteur. Cependant, et c'est là un des résultats positifs de la régionalisation, les groupes familles, se retrouvant au centre des priorités régionales, ont été « poussés » à s'organiser d'abord en secteur, tout en développant et intensifiant leurs liens avec le RIOCM.
À ces principaux constats concernant les rapports intersectoriels et sectoriels entre groupes communautaires sur le territoire de la Régie de Montréal-centre, un aspect supplémentaire mérite d'être souligné dans cette partie. Il touche aux rapports entre les groupes locaux et leur regroupement national, ce qui concerne ici essentiellement les intervenants venant de groupes de jeunes. Comme nous l'avons remarqué dans le chapitre 1, la régionalisation entraîne une redéfinition des rôles entre les regroupements provinciaux et des organismes locaux mobilisés régionalement dans un secteur et un regroupement intersectoriel. La régionalisation a donc un impact sur les rapports entremis entre les regroupements et leurs groupes membres. Pour la région de Montréal, compte tenu du nombre de groupes concernés, cette redéfinition pourrait engendrer certaines difficultés dans un futur de plus en plus rapproché. C'est du moins ce qui émerge du contenu des rencontres, sans que la nature même des difficultés ne soient explicitement identifiée. Il s'agit plus, de la part des cochercheurs, d'impressions que de constats formels. Mais voilà un dossier à suivre.
2.3 Un financement toujours laborieux
« C'est problématique la bataille qui existe ou qui est en train de se créer entre les organismes communautaires pour se partager les miettes du financement. Et quand il y en a un qui pousse, tu espères qu'il ne poussera pas trop vite parce qu'il va venir en chercher dans ton enveloppe!»
Le financement, c'est le nerf de la guerre, dit-on depuis toujours. Pas de financement stable et récurrent, pas de groupe. Ce n'est donc pas un problème nouveau et la régionalisation n'est pas en soi le seul facteur pris en compte par les cochercheurs. Ceux-ci l'abordent globalement, tel qu'ils ont l'impression de le vivre dans leurs organisations, ce qui diffère souvent d'un groupe à l'autre et entre les deux secteurs participant à l'étude. Les cochercheurs ont abordé cette dimension sous deux principaux aspects : 1-la recherche de financement et ses aléas; 2les sources multiples et les exigences des subventionneurs, en lien avec la mission des groupes.
Les cochercheurs soulignent premièrement que les sources de financement des organismes communautaires sont très variées : certains organismes sont financés en majorité par des bailleurs de fonds privés tels Centraide ou les organismes religieux; d'autres par la Régie régionale, dans le cadre du Soutien aux organismes communautaires (SOC régionalisé). Pour d'autres encore, une partie importante du budget provient de programmes particuliers. Pensons ici au programme PACE du gouvernement fédéral, géré par les régies régionales via le ministère de la Santé et des services sociaux; ce programme touche de nombreux groupes du secteur familles. Enfin, mentionnons que de nombreux organismes des secteurs à l'étude développent aussi des activités d'autofinancement.
Il ressort clairement des discussions qu'il existe de fortes disparités entre les sommes allouées à chacun des organismes au sein desquels travaillent les cochercheurs. Globalement, les intervenants du secteur Jeunesse oeuvrent dans des groupes au financement plus stable. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un regard global et qu'il y a des exceptions. Conséquemment, certains groupes jeunes semblent moins préoccupés par la question du financement puisqu'ils ont pu se prévaloir d'une somme récurrente dans le cadre du programme de Soutien aux organismes communautaires (SOC) mis sur pied par le MSSS et rapatrié depuis peu par les régies régionales. Ce programme de financement, au même titre que d'autres, vit maintenant sous le régime de l'enveloppe fermée, ce qui veut dire que malgré la création de nouveaux groupes qui répondent aux critères du programme, il sera difficile pour ces groupes d'obtenir un financement de base, car il n'y a plus d'apport d'argent nouveau.
Conséquence de ce blocage, certains organismes communautaires font alors davantage appel aux subventions temporaires, par projet, tel le programme PACE. À ce titre, l'année 97 sera déterminante pour certains organismes du groupe familles. En effet, selon les cochercheurs les sommes allouées dans le cadre de cette subvention pourraient être réévaluées à la baisse. Cette « réévaluation à la baisse » pourrait mettre en péril la survie de ces organismes puisque cette subvention représente jusqu'à 40% de leur budget annuel.7
Si dans l'ensemble les intervenants familles devaient donc composer avec des budgets non récurrents contrairement aux intervenants jeunesse, une telle situation ne manquerait pas de soulever quelques questionnements sur la parité intergroupes :
« depuis maintenant cinq ans, il n'y a pas de nouveaux organismes acceptés, alors qu'il y a des excédents au niveau des enveloppes et que l'argent est réparti entre les groupes qui sont déjà financés. Les groupes non financés ne reçoivent rien. On fait quand même tous partie du même regroupement, le regroupement intersectoriel des organismes communautaires mais on oublie les parents pauvres. Je me demande si cela ne va pas créer des divisions au niveau du regroupement. Arrêtons de nous battre pour faire augmenter les enveloppes de ceux qui sont déjà financés et pensons à ceux qui ne le sont pas encore »
(Gr. familles. R-5, p. 17-18).
En fait, c'est toute la question des tensions déjà existantes entre certains groupes qui ressort ici. Ces tensions, que l'on retrouve parfois à certaines tables de concertation locale, tirent leur origine autant du sous-financement des groupes communautaires, que du partage inégal du financement entre les organismes. Ainsi, lorsqu'un budget global est réparti entre divers groupes, il arrive trop souvent qu'un premier groupe est financé, un deuxième l'est moins et un troisième pas du tout. On observe parfois une situation similaire entre des organismes de même nature, par exemple dans des services d'hébergement, là où les groupes se partagent une seule enveloppe budgétaire.
Dans ce contexte, et c'est là un deuxième aspect fortement souligné par les cochercheurs, la question du financement rejoint celle de l'autonomie de groupes face à leurs besoins particuliers. Pour nos cochercheurs, un financement récurrent et suffisant favorise la consolidation de l'organisme communautaire et son autonomie. Pour les organismes dont le financement est moins précaire, la mission demeure la ligne directrice des demandes de subvention. Par contre, la situation inverse rend les groupes plus fragiles en ce qui a trait aux fondements de leur intervention. En conséquence : la culture de négociation et de revendication auprès des différents bailleurs de fonds ne sera pas la même. Elle varie en fonction de la stabilité ou non des entrées de fonds.
Ainsi, lorsque les groupes doivent composer avec de multiples bailleurs de fonds, ils se retrouvent comme trop écartelés dans des logiques différentes. En cherchant à respecter les critères et les exigences des différents bailleurs de fonds, les groupes mettent alors en péril la mission même de leur organisme. Toutefois dans la présente conjoncture, certains organismes n'ont plus de marge de manoeuvre pour accepter ou refuser des possibilités de financement. C'est leur avenir qui en dépend :
« pour les nouveaux organismes, c'est un peu là où Je trouve qu'on se tire dans le pied, lorsqu'un nouveau programme sort, on ne prend pas le temps de le questionner avant d'y adhérer. Les nouveaux organismes ont tellement besoin d'argent qu'ils ne se posent plus de questions et ils se lancent dedans, peu importe les programmes »
(Gr. familles, R-4, p.9);
« il y a toujours un risque d'accepter de l'argent qui finalement ne change rien à notre situation financière. Au contraire, cela nous donne plus d'ouvrage. Cela nous épuise ! »
(Gr. familles, R-l. p. 15).
Bien sûr, avec le temps, ces organismes ont développé des stratégies pour adapter leur discours aux exigences des différents bailleurs de fonds et pour pallier aux incohérences entre la nature des demandes de subvention et la réalité de l'intervention. Car il y a souvent une marge importante entre les besoins exprimés par les membres et l'intervention demandée ou exigée à l'intérieur des cadres définis par les bailleurs de fonds :
« tout ça nous oblige, pour le financement, à toujours dire ce qu'ils veulent entendre. Il faut toujours transformer un peu notre discours pour bien employer leur langage. Cela a pour effet de diluer notre mission. Et cela ramène la question de la reconnaissance des groupes pour ce qu'ils sont »
(Gr. familles, R-l, p.4).
Dans un tel contexte, les cochercheurs s'entendent pour dire qu'il y a souvent alors un hiatus entre l'action effectivement réalisée et les exigences du financement par problématique :
« ça devient tellement complexe, même pour les groupes, dans la décentralisation. Chaque enveloppe budgétaire ne peut contenir toutes les restrictions ou toute la réflexion qui est menée dans l'ensemble. Donc, l'enveloppe s'applique à une affaire tellement pointue que, même si on parle d'approche globale, on va donner des subventions pour ceux qui sont blonds, en haut de cinq pieds, pas plus vieux que tel âge. Donc, l'application des grands plans, des grandes prétentions de la régionalisation est impossible à réaliser »
(Gr. Jeunes R-l,p.2).
En fait les groupes se définissent fort différemment des institutions. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans une approche globale que dans une approche par clientèle et groupe à risques. Mais les sources de financement ne répondent guère à ces attentes « L'argent est affecté à des problèmes, des affaires bien pointues. Mais, nous, dans notre réalité, ce n'est pas comme ça. On regarde les gens, on ne regarde pas les problèmes »(Gr. Jeunes R-l. p. 16). Les groupes ne demandent que le respect de leur leur capacité de réaliser l'intervention : « c'est pour ça que l'autonomie, on travaille beaucoup avec ça. Je me dis qu'il faut savoir ce qu'on est capable de faire, ce que ça vaut, puis ce que les autres nous demandent, et être capable de leur dire non. C'est bien beau dire "on pourrait", mais ce n'est pas vrai qu'on peut ! Ce n'est pas vrai qu'on peut, et, à quel prix... c'est nous autres qui en payons de notre santé ! » (Gr. familles R1. p.14).
En dernier lieu, sur le fond, les cochercheurs questionnent également les critères retenus par les subventionneurs lorsque vient le temps d'évaluer les résultats des projets. Tous se plaignent que les bailleurs de fonds ne s'intéressent trop souvent qu'aux résultats quantitatifs. Or, les pratiques dans le milieu communautaire sont avant tout d'ordre préventif, donc difficilement mesurables mais appréciables en termes qualitatifs : « ils nous disaient de calculer l'impact de nos interventions à long terme, sur cinq ans. Par exemple, un jeune avec qui tu as été en contact et qui a aujourd'hui vingt-deux ans, de savoir où il est rendu. Bon. Si je n'ai plus de contacts avec ce Jeune, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui s'est passé ! Ils ne comprennent pas ça» (Gr. jeunes R-4, p. 23). Aussi, les cochercheurs soulignent qu'ils ne sont pas équipés pour faire ce genre d'évaluation qui demanderait des ressources humaines et financières suffisantes et une expertise dans le domaine de l'évaluation.8
Il ressort donc clairement que la vie quotidienne des groupes communautaires est fortement affectée par le type de financement accessible. Un financement récurrent et important permet de stabiliser l'organisme à plusieurs niveaux, tant pour le personnel, en offrant de meilleurs salaires et de bonnes conditions de travail, que pour les services offerts, tout en maintenant le cap. Par contre, l'instabilité et l'insuffisance du financement mettent en péril la stabilité et la consolidation de l'organisme. Elles limitent aussi la cohérence entre les projets demandés et la mission de l'organisme. L'autonomie de l'organisme se retrouve alors grandement menacée. La prochaine section explicitera l'orientation des services offerts par les organismes communautaires des deux secteurs à l'étude et tentera de mettre en relief les différents éléments qui les influencent, en lien avec les limites et les contraintes propres au financement.
2.4 Des services de plus en plus sollicités
«Il n'y a pas d'entreprise gouvernementale, pas une école, pas une université qui va réussir à rendre la gamme de services qu'on rend, avec l'argent qu'on nous donne pour les rendre! »
(Gr. familles R-Lp.13)
La mise en oeuvre de cette réforme majeure du système de santé et de services sociaux se fait dans un contexte de crises multiples : celle de l'État providence, celle de légitimité du politique et celle de la transformation structurelle du travail. Que l'État s'engage dans une telle réforme à un tel moment n'est évidemment pas l'effet d'un hasard, ne l'oublions pas. Ce processus, qui se révèle d'abord une démarche d'assainissement et de rationalisation des finances publiques, a des répercussions importantes sur les services à la population. Les groupes communautaires sont en première ligne pour en apprécier les effets sur des populations appauvries. Dans cette conjoncture, nos cochercheurs constatent un mouvement de « dumping » vers les groupes. Sans être nouveau, et nécessairement irréversible, il s'accentue dans la présente conjoncture. Parallèlement à ce mouvement, nous assistons à une nette pression pour qu'il y ait professionnalisation des groupes communautaires et en même temps, augmentation du bénévolat en leur sein. Ce double mouvement, paradoxal à première vue. tend à renforcer le volet service du travail des groupes.
Les cochercheurs s'entendent pour dire que plusieurs facteurs contribuent à influencer la nature des services offerts : la conjoncture socio/politico/économique, la diminution du filet universel de sécurité sociale, la diversification, la complexification et l'individualisation des problématiques sociales, les différentes exigences des bailleurs de fonds ainsi que l'idéologie dominante de professionnalisation et de spécialisation. Nonobstant ce contexte, ils insistent pour dire que l'orientation générale de leurs organisations tend toujours vers l'actualisation d'une mission qui s'enracine dans des pratiques qui dépassent un simple service de première ligne à la population. Pour les cochercheurs, leurs pratiques doivent encore chercher à s'inscrire, comme nous l'avons souligné dans le chapitre 1, dans une vision plus complète des problèmes sociaux où s'articulent soutien individuel et démarche collective, aide et prévention mais aussi promotion et défense des besoins et des droits sociaux (voir section 2,6).
Pour les cochercheurs. une des premières conséquences observables de cette conjoncture difficile, c'est l'aggravation de l'appauvrissement d'une partie de plus en plus grande de la population. Au quotidien, les cochercheurs des deux secteurs soulignent combien l'accroissement des inégalités dans la répartition de la richesse entraîne une augmentation du nombre de personnes faisant appel aux ressources communautaires. Ces personnes qui se retrouvent de plus en plus démunies, sont présentement incapables de bien répondre à leurs propres besoins de base ainsi qu'à ceux de leurs proches.
Dans ce contexte, les cochercheurs insistent sur la nature des besoins et des demandes des usagers. Si certains clients expriment fréquemment des besoins essentiels, tels un manque de nourriture, une partie des personnes rencontrées se débattent avec un sérieux alourdissement, une réelle complexification et une diversification de leurs problèmes personnels. Déjà surchargés dans leur travail, les organismes communautaires, du moins ceux des deux secteurs à l'étude, réussissent tant bien que mal à s'adapter à des taux de fréquentation de plus en plus élevés, sans qu'ils puissent généralement disposer des ressources financières nécessaires pour augmenter le nombre d'intervenants. L'efficience sociale et financière des organismes communautaires se révèle ici de manière pour le moins probante, dans une conjoncture socioéconomique propice à l'effritemement rapide d'un tissu social déjà effiloché.
Pour les cochercheurs, et ici c'est tout particulièrement ceux du groupe familles qui le soulignent, en ce qui concerne la nature des services aux membres, il est clair que les organismes communautaires se retrouvent aujourd'hui avec des mandats qui appartenaient auparavant aux CLSC. Il y a un net transfert vers les organismes communautaires de services anciennement offerts par les institutions. C'est tout particulièrement évident en ce qui a trait au maintien à domicile. En fait, les cochercheurs du groupe familles ont parfois l'impression que leur organisme est devenu plus souvent qu'autrement le déversoir du trop-plein institutionnel.
Pour les deux groupes, jeunes et familles, s'accroît le « dumping» des établissements du réseau vers le communautaire. D'une part, le « dumping obligé » provient du recul constaté au niveau de la présence et du soutien traditionnel de l'État. Ainsi, la reconfiguration des services de santé et des services sociaux via la Régie régionale reformule le mandat des CLSC, lequel relègue alors une partie de son mandat aux organismes communautaires : « il y a des indications très précises, au niveau de la Régie régionale et de la Direction de la santé publique, qui laissent croire que cela va encore aller en augmentant. La Direction de la santé publique, entre autres, présente des possibilités de subventions qui sont, dans le fond, de l'achat de services : on vous donne tel montant si vous remplissez un mandat qui est le suivant, qui va être évalué à partir de tels critères et qui vise telle population» (Gr. familles R-l, p. 5).
En quelque sorte les cochercheurs ont l'impression de devoir gérer un plus grand nombre de situations problèmes, qui se révèlent elles-mêmes de plus en plus lourdes et complexes. L'effet de « dumping » est donc aggravé par l'alourdissement toujours plus grand et la diversification des problématiques sociales, par l'acuité des demandes des personnes aux prises avec les problèmes ainsi que par les particularités propres à chacun des organismes communautaires. À ce titre, l'un des cochercheurs du groupe jeunes apportait l'exemple suivant : « c'est un jeune qui va dans une maison de Jeunes, mais il va bientôt avoir dix-huit ans. Je lui dis qu'habituellement, les maisons de jeunes c'est en bas de dix-huit ans. Alors, il me dit "11 faut que Je dise que J'en ai seize?" » (Gr. Jeunes R-l, p.5).
Dans ce contexte, les cochercheurs soulignent deux directions que semblent prendre leurs pratiques sous l'impulsion de ce que nous venons de décrire. Souvent complémentaires dans un lieu donné, elles peuvent aussi être vues comme contradictoires. Toutefois, ces deux directions visent à renforcer le volet service de leur intervention. Nous parlons de la professionnalisation des pratiques communautaires et de l'augmentation du bénévolat.
Ainsi, la présente conjoncture et les exigences des organismes subventionneurs tendent à créer une sort de dynamique où les organismes communautaires développent de plus en plus des services de type professionnel. Cette professionnalisation n'est pas nécessairement perçue comme étant négative, surtout du point de vue de la qualité : «je trouve ça intéressant que l'on développe une certaine expertise et que les services donnés aient un certain standard » (Gr. familles R-2, p. 7). Cependant, cette tendance renforce l'effet de dumping, rendant les organismes communautaires intéressants pour leurs moindres coûts sociaux. En fait, les groupes se sentent comme coincés, pris avec les bons et les moins bons côtés inhérents à ce processus : «de l'externe, on nous demande de nous professionnaliser pour qu'éventuellement on prenne en charge des services qui étaient rendus par les professionnels des institutions de santé: à l'interne, on trouve ça intéressant. Il faut aller chercher un savoir parce que les problématiques sont plus développées aussi Mais il faut faire attention pour ne pas commencer à faire le travail des institutions à rabais, parce que le milieu communautaire manque de reconnaissance, de financement » (Gr. familles R-2, p. 7).
Toutefois, les éventuelles pressions extérieures à la professionnalisation s'accompagnent aussi, et parfois dans un même temps, de pressions pour grossir le nombre de bénévoles. C'est le cas de Centraide : « ils vont nous de mander de développer des services de type professionnel avec une meilleure qualité, en même temps on nous demande d'augmenter le nombre de bénévoles » (Gr. familles R-2, p. 7).
Évidemment, le bénévolat au sein des organismes communautaires n'est pas un phénomène nouveau. Il est d'ores et déjà très appréciable en nombre et en qualité. Mais il semble aujourd'hui prendre une place démesurée dans la tête de bien des bailleurs de fonds, une manière de légitimer le désengagement collectif de l'État, de renvoyer aux individus le soin de gérer la misère : « le bénévolat est devenu une façon pour l'État de culpabiliser les gens; on regrette de ne pas en avoir fait » (Gr. jeunes R-l. p. 14).
Pour les groupes, un certain paradoxe s'installe entre la demande de professionnalisation, souvent associée à la qualité des services, et l'intégration de bénévoles dans l'organisme. Certains cochercheurs tiennent à rappeler que la dimension participation et formation fait aussi partie de la mission des organismes communautaires : « nous, on l'a intégrée comme une forme d'intervention, une autre façon de donner la chance aux femmes de prouver ce qu'elles sont capables de faire» (Gr. familles R-l, p.9). Par contre, les cochercheurs ont l'impression que le bénévolat se voit dénaturé par les procédures évaluatives de certains bailleurs de fonds qui en font non seulement un critère, mais aussi, à la limite, une exigence pour l'obtention, ou la justification, d'un financement (ex. : Centraide). De ce fait la pression exercée sur les organismes communautaires pour démontrer à quel point ils font appel au bénévolat s'en trouve renforcée. « Il faut toujours qu'on laisse croire qu'on a beaucoup de bénévoles, qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait dans notre organisme!» (Gr. familles R-l, p.8); « nos bénévoles! Finalement, on a fini par passer en disant que c'était la communauté au complet! Cela a marché... Centraide a trouvé ça bien le "fun" que la communauté s'implique... ! » (Gr. Jeunes R-4, p.23).
Les services offerts dans les organismes communautaires se transforment sous le poids de diverses variables. Pressés par une demande grandissante tant des populations que des institutions du réseau, nombreux sont les groupes qui se sentent coincés. Pourront-ils encore longtemps, sous l'effet de la professionnalisation et d'un volet service prédominant, conserver leur approche plus globale, qui tient compte des besoins de la personne dans son ensemble? « La diff iculté avec nos bailleurs de fonds, c'est qu'ils tentent d'encadrer par problématique : telle problématique, tel organisme, alors qu'on se retrouve, dans la réalité, à combler plusieurs besoins. Parce que, dans la vie quotidienne, les problèmes, les difficultés ou les forces ne sont pas dans des petites cases. » (Gr. familles R-l, p. 7).
2.5 Des transformations dans la gestion des tâches
«On a l'impression qu'on monte en montagne, notre coordonnateur est en haut de la côte. II voit une autre montagne et il part, tandis que nous, les intervenants, on est encore en train de monter la première avec nos sacs à dos et on est épuisé ! »
(Gr. jeunes R-5, p. 15)
Les nouveaux liens d'affiliation, les exigences de production de plus en plus coercitives autour de programmes et de plans de services de plus en plus précis, l'instabilité financière et le sous-financement de plusieurs organismes sont des facteurs qui engendrent une pression supplémentaire sur les groupes. Ces éléments pourraient mettre en péril non seulement le travail mais la mission même des groupes communautaires. Car ceux-ci doivent réajuster leurs pratiques en fonction de ces changements. C'est tout particulièrement vrai lorsqu'on se penche sur la gestion du travail à l'intérieur des groupes. Les aspects suivants sont touchés :
- alourdissement du volet administratif;
- reconfiguration des statuts de travail ainsi que des tâches au sein de bien des organismes, avec pour corollaire un mouvement vers une plus grande spécialisation;
- ambiguïtés dans le rapport aux programmes d'employabilité.
Mentionnons dans un premier temps l'alourdissement administratif qu'engendre la présente conjoncture. Ce contexte exige, on l'a vu, à la fois plus de représentations et de liens avec le réseau public ainsi que des interactions plus nombreuses et plus régulières entre groupes communautaires. Globalement toutefois, c'est sûrement la recherche de financement qui fait l'objet des plus fortes récriminations lorsque les cochercheurs cernent les dimensions de leur tâches qui hypothèquent le plus leur travail. Cet aspect de l'administration demande aux intervenants énormément de temps et d'énergie, et ce même pour les groupes « assurés > de subventions stables, car de toute manière, ces dernières suffisent rarement à couvrir tous les services.
Nous venons de mettre en évidence, dans la partie qui précède, que les modalités de financement tendent généralement à se complexifier, qu'elles comportent plus d'exigences, entre autres par rapport à l'évaluation. Cet accroissement des exigences des bailleurs de fonds surcharge le travail quotidien et contribue à alourdir les tâches des intervenants, surtout dans les petites équipes, où l'on demeure par ailleurs sous-payé. Pour certains cochercheurs, lorsque vient le temps des demandes de subvention, cela se traduit généralement par de nombreuses heures de travail supplémentaire. Des heures teintées d'amertume : pourquoi consacrer tant de temps et autant d'énergie à produire une demande malgré les minces possibilités qu'elle soit acceptée. « C'est décourageant! diront-ils, et l'on a parfois l'impression qu'ils ne les Usent même pas ».
Mais derrière ce constat d'un alourdissement généralisé du volet administratif se profile un deuxième aspect propre à la gestion des groupes, soit l'organisation du travail. En effet, les particularités propres aux différentes équipes, essentiellement liées à leur importance et leur stabilité, influencent directement la manière de s'organiser au sein des groupes. Concrètement, un financement stable et important renforce la tendance à la spécialisation du personnel régulier, tandis qu'un financement plus faible et non récurrent génère une plus grande polyvalence du personnel au sein des groupes.
D'une part donc, en ce qui concerne les organismes ayant un financement plus stable, la gestion des tâches à l'intérieur de ces organismes communautaires s'est relativement transformée ces dernières années, sans que ces transformations ne soient nécessairement tributaires de la régionalisation. À ce titre, il ressort des propos des cochercheurs que bien souvent les coordonnateurs sont appelés à se spécialiser, à concentrer leur travail sur la dimension administrative, la représentation, laissant aux autres intervenants le soin d'entretenir les relations avec les usagers sur le terrain. Ainsi, dans certains organismes, on note un écart de plus en plus marqué entre les travailleurs sur le terrain et la coordination.
En fait dans la présente conjoncture, il saute aux yeux combien les intervenants doivent posséder une plus grande expérience, et une forte expertise, pour gérer, intervenir ou représenter l'organisme. Les cochercheurs, surtout ceux du groupe Jeunes, diront qu'ils ont le sentiment de devoir agir comme des experts, sans que cela soit nécessairement en lien avec les compétences pour lesquelles ils ont été engagés au sein de leur organisme. Le signale également le niveau de connaissances que les intervenants doivent posséder en lien avec les différents « dossiers ou projets» discutés et négociés lors des multiples rencontres de représentation et de concertation. Les cochercheurs disent qu'« on envoie alors nos gros canons ! ».
À ce titre, notre démarche même de recherche a démontré l'émergence tardive d'un discours sur les pratiques concrètes auprès de la jeunesse de la part des cochercheurs du groupe jeunes, composé très majoritairement de gens qui sont en position de coordination, à la différence du groupe de cochercheurs familles, plus proche du terrain : « le discours sur la pratique terrain n'a pas ressorti rapidement, cela peut être dû aux partenaires de la recherche qui sont davantage concentrés sur la coordination. Même s'ils ne sont pas si loin de la pratique, ce n'est pas leur préoccupation quotidienne * (Gr. jeunes R-5, p.l). Mais de l'aveu même des participants de ce groupe de recherche, cette manière de faire au quotidien comporte des risques évidents qui peuvent aller Jusqu'à compromettre l'approche et la mission de l'organisme : « le danger là-dedans, c'est que les coordonnateurs coordonnent encore plus et qu'ils soient encore plus à l'extérieur, et, que les intervenants pratiquent encore plus à l'intérieur. Autrement dit, c'est là l'enjeu d'exprimer jusqu'à quel point on est communautaire dans nos rapports sociaux à l'intérieur même du travail » (Gr. jeunes R-5, p. 13).
D'une façon générale donc, les cochercheurs s'entendent pour dire qu'il y a une certaine transformation des rapports à l'intérieur même des organismes. Face à la lourdeur des dossiers, à leur complexité, aux besoins criants de la clientèle, les groupes, surtout lorsqu'ils disposent du personnel nécessaire, ont tendance à plus spécialiser les postes, ce qui nous éloigne petit à petit d'une époque pas si lointaine où de nombreux groupes favorisaient une forme de gestion moins segmentée. Cette propension à plus de spécialisation n'est pas nécessairement perçue de manière négative, compte tenu entre autres des exigences des bailleurs de fonds : « avant le contenu des demandes de subvention pour un projet était plus simple; maintenant, il faut presque citer des auteurs. C'est complexifié. et il y a augmentation des critères » (Gr. familles R-2. p.5).
Si utile soit-il de développer des expertises qui renforcent les risques de spécialisation, on souligne, souvent dans un même cadre de discussion, combien il serait dommage de perdre la polyvalence qui caractérise traditionnellement le communautaire, la possibilité en quelque sorte de toucher « à toutes les facettes du travail, de la comptabilité à l'animation » (Gr. familles R-2, p.5). En fait, ce mouvement vers plus de spécialisation rejoint alors la professionalisation dont nous avons parlé dans la section précédente. Le diplôme universitaire, souvent dans une formation professionnelle, devient une condition d'entrée presque incontournable dans certains groupes pour pouvoir accéder à des postes plus exigeants au niveau de la tâche.
L'idée de polyvalence, ce sont les groupes qui disposent de peu de personnel qui la supportent le plus dans les faits. Ici, une autre dynamique s'installe dans la gestion des tâches. Dans ces groupes qui disposent d'un petit financement, les rares intervenants se retrouvent à devoir faire plusieurs tâches à la fois, tant en intervention auprès de la clientèle et des membres qu'en représentation :
« dans notre organisme, on vit beaucoup l'essoufflement, le décrochage quand un organisme est petit. On est sollicité de partout. C'est intéressant, c'est l'"fun", sauf qu'on n'a pas les effectifs. Alors, on est engagé pour faire une job, mais on est aussi obligé, souvent, de faire d'autres tâches comme siéger à des tables de concertation par exemple » (Gr. jeunes R-l. p.6).
Dans un tel contexte, et ce sera notre troisième point, l'utilisation de programmes d'employabilité se pose avec une certaine acuité. En ce qui concerne l'embauche de personnel dans les programmes d'employabilité, il s'agit avant tout d'alléger les tâches liées à une activité ponctuelle au sein de l'organisme. Certains cochercheurs des deux secteurs à l'étude mentionnent que c'est généralement le manque de financement qui oblige les organismes à combler leurs besoins par l'utilisation des programmes d'employabilité et de bénévolat. Un effet pervers peut alors survenir : un grand roulement de personnel et un surplus de tâches pour les intervenants réguliers lorsque ces personnes quittent l'organisme, généralement lorsque les programmes prennent fin.
Dans de telles conditions, la consolidation de l'organisme est plus difficile à réaliser et ce sont les rares permanents qui voient leurs conditions de travail, et même leur qualité de vie personnelle, se détériorer : «J'ai l'impression que je n'ai pas le temps de faire un processus, d'évaluer, de planifier, de pouvoir voir ce qui s'en vient et de prévoir le travail lorsque, par exemple, une équipe part parce que son programme d'employabilité est terminé. Comment va-ton se débrouiller maintenant qu'il y a deux ou trois travailleuses sur cinq qui doivent quitter ? Donc, je n'ai jamais le temps de faire la planification dans mes heures habituelles de travail. Alors, la planification, je la fais tout le temps... j'y pense même en déjeunant. Le travail devient omniprésent » (Gr. familles R-l, p.3).
Si de manière générale l'encadrement et l'intégration des personnes engagées dans les programmes d'employabilité amènent un surplus de tâches pour les intervenants réguliers, cette situation empire parfois lorsque la personne embauchée est un membre de l'organisme. Le membre engagé comme travailleur demande souvent beaucoup plus d'attention de la part des intervenants réguliers qu'une autre personne embauchée dans un programme et qui dispose d'une meilleure formation. En fait, cette difficulté peut être contournée lorsque les personnes des programmes d'employabilité sont bien intégrées dans l'organisme, les tâches régulières étant alors réparties entre tous les travailleurs, allégeant ainsi le travail de chacun.
Globalement, les postes créés par des programmes d'employabilité, et le sous-financement chronique, favorisent la mobilité du personnel. Cette instabilité devient donc une réalité pour plusieurs organismes communautaires, et cela influence constamment l'organisation des tâches : « il faut toujours réorganiser l'équipe parce qu'on doit nous autres aussi (les régulières), aller au chômage à un moment donné » (Gr. familles R1, p.5). En bout de ligne donc, deux réalités : les groupes à petit budget, plus traversés par l'instabilité, mais plus polyvalents dans leur gestion interne et les groupes financés de manière récurrente, avec un personnel plus important, mais qui tendent à se spécialiser afin de répondre à des exigences spécifiques de la pratique. En quelque sorte, ces deux réalités composent deux visages du mouvement communautaire. Elles questionnent les conditions de réalisation d'une croissance qui respecte le spécificité du mouvement communautaire. C'est là-dessus que nous nous pencherons dans la sixième et dernière section.
2.6 Une définition des pratiques d'intervention communautaire
« Le bon côté de la régionalisation nous amène une fois pour toutes, à nous concentrer pour savoir c'est quoi un organisme communautaire.
De l'autre côté, il faut chercher à le mettre en pratique : l'approche globale, la vision globale, la démocratisation, l'inclusion de nos clientèles dans nos structures décisionnelles. Le défi est que cela ne reste pas sur papier, que cela vienne encore dans la pratique. »
(gr. jeunes R-5, p.25)
Dans la démarche de recherche, les cochercheurs ont été appelés à se pencher sur la spécificité de leur intervention, à se positionner sur le développement et les transformations récentes de ces pratiques à la lumière de la régionalisation. Les deux groupes n'ont cependant pas réagi de la même manière, et avec la même célérité, face à ces divers questionnements. Les cochercheurs du groupe familles se tiennent au ras du sol d'abord et leur discours se construit en lien avec leur travail quotidien avec les gens. Les cochercheurs du groupe jeunes sont plus analytiques et leur discours, malgré d'incessantes demandes de notre part, s'attarde moins directement aux pratiques quotidiennes avec les populations desservies. À noter que nous avons préféré laisser cette partie à la fin de ce chapitre, essentiellement parce que ce qui caractérise spécifiquement le communautaire, ce qui le distingue du réseau public, n'émerge pas du discours initial des cochercheurs. Il faudra attendre trois bonnes rencontres pour que se dessine plus clairement une définition de ces pratiques autonomes qui apparaît prioritaire chez les cochercheurs du groupe familles. À noter également qu'il faut lire ces pages comme étant une sorte de section de référence, qui renvoie à la définition des cochercheurs du communautaire idéal, d'un communautaire malgré tout le reste, malgré le fait qu'il soit mal compris par le réseau, qu'il soit «poussé » à accentuer le volet service, à se professionnaliser, à se spécialiser toujours un peu plus. En fait cette section, c'est la réponse, et le reflet d'une tension, des cochercheurs aux transformations qui traversent présentement leurs pratiques.
Amenés par le biais de la démarche de recherche à confronter leurs pratiques à l'intervention déployée dans le réseau institutionnel, les cochercheurs du groupe familles se réclameront d'une filiation première, l'Histoire du communautaire. Une histoire avec un grand H, un peu comme si devant leur manque de perspectives communes, il leur fallait élargir leurs références à l'histoire d'un mouvement au sein duquel gravitent depuis longtemps plusieurs des intervenants cochercheurs. Un peu comme si, compte tenu du manque de définition et d'identité de secteur, leur discours se déplace et fait appel plus rapidement et explicitement à une période où primait sinon une dynamique plus conflictuelle, à tout le moins une plus grande clarté dans les rapports entre l'État et le communautaire.
De fait, de nombreux éléments touchant à leur philosophie d'intervention communautaire renvoient aux luttes collectives et aux différentes mobilisations qui ont façonné, au fil des ans, la culture et l'histoire particulière des groupes. Des éléments auxquels se rallieront les cochercheurs du groupe jeunes lorsqu'ils seront ultérieurement portés à leur attention. Cela nous permet de présenter les caractéristiques de cette philosophie commune, bien qu'identifiées à des moments distincts.
Ainsi, pour les cochercheurs des deux groupes, l'approche globale est au coeur de la pratique. Elle sous-tend que la personne est au centre, c'est-à-dire que les membres mêmes doivent identifier les solutions aux différentes problématiques explorées avec eux et qu'ils doivent pouvoir se prendre en charge. L'environnement immédiat de la personne est pris en compte dans l'intervention. Les autres intervenants de l'organisme sont aussi mobilisés pour permettre un soutien et un suivi dans l'intervention. C'est le rapport à la personne et non le rapport aux services offerts dans l'organisme qui doit dominer et orienter les pratiques : « à bas la compartimentation parce qu'on travaille avec des personnes. Et l'approche globale, c'est un des points centraux avec lequel on voit le social. C'est avec cette approche globale qu'on voit les personnes comme des personnes, et non pas comme des problématiques. il y a un danger qu'effectivement on se compartimente et qu'on ait de l'argent dans la mesure où on réponde à leurs priorités à eux autres » (Gr. jeunes R-l, p. 17).
La régionalisation ne semble pas, du moins pas encore, ébranler l'idée que « la personne » doive occuper une place dominante dans les organismes, et ce malgré les pressions vers l'offre de services. Si les hommes et les femmes qui fréquentent l'organisme demeurent la raison d'être de celui-ci, il en découle l'importance de leur implication à tous les niveaux. Les pratiques d'intervention auprès d'eux font la promotion du développement d'un plus grand pouvoir sur sa vie (« empowerment »), d'une part par l'implication au sein des différentes structures de l'organisme et, d'autre part, par la participation aux activités planifiées et organisées en fonction de leurs besoins. Les activités sont donc prévues pour favoriser l'expression des membres. Ce sont des déclencheurs, des catalyseurs. Les activités sont variées mais elles font rarement la promotion d'un suivi individuel à long terme. Lorsqu'il y a une prise en charge individuelle, c'est généralement à court terme.
Les intervenants entrent en relation avec leurs membres par le biais d'activités qui, bien que plus ou moins structurées, laissent une large place à la communication, à l'information, à la prévention sous forme de discussions informelles. Les membres se sentent alors moins menacés que dans un contexte plus rigide, tel qu'on le retrouve souvent dans l'intervention institutionnelle. Dans ce climat propice aux échanges, ils sont plus à l'aise de parler de leurs préoccupations. Contrairement au milieu institutionnel, les personnes qui entrent en contact avec un organisme communautaire ne sont pas freinées par une liste d'attente. Elles ont un accueil immédiat, sans délai, et sans durée d'intervention à respecter. La souplesse du contexte de l'intervention joue donc un rôle important dans les pratiques communautaires. Les organismes communautaires ont une capacité d'adaptation rapide aux besoins de leurs membres ou participants.
La proximité avec les membres, les liens privilégiés, le partage du quotidien et la notion de plaisir sont des éléments particuliers à l'intervention communautaire au même titre que l'implication de membres dans les différentes structures d'organisation interne et les prise de décision. L'intervention communautaire est avant tout une intervention d'éducation populaire, où le respect de la personne constitue l'assise des pratiques, comme le montrent les deux extraits suivants : « on favori se beaucoup l'informel Quand tu Jais un groupe de cuisine collective, tu ne parles pas juste popote. C'est ouvert à plein d'autres affaires. C'est aussi comme ça en société. La programmation des activités est conçue pour permettre l'ouverture et les échanges dans une atmosphère propice aux confidences » (Gr. familles R3, p.20); «J'ai tout ce qu'il faut pour être un intervenant communautaire dans un CLSC. Mais, si je reste dans le milieu communautaire, c'est que j'aime ce milieu car il me permet d'avoir du plaisir aussi avec les jeunes, avec les parents, de monter des choses intéressantes, de les vivre en ayant du plaisir avec eux. On partage un peu le quotidien des gens ! » (Gr. Jeunes R-3, p.29). Pour ce faire, les groupes communautaires cherchent à créer des lieux d'appartenance où les gens sont physiquement et émotionnellement à l'aise. Ces lieux sont conçus pour favoriser l'expression des membres et les échanges. Le contexte de l'intervention inclut donc le lieu dans lequel elle se fait, c'est-à-dire un lieu qui appartient aux membres du groupe et qui permet de créer plus facilement un réseau social positif, entraidant et solide. Au besoin, on peut référer les membres à d'autres organismes communautaires ainsi qu'au réseau institutionnel, souvent à un intervenant avec qui on a développé des alliances. Dans une situation qui nécessite une référence à une institution, quelques cochercheurs mentionnent qu'ils préparent le membre en question à être référé en l'outillant à se réapproprier sa situation puisque trop souvent l'intervention en milieu institutionnel désapproprie la personne de sa situation.
Dans ce contexte, les principaux attributs de l'intervenant communautaire sont sa disponibilité, sa souplesse, son ouverture, sa spontanéité, son respect du rythme et son intervention sans jugement de valeur. Bien que l'intervention en milieu institutionnel favorise une approche de plus en plus personnalisée, elle est avant tout sujette à un mandat public qui augmente les possibilités d'établir des rapports d'autorité avec la clientèle. À titre d'exemple, certains cochercheurs soulignent qu'en milieu institutionnel, l'intervenant semble se démarquer surtout au niveau du rapport d'autorité, entre autres par le biais de non-dits face à son client, parfois même avec des objectifs cachés pour soulager un « case-load» trop chargé.
En fait, le rapport aux usagers s'avère une occasion de développer de nouvelles pratiques, de faire du vrai travail, d'aller se ressourcer dans l'intervention terrain. Les intervenants diront que « la motivation pour continuer le travail vient surtout de l'intervention auprès des usagers ». Même s'il faut beaucoup d'énergie pour répondre à toutes les demandes et pour intervenir dans une approche globale, la satisfaction personnelle dans l'intervention trouve sa source dans ce rapport aux usagers, dans l'émergence d'un sentiment de réussite en constatant « que les usagers sont capa bles de se prendre en main ».
L'intervention au sein d'un organisme communautaire demande aux intervenants d'être des « créateurs », d'être « inventifs », d'être « polyvalents » et « impliqués ».
Bien que les caractéristiques qui viennent d'être soulignées semblent rejoindre les cochercheurs des deux groupes, certains nuancent en notant les écarts qui peuvent exister d'un organisme communautaire à l'autre : « le milieu communautaire n'est pas un milieu pur et homogène qui a le même fonctionnement Ce sont des petites structures, des petites boîtes. À un moment donné, la culture de la boîte peut facilement chavirer parce qu'il y a deux personnes un peu plus fortes dans un projet. Tranquillement, les organismes communautaires commencent à ressembler à leurs formulaires de subvention. Avant c'était le "fun". Maintenant, il faut être efficient. Ce n'est pas parce que c'est le "fun" qu'on n'est pas efficace. Maintenant, il faut constamment mesurer. Cela peut amener certains changement dans la pratique parce qu'on sait que l'évaluation s'en vient » (Gr. Jeunes R-3, p.30).
Synthèse
Dans les pages qui précèdent, nous avons vu que la régionalisation se révèle un processus pour le moins complexe, dominé par deux constats majeurs : la complexité organisationnelle et l'encadrement techno-bureaucratique des instances étatiques montréalaises. Plus précisément, les premières années de la régionalisation à Montréal apparaissent avoir un impact important et plus direct sur les pratiques communautaires tout particulièrement lorsqu'il est question des rapports avec la Régie, et ses constituantes, ainsi qu'en ce qui a a trait aux rapports à l'intérieur même du mouvement communautaire montréalais (les sections 1 et 2). Du point de vue des cochercheurs, il ressort clairement que ce nouveau contexte d'intervention bouleverse sérieusement les habitudes et les pratiques développées avec les années par les acteurs concernés et nouvellement partenaires.
Les sections suivantes (3-4-5) qui touchent au financement, aux services et à la gestion interne soulèvent des questionnements qui sont déjà présents dans la réalité du communautaire depuis de nombreuses années. Ce qui s'en dégage, soit un financement toujours laborieux, un mouvement vers une plus grande professionnalisation et spécialisation des pratiques, semble toutefois, du point de vue des cochercheurs, de plus en plus traversé par le processus de régionalisation. Enfin, la section 6, sur la spécificité des pratiques communautaires, se révèle dans notre démarche collective de recherche, comme le « liant », ce qui unit et fonde l'intervention communautaire dans ce champ, en la distinguant du réseau institutionnel.
Sur la base de ces constats, il ressort que les organismes communautaires des deux secteurs à l'étude sont confrontés à divers enjeux liés à la régionalisation et à son contexte. Le prochain chapitre analyse les différentes dimensions des enjeux actuels des secteurs à l'étude, en lien avec les propositions de départ présentées dans le chapitre 1.
3. L'autonomie et ses enjeux
Le chapitre 2 nous a permis de présenter les principaux aspects abordés tout au long de la démarche avec les cochercheurs. D'un point de vue méthodologique, cette démarche était orientée dès le départ par une série de propositions identifiées au chapitre 1. Ces propositions étaient issues du travail de l'équipe de recherche qui a initié la démarche, donc des chercheurs proposeurs. Au nombre de trois, elles étaient intimement liées à notre connaissance du terrain. Elles furent bien sûr soumises aux cochercheurs au tout début de la démarche. Par la suite, elles furent discutées et travaillées durant les diverses rencontres de groupe. Pans ce chapitre final, il nous apparaît maintenant pertinent de chercher à cerner ce qu'il advient de ces propositions. Nous verrons entre autres qu'à maints égards, elles se sont bonifiées. Mais nous verrons surtout que la démarche a donné naissance à une nouvelle proposition, sérieusement discutée et validée par les deux groupes de cochercheurs.
1re proposition :
La pratique quotidienne des intervenants des secteurs à l'étude est de plus en plus définie par des contraintes extérieures, liées aux demandes étatiques dans un difficile contexte budgétaire.
Cette première proposition nous semble recouper des pans importants du matériau recueilli. il ne fait aucun doute pour les cochercheurs des deux groupes que les pratiques sont peu à peu entachées par un certain nombre de contraintes extérieures, liées aux exigences nouvelles provenant soit de l'État québécois et de ses diverses instances, soit d'autres acteurs concernés par le financement des groupes. Ces contraintes se révèlent de trois ordres :
- des contraintes extérieures liées à la conjoncture économique et au désengagement de l'État, ce qui accentue la demande de services auprès des groupes;
- des contraintes propres au financement lui-même, paradoxalement plus difficile à obtenir au moment où l'on sollicite les groupes pour qu'ils soient justement de plus grands dispensateurs de services;
- des contraintes grandissantes, et souvent distinctes d'un bailleur de fonds à l'autre, en ce qui a trait à l'évaluation des groupes et de leur pratiques.
Premièrement, en ce qui a trait à la hausse de la demande de services, le chapitre qui précède a bien montré combien les groupes communautaires sont touchés par les transformations de l'État providence, et l'accessibilité réduite à un réseau public de plus en plus restreint et souvent peu préparé à servir des populations nouvelles et appauvries. Les deux groupes de cochercheurs soulignent combien ils ont l'impression que leur groupe devient le déversoir d'un réseau public qui s'amincit. Conséquemment, ils se « doivent » dans ce contexte de prendre en charge des populations nouvelles, de plus en plus souvent refoulées par des services institutionnels qui ne répondent plus.
Un telle situation, ce sera le deuxième point, aurait normalement dû favoriser les démarches de financement des groupes.
Or, les cochercheurs des deux groupes insistent sur la multiplication des contraintes qui vont de pair avec le travail entourant ces demandes. Que ce soit par rapport à la Régie, à Centraide, ou vis-à-vis d'autres bailleurs de fonds, les cochercheurs soulignent combien les organismes sont coincés par des normes et contraintes sur lesquelles ils n'ont guère de contrôle. ici, ii est question des changements multiples, que ce soit dans les règles et les procédures, dans la modification de formulaires de plus en plus longs et complexes, dans la nécessaire utilisation d'un langage différent en fonction du bailleur de fonds; des particularités propres aux divers programmes, du fort roulement de personnel, tout particulièrement à la Régie, qui oblige les groupes à changer souvent d'interlocuteurs.
Enfin, troisièmement, les groupes sont conscients que leur reconnaissance et leur « utilisation » par le réseau s'accompagnent d'une contrainte croissante, celle de devoir fournir une évaluation de leurs services. Or, il va de soi que les groupes sont à la fois peu équipés pour faire face à une telle demande qui, au demeurant, ne laisse généralement pas assez de place présentement à une forme d'évaluation qui respecterait la spécificité des groupes. L'approche globale des groupes séduit, entre autres pour son potentiel de réduction des « coûts sociaux ». Mais paradoxalement, on en tient peu compte lorsque vient le temps d'évaluer les pratiques et leur impact.
Globalement, ces trois principales contraintes ont un effet sur la manière de travailler de bien des groupes communautaires. Elles orientent les stratégies de financement et, conséquemment, la manière de travailler. En effet, au gré des appels d'offre de services, certains organismes « adaptent » sérieusement leur discours afin de le faire correspondre aux exigences du financement. Subséquemment, si la subvention est accordée, l'organisme doit prendre en compte bien évidemment les objectifs propres à ces programmes. Les services sont alors teintés par ce financement spécifique et ses exigences. Bien sûr les groupes ont appris à se débrouiller, à jouer avec cette situation pour le moins contraignante et sur le terrain, leurs pratiques dépassent largement les cadres de la subvention. Toutefois, la pression des bailleurs de fonds s'accroît. En témoigne le fait que de plus en plus de subventionneurs exigent que l'organisme réponde à l'ensemble de leurs exigences, et ce même s'ils ne contribuent qu'à une petite partie du budget de l'organisme. Ainsi, si à partir d'une enveloppe pointue, les groupes ouvrent sur une pratique élargie, les subventionneurs les rejoignent en revendiquant tous les bienfaits de cet élargissement.
Coincés par les multiples aléas propres aux demandes de fonds, il est impérieux que les organismes se questionnent sur les effets de ces contraintes. Ainsi, emportés par les exigences de l'offre de services afin d'assurer leur survie même, certains organismes ne risquent-ils pas de perdre de vue des perspectives d'action plus structurelles? Où situer, dans la pratique, la notion de changement social, si l'on doit continuellement satisfaire les visées à courte vue de la plupart des bailleurs de fonds? En fait, obligés qu'ils sont d'adopter une logique de services à la clientèle, ligne, ce type de travail ne met-il pas en danger à moyen terme la mission actuelle de plusieurs organismes communautaires?
2e proposition :
la reconnaissance du communautaire et son intégration dans la nouvelle dynamique régionale amènent les intervenants des secteurs à l'étude à modifier d'eux-mêmes diverses dimensions de leurs pratiques (clientèles, services, modes d'intervention).
Cette seconde proposition soustend que les groupes intègrent dans leur pratique, surtout au plan des programmes et des activités, une partie de la culture institutionnelle à laquelle ils sont de plus en plus confrontés. Dans les faits, suite à la démarche de recherche, une telle tendance se révèle présente, bien qu'il faille apporter certaines nuances. Ainsi, cette proposition se confirme par rapport aux quatre traits suivants :
- Les exigences générées par les multiples formes de représentation touchent et modifient les pratiques; ce temps supplémentaire, que ce soit dans le partenariat avec le réseau ou dans les rencontres in ter-groupes, laisse moins de place au travail direct avec la population, du moins pour ceux et celles qui sont appelés à le faire. À noter que de plus en plus de groupes ne peuvent plus suivre ces activités de représentation. ils se concentrent donc sur les services. Mais les groupes qui participent aux représentations questionnent et désapprouvent cet état de fait. Dès lors, ne se crée-t-il pas un écart entre les divers groupes, certains profitant de l'implication des autres?
- Le partenariat entraîne une modification dans le mode de gestion interne des groupes. Compte tenu qu'il exige souvent le développement d'une expertise spécifique, que seuls des intervenants expérimentés et chevronnés ont pu acquérir avec le temps, nous assistons à une réorganisation du partage du travail qui se traduit par une redistribution des responsabilités, un morcellement des dossiers et une spécialisation des tâches.
- Afin de pouvoir s'asseoir et fonctionner avec les partenaires du réseau, les représentants des groupes tendent parfois à transformer leur discours sur leurs pratiques et la population desservie. On pense par exemple à l'utilisation de plus en plus « naturelle » de la terminologie propre au réseau pour identifier, à tout le moins par moments, les gens qui fréquentent leur organisme (ex. : client et usager).
- Enfin, les transformations précédentes éloignent au quotidien les groupes de leur pratique d'éducation populaire. Plusieurs individualisent leur approche avec les personnes avec qui ils travaillent, risquant de mettre en péril une perspective de résolution de problèmes plus proche de l'action collective. Dans les faits, les pratiques ne sont alors que de l'ordre du service. Nuançons toutefois, en rappelant que la force avec laquelle les cochercheurs se réclament simultanément d'une culture communautaire, illustre que la culture communautaire ne se perd pas entièrement dans la culture institutionnelle, loin de là. La rencontre communautaire/institutionnel ne tue donc pas toute la spécificité de la culture communautaire.
Au-delà de ces éléments qui révèlent l'empreinte de la culture institutionnelle, il ressort de la recherche des effet plus favorables au maintien de la culture communautaire prise dans une perspective historique. Premièrement, le partenariat (et ses limites) amène les groupes communautaires à vouloir renouer avec des manières de penser et de faire plus proches d'un modèle culturel sinon carrément conflictuel, du moins plus imprégné des courants d'éducation populaire et de conscientisation. Deuxièmement, la culture communautaire pénètre aussi le milieu institutionnel. Dans quelles dimensions et à quelles conditions cela demeure-t-il acceptable pour le communautaire? Cela reste à déterminer, tout particulièrement pour un mouvement historiquement assez frileux à l'idée d'une récupération souvent inévitable lorsqu'il y a de telles rencontres entre deux mondes.
3e proposition :
Les savoirs des intervenants des secteurs à l'étude sont de plus en plus teintés des savoirs propres au réseau institutionnel
Deux tendances, déjà notées dans le chapitre précédent, viennent étayer le contenu de cette proposition : une certaine professionnalisation des groupes ainsi qu'une plus grande spécialisation dans la répartition des tâches et dans la division du travail. À noter toutefols que l'ensemble des savoirs, tant communautaires qu'institutionnels, ne peuvent se réduire à ces seules dimensions. Comme en témoigne la section 2.6, d'importantes distinctions persistent entre le réseau public et le mouvement communautaire relativement aux savoirs propres à chacun des réseaux.
La question de la professionnalisation passe d'abord par la notion de compétence. Ainsi, la reconnaissance par l'intitutionnel, c'est aussi vouloir montrer que l'on est sérieux, rigoureux et apte à offrir des services de qualité. Et la défense de cette dimension semble passer par une inévitable professionnalisation des lieux communautaires. L'accroissement de la professionnalisation dans les organismes communautaires est donc un élément dont il faut tenir compte dans l'analyse des transformations des pratiques. En effet, les personnes désirant travailler dans un organisme communautaire doivent de plus en plus souvent posséder diplôme et expertise dans le champ de pratique convoité. D faut dire ici qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir postuler avec un ou des diplômes en main. L'arrivée d'un personnel de plus en plus qualifié, diplômé et spécialisé, modifie l'organisation du travail à l'intérieur des organismes. De fait, les statuts de travail changent, laissant ainsi la permanence aux employés qui possèdent une diplômation universitaire.
Bien sûr, selon les cochercheurs, la professionnalisation a ses bons côtés. Elle augmente entre autres la qualité des services offerts. Elle peut même favoriser la circulation de nouveaux savoirs à l'intérieur de l'organisme, en autant évidemment que ce savoir circule et ne soit pas trop cloisonné, ce qui malheureusement arrive trop souvent lorsqu'il y a spécialisation des tâches. Dès lors, avec ce mouvement vers une plus grande spécialisation, augmente non seulement le décalage entre travailleurs, mais également l'écart entre les membres et les permanents. Un enjeu se dégage et il porte sur la transmission du savoir, sur la continuité de l'expertise communautaire. Qu'adviendra-t-il à plus long terme de ce savoir, si une part importante de celui-ci demeure peu accessible aux nouveaux intervenants? Plusieurs de nos cochercheurs se sont « construits » parce qu'ils ont pu baigner dans diverses réalités, alternant continuellement entre le travail terrain, la représentation et la réflexion plus analytique. Aujourd'hui, les tâches sont non seulement plus divisées mais le contenu des tâches est généralement atrophié d'une partie importante du savoir communautaire.
Dès lors, ne risque-t-on pas de perdre dans cette division du travail, le propre du communautaire, qui valorise une vision globale du « travail social »? Peuton parler d'approche globale avec les femmes et les hommes qui fréquentent les groupes communautaires si les intervenants sont eux-mêmes segmentés, s'ils sont eux-mêmes coupés d'une partie des connaissances essentielles à leur tâche? Dans ce cadre qu'adviendra-t-il de la relation avec les gens? Ne risque-t-on pas alors d'engendrer deux types d'intervenants : d'un côté ceux qui entretiennent une « relation client », au ras du sol, mais coupés des autres enjeux sociaux; et de l'autre, ceux qui savent, les « experts » du communautaire, mais de plus en plus éloignés du vrai terrain, du vrai monde, plus proche culturellement de leurs « adversaires » de la Régie que des populations desservies?
Nouvelle proposition sur la formalisation
De ces trois premières propositions se dégage une nouvelle proposition qui touche à la formalisation. Il apparaît clairement qu'un processus de formalisation atteint le mouvement communautaire, tout particulièrement dans les secteurs qui sont plus reconnus et construits historiquement, à l'image ici du secteur jeunesse. Cette formalisation prend corps dans un nouvel espace social qui se crée avec la régionalisation et qui constitue un nouveau lieu où se vivent les rapports sociaux.
Cependant, cette formalisation est vécue de manière paradoxale par les intervenants chercheurs. Elle pourrait mettre en jeu, si certaines conditions sont franchies, l'autonomie de pratique d'une portion non négligeable du mouvement communautaire.
D'entrée de Jeu une définition du concept de formalisation s'impose. Pour les fins de cette recherche, nous reprendrons tout d'abord la définition qu'en donnent certaines d'entre nous dans une recherche parue aussi en 1997 et portant sur la culture organisationnelle dans des groupes de femmes (Guberman, Fournier, Beeman, Gervais et Lamoureux, 1997). Dans ce cadre, « le terme formalisation (...) renvoie à des modifications qui vont dans le sens du développement d'une structure plus hiérarchique. D'une modification dans la ligne du pouvoir, de la spécialisation et de la professionnalisation au niveau du travail, sans pour autant situer les organismes comme étant bureaucratiques » (p.6).
Cependant, si une telle définition nous convient bien afin de décrire les transformations qui marquent les organismes dans leur dynamique interne, elle nous semble devoir être élargie ici, en ce qui a trait à ces principaux attributs (spécialisation, professionnalisation), aux rapports entretenus à l'externe, avec les autres partenaires, qu'ils soient communautaires ou institutionnels. En fait, la régionalisation
accentue le processus de formalisation essentiellement parce que les groupes sont maintenant inclus dans le cadre structurel régional. ils sont des partenaires reconnus. Dans ce cadre, les groupes sont vus et perçus comme partie prenante d'une certaine structure de concertation. Et eux-mêmes se perçoivent comme plus inclus dans cette structure, ce qui tend à amoindrir leur fonction de chien de garde, puisque leur position change par rapport à un appareil de l'État régionalisé.
Il est toutefois important de noter que cette formalisation plus « objective », plus visible, demeure fortement teintée par l'histoire et les racines qui fondent le mouvement communautaire. En ce sens, si le communautaire tend à devenir plus formel dans ces rapports internes et externes, 11 le fait différemment, à sa façon, sur la base de ses assises, en lien avec ses fondements et l'approche globale qui le caractérise.
Dès lors, il ne faut guère se surprendre que tout au long de nos rencontres, les deux groupes de recherche ont à plusieurs reprises, et de multiples manières,
souligné l'importance de conserver la plus grande autonomie pour leurs pratiques. Pour nos intervenants chercheurs, cette autonomie leur apparaît comme la condition minimale de toute pratique communautaire qui se respecte. Mais quel pouvoir réel se dégage de ce nouvel espace? Le matériau du chapitre précédent nous donne à penser que ce pouvoir, bien qu'existant, échappe en partie à l'emprise des groupes communautaires.
Comme ils l'ont identifié euxmêmes à de très nombreuses reprises, cette autonomie devient un enjeu au fur et à mesure que le partenariat avec le réseau se fait plus étroit. Bien sûr, cet enjeu se conjugue de manière fort variable selon les secteurs. On l'a dit, ce rapport à l'autonomie des pratiques se révèle, dans le cadre de cette recherche, comme étant vécu de manière différente d'un secteur à l'autre. Ces différences, elles trouvent bien sûr leurs fondements dans le degré relatif de reconnaissance et de définition identitaire appartenant à chacun des secteurs.
D'un côté nous avons des organismes familiaux qui, nous l'avons souligné, se présentent de manière moins homogène, tant par l'histoire que les champs de pratique, et dont l'identité de secteur est faible, du moins au sein du RIOCM. Des organismes qui se retrouvent du jour au lendemain, extrêmement sollicités par la régionalisation. De l'autre, le secteur Jeunesse, traversé par une typologie des pratiques (maison de Jeunes, maison d'hébergement, travail de rue), qui se traduit historiquement par l'émergence de quelques regroupements forts et généralement représentatifs, porteurs d'un discours omniprésent, plus souvent teinté par une dynamique de confrontation. Aujourd'hui, plusieurs de ces regroupements sont nettement plus reconnus dans leur travail qu'ils ne l'étaient dix ans auparavant. Et en un sens, ils trouvent leur compte dans cette formalisation car les liens institutionnels plus étroits développés rejoignent des revendications historiques portant sur une véritable reconnaissance du communautaire. En quelque sorte, si l'autonomie est un enjeu, les groupes familles cherchent à la faire reconnaître et les groupes jeunes à la conserver.
Malgré que la formalisation les touche à des degrés différents, les intervenants chercheurs sont pris avec le même paradoxe. D'un côté, la plupart des cochercheurs n'aspirent nullement à retourner en arrière au plan organisationnel, logistique et c'est tout particulièrement le cas des intervenants jeunesse. L'ensemble des intervenants assis autour de la table, et les groupes pour lesquels ils travaillent, ont une capacité d'action, une manière de faire qui en font des acteurs qui comptent. Bien que ce sentiment soit nettement plus fort dans le groupe Jeunesse, il traverse aussi les groupes familles. Beaucoup de ces derniers disposent d'une longue expérience dans leur domaine, expérience qui leur confère une expertise qui est souvent recherchée par le réseau.
En même temps, cette relative formalisation, variable d'un groupe à l'autre et d'une personne à l'autre, ne les satisfait pas pleinement. ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose au change. C'est d'autant plus évident dans le groupe des cochercheurs issus des groupes Jeunesse, le secteur le plus formalisé. C'est en prenant conscience de cette formalisation que certains se réfèrent à la mémoire du mouvement, au vrai communautaire, à un communautaire fier de ses racines. Un appel qui plonge dans l'époque où les rapports conflictuels avec l'État étaient à l'ordre du jour, où le mouvement communautaire était plus revendicatif, plus collectif surtout. C'est à ce moment précis de la démarche, vers la fin du processus, que la critique d'un milieu communautaire potentiellement promu à sous-succursale de CLSC se fait la plus virulente.
En bout de ligne, un consensus se dégage chez nos cochercheurs des deux groupes : l'autonomie apparaît devoir passer aussi par cette voie, qui en appelle aux fondements mêmes du mouvement, bien loin d'une pratique qui ne se réduirait qu'au service, que les partenaires du réseau voudraient de toutes manières toujours un peu plus professionnaliser. Cette brèche par rapport à la logique dominante, il est toutefois important de se demander si elle ne se refermera pas lorsqu'elle se frottera aux contraintes entourant le financement présent et futur.
Conclusion
Le lecteur prendra note que la conclusion est entièrement le produit des chercheurs proposeurs. En ce sens, i1 se peut qu'elle recoupe certains passages du chapitre précédent, qui était, lui, le produit de la démarche des groupes. Ce sont des chapitres construits à des moments distincts de la démarche. En fait la conclusion s'avère pour nous l'occasion idéale de boucler la boucle, tout en ouvrant sur des voles qui nous semblent au coeur des enjeux sociaux de l'heure. À noter que certaines de nos propositions doivent être vues, et lues, comme des pistes, des ouvertures, des possibles à évaluer avec et entre les acteurs concernés. Si pour certains elles peuvent parfois avoir un petit côté provocant, elles ne doivent surtout pas être comprises comme étant pour nous vérité absolue. Cela nous condamnerait à un débat stérile se réduisant à identifier les bons et les méchants. En fait, à nos yeux, le seul débat qui compte vraiment, c'est celui nécessaire et urgent sur la nature même de la démocratie en cette fin de siècle.
Les chapitres 2 et 3 nous ont permis de saisir en quoi les pratiques du mouvement communautaire se transforment dans la présente conjoncture. S'il y a effectivement formalisation, des questions de fond ressortent et renvoient à la nature même de l'intervention des groupes communautaires telle que présentée de manière plus détaillée à la section 2.6. Ces pratiques autonomes sont-elles en péril? Quelles sont les conditions minimales qui permettront d'assurer la permanence de ces pratiques fondées sur des valeurs différentes de celles du réseau étatique? Pourrat-on encore longtemps assurer la survie et pourquoi pas le développement de pratiques dont les balises seraient posées, non pas par les seules contraintes extérieures, telles les exigences des bailleurs de fonds, mais essentiellement par les liens organiquement tissés et entretenus avec leur milieu et les membres qui le milieu?
Certains volets des résultats de cette recherche donnent un poids particulier à notre questionnement sur l'autonomie des groupes. Nous pensons en premier lieu à l'exercice même du partenariat avec les diverses instances régionales du Réseau de la santé et des services sociaux. La proposition supplémentaire issue de cette recherche (no 4), que nous développons dans le chapitre précédent, nous apparaît en elle-même périlleuse. Cette « articulation paradoxale » (Lamoureux, 1994) entre l'État et le communautaire, porte sa part de risques quant à la survie de l'autonomie des groupes. Car cette formalisation du communautaire, qui devrait aller de pair avec une « déformalisation » de l'État, ce qui reste à démontrer, sous-tend un certain nombre d'attributs sans lesquels un tel partenariat n'a pas de sens.
Ainsi, comme le souligne Claude Nélisse, « la négociation intermédiaire contraint chacun des partenaires engagés à valoriser sa spécificité, à faire accepter et à rendre acceptables ses activités, à justifier ses projets selon une définition du bien commun » (Nélisse. 1994 : 184). En bout de route, la démarche de partenariat doit aboutir à une véritable mise en commun où « il faudra convenir d'instruments de mesure standardisés, veiller à la convergence des orientations, stabiliser les référents normatifs, les ajuster aux codes et catégories de classement, convenir des conditions de passage à l'action, évaluer et officialiser des résultats » (ibid :185).
À la lumière de cette recherche, et bien que nous n'ayons pas ici tenté d'évaluer le partenariat tel qu'il s'est développé régionalement, l'expérience montréalaise nous apparaît jusqu'ici fort peu correspondre aux qualités d'un véritable partenariat. En fait, la question même du réalisme d'une telle approche se pose ici. La formalisation du communautaire semble bien peu peser dans la balance des rapports de force locaux. En fait, Jusqu'ici c'est la domination du plus gros qui se fait le plus sentir, en dehors d'un véritable consensus. Comme le rappelle alors Nélisse, comment peut-on dans un tel cadre éviter « les fusions, les instrumentalisations ou les dominations toujours possibles des uns par les autres? » (ibid).
La question de l'autonomie du communautaire se pose aussi avec beaucoup d'acuité tout particulièrement lorsque l'on se penche sur la spécialisation et la professionnalisation qui gagne déjà la vie de nombreux groupes. Coincés par la complexité grandissante de rapports sociaux qui engendrent le développement d'expertises particulières, de plus en plus d'organismes sont amenés à repenser leurs modes de gestion, accentuant la « formalisation » du réseau communautaire. Pour nous, poussée au-delà d'une certaine limite, cette tendance pourrait avoir des effets désastreux sur les pratiques « alternatives » des groupes communautaires.
Dans ce cadre, toute une série d'interrogations touche au rapport entretenu soit avec la communauté desservie, soit à l'intérieur même du mouvement communautaire. Pour les rapports entretenus avec les citoyens et la communauté qui bénéficient de l'intervention de l'organisme, nous sommes en droit de nous questionner sur la place réelle dévolue aux participants et aux membres : quel pouvoir effectif ont-ils présentement au sein des organismes fréquentés? La participation réelle des membres ne sera-t-elle pas de plus en plus difficile à assurer, faute pour ces derniers de ne pouvoir ne seraitce que « comprendre » ce qui se passe? Les membres deviendront-ils alors des « fardeaux », lourds mais nécessaires, qu'il faudra gérer au même titre que le reste des dossiers? Globalement, c'est en quelque sorte tout le regard que l'on porte sur l'« autre » qui pourrait changer et s'éloigner de ce lien plus organique qui qualifiait antérieurement les rapports humains au sein de bien des organismes communautaires.
Mais la formalisation inquiète aussi lorsque l'on se penche par exemple sur l'écart croissant entre les savoirs de travailleurs d'une même équipe, des savoirs qui correspondent à une division et à une spécialisation grandissante à l'intérieur même de l'intervention de nombreux organismes communautaires. Conséquemment, ne risque-t-on pas de se retrouver bientôt avec deux catégories de travailleurs : d'un côté ceux qui savent, les experts de la représentation qui siègent aux diverses tables de concertation ou aux multiples instances partenariales; et, de l'autre, ceux qui font, travaillant au quotidien avec la population et les membres? Un tel fossé pourrait aussi se créer entre les groupes eux-mêmes, au sein des tables de concertation, des coalitions et des divers regroupements. Ainsi, dans les groupes qui acceptent de représenter leur secteur, ne risque-t-on pas de voir l'écart se creuser entre les « experts politiques » et les groupes qu'ils mandatent pour les représenter? Un tel écart sépare parfois déjà les groupes à la base de leurs regroupements nationaux.
Dans ce tableau se dessine l'ébauche d'une fracture entre les différents secteurs dans les lieux de concertation intersectorielle. À titre d'exemple, les groupes des secteurs « à la mode », pensons à ceux touchés par les priorités régionales, qui sont appelés à prendre plus de place dans les lieux de représentation, ne risquent-ils pas de devenir des « super » groupes communautaires, dans les < vrais secteurs », ceux qui comptent aux yeux de la Régie? Ces écarts grandissants entre les groupes risquent à court terme de créer diverses tensions, entre les groupes d'un même secteur et même dans les instances intersectorielles. Dans ce contexte, comment les groupes vont-ils, entre eux, maintenir leur intégrité et leur cohésion? Ne risque-t-on pas de voir les solidarités inter-groupes s'effriter?
Bien sûr, certaines de ces interrogations renvoient à des enjeux qui ne sont pas nouveaux, au sens qu'ils traversent l'histoire du communautaire, qu'ils font échos à de multiples débats traditionnels, que ce soit dans le rapport lutte-service ou dans la dynamique de pouvoir entre les membres et les permanents. Mais la présente conjoncture nous semble aviver ces enjeux et poser avec plus de vigueur et d'acuité que jamais, l'autonomie de pratiques qui, paradoxalement, ont gagné récemment une reconnaissance longuement espérée.
Si les interrogations qui viennent d'être soulevées nous apparaissent traduire la présente réalité, il nous semble nécessaire d'affirmer haut et fort que tout n'est pas joué, que,considérant la complexification actuelle du social, aucun acteur n'est assuré de pouvoir gagner ou perdre la partie. De notre point de vue cependant, certaines conditions sont nécessaires pour que le mouvement communautaire, et, nous l'espérons, une partie importante des femmes et des hommes qu'il représente, ressortent en position de force de l'actuelle restructuration des rapports sociaux. Si certaines conditions extérieures au communautaire nous semblent incontournables, tel un financement stable et récurrent, il y en a une que nous jugeons essentielle et intrinsèque au mouvement luimême. Cette condition, c'est le «recentrage du mouvement communautaire sur une intervention vraiment communautaire, qui prenne en compte tant l'approche individuelle que collective, tant le service que la lutte ».
À la base de ce recentrage, il y a une vision du monde : la société dans laquelle nous vivons est structurée par des rapports sociaux qui traduisent des positions différentes dans la capacité d'orienter les finalités de cette société. Tous les acteurs sociaux collectivement constitués ne sont pas égaux dans cette conjoncture.
Or, historiquement, le mouvement communautaire québécois s'est fait le défenseur de communautés et de groupes sociaux appauvris et marginalisés. il est devenu un acteur non négligeable en ce qui a trait à la défense et à la promotion des droits sociaux. Nous pensons que dans la présente conjoncture, il est urgent, même si cela peut apparaître utopique, de rappeler l'importance de ce travail pour les plus démunis. Le premier contrat des organismes communautaires, c'est avec leurs membres et les communautés qu'ils représentent. il est impérieux pour les groupes d'accentuer leurs liens avec ceux et celles pour qui, et nous l'espérons, par qui ils existent.
Ainsi, traditionnellement, le mouvement communautaire se reconnaît et s'identifie par le développement de pratiques qui privilégient l'éducation populaire, la conscientisation et « l'empowerment » individuel et collectif (Ninacs, 1995). Bien que de plus en plus présente, cette tradition est ébranlée par l'actuelle restructuration des rapports sociaux qui favorise le développement du service. Dans ce contexte, cette tendance dominante du service renforce les risques d'une prise en charge individuelle des problèmes sociaux. Or. l'individualisation des pratiques se fait au détriment d'une approche globale qui devrait par définition s'ouvrir sur l'action collective, une action portée par la recherche d'une plus grande justice sociale. Comme le soulignait la Table des regroupements au moment de la mise en place de la réforme, les groupes communautaires « refusent d'être seulement des distributeurs de "band-aid" si rentables et soulageants soientils > (Table des regroupements, 1993 : 178). En fait le « travail d'éducation et de mobilisation doit être pris en compte et soutenu, autant que le service, et même le service doit être vu comme porteur de changements individuels et collectifs » (ibid).
En quelque sorte, l'approche globale des groupes dépasse la réponse aux besoins d'un individu pris isolément. Promouvoir une approche globale, c'est aussi mener la lutte contre l'oppression des femmes et des hommes, tant au niveau du milieu de vie immédiat, qu'aux niveaux politique, économique, culturel ou social. Car, l'« empowerment » de l'un passe par l'« empowerment » d'un plus grand nombre, même si le premier travail d'un groupe donné dans un quartier, c'est d'offrir gîte et couvert aux personnes en détresse ou aux familles sans le sou. En ce sens, l'appel des cochercheurs en faveur d'une vitalité communautaire qui s'enracine dans une histoire de luttes pour une société meilleure nous apparaît être le signe d'un certain ras le bol de femmes et d'hommes qui, sans être les parents pauvres du communautaire, appréhendent les limites de la concertation tout azimut.
Un tel recentrage sur le collectif devient nécessaire aussi parce qu'il permet au communautaire de se repositionner dans le débat sur l'économie sociale. il ne s'agit pas ici de remettre en cause les éventuels « bienfaits » de cette économie. De toutes manières, les groupes demeurent, qu'ils le veuillent ou non, des participants de cette économie ni privée ni étatique. il s'agit surtout de se recentrer sur une notion première qui dépasse largement l'économie sociale : l'action collective. ici, les groupes ne sontpas que des employeurs et des producteurs de services, dussentils être participatifs et traversés par le principe de réciprocité. Les groupes communautaires sont aussi là pour lutter au corps à corps contre des forces de plus en plus lourdes qui tendent à exclure des pans entiers de la société.
En fait, le recentrage fait appel à tous les niveaux d'intervention. En ce sens, il situe le communautaire ailleurs, au-delà d'une simple pratique de service. Nous pensons que le communautaire doit renouer avec ses traditions d'action sociale et d'éducation populaire, avec des approches qui laissent place à la défense de droits, à la promotion de collectivités, ce que reconnaît paradoxalement la Loi sur la santé et les services sociaux (art. 256.2). L'action collective, dans tout ce qu'elle comprend d'appel aux droits, à la solidarité, nous semble sortir de toute logique comptable, de toute velléité de faire triompher l'économie, de quelque nature qu'elle soit. ici, encore une fois, apparaît l'approche globale au sens d'une approche qui dépasse le service, mais qui dépasse aussi le localisme dans lequel trop souvent l'on vise à enfermer les pratiques communautaires.
À notre point de vue, les groupes communautaires en santé et services sociaux doivent rechercher à se maintenir dans ce que nous appellerons une zone de tension créatrice, une zone qui reconnaît à la fois que les groupes sont, en moyenne, plus formalisés qu*il y a une décennie ou plus et que cette formalisation du communautaire est inéluctable; toutefois, les groupes doivent tendre à conserver un degré relatif de « déformalisation » afin de maintenir ce qui les qualifie dans la forme comme dans le contenu de différents, alternatifs, novateurs par rapport à une structure trop formalisée. De même, il nous apparaît nécessaire de reconnaître une tension entre les services et les luttes. Les services restent souvent la porte d'entrée pour une portion importante des gens rejoints. Les groupes en santé et services sociaux travaillent souvent au «ras du sol » et il est difficile de les imaginer sans services de qualité. Cependant, la promotion des besoins et des droits des femmes et des hommes qu'ils desservent ne peut s'arrêter à ce travail quotidien. Ce dernier point d'ancrage doit s'ouvrir sur des enjeux plus larges, souvent la cause des problèmes vécus individuellement. Le pôle de lutte rappelle au communautaire qu'il est d'abord là pour travailler à transformer la société afin de la rendre plus juste et équitable.
Conséquemment, il nous semble impératif de développer des mécanismes et des mesures pour permettre aux groupes de faire perdurer et même de bonifier les pratiques spécifiquement développées avec le temps, qui sont par ailleurs leur raison d'être. Sinon, il existe un véritable danger que les groupes deviennent peu à peu des boîtes de services sans aucune perspective de changements structurels. Des boîtes qui malheureusement seraient, sans le vouloir, des promoteurs d'une intégration minimale.
En ce sens, dans la conjoncture, quelles sont les conditions qui permettraient d'assurer non seulement la survie mais bien l'intensification du travail des groupes communautaires? De notre point de vue, il faut premièrement permettre aux groupes de souffler, de respirer, en quelque sorte de prendre ou reprendre le contrôle de leur agenda. Notre recherche fait état du travail de femmes et d'hommes qui sont continuellement à la course, souvent à bout de souffle face à la demande tant des citoyens que des partenaires étatiques. Dans ce contexte, 11 est difficile de faire autrement que de réagir. il nous apparaît urgent que les groupes puissent fonctionner dans une perspective plus constructive, offensive même, donc dans un cadre où les groupes sont plus maîtres de leur devenir. En ce sens, ils doivent donc dégager du temps pour réfléchir, innover, développer leurs projets, sur leurs propres bases, seuls et avec d'autres.
Deuxièmement, nous pensons qu'il faut réaffirmer la place et l'importance des regroupements nationaux. À l'heure du démantèlement de l'État providence, il nous semble plus nécessaire que Jamais que le communautaire puisse s'appuyer sur des structures nationales, et ce pour de nombreuses raisons. D'abord parce que ce sont ces structures qui peuvent le plus facilement forcer l'État à assurer des normes nationales en ce qui a trait à l'application des politiques québécoises. Ensuite, les regroupements doivent conserver leur importance parce qu'une bonne proportion du mouvement communautaire québécois rejoint ceux et celles qu'il est en mesure d'aider soit sur des bases identitaires ou affinitaires, soit en fonction de problématiques particulières.
Que ce soit sur des questions touchant les femmes, la violence, la santé mentale, l'hébergement, nous sommes au coeur de pratiques qui ont en commun de toucher à des besoins essentiels et à des droits fondamentaux, et ce, partout sur le territoire du Québec. Le besoin de pouvoir se regrouper semble d'ailleurs prioritaire pour plusieurs, comme l'illustre dans cette recherche l'exemple des groupes familles. En fait, les regroupements nationaux sont là pour éviter que des disparités régionales ne viennent altérer soit la survie de pratiques locales, soit des aspects particuliers de ces pratiques. À l'heure où certains ne jurent que par le localisme des pratiques, nous pensons que si le local a un sens, il prend d'abord sa force dans la capacité qu'ont les instances nationales d'alimenter les groupes de base tant sur les questions de contenu ou d'orientation que sur les stratégies et moyens d'action à mettre de l'avant pour défendre l'intérêt de l'ensemble des citoyens du Québec rejoints par ces organismes.
Troisièmement, pour ce faire, il est impérieux de s'assurer que les liens organiques avec les groupes locaux et les régions ne soient pas diminués par les exigences d'une expertise particulière commandée par des structures plus nationales de partenariat avec l'État. En clair, et comme nous l'avons vu dans cette recherche, il faut éviter que des pratiques particulières, qu'elles soient nationales ou locales, éloignent de manière irrémédiable des intervenants de diverses instances, tout simplement parce que le travail des uns devient incompatible avec celui des autres ou méconnu d'eux. Si cela peut survenir à l'intérieur même d'un organisme, à plus forte raison cela peut se développer à l'intérieur d'un grand regroupement. Le contexte actuel peut, faute de disponibilité et d'énergie, alimenter des relations dominées par un certain utilitarisme mutuel. Or, ce genre d'utilitarisme nous apparaît à tout le moins néfaste pour l'avenir du mouvement communautaire.
Enfin quatrièmement, il nous faut souligner en terminant la place incontournable qu'occupent désormais les formes régionales de regroupement. En acceptant le pari de la régionalisation, le mouvement communautaire et ses quelque trente regroupements nationaux fait d'office une place inévitable à un nouveau pouvoir en son sein même : les instances régionales. Bien sûr, l'articulation des rapports entre un groupe donné, les formes locales de concertation, la structure régionale de regroupement et enfin son regroupement national, reste à être « travaillée » par toutes les instances concernées. En fait, seule la bonne volonté de chacun, au-delà des querelles de clocher et des luttes de pouvoir, permettra au communautaire d'assumer avec plus de vitalité que jamais les défis qui s'imposent au tournant de l'an 2000.
Références
Comité ministériel sur l'évaluation (1995), L'évaluation des organismes communautaires et bénévoles, 97.
Corbin, J. (1986), « Coding, Writing Memos, and Diagramming », in W. Carol Chenitz et Janis M. Swanson (Eds.), From Practice to Grounded Theory : Qualitative Research in Nursing, Ca. : Addison-Wesley.
Finn, J. L. (1994), « The Promise of Participatory Research », Journal of Progressive Human Services, vol. 5 (2), 25-42.
Founder, D. et Gagnon, L. (1991), « L'organisation communautaire avec des femmes ». dans Théorie et pratiques en organisation communautaire, sous la direction de L. Doucet et L. Favreau, Sainte-Foy. Presses de l'université du Québec, 293-305.
Gagné, J. et Dorvil, H. (1994), « Le défi du partenariat, les cas des ressources communautaires dans le secteur de la santé mentale », Nouvelles pratiques sociales, vol. 7 no 1, 63-78.
Guba, E.G.. et Lincoln, Y.8. (1985), Naturalistic inquiry, Beverly Hills, Sage publications, 416 p.
Guba, E.G.. et Lincoln, Y.S. (1989), Fourth Generation Evaluation, Newbury Park, Sage publications, 294 p.
Guberman, N., Founder, D. Belleau, J., Beeman, J et Grevais, L, (1994), « Des questions sur la culture organisationnelle des organismes communautaires », Nouvelles pratiques sociales, vol. 7 no 1, 45-62.
Guberman, N., Founder, D., Beeman, J., Gervais, L. et Lamoureux, J. (1997), Innovation et contraintes, Montréal, Centre de formation populaire et Relais femme, 76 p.
Huberman, A.M. et Miles, M.B. (1991), Analyse des données qualitatives, Bruxelles, De Boeck Université, 480 p.
Lamoureux, H., Lavoie, J., Mayer, R.. et Panet-Raymond, J. (1996), La pratique de l'action communautaire, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 436 p.
Lamoureux, J. (1994), Le partenariat à l'épreuve, Montréal, Boréal, 213 p.
Nélisse, C. (1994), • La croisée du formel et de l'informel : entre l'État et les partenariats », Lien social et politique-RIAC no 32, 179187.
Ninacs, W. (1995), « Empowerment et service social : approches et enjeux ». Service social, vol. 44. no 1. 69-93.
Panet-Raymond, J. (1994), « Les nouveaux rapports entre l'État et les organismes communautaires à l'ombre de la Loi 120 », Nouvelles pratiques sociales, vol. 7 no 1, 79-93.
Park, P., Brydon-Miller, M. Hall, B. et Jackson, T.eds. (1993). « Voices of change. Participatory Research in the United States and Canada », 230 p.
Parazelli, M (1992), « La productique sociale, un point de vue communautaire sur les risques sociaux du chapitre 42 des lois du Québec (120) », Service social, vol. 41, no 1, 129-141.
Patton, M.Q. (1990), «Qualitative Evaluation and Research Methods », Newbury Park. Sage publications, 532 p.
Reason, P. éd. (1988), « Human inquiry in Action », London, Sage publications, 242 p.
Reason.P. éd. (1994 a), « Participation in Human inquiry », London, Sage Publications, 220 p.
Reason, P. (1994 b), « Co-operative inquiry, participatory action research and action inquiry : three approaches to participate inquiry », in N.K.Denzin and Y.S.Lincoln(eds), Handbook of Qualitative Research, Newbury Park, CA, Sage Publications.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (1994). * Priorités régionales 1994-1997; 21 p.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre (1995), « L'Organisation des services de santé et des services sociaux sur l'île de Montréal vers un nouvel équilibre », 114 p.
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (1994 a), « Un réseau au service de ses communautés », mémoire déposé à la Régionale de MontréalCentre dans le cadre de la consultation sur les priorités régionales 1994-1997, 20 p.
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (1994 b), « Plate-forme de revendications communes », 16 p.
Montreal (1095 a), « Nouvel équilibre à définir », mémoire présenté dans le cadre de la consultation sur l'organisation des services de santé et des services sociaux sur l'île de Montréal, 19 p.
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montreal (1995 b)» « Et si on pariait de santé et de bienêtre », mémoire présenté à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre dans le cadre des audiences publiques en juin 1995.
René, J.F. (1991), « L'organisation communautaire avec des jeunes », dans Théorie et pratiques en organisation communautaire, sous la direction de L. Doucet et L. Favreau, Sainte-Foy, Presses de l'université du Québec, 275-291.
Strauss, A. et Corbin, J. (1991), « Basics of qualitative research », Newbury Park, Sage publications.
Table des regroupements d'organismes communautaires et bénévoles (1993), « Une analyse critique de la Politique de la Santé et du Bien-Être », Nouvelles pratiques sociales, vol. 6 no 2, 169178.
Table des regroupements d'organismes communautaires et bénévoles (1995), «Les épreuves et les défis du partenariat », 50 p.
Vaillancourt, Y. (1994), « Éléments de problématique concernant l'arrimage entre le communautaire et le secteur public dans le domaine de la santé et des services sociaux », Nouvelles pratiques sociales, vol. 7 no 2, 227-248.
White, D., Mercier, C, Dorvil H., et Juteau, L. (1992), « Les pratiques de concertation en santé mentale : trois modèles », Nouvelles pratiques sociales, vol. 5 no 1, 77-93.
White. D. (1994), « La gestion de l'exclusion », Lien social et politique - RIAC, no 32. 37-51.
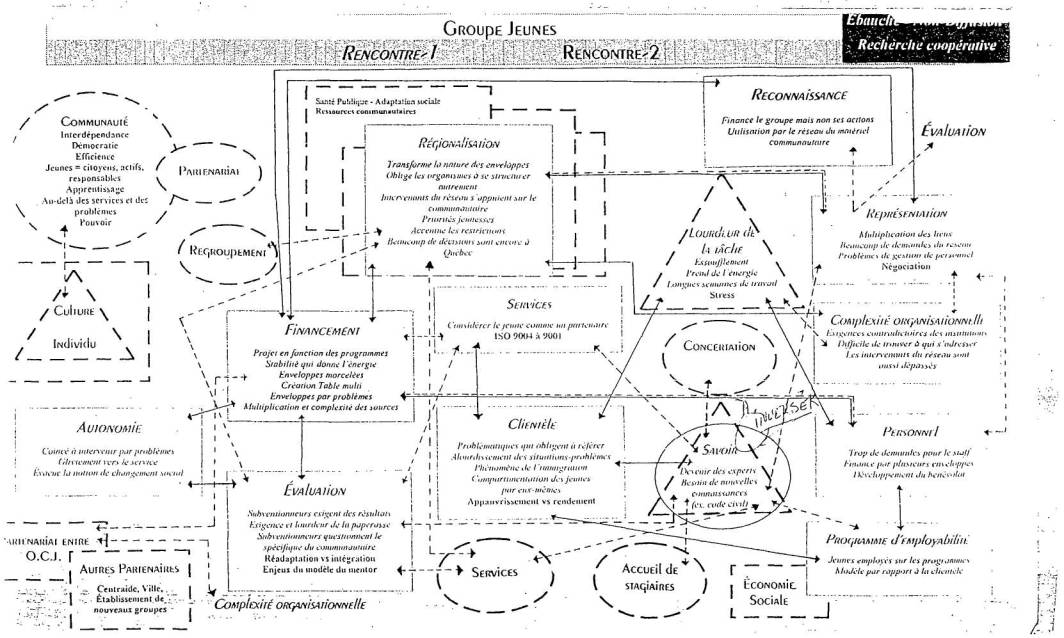
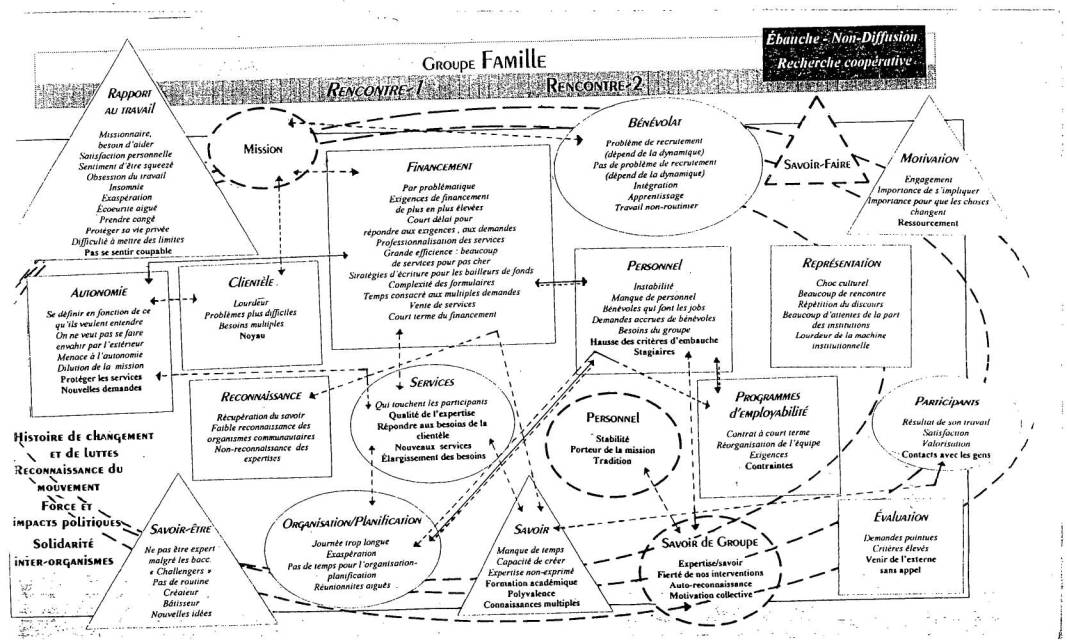
Explication des sigles