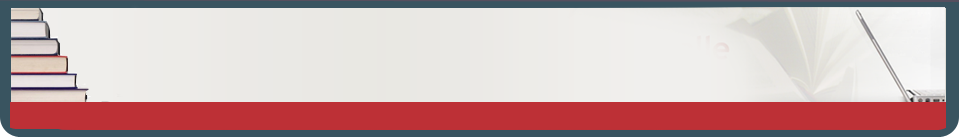Les instruments de lutte des travailleurs : guide d'évaluation (militants syndicaux) : guide d'évaluation
Introduction
Voici un guide d'évaluation de nos actions qui a pour but de nous aider à voir plus clair dans la réalité de notre milieu de travail et de nous aider à poursuivre des luttes concrètes dans le sens des intérêts des travailleurs. Remarquons que le mot "lutte" est pris dans un sens très large qui n'inclut pas seulement des grandes actions telles grèves, ralentissement de la production ou manifestations mais aussi la lutte quotidienne de militants pour une meilleure convention collective, pour les griefs déposés par les travailleurs, pour des mesures de sécurité dans son usine etc.. Au fond, il y a toujours des luttes-petites ou grandes, peu visibles ou évidentes entre travailleurs et patrons. Dans le cas où les luttes sont faibles ou peu avancées, ce guide pourra servir davantage à analyser son syndicat local et àvoir comment il peut devenir un outil de lutte des travailleurs1 Dans le cas où les luttes sont plus fortes, ce guide aidera àmieux découvrir les erreurs et les bons coups de ses luttes passées et à préparer des luttes plus correctes pour l'avenir.
Les questions de ce guide devront aider à préciser les obstacles et les conditions d'une vie syndicale plus dynamique. En gros, ces "obstacles et conditions concernent les 3 aspects suivants :
- les objectifs de nos revendications et luttes sont-ils clairs pour les travailleurs ?
- avons-nous uns stratégie qui nous aide à voir concrètement le rapport de force entre travailleurs et patrons dans notre milieu de travail ?
- nos moyens de luttes sont-ils adéquats ?
A la fin de l'évaluation, on pourra voir que nos faiblesses concernent plus tel ou tel aspect; par exemple, dans le cas où notre faiblesse principale porterait sur les objectifs, il faudrait peut-être stimuler des discussions et un groupe d'étude et de travail (get); dans le cas où la faiblesse serait la stratégie, il faudrait peut-être entreprendre une opération "connaissance de son milieu" (ou une enquête) qui permettrait de mieux connaître la force de son patron et les groupes de travailleurs les plus combatifs dans son syndicat.
N.B. Etant donné qu'aux sessions de formation syndicale du CFP., plusieurs travailleurs viennent de la fonction publique, nous avons précisé entre parenthèses des questions spécifiques à ce groupe de travailleurs et à leur lutte récente de mai 1972.
A) Objectifs de lutte
- Qui a le plus contribué à définir les objectifs de notre lutte? (Dans le cas du Front Commun: les objectifs de la négociation étaient-ils conformes aux problèmes rencontrés par les syndiqués de notre milieu de travail?)
- Quels étaient les objectifs de notre lutte?
- les travailleurs et les plus militants de notre syndicat avaient-ils des idées claires à ce sujet et partageaient-ils ces objectifs? (Les objectifs du Front Commun étaient-ils compris et acceptés par les travailleurs de notre syndicat? Préciser)
- Avons-nous entrepris au début ou au cours de notre lutte des enquêtes, analyses nous permettant de mieux identifier les causes de nos problèmes et les responsables? (Exemples: de qui attendions-nous des appuis? de qui attendions-nous des attaques ou même des menaces?)
- Les objectifs de notre lutte, tels que compris par les travailleurs de notre syndicat, ont-ils changé du début à la fin de la lutte? (Dans les moments difficiles, les travailleurs tendaient-ils àlaisser tomber certains objectifs? De nouveaux objectifs sont-ils apparus au cœurs de la lutte? )
B) Stratégie de lutte
- Tenant compte de nos luttes passées et actuelles, comment évaluons nous, en nombre et en qualité (a) les travailleurs militants les plus actifs et conscients dans notre syndicat (ils viennent de quels départements, ils ont quelles occupations etc..) (b) les travailleurs sympathiques à nos objectifs de lutte mais peu ou moyennement actifs en pratique.(c) les travailleurs apathiques, indifférents ou même opposés à nos objectifs de lutte (ils viennent de quels départements, occupations etc..)
- On se retrouvent dans le syndicat les travailleurs les plus militants: dans l'exécutif, au journal, dans un comité, ailleurs etc... ?
- Existent-ils des liens solides ou faibles -par journal, assemblée etc..- entre les plus militants de notre syndicat et l'ensemble des travailleurs? (Dans le cas du Front Commun, la structure d'information reposait-elle sur les plus militants et rejoignait-elle la majorité des travailleurs?)
- Dans notre lutte, d'autres groupes de travailleurs ont-ils soutenus ou se sont-ils alliés à nous? Si oui, ces alliés venaient de quelles classes sociales et ils représentaient les intérêts de quelles classes sociales (Voir tableau en annexe 1)
- Y a-t-il dans notre milieu de travail des individus, groupes, organismes qui se sont opposés à nos objectifs au cours de la bataille? Si oui, qui sont-ils et les intérêts de quelle classe sociale défendent-ils? ( En s'opposant au Front Commun, l'État Québécois servait surtout quels intérêts?)
- Avions-nous un plan de lutte, c'est-à-dire différentes é tapes prévues qui permettaient d'agir ou do réagir de façon soutenu (et non pas spontanément) et d'entrevoir une victoire sur notre adversaire?
- Pour l'avenir, entrevoyons-nous la préparation et le plan d'une lutte? Une lutte sur quoi surtout?
C) Méthodes de lutte
1.
- Quels sont les principaux moyens (nombre de personnes, journal, local, etc) dont nous avons disposé au cours de notre lutte? Quels sont-ils aujourd'hui?
- Quels étaient les moyens des groupes qui étaient opposés à nos objectifs? (Dans le cas du Front Commun, quels étaient les moyens, ressources dont pouvaient disposer le gouvernement? Quels sont ceux qu'il a utilisés en fait?) Quels sont-ils aujourd'hui?
2.
- Dans notre syndicat, y avait-il au cours de la lutte des "poteaux", des comités de grèves, des structures concrètes qui permettaient des communications et des discussions entre la base et la direction? Quel a été le rôle du permanent syndical? Qu'en est-il aujourd'hui?
- Quel appui ou aide avons-nous reçu de notre Fédération, du Conseil Central, de la CSN? Comment avons-nous vu le rôle de ces organes syndicaux? Comment, à notre avis devrait-il se faire dans l'avenir?
3.
- Quelles sont les principales leçons que nous avons tiré de cette lutte? Des succès? Des erreurs (Dans le cas du Front Commun, considérons-nous cette bataille comme une victoire ou un échec pour les travailleurs?)
- pour l'avenir, quelle sorte de luttes (avec quels objectifs, quelle stratégie, quels moyens) croyons-nous nécessaire et possible de mener dans notre milieu?
Annexe : Schéma des classes sociales (en société capitaliste)
La société capitaliste est composée de deux classes fondamentales, les capitalistes et les travailleurs, dont les intérêts sont tout à fait opposés. Les intérêts des classes intermédiaires balancent ou oscillent, selon les circonstances, entre ces deux classes fondamentales.
I) Travailleurs ( ou prolétariat)
- classe ouvrière; travailleurs de la production et des transport (exemple: un machiniste, un menuisier, un débardeur)
- Autres travailleurs (autres classes laborieuses) travailleurs dans les secteurs commerciaux, financiers et des services (ou des appareils d'Etat) (ex: une vendeuse, un commis de banque, une femme de ménage dans un hôpital)
II) classes intermédiaires (ou petites bourgeoisies)
- cadres et professionnels salariés (ou nouvelle petite bourgeoisie) (ex: contremaître et ingénieurs à l'usine, gérant des ventes, professeur d'université, journaliste, policier)
- petite bourgeoisie: ils possèdent leurs propres moyens de travail et ne sont pas salariés. (ex: avocats à leur compte, épiciers, cordonniers)
III) Capitaliste (ou bourgeoisie)
Les propriétaires d'usines, de commerces, de banques; et leurs représentants politiques dans l'Etat capitaliste et les appareils de cet Etat ( ce sont les hommes politiques au pouvoir et les hauts fonctionnaires) .
1 Ce qui, en pratique, voudrait dire insister plus sur les parties B et C du guide.