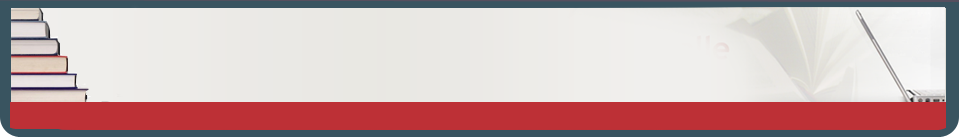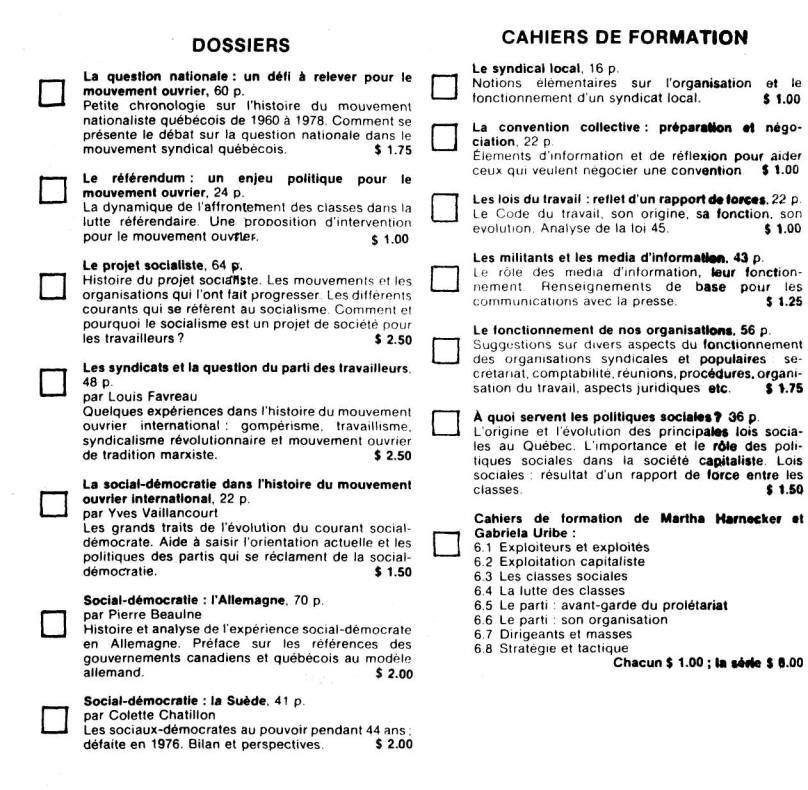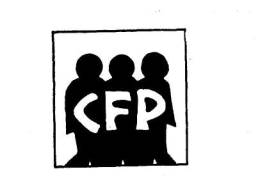Le syndicalisme aujour'hui : réflexion et témoignages de militants, juin 1981
Dépôt légal: deuxième trimestre 81 Bibliothèque Nationale du Québec
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés.
TABLE DES MATIÈRES
LE SYNDICALISME AU QUEBEC AUJOURD'HUI
LE COMITE "MOUVEMENT SYNDICAL" AU CFP
CHAPITRE 1 : TEMOIGNAGES DE MILITANTS
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE GRANDE ENTREPRISE METALLURGIQUE: UN SYNDICAT METALLO DE LA FTQ
LA LUTTE SYNDICALE DANS UN HOPITAL: UN SYNDICAT DE LA FEDERATION DES AFFAIRES
LA LUTTE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT: UN SYNDICAT CEQ
LA LUTTE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT: UNE GREVE LOCALE D'UN SYNDICAT CEQ
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE TEXTILE: DE L'UNION INTERNATIONALE A LA FTQ
CHAPITRE II : DES LUTTES QUI QUESTIONNENT LES PRATIQUES SYNDICALES ET LE SYNDICALISME LUI-MEME
I- LES PRATIQUES SYNDICALES A LA BASE
II- LE SYNDICAT LOCAL ET SON APPARTENANCE A UNE ORGANISATION SYNDICALE REGIONALE ET NATIONALE
III- L'UNITE INTER-SYNDICALE: MYTHE OU REALITE?
IV- SITUATIONS ET PRATIQUES SYNDICALES DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DANS LE SECTEUR PRIVE
V- QUELQUES ENJEUX ACTUELS DU MOUVEMENT SYNDICAL QUEBECOIS
CHAPITRE III : LES SYNDICATS EN 1981: OU EN SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS?
I- LES LUTTES SYNDICALES A LA BASE DANS LES ANNEES '70
II- LE QUEBEC DES ANNEES '70: LE MOUVEMENT SYNDICAL A L'OFFENSIVE
III- LA FIN DES ANNEES '70: LE MOUVEMENT SYNDICAL SUR LA DEFENSIVE
IV- LES ANNEES '80: LE MOUVEMENT SYNDICAL FACE A LA CRISE
V- QUESTION NATIONALE ET PROJET DE SOCIETE
LE SYNDICALISME FACE A LA CRISE: REDEVENIR UNE FORCE DE PROPOSITION
BIBLIOGRAPHIE SUR LE SYNDICALISME
ANNEXE : GRILLE DE TRAVAIL SUR LE SYNDICALISME
INTRODUCTION
LE SYNDICALISME AU QUEBEC AUJOURD'HUI
Les défis et les enjeux posés au mouvement syndical québécois en 1980 sont nombreux. Songeons un instant à l'ensemble des problèmes nouveaux qui nous sont imposés par la crise du capitalisme et auxquels nous devons maintenant nous confronter presque quotidiennement dans nos organisations: chômage, fermetures d'usines, nouvelles formes d'organisation du travail (sous-traitance, travail à temps partiel...). Bref, ce que nous vivions, il y a tout juste quelques années comme des phénomènes isolés nous apparaît de plus en plus comme étant les résultats concrets de la stratégie patronale pour sortir de la crise.
Faire cette constatation, c'est déjà y voir plus clair, mais cela suppose encore que le mouvement syndical puisse aller au-delà de ses positions défensives afin de proposer et d'imposer lui-même, en lien avec l'ensemble des composantes du mouvement ouvrier et populaire, ses propres solutions.
A plus d'une reprise dans son histoire, le mouvement syndical, grâce aux luttes qu'il a menées, a su infléchir dans le sens des intérêts de la classe ouvrière, les solutions que voulaient nous imposer les capitalistes.
C'est donc aujourd'hui que le mouvement syndical doit s'interroger, organiser les débats nécessaires, proposer des solutions concrètes pour faire en sorte de reprendre l'initiative du combat.
LE COMITE "MOUVEMENT SYNDICAL" AU CFP
Il y a trois ans, le Centre de formation populaire constituait un comité de travail sur le mouvement syndical. L'objectif de ce comité était de dégager les acquis et lesproblèmes des dix dernières années du mouvement syndical québécois et par la suite, de tenter de cerner les principaux enjeux pour les années à venir.
En effet, jusqu'à ce jour, peu de réflexions, de recherches sur les dix dernières années du mouvement syndical au Québec ont été entreprises. Pourtant, le contexte social, politique et économique de cette époque a permis que s'opèrent des changements importants dans le syndicalisme québécois: remise en question de nos pratiques syndicales pour rompre avec le syndicalisme d'affaire, radicalisation idéologique et rejet du capitalisme, nécessité pour les travailleurs de s'inscrire dans une démarche politique autonome, mobilisation autour de nouvelles revendications, etc.
Quels sont donc les véritables acquis de cette période? Quels en sont les limites et quels seront les principaux défis à relever pour les prochaines années? Ce sont ces questions auxquelles le comité de travail a tenté d'apporter un peu d'éclairage, pour alimenter les débats auprès des militants syndicaux.
L'ENQUETE
Tout au long de leur travail, les membres du comité on fait en sorte que l'ensemble de la démarche repose le plus possible sur les pratiques syndicales. Il était important de mesurer le degré d'enracinement des changements qui se sont opérés au cours des dix dernières années dans nos organisations.
C'est la raison pour laquelle nous avons cru bon, dans un premier temps, de donner la parole à des militants à l'occasion de tables-rondes.
L'enquête prévoyait organiser ce travail dans plusieurs régions du Québec. Pour diverses raisons liées à la conjoncture interne du mouvement syndical (faible disponibilité des militants du Front commun en particulier) et à cause des problèmes d'organisation et de communication, nous avons dû nous limiter à la région métropolitaine. Néanmoins, des contacts continus, surtout avec des militantsde Québec, nous ont permis d'aller plus avant dans notre recherche.
A Montréal, donc, une première rencontre eut lieu à l'automne '79, à" laquelle participèrent une dizaine de militants provenant des trois principales centrales syndicales (CSN-FTQ-CEQ). Il nous a été possible à ce moment-là, de faire un premier déblayage, à partirdes expériences syndicales de chacun des participants et ce, autour de trois questions principales:
- Qu'est-ce que vous avez essayé de changer dans vos pratiques syndicales, et pourquoi?
- Comment se sont opérés ces changements?
- Quels en sont les résultats?
Compte tenu du temps dont nous disposions et surtout du bagage qu'avaient à nous livrer ces militants à partir de leur expérience, nous avons alors convenu de nous revoir une seconde fois et de relancer la discussion sur les 4 thèmes principaux, identifiés collectivement:
- Le syndicalisme local et sa participation aux instances d'une centrale.
- La question de l'unité inter-syndicale.
- la situation et les pratiques syndicales dans les secteurs privéet public.
- Les enjeux actuels du mouvement syndical.
Malgré les difficultés rencontrées pour rassembler en un même temps et lieu des militantsdes trois centrales, nous pouvons affirmer que la démarche garde toute sa valeur. Ces rencontres, en plus d'êtrestimulantes pour les participants, ont été riches en échange sur le syndicalisme militant et sur la façon de le pratiquer. Cela a permis au comité d'accumuler du matériel de base important pour alimenter la suite de son travail.
Vous retrouverez donc au chapitre premier de ce document le compte-rendu de l'ensemble des témoignages recueillis au cours de cette enquête.
IDENTIFICATION DES PROBLEMES
A partir des exemples de luttes, le comité a re-soumis à la discussion les principaux problèmes que les militants eux-mêmes avaient pu identifier collectivement. Le deuxième chapitre renvoit donc essentiellement aux problèmes auxquels ont à s'affronter quotidiennement les militants à la base, dans la lutte qu'ils mènent contre les "boss" et aux efforts pour faire de leur syndicat un véritable instrument démocratique. Nous rendons compte de la réflexion de ces militants, tout en suggérant au passage des pistes de réflexions.
IDENTIFICATION DES DEFIS
Cette cueillette d'informations a incité le comité à pousser plus loinsa réflexion sur les enjeux du syndicalisme. Au chapitre III, à partir d'un court bilan sur les acquis et les difficultés rencontrées par le mouvement syndical durant la décennie '70, nous avons jeté en vrac les quelques réflexions sur ce qui nous semble être certains enjeux majeurs du mouvement syndical pour les années à venir.
Nous espérons que ce dernier chapitre puisse servir d'outil aux militants qui veulent inscrire leurs actions syndicales dans un projet plus large qui vise à transformer cette société.
Le comité :
René Doré, Irène Ellenberger,LouisFavreau, Camille Lacoste, Louis Maheu.
CHAPITRE 1 : TEMOIGNAGES DE MILITANTS
TABLE-RONDE SUR LE SYNDICALISME: DES EXEMPLES DE LUTTES SYNDICALES A LA BASE
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE ENTREPRISE DE MEUBLES: UN SYNDICAT QUI SE BAT CONTRE LES PATRONS ET CONTRE LA DIRECTION DE L'UNION INTERNATIONALE.
Affiliation à une union internationale.
Mon syndicat est une union internationale dans l'industrie du meuble avec "deux patrons" syndicaux fort importants: le premier aux Etats-Unis, le second, ici, au Québec. En ce moment, cette union regroupe, en 6 locaux, à peu près 4,300 membres au Québec; à Montréal, le local compte à peu près 1 ,400 membres répartis en 23 usines. L'exécutif de ce local contrôle les ressources financières pour Montréal, mais le Conseil provincial contrôle le gros de l'argent et des services.
Mon usine fait partie d'une multinationale; à Montréal, elle regroupe 400 ouvriers qui se sont syndiqués en 1967. J'ai été responsable du syndicat après avoir milité dans les groupes populaires.
Le syndicat, au niveau de mon usine, n'est pas très militant au moment où je m'y intéresse, soit au début des années soixante-dix. Le contrat de travail en vigueur ne permet pratiquement pas de lever aucun grief même si la situation des gars est très dure. Un contrat de travail signé en 1972 n'améliore pas les choses. Aussi, la vie syndicale à la base va s'organiser sur d'autres fronts: par exemple, les gars à la base s'entraident pour d'abord boycotter la cafétéria qui donnait un très mauvais service.
Préparation de la convention collective en consultation directe de la base.
De là, on est passé à la préparation du prochain contrat de travail. On a voulu procéder à la base même, dans les départements de l'usine, département par département. Les gars ont commencé à dire ce qui les ennuyait, les écoeurait. Sans support de l'exécutif régional de notre union, on a alors cherché des appuis, des ressources auprès d'organisateurs communautaires du quartier qui sont venus nous aider.
Mise sur pied de structures d'information et d'appui.
Arrivent les négociations. Là, on s'organise, à la base, nous-mêmes avec nos propres ressources: on s'est donné un journal, un fonds de défense professionnel organisé par nous-mêmes, des structures de support et d'appui à la négociation. Les négociations ont été longues: on est allé cherché un gros contrat avec une formule d'indexation des salaires et beaucoup d'améliorations. Notamment, on a pu organiser la vie syndicale à l'usine, en augmentant de beaucoup le nombre des délégués. Et les négociations ont été menées à la base par les gars eux-mêmes, assistés des organisateurs communautaires. Le permanent syndical a été tout à fait en dehors du coup. Et on a mêlé les gars à l'affaire: chacun a reçu une copie de la convention. Ça, ça a été une expérience stimulante: les gars ont beaucoup embarqué.
Démocratisation de la structure et du fonctionnement du syndicat local.
Ensuite, est venue la riposte patronale. Les autres négociations ont toutes été beaucoup plus dures et ont nécessité des grèves, de 5 à 7 semaines. On a perdu l'aspect le plusintéressant de notre clause d'indexation des salaires, par exemple. Ces grèves-là ont été menées sans beaucoup d'appui de l'exécutif provincial: on nous a même coupé les fonds du fonds de grève. On a dû, au-dessus de l'exécutifprovincial, s'adresser 3 l'exécutif international pour faireréouvrir le fonds. D'autant plus qu'il y avait 3 usines en grève en même temps. Il a falluqu'on aille là où était le pouvoir syndical.
Refus d'appui des structures syndicales.
L'action même à la base dans notre usine a stimulé le local régional syndical: l'action syndicale dans d'autres usines est devenue plus active et militante. Les gars se sont mis à vouloir faire comme nous et à aller chercher de meilleures conditions de travail. Et nous, on a pris plus de responsabilités à l'exécutif régional qui couvre les 23 usines. 1 J'en ai été le président. A partir de là, la bataille a été interne au syndicat. C'était une union traditionnelle, peu militante, qui a été réveillée par notre action qui a fait tache d'huile. La bataille dans le syndicat a été aussi très dure.
Implication au niveau régional.
Qu'est-ce que j'en retiens, moi, de ces luttes-là?
- Quelle que soit la centrale syndicale, le syndicat, ça se construit à la base, même si dans l'usine, par moment, la situation est très dure. Les mises à pied, les fermetures de départements affaiblissent un syndicat; mais malgré tout cela, c'est a la base que le syndicalisme se construit. La force, elle, est en bas, même si pour la mobiliser il y a de graves problèmes: par exemple, les nombreux délais créés par les arbitrages qui démobilisent, les grèves qui sont très dures, .. .
Rapport privé-public.
- Le problème du rapport entre le secteur privé et le secteur public demeure très réel. Dans le privé, on est face aux employeurs capitalistes, même face aux multinationales; de sorte que les conditions de travail sont sauvages. Le patronat international c'est les géants du système: on est petit face à eux. Qui et comment mobiliser face à ces forces-là?
Peu importe les centrales syndicales concernées et sans vouloir donner dans le jeu de Parizeau, le problème est très réel: le privé est le secteur-clé et il est, par rapport au public, très peu syndiqué, finalement.
On se demande où on s'en va avec le mouvement syndical? D'un côté il y a les hôpitaux, de l'autre les multinationales présentes partout, souvent aidées par certaines formes de syndicalisme...
Unité syndicale.
- On en arrive aussi à se poser des questions au sujet de l'unité syndicale, des luttes entre centrales. Faut-il changer de centrale? Nous, on était contre les comités paritaires dans notre secteur industriel: là-dessus on s'enlignait sur les propositions de la C.S.N, contre celles de notre union internationale. D'ailleurs, malgré l'opposition de l'internationale, on était aussi affilié à la F.T.Q, et souvent on a dû prendre pour la F.T.Q., contre l'exécutif provincial de notre union. Ça veut dire tout ça que le syndicalisme à la base va se développer contre et malgré les structures syndicales qui sont trop souvent un frein. Dans bien des secteurs industriels, c'est un problème majeur. Moi, je l'ai vécu et je sais que c'est un problème pour bien des ouvriers québécois. Tout cela est bien épuisant pour les militants syndicaux.
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE GRANDE ENTREPRISE METALLURGIQUE: UN SYNDICAT METALLO DE LA FTQ
Moi, j'ai eu une expérience militante en milieu syndical et politique avant de travailler en usine, dans le secteur industriel des moyens de transport. Tout de suite, à mon arrivée, il y a eu une grève de deux semaines qui a débouché sur un règlement très insatisfaisant. J'ai participé aux assemblées, puis je suis devenu délégué d'atelier par élection à la base.
Prise en main du syndicat par les militants.
Mon syndicat a une longue tradition mais il avait toujours été très peu militant, il avait connu très peu de grèves. Au moment des élections des délégués d'atelier au milieu des années '70, le mécontentement à la base était important: les gars, surtout les jeunes, trouvaient que le syndicat manquait de vitalité. La convention collective signée était insatisfaisante, le syndicat était plus ou moins un syndicat de boutique. On a fait une campagne écrite contre la direction syndicale sortante, sur les petits secrets, les saloperies, les non-interventions de la direction sortante et même leur refus de négocier là où ils auraient pu le faire. On a pu faire élire un tout nouvel exécutif à ce moment-là.
Préparation de la nouvelle convention collective en consultant la base, atelier par atelier.
A partir de là, on a donné une nouvelle orientation à la vie syndicale, dans un contexte où se préparait une nouvelle convention. On a alors procédé, à la base, en donnant beaucoup plus d'informations sur la convention collective, sur les conditions de travail. Des rencontres ont eu lieu, atelier par atelier: c'est quoi les problèmes, quelles sont les solutions possibles... On a recueilli tout cela, on a fait une synthèse qui a été présentée en assemblée générale pour refaire toute la convention collective qui a été acceptée, en assemblée, article par article.
Au moment où allait commencer les négociations, est arrivée la lutte au plan canadien contre la loi anti-inflation du gouvernement Trudeau. Chez nous, on a refusé de prendre un vote de grève selon le mot d'ordre de la FTQ: on a dit que chacun des gars, volontairement, décidera s'il participe ou pas à la grève. Plusieurs ont fait grève; riposte: la compagnie fait des mises à pied et le syndicat répond par la grève. La compagnie a alors annulé les mises à pied.
Information syndicale.
Les négociations ont commencé mais pas sur toutes les revendications: on voulait traiter la sécurité et santé au travail, le normatif puis le salarial. La compagnie refusant de négocier bloc par bloc, on a mis beaucoup de temps avant d'enclencher les négociations. Le syndicat, lui, a été patient tout en donnant beaucoup d'informations sur les revendications et en passant le mot d'ordre de boycotter le temps supplémentaire, laissant chacun libre, par ailleurs, de sa décision. Puis, nous avons commencé à ralentir la production jusqu'à 50%, la compagnie essayant, par meeting général, de stopper le mouvement. On a bloqué ce meeting pour en faire un nous-mêmes, dans l'usine.
La compagnie nous a finalement mis en lock-out, elle appelait cela une fermeture d'usine. Alors on a réclamé l'assurance-chômage, on a beaucoup protesté. De fait, le conflit a duré plus de 4 mois. Pendant 3 mois, le problème a été celui de la sécurité- santé au travail. On voulait que chaque individu ait le droit de stopper le travail s'il sent sa santé et sa sécurité menacées. On a obtenu, avant la loi 17, de santé-sécurité au travail, beaucoup de choses allant dans ce sens; par exemple, le gars n'aurait même pas à être pénalisé à moins que l'inspecteur gouvernemental ait donné l'ordre de retourner et qu'il ne l'aurait pas suivi. On a obtenu aussi le comité de sécurité où il y a alternance, syndicale et patronale, de présidence; le droit pour le syndicat de faire des enquêtes sur la sécurité dans l'usine.
Lutte pour la sécurité-santé.
D'autres gains de la convention collective: les vacances plus longues et accessibles; de meilleurs fonds de pension; participation patronale accrue à l'assurance-maladie et meilleur protection; chaussures et lunettes de sécurité; temps consacré à l'éducation syndicale; clause sur la fermeture d'usine avec dédommagements en fonction de l'ancienneté.
Qu'est-ce que cette action a donné, quels sont ses acquis?
Démocratie interne.
- Nous avons pu, à la base même, nous mettre à surveiller de très près notre convention collective. Le comité de sécurité a bien fonctionné: des enquêtes, des recommandations pour la sécurité. On a défendu la clause sur les vacances par menaces d'arrêts de travail la compagnie a voulu instaurer une nouvelle manière de contrôler la production, on a résisté en disant que ce ne pourrait être utilisé contre les travailleurs et on a fait un arrêt de travail pour lever la suspension d'un gars qui refusait ce système; une bataille de 15 jours a été menée pour protéger le droit du travailleur à stopper le travail pour fins de sécurité; durant la convention collective, pas de mises à pied, même pas d'avertissement a un seul gars.
Mais la situation s'est beaucoup durcie: à la fin de la convention collective, la compagnie a embauché un provocateur bien connu en milieu syndical. Un incident de parcours a mis le feu aux poudres: une petite bataille entre un gars et un agent de sécurité. On a fait un arrêt de travail pour protester. Riposte: suspensions indéfinies de plusieurs délégués, de militants des comités de grief, de sécurité, ... Les six mois qui ont suivi ont été très durs: le syndicat a résisté contre la compagnie qui voulait réduire nos acquis sur la sécurité, sur le temps des repas, sur les griefs, ... On a pu faire réintégrer les gars, sauf le Président. On a procédé avec tous les moyens légaux possibles: on a pris une injonction contre la compagnie, contre ses suspensions et on a refusé de négocier tant que le président n'aura pas été réintégré.
- Une question qui se pose, cependant, c'est la différence d'esprit maintenant dans notre syndicat. Certains disent qu'on a trop protégé les gars, qui eux ne se sont pas rendus compte des problèmes, de toute la réalité par rapport à l'exécutif, aux militants. L'exécutif a été fractionné et la mobilisation est tombée; comment ça va reprendre? Il y aura peut-être une contre-réaction...
- Un autre problème qui s'est posé, c'est celui de la structure syndicale. On s'est posé le problème: faut-il aller à une autre centrale, plus militante? Mais au fond, en dehors du problème d'affiliation, il y a que le militantisme est d'abord fonction de la base, de ceux qui, à la base , se mobilisent, prennent la direction d'un syndicat. C'est eux qui font que le militantisme de défense des intérêts des travailleurs se développe et que des luttes exemplaires, par exemple la santé, la sécurité au travail, vont être menées. Souvent, c'est ailleurs que dans une usine qui a produit le premier acquis que des améliorations à ces luttes vont être apportées.
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE: UN SYNDICAT DE LA FEDERATION DES MINES, DE LA METALLURGIE ET DES PRODUITS CHIMIQUES A LA CSN
Je suis venu au syndicalisme dans une période assez troublée: celledes événements d'octobre 1970, moment où le syndicalisme était une des seules forces d'opposition aux pouvoirs politiques. Mon syndicat regroupe des travailleurs de l'industrie pharmaceutique. Nous avions signéune convention collective au début des années 1970 suite à des négociations très secrètes. Les gars à la base savaient très peu ce qui se passait.
Démocratisation interne du syndicat.
Devenant président du syndicat à 4 mois d'une nouvelle négociation, je n'avais qu'un but: fonctionner plus collégialement avec les gars et l'exécutif du syndicat. Je voulais fonctionner avec les gars, le groupe: contrairement au style personnalisé et autoritaire de président précédent.
Formation syndicale
La négociation a nécessité une grève de trois mois et son objectif essentiel était de réduire les écarts salariaux entre les diverses catégories de personnel. Pendant la grève, on a fait beaucoup de boulot: avec un animateur de l'ACEF, on a monté une recherche sur la compagnie et sa structure compliquée de propriété, on a donné des cours sur les conditions de vie des travailleurs, les problèmes de consommation. La négociation a donné de bons résultats et la convention améliorait beaucoup des conditions de travail; de fait, cette convention jetait les bases pour une autre convention à venir. Dans l'entretemps, la compagnie change son gérant du personnel: ce dernier fait appel à la camaraderie, aux relations humaines , ...
Mais cela n'a pas duré: les nouvelles négociations, elles, ont été très dures et ont débouché sur une autre grève. On s'est souvent demandé pourquoi les choses ont évolué de cette manière puisque la grève a duré très longtemps et que finalement maintenant on est face à un lock-out qui dure depuis près de deux ans. Mais au fond, l'objectif majeur était que les gars voulaient prendre les choses en mains, à la base, et que par ce moyen, on s'est ouvert beaucoup plus largement aux problèmes ouvriers en utilisant, par exemple, la documentation de la centrale (CSN) , en discutant des lois en assemblées syndicales.
Développement de l'appartenance à l'organisation syndicale
Plus tard, le boss a décidé de lever le lock-out. Il a invité les employés à rentrer. En assemblée générale I laquelle participaient plus de 40 personnes, on a décidé à la quasi unanimité de ne pas rentrer. Peu de temps après cette assemblée, douze personnes ont décidé de retourner au travail et quelques jours après, deux autres ont suivi.
Organisation d'un syndicat de boutique.
Nous avons alors décidé d'organiser le boycott des produits pharmaceutiques et de maintenir le piquetage. Arrive la fin de la convention collective et le début de la période de maraudage. Un syndicat de boutique s'organise chez les scabs. Le boss demande une révision des effectifs et ainsi c'est la désaffiliation de la CSN.
Ceux qui poursuivent la grève décident de contester devant les tribunaux. Un jugement favorable est rendu au syndicat de boutique. La cause est portée en appel. Le syndicat CSN demande au même moment au boss le paiement des cotisations de scabs pour les mois qui ont précédé l'accréditation du syndicat de boutique. Le boss réplique par des poursuites pour grève illégale pour un montant de $ 160,000.00.
Plus tard, le boss va proposer à la CSN de laisser tomber les poursuites et de payer les cotisations. Notre syndicat a accepté cette situation pour éviter que la CSN soit obligée de payer après deux ans de lutte. Nous avons reçu $ 6,000.00 de cotisations des scabs et on a réglé nos dettes avec la CSN.
Aujourd'hui, personne n'est demeuré amer en se souvenant de cette lutte.
Solidarité régionale.
Notre propre lutte qui a été intense et longue, a été facilitée, aidée par notre participation suivie aux actions du Conseil central de Montréal (CSN) et par la solidarité effective que nous avons manifestée à d'autres syndicats en lutte: nous avons contribué financièrement à d'autres luttes, avons reçu visitede militants en lutte. De plus,tous les membres de notre syndicat ont participé aux réunions des structures syndicales régionales: ce n'est pas uniquement l'exécutif qui a assumé cette fonction. Beaucoup de nos membres, à tour de rôle, ont été amenés à faire un tel travail.
Implication de nouveaux militants dans les structures régionales.
On a pu constater que ceux parmi les gars qui ont continué la lutte,qui n'ont pas quitté le syndicat pour rentrer à la compagnie, ont été parmi les plus actifs au niveau de la présence dans les structures syndicales.
LA LUTTE SYNDICALE DANS UN HOPITAL: UN SYNDICAT DE LA FEDERATION DES AFFAIRES
SOCIALES A LA CSN
Le syndicat auquel j'appartiens a été fondé en 1974, en milieu hospitalier, et nous avons adhéré à la CSN suite à un court débat où le Syndicat canadien de la fonction publique a été aussi considéré. Ce débat est revenu plus tard et fut plus poussé: comparaison de structures syndicales, des services, coût de l'affiliation, ...
Dans mon milieu, l'élément-clé, c'est le très grand nombre de syndicats que l'on retrouve dans la boîte: il y en a 11 avec chacun leur exécutif et chacun leur personne) libéré pour l'action syndicale. Pour la partie patronale, c'est un problème, ça veut dire beaucoup de conventions collectives et de négociations. Pour la partie syndicale, le travail en commun, c'est un très gros problème, d'autant plus que la formation syndicale des officiers est très inégale d'un syndicat à l'autre.
Unité syndicale: préparation conjointe de la négociation.
Un moment conjoncturel important: le Front commun de 1976 et la préparation de la négociation locale. Les syndicats se mettent d'accord sur un certain nombre de revendications communes mais la mobilisation est difficile. Le SCFP, lui, hésite. Son exécutif n'ose pas prendre position et finalement les gars du SCFP décident de ne pas respecter les lignes de piquetage. Dans les autres syndicats et dans le mien, au moment où je suis président, la situation est ambiguë; finalement, nos membres dans un vote décident de ne pas rentrer. La grève a duré 15 jours et elle visait à supporter les négociations locales qui devaient compléter la négociation avec le Front commun.
Renouvellement des militants.
Information syndicale.
Elargissement des débats.
Après la grève, il y a eu réalignement du SCFP local avec élection d'un nouvel exécutif. Notre syndicat, lui-même, s'est reconstruit avec un exécutif élargi incluant plusieurs militants actifs, dont quelques-uns de groupes politiques. On a multiplié le travail d'information: assemblées générales pendant les heures de repas où les présences étaient importantes. C'est comme ça qu'on a préparé la convention collective, clause par clause, avant que ce travail ne soit revu par les structures syndicales: fédération, etc. On a aussi abordé des débats plus politiques: sécurité-santé au travail, question nationale, colloques intersyndicaux, au niveau de la boîte, notamment sur la condition féminine.
Assemblées intersyndicales.
La lutte est devenue plus intense à cause de l'annonce de coupures de postes; il y a eu regroupement de syndicats locaux, du moins les plus gros de la boîte, et on a organisé la lutte. Il y a eu des assemblées inter-syndicales sur les heures de travail même avec des coupures de salaires pour ceux qui y venaient. L'administration a quand même pu couper quelques postes sans réelle mise à pied, mais nous, on a appris une chose: on pouvait rapidement s'organiser, à la base, sous forme d'un front commun et on pouvait se défendre.
La dernière convention collective a mené aussi à une autre lutte de maraudage à l'intérieur de la période officielle prévue: il y a eu débat contradictoire qui a mené nulle part à cause de la résistance de certains syndiqués qui ne voulaient pas de syndicat unique et nous n'avons pas pu en débattre. Le SCFP est, à son tour, intervenu de nouveau en utilisant la loi: il pouvait, lui, lancer un débat collectif dans un syndicat CSN où l'affiliation se vote en assemblée générale. Mais ses statuts, à lui, sont plus compliqués: l'affiliation s'y vote individuellement, membre par membre, d'où un problème complexe au niveau du maraudage quand on veut marauder le SCFP.
Réflexion sur le maraudage.
générale. Mais ses statuts, à lui, sont plus compliqués: l'affiliation s'y vote individuellement, membre par membre, d'où un problème complexe au niveau du maraudage quand on veut marauder le SCFP. En assemblées générales, on a discutédu problème et on a pris position contre l'utilisation de la période officielle de maraudage parce que les statuts légaux des syndicats favorisent certains syndicats par rapport à d'autres.
Front commun local - structure inter-syndicale.
Cependant, le problème demeurait qu'on souhaitait que les autres syndicats, dont le SCFP, respectent nos lignes de piquetage. On voulaitun front commun local avec assemblées générales réunies en une seule: on a réussi à faire cela dans la boîte. On s'est donné un exécutif commun avec un conseil élargicomposé des exécutifs de tous les syndicats. La règle était le respect de la majorité: si une majorité de syndicats décidait de faire la grève, les autres devaient respecter les lignes de piquetage. Il y eu alors plusieursluttes locales sur les coupures de postes, les réorganisations du travail et on a pu fairefront commun et résister ensemble.
Unité inter-syndicale à la base .
A l'approche du dernier Front commun, celui de '79, on était localement prêt: on avait un comité de grève unique, des lignes de piquetage communes et intersyndicales, ... Mais à la dernière minute, le SCFP annonce qu'il ne fera pas de grève: seule la F.A.S. à la CSN a lancé ce mot d'ordre. Si bien que dans notre boîte, on était dans une impasse puisqu'au niveau des structures syndicales provinciales, le torchon brûlait. Nous, on a décidé d'aller à la base, poser le problème... vote commun de ralliement: le vote a été pris et les gars ont décidé de ne pas rentrer, tout le monde est resté dehors. Même le SCFP a aidé à maintenir les lignes de piquetage et tous les syndicats ont respecté les lignes de piquetage.
Ça veut dire qu'à la base, malgré tous les problèmes d'unité au niveau des structures syndicales provinciales, on a connu un bon front commun local; ça a été une action exemplaire. On avait, à la base, deux mandats de grève: un mandat d'appui au Front commun et l'autre, pour lutter contre la réorganisation du travail qui se ferait, dans notre boîte, au détriment des travailleurs. On a perdu quelques postes mais pas en termes de réelles mises à pied. On a même fait quelques gains allant au-delà de ce que le Front commun a obtenu. Les fermetures de poste seraient rendues impossibles et les mécanismes de griefs sont prévus pour lutter contre les réorganisations de travail.
Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les fronts communs à la base sont possibles: les structures d'appui à la grève peuvent être communes, les journaux syndicaux sont communs. Les syndicats les moins militants ont été stimulés ... la collaboration entre les militants et les permanents de la CSN et du SCFP a été constante. Le problème à venir demeure, cependant, celui d'un syndicat unique dans la boîte: on en aurait besoin, cela aiderait notre action et le rapport de force avec la partie patronale serait plus facile à organiser. Mais pour le moment, le "timing" n'est pas bon: il faut gagner du temps, une autre grève en front commun local aiderait à préparer un bon débat sur cette question d'un syndicat unique avec constitution unique. Il se pourrait aussi qu'on puisse regrouper, dans un premier temps, tous les syndicats CSN, pour ensuite arriver à un débat de fond sur la centrale qui pourrait le mieux aider le syndicat local unifié qu'on aurait à ce moment-là. Et le débat se ferait entre deux centrales, mais l'essentiel c'est le militantisme du syndicat local, à la base, qui devrait permettre de régler le problème.
LA LUTTE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT: UN SYNDICAT CEQ
Je suis une syndiquée des travailleurs de l'enseignement. Mon expérience syndicale est le résultat de luttes menées dans le contexte du Front commun et aussi au plan local au niveau de l'enseignement; mais notre situation est relativement différenciée dans la mesure où notre syndicat couvre une large région. Nous avons 4,000 membres qui sont soit enseignants, soit employés de soutien, soit professionnels non enseignants, divisés en 5 grands secteurs et relevant de 14 commissions scolaires. M y a donc un problème d'unité, d'isolement entre les syndiqués.
Notre base syndicale est souvent portée au corporatisme et cela aussi pose un problème, par exemple, réduire les écarts de condition de travail et de salaire entre enseignants du secondaire et du primaire, entre les enseignants et les employés de soutien cela pose la question de solidarité, de conscience des intérêts des travailleurs, d'unité devant des divisions chez les travailleurs. C'est un problème politique qui se retrouve aussi au sein même du Front commun: les enseignants n'ont pas encore une conscience très nette de leur appartenance au monde des travailleurs. L'adhésion au Front commun demeure un problème politique clé.
Les orientations socio-politiques du syndicat sont aussi importantes: nous avons pris position sur la question nationale, les conditions sociales d'exploitation des travailleurs, le rapport "écoles publiques -écoles privées", la condition féminine... M existe une autre préoccupation pour nous qui est de chercher à stimuler la démocratisation de la vie syndicale, notamment en réduisant le nombre de permanents en faveur de la participation syndicale la plus large à la base. Evidemment, la question des ressources financières pose un problème: on a un gros budget dont 55% retourne à la base et souvent celle-ci voit ça sous l'angle de services qu'elle achète en payant au moyen de la cotisation. Il y a là une mentalité de consom-mateurs de services qui n'est pas toujours conciliable avec des attitudes syndicales plus militantes.
Information et formation syndicale.
Nous avons aussi misé sur des politiques de formation et d'information. D'autant plus que les enseignants ont souvent spontanément le réflexe de la méfiance par rapport à leur direction syndicale, d'où la nécessité de consacrer beaucoup d'énergie à informer et, par là, à former une conscience syndicale. Les efforts d'information et de formation visent à mieux connaître et à défendre aussi le contenu des conventions collectives. Au-delà de son application, on cherchera à mettre en relief le contexte socio-politique de la convention notamment en replaçant les revendications avancées dans la conjoncture sociale plus large. Par là, on cherche à rendre les membres plus sensibles aux conditions de vie, économiques, politiques, sociales des travailleurs en général. Le lien de nos membres avec l'ensemble des travailleurs demeure une question stratégique et sa conscientisation pose un problème d'orientation politique de l'action syndicale.
Débats sur la démocratie.
Pour aller dans ce sens, on utilise la documentation de la centrale, on fait souvent des débats sur la démocratie syndicale à la base, mais aussi sur l'Etat, les conditions socio-économiques des travailleurs et le rôle du syndicalisme, ... C'est sûr que, par moments, la formation doit se faire dans l'action, que celle-ci devient tellement importante qu'elle recouvre toute la pratique syndicale; par exemple, les négociations, le Front commun, les grèves, ...
Dans nos pratiques syndicales, on cherche à stimuler la démocratisation par des implications tant au niveau des luttes quotidiennes, en cherchant à impliquer les membres dans des actions suivies, décidées à la base. A cet égard, les positions de la centrale sur la question nationale, sur la préparation et le suivi des négociations ont posé beaucoup de problèmes, dans la mesure où, à la base, la participation active des membres sur de telles questions est rendue difficile. Les points de vue personnels sont souvent différents des orientations prises par la centrale. On se sent dépossédé par certaines prises de position de la centrale quand on a pourtant essayé de stimuler la participation active à la base, préalable à certaines décisions importantes. Les tensions vécues dans une centrale rendent souvent la pratique syndicale à la base bien difficile.
LA LUTTE SYNDICALE DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT: UNE GREVE LOCALE D'UN SYNDICAT CEQ
Moi, mon expérience est fondée sur la gestion d'un syndicat du milieu de l'enseignement dont je suis responsable: c'est un gros travail où il faut voir toutes les implications. D'autant plus que je travaille avec des travailleurs intellectuels qui sont souvent pris dans les ambivalences de la petite bourgeoisie, des intellectuels face au syndicalisme.
Conscientisation et démocratisation.
Aussi, notre action syndicale visait deux objectifs: d'abord améliorer la conscientisation de nos membres par rapport à leurs intérêts collectifs, surtout que les enseignants sont souvent individualistes. Ensuite, viser la démocratisation syndicale dans le syndicat "at large": stimuler la vie syndicale, impliquer le plus de monde possible.
Information syndicale
Comment on s'y est pris? D'abord, on a travaillé beaucoup au niveau de l'information pour favoriser la mobilisation: on a décortiqué, analysé les problèmes, les informations; on a expliqué les raisons, les facteurs de revendications; on a tenté de mieux mettre en relief l'aspect technique et politique des problèmes en proposant un document intitulé: "Où sont nos intérêts?". Ce document a servi pendant la grève de '77 pour aider les gens à y voir plus clair. D'autant plus que certains syndiqués voulaient une assemblée, plus ou moins contradictoire, où l'administration présenterait son point de vue, le syndicat le sien, et après les membres trancheraient. Alors, le document visait à permettre aux syndiqués de voir plus clair. Cette grève-là avait été déclenchée après 1 mois de négociations locales ardues qui n'avaient pas débouchées et à la fin d'une réunion que certains avaient déjà quittée. Il y eut donc division entre les enseignants, et les craintes d'un éclatement. Mais l'administration se disant prête à négocier, on arrêta le débrayage. La rencontre entre les parties ne donnant rien, on reconsidéra le vote de grève qui fut là plus net.
Préparation de l'assemblée générale.
C'est à ce moment-là qu'est venue la suggestion, par voie de pétition, d'une assemblée générale plus ou moins contradictoire. On a refusé de jouer le jeu de la légalité de la pétition. On a provoqué nous-mêmes une A.G. où le document en question a été discuté; le résultat a été un gros vote pour continuer la grève à 72%.
Relève militante.
Les structures d'appui à la grève ont été très actives: réunions du conseil d'administration, du comité de grève, des militants à tous les jours et les fins de semaines pour planifier l'action. La grève a duré 7 semaines. Au milieu de la grève, l'administration proposait l'arbitrage; nous on a refusé l'arbitrage en faveur de la médiation. Notre A.G. nous a suivi mais le médiateur nommé proposait l'arbitrage à nouveau... A la 6ième semaine de grève, le syndicat avance une proposition de compromis global au médiateur, mais l'administration la refuse globalement. Finalement, le médiateur dépose ses recommandations: à 85% elles rencontraient nos revendications. Alors, on a largement diffusé à la base, très rapidement, ces recommandations et on a convoqué une réunion. Le syndicat en A.G. les a acceptées avec un vote de grève à 100% si l'administration n'acceptait pas. Mais l'administration a reculé.
Les retombées de cette lutte: surtout une plus grande solidarité entre les syndiqués d'une école à l'autre, une plus grande conscience de leurs intérêts communs. D'autres luttes ont été menées toujours appuyées par des documents que le syndicat mettait au point et diffusait largement chez les syndiqués et même, des fois, chez les parents.
Information du syndicat aux parents.
Toujours on travaille l'information à la fois sous le double aspect des problèmes techniques et politiques.
Mais dans un syndicat, il y a toujours des problèmes de structures, d'organisation de la vie syndicale. D'un côté, on a les politiques de libération pour fonction syndicale: mais trop souvent on subordonnait les choix politiques des membres aux facteurs de la compétence technique. Finalement, on a décidé d'embaucher des administrateurs pour le syndicat, pour l'administrer quotidiennement. Mais on voulait garder le contrôle politique de l'orientation du syndicat et pour cela, on a embauché des militants libérés pour qu'ils fassent ce travail d'administration. Et on cherche à respecter leurs droits de militants: ils ne votent pas au C.A. mais ils votent aux réunions de délégués, et en A.G..
Le budget reflète les orientations du syndicat.
Autre point important: les prévisions budgétaires. Maintenant, on les discute et on les adopte par programmes d'activités politiques, non plus par catégories comptables traditionnelles: de sorte que le budget est subordonné aux orientations politiques de l'action syndicale. Les membres, les militants voient alors sur quoi ils veulent mettre le paquet. Ainsi, ils peuvent faire des comparaisons avec les années antérieures. De sorte que ce processus indique clairement que les décisions budgétaires, financières, sont subordonnées aux options politiques de l'action syndicale. On voit ce que ça coûte et on se branche en fonction des orientations de nos luttes passées et présentes. C'est un aspect non négligeable de la démocratisation syndicale.
LA LUTTE SYNDICALE DANS UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE TEXTILE: DE L'UNION INTERNATIONALE A LA FTQ
Je suis venu au syndicalisme à la fin des années soixante et j'ai milité dans le syndicat d'une entreprise de l'industrie du textile. Plus tard, j'ai commencé à militer dans les structures syndicales régionales.
Déloger le syndicat de boutique.
Pour nous, le problème-clé était de déloger le syndicat de boutique indépendant de notre usine. Tout cela a pris une année et demie, pour déloger l'ancien syndicat et obtenir un nouveau contrat de travail. On a appris pas mal de choses dans cette lutte: on a vu à quel point les patrons peuvent être crapuleux quand il est question de syndicat et du droit que l'on a, en vertu de la loi, de s'organiser pour se défendre. Mais aussi, on a vu que la solidarité et la détermination des travailleurs à la base, pouvaient être résistantes et que c'était une vraie force. A ce moment-là, dans l'usine, tout était prétexte à congédiements ou à menaces de congédiements d'autant plus que le syndicat était accrédité mais n'avait pas encore négocié. Les patrons ont tout essayé: des cadeaux au personnel jusqu'à des réunions avec les gars, au-dessus de la tête du syndicat en passant par le renforcement le plus bête de la discipline et par des menaces de toutes sortes. Ils voulaient en arriver à un contrat pourvu qu'il n'y ait pi us de syndicat.
Ils ont réussi à liquider la plupart des militants. Il n'est resté qu'un petit noyau et le leader syndical. Mais grâce surtout à l'appui reçu de l'extérieur de d'autres organisations syndicales, populaires et politiques, on a pu résister et remonter notre syndicat.
Appui régional.
Deux manifestations d'appui publiques larges de groupes populaires et politiques, y compris à ce moment la section locale du P.Q. ont été déterminantes. La compagnie a dû reconnaître le syndicat et même négocier, en quelques jours, un contrat qui ne valait pas grand chose pour nous mais il permettait de prendre pied dans l'usine. La solidarité d'autres groupes de travailleurs et de groupes populaires a été déterminante: aujourd'hui, on s'en rappelle et on essaie de leur rendre la pareille en étant nous-mêmes solidaires de luttes ailleurs.
Démocratisation de la vie syndicale: information et réunions de départements.
Une autre retombée de la lutte: un syndicalisme assez militant qui a vite fait de ruer dans les bran-carts du syndicalisme international du textile. Mais aussi au plan local, on a réussi à faire abolir le travail à la pièce, les discriminations salariales entre hommes et femmes. La vie syndicale locale a été aussi plus collective et axée sur la participation: on a utilisé les assemblées de départements rapides, en une demi-heure, le midi pour passer l'information et la participation était très bonne. Les membres ont participé à la préparation de la négociation et l'ont suivie: le fait de travailler par département et pas toujours en A.G. a permis à plus de gars parmi les 180 membres de prendre la parole, de se mobiliser. On a aussi multiplié des griefs sur toute sorte de choses, de sorte que les patrons recourent moins aux mesures disciplinaires bêtes parce que la discussion des griefs sur le tas, sur le plancher de l'usine faisait perdre beaucoup de temps de travail. On a développé aussi beaucoup l'appui aux luttes extérieures, peu importe la centrale, le syndicat.
Ouverture aux luttes extérieures.
Quels ont été les objectifs de notre pratique syndicale?
- D'abord la démocratisation de la pratique syndicale: on voulait avoir notre mot à dire sur les décisions qui nous concernaient en tant que travailleurs et syndiqués. Mais les décisions importantes, finalement, n'étaient pas celles prises en congrès mais plutôt celles que la direction canadienne ou internationale de l'union prenait: on avait beau décider des affaires en congrès, eux autres laissaient les affaires dormir et il ne se passait rien. On a donc demandé le rapatriement au Québec de l'engagement du personnel permanent devant travailler au Québec même; le droit de décider de l'orientation de notre union au Québec, laquelle négocierait les services dont elle a besoin et les programmes de formation qui sont nécessaires.
Lutte pour la démocra-tisation de l'union internationale.
- On voulait aussi une accentuation des services au niveau de l'éducation et de la formation syndicales. A ce niveau, on n'avait pas d'outils satisfaisants: les permanents, après la négociation, se retiraient et nous autres, il fallait, tout seuls, faire tout le reste. On voulait un programme d'éducation syndicale pour les locaux québécois, programme contrôlé par le conseil provincial .
- On demandait aussi le respect de la langue de travail de la majorité des membres au Québec. Au niveau de l'information et des négociations - souvent si un seul ne parlait pas français, c'était fréquemment le directeur de l'usine, ça se passait en anglais - il n'y avait pas moyen d'avoir du français.
Bref, on souhaitait un syndicalisme militant et combatif qui serait à notre mesure et que l'on contrôlerait nous-mêmes, à la base. On demandait trop, semble-t-il: la direction canadienne a riposté en sabordant notre conseil provincial et en mettant deux groupes en tutelle.
Affiliation directe à la FTQ.
De là, a commencé le mouvement de désaffiliation de l'unioninternationale et la majorité s'est retrouvée à la FTQ, comme affiliés directs, au milieu des années '70. Cette dernière a toujours défendu et supporté l'autonomie des syndicats locaux qui se battaient contre les structures syndicales internationales et canadiennes pourries. D'ailleurs, la FTQ fournit une protection de ces syndicats locaux affiliés à elle directement, dans la mesure où les unions internationales n'osent pas affronter trop directement la FTQ.
Des structures démocratisées: contrôle de la base
Depuis ce temps, on a essayé de mettre en application les revendications avancées. Par exemple, le conseil provincial prend toujours les décisions au sujet de la formation syndicale, de l'organisation, de l'information, du travail des permanents. Depuis quelque temps, deux délégués de chaque groupe de syndiqués se rencontrent régulièrement pour évaluer le travail fait et le travail à venir. Le travail d'orientation, de direction est fait à la base, par les militants, pas par les permanents. Le contrôle est exercé par la base grâce à l'autonomie des syndicats locaux et du conseil provincial. Les syndicats locaux prennent de plus en plus en charge leur propre vie syndicale.
Implication des militants dans les instances régionales.
Une autre dimension de notre pratique syndicale, la mienne aussi dans ce contexte, c'est la participation aux activités des instances, le Conseil du travail de Montréal et a la FTQ. L'affiliation à ces organismes, bien sûr, est volontaire. Pour nous, ces affiliations sont venues de notre conviction que la solidarité des autres nous avait aidés et qu'il fallait nous-mêmes être cohérents en se montrant solidaires. Dans ces structures, les objectifs de la pratique syndicale rejoignent ceux défendus à la base même: démocratisation des structures syndicales, formation syndicale et information, fonctionnement syndical plus militant, solidarité inter-syndicale et inter-centrale. Des terrains nouveaux de lutte nous apparaissaient aussi très importants: sécurité-santé au travail et les conditions des femmes au travail.
Unité inter-centrale.
Deux préoccupations plus importantes de la pratique syndicale dans ces structures: d'abord l'unité syndicale. Il faut promouvoir les projets d'activités inter-centrales à toutes les instances. Par exemple, le CTM voudrait réactiver le CRIM (Conseil régional inter-syndical de Montréal), mieux préparer la fête du 1er mai. Le point de non-retour, comme certains permanents se plaisent à le dire, n'a pas été franchi. A la base, il y a une volonté ferme d'unité inter-syn-dicale. Mais comment travailler cela? Par le sommet, par les instances ou par la base militante? Ce ne sont pas les travailleurs, à la base, qui entretiennent les chicanes mais, ce sont eux qui vraiment en souffrent. M faudrait aussi admettre que l'unité ne se fera pas en voulant se manger l'un l'autre pour devenir la grosse centrale; il va falloir se respecter et ne pas tenter d'éliminer l'autre.
Syndicalisation massive.
Il faut aussi dire que la syndicalisation massive peut être un objectif facilitant l'unité syndicale. Dans le secteur industriel privé, on est peu et mal organisé; le public qui est très syndiqué devrait nous aider à mieux pénétrer le secteur privé. Chaque grand secteur devrait reconnaître ses acquis, les acquis de l'autre, rendre plus clair comment il y est parvenu parce que le camouflage ne réglera rien et ne fera que stimuler les préjugés entre ces secteurs. Toutes les centrales pourraient trouver là un terrain d'unité: il faut moins marauder et dépasser le plafond des 18 à 20% des syndiqués du privé.
C'est là un objectif prioritaire de la pratique syndicale actuelle: le clan des syndiqués est en train de devenir "gras dur" alors que beaucoup de non-syndiqués, eux, ne s'en sortent pas et surtout dans le secteur privé. Le secteur public devrait s'impliquer à fond dans un programme de syndicalisation massive.
Nécessité d'un militantisme permanent.
Un dernier point très important : le problème de la continuité dans l'action syndicale. Trop de monde, aujourd'hui, ne viennent que pour donner un coup de collier puis ils s'en vont quand ça commence à leur entrer dans le corps, à faire mal. Il me semble qu'au Québec, on a peu de fierté réelle d'être ouvrier; plusieurs cherchent par tous les moyens à quitter cette condition. Les ouvriers ne sont pas conscients qu'ils sont les moteurs de la société et donc aussi du changement social. Il faut bien voir que ceux qui ne sont que de passage dans le mouvement ouvrier ne rendent pas le mouvement syndical très crédible. Déjà ceux qui ont milité dans les groupes populaires savent que tous ceux qui ne font que passer sèment la démobilisation: après, il faut remonter toute l'affaire, relancer la pratique militante.
CHAPITRE II : DES LUTTES QUI QUESTIONNENT LES PRATIQUES SYNDICALES ET LE SYNDICALISME LUI-MEME
TABLE-RONDE SUR LE SYNDICALISME
INTRODUCTION
Dans les exemples de luttes syndicales qui précèdent nous avons pu voir que des travailleurs du secteur public et du secteur privé ont entrepris, sur plusieurs années, de transformer leurs syndicats pour en faire de véritables instruments de lutte. A partir des luttes dans lesquelles ils ont été engagés, ils n'ont pas manqué comme militants de se poser ou de se reposer des questions sur leurs pratiques syndicales et sur le syndicalisme lui-même. Voici l'essentiel des propos que ces militants ont développés au cours des discussions animées par le comité. Nous avons regroupé ces propos autour des grandes questions suivantes:
- La première question qui surgit, c'est d'examiner comment est-il possible d'organiser la mobilisation dans son syndicat? Comment est-il possible de bâtir un rapport de force avec le ou les patrons? Comment est-ilpossible de faire du syndicat une organisation active, démocratique, militante? Comment est-il possible d'assurer une relève aussi, dans le contexte qui est le nôtre?
- Comment aussi, des travailleurs qui cherchent à s'organiser à la base, au niveau local, peuvent-ils développer et vivre l'appartenance à uneorganisation syndicale au niveau régional, dans leur secteur et au plan national ?
- Comment également, dans le même ordre d'idées, faire avancer, en dépit des difficultés actuelles, l'unité inter-syndicale que beaucoup de travailleurs souhaitent: demeure-t-elle une aspiration qui peut difficilementprendre forme, qui est plus ou moins réalisable dans les faits?
- En outre, a un niveau plus général, le questionnement peut porter surla situation différente des travailleurs du secteur privé par rapport àceux du secteur pub lic: leurs organisations sont-elles condamnées à se développer en parallèle comme deux solitudes? Ou bien est-il possible de favoriser des rapprochements sans pour autant développer des coordinationsaussi confuses qu'artificielles?
- Finalement, le mouvement syndical est-il capable de devenir une force de proposition sur des enjeux qui concernent l'ensemble des travailleurs:des problèmes tels la sécurité au travail, les conditions de vie et de travail des femmes, l'oppression nationale du peuple québécois, ... peuvent-ilsêtre pris en charge par delà les prises de positions de congrès ou d'assemblées générales?
Ces questions ne sont certes pas nouvelles. Elles se posent cependant, pour bon nombre de militants syndicaux, de façon plus aiguë dans le contexte actuel: le mouvement syndical n'est-ilpas davantage aujourd'hui en difficulté et sur plusieurs fronts à la fois? Que l'on pense ici au dernier Front commun dans le secteur publicet para-public ou encore aux luttes du Front commun des travailleurs du papier et de la forêt (CSN).
Au cours des rencontres que nous avons eues, certaines réponses ou éléments de réponse se sont esquissés ou profilés. Ces références ne sont pas nécessairement concluantes. Elles permettent néanmoins d'identifier une direction à la réflexion. Nous voulons dans ce qui suit, rendre compte en synthèse, des problèmes que des militantsréunis en table-ronde ont identifiés collectivement et des pistes d'action que leur a suggérées la réflexion sur ces problèmes.
Pour faciliter les choses, nous avons regroupé leurs propos autour de cinq thèmes qui seront traités les uns après les autres. Il s'agit: 1) des pratiques syndicales militantes à la base; 2) du syndicat dans son appartenance à une organisation syndicale nationale (une centrale); 3) de la question de l'unité intersyndicale; 4) des situations et pratiques syndicales dans le secteur public et dans le secteur privé;5) des enjeux actuels du mouvement syndical pris dans son ensemble.
I- LES PRATIQUES SYNDICALES A LA BASE
1) Démocratie syndicale et militantisme
Plusieurs des luttes syndicales précédemment évoquées mettent en lumière que la pratique syndicale à la base est l'élément-clé d'un syndicalisme vraiment militant. L'émergence d'un véritable "syndicalisme de combat" repose de façon déterminante sur la vitalité et le militantisme de la base syndicale. Il faut donc prendre plusieurs types de moyens pour favoriser l'émergence d'un tel militantisme. On notera au sein des exemples de lutte syndicale évoqués, l'utilisation d'un certain nombre de moyens qui sont privilégiés. C'est ainsi que plusieurs syndicats locaux contribuent à l'amélioration du militantisme en misant sur l'information, la formation des militants et l'animation en direction de la base du syndicat. On tente ainsi de stimuler la vie syndicale locale en profitant de toutes les occasions pour informer les membres et favoriser la formation de militants afin de stimuler la vie syndicale. En plus de tenir des assemblées générales bien préparées, on fera appel à toutes sortes de réunions plus fréquentes visant des effectifs plus restreints, souvent au niveau des sections et des départements d'une usine, de manière à rejoindre davantage la base du syndicat .
Plusieurs participants à la table-ronde font référence à l'importance des moyens d'éducation et de formation de militants au moment de grèves et de conflits particuliers. De telles rencontres de formation et d'éducation peuvent aussi servir à sensibiliser les nouveaux membres à l'histoire acquise d'un syndicat local. En effet, de manière à favoriser la mobilisation de militants syndicaux, des rencontres d'éducation de ce type s'avèrent une voie de stimulation importante.
2) Convention collective, législation du travail et luttesyndicale
Par ailleurs, les militants doivent consacrer beaucoup de temps et d'énergie à protéger les acquis, à défendre la convention collective qui a été signée. Parfois on s'épuise, on se démoralise et même on se démobilise suite aux nombres effarants de griefs auxquels on doit recourir pour bien protéger les acquis. Mais la plupart du temps, ces griefs se règlent très lentement et s'accumulent sans cesse. Aussi, se pose le problème d'arriver à une pratique syndicale qui puisse dépasser ces contraintes et ces limites.
Ce à quoi il faut ajouter que la législation du travail produit souvent des effets fort néfastes pour le mouvement syndical. Elle pousse trop souvent au corporatisme syndical local et à l'enfermement de la vie syndicale dans un cadre juridique étroit (pré-avis de grève, vote de grève réglementé par le gouvernement dans le secteur public, ...). Tout cela peut contribuer à isoler et à limiter les luttes syndicales locales.
Cette analyse en amène plusieurs à vouloir une transformation substantielle de la législation du travail. On mentionne entre autre chose que l'accréditation sectorielle serait fort utile. De telles négociations sectorielles permettraient peut-être au mouvement syndical d'avoir une plus grande force de frappe et en même temps elles rendraient peut-être moins coûteux et difficile le problème de la syndicalisation massive des travailleurs .
3) la relève militante dans les syndicats à la base
Une autre dimension importante de la vie syndicale locale touche au recrutement et au renouvellement des militants syndicaux. Trois mécanismes en particulier semblent favoriser le recrutement et le renouvellement des militants: 1) certaines luttes plus intenses semblent une occasion importante d'émergence et de recrutement, et même de formation de militants nouveaux; 2) les rencontres de formation et d'éducation syndicales pratiquées à la base et dans les regroupements régionaux du mouvement syndical semblent aussi un mécanisme favorisant le renouvellement et le recrutement des militants; 3) certaines luttes plus politiques 2 semblent fournir des occasions particulièrement propices au recrutement et au renouvellement du militantisme local. Le renouvellement du militantisme au niveau du syndicat local, et même au niveau régional, est d'autant plus important qu'on note un "turnover" chez les militants qui varie de 2-3 ans à 4-5 ans. Aussi, ce "turnover" relativement rapide pose-t-il un problème important:
comment arriver à garder une certaine continuité dans le militantisme syndical et empêcher que des militants quittent le mouvement par épuisement après de trop nombreuses luttes fort exigeantes?
II- LE SYNDICAT LOCAL ET SON APPARTENANCE A UNE ORGANISATION SYNDICALE REGIONALE ET NATIONALE
Il faut mentionner ici, à propos de ces pratiques syndicales locales militantes, que le problème de leur diffusion, de leur répercussions à l'extérieur du milieu local demeure important. Pour que ce militantisme de combat devienne un pôle d'entraînement du mouvement syndical en général, il faut que des moyens soient pris pour publiciser ces luttes exemplaires. A cet effet, les regroupements syndicaux régionaux ou les diverses instances des centrales syndicales auront un rôle fort déterminant pour permettre, à l'intérieur de tout le mouvement, la diffusion des luttes locales les plus importantes.
Il va sans dire qu'il y a des moments particuliers de la vie syndicale qui semblent davantage propices à l'ouverture des syndicats locaux, aux activités syndicales plus régionales ou mêmes nationales. C'est pendant une lutte syndicale locale que l'ouverture vers d'autres instances du mouvement syndical semble se faire plus facilement. Les services de la centrale, les contacts plus fréquents avec des conseillers syndicaux et des militants d'autres syndicats, les mécanismes de soutien à la lutte et de solidarité rendent le syndicat plus sensibleet conscient de la vie syndicale régionale et nationale.
La lutte syndicale locale est donc un excellent déclencheur de l'ouverture à un engagement qui déborde son propre milieu de travail tout en partant de lui. Tout le problème demeure de faire en sorte que ce type de lien continue après la fin d'une lutteau plan local. Aussi,le point crucial devient-il de maintenir la mobilisation pour qu'après la lutte les choses ne redeviennent pas comme avant. Le recrutement, au cours de la lutte, de militants locaux qui ont eu recours aux instances syndicales régionales est un excellent mécanisme pour maintenir des liensvivants avec l'ensemble du mouvement syndical.
Les contacts avec les diverses fédérations syndicales semblent cependant moins propices au militantisme syndical que les contacts avec les organismes syndicaux régionaux. Les fédérations apportent bien sûr un appui au niveau des négociations de conventions collectives, Mais souvent, les contacts les plus intéressants se font entre syndicats en lutte, en dehors des réunions formelles de fédérations, ces syndicats s'apportant divers appuis au niveau des négociations ou au niveau des griefs. Par ailleurs, les organismes syndicaux régionaux sont particulièrement importants au niveau des moyens d'éducation et d'information qu'ils apportent au militantisme syndical local.
Par contre, il faut aussi noter que la force de certains syndicats locaux leur donne une importante autonomie locale qui peut jouer contre les formes de regroupements régionaux ou même nationaux. Certainssyndicats locaux assument la presque totalitédes services requis dans les moments de luttes et de conflitsouvriers. Dans ce cas, l'importance de l'autonomie locale fait que le hors-local est perçu comme étant très loin et très extérieur à la vie syndicale. Ainsi, la solidarité syndicale interne à une centrale peut souffrir beaucoup de ce fait. Des soirées, des réunions de solidarité syndicale soit au niveau régional, soit au niveau national s'avèrent d'excellents moyens d'échapper à ce repli de la vie syndicale sur l'autonomie locale.
Les fonctions des regroupements syndicaux régionaux sont en outre tout particulièrement importantes au niveau de la solidarité, du soutien aux luttes locales. Pour un syndicat local,il est important d'aller chercher au niveau régional un appui à ses luttes en même temps qu'ilpourra lui-même faire preuve de solidarité en appuyant d'autres luttesque le regroupement régional lui fera connaître. Les militantslocaux qui vont vers les instances régionales trouvent là des appuis et cela les sensibilise à des enjeux plus larges (sécurité-santé, condition féminine, question nationale, solidarité internationale, ...). De cette manière, ces militantsvoient plus le lien actif et intense entre le niveau local et le niveau régional. Le fait de militer hors-local devient alors un facteur-clé de mobilisation. Les visites à d'autres syndicats peuvent aussi devenir mobilisatrices pour expliquer une lutte, conflitlocal et pour se sensibiliser à ce qui se passe dans d'autres secteurs de lutte. C'est de cette manière que des fronts de lutte pluslarges peuvent se développer et que progresse une plusgrande conscience politiqueet syndicale.
Il est donc important d'accentuer les rapports et les liens de solidarité pour que les militants découvrent les autres luttes et conflits du mouvement ouvrier. Aussi, faudrait-il que les congrès syndicaux qui se tiennent périodiquement servent encore davantage à multiplier les liens entre divers syndicats en lutte en organisant à ces occasions-là des rencontres d'information pour que les militants soient sensibilisés à divers conflits. Les organismes syndicaux régionaux ou encore les réunions des conseils généraux permettent souvent de développer des débats politiques qui s'avèrent très formateurs. Fréquemment, ils aident aussi les militants locaux à perdre leurs préjugés par rapport à d'autres secteurs du mouvement ouvrier. M faut donc souhaiter que les organismes régionaux syndicaux, ainsi que les fédérations de chaque centrale jouent de plus en plus leur rôle au niveau de la solidarité syndicale et des débats politiques que ceux-ci occasionnent.
Par ailleurs, les problèmes d'adhésion d'un syndicat local à une centrale syndicale est souvent une dimension fort présente et stratégique lors d'un conflit, lors d'une lutte syndicalelocale. C'est en effet souvent au moment d'une lutte particulière que se pose ou se repose le problème de l'affiliation ou de la désaffiliation d'une centrale syndicale. Le problème se pose entre autre parce que le syndicat local cherche à obtenir de la centrale à laquelleil est affilié les appuis et les services dont il a besoin pour mieux mener sa lutte. C'est ainsi que beaucoup de syndicat ont rompu avec des unions internationales au moment où celles-ci leur refusaient les appuis nécessaires dans le contexte de leur conflit local pour passer à une autre centrale (la CSN en l'occurrence) ou pour s'affilier directement à la FTQ.
Quelle que soit la centrale syndicale, le problème devient assez rapidement de savoir quel support un syndicat local recevra des instances syndicales régionales ou nationales et aussi comment ce syndicat local peut lui-même participer aux luttes syndicales plus larges du mouvement ouvrier tant au niveau régional que national. Par ailleurs,lorsqu'il s'agit d'une désaffiliation d'une union internationale, ce qui est recherché relève en premier lieu d'impératifs de démocratisation de la vie syndicale et des supports nécessaires à une lutte syndicaleintense. Par la force des choses, la lutte syndicalelocale doit s'appuyer sur les instances plus larges du mouvement syndical,de même que la lutte locale peut servir à rendre plus vivant et militant le mouvement syndical en général. Il faut donc que les instances syndicales plus larges soient suffisamment démocratiques et accessibles pour que les militants de la base, suite à leurs luttes syndicales, puissent marquer l'évolution de la centrale à laquelle ils sont affiliés.
III- L'UNITE INTER-SYNDICALE: MYTHE OU REALITE?
1) L'unité inter-syndicale à la base
Beaucoup d'expériences militantes à la base manifestent une unité syndicale effective. Malgré les querelles entre centrales syndicales, certains syndicats réussissent quand même à fairefront commun lorsque des militants d'un même milieu de travail décident de lutter ensemble pour défendre leurs droits. A la base, notamment dans l'exemple de la luttesyndicale dans un hôpital, la vie syndicale des uns n'est pas bloquée par celle des autres. Au contraire, certainssyndicats vont préparer conjointement des clauses de convention collective. Bref, les fronts communs locaux sont possibles même lorsque les appareilssyndicaux ne les encouragent pas explicitement. Il faut d'ailleursnoter que l'appartenance à un même milieu de travail favorise les rapports entre syndicats locaux appartenants à diverses centrales. Mais la force relative de chaque syndicat joue aussi dans la mesure où un petit syndicat assez isolé serait davantage sensible à des possibilités de fronts communs à la base.
Signalons toutefois que ces fronts communs à la base sont fragiles lorsqu'ils sont trop à la remorque d'un conflit, d'une lutte conjoncturelle. Aussi, faut-ilporter le débat sur l'unité syndicale à l'intérieur des instances de sa centrale, de manière à favoriser un véritable rapprochement. D'autant plus qu'il peut bien arriver qu'un syndicat local soit écoeuré d'être trop souvent au coeur des luttespour d'autres syndicats locaux d'une même entreprise qui ne l'appuient pas assez. Des exemples sont connus où le fait d'avoir à faire face à un même patron n'a pas vraiment favorisé le développement des fronts communs locaux. Cela est probablement dû à la diversité des syndicats d'une même entreprise; les uns étant des regroupements de type industriel, les autres des regroupements de type professionnel ou de métier.
Il est vraisemblable que la formation de militants issus de diverses luttes soit une voie de solution pour stimuler l'unité syndicale. En effet , est-il possible de penser à une formation syndicaleà la base, formation syndicale inter-centrale? Le travail ainsi fait à la base, entre les membres de divers syndicats, permettrait peut-être d'échapper aux pressions exercées par les appareils syndicaux.
Les organismes syndicaux régionaux demeurent aussi d'importantes instances où le travail d'unité syndicalepeut être fait. En effet, la vie syndicale peut être alimentée par toutes sortes d'actions de regroupement entreprises au niveau régional. Il faut voir que les fronts communs régionaux peuvent être aussi fonction directement de la base syndicale sans que les appareils ou les centrales syndicales ne s'en mêlent.
2) L'unité inter-syndicale à la base... et dans les instances: les difficultés actuelles
L'unité syndicale, c'est aussi un problème d'appareils, d'instances plus larges du mouvement syndical. A la base et dans les instances, le problème de l'unité n'est pas nécessairement ni perçu ni vécu de la même manière.
La conjoncture actuelle, en ce qui a trait notamment au rapport entre la CSN et la FTQ est particulièrement détériorée au sujet de l'unitésyndicale. Les luttes apparues dans le secteur du commerce et dans la métallurgie tout particulièrement n'ont pas du tout aidé à la cause de l'unité syndicale, le maraudage se faisant autant d'un côté que de l'autre. D'autre part, le projet de protocole de non-maraudage n'a pas été suffisamment débattu et négocié, en conséquence de quoi il s'est avéré sans effet.
M faut bien voir que le problème de l'unité syndicale est un problème politique dans la mesure où la législation du travail condamne souvent les centrales à manifester des intérêts contradictoires et divergents. La mise en relief de ces intérêts contradictoires et divergents est même favorisée par la loi, ce qui exacerbe encore davantage les conflits. On n'a qu'à penser à ce qui se passe dans le secteur de la construction pour voir combien le gouvernement a stimulé les divisions syndicales en légalisant le maraudage, ce qui fait que les règles du jeu, les législations et les structures syndicales jouent contre l'unité syndicale. Cela en est au point où on faitsouvent des négociations en fonction des périodes de maraudage à venir.
Les préjugés respectifs d'une centrale vis-à-vis une autre, souvent savamment entretenus par les média, ne favorise pas non plus beaucoup l'unité syndicale. Par exemple, depuis le premier Front commun dans le secteur public et para-public en 1972, la CSN a une image de centrale syndicale identifiée de façon quasi-exclusive aux travailleurs du secteur public alors que la FTQ apparaît comme une centrale de travailleurs du secteur pri-vé. D'autre part, l'image de la FTQ a trop souvent été, d'une manière simpliste, une image de "yes man" collé sur le gouvernement du P.Q. ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité de cette centrale.
M faut encore retenir que la conjoncture syndicale et politique globa le a eu un impact déterminant sur le problème de l'unitésyndicale. A cet égard, les problèmes du secteur de la construction au milieu des années '70, avec la mise en tutelle de syndicats par le gouvernement suite aux recommandations dans ce sens de la Commission Cliche , auront eu une grande influence sur toute la question de l'unité syndicale. La conséquence en a été la législation qui institutionnalisait la pratique du maraudage et des luttes in-ter-centrales. Dans ce sens, on dit trop souvent que le manque d'unitésyndicale est dû à la venue au pouvoir du Parti Québécois et aux appuis qu'il a reçus dans certains milieuxsyndicaux, alors que le problème réside davantage dans la conjoncture propre au mouvement syndical qui a précédé son arrivée au pouvoir, notamment dans le domaine de la construction avec la division entre la CSN et la FTQ qu'est venue consacrer la Commission Cliche.
Notons finalement que les rapports entre les secteurs public et privé de l'économie demeurent une dimension fort importante pour travailler la question de l'unité syndicale. Chaque centrale est sensible à ce problème. Il y a donc là aussi un enjeu important lié à la question de l'unité syndicale.
3) L'unité syndicale et les enjeux actuels du mouvement syndical dans son ensemble
Face à cela, il faut bien sûr faire les débats contre le maraudage pour favoriser l'unité syndicale. Mais il ne faut pas tout miser sur ces débats. L'unité syndicale, c'est un ensemble d'interventions à faire. Il faut d'abord compter essentiellement avec la base syndicale. Il y a beaucoup de distance entre les membres des syndicats et les instances syndicales à ce sujet. Il faut aussi penser que d'autres enjeux sociaux et politiques peuvent être mobilisateurs au niveau de l'unité syndicale. Il en est ainsi, par exemple, des problèmes de la condition des femmes, des problèmes de la sécurité et de la santé au travail. Si on parvient à mobiliser des mi- Htants syndicaux sur ces enjeux, à la base, cela sera sans doute fort sti mulant. On pourrait aller plus loin encore en mobilisant l'ensemble du mou vement syndical autour de la syndicalisation massive des travailleurs sala riés , ce qui impliquerait que le secteur public aide à la syndicalisation du secteur privé. A ce niveau, chaque centrale syndicaleserait appeler à collaborer à ce grand objectif de la syndicalisation massive.
D'autres enjeux du mouvement syndical serait aussi utiles pour favo riser l'unité syndicale. Les luttes contre le travail au noir ou contre le sous-traitance seraient des occasions de mobilisation qui permettraient de diminuer la division syndicaleet notamment la division entre les secteurs public et privé.
IV- SITUATIONS ET PRATIQUES SYNDICALES DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DANS LE SECTEUR PRIVE
I) Les capitalistes dans les secteurs privé et public
Il faut d'abord caractériser les capitalistes dans le secteur privé:notons que ce secteur est essentiellement celui de la production de marchandises, production contrôlée par des compagnies très puissantes, plus souventqu'autrement étrangères dont plusieurssont de grandes multinationales.
L'Etat, favorisant encore plus les multinationales que les capitalistes locaux, le rapport de force entre ce type de patrons et un syndicat local est, en dernière analyse, encore plus difficile à développer: plus souvent qu'autrement, le syndicat se trouve dans une situation d'isolement et de manque effarant de soutien des autres syndicats appartenant à la même multinationale.
2) Les travailleurs dans les secteurs privé et public
Dans le secteur public, la situation est passablement différente: les travailleurs syndiqués de ce secteur relèvent le plus souvent des appareils de l'Etat. Il s'agit d'appareils publics et para-publics, comme les écoles, les hôpitaux, les centres de services, etc. C'est une structure patronale à plusieurs niveaux. Il y a d'une part des autorités locales, regroupées aussi en fédérations ou associations. Il y a d'autre part, les divers Ministères de l'Etat provincial mais aussi les divers Ministèresde l'Etat fédéral. Cette structure patronale à divers niveaux peut entraîner plusieursproblèmes de coordination entre les divers niveaux des appareils et par là des problèmes de concertation entre syndicats impliqués.
Par ailleurs, si on examine les caractéristiques propres des travailleurs du secteur privé, il faut d'abord noter que le taux de syndicalisation est beaucoup plus faible. En outre, le travail dans des entreprises de type manufacturier est, d'un groupe de travailleur à l'autre, un travail relativement similaire, bien qu'ils soient très dispersés géographiquement et qu'ils soient composés de plusieurs communautés ethniques. Quant aux travailleurs du secteur public, il faut noter qu'une proportion assez importante d'entre eux sont de fait des syndiqués. En outre, à la différence des travailleurs du secteur manufacturier, le type de travail qu'ils font est souvent plus diversifié: on y relève des employés de soutien, des travailleurs intellectuels, du personnel clérical, etc. Cette composition variée des travailleurs de ce secteur peut poser, à l'intérieur d'un même syndicat, d'importants problèmes d'unité.
3) Les structures syndicales dans les secteurs privé et public
Au sujet des structures syndicales du secteur privé, mentionnons d'abord que les syndicats locaux de ce secteur sont souvent très isolés les uns des autres. Etant donné que la négociation se fait entreprise par entreprise, le rapport de force de l'organisation syndicale au niveau du Québec ou même au niveau régional ne peut jouer un très grand rôle. La solidarité autour des conflits et des luttessyndicales est alors quelque chose de très difficile à organiser. Beaucoup de syndicats locaux demeurent affiliés à des unions internationales sans adhérer à la FTQ. Ils échappent ainsi aux efforts faits en vue de créer des fronts de solidarité syndicale au niveau régional ou national.
Quant aux structures syndicales dans le secteur public, il faut d'abord noter que les syndicats locaux ne relèvent pas tous d'instances strictement régionales ou québécoises. Des regroupements pan-canadiens y exercent aussi un rôle non négligeable dans la mesure où certains gros syndicats canadiens ont une présence fort importante dans le secteur des appareils publics et para-publics.
A cause même des caractéristiques des structures syndicales dans les deux secteurs, le rapport de force de l'organisation syndicale au niveau du Québec ou même au niveau régional joue, dans le cas du secteur public, un grand rôle. C'est ainsi que le Front commun, en tant que rapport de force à l'échelle du Québec pousse davantage à agir au niveau des instances syndicales pluslarges. Comme l'Etatest le plus gros employeur, les conflits de travailatteignent une dimension politique, l'opinion publique et les mass média y étant plus directement mêlés.
Il faut noter cependant que les rapports entre les diverses instances syndicales du Front commun ne sont pas nécessairement très faciles. Par exemple, au cours du dernier Front commun, on a noté beaucoup de dissensions et de divisions au sein du mouvement syndical. Ce Front commun fut particulièrement fragile,il ressemblait plus à un mariage de raison. Les conseils de coordination et d'orientation de ce Front commun n'ont pas vraiment fonctionné et les comités de liaisonont été aussi très peu actifs. On a aussi vu, comme les journaux l'ont rapporté, des dissensions importantes au niveau de la négociation même. Du côté de la FTQ, des ententes de principes auraient été apparamment votées et signées et la FTQ aurait pressé le gouvernement de dire que ceux qui n'avaient pas réglé - en occurrence des syndicats de la CSN et de la CEQ - n'auraient pas plus que ce qu'elle avait elle-même obtenu. Cela a eu pour effet d'empêcher d'autres éléments du mouvement syndical de réussirdes percées. Cette attitude a considérablement nui à l'évolution des revendications syndicales au sein de ce Front commun.
Bref, si au Front commun de 1976, les rapports et les liens entre les diverses composantes du mouvement syndical ont été forts, en 1979, la situation a été complètement changée. Le mouvement syndical est alors apparu très divisé au niveau de ses revendications et de sa mobilisation. La coordination, apparaissant souvent extérieure aux divers syndicats impliqués, ne s'est faite que fort difficilement.
Il se pose donc entre les syndicats du secteur public et du secteur privé un important problème de liaison. Dans un cas, les luttes syndicales sont davantage liées aux rapports économiques de production, au capitalisme tant national que multinational. Dans l'autre cas, les luttes sont plus directement politiques et liées aux structures étatiques provinciales et fédérales. Ce qui veut dire que l'appui aux luttes syndicales varie d'un secteur à l'autre. Souvent, dans le secteur privé, les luttes syndicales demeurent relativement difficiles à diffuser et à comprendre. Dans le secteur public, les luttes sont tout de suite plus visibles et souvent elle sont surpolitisées à cause même du champ de négociation et du type de structures patronales. Ces différences entre le privé et le public n'aident pas beaucoup à l'unité syndicale.
Les rapports entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé sont aussi plus difficile du fait que la partie patronale utilise des stratégies et des idéologies qui tentent de diviser, de séparer les travailleurs salariés de ces divers secteurs. On fera ainsi croire que les travailleurs de ces secteurs ont des intérêts et des besoins divergents, sinon contradictoires. Par exemple, on dira que les travailleurs du secteur public sont payés à même les taxes des travailleurs majoritairement du secteur privé, que c'est à cause d'eux si les taxes sont si élevés... Au niveau du mouvement syndical dans son ensemble, il est difficile de dépasser ces images et favoriser des rencontres et des échanges entre syndiqués de ces secteurs. Diverses tentatives ont été faites pour rapprocher les travailleurs de ces secteurs, mais dans l'ensemble, l'existence de préjugés, savamment entretenus par la partie patronale, ne favorise pas les contacts entre ces divers salariés.
Finalement, il est permis de s'interroger sur la stratégie syndicale qui dans les années '70, a voulu faire du secteur public un pôle d'entraînement par rapport au secteur privé. Peut-être a-t-elle perdu de son efficacité et peut-être aussi est-elle moins comprise aujourd'hui qu'auparavant? Si cette stratégie a déjà donnée quelques résultats, elle ne fut pas efficace au cours du dernier Front commun. Au contraire, le fossé entre ces deux secteurs de travailleurs se serait accentué. Par contre, la fonction d'entraînement du secteur public n'a pas véritablement apporté les fruits escomptés.
Il se pose donc un problème de solidarité générale entre travailleurs de ces deux secteurs de l'économie. Il faut travailler au développement de la conscience de classe des uns et des autres pour permettre d'établir un pont entre ces divers groupe de travailleurs. Pour rompre la distance, il faut mettre les bases de ces deux secteurs en contact entre elles pour qu'il y ait de moins en moins de préjugés. Diverses instances régionales du mouvement syndical ont tenté de telles expériences et ont pu ainsi contribuer à réduire les écarts et les préjugés de ces diverses catégories de travailleurs. Il faut d'ailleurs démystifier quelque peu les différences entre les secteurs public et privé de l'économie si l'on veut favoriser la possibilité d'une plus grande sensibilisation à la dimension de classe des luttes de ces deux secteurs. D'autant que la question de la syndicalisation massive de travailleurs non-syndiqués devrait servir de stimulant à l'unité syndicale entre les travailleurs du public et les travailleurs du privé. Les uns et les autres pourraient être réunis dans cette tâche d'agrandir les rangs du mouvement syndical.
V- QUELQUES ENJEUX ACTUELS DU MOUVEMENT SYNDICAL QUEBECOIS
Il y a des enjeux plus globaux de l'action syndicale qui ne doivent pas être négligés quand on examine comment le syndicalisme de combat peut être mieux développé. Au nombre de ceux-ci, il y a d'abord la syndicalisation plus massive, notamment des travailleurs du secteur privé. Il y a aussi le problème de l'unité syndicalequi plonge des racines dans diverses dimensions de notre réalité économique et politique. Par exemple, le travail à la pige et la sous-traitance peuvent constituer des terrains de lutte aptes à favoriser l'unité syndicale dans la mesure où tout le mouvement syndical déciderait de s'attaquer à de telsproblèmes. Il en est de même de la question de la négociation sectorielle ou multipatronale et des diverses modifications à la législation du travail.
Au-delà du syndicalisme comme instrument de défense économique de groupes de travailleurs, il y a des problèmes sociaux que le mouvement syndical peut prendre en charge. Par exemple, des fronts de lutte importants peuvent être développés du côté de la condition des femmes, de la question nationale des problèmes de santé et de sécurité aux travail. Tous ces problèmes ont un potentiel de mobilisation politique très large et peuvent contribuer à diminuer les divisions syndicales et à favoriser le regroupement et l'unitédes diverses composantes du mouvement syndical.
Il est encore un autre défi auquel le mouvement syndical doit faire face, soit celui d'atteindre à une meilleure liaison entre les diverses composantes de la classe des travailleurs. Il s'agiten effet de tenter de coordonner et de réunir les travailleurs du secteur privé et du secteur public, les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels, les travailleurs de divers groupes ethniques et les salariés des diverses régions du Québec. Une meilleure articulation et liaison entre ces diverses composantes de la classe des travailleurs et du mouvement syndical permettrait à celui-ci de passer de luttes plusdéfensives à des luttes plus nettement offensives et à des luttes politiques plus larges. La vitalité même du mouvement syndical exige qu'il soit apte à engager des luttes sociales et politiques plus larges.
CHAPITRE III : LES SYNDICATS EN 1981: OU EN SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS?
INTRODUCTION
Le processus d'enquête dans lequel le comité "mouvement syndical" s'est engagé il y a de cela deux ans (organisations de tables-rondes avec des militants des trois centrales, sessions de formation, cueillette et relecture de documents des organisations syndicales...) nous a incités d'abord à laisser la parole aux militants que nous avons interrogés collectivement. Ce processus nous a par ailleurs engagés nous-mêmes dans une réflexion sur le syndicalisme et sur le militantisme syndical des années '80. C'est de cette réflexion dont nous voulons à ce chapitre-ci faire état, considérant qu'il s'agit plus d'une réflexion en vrac qui nous obligera ultérieurement (nous et d'autres nous l'espérons) à une analyse plus systématique, à un questionnement plus rigoureux susceptible à terme de favoriser un renouvellement des perspectives et des stratégies de lutte syndicale.
I- LES LUTTES SYNDICALES A LA BASE DANS LES ANNEES '70
Faut-il le rappeler, les exemples de lutte Iciprésentées révèlent un certainnombre d'avancées concrètes du syndicalisme à la base dans différents secteurs (le textile,la métallurgie, les hôpitaux, l'enseignement...) et dans les trois centrales (que ce soit à la FTQ, à la CSN ou à la CEQ). Avancées concrètes que d'aucuns ont identifiées sous l'appellation de syndicalisme militant ou de "syndicalisme de combat" 3ou encore de ce que d'autres ont suggéré comme étant l'émergence, dans les années '70, d'une gauche syndicale.
Qu'est-ce à dire, sinon que des travailleurs se sont progressivement impliqués dans leur syndicat en misantsur le développement d'une véritable démocratie interne (réunions de départements, tenue régulière d'assemblées générales, et mise sur pied de conseilssyndicaux...) et sur un ensemble de moyens susceptibles de la favoriser (l'information, la formation, la préparation d'une relève...). Ces travailleurs ont, au cours des luttes, modifié leurs vues quant au rôle que pouvait jouer le syndicat dans leur milieu de travail et de façon plus large dans la société: l'appartenance à un mouvement compte pour beaucoup, la liaison et l'unité inter-syndicale deviennent une préoccupation concrète, la prise en charge de problèmes relatifs à la sécurité-santé au travail,à la condition féminine, à l'oppression nationale... font l'objet de débats et d'interventions à la mesure du rapport de force qu'ils peuvent développer et du niveau de conscience de leurs camarades de travail.
Au bout du compte, on commence à s'éloigner, avec les années '70 de façon plus nette encore, d'un syndicalisme "police d'assurance" pour un syndicalisme qui défend différemment les intérêts des travailleurs quant aux salaires et aux conditions de travail tout en se posant agent de transformation sociale à un niveau plus général sans pour autant décoller du milieu de travail lui-même.
Les rencontres collectives que nous avons organisées ont aussi suggéré, comme certains nous l'ont fait remarquer, que les travailleurs du secteur public n'ont pas le monopole de la vitalité syndicale, ni non plus que cette nouvelle forme de syndicalisme appartient à une centrale plutôt qu'à une autre. Les préjugés tombant, c'est le besoin d'un terrain commun d'échange à des militants, autant du privé que du public, de la FTQ comme de la CSN ou de la CEQ qui s'est manifesté. Besoin auquel est venu s'ajouter un nouveau questionnement:
- La stratégie syndicale qui veut faire d'un secteur (le public)par rapport à l'autre, un pôle ou un facteur d'entraînement, est-elle aussi efficace, aussi affirmée que certains le prétendent?Faut-il vraiment tenir à une telle stratégie? Les bases syndicales y croient-elles?
- Comment, en outre, échapper aux pièges des stratégies patronaleset gouvernementales qui cherchent à diviser, à séparer les travailleurs d'un secteur par rapport à un autre, d'une centrale parrapport à une autre?
- Quelles sont les revendications communes susceptibles de mobiliser les uns et les autres? Comment favoriser l'unité inter-syn-dicale et inter-sectorielle en considérant que celle-ci ne peut se bâtir uniquement par en haut et qu'il faut donc prendre en compte les traditions particulières à chaque centrale, leurs positions et leurs susceptibilités respectives?
Les exemples de lutte ici présentées sont donc riches d'expériences: sur la manière dont il est possible de bâtir un rapport de force dans un milieu de travail, sur la manière de développer et de vivrel'appartenance à un mouvement, sur la manière aussi de faireavancer l'unité inter-syndi-caie dans un milieu donné. Ils sont aussi riches de questionnements: sur la question de l'unité inter-syndicale et sur les rapports entre les travailleurs du secteur public et du secteur privé.
Ce qu'il faut également mettre en relief, c'est que ces exemples ne sont pas des faits isolés: le syndicalisme militant ou le "syndicalisme de combat" a marqué les années '70, il a été dans le mouvement ouvrier québécois un fait politique significatif bien que minoritaire, particulièrement dans les quatre ou cinq premières années de cette décennie. Qu'est-ce qui l'a rendu possible? Dans cette perspective, il est important de le resituer dans le contexte économique, socialet politique de cette période.
II- LE QUEBEC DES ANNEES '70: LE MOUVEMENT SYNDICAL A L'OFFENSIVE
Pendant la période de 1970-1975, on assiste à une radicalisation du mouvement syndical: radicalisation dans les prises de position et dans les orientations des centrales (rejet du capitalisme, reconnaissance de la nécessité de l'action politique autonome des travailleurs...), radicalisation des luttes syndicales (refus de se laisser "encarcaner" par des lois spéciales, des injonctions...). Cette radicalisation qui prend forme dans les centrales reflète le développement d'une nouvelle conscience de classe au sein d'une couche de militants qui sont partie prenante des événements de '72 (Front commun du secteur public et para-public, emprisonnement des chefs syndicaux...) et de ceux de '74 (la lutte des syndicats pour l'indexation des salaires).
Ce n'est pas le fruit du hasard mais bien d'une transformation du rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes. Schématiquement, on peut expliquer cette radicalisation de la façon suivante: 1) il y a d'abord une expansion du capitalisme dans l'après-guerre (années '50 et début des années '60) qui favorise le développement de nouvelles industries (General Motors à Ste-Thérèse ou Firestone à Joliette pour ne citer que deux exemples); 2) il y a aussi le prolongement de ce développement économique, axé sur la recherche du maximum de profit, surtout dans les années '60, la modernisation de l'Etat québécois à laquelle s'emploient les capitalistes les plus importants aidés en cela par le Parti Libéral du Québec. C'est la période des grandes réformes avec la nationalisation de l'hydro-électricité, la restructuration des services hospitaliers et de sécurité sociale, !a réforme de l'enseignement...
De telle sorte qu'on se retrouve à la fin des années '60 avec des changements importants au niveau des classes sociales et notamment chez les travailleurs: 1) une augmentation des effectifs (de moins en moins d'artisans, de petits commerçants et de cultivateurs et de plus en plus de travailleurs); 2) l'apparition de nouveaux salariés dans des secteurs telsl'enseignement, l'information, la santé...; 3) une certainespécialisation et une plusgrande scolarisation d'une bonne partie des travailleurs; 4) aussi une classe ouvrière plus"tertiarisée" (employés à l'entretien dans les écoles, préposés aux malades dans les hôpitaux...).
Concrètement donc, dans l'enseignement, dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'usines, les travailleurs sont plus jeunes, plus qualifiés et plus scolarisés, et de ce fait plus disposés à la mobilisation, à la lutte. Changement important par ailleurs: l'Etat québécois devient un employeur de taille, le même pour une bonne partie de ces nouveaux salariés.
Et puis il y a cet autre facteur de radicalisation qui est la relance du mouvement national au Québec dans toutes les classesde la société. Bien que le mouvement national soit inscrit de façon prédominante dans une dynamique capitaliste de renforcement d'une bourgeoisie québécoise, certainssecteurs pluspopulaires de ce mouvement avancent des revendications qui mettent en relief la situation de dépendance économique et politiquedu Québec vis-à-vis du Canada et des Etats-Unis.
On se retrouve donc avec de nouveaux groupes de travailleurs, plus jeunes, plus qualifiés, plus scolarisés, plus disposés par le fait même au changement, plus sensibles aussi à la situation d'oppression vécue en tant que travailleurs québécois. Ce sont ces groupes de travailleurs qui vont progressivement s'organiser au plan syndicale et cela de façon massive. Dans cette période, le syndicalisme se renforce considérablement: la CSN passe de 94,000 membres en 1960 à 245,000 dix ans plus tard, le FTQ passe de 100, 000 membres en 1960 à 230,000 membres en 1970, la CEQ passe de 28,000 membres en 1960 à 70,000 en 1970. En dix ans seulement, le total des effectifs syndicaux qui était en deçà de 30% se rapproche du 40% . 4
Le mouvement syndical au début des années '70, se trouve donc dans de bonnes conditions pour passer à l'offensive: la lutte nationale telle qu'amorcée dans les années '60 (contre le Bill 63, pour le McGill français...), la lutte pour la syndicalisation dans le secteur public, les luttes étudiantes (occupations des Cégeps), le développement de groupes populaires à la base dans un certain nombre de quartiers des centres urbains comme Montréal, Québec, Hull, la naissance de média communautaires, l'ouverture du mouvement ouvrier et populaire à la solidarité internationale (Chili...)... puis l'électro-choc de l'occupation armée du Québec constituent l'arrière-plan social et politique d'un certain nombre de militantssyndicaux de cette période qui participent au Front commun du secteur public et para-public avec toutes les implications du moment: des occupations de postes de radio, des contrôles de villes et de municipalités (Thetford, Sept-Iles...), des manifestations anti-capitalistes... crise du gouvernement Bourassa en '70, recrise du gouvernement Bourassa en '72... 5
La mobilisation est donc relativement massive chez les travailleurs syndiqués qui bénéficient en plus de larges appuis populaires 6, la politisation rapide mais... car il y a un mais: "Nous avons mal évalué le degré d'enracinement de cette nouvelle conscience. Ça a été une flambée, On a trop facilement pris pour acquis que l'accord des travailleurs sur de grands objectifs allait entraîner une lutte à finir de leur part... la radicalisa-tion était d'abord syndicale... C'est la ripostede l'Etat qui a porté l'affrontement sur un terrain plus global, politique, d'affrontement avec l'Etat... et on n'était pas organisé pour soutenir la batailleà ce niveau". 7
De telles sortes qu'au moment où arrive le P.Q. au pouvoir en 1976, le mouvement syndical dans la majorité de ses composantes est essoufflé et quelque peu désarmé. Car il y a aussi les séquelles de cette radicalisation: crise de directionà la CSN (la formation de la CSD) , développement des syndicats indépendants, rupture de l'unitéinter-syndicale avec la Commission Cliche (particulièrement du côté des syndicats CSN et FTQ dans la construction), coupure entre les militantset leur base dans un certain nombre de syndicats... projet social nouveau présent dans la gauche syndicalemais encore flou et sans articulation politique... Alors que le P.Q., c'est un parti, avec un programme, une base militante et hégémonie sur un mouvement national qui a un passé de crédibilité, de légitimité et qui est capable au moment de son arrivée au pouvoir d'aller se chercher des alliés du côté des journalistes, des enseignants... et de maintenir ses appuis dans différents secteurs du milieu, ceux-ci reportant davantage leur espoir sur le P.Q. que sur le mouvement syndical.
III- LA FIN DES ANNEES '70: LE MOUVEMENT SYNDICAL SUR LA DEFENSIVE
Avec les années '74-'75, la crise économique tant au niveau national qu'international tend à s'amplifier: un taux élevé de chômage coexiste avec un taux élevé d'inflation, le dollar perd de la valeur sur la plan mondial provoquant au bout de la ligne des déficits budgétaires plus imposants du côté gouvernemental.
C'est dans ce contexte qu'à la fin de '75, le gouvernement fédéral décrète le gel des salaires. C'est là le signal d'une reprise de l'offensive gouvernementale et patronale contre les syndicats. Dans un contexte de crise de l'Etat (remise en question des politiques sociales antérieures dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux. ..),8 le rapport de force se modifieconsidérablement car l'Etat intervient plus que jamais dans les conflitsavec tout son arsenal législatif et judiciaire. La situationéconomique d'ensemble devient donc plus aiguë: hausse rapide des prix,licenciements massifs et fermetures d'usines, coupures de postes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Ce qui place le mouvement syndical sur la défensive.
De façon plus globale, c'est à une réorganisation du capital, tant au plan international que national que nous assistons: une stratégie de sortie de crise se met en place, qui amène le déménagement des secteurs moins rentables (textile, chaussure, vêtement...) vers les pays du tiers-monde et la consolidation des secteurs de pointe(informatique, électronique...) dans certains pays (Etats-Unis, Allemagne, Japon). De façon particulière l'économie canadienne est marquée par l'investissement plus fort dans l'exploitation du pétrole, du gaz, de l'hydro-électricité au détriment du secteur industriel, manufacturier (ce secteur représentait 26% des emplois en '66, alors qu'aujourd'hui, il n'en représente que 19% 9).
La stratégie de sortie de crise du patronat et de l'Etat n'implique pas seulement la réorganisation de l'économie (investissement/désinvestissement) mais aussi une réorganisation du travail: une décentralisation des entreprises et de la production avec le développement de la sous-traitance et un nouvel essor du travail à domicile..., une extension du travail à temps partiel10 particulièrement dans les secteurs de la santé, des services sociaux, de l'enseignement et de l'information.
Cette réorganisation d'ensemble de l'économie et du travail affecte de façon particulière certaines catégories de travailleurs: les jeunes, les femmes, les immigrants.
Face à cette situation, les syndicats ont été plus ou moins pris de court: on a cherché à répondre au plus pressé (non aux fermetures d'usines, non aux coupures de postes) en improvisant. La venue au pouvoir du P.Q. a pris les syndicats par surprise et le déploiement de nouvelles stratégies patronales n'a pas été immédiatement saisi. C'est ainsi que plus souvent qu'autrement les syndicats et beaucoup de leurs militants se sont trouvés de plus en plus démunis: On y pense à deux fois avant de faire une grève illégale quand on voit la batterie de moyens systématiquement utilisés directement ou indirectement tels les poursuites, les lois spéciales, les recours collectifs utilisés par de pseudo-comités d'usagers,le retour en force du syndicalisme de boutique (cas de Commonwealth Plywood), la non-application des sentences arbitrales dans des cas de congédiements. On y pense à deux fois avant de participer à des sommets économiques lorsque le gouvernement du P.Q. nous y invite alors qu'avec Bourassa la réponse était non, immédiatement.
Finalement, dans les dernières années, au bilan, les syndicats se retrouvent avec peu de victoires et beaucoup d'échecs: grèves longues qui finissent en queue de poisson, le Front commun du secteur public et para-public qui finit en rangs dispersés avec comme arrière-plan politique la défaite référendaire du 20 mai '80. Défaite qui n'est pas seulement celle du P.Q., mais aussi celle de toutes les forces populaires 11pour lesquelles la lutte contre l'oppression nationale représente un enjeu certain. Les syndicats se retrouvent aussi plus divisés: tensions à l'intérieur de chaque centrale et division inter-syndicale causée par l'attitude respective des centrales vis-à-vis du gouvernement Lévesque, par le maraudage légalisé dans la construction suite à la Commission Cliche...
Les syndicats lorsqu'ils engagent des batailles sont dès lors dans un rapport de force qui leur est défavorable. Mais en même temps, on constate de plus en plus les limites qu'impose le code du travail à la syndica-lisation, car le taux global des effectifs syndicaux est en régression ou du moins il plafonne. 12
IV- LES ANNEES '80: LE MOUVEMENT SYNDICAL FACE A LA CRISE
Sans céder à la facilité et au pessimisme en parlant de reflux et de désaffectation, on peut néanmoins identifier un certain désenchantement chez un bon nombre de militants syndicaux en même temps qu'un début de remise en question des stratégies syndicales actuelles. Car si la mise en é-chec du syndicalisme s'explique en bonne partie par l'offensive patronale et gouvernementale, cette offensive ne peut masquer les insuffisances propres aux syndicats eux-mêmes: 1) que proposons-nous pour répondre aux problèmes de fermetures d'usines et aux coupures de postes? 2) que proposons-nous pour défoncer le plafond actuel de la syndicalisation des travailleurs? 3) que proposons-nous pour répondre aux nouvelles formes d'exploitation du travail féminin (temps partiel, travail à domicile...)? 4) quels rapports les organisations syndicales - surtout dans le secteur public - peuvent-elles établir avec l'ensemble de la population?...
1) Les syndicats face aux fermetures d'usines et aux licenciements
Le problème est majeur: entre 1978 et 1980, pas moins de 684 fermetures ont touché près de 39,000 travailleurs. 13 Mais jusqu'à maintenant, les revendications du mouvement syndical, plus souvent qu'autrement, se sont portées en direction des gouvernements: obligerles entreprises à publier leurs états financiers, obligerles entreprises à un pré-avis, obliger les entreprises à indemniser les travailleurs licenciés, obtenir un meilleur régime d'assurance-chômage. Parallèlement à cela, on négocie entreprise par entreprise des clauses de sécurité d'emploi, l'élimination des sous-contrats, l'augmentation des semaines de vacances payées.
Dans le premier cas, on se sent complètement impuissant, dans le second, on se sent à peu de choses près complètement isolé. Dans un cas des revendications politiques coupées de toute mobilisation syndicale, dans l'autre des revendications syndicales locales, coupées de tout prolongement au niveau national. Alors que faire? Comment bloquer la restructuration capitaliste qui se fait sur le dos des travailleurs?
Dans le mouvement syndical européen (France, Italie...), plusieurs secteurs du syndicalisme affirment qu'il ne faut pas se contenter de développer les politiques patronales et gouvernementales, non plus que de pratiquer l'anti-capitalisme verbal: il faut lutter pour une "répartition égalitaire entre hommes et femmes de l'ensemble que constitue le travail salarié, le travail ménager et les tâches d'éducation des enfants"14. C'est ce qui lesconduit à opter pour une réduction substantielle des heures de travail comme revendication-clé de la période actuelle.
Car cette revendication est à la charnière de plusieurs problèmes: c'est une manière de lutter contre le chômage d'abord. Autrement dit, sauver des emploisqui sont menacés ou qui risquent de l'être demain. C'est ainsi qu'aux Etat-Unis, on estime qu'en réduisant la semaine de travail de 5 heures pour les 37 millions de personnes qui en travaillent 40 et pour les 24 millions d'autres qui en travaillent plus de 40, on pourrait créer 8,700,000 emploi. 15 C'est aussi potentiellement une manière de vivre autrement (plus de temps à soi, pour se répartir les tâches à la maison, pourses loisirs, pour militer...). C'est aussi questionner une société bâtie par/pour et en fonction uniquement du travail (le productivis-me). Alors peut-être qu'il y a de ce côté une piste à explorer plus à fond.
D'autre part, il y a des luttes, comme par exemple celle contre la fermeture de la boulangerie Vaillancourt à Québec, qui démontrent que l'on peut faire mieux et autre chose que de négocier le placement de travailleurs ailleurs16: lutter pour des emplois perdus à partir d'un projet de ré-ouverture (élaboré par le syndicat avec l'aide d'économistes militants). Ce qui implique d'imposer certaines conditions: le droit à l'information, la réintégration des travailleurs par ordre d'ancienneté...
2) Les syndicats dans le secteur public: revendications des travailleurs et qualité des services
Les grèves dans les services publics sont depuis plus de 10 ans constamment discréditées. Le gouvernement et le patronat ne manquent jamais d'exploiter en leur faveur l'impopularité de ces grèves dans une population momentanément privée d'un service qu'elle juge essentiel: transport en commun, soins dans les hôpitaux.
Face à cela, la réponse communément admise par les syndicats est que les intérêts des travailleurs (leurs revendications) correspondent à ceux de la population. En d'autres termes, l'amélioration des conditions de travail des employés dans les hôpitaux provoque par le fait même l'amélioration des soins. Par exemple, lutter pour la diminution de la charge de travail (moins d'enfants par classe, moins de malades à s'occuper par préposé...) c'est dans les faits, favoriser ces enfants ou ces malades puisque les enseignants ou les préposés aux bénéficiaires disposeront de plus de temps à consacrer à chacun. Si l'exemple est simple et semble avoir toutes les apparences de l'évidence, il n'en va pas ainsi dans la population qui plus souvent qu'autrement est convaincue du contraire. Pourquoi alors?
Un premier facteur renvoie certainement à l'utilisation contre les syndicats des mass média par le patronat en général et par le gouvernement en particulier surtout lorsqu'il s'agit de grèves dans le secteur public où ce même gouvernement est immédiatement concerné. Mais ce facteur n'explique pas tout, loin de là. Sinon la réaction de la population aurait été à peu de choses près la même au moment du Front commun de 1972, celui de 1976 et de 1979. Ce qui ne fut pas le cas, surtout si on compare 1972 et 1979: en 1972, le Front commun avait réussi à gagner la sympathie de la population, sympathie même très active dans certains milieux; en 1979, c'est le contraire qui s'est produit, le Front commun était très isolé.
La coupure entre les travailleurs du secteur public et la population provient en bonne partie du processus de bureaucratisation et de centralisation marquées des services sociaux, de l'éducation et des services de santé. Cette bureaucratisation a complètement mis à l'écartles usagers et l'ensemble des citoyens:17 les conflits depuis une dizaine d'années ne se situent, à l'intérieur de ces institutions, qu'entre la partie patronale (gouvernement et administrations) et les employés organisés en syndicats. La population dans son ensemble (pas seulement les usagers immédiats) a été écartée de plus en plus de toutes les décisions prises dans ces institutions, sans pour autant qu'elle puisse s'organiser pour réagir à cette situation. Ce qui ne fut pas le cas des travailleurs de ces services qui ont pu s'organiser en syndicat au moment où s'amorçait ce processus de bureaucratisation et de centralisation (1965-66). La population ne disposant d'aucun moyen approprié d'exprimer de façon autonome son point de vue, les usagers immédiats de ces services constituent dès lors une masse de manoeuvre intéressante pour les pouvoirs en place qui les utilisent au besoin pour justifier leur propre politique (exemple le comité des malades de l'hôpital St-Charles Boromée).
Un troisième facteur joue en défaveur des travailleurs des services publics dans leurs rapports avec la population en général et les usagers en particulier: la réorganisation du travail. L'aggravation de la crise économique au milieu des années '70 a amené le patronat et le gouvernement à vouloir réduire les coûts de production: on augmente les charges, on minute les soins infirmiers dans les hôpitaux 18on multiplie les temps partiels... Autant d'exigences dans les normes de production qui obligent les employés des services publics à faire rapidement et sans application le travail qui est le leur. La qualité des services s'en trouve diminuée: les usagers en font les frais et les travailleurs y sont astreints. Mais ce sont ces derniers qui écopent de cette situation, bien placés qu'ils sont pour servir de boucs-émissaires.
Face à cela - propagande anti-syndicale du patronat et du gouvernement, bureaucratisation et centralisation des services, réorganisation du travail en fonction d'une réduction des coûts de production - les organisations syndicales ont plutôt opéré une repli défensif (non aux coupures de postes...). Elles tardent à renouveler leurs politiques et leursstratégies de lutte: quelles sont les politiques avancées par les syndicats du secteur public et par le mouvement ouvrier et populaire en général en matière de santé, d'éducation, de services sociaux qui prennent en compte ces nouvelles données? Quand il y en a, elles ont peu d'enracinement chez les travailleurs syndiqués eux-mêmes et encore moins dans l'ensemble de la population. La question demeure donc entière à ce stade-ci: comment développer une véritable convergence de vue, des politiques communes et des luttes conjointes des travailleurs de ces services et de la population qui en bénéficie?
Les réponses à cette question ne peuvent s'élaborer que sur le long terme. Mais à court terme, ne peut-on par réviser les formes de lutte syndicale dans ce secteur: faire la grève dans le secteur public comme on la fait dans le secteur privé, c'est dans ce nouveau contexte, souvent se condamner au repli et à l'isolement. Dans ce sens, l'expérience des travailleurs de l'Institut A.Prévost à Montréal au moment du Front commun de 1972 est suggestive: l'Institut avait été occupé par les travailleurs qui avaient eux-mêmes organisé lesservices aux malades après avoir mis à la porte administrateurs et cadres. Dès lors, ils faisaientd'une pierre deux coups: ils ne pouvaient prêter flanc à la propagande gouvernementale 19 et se trouvaient - temporairement du moins - dans de bonnes conditions pour remettre en question l'organisation du travail et des services au sein de l'Institut. A travers cet exemple, il y a l'illustration concrète d'une manière différente de faire la grève dans le secteur public qui, loin de diminuer l'efficacité de la pressionsyndicale, lui donne au contraire un impact plus grand.
V- QUESTION NATIONALE ET PROJET DE SOCIETE
Depuis 1972, les organisations syndicales ont quelque peu négligé, à l'intérieur de leurs rangs, la poursuite du débat sur le projet de société. M n'en demeure pas moins que la réflexion et la conscience des membres se sont quand même développées suite à des luttes importantes (les Fronts communs, la lutte contre la loi C-73, etc), suiteaussi à la mobilisation autour de revendications concernant notamment la condition féminine et la santé-sé-curi té au travail.
D'autre part, l'avènement du Parti Québécois au pouvoir et le référendum qui s'annonçait par la suite, a provoqué à nouveau des débats dans le mouvement syndical sur la question nationale. N'oublions pas que la venue au pouvoir du Parti Québécois a constitué, pour une partie importante des travailleurs, un véritable espoir de changement. Aussi, le Parti Québécois avait réussi, au cours des années précédentes, à établirune hégémonie presque complète sur l'ensemble du Mouvement national au Québec.
1) Un point de vue autonome du mouvement ouvrier
L'enjeu était donc de taille, en 1977, pour le mouvement syndical: développer sur l'ensemble de cettequestion une position qui lui soit propre et formuler sur ses propres bases des revendications luipermettant de lutter contre l'oppression nationale. Il étaitapparu évident que quelque soit l'issu de ces débats, cela aurait des conséquences sur les conditions de vie et de travail de l'ensemble du peuple québécois.
A cet effet, des énergies immenses ont été mises à contribution dans les principales centrales syndicales pour faire en sorte de formuler un point de vue autonome du mouvement ouvrier sur cette question. On doit tout de même préciser que les démarches de la CSN et de la CEQ sont davantage allées dans cette direction, à la différence de la position soumise par les dirigeants de la FTQ lors de leurcongrès spécial sur la question nationale et qui n'est ni plus ni moins qu'un appui inconditionnel au projet du Parti Québécois.20 Ce travail d'éducation et de sensibilisation à l'intérieur du mouvement syndical a permis la formulation et l'adoption d'un ensemble de revendications visant à lutter contre l'oppression nationale. Elles concernent autant le droit au travail que la sécurité-santé, l'amélioration du pouvoir d'achat, le français comme langue de travail, etc, questions qui en tout point manifestent le vécu de l'oppression nationale du peuple québécois; taux de chômage plus élevé qu'en Ontario... 21
Cette plate-forme de revendications, non seulement vise-t-elle à donner un sens concret à la luttecontre l'oppression nationale, mais aussi s'inscrit-elle dans un processus pour faire avancer notre projet de société.
"Formuler démocratiquement nos revendications, travaillera les faire connaître, discuter et partager par le plus grand nombre, susciter les mobilisations nécessaires à leur développement, faire de nouveaux pas, tout cela c'est la façon pour notre organisation syndicale de faire avancer notre projet de société."22
Les positions jusqu'ici adoptées par le mouvement syndical ont donc permis de nous démarquer du projet mis de l'avant par le Parti Québécois. Reste à définir de façon plus explicite la position du mouvement syndical face à la question de l'Indépendance du Québec. Ce débat devrait être relancé le plus tôt possible afin de préciser en quoi l'Indépendance s'inscrit dans notre démarche vers une société socialiste et démocratique.
Cette démarche pose aussi les limites de l'action syndicale et renvoie à la question importante du pouvoir politique. Les classes populaires au Québec ne pourront pas toujours laisser à des partis politiques qui ne représentent pas nos intérêts, le loisir d'occuper complètement le champ politique. Ainsi, le mouvement ouvrier doit travaillerà la construction de l'organisation politique susceptible de regrouper et d'unifier l'ensemble des fronts de lutte au Québec.
2) Faire avancer notre projet de société
L'ensemble des luttes que les travailleurs ont menées et mènent encore aujourd'hui dans chacun de leur milieude travail et sur l'ensemble des conditions de vie manifestent en soi une volonté de résistance aux formes diverses de l'exploitation capitaliste. Mais n'oublions pas d'autre part qu'encore aujourd'hui, les travailleurs qui s'organisent en syndicat le font d'abord et avant tout parce qu'ils ont pris conscience de la nécessité de se regrouper pour mieux défendre leurs intérêts. Définies ainsi,les organisations syndicales sont des organisations de classe parce qu'elles regroupent exclusivement des travailleurs en même temps qu'elles recherchent activement à dégager des revendications et des orientations en fonction d'une classe, celle des travailleurs. Elles sont aussi des organisations de masse parce qu'elles comprennent dans leursrangs des travailleurs qui ne partagent pas tous la même idéologieet les mêmes choix politiques.
Il faut donc tenir compte de ces caractéristiques importantes du mouvement syndical si l'on veut comprendre la spécificité de la démarche syndicale quand on parle de projet de société. Donc, l'ensemble des revendications et des orientations mises de l'avantpar les organisations syndicales doivent chercher à susciter l'adhésion la plus large possible et prendre en considération les différentes orientations politiques de leurs membres.
Surtout depuis la fin des années soixante, le mouvement syndical a constaté l'importance d'intervenir dans les débats politiques dans la mesure où ces questions ont des conséquences directes sur l'ensemble des conditions de vie des travailleurs et des classes populaires. Durant cette période, tout un ensemble de conditions (les négociations des employés du secteur publicet para-public contre le régime Bourassa, les luttes importantes contre les multinationales, le développement et l'enracinement du mouvement national) ont fait en sorte d'amener les principales centrales syndicales à questionner le fonctionnement de la société capitaliste au Québec.
L'ensemble de ces réflexions a conduit à la parution de trois manifestes importants: "Ne comptons que sur nos propres moyens" (CSN), "L'E cole au service de la classe dominante" (CEQ), et "L'Etat, rouage de notre exploitation" (FTQ). Ces manifestes, avec les débats et même les divisions
qu'ils ont entraînés, constituent un moment de rupture important au plan idéologique avec le système capitaliste.
En janvier '8l, lors d'un colloque réunissant des travailleurs des mines et auquel étaient invités deux délégués du syndicat "Solidarité" de Pologne, Norbert Rodrigue, président de la CSN, affirmait: "Le socialisme auquel réfère la CSN est davantage un point d'appui et de référence pour faire prendre conscience aux travailleurs qu'il est possible de vivre et de travailler autrement". Ce projet de société, tout en s'inscrivant dans les luttes que les travailleurs ont menées depuis les 150 dernières années au nom du socialisme, veut aussi se démarquer des déviations importantes qui caractérisent les expériences socialistes que l'on connaît aujourd'hui. Aussi, ce projet socialiste n'est pas érigé comme un dogme auquel les membres doivent adhérer obligatoirement. Il est davantage, comme l'affirmait un dirigeant syndical, l'expression d'une recherche collective et d'un processus créateur auquel le plus grand nombre de travailleurs doivent apporter leur contribution.
3) Inscrire ce projet dans nos luttes quotidiennes
La conscience des travailleurs ne progresse pas uniquement par l'action idéologique. Elle se développe d'abord et avant tout par les luttes qu'ils mènent contre l'exploitation capitaliste.
Cependant, le mouvement syndical n'a pas toujours su faire ressortir le lien entre les luttes que l'on mène quotidiennement dans chacune de nos boîtes et notre combat plus global pour changer la société.
Le militant qui travaille pour faire de son syndicat un instrument vraiment démocratique au service de ses membres, les travailleurs qui se battent pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes, le syndicat qui veille à protéger l'intégrité physique de ses membres, tous luttent pour améliorer leur condition d'existence. Malheureusement, nombreux sont les militants qui, parce qu'ils ne voient pas dans quelle direction vont ces luttes, perdent courage et abandonnent.
N'est-ce pas là une tâche essentielle des militants syndicaux aujourd'hui de tenter de redonner un sens et un espoir aux travailleurs en lutte si l'on veut sortir d'un syndicalisme souvent encore affairiste.
Le projet socialiste n'est pas un projet figé, abstrait, il se construit chaque jour dans nos luttes , dans nos débats, il prend corps dans nos revendications. Les années qui viennent devront servir à préciser le type de société dans lequel nous voulons vivre.
Le soin de définir un projet de société n'appartient pas qu'aux organisations politiques. Il appartient aussi aux organisations de masse de susciter dans leurs rangs le débat à cet effet. L'exemple de la Pologne est assez éloquent à ce sujet.
CONCLUSION
LE SYNDICALISME FACE A LA CRISE: REDEVENIR UNE FORCE DE PROPOSITION
Nous avons soulevé ici deux problèmes-clés auxquels sont confrontés présentement les organisations syndicales: celui des fermetures d'usines dans le secteur privé et celui des coupures de postes et de la qualité des services dans le secteur public. Il y en a d'autres: 1) celui de la con-dition des femmes, de l'ensemble des discriminations qu'elles subissent au travail et dans leur vie quotidienne (garde des enfants, responsabilité principale dans les tâches ménagères, contraception, viol,avortement...); 2) celui du travail au noir qui prend un nouvel essor non seulement dans les secteurs traditionnels comme le textile et le vêtement mais aussi dans de nouveaux secteurs comme l'informatique, la traduction...23; 3) celui de la santé non seulement au travail mais aussi dans le cadre de vie (quelle production pour quel environnement?); 4) celuidu développement économique et donc de la qualité des produits et de leur utilité sociale (que produit-on et pour qui?); 5) celuides conditions de vie en dehors du mi lieu de travail (logement, loisirs, culture...).
Ces problèmes sont et doivent être attaqués de front par des luttes syndicales menées au coup par coup quotidiennement: que l'on pense aux travailleurs de l'entreprise "Les doigts de fées" dans la région de Québec qui résistent à la fermeture de l'usineet à la tentative de développer une sous-traitance ailleurs, que l'on pense aux travailleurs de CPVC à Valleyfield qui dénoncent la production d'explosifs destinés au gouvernement d'Afrique du Sud, que l'on pense aux travailleurs forestiers qui dénoncent les compagnies qui détruisent les forêts pour maximiser leurs profits, que l'on pense à la démarche des syndicats CSN/CEQ/FTQ à Montréal conjointement avec les groupes populaires pour élaborer des alternatives au développement capitaliste de la région métropolitaine, que l'onpense à la lutte de nombreux syndicats pour s'attaquer aux problèmes de la sécuritéet de la santé au travail ...
Ces luttes doivent cependant s'inscrire mieux et de plus en plus dans un projet d'ensemble où les différentes composantes de la gauche du mouvement ouvrier et populaire québécois (syndicats, groupes populaires, organisations féministes, organisations étudiantes...) se donnent les outils politiques nécessaires en direction d'une société radicalement nouvelle,différente, de caractère socialiste. C'est à travers ce type de luttes et dans cette perspective que le syndicalisme, souvent mis sur la défensive ces dernières années, peut redevenir une force de proposition.
BIBLIOGRAPHIE SUR LE SYNDICALISME
La liste ci-dessous ne contient pas toutes les références que nous avons utilisées. Elle suggère quelques ouvrages par thème qui peuvent permettre à chacun d'approfondir un peu plus tel ou tel aspect du syndicalisme.
1 - Histoire du syndicalisme au Québec et au Canada
- CSN-CEQ, Histoire du mouvement ouvrier au Québec (1825-1976),Montréal, 1979.
- Lipton, Charles, Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec ( 1827-1959),Ed. Parti Pris, 1976.
2- Le syndicalisme au Québec dans les années '70
- Leclerc A., Les lendemains du lendemain qui n'a pas chanté, dans L'impasse,Ed. Nouvelle Optique, Montréal, 1980, p.27 à 44.
- Ethier, Piotte, Reynolds, Les travailleurs contre l'Etat bourgeois, (avrilet mai 1972), Ed. L'aurore, Montréal, 1975.
- Piotte J.M., Le syndicalisme de combat, Ed. Albert St-Martin, Montréal, 1977
3- Les syndicats face aux fermetures d'usines et aux licenciements
- Revue Vie Ouvrière, Ils ferment a vec notre argent, No 154, mai-juin 1981.
- FTQ, Pertes d'emplois: mobilisation, document de travail du colloque organisépar la FTQ, les 15-16-17 février 1981.
- CSN, La réduction du temps de travail avec pleine compensation, document detravail du Service d'action politique, novembre 1979.
4- Les syndicats et la sous-traitance, le travail à temps partiel, le travail au noir
- Revue Vie Ouvrière, Le travail en miettes (le temps partiel), No 133, novembre'79
- Revue Vie Ouvrière, Quand les usines émigrent dans les foyers, No 151 février '81
- Bernier C, Le travail à temps partiel, IRAT, avril 1978
- Bernier C, et David H., A l'ouvrage (l'organisation du travail au Québec)IRAT, juin 1981 .
5 - Les syndicats et la condition des femmes
- CFP., Le mouvement des femmes au Québec, Montréal, mars 1981 .
- Maruani M, Les syndicats à l'épreuve du féminisme, Ed. Syros, 1979 -
- CSN, La lutte des femmes, combat de tous les travailleurs (1976) et La luttedes femmes pour le droit au travail social (1978), comité de la conditionféminine.
- CEQ, Droit réel des femmes au travail social, rapport au congrès de '80.
- FTQ, Une double exploitation, une seule lutte, document ayant servi aucol loque de '79.
6 - Les syndicats et la question de la sécurité-santé
- Daum et Stellman, Perdre sa vie à la gagner, Ed. Partis Pris, col.Ouvrier, '79•
7 - Les syndicats et la question des conditions de vie
- Conseil Central de Montréal (CSN), Sommet populaire de Montréal, doc. detravail, avril '80.
- Centre d'animation et d'analyse en loisir (CANAL),Loisirs et pouvoir populaire.Ed. Desport, Montréal, 1980.
8 - Les syndicats et la question nationale
- C.F.P., Le mouvement ouvrier québécois, ces revendications à propos de la question nationale, avril 1979 -
- C.F.P., Poursuivre la lutte nationale, mars 1981.
- CSN, Rapport du comité d'orientation au congrès spécial de la CSN sur laquestion nationale, juin '79.
- CEQ, S'approprier la question nationale, juin 1978.
- FTQ, document du 16ème congrès, nov. 1979.
- Revue Vie Ouvrière, Question nationale et réalité ouvrière, No 141, janv. '80.
9 - Les syndicats et l'action politique
- CFP, Les syndicats et la question du parti des Travailleurs, mai 1978.
10 - Le syndicalisme: orientations et perspectives
- Désy, Ferland, Lévesque, Vaillancourt, La conjoncture au Québec au début
- des années ' 80, les enjeux pour le mouvement ouvrier et populaire. Librairie Socialiste de l'Est, l98O.
- Maire E., Reconstruire l'espoir, CFDT, Paris, Points/Seuil, 1980
- En collaboration, La crise et les travailleurs, colloque des 12-13 octobre1979, U.Q.A.M., Ed. CEQ, 1979-
- CEQ, Renforcer nos acquis, Bâtir notre avenir, document de consultation,congrès d'orientation, phase I, fév. '81.
- CSN, Evaluation de la réflexion collective sur le document "Ne comptonsque sur nos propres moyens" (1972) et Rapports du Comité d'orientation au congrès de 1978 et au congrès spécial de juin '79.
ANNEXE : GRILLE DE TRAVAIL SUR LE SYNDICALISME
OBJECTIFS ET MOYENS POSSIBLES D'UN SYNDICALISME MILITANT
1. Au niveau des luttes économiques: mise de l'avant de revendications plus égalitaires:
- réduction des écarts hommes - femmes;
- réduction des écarts régionaux;
- augmentation pour bas salariés;
- salaire minimum décent pour tous, selon ses besoins...
2. Au niveau des luttes portant sur les conditions de travail: mise del'avant de revendications sur la qualité de vie en milieu de travailou à portée sociale:
- santé - sécurité ;
- réduction des heures;
- droits de gérance à limiter;
- droits parentaux.
3. Développement de nouvelles formes de luttes: collectivisation desluttes - développement de la solidarité:
- Fronts communs (public, para-public et privé);
- lien entre les conflits...
4. Organisation plusdémocratique et plus militante de la vie syndicale:
- démocratisation des syndicats;
- décentralisation de l'application de la convention;
- débureaucratisation;
- enracinement des revendications et des positions adoptées par lesinstances;
- démocratisation et partage de l'information...
5. Elargissement de la perspective syndicale (assumer la portée sociale et politique du syndicalisme):
- déboucher sur un syndicalisme à portée sociale;
- participation aux différentes structures de pouvoir;
- uniformisation des conditions de travail, ce qui implique que l'onrejoigne les non-syndiqués, les secteurs les plus démunis;
- participation du syndicalisme à la vie sociale (ex.: radio commu-
- nautaire, CRD)...
6. Importance accrue de l'information et de la formation. Contenu plus. progressiste et plus englobant:
- démocratisation de l'information;
- dimension capitale de la démarche d'éducation;
- ouverture sur les problèmes économiques;
- éducation syndicale plus progressiste et plus englobante...
7. Développement d'une conscience et d'une perspective de classe:
- élever la conscience des travailleurs;
- renforcer l'autonomie des syndicats;
- démasquer le rôle de l'Etat;
- l'exploitation: une réalité largement partagée.
8. Développement de l'unité syndicale:
- la solidarité syndicale implique l'unité syndicale;
- l'unité syndicale: condition essentielle pour l'avancement de l'idée du socialisme.
9. Insertion dans le mouvement syndical mondial:
- développement de la solidarité internationale...
10. Développement de l'idée du socialisme:
- conditions à mettre en place pour faire progresser l'idée du socia-lisme;
- ajuster nos pratiques syndicales à notre option socialiste.
Trois questions se greffent à cet ensemble d'objectifs et de moyen? qui s'inspirent du syndicalisme militant des dernières années:
- Comment avons-nous travaillé à la réalisation de ces objectifs?
- Quels en ont été les résultats?
- Quelles leçons en tirons-nous pour l'avenir?
|
|
|
|
DOCUMENTS DE TRAVAIL
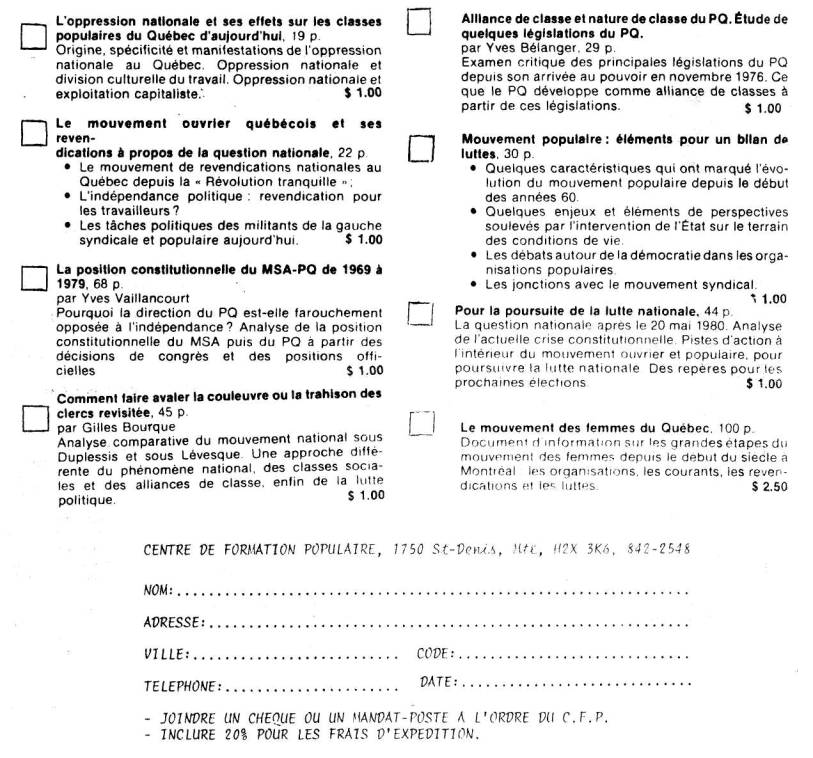
NOTES
1 Les 23 usines sont couvertes par un seul syndicat qui est un "local composé" c'est-à-dire un syndicat à plusieurs sections (23 sections dans ce cas-ci).
2 Il s'agit ici de luttes qui débordent les cadres habituels de la convention collective: lutte sur la sécurité-santé, débat sur la participation ou la non-participation au sommet économique convoqué par le gouvernement
3 Piotte, J.M., Le syndicalisme de combat, Ed. Albert St-Martin, 1977.
4 A ce sujet voir, CSN-CEQ, Histoire du mouvement ouvrier au Québec, pp. 227 à 230 et le Mouvement ouvrier et ses revendications à propos de la Question nationale, CFP, 1979, PP. 8 et 9. Mentionnons toutefois que la syndicalisation massive de cette période a été favorisée par une nouvelle législation du travail en 1964.
5 Piotte, Ethier, Reynolds, Les travailleurs contre l'Etat bourgeois, avril et mai '72, Ed. L'Aurore.
6 Il faut ici rappeler que les revendications syndicales du Front communrépondent non seulement aux aspirations des travailleurs de ce Frontcommun, mais aussi aux aspirations d'autres secteurs (100 $ minimum pourvivre... et plus tard en '74 l'indexation des salaires).
7 A. Leclerc, permanent FTQ, L'Impasse, Ed. Nouvelle Optique, pp. 27 à 44,Les lendemains du lendemain qui n'a pas chanté.
8 Mentionnons ici que la crise canadienne n'est pas seulement d'ordreéconomique et sociale mais aussi politique: la question nationalequébécoise, par la force du mouvement qui la sous-tend depuis la findes années '60 lui donne un caractère plus grave encore.
9 Presse-Libre No 2, p.13 "Pourquoi des fermetures", G, Lafleur.
10 Travail à temps partiel: de façon générale, il s'agit d'un travail exécuté pendant un nombre d'heures inférieur à la durée de la semaine normale de travail. Il prend cependant toutes sortes de formes dont les principales sont: 1) temps partiel stable (continu et régulier); 2) surnuméraire (travail sur appel, continu mais irrégulier); 3) occasionnel (dans les périodes de surcroît d'activité comme aux temps des fêtes par exemple); 4) à forfait (journalistes à la pige, chargés de cours...).
11 Au sujet du référendum et de ses résultats politiques pour le P.Q. etles forces populaires à gauche du P.Q.., voir "Poursuivre la lutte nationale", CFP, mars '81.
12 Cf. Renforcer nos acquis, Bâtir notre avenir, CEQ, fév. '81, pp. 60-62,
13 Forest, Jean, Les usines ferment, le droit au travail est menacé, Vie Ouvrière. No 154, mai '81. 25,000 licenciements collectifs par année en moyenne selon le Ministère du travail et de la main d'oeuvre du Québec, cité par la FTQ dans son document Pertes d'emplois: mobilisation, colloque de février '8l, p. 6.
14 E. Maire, CFDT, Reconstruire l'espoir, p. 52, Points-Politique, Seuil.
15 Service d'action politique (CSN) , La réduction du temps de travail avecpleine compensation, novembre '79, p.14
16 Ce que les syndicats inscrits dans la tradition du syndicalisme d'affaire se contentaient de faire.
17 Ici nous voulons signifier que le problème de la bureaucratisation etde la centralisation des services ou à l'inverse la question de la dé-mocratisation des services se pose non seulement en rapport avec lestravailleurs et les usagers immédiats, mais aussi en rapport avec l'ensemble de la population qui est concernée tout autant que les autres:chacun de nous est payeur de taxes, chacun de nous est aussi un éventuel usager.
18 Le fameux P.R.N.: Projet de recherche en nursing.
19 Du type: "le syndicat négocie sur le dos des malades".
20 Les positions du Conseil du travail de Montréal (FTQ) et de la section québécoise du SCFP sont quand même plus nuancées et tendent à se démarquer du projet du P.Q..
21 A ce sujet, voir le rapport du comité d'orientation en congrès spécialde la CSN sur la question nationale, juin '79, pp. 13 à 20. Voir aussile No 141 de janvier '80 de la revue Vie Ouvrière.
22 Tiré du document du congrès spécial sur la question nationale, CSN,juin '79, P.92.
23 Revue Vie Ouvrière, "Quand les usines émigrent dans les foyers", No 151, février '81.