Moi aussi j'travaille... au foyer : rapport du colloque national tenu
à l'Université du Québec à Montréal : pavillon
Judith Jasmin : 26 mai 1984
Rédaction : Ouellet, Michelle
Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS),
1989
NOUS TENONS A REMERCIER LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT (PROGRAMME
DE LA PROMOTION DE LA FEMME) QUI, GRÂCE A UNE SUBVENTION, A PERMIS
LA PUBLICATION DU PRÉSENT RAPPORT.
SOMMAIRE
En 1981, l'Association Féminine d'Education et d'Action Sociale
(AFEAS) entreprenait une recherche-action sur la situation des femmes
au foyer. Plusieurs activités ont été organisées
dans le cadre de cette recherche-action, dont la tenue, le 26 mai 1984,
du colloque national "Moi aussi j'travaille...au foyer".
Le présent rapport fait état de l'ensemble du déroulement
de notre recherche-action sur les travailleuses au foyer, pré-
sente la description des actions entreprises par l'AFEAS dans ce dossier
et fait connaître le cheminement prévu des résolutions
adoptées lors du colloque national.
L'AFEAS existe depuis 1966 et regroupe actuellement 35 000 membres
actifs dans 600 localités du Québec. L'AFEAS poursuit deux
buts: l'éducation et l'action sociale. C'est par le biais d'un
programme d'études mensuelles qu'elle amène ses membres à
une prise de conscience individuelle et collective des conditions de
vie des femmes et de celles de la société. L'AFEAS incite
ses membres à engager des actions concrètes dans leur milieu
en vue d'un réel changement social.
Sur recommandation de ses membres, l'AFEAS entreprend des recherches
à long terme visant à transformer les conditions de vie et
de travail de certaines catégories de femmes. L'AFEAS a déjà
mené une étude sur la situation des femmes collaboratrices
de leur mari dans une entreprise familiale (1975 à 1980). Les revendications
issues de cette sensibilisation de la population ont permis aux femmes
collaboratrices d'être reconnues comme "employées" pouvant
bénéficier de certains avantages sociaux. Les femmes collaboratrices
sont maintenant regroupées dans une association: l'Association
des femmes collaboratrices.
La publication du présent rapport constitue, pour l'AFEAS, une
nouvelle étape dans la poursuite de son objectif d'améliorer
les conditions de vie des femmes. L'AFEAS ne vise pas à retour-
ner toutes les femmes au foyer ni à diriger celles qui sont
au foyer vers le marché du travail rémunéré.
On veut plutôt ana- lyser la situation des travailleuses au foyer
et identifier des mesures qui répondent à leurs besoins.
On retrouve donc, dans le présent rapport, les chapitres suivants
:
- l'historique du dossier des travailleuses au foyer (les étapes
de la recherche-action);
- le rapport des colloques régionaux organisés dans le cadre
d'une campagne de sensibilisation sur le dossier des travailleuses
au foyer;
- le rapport du colloque national "Moi aussi j'travaille au foyer";
- la conclusion.
HISTORIQUE DU
DOSSIER DES TRAVAILLEUSES AU FOYER
"Les femmes au foyer constituent un groupe numérique important
au Québec, mais leurs caractéristiques sont fort peu connues
et étudiées. Cette ignorance n'est pas le fruit du hasard.
Il en est ainsi en premier lieu à cause de la nature de leurs activités:
dans un monde orienté vers la production marchande, seul le travail
salarié est considéré comme une activité économique.
Il en est ainsi également à cause de l'isolement de chacune
de ces femmes dans leur foyer: il est difficile de saisir comme groupe
social un ensemble d'individus se définissant d'abord et avant
tout comme membres d'une unité familiale. Cette situation d'isolement
est renforcée par une attitude orientée vers l'amour et l'oubli
de soi. Comment revendiquer sur la place publique des avantages sociaux,
des mesures assurant une certaine sécurité financière
quand on accomplit ses tâches par amour et quand on fait profession
de prendre soin des enfants?
Depuis quelques années, l'AFEAS s'est heurtée dans son travail
à plusieurs injustices envers les femmes au foyer: citons entre
autres l'absence de reconnaissance sociale de leur travail, la non-
accessibilité à la formation professionnelle et aux régimes
de re- traite des travailleurs."(1)
Des 35 000 membres AFEAS, 58,6% travaillent
exclusivement au foyer(2). "De plus, le travail au foyer
concerne toutes les femmes qui, en général, assument la plus
grande partie des travaux ménagers et des soins aux enfants."
Il n'en fallait pas plus pour que les déléguées de l'AFEAS,
lors du premier congres d'orientation d'août 1981, décident
de faire de la situation des femmes au foyer l'objet d'une recherche-action.
"Entreprendre une recherche sur ce groupe, c'est s'attaquer à
un sujet ayant une portée sociale et scientifique. Qu'elle soit
en plus commandée et acheminée par un groupe de femmes lui
confère une importance et une signification particulières.
A la base de cette démarche, il y a la découverte de difficultés
pratiques dans un travail auprès de femmes au foyer et la volonté
d'amorcer un processus collectif de changement."
- Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,
Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.
- Enquête sur le profil du membre AFEAS, 1981.
- Ibid 1.
En septembre 1981, un comité est mis sur pied à l'AFEAS.
For- mé de cinq (5) personnes, sous la responsabilité de Louise
Coulombe- Joly, ce comité a pour mandat d'élaborer les différentes
étapes de cette recherche-action et d'en suivre le déroulement.
Ce comité a commencé son travail par un inventaire des ouvrages
traitant du sujet et par une recherche des ressources et collaborations
éventuelles.
(1) Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,
Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.
L'AFEAS, en mettant sur pied cette recherche-action, "souhaitait obtenir
un changement de mentalité tel que la femme au foyer se sente valorisée
dans ses fonctions, que l'on ne ressente plus cet esprit de comparaison
entre femmes au foyer et femmes sur le marché du travail, que la
femme au foyer obtienne son propre statut et que l'on reconnaisse la
valeur sociale et économique du travail.(1) au foyer.
A partir de cet objectif global, le Conseil d'administration de l'AFEAS
définissait les objectifs spécifiques suivants:
- définir les femmes au foyer des années 1980;
- découvrir leurs motivations, leurs aspirations, leurs frustrations
et leurs besoins;
- faire ressortir les aspects légaux et financiers de leur statut;
- reconnaître l'importance de leur rôle social, écono-
mique, culturel et chrétien;
- élaborer des recommandations pour l'obtention de cette reconnaissance;
- faire prendre conscience aux femmes de leur identité propre;
- améliorer leurs conditions de vie;
- par des pressions auprès des instances gouvernementales, obtenir
des mesures qui répondent aux besoins de ces femmes.
- (1) Revue Femmes d'ici,
Plusieurs étapes ont marqué le déroulement de la recherche-
action "femme au foyer" entreprise par l'AFEAS en septembre 1981. Ce
sont:
- la recherche;
- la sensibilisation des membres AFEAS;
- la campagne publique d'information.
LA RECHERCHE
La Faculté de l'éducation permanente de l'Université
de Mont- réal a accepté, à la demande de l'AFEAS, de
contribuer à la réalisation de ce projet en y affectant un
chercheur. C'est Rita Therrien qui a assisté les membres du comité
"femme au foyer" tout au long de cette étape.
Un pré-sondage aidait à l'élaboration d'un questionnaire-
enquête de 61 questions portant sur l'âge, le statut, la religion,
les études, l'occupation, le domicile, le nombre de personnes à
charge, le temps consacré aux différentes tâches, les
sources et montants des revenus, l'autonomie personnelle et financière,
les contrats de mariage, les rapports avec le conjoint, la connaissance
et l'appréciation de certaines mesures sociales gouvernementales,
les attitudes et comportement vis-à-vis des femmes au foyer, les
aspirations personnelles, la santé, l'implication dans le milieu,
les satisfactions retirées de leur vie actuelle et la formulation
de souhaits pour améliorer des aspects de leur vie. La plupart
des questions sont fermées mais on prévoyait souvent un espace
libre lorsque les réponses ne convenaient pas à la répondante.
Toutes les questions concernant les projets d'études et les sources
de satisfactions et d'insatisfactions étaient ouvertes.
Le questionnaire a été "pré-testé" auprès
d'une cinquantaine le femmes qui, en moyenne, ont mis 30 minutes à
y répondre.
Le Centre de sondage de l'Université de Montréal a procédé
à l'échantillonnage à partir d'une liste officielle.
La sélection couvrait l'ensemble du territoire québécois.
Dans chaque unité territoriale, on a d'abord sélectionné
des secteurs en fonction de la taille de l'unité, puis on a choisi
un nombre de femmes dans chaque secteur, le tout au hasard systématique.
Au total, l'échan- tillonnage se composait de 2 054 femmes s'identifiant
elles-mêmes comme ménagères (excluant donc les étudiantes,
les retraitées et les chômeuses).
"Le questionnaire a été envoyé par la poste durant la
première semaine du mois de mars 1982. Un rappel par la poste
a été effectué deux semaines plus tard. La cueillette
s'est terminée vers la mi-avril avec un retour de 693 questionnaires
complétés, soit un taux de réponse de 34%. Un certain
nombre (59) sont revenus pour cause de déménagement. Ce taux
de réponse est satisfaisant pour un tel type de sondage: il s'est
effectué par la poste, le questionnaire est long et s'adresse a
des personnes n'ayant aucun lien avec l'organisme commanditaire.
Le questionnaire a été traduit en anglais et envoyé
en 200 exemplaires. Les répondantes pouvaient en réclamer
un en anglais ou en français en utilisant un numéro de téléphone
indiqué sur le questionnaire.
Signalons que l'AFEAS a assumé la charge financière des opérations
suivantes: dactylographie, traduction du questionnaire, imprimerie,
envois postaux des questionnaires et des lettres de rappel, de même
que les coûts de l'échantillonnage.
Vint ensuite l'étape de la codification des réponses. Le
Conseil québécois de la recherche sociale a contribué,
par une subvention, au financement de cette étape. Finalement,
on procédait à la compilation des données.
C'est le 15 septembre 1982, lors d'une conférence de presse à
Montréal, que l'AFEAS rendait publiques les données brutes
de l'enquête. Partout à travers le Québec, des responsables
de l'AFEAS ont, pendant les semaines qui suivirent, rendu publics les
résultats alors disponibles.
(1) Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer, Rita Therrien,
Louise Coulombe-Joly, Boréal Express, 1984.
C'est le 31 octobre 1984 que l'AFEAS et la maison d'édition du
Boréal Express procédaient au lancement du "Rapport de l'AFEAS
sûr la situation des femmes au foyer".
Disponible en librairie, ce rapport analyse la situation réelle
des ménages québécois à partir de l'enquête
effectuée en 1982. Il dresse un tableau réaliste de la diversité
des situations vécues par les femmes au foyer du Québec.
Ce livre, dont les auteures sont Louise Coulombe-Joly (AFEAS) et Rita
Therrien (Université de Montréal), s'adresse aussi bien aux
femmes qu'aux hommes, aux dirigeants politiques et a tous les groupes
désireux de faire avancer un débat crucial dans l'évolution
actuelle de notre société.
Le "Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer" contient
la compilation des données de notre enquête, les éléments
de la littérature sur le sujet, les informations appropriées
et l'analyse des différentes situations. Les six (6) premiers
chapi- tres concernent les 526 répondantes au foyer à plein
temps et trai- tent du choix de demeurer au foyer, de la dépendance
et de l'insé- curité financière, du pouvoir dans les
familles, de la participation sociale et des intérêts des
femmes au foyer, de leur travail et de leur santé. Le dernier
chapitre est consacré aux 167 répondantes exerçant une
activité à temps partiel, un travail rémunéré
à l'ex- térieur ou à domicile ou qui collaborent avec
leur mari dans une entreprise familiale.
Dans l'ensemble, ce rapport nous indique que les femmes au foyer ne
sont pas malheureuses et qu'elles retirent des satisfac- tions de leur
rôle. Par contre, le fait de demeurer au foyer en- traîne
des conséquences pour l'avenir. De plus, l'autonomie et la sécurité
financière sont loin d'être assurées à celles qui
déci- dent de jouer ce rôle.
Voici un bref résumé de chaque chapitre de ce rapport.
Résumé du chapitre 1 du "Rapport de l'AFEAS sur la
situation des femmes au foyer : être femme au foyer, un choix
ou le résultat de contraintes?
Ce chapitre nous donne les caractéristiques des répondantes
et nous indique que la décision de demeurer au foyer s'est effectuée
dans des contextes différents suivant les générations.
Les répondantes sont âgées de 20 ans et plus:
- 27,3% ont moins de 34 ans;
- 28,5% sont âgées de 35 à 54 ans;
- 44,3% ont 55 ans et plus.
Elles sont presque toutes (92,1%) mères de famille; 85,3% sont
mariées, les autres sont veuves, séparées, divorcées,
en union libre ou célibataires. Cette forte proportion de femmes
mariées ne doit pas surprendre puisque généralement lorsqu'un
conjoint demeure au foyer, c'est que l'autre conjoint exerce un travail
rémunéré pour subvenir aux besoins de la famille.
La majorité des familles disposent d'un revenu modeste inférieur
à 20 000$. Si la présence d'un conjoint ne prémunit
pas nécessairement contre la pauvreté, son absence en est
presque le gage, car 68,8% des femmes seules et 90,5% des femmes chefs
de famille ont un revenu inférieur à 10 000$.
Les répondantes proviennent de toutes les régions de la province,
dont une forte proportion de la région administrative de Montréal:
la répartition selon les régions se rapproche d'assez près
de la population québécoise. Les autres caractéristiques
nous informent que 89,8% sont nées au Québec, 88,0% sont de
langue maternelle française et 91,6% sont catholiques.
En ce qui concerne le bagage scolaire:
- 60,0% n'ont pas complété le niveau secondaire;
- 27,7% ont complété une 11e ou 12e année;
- 10,7% ont 13 années ou plus de scolarité.
Du côte des expériences antérieures de travail, nous
constatons que 41,9% n'ont jamais travaillé à l'extérieur.
Parmi celles qui ont déjà participé au marché du
travail, les trois quarts étaient parmi les employées de bureau,
les travailleuses de services, les ouvrières de la production,
les employées de magasin ou dans le domaine des transports et communications.
En terminant, nous découvrons que la présence à
assurer auprès des enfants est la principale raison qui a influencé
leur décision de demeurer au foyer (66,5%). Viennent ensuite le
travail ménager (44,9%) et l'attitude du conjoint (41,4%). C'est
parce que la présence à assurer auprès des enfants et
le travail ménager sont considérés comme des rôles
féminins que les femmes choisissent de demeurer au foyer. Si la
charge de travail est lourde et si le gain prévisible d'un emploi
est peu élevé, une femme choisira de demeurer au foyer a plein
temps lorsque le revenu du conjoint est suffisant. Le choix pourrait
être différent si les tâches étaient partagées
autrement au sein de la famille et si le marché du travail était
intéressant pour les femmes.
Le rôle de mère n'a pas seulement pour conséquence le
retrait actuel du marché du travail; il ferme aussi des portes
pour l'ave- nir. Compte-tenu de leurs études antérieures,
de leurs expériences sur le marché du travail et de l'âge
d'une fraction importante des répondantes, la réinsertion
dans des études ou sur le marché du travail pourraient s'avérer
pénible. Les conséquences peuvent être graves advenant
la perte d'emploi du conjoint, l'invalidité ou le décès
de celui-ci, au moment d'une séparation ou d'un divorce.
Résume du chapitre 2 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation des
femmes au foyer": la dépendance et l'insécurité financière
des femmes au foyer.
Les données de ce chapitre nous démontrent que la grande
majorité des répondantes ont accès aux ressources financières
de la famille. Pour le travail non-rémunéré qu'elles
accomplissent, cela va de soi. Par contre, certaines ont des problèmes
pour obtenir de l'argent pour leurs dépenses personnelles. Ces
situations ne devraient pas exister et cela démontre que celui
qui gagne le salaire a la possibilité de dominer.
La sécurité pour l'avenir est loin d'être réglée,
même chez les jeunes femmes au foyer. Trop de répondantes
n'ont jamais contribué à un régime de retraite personnelle:
plus de 80% dans chacune des catégories d'âge. Elles seront,
à la retraite, dépendantes du conjoint ou de la rente de conjoint
survivant ou des pensions des gouvernements, des mesures sociales.
D'un autre côté, le partage des biens dans le couple n'est
pas évident; la trop grande popularité du contrat de mariage
en séparation de biens est inquiétante. L'instauration du
régime de la société d'acquêts en 1970 n'a pas connu
la faveur populaire. Parmi les couples mariés avant 1970, 42,0%
sont en séparation de biens et parmi ceux mariés âpres
1970 le pourcentage s'élève à 52,8%, une augmentation
de 10,8%. Le régime de la société d'acquêts est
moins utilisé que la communauté de biens, pourquoi"? De plus,
nous constatons que peu de couples font leurs achats en co-propriété.
Parmi les couples propriétaires de leur maison et mariés en
séparation de biens, le conjoint est l'unique propriétaire
dans 68,8% des cas. Le salaire appartient à celui qui le gagne
et, par le fait même, il s'approprie les biens du ménage dans
la grande majorité des couples. Ainsi, au moment du partage des
biens, on peut se demander quelle sera la part de la femme au foyer?
Et pourtant, les deux conjoints travaillent ensemble à acquérir
et à entretenir ces biens.
Quant au décès du conjoint, les couples de l'enquête
pré- voient des dispositions légales; 90% des répondantes
seront bénéficiaires en tout ou en partie du testament et
de l'assurance-vie du conjoint. Selon les dispositions actuelles du
couple, la situation financière de l'épouse dépendra
des avoirs du ménage et du montant des assurances.
En somme les jeunes femmes au foyer vivent les mêmes situations
que leurs aînées ont vécues. Elles ont accès aux
ressources financières de la famille sans nécessairement posséder
des biens durables; elles sont en majorité mariées sous le
régime de la séparation de biens et elles ne sont pas plus
nombreuses à contribuer à un-régime de retraite. De plus,
elles font face à l'augmentation des taux de séparation, de
divorce, aux problèmes de crise économique et de chômage,
etc.
Résume du chapitre 3 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation
des femmes au foyer"; le pouvoir dans les familles.
Ce chapitre nous démontre que le pouvoir dans la famille se définit
selon le rôle de chacun selon la division des tâches entre
les sexes. Les femmes ont la responsabilité des tâches ménagères,
du bien-être et de l'harmonie dans la famille. Les hommes possèdent
le pouvoir économique et ont le choix d'aider ou non dans les autres
domaines tels l'entretien de la maison, l'éducation des enfants.
Les femmes décident plus souvent seules du montant de la nourriture,
du budget pour leurs vêtements et ceux des enfants. Les autres
décisions se prennent majoritairement à deux. Quant aux tâches
ménagères, les femmes ont la responsabilité des tâches
quotidiennes et routinières. Les conjoints et les enfants assument
certaines tâches occasionnelles: sortie des ordures ménagères,
tondre le gazon, jardiner, pelleter... Par contre, les tâches
sont plus partagées lorsqu'il s'agit des soins aux enfants. Les
femmes entretiennent avec leur conjoint des relations où elles
peuvent exprimer leurs opinions dans la majorité des cas. Nous
constatons que les jeunes femmes choisissent moins souvent de se taire
et de céder lors d'une discussion. Les plus âgées sont
plus soumises et s'engagent moins volontiers dans des oppositions ou-
vertes. Doit-on louer leur sagesse ou déplorer le fait que la
paix de leur ménage soit acquise souvent au prix de leur silence?
Ainsi, les femmes exercent un pouvoir d'influence à l'intérieur
des limites fixées par la division sociale du travail et lorsque
la qualité des relations avec le conjoint le permet.
Résumé du chapitre 4 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation
des femmes au foyer": la participation sociale et les intérêts
des femmes au foyer.
La société véhicule deux images contradictoires concernant
les femmes au foyer. Une les présente comme des personnes isolées,
absorbées par leurs tâches, participant peu à la vie
sociale et sans projet pour l'avenir. L'autre, dit qu'elles sont privilégiées,
comme elles "ne travaillent pas", elles ont du temps pour s'informer
sur tous les sujets et elles peuvent choisir les activités qu'elles
désirent. Or, les données de ce chapitre nous révèlent
que ni l'une ni l'autre de ces images n'englobent toutes les répondantes.
Même si les femmes au foyer ont des points en commun, elles ne
sont pas identiques pour autant.
Certaines (environ la moitié) ont un réseau social varié,
s'intéressent à plusieurs sujets différents et font divers
projets pour l'avenir. D'autres (à peu près la même
proportion) vivent presque isolées, avec peu d'intérêts
en dehors de leurs tâches et font peu ou pas de projet pour le
futur. Les jeunes femmes, avec de jeunes enfants, sont moins impliquées
socialement et effectuent moins de sorties, mais elles ont une diversité
d'intérêts et font des projets d'avenir. Les femmes âgées
sans enfant à la maison ont un réseau social limité,
moins de sujets d'intérêt et peu de projets personnels.
Les femmes de milieux favorisés ont plus tendance à exercer
les différents rôles sociaux. Celles vivant dans des milieux
pauvres ou modestes se retrouvent très souvent dans des conditions
peu propices a l'extension de leur réseau social et de leurs intérêts.
Nous constatons que la grande majorité des projets d'avenir vont
vers des activités plus faciles à intégrer a leurs tâches
a la maison comme le travail a temps partiel, le bénévolat
ou les études. Les activités peuvent devenir une façon
de sortir graduellement sans trop perturber l'horaire familial et ainsi
éviter le double emploi.
Résumé du chapitre 5 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation
des femmes au foyer": le travail au foyer.
Les extraits de la littérature greffes a ce chapitre nous permettent
d'affirmer que le travail au foyer contribue de façon importante
au bien-être de la population et à l'économie. Ce travail
ne se limite pas à l'entretien ménager; il comprend aussi
les fonctions d'épouses et de mères. Les femmes contribuent
à la formation de la main-d'oeuvre future et le travail qu'elles
accomplissent rend les conjoints disponibles pour leur travail et leur
rôle dans la société. Les femmes produisent le capital
humain et l'entretiennent. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un service
privé.
Quant aux tâches familiales nous découvrons que les répondantes
en effectuent 7 à 8 heures par jour en moyenne, ce qui signifie
que certaines (celles qui ont de jeunes enfants) en font plus que d'autres
pour en arriver à une moyenne de 7-8. N'oublions pas que certaines
tâches doivent être accomplies 7 jours par semaine; entre
autres, les repas, la vaisselle... ce qui nous donne une bonne semaine
de travail.
Les autres données du chapitre nous font prendre conscience que
les répondantes perçoivent leur rôle de façon positive
et en retirent des satisfactions. La majorité demande aux gouvernements
de mettre sur pied des mesures visant à laisser aux femmes le libre
choix de demeurer au foyer ou non et voient d'un très bon oeil
l'intervention de l'état pour améliorer les conditions de
vie des femmes.
Résume du chapitre 6 du"Rapport de l'AFEAS sur la situation des
femmes au foyer": la santé des femmes au foyer.
Cette partie nous permet de brosser un tableau de la fréquence
de certains symptômes chez les femmes au foyer, de leurs habitudes
de consommation des services et des traitements qu'elles reçoivent.
Le recours aux médicaments est une habitude répandue auprès
des répondantes comme d'ailleurs dans la population féminine
canadienne.
Les facteurs de tâches répétitives, de non-reconnaissance
monétaire, de surcharge, d'isolement peuvent être autant de
causes aux problèmes de santé des femmes au foyer. Deux groupes
semblent avoir des problèmes particuliers et faire l'objet d'interventions
plus lourdes: les personnes de 65 ans et plus et celles disposant d'un
revenu faible.
Résumé du chapitre 7 du "Rapport de l'AFEAS sur la situation
des femmes au foyer": les femmes au foyer qui travaillent à temps
partiel.
Cette partie nous démontre que certaines femmes exerçant
un travail à temps partiel se définissent d'abord et avant
tout comme des femmes au foyer. Ce sont des femmes collaboratrices
du mari dans une entreprise ou des travailleuses rémunérées
à temps par- tiel à l'extérieur ou à domicile.
Très peu d'éléments les différencient des femmes
au foyer à temps plein. Elles sont pour la plupart des épouses
et mères et elles accomplissent les tâches reliées à
ces rôles. La majorité sont mariées sous le régime
de la séparation de biens et trois femmes sur quatre n'ont jamais
contribué à un régime de retraite.
La majorité ont la responsabilité des tâches familiales
régulières et répétitives et obtiennent une aide
occasionnelle.
Nous devons admettre que le travail à temps partiel, tel qu'il
est vécu par ces femmes, ne semble pas apporter de solutions aux
problèmes de dépendance financière, de sécurité
pour l'avenir, de partage des tâches, etc.
Ce rapport, publié au terme de la période de sensibilisation
menée par l'AFEAS, vient appuyer toute la problématique qui
y fut développée.
LA SENSIBILISATION DES MEMBRES AFEAS
Afin de concilier les besoins de la recherche scientifique et ceux
d'un groupe d'action, l'AFEAS amorça la phase sensibilisation des
membres parallèlement au travail d'analyse des don- nées.
C'est ainsi que de septembre 1982 à juin 1983 les membres des 600
cercles AFEAS ont analysé les données de l'enquête selon
leur vécu et approfondi les différents aspects de la situation
des femmes au foyer. C'est lors des rencontres mensuelles des membres
que ces études ont été réalisées.
Pour aider les membres à réaliser cette étude, des dossiers
d'information sur chacun des aspects abordés par la recherche ont
été préparés et expédiés aux responsables
dans les cercles. Ces dossiers portaient:
- octobre 1982: L'évaluation de l'autonomie financière
des femmes au foyer.
- décembre 1982: La découverte des principales motivations
et insatisfactions des femmes au foyer.
- janvier 1983 : L'examen de la protection légale et financière
des femmes au foyer devant certains événements majeurs de
la vie,
- février 1983 : L'évaluation du degré de satisfaction
vis-à-vis les mesures sociales gouvernementales prévues pour
les femmes au foyer.
- avril 1983 : La préparation d'actions à entreprendre
dans la famille pour en arriver à de meilleures relations familiales.
- mai 1983: La découverte de l'état de santé des
femmes au foyer.
Chaque étude réalisée poursuivait un objectif précis,
celui d'amener chaque femme à découvrir, à travers la
situation des autres, sa situation, ses conditions sociales, juridiques
et économiques et à formuler, avec l'aide de son groupe AFEAS,
des recommandations visant à améliorer la situation des femmes
au foyer.
Ces recommandations, d'abord adoptées au niveau des cercles locaux,
sont acheminées aux congres régionaux avant de parvenir au
congrès provincial de 1983. Au terme de cette année d'étude,
les recommandations suivantes furent adoptées:
- Que nos gouvernements accordent à la femme (homme) au foyer
un statut légal de travailleuse(eur) au foyer.
- Que le terme "travailleuse(eur)"au foyer soit employé dans
toutes les politiques et lois qui les concernent.
- Que l'AFEAS entreprenne des démarches auprès de l'Office
de la langue française pour normaliser le terme de travailleuse(eur)
au foyer.
- Que nos gouvernements reconnaissent officiellement la valeur du
travail au foyer en l'intégrant au produit national brut et que
ces travailleuses(eurs) bénéficient des avantages accordés
aux travailleuses (eurs).
- Que les gouvernements révisent leurs systèmes fiscaux
de façon a reconnaître les travailleuses(eurs) au foyer
comme des personnes à part entière et non plus comme personne
à charge.
- Que les gouvernements reconnaissent la part du tra- vail au foyer
durant la vie de couple (ex: partage du revenu familial, partage
des gains du régime des rentes, etc.).
- Que le travail au foyer soit reconnu comme une participation à
l'enrichissement du couple.
- Que cette participation a l'enrichissement du couple soit incluse
dans la prestation compensatoire.
- Que le ministre de la justice du Québec amende la loi 89 afin
que la résidence familiale soit automatique- ment protégée
sans démarche d'enregistrement.
- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes fiscaux
de façon à instaurer des avantages sociaux tels que régimes
des rentes, régimes de pensions, allocations maternité,
congés de maladie et indemnisation en cas d'accident pour les
travailleuses(eurs) au foyer.
C'est avec ces recommandations que l'AFEAS a débuté son travail
de revendication auprès des instances concernées.
II est clair qu'un changement de mentalité s'impose pour favoriser
l'évolution de la situation des travailleuses au foyer. C'est pour
contribuer à cette évolution que l'AFEAS, en septembre 1983,
préparait une vaste campagne de sensibilisation de la popu- lation.
Ainsi, l'AFEAS passait à l'action! Grâce à l'obtention
d'un projet "Relais" (programme de relance du gouvernement fédéral),
huit (8) coordonnatrices étaient embauchées pour mener à
bien ce projet.
La période de septembre a décembre 1983 a servi à mettre
en place les structures nécessaires pour l'animation et à pré-
parer les outils nécessaires a cette campagne. En janvier 1984 commençait,
à travers le Québec, la campagne de sensibilisation qui devait
se terminer dans chaque région par la tenue d'un colloque. En mai
1984, un colloque national mettrait fin à cette campagne.
Préparation de la campagne d'information
Dans chaque région AFEAS des responsables de comités régio-
naux, des membres de Conseil d'administration ont fait équipe avec
la coordonnatrice régionale pour réaliser le projet "les travailleuses
au foyer du Québec".
Une équipe d'étudiantes inscrites au certificat en anima-
tion UQAM-AFEAS ont contribué à la production de différents
outils utilisés pendant la campagne. C'est à un groupe d'entre
elles que nous devons le logo, le choix du thème de la campagne
et le diaporama produit en vue des rencontres de sensibilisation, Intitulé
"Moi aussi j'travaille", ce diaporama d'une durée de 12 minutes
s'est avéré d'une utilité remarquable pour déclencher
réflexions et discussions lors des rencontres d'information. Il
a été disponible dans toutes les régions du Québec.
Des feuillets publicitaires, affiches, macarons véhiculant tous
le même thème ont aussi été produits.
Des guides d'animation conçus pour faciliter le travail des animatrices
ont été réalisés par les coordonnatrices du projet
"Relais". Elles ont aussi élaboré le plan de communication.
Chaque cercle local AFEAS devait organiser une rencontre avec un des
groupes de son milieu. Les différents outils produits furent mis
à leur disposition. Des équipes d'animatrices, formées
par les paliers provincial et régional, agissaient comme personnes-ressources
lors de l'organisation de telles rencontres.
La réalisation de la campagne d'information
Les objectifs
Le travail au foyer bénéficie à la famille et est compensé
par une reconnaissance affective et matérielle à ce niveau.
Toutefois, le travail au foyer contribue aussi à l'ensemble de
l'économie et à la société toute entière.
Pourtant, le travail au foyer n'est pas considéré par la
société comme un travail au même titre qu'un emploi rémunéré.
L'État ne reconnaît pas sa juridiction sur ce travail ni sur
ces travailleuses qui ne font pas partie de la population active. Socialement,
les femmes paient un lourd tribut: celles qui sont au foyer à
plein temps en retirent un statut de personnes dépendantes, alors
que celles qui occupent un emploi rémunéré héritent
d'une seconde tâche invisible et obligatoire. Une somme énorme
de travail est purement et simplement passée sous silence.
Plusieurs études gouvernementales canadiennes révèlent
que la pauvreté est très souvent le lot des femmes. Trois
adultes pauvres sur cinq au Canada sont des femmes. Ces études
démontrent les ravages provoqués par la dépendance financière
d'un conjoint: trois femmes sur quatre seront seules à un moment
donné de leur vie suite à une séparation, un divorce
ou un décès.
La position de l'État à l'égard du travail au foyer
est une position de non-intervention prétextant qu'il appartient
au domaine privé. Pourtant, si on y regarde de plus près,
il intervient beaucoup dans le domaine dit familial (ex: révision
du code ci- vil, législation sur les régimes matrimoniaux,
soins médicaux, services sociaux, éducation des enfants...).
Les travailleuses au foyer possèdent peu de pouvoir pour s'assurer
d'un minimum de sécurité financière. Malgré l'apport
social et économique qu'elles fournissent, elles demeurent dépendantes
du conjoint qui exerce une activité rémunérée.
Les jeunes femmes au foyer vivent les mêmes situations que leurs
aînées.
Seul un changement dans les règles du jeu, soit la reconnaissance
publique du travail au foyer et l'adoption de mesures concrètes
pour assurer cette reconnaissance permettra à cette importante
partie de la population (2 millions de femmes) d'atteindre une certaine
autonomie financière et une sécurité personnelle.
L'AFEAS sait qu'il ne suffit pas de changer les lois pour améliorer
des situations. Le changement de mentalité est tout aussi important
et elle voulait que cette campagne de sensibilisation aide à l'évolution
du dossier des travailleuses au foyer.
Le thème véhiculé
C'est le titre du diaporama qui a servi de thème à toute
la campagne d'information: "MOI AUSSI J'TRAVAILLE AU FOYER" s'adressait
avant tout aux femmes au foyer, mais également à celles sur
le marché du travail rémunéré. En définitive,
la problématique de l'autonomie rejoint toutes les femmes.
Le logo
Le coeur représente la base de notre vie de femme, l'amour. Son
contour délimite la société dans laquelle nous vivons.
Le cœur plein évoque les années du travail au foyer. Il
exprime la reconnaissance affective, émotive et familiale reconnue
pour ce travail.
Les figures stylisées symbolisent la place que chaque travailleuse
au foyer désire dans la société: sa place, Le "$" illustre
le désir d'une reconnaissance légale et financière.
Nous avons aussi voulu rejoindre les hommes pour leur faire part de
notre dossier. Il nous semblait important qu'ils participent à
notre démarche puisqu'ils partagent quotidiennement nos vies.
Pour rejoindre nos clientèles, nous avons utilisé différentes
structures ou organisations: organismes, associations, centres communautaires,
associations professionnelles, presse parlée et écrite, kiosques
d'information, affichage...
Les activités réalisées
On évalue à 400 le nombre de rencontres de sensibilisation
effectuées à travers le Québec. Chaque rencontre regroupait
entre 10 et 100 participants.
En plus de toutes ces rencontres de sensibilisation, plu- sieurs autres
projets furent réalisés durant cette période. Mentionnons:
- la réalisation des projets d'intervention de 30 étudiantes
au Certificat en animation et recherche culturelle (UQAM-AFEAS) dans
le cadre du pro- jet "travailleuses au foyer";
- utilisation du thème des "travailleuses au foyer" pour l'organisation
des activités du 8 mars 1983 à travers la province de Québec;
- la cueillette de 24 475 noms dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean.
Ces personnes ou organismes appuyaient notre dossier des "travailleuses
au foyer";
- l'expédition de 175 dossiers décrivant le projet "travailleuse
au foyer" aux organismes de la région Bas St-Laurent-Gaspésie;
la presentation d'une pièce de théâtre-animation sur
le thème des travailleuses au foyer par des étudiantes stagiaires
en animation dans la région de la Mauricie (300 personnes assistaient
aux représentations) ;
- la mobilisation des élèves du primaire dans une école
de la région Richelieu-Yamaska pour réaliser un projet éducatif
intitulé "raconte le travail de ta mère à la maison".
Il est bien sur impossible de faire le tour de tous les projets réalisés.
Il est encore plus difficile d'évaluer le nombre de personnes rejointes
et d'en mesurer l'impact. Au ni- veau publicitaire:
- des articles ont paru dans les quotidiens, hebdomadaires, revues...
- des entrevues furent réalisées a la radio et T.V.;
- des kiosques d'information nous permettaient de rejoindre la population
dans les centres commerciaux;
- 2 000 affiches, 15 000 feuillets publicitaires et 17 000 macarons
furent distribués durant cette période.
Dans les régions, ce sont les coordonnatrices qui assuraient la
distribution du matériel et la coordination des activités.
Au palier provincial, une coordonnatrice planifiait les activités
sous la supervision d'un comité formé par l'AFEAS. Ce comité
relevait directement du Conseil exécutif provincial de l'AFEAS.
La recherche-action sur la situation des femmes au foyer a débordé
depuis le tout début des cadres de l'AFEAS. L'enquête tenue
en 1982, par ses implications, a touché toutes les femmes au foyer
du Québec, non seulement les membres AFEAS. L'étape de sensibilisation
a permis à un plus large public de femmes et d'hommes de connaître
notre dossier, d'en approfondir les enjeux.
Dans chaque région du Québec, des colloques clôturaient
la campagne de sensibilisation et permettaient aux participantes (ants)
de s'exprimer sur les différents volets du dossier:
- en discutant des problématiques proposées;
- en identifiant des mesures sociales, légales et financières
pour reconnaître le rôle des travail- leuses (eurs) au foyer
dans la société.
Au terme de chaque colloque régional, des solutions, exprimées
sous forme de recommandations, étaient adoptées. Chaque atelier
de travail retenait deux recommandations jugées prioritaires et
devant être acheminées au colloque national.
Chaque région avait l'entière responsabilité de l'organisation
de son colloque. Des comités ont été mis sur pied.
Les coordonnatrices régionales, des membres des conseils d'administration
de l'AFEAS et des responsables régionales AFEAS siégeaient
sur ces comités d'organisation. Sans l'implication bénévole
des membres AFEAS, ces activités n'auraient pu se réaliser.
Par leur participation, de nombreuses femmes ont contribué au
succès de ces colloques régionaux. Plusieurs, impliquées
dans les dossiers de condition féminine, ont répondu à
l'invitation des différents comités organisateurs régionaux
et ont participé aux colloques à titre d'invitées
spéciales ou de personnes-ressources pour le travail en ateliers.
Les comités organisateurs ont dû faire preuve d'imagination
pour réunir les ressources matérielles et financières
nécessaires. Plusieurs organismes ont accepté de contribuer
à l'organisation. Citons: les services de l'éducation des
adultes des Commissions scolaires ou CEGEP, les services à la collectivité
des universités, les bureaux de Consult-Action du Conseil du Statut
de la femme, etc. Certains organismes publics ou privés ont accepté
de fournir des locaux ou des services d'imprimerie. Le siège social
de l'AFEAS, grâce à des subventions obtenues de différents
programmes, mettait à la disposition des comités organisateurs
des affiches, des feuillets publicitaires, un plan de communication
et les documents de travail pour les ateliers.
Dix-huit (18) colloques ont eu lieu à travers le Québec entre
le 8 mars et le 5 mai 1984. Chaque région retenait la formule
qui lui convenait: activité d'une journée ou d'une demi-journée
ou d'une soirée.
Ces colloques régionaux ont réuni un total de 2 300 par-
ticipantes (ants). Celui de Drummondville réunissait plus de 500
participantes(ants). Cependant, que les colloques réunis- sent
500 ou 40 participantes(ants), c'est la présence active de toutes(tous)
celles(ceux) qui ont répondu a l'invitation qui a permis d'atteindre
les objectifs. Une ombre au tableau: même si des efforts avaient
été faits pour inviter toute la population à participer
aux colloques régionaux, très peu d'hommes s'inscrivaient
à ces activités.
Le tableau suivant donne les coordonnées des colloques régionaux
"Moi aussi j'travaille...au foyer".
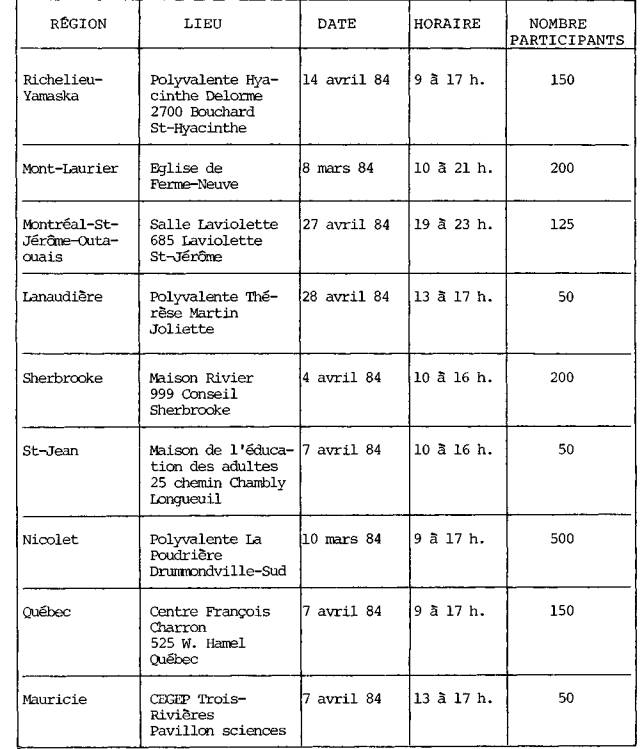
Si le déroulement général a pu varier d'un colloque
à l'autre, partout les participantes discutaient des mêmes
thèmes touchant la situation des travailleuses au foyer.
Ces thèmes développaient les aspects les plus importants
vérifiés par l'enquête menée par l'AFEAS en
1982. Ils avaient fait l'objet d'études par les membres
de l'AFEAS et furent développés pendant la campagne
de sensibilisation auprès du grand public. Chaque atelier
traitait d'un thème.
ATELIER 1; LA VALEUR DU TRAVAIL AU FOYER
Cet atelier interrogeait les participantes sur la définition
de la valeur de ce travail, sur les conséquences de son
invisibilité, sur la force économique que constituent
les femmes au foyer. Les discussions devaient amener l'identification
de moyens efficaces pour rendre visible l'apport social du travail
au foyer. Les recommandations issues des colloques régionaux
furent les suivantes:
- Que les gouvernements accordent a la personne au foyer un statut de
travailleuse(eur) au foyer.
- Que le terme de "travailleuse(eur)" au foyer soit employé pour
que toutes les femmes (hommes) qui travaillent a la maison s'identifient
de cette façon.
- Que le travail au foyer soit comptabilisé au produit national
brut.
- Que toutes les travailleuses(eurs) au foyer s'inscrivent au Centre
de main-d’œuvre afin d'être reconnues(us) dans la population
active, de faire partie de la main- d’œuvre de réserve
et de rendre plus justes les statistiques portant sur les travailleuses(eurs)
non-salariées (es).
- Que l'AFEAS dénonce l'ambiguïté du message social face
au travail domestique.
- Que l'AFEAS continue à rejoindre les femmes au foyer par divers
moyens tels la diffusion du diaporama, en utilisant les différents
médias pour que la société prenne conscience de cette
réalité.
- Que l'AFEAS mette sur pied un comité destiné à analyser
les composantes et enjeux du travail au foyer afin d'élaborer de
meilleurs stratégies d'action.
- Que la sensibilisation amorcée soit poursuivie et même accentuée
auprès des hommes, des femmes et des enfants.
- Qu'on publicise le nombre d'heures consacrées au soutien de la
famille à l'intérieur d'une semaine de sept jours.
- Que la publicité arrête de présenter l'image stéréotypée
de la femme (mince, bien mise, souriante). Qu'elle laisse plutôt
voir la trace laissée par le travail quotidien.
- Que les femmes continuent à sensibiliser leur entourage, qu'elles
portent l'information aux femmes isolées et se préparent aux
changements.
- Qu'il y ait front commun des travailleuses(eurs) non rémunérées(ès)
et rémunérées(ès) pour l'obtention de la reconnaissance
du travail domestique.
- Que les groupements féminins continuent leur travail afin que
toutes les femmes soient conditionnées à s'engager et à
former des groupes de pression a tous les échelons de la société.
- Que toutes les femmes soient solidaires des autres associations
lorsque ces dernières travaillent a faire avancer la condition
des femmes ou posent des actions en vue du mieux-être de la communauté
paroissiale, régionale, nationale et même internationale.
- Que les gouvernements augmentent les budgets des organismes qui
travaillent à développer l'autonomie et à briser l'isolement
des travailleuses(eurs) au foyer.
- Que l'AFEAS et le Conseil du statut de la femme organisent, annuellement,
des manifestations collectives re- groupant les travailleuses(eurs)
au foyer de toutes les régions du Québec en vue de briser
leur isolement.
- Que le prochain 8 mars soit décrété "journée
annuelle de repos" pour toutes les femmes en reconnaissance des tâches
domestiques exécutées et ce, avec la collaboration des conjoints,
de l'entreprise publique et privée (congé payé).
ATELIER 2; LA RECONNAISSANCE LÉGALE ET FINANCIÈRE
Ce thème permettait aux participantes de s'interroger sur la forme
de reconnaissance désirée, sur le rôle de la société
face à cette reconnaissance, sur les moyens dont disposent
la femme au foyer pour s'assurer elle-même d'une sécurité
financière acceptable et la part que l'État devrait assumer
pour fournir une sécurité financière minimale à
toutes celles qui, par choix ou autrement, travaillent à
la maison. Les recommandations issues des colloques régionaux
sont:
- Que l'union d'un couple ne soit pas seulement une union
amoureuse, mais aussi une union économique avec les conséquences
juridiques et financières qui en découlent.
- Que les gouvernements reconnaissent un statut légal
aux travailleuses(eurs) au foyer.
- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes
fiscaux de façon a. reconnaître les travailleuses(eurs)
au foyer comme personnes à part entière et non plus
comme personnes à charge.
- Que la production domestique entraîne la production
d'un rapport d'impôt.
- Que les déductions d'impôt accordées aux
conjointes(oints) soient versées aux travailleuses(eurs)
au foyer.
- Que l'exemption de personne mariée soit versée
directement a la personne à charge par le gouvernement,
sous forme de crédit d'impôt.
- Que les gouvernements augmentent l'exemption accordée
au conjoint au foyer. Que le montant de cette exemption
et celui accordé pour les enfants à charge soient
versés au conjoint au foyer.
- Que les exemptions de conjoint et d'enfants à charge
soient haussées pour les ménages formés d'une(un)
travailleuse (eur) au foyer et d'une(un) travailleuse(eur)
rémunérée(é).
- Que les revenus provenant du régime des rentes, pensions
de vieillesse, allocations familiales, pensions alimentaires,
allocations au conjoint survivant soient non imposables.
- Que les revenus provenant de pensions alimentaires et des
rentes versées aux conjoints survivants ne soient pas
considérés comme revenus au niveau de l'aide sociale.
- Que nos gouvernements révisent leurs systèmes
fiscaux afin que la femme au foyer ait sa part financière
socialement.
- Qu'une allocation correspondant à la déduction
d'impôt de personne à charge soit versée mensuellement
à l'épouse(époux) travailleuse(eur) au foyer.
- Que les gouvernements accordent aux femmes au foyer une
rétribution financière pour la garde de leurs enfants.
- Qu'un salaire soit verse pour toutes(tous) les travailleuses(eurs)
au foyer.
- Que le travail au foyer donne droit à un revenu.
- Que les gouvernements versent une allocation à toutes
les femmes(hommes) au foyer en privilégiant les plus
démunies (is) (familles monoparentales, personnes seules,
veuves...)
- Qu'une allocation de salaire unique soit versée aux
travailleuses(eurs) au foyer, incitative à la natalité.
- Que des mesures incitent au partage des revenus entre conjoints.
- Que la reconnaissance d'un statut de travailleuse(eur) au
foyer donne droit, par la loi, à un pourcentage du salaire
du conjoint.
- Que la(le) conjointe(oint) verse un salaire à la (au)
travailleuse(eur) au foyer et que ce salaire soit déductible
de son revenu imposable.
- Que le travail au foyer soit reconnu comme participation
à l'enrichissement du couple.
- Que les biens familiaux (résidence, meubles, automobile)
deviennent, dès leur acquisition, co-propriété
entre les conjoints.
- Que les gouvernements reconnaissent le travail au foyer et accordent
aux travailleuses(eurs) au foyer les mêmes avantages sociaux qu'aux
travailleuses(eurs) rémunérées(es). Certaines régions
ont tenu à énumérer les avantages sociaux auxquels elles
tenaient: indemnités pour maladies, indemnités pour maternité,
congés de maternité, allocations de disponibilité, allocations
pour garderies, subventions pour études, régimes de pensions
publics, santé et sécurité au travail, assurance-chômage.
- Que les travailleuses(eurs) au foyer puissent participer au Régime
des rentes du Québec.
- Que la contribution des travailleuses(eurs) au foyer au KRQ soit
basée sur la moitié du salaire industriel moyen canadien.
- Que cette contribution soit payée par les sommes récupérées
des exemptions pour personnes a charge du rapport d'impôt
de la (du) conjointe(oint).
- Que l'exemption de personne mariée soit transformée en
crédit d'impôt pour les travailleuses(eurs) au foyer, applicable
au KRQ.
- Que les contributions des travailleuses(eurs) au foyer au RRQ soient
payées par le conjoint.
- Que les régimes de pensions publics soient disponibles des
l'âge de 55 ans pour les femmes ayant des enfants.
- Que les gouvernements assurent la sécurité financière
des femmes âgées en prévoyant la réversibilité
des régimes supplémentaires de rentes.
- Que la rente au conjoint survivant soit complète et non coupée
de moitié a 65 ans.
- Que les acquis expérientiels du travail au foyer soient reconnus
pour fin d'études ou pour l'intégration au marché du
travail.
- Que des représentantes d'associations féminines aient
droit de regard sur les mécanismes d'évaluation des acquis
du travail au foyer.
- Que les acquis du travail au foyer se traduisent en terme d'années
d'expérience.
- Que le travail au foyer soit reconnu par des crédits quand
la(le) travailleuse(eur) au foyer intègre le marché du travail.
- Que les compétences développées dans le bénévolat
soient négociables sur le marché du travail.
- Que les travailleuses(eurs) au foyer bénéficient de la
reconnaissance d'acquis d'expérience pour les soins spécialisés
(éducation, santé) qu'elles(ils) assument à la place
des institutions publiques. Que ce travail soit rémunéré.
- Que l'AFEAS donne des outils à ses membres face à la préparation
de curriculum vitae qui tiennent compte des expériences et du
travail exécuté au foyer.
- Que le gouvernement accorde aux travailleuses(eurs) au foyer les
avantages (prêts et bourses) rattachés au statut d'étudiant.
- Que l'on tienne compte du nombre d'enfants dans la famille comme
critère pour l'obtention d'une bourse pour les études.
- Que, pour les personnes seules, les revenus d'aide sociale ou de
pensions alimentaires ne soient pas diminués après l'obtention
d'une bourse, vu le surplus de dépenses occasionnées par
un retour aux études.
- Que l'allocation maternité de 240$ soit accordée à
toutes les femmes.
- Que les gouvernements offrent d'avantage de services aux femmes
au foyer au moment des grossesses.
- Que l'on étende le réseau de garderies pour accommoder
les femmes au foyer.
- Que les travailleuses(eurs) au foyer bénéficient de prix
spéciaux permettant l'accès aux garderies en cas de maladie
(10 jours par année).
- Que les travailleuses(eurs) au foyer aient accès gratuitement
aux halte-garderies et camps de vacances.
- Que les gouvernements accordent à la femme seule, chef de famille,
le coût d'entretien et de garde d'enfants pour un montant équivalent
au coût de placement de ses enfants en foyer nourricier.
- Que le crédit d'impôt pour enfants soit accessible à
toutes les femmes indépendamment du salaire du mari.
- Que le statut de travailleuse(eur) au foyer accorde l'accès
à l'aide juridique.
- Que l'AFEAS fasse des pressions auprès des gouvernements et
entreprises pour que des congés spéciaux pour "affaires
de famille" soient reconnus à tous les travailleuses(eurs) du
Québec.
- Qu'il y ait des structures favorisant le temps partiel régulier
(temps partagé) hebdomadaire pour le couple avec tous les avantages
sociaux.
- Que le processus et les mesures administratives pour dé- fendre
ses droits soient simplifiés.
- Qu'un fond gouvernemental spécial soit disponible pour les
besoins des travailleuses(eurs)au foyer.
ATELIER 4 ; LES RELATIONS FAMILIALES
Ce thème fournissait l'occasion d'identifier des moyens concrets
à prendre pour atteindre un partage équitable des responsabilités
éducatives, familiales et domestiques. Comment amener son
conjoint à ré-évaluer son rôle, sa participation
à la vie familiale? Quelles solutions peut apporter l'éducation
familiale? Voici les recommandations de cet atelier:
Que les femmes acceptent et fassent accepter l'égalité
dans les droits, responsabilités familiales et partage des tâches.
Que le vocabulaire utilisé habituellement (ex: ma cuisine,
mon lit, mon ménage...) soit changé de façon a promouvoir
la co-responsabilité et la participation de chacun à la
vie familiale.
Qu'une sensibilisation soit faite sur l'importance et les moyens
de valorisation de soi dans la vie quotidienne.
Que le Conseil du statut de la femme ait le mandat de sensibiliser
la population sur une image plus valorisante de la femme au foyer.
Que l'éducation soit désexisée à la maison.
Que l'AFEAS fasse des pressions auprès du Ministère de
l'éducation pour que le futur programme de formation humaine
et sociale se préoccupe des rôles masculins et féminins
de façon a véhiculer une responsabilité familiale partagée.
Que le Ministère de l'éducation abolisse les
stéréotypes dans les manuels scolaires, dans les
cours, dans les activités, dans les comportements véhiculés
par les professeurs et ce, en y prévoyant les budgets
nécessaires.
Que le Ministère de l'éducation intègre,
à tous les niveaux du système scolaire du projet
éducatif du primai- re jusqu'à l'éducation
des adultes, une formation à la prise de conscience des
droits et libertés de la personne.
Que les étudiants de chaque sexe puissent avoir accès,
sans discrimination, à toutes les options offertes.
Que les cours de sciences familiales soient offerts tant
aux filles qu'aux garçons, sur une base obligatoire.
Que le ministre des communications abolisse la publicité
sexiste dans tous les médias en prévoyant des sanctions
sévères aux contrevenants.
Que la publicité privée et publique soient axée
sur une répartition équitable des rôles et
que le partage des responsabilités y soit véhiculé.
ATELIER 5: LA SANTE DES FEMMES AU FOYER
À partir des constatations rapportées dans le document
de travail, les personnes inscrites dans cet atelier s'interrogeaient
sur les causes réelles des malaises dont se plaignent les
femmes au foyer et sur l'impact du conditionnement social sur
leur santé. Elles devaient identifier dans quelle mesure
les services actuels de la santé contribuent à la grande
consommation de ces services que font les femmes et analyser
jusqu'à quel point ces services sont responsables de cet
état de chose. Les recommandations sont les suivantes :
- Que les politiques et lois qui concernent la santé au travail
reconnaissent aux travailleuses(eurs) au foyer les mêmes avantages
qu'aux travailleurs(euses) rémunérées (és).
- Que les gouvernements augmentent la qualité et la quantité
de l'information aux femmes.
- Que l'AFEAS fasse des pressions auprès des gouvernements pour
initier, par une campagne de sensibilisation, les femmes à s'auto-évaluer
et à prendre en charge leur état de santé.
- Que le Ministère de la condition féminine diffuse toutes
les informations santé auprès des femmes (ex: services offerts
par le MAS, consommation de médicaments, rôle des associations
impliquées...).
- Que les gouvernements accordent des budgets aux groupes de femmes
déjà existant qui travaillent à favoriser l'auto- santé
des femmes et à démystifier le pouvoir médical.
- Que les gouvernements consacrent plus de budget pour la médecine
préventive.
- Que soient reconnues d'autres formes de médecine que la médecine
traditionnelle (ex: médecine douce ou naturelle).
- Que l'AFEAS développe des ressources visant à améliorer
la santé des femmes: groupes de partage et d'échange.
- Que les gouvernements créent des centres de dépannage
pour personnes en difficulté.
- Qu'il se fasse davantage de publicité sur la santé mentale.
- Que les femmes se regroupent pour continuer leur prise de conscience
personnelle.
- Que les femmes soient sensibilisées a leurs droits vis- à-vis
la santé.
- Que les femmes s'informent sur les actes médicaux qui les concernent.
- Que les formateurs et professionnels de la santé soient sensibilisés
a la problématique des femmes.
- Que soit augmentée la recherche faite sur la santé des
femmes.
- Que des équipes multidisciplinaires répondent aux besoins
des femmes de 35 ans et plus.
- Que ces équipes multidisciplinaires se greffent aux structures
en place: cliniques de planification, CLSC...
- Que les femmes soient sensibilisées aux effets et conséquences
des médicaments qu'elles prennent.
- Que le corps médical soit plus à l'écoute des besoins
ex- primés par les femmes au lieu de prescrire automatiquement
des médicaments.
- Que soient publicisés les moyens a prendre pour se guérir
de l'usage des médicaments.
Le 26 mai 1984. Colloque national "Moi aussi j'travaille au foyer"...Université
du Québec à Montréal. Dans l'histoire des travailleuses
au foyer, c'était une première! L'AFEAS pro- jetait de faire
de ce colloque un carrefour: carrefour d'idées, de recommandations,
de suggestions venues de toutes les régions du Québec.
Au terme d'une année d'étude (82-83) les membres AFEAS ont
pris position sur certains principes de reconnaissance de la valeur
du travail au foyer. Étant donné que les démarches et
les actions entreprises concernent toutes les femmes, l'AFEAS leur a
offert l'opportunité de se prononcer sur le sujet au moment des
colloques régionaux. Le colloque national fut le couronnement
de toutes ces discussions. Il s'agissait alors de faire des choix,
d'établir des priorités parmi la pléiade d'hypothèses
soumises pour améliorer la situation des travailleuses au foyer.
C'est pour alimenter et orienter ses actions futures que l'AFEAS a
initié ce processus. Ainsi, elle serait représentative non
seulement des aspirations de ses membres sur ce dossier, mais aussi
des besoins exprimés par les femmes de toutes les régions
qui ont participé S cette démarche.
Une coordonnatrice provinciale, Judith Pinsonneault, était responsable
de l'organisation du colloque national. Toutes les coordonnatrices régionales
avaient la tâche, dans leur région respective, de publiciser
le colloque et de former la délégation régionale. Des
membres AFEAS ont accepté d'agir comme animatrices, informatrices
ou secrétaires des ateliers de travail à ce colloque national.
Plusieurs contributions ont rendu possible cette réalisation.
Mentionnons celles du programme de la femme du Secrétariat d'État,
les services à la collectivité de l'Université du Québec
à Montréal, Provigo inc., Eaton, Culinar inc., Cosmair inc.,
Clairol Canada, Steinberg inc. et Charles d'Alcan- tara.
Les communications ont joué un rôle important tout au long
de la campagne de sensibilisation portant sur les travailleuses au foyer
du Québec. Des affiches, feuillets publicitaires, macarons ont
été distribués pendant cette période. Les organisatrices
régionales ont émis des communiqués de presse, réalisé
des entrevues à la radio et à la télévision.
Pour publiciser le colloque national, mille affiches et trois mille
feuillets publicitaires ont été distribués dans les régions
du Québec et dans certaines associations canadiennes.
Plus de trois cent cinquante invitations ont été adressées
à des organismes ou à des individus.
Un communiqué de presse a fait connaître les coordonnées
de cet événement. Plusieurs articles paraissaient dans les
journaux et revues. Des entrevues à la radio et à
la télévision furent réalisées avant et après
le colloque national.
Les deux pages suivantes reproduisent des manchettes ex- traites du
dossier de presse des colloques régionaux et du colloque national.
Des commentaires ont été recueillis tout au long des rencontres
de sensibilisation et des colloques régionaux. Ces graffiti, porteurs
de souhaits, constatations, espoirs des femmes, décoraient l'amphithéâtre
lors du colloque national. En voici quelques-uns, exprimés par
les participantes de toutes les régions du Québec.
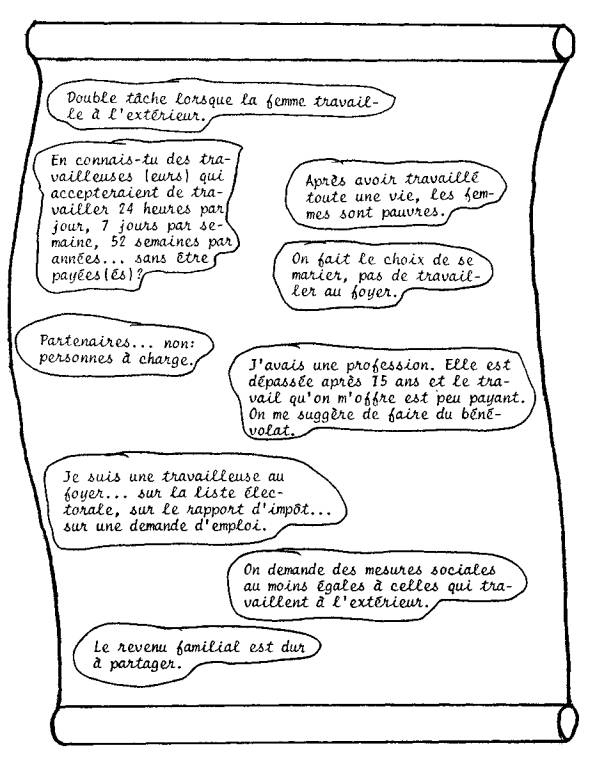
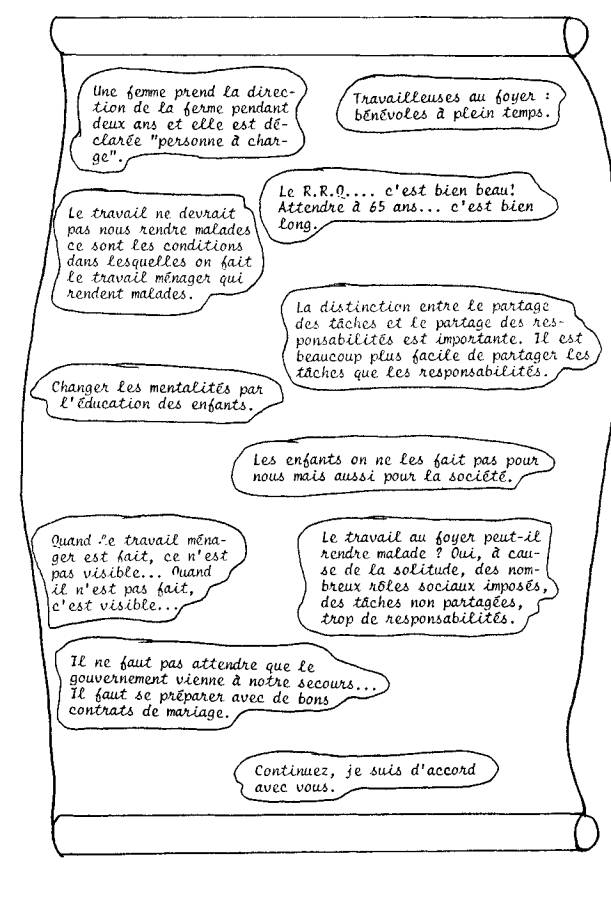
On estime à 300 le nombre de participantes au colloque national.
Elles se sont inscrites à titre individuel ou comme représentantes
d'organismes. Parmi les organismes présents, citons:
- la Fédération des femmes du Québec;
- l'Association des femmes collaboratrices;
- la Fédération des femmes canadiennes-françaises;
- le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail;
- le Mouvement Hélène de Champlain;
- l'Association des familles monoparentales;
- les Femmes acadiennes de l'Île-du-Prince-Edouard;
- l'Association des fermières de l'Ontario;
- le Mouvement des femmes chrétiennes;
- le Réveil des assistés sociaux;
- l'Union des femmes arabes du Canada;
- l'Institut de la famille;
- Plurielles de Winnipeg;
- le Comité féminin de la Société St-Jean-Baptiste.
Plusieurs intervenantes de centres de femmes, des membres de comités
de condition féminine de syndicats, de partis politiques et de
ministères assistaient également à ce colloque.
Les provinces du Canada représentées étaient: Québec,
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard, Ontario,
Manitoba, Alberta.
L'OUVERTURE DUCOLLOQUE
Lise Paquette, présidente générale de l'AFEAS, exprimait,
au moment de l'ouverture du colloque, sa joie de constater l'intérêt
soulevé par le dossier des travailleuses au foyer.
Elle rappelait les rencontres tenues durant la campagne de sensibilisation
et les grands consensus qui se dégagent des col- loques régionaux.
"Les femmes au foyer ont, entre autres, ex- primé leur volonté
de voir leur travail reconnu et d'être con- sidérées
comme des personnes à part entière, non comme des personnes
à charge".
Elle sollicitait la collaboration des participantes: "...Il y a place
aussi pour de nouvelles idées que nous accueillerons avec grand
intérêt. Même si chaque atelier doit prioriser deux
hypothèses, toutes seront recueillies et feront l'objet de considération
de notre part. Votre collaboration est précieuse aujourd'hui.
Elle le sera encore dans les jours a venir. Ce colloque marque la fin
d'une étape et le début d'une autre au cours de laquelle votre
appui, vos réactions, vos suggestions nous seront nécessaires.
Nous savons que tout changement demande une grande persévérance,
une grande ténacité. Comme femmes, nous avons maintes fois
fait preuve de ces qualités. L'occasion nous en est encore donnée.
C'est avec confiance en la solidarité grandissante des femmes que
l'AFEAS vous associe à sa démarche. Cette solidarité
est notre force. Elle est la base pour édifier une société
nouvelle, une société qui reconnaîtra la valeur du travail
au foyer et qui permettra aux personnes qui l'accomplis- sent de dire
fièrement «MOI AUSSI J'TRAVAILLE...AU FOYER»"
Louise Coulombe-Joly, vice-présidente de l'AFEAS et responsable
du dossier des travailleuses au foyer depuis 1981, en faisait l'historique
pour les participantes et donnait un bref compte-rendu des colloques
régionaux.
Lucie Pépin, alors présidente du Conseil consultatif canadien
sur la situation de la femme, rappelait l'importance du travail effectué
au foyer et constatait des injustices faites a ces travailleuses au
foyer. Elle rappelait que le pouvoir politique dont disposent les femmes
est trop souvent ignoré ou mal utilisé.
Après ces allocutions, les personnes présentes visionnaient
le diaporama produit par l'AFEAS «Moi aussi j'travaille».
Descriptif du travail au foyer et présentant les principales problématiques
du dossier, il constituait l'élément idéal pour amorcer
le travail en atelier. Les commentaires recueillis par l'évaluation
demandée aux participantes en faisaient état. On a suggéré
de continuer à l'utiliser pour faire de la sensibilisation. Tout
en informant, on souligne sa capacité de soulever le questionnement.
Par la suite, les participantes se dispersaient dans les ateliers qui
correspondaient à leur choix.
LE TRAVAIL EN ATELIERS
Les thèmes des ateliers étaient les mêmes que ceux choisis
pour les colloques régionaux. Le processus de travail commandait
cette continuité. On retrouvait donc les thèmes d'ateliers
suivants :
- La valeur du travail au foyer - Même s'il s'avère
nécessaire, le travail au foyer est ignoré par la société.
Il n'est comptabilisé nulle part et con- serve son caractère
privé. Pourtant, il contribue dans les faits à l'enrichissement
de la société et a un impact sur la collectivité. Comment
atteindre cet objectif de faire reconnaître la valeur du travail
au foyer?
- Reconnaissance légale et financière: pourquoi pas?
Que signifie le terme reconnaissance pour des femmes qui se consacrent
a un travail non reconnu, non rémunéré. Dans une société
qui évalue un individu
en terme de production, qui considère la travailleuse au foyer
"à charge" de son conjoint, comment définir l'autonomie, la
reconnaissance et le statut légal?
3- Des mesures sociales gouvernementales: pour qui? Des mesures
sociales rejoignent la travailleuse au foyer à travers son rôle
de mère, sa situation de conjointe, de personne à charge.
La plupart des mesures sociales sont liées au travail rémunéré:
régimes de pensions publics, congés et allocations de maternité,
indemnités pour accidents de travail. Les modalités actuelles
d'application de ces me- sures excluent les travailleuses au foyer et
accentuent sa dépendance face au conjoint. Quelles mesures pourraient
satisfaire les besoins propres des travailleuses au foyer?
- Le travail au foyer: toi? moi? nous? - Peut-on parler de
partage si le conjoint perçoit son action comme un apport au
travail qui appartient à l'autre? Il faudrait parler davantage
de partage des responsabilités que du partage des tâches.
Pour effectuer un changement dans les mentalités, les femmes
ont un rôle à jouer en ce sens dans l'éducation des
enfants, dans leurs rapports avec leurs conjoints. Comment faire
évoluer les relations familiales en ce sens?
- Femmes au foyer, femmes en santé?- Les conditions de
travail au foyer peuvent contribuer à amener les femmes à
chercher de l'aide auprès des ressources médicales. Santé-femme:
prévenir ou guérir? la prévention est une démarche
consciente qui s'attarde à rechercher les causes des malaises
plutôt qu'à les masquer par l'absorption de médicaments.
Santé-femme: dépendance ou autonomie? Un individu est
en santé quand il peut devenir autonome, qu'il peut prendre sa
place, résister au courant social qui assigne des rôles.
Quels moyens peuvent favoriser l'autonomie des femmes au foyer en
regard de leur santé?
Toutes les recommandations adoptées lors des colloques régionaux
avaient été acheminées et compilées au niveau provincial,
Certaines étaient réalistes, d'autres utopiques. Toutes ont
été considérées, analysées. Des regroupements
ont dû être effectués pour éviter les répétitions
mais la compilation a été faite avec le souci de conserver
l'intégrité de chaque idée émise.
Réunies dans un document de travail remis à chaque participante,
ces recommandations étaient proposées à la discussion
et au vote dans les ateliers concernés. Il était possible
de modifier, par des amendements, les propositions inscrites au cahier
du colloque ou d'en formuler de nouvelles.
Le déroulement du travail était sensiblement le même
dans chacun des dix ateliers:
- présentation des personnes responsables du déroulement;
- présentation des participantes;
- informations sur les procédures de travail;
- lecture du texte de présentation de la problématique;
- discussion sur les recommandations proposées;
- choix de deux recommandations jugées prioritaires.
On a souligné, dans les évaluations recueillies, le climat
chaleureux et le choix excellent des responsables d'ateliers: animatrices,
informatrices et secrétaires.
LA CLÔTURE DU COLLOQUE
Une plénière complétait le travail effectué dans
les ateliers. C'est a ce moment qu'une représentante de chaque
atelier a fait connaître à l'ensemble des personnes présentes
les deux priorités adoptées par son atelier.
Au terme de cette journée, une causerie fut prononcée par
Francine MacKenzie, présidente du Conseil du statut de la femme
du Québec. Elle a passé en revue les différentes recommandations
faites par le Conseil dans le rapport "Pour les Québécoises,
égalité et indépendance". Elle a assuré l'assemblée
que le Conseil saurait retenir et soutenir les propositions faites par
les ateliers pour faire avancer le dossier et amener la reconnaissance
du travail au foyer.
Lise Paquette faisait ensuite connaître le suivi que l'AFEAS entendait
donner à ce colloque. Elle promettait aux participantes un rapport
du colloque avec le suivi donné aux recommandations. Finalement,
elle remerciait les participantes venues de toutes les régions
du Québec et des différentes parties du Canada pour leur participation
au colloque.
Par les évaluations recueillies, les participantes ont déclaré
être d'accord avec les positions de l'AFEAS. Elles lui demandaient
de poursuivre sa sensibilisation auprès des femmes et ses démarches
auprès des gouvernements.
Un commentaire constant place cette journée sous le signe de la
solidarité: solidarité vécue par les participantes quels
que soient leurs intérêts, leur appartenance. Elles ont apprécié
le contact avec des femmes provenant d'organismes variés, issues
de régions différentes et se situant dans toutes les catégories
d'âge, de l'étudiante à la personne du troisième
âge.
Les participantes ont manifesté leur désir que cette prise
de conscience entraîne des actions individuelles et collectives
pour amener un changement dans la situation vécue par les femmes
au foyer.
Les recommandations retenues comme priorités à l'issue du
colloque national ont fourni de nouvelles pistes pour alimenter le dossier
des travailleuses au foyer. En septembre 1984, l'AFEAS définissait
les procédures qui permettraient de donner suite à ces recommandations.
Un comité ad hoc formé au niveau provincial a procédé
à l'étude de chaque recommandation et en a déterminé
le cheminement.
Certaines des recommandations adoptées lors du colloque re- joignent
des positions déjà adoptées par les membres de l'AFEAS.
Pour respecter le mode de fonctionnement de notre association, les autres
recommandations devront être étudiées et soumises au
vote des déléguées lors de l'assemblée générale
annuelle d'août 1985 avant de faire l'objet de démarches spécifiques.
Cette partie du rapport définit les actions prévues pour
chaque recommandation adoptée au colloque national. Pour bien comprendre
ces prévisions, il est essentiel de faire au préalable une
brève description des moyens habituellement utilisés a l'AFEAS
pour acheminer une recommandation et amener un changement par rapport
à une situation.
ACHEMINEMENT DES RECOMMANDATIONS
Toutes les recommandations adoptées en assemblée générale
à l'AFEAS sont d'abord acheminées aux autorités concernées.
Des responsables des paliers provincial, régional ou local rencontrent
les représentants de ces autorités.
De plus, l'AFEAS profite de toutes les occasions pour véhiculer
les prises de position de ses membres: participation à des
rencontres publiques, élaboration et présentation de mémoires,
interventions dans les médias, concertation avec d'autres organismes,
etc.
Chaque année, une ou des priorités d'action sont choisies
par les membres réunies en congres. Pour 1984-85, la priorité
d'action vise a obtenir pour les travailleuses au foyer l'intégration
au régime des rentes du Québec ainsi que le bénéfice
des autres avantages sociaux habituellement réservés aux travailleuses(eurs)
rémunérées(es): allocation de maternité, congés
de maladie, indemnisation en cas d'accident de travail. Différentes
actions ont été planifiées pour atteindre cet objectif.
Le mois de novembre 1984 fut consacré à l'étude de cette
priorité et à la planification des actions à entreprendre.
Au niveau des 35 000 membres AFEAS:
- Les membres ont été sensibilisées à utiliser
le terme travailleuse au foyer pour s'identifier sur les listes électorales
et a tout endroit où une demande d'identification de profession
est faite.
- Les membres ont été incitées a remplir une demande
d'état de gains inscrits a leur nom au registre de la Régie
des rentes du Québec.
- Les cercles ont sollicité des appuis auprès de différents
organismes de leur localité sur le dossier des travailleuses
au foyer. Les appuis re- cueillis furent acheminés au niveau
régional de
l'AFEAS.
Au niveau regional:
- Des représentantes des conseils d'administration régionaux
avaient pour mandat de rencontrer 4 députés de leur région
(2 au fédéral et 2 au provincial). En plus de sensibiliser
ces représentants à notre dossier, nous voulions qu'ils effectuent
des pressions pour obtenir des avantages sociaux pour les travailleuses
au foyer.
Au niveau provincial;
- Des communiqués de presse concernant notre priorité d'action
ont été émis. Des articles dans les journaux, revues
ainsi que des émissions de radio ou T.V. ont été réalisées
suite à ces communiqués.
- Une lettre expliquant la démarche des membres AFEAS a été
adressée au président de la Régie des rentes du Québec.
- Une lettre défendant les intérêts des travailleuses
au foyer face à l'accès au Régime des rentes du Québec
a été adressée à tous les députés québécois
des gouvernements provincial et fédéral.
- Une démarche fut entreprise auprès de l'Office de la langue
française pour officialiser
le terme "travailleuse au foyer".
AUTRES ACTIONS
Différents projets sont actuellement en cours sur le dossier des
travailleuses au foyer. Ces projets rejoignent certaines des recommandations
adoptées au colloque national. Mentionnons, entre autres, celui
de la reconnaissance des acquis qui vise à informer les femmes
sur la notion de la reconnaissance des acquis, à identifier les
apprentissages acquis par le travail au foyer et le bénévolat
et à les amener à choisir et organiser une action. Ce projet
se déroulera au cours de 1985-86 dans toutes les régions du
Québec.
LES PUBLICATIONS DE L'AFEAS
L'AFEAS publie mensuellement la revue "Femmes d'ici" qui résume
souvent les projets et démarches de notre organisme. Depuis mars
85, une chronique "action" y est publiée mensuelle- ment. Évidemment,
on y traite abondamment des suites données au dossier des travailleuses
au foyer.
Tous les mois, l'AFEAS publie aussi un dossier d'étude pour aider
les responsables locales à préparer les réunions. La
diversité des thèmes nous permet de rejoindre les travailleuses
au foyer: violence, santé, sexisme, économie...
Plusieurs brochures d'information ont été publiées par
l'AFEAS. La brochure "Comment conjuguer amour et sécurité"
fut produite dans le cadre de notre recherche-action sur les travailleuses
au foyer. Cette brochure décrit les différentes for- mes
de contrats de mariage et de testaments en plus de traiter des assurances
et de l'utilisation du crédit. La brochure fut distribuée
en 1982.
Le 31 octobre dernier, l'AFEAS et la maison d'édition Boréal
Express lançaient le "Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes
au foyer". On retrouve un résumé des chapitres de ce volume
dans le chapitre "Historique du dossier des travailleuses au foyer"
du présent rapport.
COLLABORATIONS
Pour sensibiliser le plus grand nombre de femmes possible, l'AFEAS
répond aux différentes demandes qui lui sont adressées
face à l'utilisation du diaporama "Moi aussi j"travaille" et à
la documentation disponible. Entre autres, le diaporama a pu servir
d'outil de travail lors d'un colloque au Manitoba.
On prévoit signer un protocole d'entente avec la Fédération
des Femmes Canadiennes-Françaises pour l'utilisation du matériel
produit par l'AFEAS sur le dossier des travailleuses au foyer. Si ce
projet se réalise, notre dossier connaîtra une large diffusion
hors Québec.
LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES AU COLLOQUE NATIONAL
Les recommandations qui suivent ont été jugées prioritaires
dans les ateliers de travail lors du colloque national. Elles furent
présentées à l'ensemble des participantes au moment de
la plénière.
Pour chaque recommandation, nous présentons les suites données
par l'AFEAS.
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
|
VALEUR DU TRAVAIL AU FOYER
|
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
|
RECONNAISSANCE LÉGALE/FINANCIÈRE
|
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
|
MESURES SOCIALES GOUVERNE- MENTALES
|
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
|
SANTÉ DES FEMMES AU FOYER
|
RECOMMANDATIONS SUITES DONNÉES PAR L'AFEAS
L'AFEAS, depuis 1981, a développé et mené ce dossier.
Elle prévoit poursuivre ses revendications au nom des travailleuses
(eurs) au foyer. Parmi les recommandations issues du colloque national,
plusieurs viennent renforcer nos positions antérieures. Les autres
nous fournissent de nouvelles hypothèses à analyser.
En terme de législation, rien n'est acquis. Au niveau des mentalités
cependant, des changements sont déjà amorcés. Des mesures
concrètes sont de plus en plus discutées pour reconnaître
l'apport des travailleuses au foyer. Il y a peu d'objections pour reconnaître
la valeur économique et sociale du travail accompli au foyer.
L'intégration au Régime des rentes du Québec fait l'objet
de débats publics dépassant le cadre des revendications des
femmes. D'autres mesures s'élaborent à l'intention des travailleuses(eurs)
au foyer: programmes plus variés et accessibles de formation professionnelle,
de reconnaissance des acquis. Par contre, des jugements de Cour nient
encore le droit à une prestation compensatoire pour le travail
effectué au foyer (ex: jugement de la Cour d'Appel du Québec
en octobre 1984).
Même si les mesures législatives sont lentes, les changements
de mentalités sont amorcés dans la population. Généralement,
on s'entend pour dénoncer les problèmes de cette catégorie
de travailleuses(eurs). Déjà, nous avons réussi a démystifier
un certain nombre d'idées bien enracinées qui empêchaient
de voir les solutions concrètes.
Cependant, l'autonomie est, avant tout, un objectif individuel. Dans
cette perspective, l'AFEAS a tenu un rôle d'initiatrice face à
cette prise en charge personnelle. Une partie de la sensibilisation
effectuée propose des moyens pour y arriver: avoir son compte en
banque, établir sa cote de crédit, connaître son contrat
de mariage et la protection offerte par ses assurances, prévoir
les conditions de sa retraite, utiliser l'enregistrement de résidence
familiale, la co-propriété lors d'achats de biens, etc.
Les moyens à notre portée sont nombreux. C'est à chacune
d'entre nous qu'il incombe de les négocier. Une telle démarche
individuelle est le complément indispensable à une action
collective.
Le colloque national a permis une expression de solidarité réconfortante.
Un tel rassemblement de femmes venues pour discuter, s'informer et donner
leur appui a une association sur ce dossier est plus que motivante.
L'AFEAS tient à exprimer sa satisfaction suite aux nombreuses
collaborations obtenues. Elle remercie chacune des participantes qui,
par sa présence, a contribué au succès de cette rencontre.
On a noté, dans les évaluations, l'importance de se regrouper
et la force que nous pouvons détenir quand, ensemble, nous poursuivons
un même but.
L'implication des membres AFEAS dans ce dossier mérite d'être
soulignée. Leur participation a été active et importante
lors des colloques régionaux. Toutefois, nous aurions souhaité
rejoindre davantage la population masculine.
L'AFEAS continuera de travailler au dossier des travailleuses au foyer
dans une optique de justice, d'égalité et de partage. Ces
travailleuses doivent être considérées comme des partenaires
dans la famille et dans la société.
Nous tenons a réaffirmer que nos intentions ne sont pas de retourner
toutes les femmes au foyer ni à diriger celles qui sont au foyer
vers le marché du travail rémunéré. Nous considérons
toutefois que celles qui choisissent librement de demeurer au foyer
doivent être reconnues pour leur travail.
|