LES JEUNES PAS PAREILS MAIS EGAUX
PROJET D'ANIMATION POUR RENOUVELER
PHASE I
présenté par:
Renée Brindamour, c.o.
Ginette Dumont
Fédération des femmes du Québec
Région Québec
Juillet 1988
Dans son programme d'activités de l'automne 1987, la
Fédération des
Femmes du Québec - région Québec, créait un
Comité Jeunesse afin d'établir
des contacts et d'échanger avec des jeunes filles.
Après avoir partagé
avec elles nos perceptions actuelles de la condition
féminine, le Comité
Jeunesse composé de membres actives à la FFQ -
région Québec a conçu un
projet, afin de développer et d'expérimenter des outils
de conscientisation à l'intention des jeunes du secondaire
sur leur conditionnement
dans leur rapport filles-garçons. Ce comité est
formé de Louiselle
Couture, Ginette Dumont, Thérèse Dussault, Louise Godin
et Suzanne
Messier.
Après avoir entériné ce projet lors de son
assemblée générale provin
ciale tenue en mai 1988, la Fédération des Femmes du
Québec, s'est
associée à Relais-Femme pour financer la conception de
l'outil. L'expéri
mentation sera assumée par deux écoles de niveau
secondaire de la région
de Québec, soient l'école secondaire Vanier de la
Commision des écoles
catholiques de Québec et de l'école secondaire Les
Etchemins de la
Commission scolaire des Chutes-de-la-chaudière.
Pour la Fédération des Femmes du Québec -
région Québec, ce projet
constitue sa première approche auprès des jeunes de 12
à 16 ans, et c'est
pourquoi elle entend bien suivre de près les résultats
de cette expérimen
tation afin de poursuivre plus loin son action.
Comité Jeunesse
FFQ - Région Québec
Le projet d'animation, ayant pour objectif général
de reconnaître et
de renouveler les valeurs et les comportements entre filles et
garçons,
est conçu en deux phases. Le premier bloc d'activités
présenté dans ce
document est expérimenté à l'automne 88 et le
deuxième à l'hiver 89.
Le présent document comprend:
en première partie, le guide d'utilisation annonçant
la mission
globale du projet, l'approche utilisée et un plan d'ensemble
des
objectifs poursuivis.
en deuxième partie, le contenu des douze rencontres et
les annexes
qui ont été insérées à la suite de
chaque activité de manière à
faciliter le travail de l'animatrice.
Veuillez prendre note que pour certaines activités, nous
nous sommes
inspirées du document "La Jeunesse" publié par la
Centrale d'Enseignement
du Québec.
Depuis le discours féministe des années 60,
apparaît le déclin
du patriarcat et l'émergence de nouveaux modèles de
rapports
entre les sexes, afin que le sexe ne soit plus un facteur
déterminant des rôles sociaux. Nous constatons alors
une
certaine évolution des moeurs par rapport à la
condition
féminine et masculine.
Depuis ces années, le mouvement féministe, par sa
visibilité,
est à l'origine d'un processus de mutation de la
société qui est
irréversible. Aussi, notre projet d'intervention
s'insérant
dans ce contexte, se veut un projet de société
novatrice au lieu
d'être un projet exclusivement féministe. Il vise
à aider les
jeunes à s'actualiser selon les changements sociaux
actuels.
Considérant l'école comme une
micro-société, considérant qu'il
est souhaitable de réinventer de nouveaux rapports, de
nouvelles
alliances et par conséquent, de modifier les valeurs, les
atti
tudes et les comportements, nous voulons offrir aux jeunes,
un
apprentissage en vue de les informer et de les sensibiliser
à la
condition féminine et masculine. De plus, nous leur
suggérons
d'ouvrir un premier dialogue entre eux sur l'égalité
des sexes.
L'approche privilégiéedans cette session s'inspire
des groupes de rencontre de CarL R.Rogers. Ce psychologue est
reconnu comme véhiculant desnotions de non-directivité, de
respect, d'empathie et d'écoute active. Il croit
inconditionnellement
que la personne possède naturellement la tendance à
l'actuali
sation d'elle-même.
Lors des rencontres, l'implication personnelle et authentique
de
l'animatrice est essentielle. Ses principales
préoccupations
seront: les phénomènes de groupe, les relations
interperson
nelles, la place que chacun occupe et la cohésion du
groupe.
Enfin, un climat sécurisant et permissif favorisera
l'apprentis
sage de l'art de la rétroaction tout au long de la
session.
Des activités structurées seront donc
suggérées, afin que les
jeunes expérimentent des situations proches de leur
réalité.
Cela leur permettra de s'ouvrir à l'expression de leur
propre
expérience et de s'en approprier.
En vue d'atteindre les objectifs caractéristiques des
groupes de
rencontres, le groupe devra être formé de douze (12)
à quinze
(15) jeunes et d'une animatrice.
Une fois le groupe formé, l'homogénéité et
la stabilité des
participantes et participants sont souhaitables, afin
d'assurer
la cohésion du groupe. Si par ailleurs des éducatrices
et
éducateurs veulent se joindre au groupe, l'impact ainsi
créé
pourra avoir des retombées positives dans l'école.
Tout au long de la session, le groupe devra être
assuré de
l'utilisation du même local, à l'intérieur duquel
il y a place à
l'affichage, au mouvement et à toutes formes
d'activités possi
bles. Ainsi, cet environnement permettra de développer
un
sentiment d'appartenance si prioritaire à l'adolescence.
L'animatrice compte sur ce climat de sécurité et de
confiden
tialité, afin de pouvoir présenter des thèmes
intimes et person
nels pendant les deux phases du projet.
La session, d'une durée de 12 semaines est divisée
en 3 blocs de
4 semaines chacun.
L'objectif global étant de reconnaître et de
renouveler les
valeurs et les comportements entre filles et garçons,
chaque
bloc poursuit des objectifs spécifiques:
ler Bloc: - Former un groupe de 10 à 15
personnes.
- Créer des liens de solidarité.
Identifier notre groupe.
2e Bloc: - Se reconnaître comme personne
unique.
hier
aujourd'hui
demain
3e Bloc: - Créer de nouveaux liens de
communications
entre nous (filles et garçons).
Susciter l'intérêt pour la prochaine session.
Le fil conducteur qui sous-tend ces objectifs est:
GROUPE - INDIVIDU - GROUPE
Nous formons ensemble un groupe, nous allons créer des
liens
entre nous. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que
nous
sommes tout d'abord des individus, avec chacune et chacun une
personnalité bien à soi. Et une fois après avoir
bien distingué
ce qui est conditionnement social et ce qui nous appartient
vraiment à soi, cela nous permets de s'impliquer dans de
nouveaux rapports.
Durant l'année scolaire, et ce, une fois par semaine, les
jeunes
se rencontrent sur l'heure du dîner, avec leur lunch. Le
projet
prévoit douze rencontres, soit de la mi-septembre à la
mi
décembre, permettant ainsi de faire la promotion et le
recrute
ment durant les premières semaines scolaires. Chaque
rencontres
d'une durée d'une heure a le profil type qui suit:
Accueil 15 min
Dîner
Mise en train
(annoncer le thème et les objectifs
ou l'activité particulière).
Annoncer l'activité principale 5 min
Activité principale 25 min
Boucler l'activité et rétroaction 10 min
Annoncer le thème de la semaine prochaine3 min
Retour en classe 2 min
OBJECTIFS
Faire connaissance
Former un groupe
Exprimer nos attentes
ACTIVITES:
4.1.1 Accueil
Objectif:
Matériel:
Méthodologie:
Durée:
Faire en sorte que les jeunes se sentent
à l'aise dès leur arrivée.
Aménagement du local + musique.
L'animatrice accueille chaque personne.
5 minutes.
4.1.2. Présentation personnelle.
Objectif: Faire connaissance.
Matériel: Lunch.
Méthodologie: L'animatrice se présente et ensuite,
à
tour de rôle.
Durée:
20 minutes.
4.1.3 Présentation du programme.
Objectifs:
Donner l'information des thèmes des
rencontres.
Expliquer le concept du journal de bord.
Recueillir les attentes.
Matériel:
Méthodologie:
Durée:
Jeu de cartes (fabrication maison).
Confectionner 12 cartes identifiées
chacune à un thème du programme et ses
objectifs. De plus, insérer un nombre de
cartes blanches à compléter par les
attentes des jeunes.
20 minutes.
4.1.4 Jeu du ballon.
Objectif: Apprendre tous les noms et se qualifier.
Matériel:
Ballon.
Méthodologie:
Placer en rond, on lance le ballon à une
personne dont on veut apprendre le nom et
la qualité prédominante.
Durée:
5 minutes.
4.1.5 Remettre le questionnaire "Sensibilisation au
sexisme",
(voir l'annexe I, page 11).
ANNEXE I
QUESTIONNAIRE DE SENSIBILISATION AU SEXISME
- Si tu savais qu'un garçon prend plaisir à faire
des gâteaux, est-ce que tu te moquerais de lui ?
- Le hockey, ce n'est pas pour les filles, le pati
nage, ce n'est pas pour les garçons.
- Si tu savais qu'une fille demande un coffre à
outils en cadeau, est-ce que tu te moquerais
d'elle ?
- Pour une fête entre jeunes, ce sont
généralement
les filles qui préparent le lunch.
- C'est plus naturel pour les mères que pour les
pères de prendre soin des enfants.
- Les grosses boîtes sont généralement
portées
par les garçons.
- Les filles sont plus fragiles que les garçons.
- Etre policier, c'est pour les garçons et être
secrétaire, c'est pour les filles.
- Est-ce que tu trouves cela respectueux:
De siffler après quelqu'un...
- De passer ou de te faire passer des dessins
"porno".
- Est-ce que c'est à chacun d'être respectueux
envers l'autre peu importe que ce soit une
fille ou un garçon ?
- En général, à l'école, est-ce que tu
trouves
les comportements respectueux entre les filles
et les garçons ?
- S'il y a des comportements non respectueux,
d'après toi, lesquels se produisent le plus
souvent ?
OBJECTIFS - Appartenir à un groupe
Créer des liens de solidarité
ACTIVITES:
4.2.1 Mise en train durant le lunch
Objectif: Retour sur le
questionnaire
"sensibilisation au sexisme".
4.2.2 La table
Objectifs: - Expérimenter les phénomènes de
groupe.
Sensibiliser aux stéréotypes existants.
Matériel: Casse-tête en carton d'une table
octogo
nale, (voir l'annexe II, page 14).
Méthodologie: Préparer à l'avance, selon le
nombre de
jeunes, des enveloppes comprenant chacune
un morceau du casse-tête.
Distribuer aux jeunes les enveloppes
avec la seule consigne* de réaliser le
casse-tête dans le temps alloué.
L'animatrice assurera un rôle d'observa
tion des phénomènes de groupe durant
l'activité.
Durée: 20 minutes.
* La forme du casse-tête ne doit pas être
révélée.
4.2.3 Retour sur l'activité
Objectifs: - Faire une rétroaction sur
l'expérience.
- Susciter une réflexion sur les phénomènes
de groupe et les stéréotypes.
- Donner de l'information théorique.
Matériel: Note théorique sur les
phénomènes de
groupe, (voir l'annexe III, page 15).
Méthodologie: Discuter ensemble les faits vécus,
durant
l'expérience et susciter une réflexion
sur les phénomènes de groupe à partir de
la note théorique.
Durée : 15 minutes.
Préparation à la 3e RENCONTRE.
Apporter des revues, ciseaux, colle, ruban adhésif,
coussins ou serviettes.
L'école fournira les cartons de couleurs et les crayons
de feutre.
ANNEXE II
CASSE-TETE DE LA TABLE OCTOGONALE
Explications:
- La présente table est composée de 12 morceaux.
- Le nombre de morceaux nécessaire doit équivaloir au
nombre
de personnes de votre groupe.
Pour ce faire, vous pouvez couper les morceaux
présentés,
plus gros ou plus petits. Mais attention le centre octo
gonale est un espace vide et ne doit pas être compté
comme
un morceau disponible.
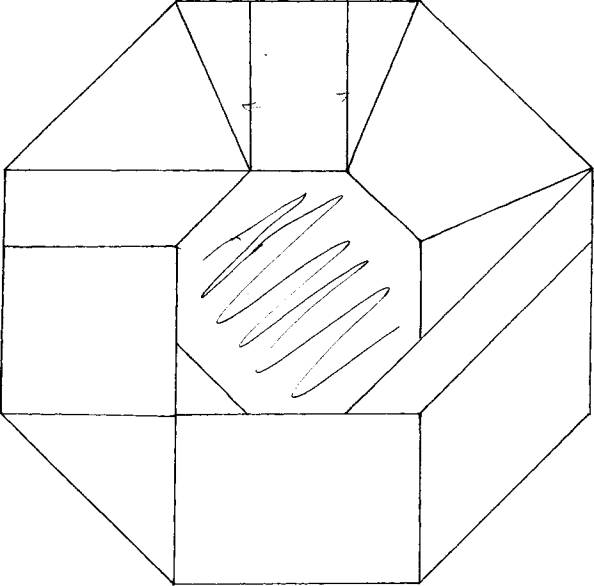
ANNEXE III
NOTE THEORIQUE SUR LES PHENOMENES DE GROUPE:
Tirée de Yves St-Arnaud, Le travail en équipe,
éditions du C.I.M.
Introduction
Les notions de "rassemblement d'individus" et de "groupe sont
fondamenta
lement différentes. Les gens qui composent un rassemblement
demeurent
anonymes, ce sont, par exemple, les spectateurs d'un
théâtre, les passa
gers d'un train ou les consommateurs d'un magazine.
Pour qu'un rassemblement de personnes devienne un groupe, deux
principaux
éléments doivent être en présence:
la perception d'un objectif commun
(une tâche à accomplir ensemble);
- une interaction entre chacune et chacun des membres
réunis (des relations entre les personnes).
Et pour harmoniser le tout, particulièrement dans le cas
d'un groupe de
travail, un troisième élément qui est la
détermination des règles du jeu
qui permettra au groupe de fonctionner.
Dans cette partie, nous vous présenterons certains
éléments théoriques qui
nous permettront d'avoir une compréhension des facteurs de
base de
l'animation:
la vie d'un groupe;
les niveaux de l'animation;
la participation des membres.
La vie d'un groupe
Comme une personne, un groupe a un cycle de développement
naturel qui
comprend 3 phases:
la naissance
la croissance
la maturité
Ce qu'il faut en savoir, ce sont les éléments de
base qui nous permettront
de percevoir où en est rendu le groupe dans son
développement et d'en
saisir le rythme. Par exemple; on ne peut demander une grande
production
à un groupe qui se rencontre pour la première fois. De
la même façon, un
invité assistera à une réunion au moment où
le groupe a atteint la
maturité et celui-ci sentira une énergie, une
cohésion entre les membres.
La NAISSANCE d'un groupe est relié au début d'un
comité après une élection
de nouveaux membres ou au début d'une réunion. Les gens
ne savent pas
encore comment ils vont fonctionner ensemble, comment ils vont
s'entendre
ensemble, comment ils vont travailler ensemble. Et au fur et
à mesure que
le temps passe des éléments se précisent, c'est la
période de la CROISSANCE. On se définit des objectifs
communs, des règlements et les
relations entre les personnes s'établissent.
Durant cette période de croissance, le balancier oscille
entre des élans
de production d'un travail, d'une tâche, d'un
événement et des élans de
complicité entre les membres, où il faut prendre le
temps de mieux se
connaître, afin de tenir compte de chacune et chacun en tant
que personnes
amenant de l'eau au moulin.
A mesure que le groupe progresse la cohésion entre les
membres s'établit
et le cheminement vers l'atteinte des objectifs se poursuit. La
MATURITE
du groupe se dessine au moment où les résultats se
présentent sans trop de
heurts et où le groupe a la capacité de surmonter les
crises.
Les niveauxde
l'animation
L'animation de groupe est un art. La définition la plus
générale du mot
"art" est selon le petit Robert : "un ensemble de moyens, de
procédés
réglés, qui tendent vers une certaine fin
<1>. Cette définition nous
paraît convenir tout à fait à ce que nous
entendons par le terme anima
tion.
1. Paul Robert, Le Petit Robert, dictionnaire de la
langue française,
éditions Le Robert, 1972, 1970 pages.
C'est dans la mesure où l'animatrice, imprimée de
certains principes,
habilitée de certaines techniques et sensibilisée aux
différentes dimen
sions de fonctionnement de groupe, qu'elle pourra le mieux
susciter une
conscience collective pour aider le groupe à atteindre ses
objectifs.
Les 3 niveaux sur lesquels l'animatrice intervient sont:
LE CONTENU (l'objectif commun);
LE CLIMAT (les relations entre les personnes);
LES PROCEDURES (les règles du jeu).
Le niveau du CONTENU: un groupe ne se réunit pas
seulement pour le
plaisir de la chose ou pour les beaux yeux de l'animatrice, mais
bien
parce qu'il a une tâche à accomplir ou un objectif
à atteindre. Il est
donc important que cet objectif ou tâche soit clair,
précis et partagé par
tous. Durant les discussions, le rôle de l'animatrice sera
de voir à ce
que les participantes et les participants expriment clairement
leur pensée
et qu'ils soient compris et écouté de tous.
Le niveau du CLIMAT: lorsqu'un groupe de personnes poursuit
ensemble un
objectif commun, il est inévitable qu'il se crée
occasionnellement des
affinités et des tensions en cours de discussion. La charge
émotive qui
se développe à cause de ces différences de points
de vue peut paralyser le
travail du groupe. C'est donc le rôle de l'animatrice de
voir à faire
circuler l'information rationnelle et affective, à un juste
degré pour
maintenir l'équilibre et favoriser un climat propre à
la discussion.
Le niveau des PROCEDURES: c'est l'ensemble de règles, de
consignes que se
donne un groupe pour son fonctionnement en réunion. Par
exemple, le fait
de lever la main pour demander la parole, le processus de prise
de
décision, le tour de table pour les discussions, la
sensibilisation au
temps. Pour certains groupes leurs procédures sont
consignées dans leurs
règlements généraux, pour d'autres ils utilisent
les procédures d'assem
blée du bien connu, code Morin.
Souvent les personnes qui animent les réunions ne
tiennent pas compte de
l'un ou l'autre des trois niveaux d'animation et c'est à ce
moment-là que
les insatisfactions surgissent de la part des participantes et
des
participants. Vous voyez bien que c'est tout un art l'animation:
de
faire circuler l'information quand elle est nécessaire et
conserver
l'équilibre entre l'efficacité et les échanges
interpersonnelles.
Laparticipation desmembres
Un groupe est formé de personnes rassemblées pour
réaliser des objectifs
communs. Selon la tâche à accomplir et le climat du
groupe, la partici
pation des membres varient à tout moment. Ce qu'on
désigne par la
participation, c'est l'interaction de chacun des membres par
rapport à
l'objectif de la rencontre.
Monsieur Yves St-Arnaud a établi un instrument, une
grille qui permet à
l'animatrice de vérifier le degré d'implication de la
participante ou du
participant par son comportement. Sa grille d'analyse il la
définit en
terme de positions sur un axe de participation.
Position de centre;
Position de l'émetteur;
Position du récepteur;
Position de satellite;
Position de l'absent.
Avant d'identifier chacune des positions, il sera judicieux de
confirmer à
l'animatrice l'importance de développer son sens de
l'observation afin de
saisir où en est la participante ou le participant en
rapport avec
l'objectif de la réunion.
La position du CENTRE
la participante fait une proposition précise sur le
contenu de
la discussion;
le participant fait un résumé des différents
éléments de la
discussion.
Le comportement observé exprime une contribution
personnelle du membre
directement relié à l'objectif, il participe activement
à la réunion.
La position du RECEPTEUR
la participante exprime verbalement ou non verbalement son
attention à
l'égard d'un autre membre qui occupe la position
d'émetteur ou de
centre;
le participant pose une question de clarification à un
autre membre.
Le comportement observé exprime un état d'attention
et de réceptivité par
rapport à ce qui se passe dans le groupe. Cette position
peut aussi
s'appeler observateur passif ou actif, qui intervient dans le
groupe en
fonction de l'atteinte de l'objectif.
La position du SATELLITE
la participante exprime verbalement ou non verbalement une
inattention
évidente au déroulement de la réunion;
le participant fait une intervention sans lien apparent avec
la tâche
à faire.
Le comportement observé exprime clairement qu'il est
distrait de la tâche
à accomplir, que son attention est dirigée
momentanément vers d'autres
aspects de la vie du groupe ou dans sa vie personnelle.
La position de L'ABSENT
- la participante s'absente momentanément de la
réunion;
le participant est en retard.
Un membre occupe cette position lorsqu'il est physiquement
absent du lieu
où le groupe est réuni. Donc il n'y a aucun
comportement à observé mais
souvent cette absence va tout de même avoir un impact sur la
réunion, à
savoir; si cette personne détient de l'information que nous
aurions dû
savoir ou l'absence de membres nous empêche de prendre des
décisions
officielles parce que nous n'avons pas quorum.
Le concept de la participation des membres dans le groupe est
différent du
type de leadership que ceux-ci peuvent exercer. Il faut voir la
partici
pation comme si vous pourriez prendre des photos
instantanées de la
personne assistant à votre réunion et à tout
moment cela change, donc il
est important que l'animatrice soit toujours attentive.
Notes compilées par Ginette Dumont.
OBJECTIFS
Cohésion du groupe
Nommer notre groupe
Aménagement de notre salle
ACTIVITES:
4.3.1 Mise en train durant le lunch
Objectifs: -
Annoncer l'activité principale et
verbaliser les objectifs.
Déterminer les sous-groupes de 3 jeunes
Rappeler le thème global de la session et
susciter l'émergence d'idées créatrices
pouvant servir à l'activité.
4.3.2 Activité principale - Création collective
- Collage
Objectif: Faire des tableaux à la "couleur" du
thème global du groupe: "Les jeunes, pas
pareils, mais égaux".
Matériel: Grands cartons de couleur, punaises,
crayons feutre, colle, ruban adhésif,
ciseaux, différentes revues.
Méthodologie: Chaque sous-groupe crée un collage
à
partir du matériel disponible.
Durée:
25 minutes.
4.3.3 Boucler 1 'activité - Exercicede
remue—méninge
Objectif:
Matériel:
Méthodologie :
Trouver un nom à notre groupe, afin
d'accentuer leur sentiment d'appar
tenance .
Les tableaux produits.
Chaque sous-groupe affiche son tableau.
On demande spontanément les appellations
que les tableaux suggèrent. Faire un
choix final sur le nom à adopter, qui
sera évocateur de la "couleur" de notre
groupe.
Durée:
15 minutes.
OBJECTIFS
Faire le point sur la réalité du groupe
"ADO" aujourd'hui.
Introduire la notion d'identité person
nelle.
ACTIVITES:
4.4.1 Mise en train durant le lunch
Objectif:
Faire le point sur la réalité du groupe
"ADO" tout en leur amenant la notion des
besoins.
Méthodologie:
Faire un retour sur la notion de groupe
des deux premières rencontres.
Le vécu en tant que groupe.
C'est quoi un groupe ?
Quelle est la "couleur" de notre
groupe ?
Amener le groupe à identifier ce qui
caractérise particulièrement un groupe
d'adolescents. Demander s'il y a des
sujets qui n'auraient pas été encore
mentionné.
Ex: - Les changements physiologiques,
biologiques.
- Les besoins de plaire etc...,
et faire appel à leur vécu
comme adolescent.
L'animatrice amène ainsi
l'activité principale sur
besoins de la personne.
le groupe à
la notion des
4.4.2 Activité principale — Besoins de la
personne
Objectif: Reconnaître les besoins fondamentaux et
la façon dont ils se manifestent.
Matériel: Liste des besoins fondamentaux,
(voir l'annexe IV, page 25).
Méthodologie:
L'animatrice présente l'activité princi
pale en se servant comme exemple des
besoins physiques et d'accomplissement.
- Interroger les jeunes sur leur connais
sance de la notion de besoins en se
servant comme exemple des besoins
physiques et d'accomplissement.
Déterminer 3
le matériel.
sous-groupes et distribuer
Durée:
5 minutes.
Proposer un besoin différent (sécurité,
affection, ou estime) à chaque sous
groupes et répondre aux questions.
Durée:
15 minutes.
Retour au grand groupe.
Chaque sous-groupe fait part
réflexions, un besoin à la fois.
Durée:
10 minutes.
4.4.3 Boucler l'activité
Retour sur le processus de l'activité principale en
suggérant de poursuivre la réflexion dans leur
journal de bord.
Faire ressortir le besoin satisfait et non
satisfait.
Par quels moyens peux-tu satisfaire ce
besoin ?
Préparation à la 5e rencontre.
- Apporter une photo, un dessin ou une découpure de
magazine, les
identifiant entre 0-7 ans.
Echanger à l'aide d'un questionnaire distribué aux
jeunes (voir
l'annexe V, page 26) avec une personne significative de la
parenté.
Monter un petit scénario, histoire humoristique,
improvisation
sur un des aspects qu'ils veulent nous faire connaître
d'eux,
d'une durée maximale de 3 minutes.
ANNEXE IV
LISTE DES BESOINS FONDAMENTAUX
besoin physique (santé, bien-être);
besoin de sécurité;
besoin d'affection et d'appartenance;
- besoin d'estime (considération et réussite);
besoin d'accomplissement de soi (aspirations, savoir,
agir,
réalisations).
QUESTIONS:
Comment est-ce vraiment un besoin ?
Comment je reconnais et ressent ce besoin ?
Comment il se manifeste dans mes comportements ?
GUESTIONNAIRE SUR L'HISTOIRE
PERSONNELLE
ANNEXEV
- Retracer une manie personnelle
(ex.: tirer la jupe de ma mère).
- Avais-je un surnom ?
- Me suis-je déjà sauvé(e) de la maison
?
- Ai-je déjà fait un mauvais coup ?
- Quels étaient mes jeux favoris ?
- Un événement marquant...
- Et d'autres informations que tu aimerais nous livrer.
OBJECTIF - Reconnaître son
histoire personnelle.
ACTIVITES:
4.5.1 Mise en train durant le lunch
Objectif: Présentation du matériel nous
identifiant
0-7 ans.
Matériel: Photo, dessin, découpure de
revues.
Méthodologie:
Au lunch, chaque jeune présentera sa
photo et partagera avec nous la raison de
son choix.
4.5.2 Activité principale - Place au
Théâtre
Objectif: Nous présenter une caractéristique
de
leur personnalité.
Méthodologie: A tour de rôle les jeunes font
leur
présentation, en commençant par la
personne qui est prête à s'exprimer.
Durée: 30 minutes.
4.5.3 Boucler l'activité
L'animatrice demande aux jeunes; qu'est-ce que
l'activité vous a appris sur vous-mêmes ?
- Elle suggère de poursuivre la réflexion dans
le
journal de bord.
Durée: 5 minutes.
OBJECTIFS - Identifier nos forces et faiblesses
personnelles versus l'autre.
Evaluer l'estime de soi.
ACTIVITES:
4.6.1 Mise en train durant le lunch
Présenter le thème et l'activité. Elaborer un
peu plus
sur la notion de l'estime de soi.
4.6.2 Activité principale - Les deux pôles de ma
personna
lité
Objectif: Prendre conscience de soi; sur le
plan
physique: mon corps et ses différentes
parties, ma physionomie, ma respiration
et sur la plan psychologique: ma
personnalité, mes habitudes, mes désirs,
mes besoins, mes forces et faiblesses.
Matériel: Musique de relaxation.
Méthodologie: Chacun prend une position confortable,
assis sur sa chaise. L'animatrice
suggère lentement les séquences
suivantes:
Prendre conscience de soi sur le plan
physique. Amener les jeunes à une
détente complète de leur corps, des pieds
à la tête, tout en se concentrant sur la
respiration qui permet de se centrer sur
soi.
Prendre conscience de soi sur le plan de
la personnalité; en gardant les yeux
fermés, amener les jeunes à identifier
leurs qualités, leurs forces et aussi
leurs limites et faiblesses. Prendre
contact avec ces deux pôles de leur
personnalité.
Durée:
20 minutes.
4.6.3 Boucler l'activité
Objectif: L'animation se continue de façon à
alimenter la réflexion des jeunes autour
de l'expérience vécue.
Méthodologie: - Faire ouvrir les yeux:
- Evaluer la détente corporelle.
- Suis-je plus ou moins détendu
qu'au début ?
- Qu'est-ce qui a causé certaines
tensions ?
- Les yeux fermés, la concentration sur
soi, la réflexion intime (forces,
faiblesses).
La réflexion peut rester personnelle ou être
partagée.
Terminer en distribuant la feuille sur l'estime person
nelle, à compléter chez eux, (voir l'annexe VI,
page 31).
Durée:
15 minutes.
ANNEXE VI
ESTIMEPERSONNELLE
L'estime personnelle est ma capacité de me sentir bien et
de me savoir
important(e), en tout temps et en toutes circonstances. C'est
aussi ma
volonté, qu'il en soit ainsi pour les autres.
C'est me faire plaisir à moi, bien me traiter et savourer
la vie à
travers tout. C'est ma façon positive de me voir.
PROCEDURE
J'identifie des activités qui me font réellement
plaisir, qui me
donnent de la joie. Si je veux, je les inscris dans mon journal
de bord.
Quotidien
4.
________________________________________________________________________________
Hebdomadaire
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
Mensuel
Annuel
1.
______________________________________________________________
2. ___________________________________________________
OBJECTIF - Amener les personnes à faire des
choix plus éclairés, novateurs, qui répondent
plus à leur individualité.
ACTIVITES:
4.7.1 Mise en train telle que prévue dans le profil
type
4.7.2 Activité principale - Apprentissage des
rôles
Objectif: Sensibiliser les jeunes à l'influence du
conditionnement social dans leur choix de
vie.
Méthodologie :
Distribuer aux jeunes une feuille sur
laquelle est inscrite une liste de traits
de caractère, (voir l'annexe VII,
page 34).
A l'aide de cette liste, proposer aux
jeunes de se faire un portrait personnel
de traits de caractère qui semblent leur
convenir.
Le groupe engage une discussion à partir
du matériel personnel. L'animatrice
amène les jeunes à se questionner:
Est-ce que le portrait est
stéréotypé ?
Qu'est-ce qui me fait dire qu'il l'est
ou pas et pourquoi ?
Est-ce qu'il correspond à une image de
la société actuelle ?
Est-il avant-gardiste ou pas et
pourquoi ?
Durée: 25 minutes
4.7.3 Boucler l'activité
Identifier les aspects qui ont suscité le plus de
réactions et continuer l'échange. Quels moyens
pren
dront-ils pour effectuer des modifications s'il y a
lieu ?
Durée: 5 minutes.
Préparation à la 8e rencontre.
Distribuer et lire l'article "Un peu de paix et d'amour'
(voir annexe VIII, page 35).
ANNEXE VII
LISTE DES TRAITS DE CARACTERE
Incohérence
Spontanéité
Soumission
Besoin d'ami(e)s
Esprit méthodique
Besoin de prestige
Subtilité
Besoin de s'affirmer
Activité
Ruse
Besoin de sécurité
Indépendance
Besoin d'être
caressé(e)
Peur
Goût du secret
Agressivité
Besoin de se
confier
Autorité
Créativité
Besoin de puissance
Décision
Rêve
Fermeté
Nervosité
Goût du risque
Orgueil
Sensibilité
Coquetterie
Rigidité
Besoin sexuel
Besoin d'amour
Diplomatie
Passivité
Jalousie
Scepticisme
Intellectualisme
Besoin de célébrité
Cynisme
Intuition
Ambition
Besoin de plaire
Compassion
Combativité
Discipline
Besoin d'être
admiré(e)
OBJECTIFS - Définir la notion de valeur.
Faire ressortir mes valeurs.
Assumer mes valeurs dans mes compor
tements avec mon ami(e), ma famille,
ma gang.
ACTIVITES:
4.8.1 Mise en train durant le lunch
Echanger sur l'article distribué la semaine
précédente
"Un peu de paix et d'amour", en les faisant verbaliser
sur les valeurs des jeunes.
4.8.2 Activité principale — Jeux des
valeurs
Objectifs: Identifier ce qu'est une valeur, iden
tifier des valeurs, identifier leurs
valeurs.
Matériel: - Confection de 30 cartes, chacune iden
tifiée à une valeur (voir l'annexe IX
page 40).
Photocopier en nombre suffisant
l'annexe IX.
Méthodologie:
Etaler les cartes devant nous.
Les jeunes prennent connaissance des
différentes valeurs proposées et
déterminent celles qui les rejoignent.
Les jeunes complètent les feuilles
d'identification de leurs valeurs
(voir l'annexe X, page 41).
Durée: 20 minutes.
4.8.3 Boucler l'activité
Echanger en dyade ou en groupe la justification de leur
choix et apporter la notion de comment assument-ils
leurs valeurs dans leurs relations interpersonnelles.
Durée: 10 minutes.
Préparation à la 9e rencontre.
Achat d'une carte de souhaits stéréotypée.
|
LISTEDES VALEURS
Ambition:
Amitié:
Amour:
Apparence :
Auto-suffisance :
Bonheur :
Compétence :
Consommation :
Connaissance :
Créativité :
Dévouement :
Esthétique :
Famille:
Honnêteté :
Honneur :
Influence:
Justice:
Liberté :
Loisir:
Paix:
Popularité:
Prestige:
Spiritualité:
Santé:
Sécurité:
Sincérité:
Solidarité:
Succès :
Tolérance:
Travail:
|
, ANNEXE lY
Désir de devenir célèbre ou de recevoir des
honneurs.
Entente mutuelle, sympathie.
Affection envers les autres.
Attrait personnel important.
Autonome, indépendant.
Plaisir, contentement, joie.
Capable, efficient, compétent.
Usage de biens et services.
Informat ion, savoir.
Imaginatif, inventif.
Serviable, attentif aux besoins des autres.
Sensible à la beauté de l'art et de la nature.
Personnes vivant sous le même toit.
Digne de confiance.
Respect, dignité.
Autorité sur les personnes ou choses.
Egalité de possibilité pour tous.
Agir sans contrainte.
Temps libre.
Ordre, exempté de guerre.
Aimé et respecté.
Distinction, récompense pour habiletés ou
réussites personnelles.
Vie intérieure, sérénité.
Mentale et physique.
A l'abri du danger, inquiétude.
Sans prétention ou illusion.
Intérêt commun, entraide.
Fortune et gloire.
Patience, acceptation.
Emploi, métier, profession.
OBJECTIFS - Distinguer les notions de valeurs,
attitudes, comportements.
Adopter de nouvelles attitudes avec
mon amie, ami.
ACTIVITES :
4.9.1 Mise en train durant le lunch
Objectif: Identifier les stéréotypes
sexistes
dans les cartes de souhaits.
Matériel: Cartes de souhaits.
Méthodologie: Durant le lunch, les jeunes partagent
leurs trouvailles et cela suscite une
discussion sur les stéréotypes.
4.9.2 Activité principale - La vie n'est pas un
roman
Harlequin
Objectif: Faire émerger les stéréotypes
sexistes
dans les relations entre les filles et
les garçons.
Méthodologie:
- Dans les groupes non mixtes de 3 à 5
personnes, les jeunes échangent à
partir de l'exercice de réflexion
relativement aux rapports filles
garçons (voir l'annexe XI, page 44).
- En plénière, filles et garçons mettent
en commun leurs réflexions.
Durée: 25 minutes
4.9.3 Boucler l'activité
L'animatrice amène les jeunes à identifier les
attitudes
et comportements qu'ils souhaiteraient modifier.
Durée: 10 minutes
EXERCICE DE RÉFLEXION POUR LES
FILLES ANNEXE XI
Est-ce que les situations suivantes correspondent à une
réalité vécue par
toi ou par une ou des filles que tu connais ?
Relativement aux rapports affectifs
filles-garçons:
ne pas sortir avec la famille ou des amies parce que la fille
attend
un appel téléphonique de son "chum";
se poser un tas de questions sur soi parce que les gars ne
s'intéres
sent pas à soi "ne pas pogner";
aller dans une soirée et attendre que les gars viennent
te demander
pour danser;
se maquiller pour plaire ou parce que toutes les filles du
groupe le
font;
dire du mal d'une fille qui a "volé" le "chum" d'une
autre;
aller quand même dans un endroit avec ton ami, même
si cela ne
t'intéresse pas (ex.: une partie de hockey);
accorder priorité à une sortie avec un gars
plutôt qu'à une sortie
entre filles;
croire qu'une fille doit faire les premiers pas après une
chicane avec
son "chum";
ne pas oser remettre un gars à sa place lorsqu'il
fait des remarques
grossières sur les femmes, sur leur corps;
se sentir mal à l'aise quand un gars veut t'embrasser et
ne pas oser
t'opposer pour ne pas paraître "niaiseuse" ou ne pas oser
t'opposer
par gêne;
vouloir embrasser un gars mais ne pas oser le faire;
avoir peur de passer pour une fille qui "marche";
avoir seulement le goût de marques d'affection et de
tendresse et ne
pas être capable de dire non à un gars qui veut que le
rapprochement
aille plus loin.
accepter une claque de son frère ou son "chum".
EXERCICE DE RÉFLEXIONPOUR LES GARÇONS
ANNEXE XI
Est-ce que les situations suivantes correspondent à une
réalité vécue par
toi ou par un ou des garçons que tu connais ?
Relativement aux rapports affectifs
filles-garçons:
se poser des tas de questions sur soi parce que les filles ne
s'inté
ressent pas à soi "ne pas pogner";
être gêné de parler àune fille qui nous
plaît;
laisser entendre à une fille qu'on l'appellera pour
sortir et ne pas
le faire;
prendre régulièrement l'initiative de choisir le
lieu de sortie avec
sa "blonde";
se retrouver avec un groupe de gars et tenir des propos
désobligeants
à l'égard des filles et en rire, alors que seul, on
n'oserait pas;
se moquer d'un gars qui éprouve de la gêne avec les
filles;
masquer sa gêne et commettre des maladresses envers les
filles;
accorder priorité à une sortie entre gars
plutôt que d'accepter une
invitation d'une fille;
ne pas tolérer que la fille refuse de se faire
"minoucher" durant une
soirée où elle est fatiguée;
embrasser une fille sans tenir compte de la gêne ou de
l'embarras
qu'elle éprouve;
ne pas être l'initiateur d'un baiser avec une fille;
traiter de "niaiseuse" une fille lorsqu'ils vont penser
qu'elle
accepte toute avance sexuelle;
se surprendre qu'une fille veuille limiter le rapprochement
à des
marques d'affection et de tendresse;
avoir peur de passer pour un "niaiseux" parce que tu n'as pas
encore
fait des avances sexuelles à une fille;
mépriser verbalement sa "chum" ou sa soeur;
appeler sa "chum" sa fille.
OBJECTIFS
Analyser les rôles dans ma famille
et les valeurs qu'elles sous-tendent.
Assumer mes valeurs individuelles dans
mes relations avec ma famille.
ACTIVITES:
4.10.1 Mise en train durant le lunch telle que
prévue
dans le profil type
L'animatrice explique la notion de règles
familiales selon la note théorique proposée
(voir l'annexe XIII, page 48).
4.10.2 Activité principale - Jeu de rôles
Objectif:
Identifier différentes règles implicites
ou explicites dans une famille.
Méthodologie :
L'animatrice divise le groupe en deux
avec les consignes suivantes:
- un des groupes devient des parents et
l'autre représente des jeunes adoles
cents, et ils devront chacun de leur
côté établir une liste de règles
familiales.
Durée:
- En plénière, chaque groupe énonce leur
résultats et l'animatrice les transcrit
au tableau en 2 colonnes.
25 minutes
4.10.3 Boucler l'activité
A partir deslistes fournies, l'animatrice amène
les jeunes àreconnaître, à nommer les valeurs
qui
sous-tendentces règles.
Ex.: santé,sécurité, liberté.
Suggérer de poursuivre la réflexion dans le
journal
de bord à partir des questions suivantes:
Qui fait les règlements ?
Est-ce que ces règlements me conviennent ?
Sinon, comment j'assume le choix de mes
valeurs à travers les règles de ma famille ?
Durée: 10 minutes
annexexii
NOTE THEORIQUE SUR LA NOTION DE
RÈGLESFAMILIALES
selon "L'éducation sexuelle en fanille" par
Pierre-Yves Boily, éditions
Anne Sigier, p. 31-32-33
Les règles familiales indiquent comment chaque membre
peut
remplir ses rôles. Les règles répondent à la
question "Qu'est-ce qui est
permis ? Qu'est-ce qui est défendu ?" Certaines règles
sont rigides; il
n'y a pas de "passe-droit". Si un membre les enfreint, il
s'attire des
reproches de toute la famille. D'autres règles sont souples;
elles
s'appliquent plus ou moins compte tenu des circonstances. Enfin
d'autres
règles sont spontanées et s'appliquent dans une
situation particulière.
Un phénomène demeure constant cependant: plus la vie
familiale est
difficile, plus les règles sont rigides. Les règles,
comme les rôles, ne
sont pas toujours explicites, verbalisées, mais tous les
membres d'une
famille les connaissent. Voici quelques exemples de règles
familiales:
- chacun peut exprimer son agressivité;
les baisers se font le soir ou avant de
partir;
- chacun décide de sa chevelure et de ses
vêtements;
les drames sur les sorties commencent après 23 heures;
la TV est fermée lorsqu'on présente des films
violents;
- chacun peut se promener nu dans la maison;
les portes de chambre restent fermées;
- la porte de la toilette doit être barrée;
les questions sexuelles ne sont pas abordables durant les
repas;
- la chambre des parents est interdite aux enfants;
il ne faut pas se moucher à la table;
- quand les parents parlent, il faut les écouter sans
inter
venir.
Chaque famille a ses règles sous forme d'habitudes, de
coutumes,
de façons de faire. Les difficultés surviennent lorsque
les règles ne
correspondent plus au vécu familial, ou lorsqu'un membre,
à cause de son
vécu personnel, conteste ouvertement une règle. Les
règles existent pour
obtenir une certaine harmonie familiale, mais toutes les
règles peuvent
être changées et certaines sont plus faciles à
changer que d'autres.
OBJECTIFS - Vérifier le réalisme d'agir
selon des
valeurs, attitudes, comportements
novateurs, dans lesquels ils se recon
naissent .
Vérifier "le moi dans la gang".
ACTIVITES:
4.11.1 Mise en train durant le lunch, telle que prévue
dans le
profil type
4.11.2 Activité principale - L'improvisation en
comparé
Objectif: Expérimenter les stéréotypes
sexistes et
non-sexistes véhiculés dans les groupes
de jeunes.
Méthodologie:
- Diviser le groupe en deux.
- Donner comme consigne au 1er groupe
d'improviser 5 minutes sur le thème
suivant:
. Ma gang qui véhicule des stéréotypes
sexistes.
Laissez 1 minute de préparation au
groupe.
- Donner comme consigne au 2e groupe
d'improviser 5 minutes sur le thème
suivant:
- Ma gang qui véhicule des stéréotypes
non-sexistes.
Laissez 1 minute de préparation au groupe.
Durée: 12 minutes.
4.11.3 Boucler l'activité
L'animatrice interroge le groupe numéro 1, sur ce
qu'il
a vécu (5 min) et ensuite, le groupe numéro 2 (5
min).
L'animatrice, à partir des réflexions, fait cheminer
le
groupe par rapport à l'objectif du thème.
Durée: 10 minutes.
Préparation à la 12e rencontre.
Prendre le questionnaire sur la sensibilisation au
sexisme,
(voir l'annexe I, page 11), à rapporter à la prochaine
rencontre,
une fois complété.
Apporter ciseaux, colle, ruban adhésif; l'école
fournira les grands
cartons de couleur et les crayons de feutre.
OBJECTIFS - Réaliser une synthèse des
apprentissages
de la session et exprimer les changements
souhaités s'il y a lieu.
Susciter l'intérêt de continuer au 2e
bloc de rencontres.
ACTIVITES:
4.12.1 Mise en train telle que prévue dans le profil
type
4.12.2 Activité principale - Création collective
- collage
Objectif: Vérifier si les jeunes se sont
appropriés le thème global de la session:
"Les jeunes, pas pareils mais égaux".
Matériel: Grands cartons de couleur, punaises,
crayons feutres, colle, ruban adhésif,
ciseaux, différentes revues.
Méthodologie:
En sous-groupe de 3 jeunes, chaque sous
groupe crée un collage à partir du
matériel disponible en exploitant le
thème principal:
"Les jeunes, pas pareils mais égaux".
Durée: 20 minutes
Retour en grand groupe. Chaque sous
groupe présente son collage.
Durée: 10 minutes.
4.12.3 Boucler l'activité
1. Présentation du thème global et du programme
d'activités pour le 2e bloc de rencontres.
2. Evaluation de la session: compléter le
questionnaire "évaluation de la session"
(voir l'annexe XIII, page 54).
Durée: 10 minutes.
4.12.4 Echange de souhaits de Joyeuses Fêtes et de
Bonnes
Vacances
5.1 Evaluationde la session
THEME GLOBAL: LES JEUNES, PAS PAREILS MAIS EGAUX.
Directives: Veuillez encercler le chiffre approprié.
- très satisfaisant
- satisfaisant
- + ou - satisfaisant
- insatisfaisant
- très insatisfaisant
RAPPEL DES THEMES ET ACTIVITES
- Connais, connais-pas
- J'appartiens à un groupe
- Notre groupe
- Moi, là-dedans
- Hier, qu'est-ce que j'étais?
- Aujourd'hui, qu'est-ce
que je suis ?
- Demain, qu'est-ce que
je serai ?
- Moi et les autres
- Moi et ma ou mon "chum"
- Moi et ma famille
- Ma gang
- J'assume ma différence,
ma spécificité
Jeu de cartes
La table octogonale
Création collective
Identification des besoins
Place au théâtre
Pôles de ma personnalité
Apprentissage des rôles
Jeux des valeurs
La vie n'est pas un roman
Harlequin
Jeu de rôles
Improvisation
Création collective
LE CONTENU
Les thèmes abordés et les activités
proposées
étaient adéquats et pertinents de
façon:
12345
Laquelle j'ai le plus aimée numéro:
________________
Laquelle j'ai le moins aimée numéro:
________________
Cette session a répondu à mes attentes d'une
façon: 12345
Commentaires : _______________________________________
Climat, processus
Ma participation et mon implication personnelle étaient:
12345
Commentaires : __________________________
La participation et l'implication des membres 12345
du groupe étaient:
Commentaires: __________________________
Les échanges se sont faits dans un climat: 12345
Commentaires : __________________________
L'animation
La manière dont les rencontres étaient animées
était: 12345
Commentaires : __________________________
L'animatrice, au niveau de ses connaissances, de sa
facilité à les transmettre et son dynamisme dans le
groupe était:
Commentaires : __________________________
__________________________________________________ Merci
beaucoup 1
Le journal de bord est un cahier personnel dans lequel
j'inscris
mes sentiments, mes émotions, mes inquiétudes et mes
réflexions
après chaque rencontre. Il n'est pas nécessaire que ce
soit
long; parfois une réflexion et une pensée suffisent
à démontrer
ce que j'ai ressenti par rapport à une des activités,
ou par
rapport aux relations avec les autres. Cela peut aussi
devenir
un outil utile à ma croissance personnelle dont le contenu
peut
être partagé avec les autres, si la personne le
désire.
C'est une excellente habitude à prendre à l'occasion
de diverses
activités de la vie courante, car le journal personnel
permet de
rester en contact avec soi, de s'intérioriser et aide à
se
connaître.
Il est bien entendu que l'animatrice ne fait que suggérer
cette
façon et que cela demeure un choix personnel.
Boily, Pierre-Yves, L'éducation sexuelle en
famille. Québec, Anne
Sigier, 1984.
Gauthier, Gaston, Le counseling de groupe. Québec,
P.U.Q., 1984.
Pelletier, Denis, Bujold, Raymonde et Coll., Pour une
approche
éducative en orientation. Québec, Gaétan
Morin, 1984.
Rogers, Carl R., Les groupes de rencontre. Paris Ounod,
1973.
St-Arnault, Yves, Les petits groupes. Québec, C.I.M.,
1978.
St-Arnault, Yves, La personne humaine. Québec,
C.I.M., 1974.
Documents: "La jeunesse", cahier pédagogique,
Québec, Communication
C.E.Q., juin 1985.
"Pour créer de nouveaux rapports femmes-hommes",
Cahier
pédagogique, Québec, Communication C.E.Q., février
1981.
"Famille et sexualité", guide de l'animateur,
Fédération
de la famille de Québec.
|