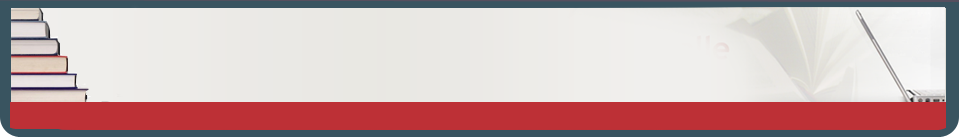Victor Bélanger
Anne-Marie Ouellet
Étiennette C.-Sirois
Marie-Rose Ouellet
Préface de Marc Laberge
![]()
Centre Alpha
Recueil de contes et récits de vie
Coordination du projet
Marcel Desjardins
Saisie des textes
Julie Ouellet
Représentations graphiques
Anne-Marie Ouellet
Collaboration spéciale
Centre d'Édition des Basques
Correction
Marcel Desjardins, Julie Ouellet, Anne Paquette, Paul Dumas, Nathalie Ouellet
ISBN2-920829-11-4
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada
Publié par le Centre Alpha des Basques avec l'appui financier du ministère de l'Éducation du Québec et du Secrétariat national à l'alphabétisation dans le cadre du programme Initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière d'alphabétisation (IFPCA).
Pour commander des exemplaires
Centre Alpha des Basques 15, rue Notre-Dame Est, C.P. 1337 Trois-Pistoles (Québec) GOL 4K0 Téléphone: (418) 851-4088 Télécopieur : (418) 851-3567 Courriel : alfabas@globetrotter.net
Et si les racines continuaient de pousser!
Pareilles à des vers de terre qui, dit-on, fécondent la terre qu'ils traversent aveuglément, les histoires passent de bouches à oreilles et disent, depuis longtemps, ce que rien d'autre ne peut dire.
Jean-Claude Carrière
La vie moderne et particulièrement la télévision en viennent à nous convaincre que les choses n'arrivent qu'aux autres, que notre vie est vide. On finit par vivre par procuration, à travers la vie des autres. Et pourtant, chacun d'entre nous porte un grand nombre d'histoires en sa mémoire. Pour pouvoir les raconter, il faut chercher l'accès à son propre imaginaire.
Ce plaisir ancien et universel qu'est celui de raconter est presque tombé dans l'oubli au cours du XX e siècle. On a cessé d'écouter les personnes qui avaient un vécu et qui ne demandaient rien d'autre que d'être entendues. Que ce rapport individu-récit se rompe et voilà qu'une société se déconnecte d'elle-même pour se « mondialiser », perde le fondement de son identité et se retrouve à la dérive. Des peuples s'effacent ainsi : ne plus pouvoir se raconter conduit à s'oublier faute d'une mémoire constamment ravivée.
Depuis longtemps, lors de mes déplacements de conteur, j'étais à l'affût de la possibilité d'amener les gens à raconter leurs propres histoires. Je percevais bien l'effet stimulateur des mots « dits » sur l'esprit d'une grande partie des auditeurs. Souvent, je les incitais à poursuivre par eux-mêmes en fouillant dans leur
imaginaire à la recherche de leurs propres histoires. Parce que pour moi, une personne normale est une personne capable de raconter sa propre histoire. Elle sait d'où elle vient, son origine, son passé, une mémoire empreinte de son vécu, elle sait où elle vit et connaît son identité et elle croit savoir où elle va. Elle est située dans le mouvement de la vie et donc dans un récit, dans une histoire qui est la sienne et qui peut se raconter.
Lorsque à Trois-Pistoles, en 1996 lors du Festival des Grandes-Gueules, l'idée est venue de chercher les histoires que les habitants de la région auraient à raconter. Et, en collaboration avec le Centre Alpha des Basques, nous voilà à l'écoute des gens qui nous transmettent ce que la vie leur a donné. Issus d'un peuple de parole qui a, depuis toujours, appris à exister et à se définir par l'oralité, les gens d'ici ont la mémoire débordante d'histoires qui ont cheminé à travers leurs mémoires comme des secrets bien gardés.
Raconter une histoire c'est une manière de se couler dans le temps.
Marc Laberge

Pionnier de la première heure lors de la création de la petite municipalité de Saint-Guy dans les Basques, monsieur Bélanger a été, comme bien d'autres de son temps, bûcheron et cultivateur. Il a élevé une famille de quinze enfants et vit aujourd'hui une retraite paisible à Saint-Jean-de-Dieu.
Il aime tout ce qui touche la nature et plus particulièrement la cueillette des fruits sauvages.
Monsieur Bélanger est un conteur naturel qui sait captiver son auditoire par son franc parler et un foisonnement intarissable d'anecdotes, de récits et de contes toujours plus « vrais » les uns que les autres.
Présent à tous les ateliers de contes et récits de vie organisés par le Centre Alpha au cours des quatre dernières années, monsieur Bélanger nous présente une brochette de contes issus de son imagination ou de faits vécus.
M.D.

On était à l'école un hiver quand on a appris que la voisine, madame Edmond, avait eu un petit bébé. Les garçons de l'école disaient qu'il était dans son ventre et était sorti par en bas. Moi, j'ai dit : « Ben non! Les bébés sont apportés par les sauvages. Ma mère me l'a dit ».
Je lui avais demandé d'où viennent les bébés et les petits animaux parce que toutes ces questions me tracassaient beaucoup.
Pour les petits veaux, c'est facile. Ils viennent d'en dessous des pavés de l'étable. Je n'avais pas pu vérifier parce que mon père nous renvoyait à la maison à chaque fois qu'un veau arrivait. Il disait que la vache devenait maline, qu'elle avait peur de tomber et que c'était dangereux quand on ouvrait un pavé.
Pour les cochons, c'était plus compliqué. On devait avoir prévu un petit pavé spécial dans un coin du clos de la truie pour que les petits cochons puissent sortir et ne pas retomber en-dessous de la soue.
Donc, cet après-midi là après l'école, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a redit que c'était les sauvages qui avaient apporté le bébé à madame Edmond. Comme il y avait de la neige, les sauvages avaient mis leurs raquettes de babiche, étaient sortis du bois sans faire de bruit et avaient laissé le bébé bien caché dans une couverte sur le perron d'en arrière. Je lui ai répondu que ça ne se pouvait pas parce qu'il n'y avait aucune piste autour de la maison, ni dans les champs, ni au bord du bois. Elle a fini par me dire que j'avais trop de questions et elle avait bien trop d'ouvrage. J'ai continué de croire que ma mère disait toujours la vérité.
Au printemps, pendant la récréation, une petite souris est sortie par un trou dans le solage de l'école. On a tous couru après. On a fini par l'attraper et un des garçons lui a marché dessus. On a vu plein de petites souris toutes nues sortir de son ventre ouvert. Les autres garçons ont dit : « Tu vois ben Victor que les bébés sont dans le ventre. T'es un beau niaiseux! Ta mère t'a conté des menteries et toi, tu l'as crue! »
C'était le drame. Moé, môman l'ai toujours adorée. Dans ma tête, ma mère c'était pas une menteuse. Ça se pouvait pas qu'elle m'ait menti.
J'en ai tiré deux leçons. La première, c'est que ma mère pouvait mentir par obligation et la deuxième, c'est qu'il ne faut jamais conter de menteries aux enfants.

C'était le 15 juin 1951, une journée comme les autres, qui paraissait être comme les autres, mais... midi moins dix, le téléphone sonne. C'est ma soeur qui m'appelle puis elle me dit :
« Victor, j'ai perdu mon petit gars, mon petit Alain. On le trouve pas. On ne sait pas où c'est qu'il est. Il est allé bûcher avec son père à matin. Son père l'a emmené bûcher sur son lot, à un tiers de mille de la maison. Il est parti comme de coutume d'avec son père pour s'en venir manger vers 10 h, puis il est pas revenu. »
Quand Ti-Paul est revenu, elle lui a dit :
« Le petit Alain où c'est qu'il est? »
Ben il dit :
« Il s'est envenu. Il est parti vers 10 h d'avec moi. »
Mais il n'était pas revenu à la maison. Eh ben là, ils ont paniqué. C'est à ce moment que ma soeur m'a appelé. Je lui ai dit:
«Attends un peu, il y a pas mal de monde icitte, ça sera pas long.»
J'ai appelé le voisin, puis je lui ai dit ça. Le voisin avait des gros camions, il m'a dit :
«On va y aller tout suite.»
Dans dix minutes, on était comme quatorze qui débarquaient du camion pour aller chercher le petit gars qui était perdu. Où? On le sait pas mais étant donné qu'il était allé bûcher sur son lot, on a pris de ce bord-là pour aller chercher. Puis on l'a appelé, on a marché puis on a viré puis on est revenu puis on a retourné. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait entendu crier, personne ne l'avait entendu pleurer. Le petit gars était disparu. On as-tu marché un peu, tout l'après-midi!
Quand il est venu vers 5 h, j'ai dit à Ti-Jo Charron de Saint-Guy :
« Si tu veux dire comme moi, on va aller faire un tour dans le bout de la coulée bleue. Parce qu'un petit gars de 5 ans et demi qui était capable comme un petit gars de 6 ans et demi, peut-être ben que... On va aller prendre une marche dans ce bout-là. »
Ça fait qu'un moment donné en virant comme ça dans le bois, on faisait à peu près un mille de profond puis on s'en revenait, on a trouvé ses petites chaussures, à peu près à un demi mille je crois ben d'où ce qu'il était parti. C'est un gars du 5 et 6 qui était avec moi, un dénommé Blier, qui avait trouvé ça ces petites chaussures là puis il m'a dit :

« Regarde les petites chaussures icitte. »
On est revenu avec ça à la maison puis on a rencontré son père :
« C'est t'y à lui ça? » Il a regardé ça et il a dit :
« Je connais pas ça. » Sur le moment lui là, la peur puis tout...
« Je connais pas ça. » J'ai emmené ça à sa mère puis elle dit :
« Ben oui, c'est ses petites chaussures. » Là, ça nous a donné une direction de quel bord prendre.
On a marché, marché, marché puis toute la nuit, on voulait aller dans la coulée bleue. Mais y a monsieur le curé qui est venu puis il a dit:
« Cherchez pas loin, il est ben proche. »
Ça c'est de notre faute. On aurait dû quand même aller dans la coulée bleue parce qu'un petit gars de cet âge-là fait un mille, deux milles. Il est quasiment plus capable que nous autres, c'est capable un enfant. C'est vrai, ça marche puis ça pas l'air à fatiguer.
Fait que là nous autres on s'est contenté de faire un mille de profondeur. Puis après ça on a débouché sur le (rang) 5 et 6. Là il y avait des abattis sur le 5 et 6 y a plus de bois là, on cherchait plus là, on cherchait surtout dans le bois. Un mille dans le bois c'est pas mal loin. On trouvait que... Le curé nous avait dit :
« Cherchez pas loin, il est proche. »
Mais si on aurait pensé qu'un petit gars comme ça peut faire 5 milles dans le bois avec nous autres ben sûr, tout seul aussi il peut en faire 5 milles puis peut-être ben plus que ça. On aurait pu se lâcher dans la coulée bleue quand même que le curé avait dit ça, mais on y a pas été. On aurait pu le trouver cette nuit-là.
Le lendemain midi, quand on a arrivé faire un tour le midi, pour essayer de manger, casser une croûte, y a quelqu'un qui a arrivé puis qui a dit :
« On a vu ses pistes dans la coulée bleue, à peu près à deux milles et demi de la maison du petit. On a clôturé ça pour que pas personne marche là dedans et pour que vous pouvez les voir. »
Fait que c'est ça qu'on a fait; on est allé voir ça puis c'était ben ses pistes à lui. On dirait qu'il avait enlevé ses petites chaussures parce qu'il avait calé dans la terre noire. Il s'était amusé un peu là, il s'était assis sur un petit corps d'arbre qu'il a vu. Il a démanché ses lacets, il a attaché ses petites chaussures après des cotons de framboisiers. Ils portaient pas à terre.
Mais là nous autres on se trouvait en arrière de lui, on marchait en arrière de lui. Il aurait fallu aller en avant et loin en avant pour essayer de le trouver. Puis on le trouvait pas. Ça fait qu'on a marché comme ça trois jours de temps.
La cinquième journée je crois, on est parti une petite gang. Tout le monde était assez connaissant pour ne pas s'écarter. On se groupait par quatre ou cinq puis on prenait chacun une direction, guidés par notre instinct. On marchait en direction du Lac Saint-Jean de Sainte-Rita.
Moi et Eugène Lauzier, on s'est retrouvés seuls un moment donné.
Ti-Gène et moi on a marché marché, puis vers les onze heures de l'avant-midi, j'ai aperçu une petite bête; c'était un petit chevreuil. J'ai averti mon ami Eugène sans faire de bruit puis j'ai pris le petit animal dans mes bras; il ne bougeait pas. Moi, j'ai pensé qu'il était malade mais Ti-Gène m'a dit :
« Non, il dort, il n'est pas malade, il dort les yeux ouvert. C'est sa nature de dormir les yeux comme ça. »
Il pesait environ une douzaine de livres; il était beau et il sentait bon. Il était pivelé; des taches jaunes et rouges. Il n'y a pas un animal au monde plus beau à voir. Puis Ti-Gène m'a dit que pour le réveiller, il fallait le taper chaque bord de la tête, ce que j'ai fait. Tout de suite il s'est réveillé. En nous apercevant, il a braillé fort, fort et ça avait comme la voix d'un enfant.
Les autres qui cherchaient pas loin ont pensé qu'on avait trouvé le petit Alain. On a marché jusqu'au soir tard. Pas de chance, pas plus que les autres jours.
Un soir la grosse pluie a pris puis la pluie était pas chaude. On avait pratiquement pas mangé parce qu'on pensait, on avait des enfants nous autres et les autres en avaient eux autres aussi, puis on pensait : « C'est pas rien, ce pauvre petit garçon qui est tout seul dans le bois, y a des mouches, y a pas mangé, y a peur, y crie après ses parents, y a personne qui sont venus le secourir, y est tout fin seul dans le bois. » Là, on marchait tout le temps, on était pas capable de s'arrêter manger, on mangeait une croûte comme ça en pensant pas d'autre chose puis on buvait des fois dans une source que l'on trouvait dans le bois. Ça virait comme ça.
Mais ce soir-là, la tempête a pris, une pluie poussée par le vent ben fort. Nous autres on avait eu chaud à plein puis le frette nous a pris. On était une quinzaine puis on a sorti du bois.
Quand on a arrivé, le docteur Catellier de Trois-Pistoles a monté puis là, il a dit :
« Soyons réaliste. »
Le petit gars avait plutôt un caractère rageux, il était solide, il était fort et se laissait pas conduire par tout chacun puis il maîtrisait sa peur un peu pour son âge. Le docteur Catellier dit :
«Cet enfant là, vous pouvez pleurer sa perte, mais pleurez pas parce que il est dans le bois puis il souffre, il court, il a faim, il a chaud, il y a des mouches. Non. Le premier soir il est parti dans l'avant-midi, il a crié, il a pleuré, il a couru, il a couru encore, il a crié encore jusqu'à temps qu'il soit au bout des bouts. Quand il a tombé, il a tombé sans quasiment le savoir, il a tombé endormi. Il avait chaud et tomber en plein ventre à terre puis les poumons sur la terre, il s'est endormi là. Puis là, la fraîcheur de la terre, il a fait comme une inflammation des poumons. On va y donner toutes les chances, s'il s'est relevé le lendemain matin, s'il a fait 100 pieds, je peux pas y en donner plus que ça. Normalement, ils se relèvent pas puis ils meurent dret-là.»
Dans le fond ça avait du bon sens par exemple. Ça, ça resté là. On cherchait pareil.
J'ai parti avec un de mes frères un coup puis on a monté par le 5 et 6. Tout chacun nous disait :
« Il court en avant de nous autres, il mange les restants de sandwich, puis il a le ventre plein, il est pas achalé, il a peur et il répondra pas. Comment que vous le demanderiez, il répondra pas, il se cache. »
Tellement qu'on y croyait un peu, qu'il pouvait faire ça. Fait qu'avec mon frère on a été par le 5 et 6, des fois on peut peut-être ben trouver quelque chose. Là, on a pris le bois, puis après dans quatre ou cinq arpents dans le bois, on a entendu dans une grosse talle de noisette : « froush, froush » ça marchait là-dedans. Là j'ai dit à mon frère :
« Ça doit être lui. Ben oui c'est lui certain, on va le pogner. »
Un d'un bord, l'autre de l'autre puis là on fait le tour puis on a watché. J'ouvrais la talle pour voir, mais il commençait à faire brun un petit peu. Mais en dedans, c'était deux petits ours qui avait là. Puis là, moi j'en ai pogné un. Il pesait à peu près comme 18-20 livres je crois ben. Je l'ai pogné d'une main par dessus le cou puis je l'ai sorti de là. Puis là, on a entendu la mère se lamenter, la mère ça lâche comme des siffles, ça grogne épouvantablement. Il y avait Ti-Gène Lauzier c'était un chasseur de Saint-Guy. Il a entendu la mère crier comme ça puis il a dit :
« Venez-vous en vous autres, ça presse! Vous voyez pas qu'il y a une mère ours. »
Il le savait pas lui qu'on avait pogné un petit ours. On l'avait, je l'avais dans mes bras moi, je le tenais puis je voulais le sortir absolument. Il était assez beau que je voulais le sortir même s'il criait et braillait. Le gars me dit :
« Lâchez ce petit ours-là et venez-vous en au plus vite, vous allez vous faire manger. »
On entendait toujours crier la mère puis elle s'en venait sur nous autres. Finalement quand on a arrivé à lui, on a lâché le petit ours puis là, on a pris nos jambes puis on a sorti.
Là quand on a arrivé chez nous, c'est-à-dire chez Ti-Paul Boucher, le père du petit Alain, il y a un char qui est arrivé. C'était un gars qui faisait de l'hypnotisme. Il avait deux docteurs en hypnose, deux jeunes qui étaient avec lui puis là il dit :
« Qui c'est qui veut garder mes jeunes, je veux pas que personne leur parle. »
La petite fille c'était la petite Jacqueline qui avait 15 ans et le petit gars avait 18 ans, il s'appelait Denis. Ça fait que j'ai dit :
« Je peux ben les garder moi. » Il me dit :
« Embarquez dans mon char puis gardez-les. Moi, je veux donner la main au père puis à la mère. »
Ça fait qu'il entre dans la maison puis il va donner la main aux parents et leur dit :
« Je vais endormir mes docteurs en hypnose, puis je vas les faire parler. »
« OK ». ont-ils répondu.
Chez nous, on avait logé une maison nous autres puis on avait des chambres qui barraient. J'ai dit :
« Venez faire ça chez nous, vous serez tranquille j'ai des chambres qui barrent puis on peut vous donner une chambre. »
Je connaissais pas grand chose à son affaire. Ce gars là c'était Gaston Pascal, son nom d'hypnotiseur. Fait que là on s'en vient chez nous.
Moi, mon frère André, Paul Boucher le père du petit garçon, et quelques autres, on a entré dans la chambre puis là, il a endormi la petite fille. Il a dit :
« Je vais l'endormir mais questionnez-la. »
Il l'endort puis là bon moi j'y demande : « Comment ce qu'il était habillé? »
« Il avait des petites chaussures. »
« Comment il avait d'oeillets après ses petites chaussures? »
« Il y en a trois. »
« C'est ben ça. »
« Quelle couleur sont ses lacets? »
« Je suis pas certaine, ça l'air d'être brun mais là encore je ne suis pas certaine. »
« Après ça, avait-il une petite chemise, des petites culottes? »
« D'abord il était nu tête, il avait une petite chemise. C'était tout ce qu'il avait sur le corps avec des petits pantalons courts, courts. Il avait pas de bas dans ses petites chaussures. Ses chaussures il les a ôtées, il les a laissées là. »
« Suis-le pour voir où c'est qu'il va. »
Là elle l'a suivi. La coulée bleue elle ne connaissait pas ça mais elle dit qu'il arrivait à une place puis il avait ben soif. Il voulait boire, puis à la place qu'il voulait boire, il avait passé des snows, il y avait des snows qui avait charrié du bois, ça laisse de l'huile puis il y avait de l'huile sur l'eau. Elle voyait l'huile puis elle dit en criant :
Tu vas t'empoisonner, bois pas là, tu vas t'empoisonner! »

Le petit gars a descendu dans l'eau puis il a bu. Il a sorti de là puis après qu'il a été sorti, c'est là qu'il a tombé à terre sur le ventre puis il s'est pas relevé. Mais là, tout le temps elle a disait :
« Lèves-toi, marche un peu, lèves-toi! » J'ai dit à la petite fille :
« Tourne-le donc puis écoute son coeur. » Là elle l'a tourné puis elle écoute son coeur puis elle dit :
« Son coeur fait aucun battement. Pour moi, il est mort. »
Ce qu'il arrive en même temps, c'est une mère ourse. On était dans la nuit là. La mère ourse l'a liché longtemps, il avait du sang sur les jambes. Il avait les jambes déchirées par les framboisiers, les branches puis il avait des gouttes de sang et la mère ourse lichait les gouttes de sang. La petite fille a assez eu peur de la mère ourse qu'elle a crié, crié, puis elle pleurait. Fait qu'il la réveillé parce qu'il dit :
« Elle sera pas capable de continuer. » Il lui dit :
« Tu vas te réveiller, tu ne te rappelleras plus de rien de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu, tu ne te rappelleras de rien, de rien. Au compte de trois tu vas te réveiller. 1,2,3. »
Elle s'est réveillée. Elle est passée dans la cuisine, puis elle dit:
« Je pense que j'ai pleuré. Je ne sais pas ce que j'ai vu mais je pense que j'ai pleuré. »
Fait que là, il a fait venir le petit gars, il l'a endormi puis il a dit:
« Questionnez-le. »
Là on a commencé à le questionner. Il a passé dans les mêmes traces que sa petite copine, dans les mêmes traces, toutes, toutes, il a tout dit les mêmes choses, les même affaires. Quand il a vu la mère ourse qui est venue pour le pogner, il a crié pas mal fort. Il avait l'air à avoir peur. Il disait :
« Sauve-toi, elle va t'emmener, elle va t'emmener. »
Puis elle l'a emmené. Elle l'a pogné dans sa gueule par les reins puis elle l'a emmené. Elle est partie avec. Elle a marché loin, loin. Puis là, il nous a conté que cette mère ourse là avait deux petits ours avec elle. Puis ils l'ont mangé, ils l'ont tout mangé.
Quand le Gaston Pascal l'a réveillé, il lui a dit :
« Tu te souviendras de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as vu, tu te souviendras de tout ça. Au compte de trois tu vas te réveiller. »
Au compte de trois, le petit garçon s'est réveillé. Il a dit : « Où est le père du petit gars, je veux le voir. »
À longueur de la gang, il connaissait personne. Là, Paul Boucher s'est avancé et a dit :
« C'est moi. » Le petit gars lui a dit :
« Ça me fait de la peine de vous dire ça monsieur Boucher, mais jamais vous revoirez votre petit enfant. J'ai trop ben vécu ça. Ça se peut pas. Vous ne le revoirez jamais. »
Moi je lui avais demandé :
« Il reste tu quelque chose, des os, du linge? »
« Le linge qu'il a là est ben, ben maculé de sang. C'est comme des copeaux par exemple. Il reste pas grand chose, quasiment rien. »
J'ai dit :
« Y a-t-y passé quelqu'un proche? » « Il a passé deux gars proche de là mais comment qu'il aurait passé dessus ça aurait été ben difficile de le reconnaître. Il restait plus rien. »
Il y avait des ours à plein, à plein.
Je me rappelle, les Fusillés du Saint-Laurent sont venus le chercher, le Royal 22e aussi, il est venu des hélicoptères, tout chacun sont venus. Plus tard un peu, il est arrivé un matin une femme du Saguenay Lac Saint-Jean. Elle avait un petit gars puis un petit chien qui pesait une quinzaine de livres. Elle dit :
« Moi, mon petit chien est assez fin, donnez moi un morceau de linge qui lui a appartenu, je vais lui faire sentir ça puis vous allez voir. »
Fait que là ils ont dit :
« Toi Victor tu connais les bois. »
Je commençais à connaître le bout. Il y avait comme à vol d'oiseau, à aller au Lac Saint-Jean de Sainte-Rita, à peu près cinq milles du Lac des Vases. Fallait faire à peu près 5 milles à vol d'oiseau dans le bois. Ben là, moi je le connaissais assez, que je m'écartais pas là-dedans. Je correspondais à l'homme idéal. Fait qu'ils ont dit :
« T'es-tu bon pour aller avec? »
« Oui. »
Fait qu'elle a fait sentir du linge qu'il avait, elle lui a fait sentir ça puis les petites bottes de robeur qu'on avait trouvées. On les avait emmenées puis là on les avait encore. Ils ont fait sentir ça au petit chien et nous voilà partis.
On a été jusqu'au Lac Saint-Jean, tout près du Lac Saint-Jean. Quand on a arrivé au Lac Saint-Jean, le petit chien ronait toujours en avant, puis il s'en allait, puis il s'en allait. Il avait passé à peu près aux places qu'on avait vu les pistes. Les pistes d'enfant l'été c'est mal aisé à voir mais l'eau du printemps avait charrié de la terre noire puis ça faisait des belles pistes d'enfant. C'était inévitable, n'importe qui aurait dit que c'était ça. Puis il y a une place le petit gars s'en allait, des petits pas, des petits pas, puis il s'en revenait, des petits pas encore et s'en retournait. Il cherchait là, lui. Quand il s'en retournait, on a mesuré trois pieds et demi entre les pas. Il courait là. On avait clôturé ça pour... en tout cas. Là on est rendu avec le petit chien puis on file jusqu'au Lac Saint-Jean.
Au Lac Saint-Jean il y avait comme des battures, il avait des trembles, des petits peupliers puis du foin. Il avait beaucoup de marde d'ours. Les ours allaient jouer là, dans le chemin. Le petit chien s'est enfilé le nez là-dedans. Il a senti plusieurs tas puis il faisait quasiment comme un loup. Il se relevait la tête puis «aouuuuu», le nez drette en l'air puis il se remettait le nez là dedans puis «aouuuuuu». Il a jamais voulu allez plus loin. Il s'est arrêté là. La femme a dit :
« Il s'est fait manger par les ours. Je suis certaine, ce chien-là a trouvé des affaires, ça se peut pas. Il est fin. »
Il avait l'air fin à plein, à plein.
On a cherché quinze jours de temps, sans arrêter. Le monde ça faisait des promesses épouvantables. Qui c'est qui retrouverait le petit gars. Ils faisaient des promesses. Des promesses qu'ils auraient jamais tenues possiblement. « Je prendrai plus jamais une goutte de boisson. » Toutes sortes d'affaires... Ça disait le chapelet tout le temps dans le bois. On trouvait tout dans le bois : des petits bouts de lacet des fois, des petites affaires mais le petit gars, on le trouvait pas.
Ma fille avait 13 ans et elle m'a dit :
« J'ai rêvé cette nuit où c'est qu'il est puis il faut absolument papa que j'y aille. »
J'étais avec un de mes frères puis j'ai dit :
« OK, envoyé en avant, moi tu m'écarteras pas. Avec le soleil je m'écarterai pas. »
Y avait du soleil cette journée là. Puis elle a marché, elle a fait comme quatre milles, toujours à vol d'oiseau, en plein bois. On la suivait. On la suivait, un peu plus loin, marche, encore plus loin, puis marche au travers des arbres renversés. C'était dans la bois, c'était sale . Il y avait des journalistes qui disaient : « Dans les bois accidentés de Saint-Guy » et c'était le cas.
Des côtes, des montagnes, la coulée bleue c'était une montagne ça. Ça formait des petites coulées qui étaient encore des petites montagnes à travers de ça. Puis on s'est rendu jusqu'à Rivière Boisbouscache puis rendu là, elle dit :
« Mon rêve se termine icitte, il y a plus rien, mon rêve se termine icitte. »
Puis là toujours, au bout de quinze jours, on savait plus sur quel pied danser.
Notre gars lui, notre hypnotiseur Gaston Pascal lui était à Québec, il restait à Québec. Il a pris le train puis il est revenu avec son docteur en hypnose, le petit garçon. Il est arrivé et il a dit :
« Moi je veux en savoir plus long que ça. » « Ok, quoi c'est qu'on fait? »
Il dit :
« J'aimerais ça aller dans le bois, où ce que vous pensez qu'il peut avoir fini ses jours. »
« C'est embêtant, on peut vous emmener, pas ben, ben loin du Lac Saint-Jean. »
Il y avait une place qui s'appelait ça le Tracel. Le monde avait charrié des billots dans les chantiers à Couturier déjà. C'était un petit coteau à-pic, à-pic, puis ils avaient mis des grosses épinettes puis avec des pavés là-dessus; on appelait ça le Tracel. Ça avait resté là dans le bois. Fait qu'on va jusque là. Rendu là toujours, le père Gaston Pascal dit à son élève :
« Tu serais pas mal quanté icitte sur le bord du Tracel, je vas t'endormir. » « Ok »
Fait que le petit gars se quante là puis il l'endort. Mais ça va mal son affaire; il y a des mouches au mois de juin. On était à fin de juin et commencement de juillet, il y avait des mouches, ça pas de bon sens. Fait que là, il casse une branche de feuilles puis il lui passe ça dans la face puis il dit :
« Il y a pas de mouche qui va te toucher, y a pas de mouche qui a le droit de te toucher, il y a pas de mouche qui va te toucher. »
Sacrifice! Les mouches ce sont toutes en allées. J'étais avec mon frère, j'ai dit :
« Sacrament, ça se peut pas. » Il était tranquille puis il dormait. Là il nous a dit :
« Questionnez-le, demandez-y des affaires... » Ben là, j'ai demandé :
« C'est où, à partant d'icitte, que le petit gars s'avait fait manger par les ours? » « C'est ben loin d'icitte. » « Par quel côté? » - « C'est par là. »
Il montre ça avec sa main. Je lui redemande :

« Y a-t-il quelque chose dans les alentours que tu remarques icitte ? »
« Oui, oui. Il y a une maison. »
« On est en plein bois, loin dans le bois puis il y a une maison. Est-elle loin d' icitte ? »
« Non, elle est à deux rues d'icitte. »
Lui il mesurait pas à l'arpent. Je lui demande :
« Y a pas de chemin pour aller là je crois ben ? »
« Oui, on peut y aller. Il y a un chemin pour aller là. »
« Quel sorte de bois qu'il y a là, pour aller là? »
« C'est des arbres de Noël. »
« Si tu te fais réveiller tout d'un coup pourrais-tu nous emmener là? »
« Ah oui, ben sûr! »
Là, moi puis mon frère on se coudait un peu, on s'est dit :
« Le chat est sorti du sac, on va l'avoir hein! » On lui a dit :
« Entre donc dans la maison, pour voir ce qu'il y a là. » « Je peux pas. » « Pourquoi? »
« C'est des planches dans la porte, il y a des planches dans la porte. »
« Là, si tu serais réveillé, tu serais capable de nous emmener là?»
« Oui, oui. » « Quel bord que c'est? » « C'est par là, c'est par là, c'est pas loin d'icitte. »
J'ai dit à Gaston Pascal :
« Réveillez-le, on va y aller. » « Au compte de trois tu seras réveillé. 1,2,3. »
Il s'est réveillé. On lui a dit :
« Bon, es-tu capable de nous emmener à ta petite maison que t'as vu là, qui a des planches dans la porte? » « Ben oui, suivez moi. »
Il passe sur le Tracel et prend un petit chemin, un chemin que les branches se remettent à pousser dedans, le chemin reste tout le temps distinct un peu en bas. On prend ce chemin là puis on le suit. Sacrifice, on est arrivé à un petit camp où les rouleux qui roulaient le bois, dans le temps des gros chantiers qui avaient là, y avaient fait un petit camp en planche et y s'étaient mis une baratte là-dedans puis y chauffaient. Y roulaient leur bois et se chauffaient en attendant l'autre voyage. Le petit camp avait défoncé, puis les planches étaient cassées et elles bloquaient dans la porte. Moi j'ai resté en tout cas... On a tous resté... Surpris!
Fait que là j'ai fait le recul, je pense ben que le petit gars a été mangé par les ours. Je pense que c'est ben ça, d'après ce qu'on a vécu ensemble.
Je suppose que le petit garçon s'est trompé de côté quand il est retourné chez eux. Il y avait un chemin qui se rendait au bûché mais le chemin ne se poursuivait pas loin, seulement un petit quart de mille, c'était un cul de sac. Ce qui était arrivé c'est que quand le petit gars partait, il disait à son père :
« Je m'en vas là. »
Il s'en allait chez eux. Mais ce matin là, son père a été bûcher l'autre bord du chemin. Le petit gars a dit à son père :
« Bon je m'en va papa. »
Il a tourné sur le même sens qu'il tournait avant. Puis, il a marché jusqu'à la fin du chemin. Lorsque que le petit gars s'aperçoit qu'il n'a plus de chemin, il continue car pour lui c'est par là que sa maison était. Mais en réalité, il s'en allait vers l'ouest, vers la forêt, vers le Lac Saint-Jean. Y a sorti au fronteau de chez eux, y a pris la coulée bleue, deux milles et demi du fronteau de chez-eux.
Mais son père n'est peut-être pas le dernier qui l'a vu. Quand il a débouché sur le 5 et 6, c'était un abattis ça, puis il y a un gars qui l'a vu passer. L'enfant se dirigeait vers la rivière Boisbouscache. Il l'a vu puis il lui a dit :
« Où ce que tu vas petit? »
Le petit gars a traversé puis là, il a pris la coulée bleue. Il m'a conté ça quelques semaines plus tard. Il nous l'avait pas dit lui là, s'il nous aurait dit :
« Votre petit gars est passé, allez le chercher là-bas. »
On l'aurait retrouvé. Lui a eu peur de se faire accuser d'avoir vu passé un petit gars dans le bois. Lui, le petit gars avait un mille de fait du lot chez eux. Ça lui avait pris deux heures au petit pour déboucher là puis l'homme sortait de l'ouvrage quand il l'a vu passer.
Des personnes qui ont cherché avec nous autres, qui ont marché et qui ont vécu cette histoire là, il n'a à vrai dire plus. Les parents sont décédés tous les deux. Les gars qui avaient trouvé les pistes dans la coulée bleue sont décédés eux autres aussi. Ils sont tous disparus; il en reste plus de vivants.
J'espère que son père et sa mère l'ont retrouvé au paradis!
C'était un homme de Saint-Guy qui travaillait dans la route des Aigles, dans les gros chantiers qui se faisaient là. À tous les samedis soir, il descendait chez eux à Saint-Guy, avec un chevreuil sur son dos. Durant ce qu'ils mangeaient ça, lui il remontait le dimanche au soir reprendre sa semaine de travail. Il faisait pareil le samedi d'ensuite, quand il faisait beau. Quand le temps était pas sortable, il restait au camp tout simplement.
Ce samedi soir là, il avait pas tué de chevreuil. Il avait juste à prendre sa carabine avec sa lumière et les pogner au jack. Dans ce temps là, on appelait ça de même. Il les éclairait dans les yeux puis les chevreuils regardaient la lumière et lui il pouvait les approcher et tirer. Il les pognait pas mal à tous les coups.
Donc ce soir là, il avait pas tué de chevreuil et il descendait chez eux à Saint-Guy. Toujours, il y avait un tas de toppe de branches et sa carabine était cachée là-dedans parce que dans ce temps là aussi il y avait des garde-chasse. Il fallait se watcher un peu mais des chevreuils, y en avait en masse. Il a été dans le tas de toppe, il s'est écrasé sur ses jambes pour prendre sa carabine, son fanal dans une main. Faut croire que sa carabine il l'a halé par le canon car il a reçu une décharge de carabine en plein coeur. Il a pas regrouillé de là. Il a resté la main sur sa carabine, l'autre main sur son fanal et il était écrasé là, aussi large que long et la tête lui a tombé sur l'estomac. Il a tombé sur ses jambes et il était déjà
racotillé sur lui. La main sur le fanal qui a continué d'éclairer puis de chauffer, parce que les anciens fanais c'était chaud ça, la main là-dessus. Le feu a pris puis ça lui a brûlé tout le bras, le bras a tout brûlé. Il a resté là lui, il sentait pas ça lui parce qu'il était mort.
Le lendemain matin, les gars ce sont levés, y déjeunaient tard un peu car c'était dimanche. Dans ce temps là, c'était défendu de travailler le dimanche. Dans les camps ça ne travaillait pas le dimanche. Si un homme se faisait pogner à travailler le dimanche, à bûcher, il se faisait clairer. Mais les gars allaient quand même prendre une marche dans le bois, y allaient voir où c'est qu'ils allaient bûcher dans leur semaine. Un moment donné, y en a un qui a vu ça. Il a vu un gars qui était écrasé là, il a été voir. Le gars était raide mort ben sûr. Là, il a averti le boss du camp puis il l'a descendu en bagnole chez eux.
Comme ça aurait été grossie d'arrêter directement chez eux avec ça et dire : «Je vous emporte votre mari»... Il a été chez le voisin. Il a arrivé chez le voisin et il a dit :
« C'est un accident qui est arrivé puis il est mort. »
Il lui a tout conté ça. Il y avait une shed à bois à côté de la maison. Ils l'ont ramassé puis ils l'ont mis dans la shed à bois. Il faisait ben frette puis il est resté gelé. Il était gelé là lui dans un tapon.
Ils ont pas averti la famille tout de suite parce qu'il avait deux grandes filles lui. Puis le soir, ils faisaient une veillée de danse. Fait qu'ils ont dit :
« Si on avertit la famille, on aura pas les filles pour danser. On va perdre notre veillée. Ça pas de bon sens. On avertira juste demain ou après la veillée. »
Là, ils ont fait leur veillée de danse. Ça allait ben, ils ont dansé avec les filles et les ont peut-être tassées dans un coin un peu mais dans ce temps là, c'était pas permis mais c'était bon pareil. Ça fait qu'après la veillée, ils ont averti ses filles puis sa femme qui dansait là aussi, qu'il était arrivé un accident à leur père. Dans la colonie, ils étaient pauvre à plein, à plein. « Faudrait lui faire une tombe; on va lui faire une tombe ». Il y a un monsieur pas loin qui a dit :
« J'ai de la planche dans l'étable; une crèche, je vas défaire ça. »
Il a défaite une crèche de vache puis il lui a fait une tombe. Puis là, parce qu'il était gelé tout dans un tapon, ça prenait une tombe assez grosse. Il l'a fait grosse la tombe. Il l'a fait la même longueur qu'une tombe ordinaire; un six pieds et demi à peu près.
Le lendemain matin, ils ont chargé ça dans une traîne à barreaux, les grosses traînes. Ils ont monté au village avec ça. Ils ont arrivé sur le curé puis là ils ont dit ça :
« Il est mort. On est venu l'enterrer. » Le curé a regardé ça, il dit :
« Quand il était vivant, il a jamais entré dans l'église, il ne rentrera pas plus mort. Non. Allez où ce que vous voudrez avec, moi je ne veux rien savoir. »
Ils ont été obligés de revirer de bord. Ils ont dit : « Qu'est-ce qu'on fait avec? »
Ça fait qu'ils ont parti chacun de leur bord dans les rangs, sur la grande route, ils ont été quêter pour ramasser de l'argent pour le faire enterrer. En tout ils ont ramassé 12 $. Dans ce temps là,
l'argent était rare, mais dans toute la colonie, ils ont ramassé 12$. Étant donné qu'à Saint-Guy, le curé ça lui tentait pas ben ben de l'enterrer pas d'argent, ils ont décidé de le descendre à Saint-Médard.
Ils ont arrivé à Saint-Médard puis ils ont parlé de ça au curé. Le curé a dit :
« Oui, entrez-le dans l'église. »
Mais ce n'était pas un cadeau entrer ça dans l'église, cette grosse tombe là. La chapelle était au deuxième étage, il y avait une grande, grande escalier, d'une trentaine de marches, à pic pas mal. Ils ont monté ça la dedans. Ils étaient une gang d'homme, six porteurs qui ont monté ça dans l'escalier. Quand ça penchait trop d'un bord, le mort déboulait du bord que ça penchait là, lui. Il mettait pas les breaks. Y ont manqué tomber dans l'escalier avec ça. Y ont venus à bout de peine et de misère à monter. Ça fait qu'ils l'ont entré dans l'église et le curé lui a chanté un service, en tous cas une messe, là. Puis après ça, ils ont été le mettre dans la charnière. En partant de là dans la charnière, au printemps, ils l'ont empilé dans la fosse commune, y ont mis de la terre par là-dessus et salut!

C'est pour vous dire que dans le temps, l'argent ça coulait pas dans les chemins. Les gars étaient quand même serviables pour lui avoir fait une tombe avec les moyens qu'ils avaient, avoir quêté pour le faire enterrer, l'avoir descendu à Saint-Médard et l'avoir remonté dans chapelle en haut.
Justement, la journée que je suis monté, je me demandais quoi c'était ça. Ordinairement, on met une truie dans une boîte de même. Je trouvais que la boîte était pas haute à plein. Je trouvais ça curieux. Je ne comprenais pas ça. Il était encore gelé et il était ben comme ça. Pour aller dans terre, y était ben comme ça.
Avant de me marier, j'suis monté à Saint-Guy pour acheter un lot. Fallait aller chez l'inspecteur de colonisation et chez le curé. C'était le OK du curé qui déterminait en bonne partie le OK de l'inspecteur de colonisation.
Il y avait sur chaque lot une maison bâtie par un regroupement de colons. Ceux qui voulaient des lots devaient participer à la construction des maisons et étaient payés 30 cents par jour, nourris et logés. Pendant la construction, les hommes restaient dans des dortoirs bâtis exprès. Ils bûchaient le bois à l'emplacement choisi pour la maison. Il y avait un moulin à scie portatif pour préparer les pièces de bois servant à construire les maisons. C'était de simples bâtisses de 22 pieds par 24 pieds d'un étage et demi, sans cave, divisées en deux parties et lambrissées en papier noir à l'extérieur. Les colons mettaient de la tapisserie sur les murs en dedans, pour cacher les pièces de bois. Ben souvent, les souris mangeaient la tapisserie.
On donnait les lots sur la grande route aux gens mariés et aux jeunesses les lots dans les rangs plus éloignés. Moi, ce que je voulais, c'était un lot sur la grande route. Je n'avais aucun intérêt à aller dans un rang loin de l'église et du marchand général. J'avais envie d'être proche du magasin pour faire mes achats en général et pour mes biscuits au chocolat en particulier.
Donc, je vais voir le curé qui me demande si je suis marié. Je lui réponds que non et que ce n'est pas une raison pour m'empêcher d'avoir un lot sur la grande route puisque j'ai l'intention de le faire. Il veut savoir quelle sorte de fille j'épouserai.
« Une fille de cultivateur, monsieur le curé. »
J'argumente tant et si ben que le curé donne son accord et l'inspecteur aussi, à condition que je vienne résider dès la semaine suivante.
« Non, c'est l'hiver. On est en plein coeur du mois de février. Chez nous, ils ont besoin de moi. Je vais les aider jusqu'au printemps. Ensuite, je viendrai. » « Trompe-moi pas le jeune parce que ça va mal aller. »
J'suis monté le 2 mai pour résider dans la maison sur mon lot. Une maison vide, sans meuble, pas de chaise, pas de lit, pas d'armoire... Je m'installe quand même du mieux que je peux et passe mes journées à bûcher ou à tasser de l,abatis. Vers le 15 juin, je reçois la visite du curé.
« Quand est-ce que tu te maries, le jeune? » « Pensez-vous que je vais amener une fille vivre icitte, voyons donc monsieur le curé. Celle que j'ai en vue, vit dans la plus belle maison du rang. Je ne veux pas la faire vivre icitte dans la misère. Y a même pas de docteur. »
Le curé s'en va choqué et moi, je pense à mon affaire pendant une bonne semaine. Je me demande pourquoi je ne me marierais pas. Je suis en âge et je suis installé.
Je descends rencontrer ma douce. Arrivé chez son père, je la vois assise dans la balançoire en train de tricoter. Elle me demande :
« Qu'est-ce que tu viens faire? »
« Je suis venu me chercher une femme et c'est toi mon choix. »
« Qu'est-ce que t'es venu faire? Reviens veiller à soir. On pourra parler. »
Le soir, je suis allé veiller. Et une troisième fois, elle me demande ce que je suis venu faire. Je lui réponds à nouveau que c'est elle mon choix. Je lui dis :
« Je ne veux pas que tu dises oui avant d'avoir vu la maison et le lot. Si tu trouves ça à ton goût, tu diras oui mais pas avant. »

Elles est montée la semaine suivante avec son père et sa mère. Elle a ben regardé partout. J'ai fait la grande demande dans la maison. On s'est marié le 11 juillet 1938. Ça fait 62 ans que ça dure et j'ai ben l'intention que ça continue. Je m'en rappelle comme si c'était hier et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Je l'aimais tant.
Pour partir notre ménage, j'ai acheté quatre chaises du beau-père. Mes frères Lucien et Ti-Bé nous ont fait une armoire en planches de tremble, avec un panneau et trois belles tablettes à l'intérieur. C'était le plus beau meuble de la maison. Ma femme a apporté son set de chambre et moi, mon lit. Le beau-père et la belle-mère nous ont donné une chaise berceuse. Ti-Jeanne avait son trousseau de linge de maison. J'ai fait une table et plus tard, une couchette de bébé. J'ai acheté des beaux clous pour suspendre notre linge; il n'y avait pas de garde-robe. A mesure qu'on avait de l'argent, on s'achetait des articles de cuisine et des outils au magasin général ou par catalogue, chez Dupuis et Frères. Je me souviens d'avoir acheté un pot à lait à 3,50 $. C'était cher mais on le trouvait à notre goût. On l'a encore. On a encore les sets de chambre, la chaise berceuse et les outils. Ils sont encore solides et en bon état.
Avant de me marier, j'avais demandé des conseils à ma mère parce que je ne savais rien sur les femmes et le mariage, les enfants et la vie sexuelle. Elle m'avait répondu :
« Mon garçon, t'auras juste les enfants que le bon Dieu voudra te donner. »
Quand on s'est marié, j'étais pas mal ignorant et ma femme n'en savait pas plus. Après le soir des noces et les semaines qui ont suivi n'ont pas été très drôles puisque la belle-mère et le curé couchaient entre nous chaque soir. Ça fait pas des enfants forts.
Quand j'étais jeunesse, j'avais vu un orphelinat. J'avais trouvé ça beau de voir tous ces petits enfants. J'aimais les enfants. J'étais le cinquième d'une famille de seize enfants. J'avais toujours vécu entouré d'enfants. Ça me manquait. J'ai dit à ma femme qu'on pourrait aller à la crèche se chercher un garçon et comme je n'étais pas égoïste, une fille pour elle. Elle m'a dit que j'étais malade et qu'on n'avait qu'à attendre d'en avoir ben à nous autres. Je lui ai répondu que pour ça, il faut prendre les moyens.
Ça fait qu'on a pris les moyens et c'est venu tout de suite, mieux qu'on pensait même. C'est comme ça que Ti-Jeanne m'a donné quatorze beaux enfants et un ange au ciel que j'adore. Je les ai aimés à la minute où ils sont nés. Je leur ai donné à manger et tout ce que je pouvais leur donner et en plus, pas d'autre chose que tout mon amour.
Je continue d'aimer tous mes enfants et leurs familles. Pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est notre plus grande fierté et la réussite de toute notre vie.

Mon père et ma mère m'ont conté cette histoire quand j'avais douze ans. Ils ne l'avaient pas fait avant pour ne pas nous faire peur. C'est l'histoire de Jos et de sa maison hantée.
Jos est parti à la mort de sa mère, il avait six ans. Il a déserté la maison paternelle et est arrivé dans une famille américaine qui l'a adopté. À seize ans, il a commencé à aller aux chantiers du Maine puis sur le Témis. Comme il était ménager, il a réussi à se marier avec une belle fille de Saint-Eusèbe et à s'installer sur une terre dans le rang de la Société.
Ils ont eu vingt-deux enfants dont plusieurs étaient morts nés. Puis, la santé de sa femme s'est détériorée. La gangrène a envahi ses jambes. On a dû l'amputer à l'Hôpital de Rivière-du-Loup, une jambe après l'autre tout près du corps. Elle ne prenait plus beaucoup de place ni dans la maison ni dans son lit. Jos la prenait dans ses bras et l'attachait sur une chaise pour qu'elle puisse manger et la ramenait ensuite dans sa chambre. Elle souffrait de grandes douleurs sans calmant et sans se plaindre.
Puis, ils ont commencé à entendre des bruits étranges : des bruits de cordes de bois qui déboulent, d'objets qui cognent sur les murs, des grincements, des cris d'animaux... Jos disait à sa femme que c'était la faux qui était tombée, que c'était un oiseau qui s'était cogné dans une vitre ou un mouton qui avait été mordu par le chien pour expliquer ces sons. Jos ne croyait pas aux superstitions mais il commençait à avoir des doutes. Il employait toutes sortes de prétextes pour ne pas faire peur à sa femme.
« Tordieu, les animaux sont sortis. J'entends les vaches à côté de la maison. »
Jos s'habille et sort, il se rend à l'étable. Les vaches sont couchées et ruminent paisiblement.

Un soir de noirceur, il se rend à l'étable et voit jaillir de la tête du boeuf qu'il a abattu pendant la journée, des flammes et des tisons rouges. Lorsqu'il revient à la maison, sa femme voit ben qu'il y a quelque chose qui ne va pas et lui demande pourquoi il est si songeur depuis un bout de temps. Jos lui répond qu'il pense à ses voyages de jeunesse. Au bout d'un moment, ils entendent des bruits de pas dans le grenier. Sa femme lui demande d'aller voir. Jos redescend en disant que c'est un oiseau qui est entré par la lucarne restée ouverte.
Excédé, Jos demande à ses voisins de venir veiller avec eux. Là, les voisins entendent toutes sortes de bruits : des moutons qui bêlent, des chaises qui craquent, du bois qui déboule, des lamentations... Jos va voir le curé qui lui donne des médailles et de l'eau bénite et lui dit que tout ça c'est le fruit de son imagination.
Mon père était un homme sans aucune peur. Lui aussi entendait les bruits. Un soir, après la veillée, il est allé à l'étable soigner ses animaux comme il le faisait chaque soir. Il a vu dans le carré à foin, le visage de notre voisin à grande barbe mort quelques temps avant. Son fanal s'est éteint. Il est revenu à la maison et a tout raconté à ma mère. Ma mère lui a demandé s'il avait eu peur. Il lui a répondu qu'il n'avait pas peur de lui de son vivant et qu'il n'y avait pas de raison qu'il ait peur de lui une fois mort.
Un soir, mon père et les voisins ont entendu le cri d'un cochon qu'on égorge dans la cave chez Jos. Jos est allé voir le curé et lui a dit:
« On s'en va. On n'en peut plus. » Le curé lui a répondu :
« Fouille dans ta mémoire Jos. T'as dû faire affaire avec quelqu'un qui t'en veut ou autre chose. »
Le curé est monté dans le grenier, a béni partout et a aspergé le plancher d'eau bénite. Tout s'est déchaîné : bruits de chaînes, moutons qu'on égorge, cris et pleurs...
« Fouille ta mémoire, Jos. Y a quelqu'un qui t'envoie un message. »
Alors Jos a pensé que dans sa jeunesse, il avait prêté dix piastres à un gars de chantier. Il avait eu beau le sommer de lui rendre son argent, l'autre n'avait rien voulu savoir. La dernière fois qu'il l'avait vu, c'était dans le train du Petit Témis le gars lui avait dit :
« Va chez le diable. Je te le rendrai pas. »
« C'est toi qui va aller chez le diable et il va te chauffer le cul avec mon dix piastres. »
Alors Jos est monté au grenier et a crié ben fort :
« Viens pu me bâdrer. Je te le donne mon dix piastres si c'est ça qu'il faut pour que t'ailles au paradis. »
À la minute même, tout s'est arrêté.
Jos a appris par la suite que le gars était mort quelque temps avant. Il a continué sa vie sur sa terre comme avant. Sa femme est morte et il s'est remarié avec une vieille fille et ils ont eu quatre enfants. Ça lui faisait donc vingt-six enfants. Un décret de ce temps-là disait que le curé avait droit au vingt-sixième minot, à la vingt-sixième charrette de foin, à la vingt-sixième poche de patates... Il est allé voir le curé et lui a dit qu'il était venu payer sa dîme.
« Voici mon vingt-sixième enfant. Je vous le donne mais pas tout de suite. Il a encore besoin de sa mère pour l'allaiter. »
C'était un bon croyant qui a continué à faire sa religion et à payer sa dîme mais finalement il a gardé son vingt-sixième enfant.
Marcel était un petit garçon de cinq ans. C'était un petit blond frisé, beau comme un coeur et intelligent. Tous les petits gars de son âge auraient voulu être lui. Quand il nous parlait, il s'appuyait sur un pied puis sur l'autre. Il fermait ses petites mains puis il les ouvrait, comme pour chercher ses mots. Il était attachant.
Un jour, ses parents sont allés aux noces chez une de ses tantes. Ils devaient revenir deux jours plus tard. Ils avaient laissé une gardienne pour prendre soin de Marcel et de sa petite soeur, son aînée.
Un malheur arriva. Le petit Marcel tomba malade. Un gros mal de ventre; on disait que c'était des coliques cordées.
Pas de téléphone; ils se sont recommandés au voisin. Une femme âgée est venue. Elle lui a posé des cataplasmes de grains chauds sur le ventre. Il avait l'appendicite et au contact de la chaleur, l'appendice à crevée. Le pauvre petit Marcel a rendu l'âme pas longtemps après que ses parents soient revenus de leur voyage.
La perte de leur petit Marcel leur a causé beaucoup de chagrin; leur plus vieux garçon. Ils ne pourraient se consoler de perdre ce qu'il avait de plus cher au monde.
Moi, j'avais huit ans et je demeurais tout près de la famille. On a demandé quatre porteurs dans l'arrondissement de l'école dont moi j'en faisais partie.
Ça fait quelque soixante-quinze ans et je n'ai jamais oublié son beau sourire. Cette journée-là, un petit ange s'est envolé au ciel.

Quand j'étais jeune, la maîtresse d'école et monsieur le vicaire nous disaient que chacun de nous avait son ange gardien. C'était un ange qui devait nous protéger et veiller sur nous. Sur des images, on nous le représentait comme un jeune homme un peu efféminé, avec une grande paire d'ailes et qui se tenait toujours en arrière de nous autres.
Moi, je n'aimais pas ça me sentir épié et surveillé. Souvent, je me retournais d'un coup sec dans l'espoir de l'apercevoir, mais je n'ai jamais vu cet oiseau-là. Sauf que parfois je sentais son haleine... et ça ne sentait pas bon... C'était une haleine de cheval ou de vache. Il faut dire que dans ce temps-là, on allait à l'étable soir et matin pour faire le train. En vieillissant, je suis venu à y croire plus ou moins et à ne plus y penser souvent.
Plus tard, je suis parti de la maison, je me suis marié et nous avons eu des enfants. À un moment donné, les enfants ont attrapé la coqueluche. Un peu plus tard, ma femme a donné naissance à notre huitième enfant; un beau gros garçon vigoureux.
Malheureusement, notre petit bébé a attrapé la coqueluche. Il s'est mis à tousser, à tousser, à s'étouffer, à tousser encore... Il souffrait le martyre. Nous l'avons veillé jour et nuit, ma femme, mes enfants et moi. On était seul, on était fatigué. On savait qu'il ne pouvait pas passer à travers. Il ne pouvait plus manger et malgré cela, il a souffert et a vécu pendant un long mois.
Quand enfin ses souffrances ont été terminées, un sourire angélique est apparu sur son visage. Ça été la plus belle journée de ma vie.
Le curé de la paroisse nous avait dit :
« Vous êtes chanceux, vous avez un petit ange au ciel. N'ayez pas peur de l'invoquer, il va vous aider. »

J'y croyais. Souvent de fois, je lui ai demandé de l'aide et d'une manière ou d'une autre, ça finissait toujours par s'arranger au mieux.
Sur la « terre du coin », une petite terre que nous avions au coin du rang de la Société, nous avions mis treize taurâilles en pacage. De temps en temps, j'allais voir aux taurâilles mais un bonjour, les animaux n'étaient plus là.
On a fait le tour du clos et on a trouvé par où elles étaient passées. En s'informant, on a su que les taurâilles étaient passées à travers le bois et qu'elles étaient rendues à Sainte-Rita, deux rangs plus haut.
De bonne heure le lendemain, on a greyé deux waguines avec des racks à foin avec des rentourages attelés à deux tracteurs et on est monté à Sainte-Rita pour tenter de ramener les taurâilles. On était cinq ou six. On les a cernées dans un coin de clôture avec des barrières pour les charger dans les waguines... Mais c'était devenu des animaux sauvages, de vrais chevreuils effarouchés. Les taurâilles se sont lancées, elles ont défoncé les clôtures, jeté à terre les barrières, foncé par dessus nous autres en en bousculant et en en blessant une couple en passant. Puis, elles ont pris le large, le nez en l'air, les narines évasées, l'oeil fou, à la fine épouvante et sont disparues dans le bois.
Le soir à la maison, on ne savait plus quoi faire. Devait-on essayer de les tuer au fusil pour au moins récupérer la viande? C'est là que j'ai dit aux enfants :
« On a assez couru... C'est votre ti-frère qui est au ciel qui va courir astheure ! »
Le lendemain matin, neuf des taurâilles étaient revenues dans le clos de pacage, aussi dociles qu'avant. Nous avons réparé la clôture. Au bout d'une semaine environ, un cultivateur du rang nous a averti que quatre taurâilles pacageaient avec ses vaches à lait. C'était bien nos bêtes. On est allé les chercher en auto. On les a lâchées dans le chemin et à pied, elles se sont rendues dans leur clos d'origine, à deux milles de distance. Il y avait des montées de maisons, des passages d'ouverts. On a rencontré des autos, des tracteurs et même un gros camion, mais les quatre bêtes sont allées rejoindre les neuf autres taurâilles dans le clos, le plus calmement du monde.
J'en ai conclu que c'était notre petit ange au ciel qui avait fait tout le travail
J'avais trouvé mon ange gardien!
Je veux parler du temps où il y avait de la mortalité dans la paroisse et plus précisément dans le rang de la Société.
Ça fait de cela 75 à 80 ans. Quand quelqu'un mourait, pas question de le faire embaumer. On ne savait même pas que ce service pouvait un jour être inventé.
Mon père et ma mère allaient faire la toilette au défunt. Ils allaient le laver et lui faire la barbe. Pour les hommes c'était l'ouvrage de papa et pour les femmes, c'était ma mère qui faisait sa toilette. Ils les couchaient sur des planches avec des chevalets d'une hauteur de quatre pieds. On leur croisait les mains, et on leur fermait les yeux et la bouche. Ça ne restait pas toujours en place, il fallait refaire l'opération souvent. Puis, on le couvrait d'un suaire. On appelait ça ensevelir les morts.
J'avais sept ans quand notre voisin est mort. Il avait 46 ans et il est mort d'une consomption tuberculeuse. Il avait presque plus de cheveux sur la tête; juste une couronne blanche autour de la tête et une barbe d'une bonne dizaine de jours. Il ressemblait à une personne de 90 ans.
On l'avait installé dans la chambre du fond. On bouchait les châssis et on installait une petite table sur laquelle un cierge veillait jour et nuit et ça devait durer trois jours et trois nuits. Dans le jour, on disait le chapelet aux heures et la nuit aux heures et demie. La pauvre femme qui devait besogner tout ce temps là puis aller au service; elle n'était pas fatiguée, elle était morte. Ce n'était pas catholique.
Nous les enfants d'école de l'arrondissement, on était invité à rendre une visite au corps. On nous amenait à la maison du défunt la veille du service et on entrait dans la chambre où il était exposé. Il fallait pas dire un mot sauf pour répondre à la prière. Une dizaine de chapelets agenouillés sur un prie-Dieu qui était installé tout près du défunt. Après on nous faisait monter debout sur le petit banc pour mieux voir le mort et là, on enlevait le suaire. Ça faisait déjà cinq minutes qu'on avait arrêté de respirer. On se trouvait face à face avec le mort pas embaumé, pas peinturé, blanc comme un drap, un oeil à moitié ouvert aussi, la bouche dans la même position.
Vous ne vous imaginez pas la peur qu'on avait en sortant de là. On le voyait partout, à l'étable, dans le trou à foin. Au moindre petit bruit, c'était le mort qui courait après nous autres. Dans ce temps-là, on disait à nos petits frères et soeurs de venir coucher avec nous autres et là, on pouvait dormir. Avec les années, le sort des morts s'est amélioré. Nous on a grandi et petit à petit, la peur a fait place à la confiance. Aujourd'hui, moi je trouve que les morts sont beaux et reposants à regarder. Ma prière va pour leur demander de nous préparer une place quand notre tour viendra.
Faut dire que les temps ont bien changé.
Dans les chantiers dans ce temps là, y sortaient pas avec des snows, y sortait pas avec des chevaux, ça restait tout dans le bois et y sortaient en raquettes aux Fêtes, très rarement.
Dans le bois un coup, ils étaient une cinquantaine d'hommes qui étaient restés dans le camp. Ensemble ça jasait puis tout ça... Un moment donné, il y avait des fîers-à-bras un peu là-dedans puis des grandes gueules. Quand qui est venu la veille de Noël, c 'était qui c 'est qui dirait le plus gros blasphème, le plus gros sacre. Là ça sacrait, tout les gars ça sacrait et ça contait toutes sortes d'histoires, ça sacrait puis bon...

Même dans les camps, y se fait toujours un réveillon vers onze heures, onze heures et demie. Là, quand qui est venu le temps du réveillon, y en a un qui a dit après avoir sacré toute la veillée, toute la gang :
« Moi, à soir pour mon souper, je mangerais une cuisse du petit Jésus. »
Mais quand y a dit ça, y est venu un gros coup de tonnerre. Les hommes se sont tout figés. Un moment donné, un gros coup de vent. Même dans le camp y est venu un gros coup de vent qui a éteint toutes les lumières. C'était des lumières avec de la kérosène, ça a éteint toutes les lumières. Le vent a continué.

Y avaient abattu des boeufs dans l'hiver pour manger et y avaient tout garroché les têtes des boeufs loin du camp. Les têtes ont sorti de la neige puis un moment donné, la flamme sortait par les yeux et les oreilles des boeufs. Les têtes de boeufs couraient sur la neige puis les boeufs beuglaient comme des boeufs enragés. Là c'est ben simple, tout le monde avait tellement peur, c'était épouvantable. Ça continué de faire une tempête, de la poudrerie partout même que la poudrerie entrait dans le camp.
Un moment donné, à travers de tout ce brouhaha là, y ont entendu un cri de mort, un cri épouvantable. Là, la tempête a cessé, y ont rallumé les lumières mais le gars qui avait dit qui mangerait une cuisse du petit Jésus, y l'ont jamais revu. Y a disparu et yl'ont jamais revu. C'est pour dire que les autres après ça, y ont abandonné de sacrer.
Cette histoire là, c'était coulé dans le béton quand j'étais jeune mais peut-être ben qu'astheure, le béton est magané un petit peu.
L'homme qui s'est battu avec le diable
Une véritable face de boeuf
L'histoire qui suit s'est déroulé à Saint-Guy dans les années 40. L'argent était rare dans la colonie, les habitants crevaient littéralement de faim surtout pendant la saison froide. Je ne faisais pas exception; donner à manger à ma femme et à mes enfants était une lutte de tous les instants. Vous comprenez que je n'ai pas hésité une seconde devant l'offre que m'a fait un de mes voisins nommé Lucien.
Il y avait une compagnie qui avait fait une coupe de bois non loin de chez moi. Il restait sur place les toppes des arbres abattus par la compagnie. Il était facilement possible de récupérer un ou deux billots de huit pieds par toppes. Ça fait que Lucien me dit :
« Qu'est-ce que tu dirais si on allait de nuit chercher tous ces beaux billots, on pourrait se faire quelques piastres. C'est quasiment pas catholique de laisser ça pourrir sur place. »
Le soir venu nous avons attelé les sleighs et nous avons pris le bord du bois. À chaque soir pendant les quelques semaines qui suivirent nous allions nous couper chacun un voyage de bois que nous ramenions à la maison. Lucien était un bon travaillant, fort comme un boeuf et vaillant comme il ne s'en fait plus. Il était un partenaire de travail très efficace. Par contre, c'était un bourreau pour les chevaux et un sacreur sans scrupule. Il sacrait même plus que moi, faut le faire. Il alignait les blasphèmes et faisait des combinaisons de sacres de façon impressionnante.
Toujours qu'une nuit, on rentre dans le bois pour couper notre voyage journalier; Lucien avait amené son petit frère Denis âgé d'à peine six ans. Sur le chemin du retour, Lucien se rend compte qu'il a oublié son pocheton de paille, ses lunettes et son portefeuille dans le bois.
« Calvaire de tabarnac, Denis court vite pis vas m'chercher mes effets. »
Comme de raison le petit voulait rien savoir de retourner dans le bois tout seul, il faisait noir comme chez le loup et on entendait des coyotes hurler non loin de là.
« Mon petit christ, organise-toi pas que j'te mette la patte su l'corps parce que tu vas y aller en baptême. »
Le petit Denis retourne sur ses pas pour aller chercher le stock. Il était pétrifié à l'idée de rencontrer des coyotes mais il avait encore plus peur de rencontrer son grand frère. Moi j'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles; comment pouvait on faire ça à un enfant. J'étais révolté par la conduite de Lucien mais je n'osais intervenir; il était intimidant en maudit.
Denis revient mais il avait pas les lunettes. Il avait ben le pocheton et le portefeuille mais il manquait les lunettes. Deux trois claques sur le bord de la tête :
« Mon petit tabarnac tu vas y retourner pis vite. »
Le gars était ben rough. C'en était trop, je ne pouvais laisser cette brute battre son frère de la sorte. Je lui dit :
« J'ai pas l'intention de coucher ici ça fait que lâche le flo pis sacrons notre camp. »
Ça l'a surpris de se faire parler de même, il n'a pas répliqué et on est reparti.
Sur notre chemin, il y avait un lac que nous devions traverser. La glace était assez épaisse pour supporter le poids des charges mais il y avait par endroit des trous chauds où la glace était moins épaisse. Lucien passait en premier; il avait un plus petit cheval que moi et donc un plus petit voyage. On fait un bout sur la glace quand tout à coup mon cheval défonce et plonge dans les eaux glacées du lac.
La seule façon de sortir un cheval de l'eau est de lui passer un noeud coulant autour du cou et de le tirer avec un autre cheval. Quand il se sent ben étouffé, il donne le coup du boeuf et saute sur le bord de la glace; c'est l'instinct de survie. C'est ça qu'on a fait et le cheval a enfin sorti de l'eau. La sleigh était resté sur la glace; nous n'avons eu qu'à la tourner, l'atteler et enfin reprendre notre route. Tout au long de l'opération de sauvetage et sur le chemin du retour, Lucien sacrait ça n'avait pas de maudit bon sens. J'avais jamais entendu quelqu'un tempêter de la sorte.
La punition
À l'époque où se déroule cette histoire, la religion occupait une immense place dans la vie des gens. Le danger de brûler en enfer pour l'éternité était très présent. Plusieurs personnes de l'entourage de Lucien étaient inquiets pour lui. S'il continuait à blasphémer et à sacrer, on ne donnait plus cher de sa peau. Son propre père le mettait en garde contre le danger de rencontrer le diable. Notre cher Lucien quand à lui ne s'inquiétait pas. Il disait que si le diable voulait le pogner il avait besoin de se lever de bonne heure.
Lucien possédait un cheval et quelques vaches qu'il gardait dans une petite grange située à environ 150 pieds de la maison. Il habitait avec sa soeur et son père. À chaque soir vers les dix heures, il allait à l'étable pour soigner ses bêtes. Ça fait qu'un soir, Lucien se prépare à aller faire sa tournée, il vient pour allumer son fanal... plus de gaz dans le fanal.
« Christ de tabarnac. » Il donne le fanal à sa soeur.
« Comment ça qu'il n'y a pas de gaz dans c 'te viarge de lampe; ma christ occupe-toi s'en. »
Il n'a pas eu besoin de lui dire deux fois. Elle savait qu'il était capable de tout, un coup choqué. Elle en avait peur. Lucien reprend l'allumage de la lampe.
« Jésus Christ, c'est l'bout d'la christ de marde, le globe est ben noir de suie. »
Maria prend le globe et le lave. Lucien l'allume et est enfin prêt à aller à l'étable.
En sortant sur le perron, il vient un maudit coup de vent et le fanal s'éteint. Lucien n'était plus maître de lui, il était choqué ça n'avait pas de bon sens, il était dangereux à approcher. Lucien prend son fanal par l'anse puis il l'a toute défaite sur le bord du perron et il a été à l'étable pas de lumière.
La grange était séparée en deux par une porte. D'un côté il y avait l'étable pour les animaux et de l'autre, il avait la batterie; endroit où on entreposait le foin. Lucien entre dans la batterie, il fait ben noir, il commence à regretter d'avoir défaite son fanal, c'est pratique de la lumière des fois. Comme il se penche pour prendre une galette de foin, il reçoit un maudit coup de poing sur la gueule.
« Le tabarnac qui vient dans ma grange pour me baver, y est pas mieux que mort. »
Il finit par trouver sa fourche et comme il vient pour darder l'ombre qu'il voyait, il reçoit une autre maudite claque. Ça l'air qu'ils se sont battus pas mal longtemps.

Lucien commençait à avoir peur. Il repensait aux mises en garde de son père et aux dangers de voir le diable.
« C'est le diable certain qui est venu me chercher. »
Il n'était pas fou, pas loin mais pas fou; il savait qu'il en avait trop fait au court de sa vie. Lucien rassemble son courage et ses forces et sort de l'étable. Il a fait un bout vers la maison sur ses jambes mais la dernière partie du trajet il l'a fait à quatre pattes, il avait trop peur, il avait l'impression de sentir une présence tout près de lui. Il finit par arriver à la maison. Il n'est pas capable d'ouvrir la porte, il se contente de gratter jusqu'à ce qu'on vienne lui ouvrir.
Après ces événements, Lucien n'était plus le même homme. Il était tout maigre, le dos rond, les yeux creux; il était tout le contraire de ce qu'il avait déjà été. Dès que la brunante pognait, Lucien commençait à trembler, il ne sortait pratiquement plus de la maison. Il ne mangeait presque plus et le plus important, il n'a plus jamais blasphémé.

Après avoir bourlingué autour du monde une bonne partie de sa vie, Anne-Marie Ouellet s'établissait dernièrement à Trois-Pistoles pour exercer ses nombreux talents et surtout en faire profiter aux gens d'ici.
Le dessin, la peinture, le chant, la musique, l'écriture et le bricolage occupent depuis plusieurs années la majorité de son temps libre, en dehors de ses périodes d'enseignement.
En plus d'avoir signé deux textes du présent recueil, Anne-Marie Ouellet a produit les illustrations de tous les contes.
M.D.
Un Noël chez des amis amérindiens
J'étais à Chicoutimi depuis trois ans. Je travaillais avec des familles apparentées aux Amérindiens. Une de ces familles avait de la parenté qui habitait dans une réserve très éloignée de la ville.
Comme ils me connaissaient bien et voulaient me faire plaisir, ils m'ont offert d'aller vivre un mois ou deux avec eux dans la réserve.
Ça m'intéressait de connaître leurs coutumes de plus près mais j'hésitais à accepter cette offre. Après y avoir bien réfléchi, j'ai décidé d'y aller.
Je suis partie au début novembre avec la famille amérindienne qui m'accompagnait. La route à travers la forêt était magnifique mais n'en finissait plus. C'était à une centaine de kilomètres de la ville.
Enfin arrivés à la réserve. La petite famille est venue à notre rencontre. Le papa et la maman relativement jeunes et huit beaux enfants riants et pleins d'entrain. Cette famille semblait très unie. Je me suis tout de suite sentie à l'aise parmi eux. Chacun avait son importance. Chacun avait sa part à faire dans la maison ou à l'extérieur. Les plus grands s'occupaient des plus petits. C'était une vie au grand air vécue dans l'harmonie.
Les semaines passaient très vite. On allait à la pêche en faisant des trous sur un petit lac gelé. On allait à la chasse au petit gibier. J'ai appris à décortiquer un lièvre de sa toison et à la traiter pour qu'elle se conserve bien. Le soir on tissait des raquettes, réparait des mocassins et on s'endormait enroulé dans de belles peaux de bison.
Noël approchait. Un soir que les enfants étaient couchés, on s'est mis à se raconter nos Noël d'antan. Leurs souvenirs étaient très différents des miens, mais pas moins enivrants.
Cette année ils voulaient faire un peu de nouveau. D'habitude ils mangeaient du gibier de la forêt et du poisson. Alors ils décidèrent, pour faire plaisir aux enfants d'aller chercher des victuailles, comme de la dinde, des fruits et des petits cadeaux surprises. Mais pour ça, il fallait faire au moins cinquante kilomètres dans la forêt avant d'arriver à la « station » la plus proche.
Le lendemain, on attelle les chiens à deux grands traîneaux. La maman reste à la maison et moi je pars avec le papa. Le temps était gris et venteux mais ces jours-là, ils sont habitués à ça et ça ne leur fait pas peur. Les chiens se débrouillaient bien dans la forêt et obéissaient parfaitement à leur maître. Ça m'a paru presqu'une éternité avant d'arriver à ce point de ravitaillement. On a acheté tout ce qu'il nous fallait et installé ça dans nos toboggans. On est reparti à travers bois vers la maison. La tempête rageait toujours de plus en plus. Le vent tourbillonnait; on ne voyait plus ni ciel ni terre. Un peu énervée je lui ai demandé :
« Qu'est-ce qu'on fait? »
« Pas de problème, mes chiens sont habitués à ça. Tu vas voir lorsqu'on va entrer plus profondément dans la forêt, ça va être moins pire. »
A un moment donné un coyote est apparu et les chiens dans leur instinct de survie ont voulu sauter dessus. Il y avait un fossé. Le traîneau s'est renversé et se fracassa contre un arbre.
En me retournant, j'ai vu que le monsieur frappait le coyote avec un bout de bois. Soudain il est tombé, restant coincé entre deux troncs qui jonchaient le sol. En me précipitant à son secours, je me suis rendue compte qu'il avait une jambe cassée.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rapailler les chiens et embarquer le monsieur dans un des traîneaux. Comme la charge était trop lourde, on a dû laisser la dinde et les autres victuailles dissimulées près d'un arbre, avec l'intention de revenir les chercher après que j'aurais amené le blessé sain et sauf à la maison.
Les chiens tout énervés ne voulaient plus tirer. Ils ne voulaient même plus écouter leur maître. J'ai dû m'atteler sur le traîneau et avancer péniblement dans la tempête. C'est le monsieur qui me disait dans quelle direction aller.
À la maison, la madame s'inquiétait. La noirceur s'en venait et rien à l'horizon... Elle se promenait devant la porte et regardait tout autour quand soudainement elle m'aperçut tirant sur le traîneau. Tout de suite, elle est venue à ma rencontre. On a entré le blessé dans la maison et on l'a installé près du feu, emmitouflé dans de bonnes couvertures chaudes. Madame lui a servi un bouillon chaud. Le lendemain, la force et le courage nous étant revenus, je suis repartie de nouveau avec les chiens attelés sur un toboggan pour récupérer nos achats de la veille. Maintenant je connaissais le chemin et la tempête avait cessé.
C'était le 24 décembre au matin. Vers les quinze heures, je n'étais pas encore revenue et toute la maisonnée s'inquiétait.
Finalement on m'a vu apparaître à l'orée du bois avec les provisions. Quelle joie !

« Tu fais ça comme une vraie amérindienne. » m'ont-ils dit.
Ce Noël là a été très spécial. Les parents et les enfants avaient comme des étoiles dans les yeux. Ils chantaient et dansaient accompagnés des tam-tams. Des familles des alentours commencèrent à arriver ayant dans leurs paniers des petits gibiers et des confections artisanales.
Une grande table au centre de la pièce sur lequel trône un enfant nouveau né placé sur un lit de branches de sapin. Les enfants sont les rois cette nuit-là. Nos chants et nos plus belles louanges montent vers le Grand Manitou pour la vie qu'il nous donne et la joie d'être ensemble.
C'est le partage et la promesse de ne faire que du bien aux autres comme le veut le Grand Manitou qui a daigné se faire petit pour se rapprocher de nous...
Tous les souvenirs d'enfance que je garde de Noël sont merveilleux. À partir du 15 novembre environ, nous écoutions le Père Noël à la radio. C'était un moment de rêve. Qu'avait-il pour nous dans son beau grand sac rouge bordé de fourrure blanche.
À partir de cette date, maman, qui chantait très très bien, ne se gênait pas pour nous chanter de beaux chants de Noël et nous raconter des légendes sur les Rois Mages, les bergers, les anges. A ce moment-là, la télévision n'existait pas. Nos soirées se passaient donc à chanter, à jouer et à se faire raconter des histoires parfois épeurantes mais toujours fascinantes, qui dans nos têtes d'enfants, semblaient la réalité.

Comme nous étions à la campagne, il n'y avait d'électricité, les enfants se couchaient tôt. Alors, maman et papa en profitaient pour fabriquer des jouets. Des poupées de coton, des chevaux de bois, des petites maisons en bois rond, qu'importe. Ils avaient du plaisir à préparer tout cela en cachette. Comme la famille était grande, nous étions 17 enfants, il fallait avoir une surprise pour les plus grands comme pour les plus petits.
Plus le temps avançait, plus on s'approchait de Noël, plus mes parents paraissaient mystérieux. Ça devait être sûrement le bonheur pour eux autres, le bonheur qu'ils auraient de voir nos yeux s'émerveiller devant ces humbles jouets, fabriqués de leurs mains avec tant d'amour.
Après la Notre-Dame, Immaculée Conception, on faisait boucherie. Alors on préparait la grande fête de Noël, pâtés, tourtières, creton, beignes, gâteaux, bonbons aux patates. Quand on arrivait de l'école, ça sentait bon mais on ne voyait pas ce qui s'était préparé.
Maman nous disait que c'était pour la grande fête, la naissance du Sauveur. Chaque jour qui nous rapprochait de Noël, transformait la maison en une espèce de chaleur enveloppante, quelque chose d'indéfinissable. On savait que quelque chose s'en venait, que c'était grand et merveilleux. Quelques jours avant Noël, papa allait couper un beau sapin et le laissait dégeler près de la galerie. Ça sentait Noël de plus en plus. Cette senteur là, on l'avait qu'une fois dans l'année. Ce sapin, quelle odeur!
Et maman nous répétait « N'oubliez pas que dans la journée de la veille de Noël, il faut réciter mille Ave. Pour s'aider à ne pas oublier qu'à minuit, Jésus va venir. Sans lui, le paradis n'existerait pas. Comprenez-vous à quel point il faut être reconnaissant de cette vie qu'il nous apporte? » Nous étions petits et nous comprenions ce que nous pouvions comprendre de cette grande réalité. Mais ça rendait quand même la chose mystérieuse.
Deux ou trois jours avant Noël, le sapin était placé dans le salon. Mais nous ne pouvions pas le voir, la porte restait sous clef. Maman le décorait en mettant bien en évidence la crèche et tous les petits santons autour et elle plaçait les jouets de chaque côté de l'arbre. La veille on était fébrile; c'était la nuit tant attendue, enfin! Gonflé de bonheur, on allait se coucher mais on avait de la difficulté à s'endormir. On regardait par la fenêtre et il nous semblait voir le traîneau du Père Noël à travers les nuages. Mais on se disait : « Maman nous a bien dit que c'était le petit Jésus qui nous donne des cadeaux. », mais elle nous laissait quand même croire au Père Noël.
Il y avait une odeur de sapin, de beignes, de tourtières, qui rodait dans la maison. Vers 10 h 30, maman venait nous chercher. Après nous avoir bien emmitoufler, nous sortions dehors et papa nous attendait avec le grand traîneau où il y avait placé des bûches de bois réchauffées au fourneau pour les mettre tout au fond du traîneau sous la peau de carriole. Pour cette occasion, mon père plaçait des clochettes et des carillons de surplus au harnais du cheval, et ça résonnait dans la nuit. Plusieurs voitures nous suivaient et ils avaient eux aussi ajouté des clochettes à leur voiture. Donc c'était un cliquettement de belle petite musique de clochettes dans l'air. La neige craquait sous les patins du traîneau. En pleine nuit, une promenade en traîneau, c'était extraordinaire.

Rendus à l'église, toute illuminée, elle nous accueillait. C'était merveilleux de voir les lampes à l'huile qui ornaient toutes les colonnes de l'église. Et la crèche, avec ses santons, on les aurait dit vivants et le petit Jésus en cire semblait presque venir du ciel. Le minuit chrétien, les cantiques traditionnels. Et en ce temps-là , il y avait trois messes d'affilées, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et pourtant nous ne trouvions pas le temps long. La messe terminée, c'était les souhaits de Joyeux Noël à tous les paroissiens. On se rencontrait, on s'embrassait, c'était la fête.
Et nous regagnions le foyer pour le réveillon et la remise des cadeaux. La joie des enfants émerveillés, des parents heureux, c'était une nuit sans pareille. Notre mansarde cette nuit-là, semblait différemment illuminée, parce que je crois qu'elle était habitée par l'Amour. Une nuit qui avait le goût de jouets de bois vernis, une odeur de cierge qui brille.
Cette nuit-là, les visages prenaient un air différent, un peu céleste, comme une joie qu'on ne peut pas définir car ils sont dans l'attente d'un miracle. Cette attente bâtit toute l'année par les récits des promesses et surtout par des airs entendus, des allusions secrètes et l'immensité de l'amour qui descend jusqu'à nous mais aussi cet amour qu'une fois de plus offert par nos parents et cet amour qu'on se répétait l'un à l'autre en se disant : « Cette nuit c'est un peu comme une fleur rare qui naîtrait une fois l'an dans la neige... »

Originaire de Saint-Paul-de-la-Croix, madame Sirois demeure à Saint-Jean-de-Dieu depuis 1957. Elle s'est toujours impliquée dans différentes organisations culturelles et sociales de son milieu et s'est dévouée lors de la fête du 125 e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu, par la préparation d'une exposition de photographies anciennes.
Participante aux ateliers offerts par le Centre Alpha, madame Sirois a siégé comme membres du Conseil d'administration de cet organisme pendant quelques années.
En plus des travaux manuels axés sur la créativité, madame Sirois adore la peinture et l'écriture. Elle a à son actif plusieurs expositions de peintures à Trois-Pistoles et à Rivière-du-Loup ainsi que deux romans. Un de ses contes a été publié dans « La machine à raconter le Canada ».
M.D.
Je me souviens qu'autrefois quand on avait besoin d'un manteau, d'une robe ou de petits souliers, maman nous disait :
« On va attendre Adémard. »
Quand je le voyais arriver, arrogant et menteur, et qu'il disait de sa voix rauque :
« J'ai ça, cette babiole là. » Je ne l'aimais pas du tout.
Adémard attendait l'arrivée du printemps, quand les berlines apparaissaient dans les rangs et villages, pour tenter les femmes d'ici et là.

Si je me souviens bien, celui qui pratiquait ce métier qui remonte à la nuit des temps, avait le verbe facile et la tête pleine de nouvelles. Avec les quêteux, il était le journal du temps et ça l'aidait à faire passer sa marchandise plus facilement. Souvent, l'une avait fait la «chose» avec un et elle était enceinte, de son dire.
Les marchands généraux des villages ne l'aimaient pas du tout. Le dimanche, lorsqu'il était passé avec sa grosse cabousse de couleur noire, la quête était moins bonne. M. le curé montait en chaire et fulminait contre ceux qui placottent des autres, passent leurs guenilles et vendent des bénédictions.
Fallait que ce soit toujours de l'argent comptant pour payer la marchandise. Maman nous demandait de vider nos petites banques et nos petits cochons pour payer le colporteur Adémard. C'était jamais pour moi le manteau ou la robe que maman achetait car je n'étais pas la plus vieille de la famille. Hélas, l'année d'ensuite, il m'était destiné. Par contre, c'est moi qui l'avait déjà payé en partie.
Autrefois, en dehors des inondations subites ou des tremblements de terre, rien ne pouvait arrêter la célébration de l'eucharistie, comme en témoigne la petite histoire que je vais vous raconter.
Quand j'étais jeune, on demeurait proche de l'église et du presbytère de Saint-Paul-de-la-Croix. Mes parents étaient très catholiques et maman allait faire le ménage de l'église et lavait le couvent avec notre aide. Évidemment elle nous promettait de petites récompenses qu'on ne voyait pas souvent.
Monsieur le curé nous disait :
« Les petites filles, vous allez apporter les surplis pour les laver et les repasser. »
Dieu du ciel que c'était long à empeser, à faire tous les plis craqués de la blouse car il y en avait beaucoup qui servaient la messe; une messe le matin et une le soir, à part les grandes rencontres du dimanche, la confirmation, la petite communion et autres cérémonies.
La messe était toujours célébrée dans la sacristie l'hiver et dans l'église en fin d'avril, quand le soleil devenait de plus en plus chaud.
Un matin de printemps à la messe de sept heures, monsieur le curé était déjà arrivé comme d'habitude depuis quelques minutes
et nous avions revêtu nos surplis. Et la messe commençait. Drôle à dire, dans ce temps-là, il y avait autant de paroissiens qui y assistaient qu'à la grande messe aujourd'hui.

M. le curé commence la messe et rendu à la consécration, je lui apporte le calice avec le vin. Quand il vient pour boire, une mouche à vers tombe d'en haut en virevoltant et se noie dans le vin.
Alors, M. le curé me regarde ... je le regarde l'air gêné, je lui fais signe et lui me fait signe en me disant de mettre le doigt dans le calice pour enlever la mouche à vers. Soudain il se choque et me dit :
« Enlève la mouche, enlève la mouche! Qu'est-ce que tu attends? »
Je n'étais pas pour me tremper les mains dans le vin. Les paroissiens qui assistaient à la messe se demandaient ce qui se passait. M. le curé nerveux, se mit la main dans le calice d'un geste furieux et en sortit la mouche. Il se plaça en faisant semblant de boire le vin et consacra l'hostie.
Après la messe, il raconta en riant son histoire à ceux qui ont assisté à sa mésaventure. Il brûla le vin avec la mouche à vers.
Si tout nous était conté, il y en aurait des choses à dire et à raconter. Des choses qui arrivaient à nos parents, nos tantes et autres personnes du village. Quand j'étais petite, je me souviens avoir entendu raconter par maman l'histoire d'une fille engagère.
C'était une fille qui s'appelait Joséphine. La fille engagère du village aux cheveux blonds dorés de la longueur jusqu'au fesse. Dans le temps quand une fille avait les cheveux longs, un beau sourire, une belle taille, de beaux yeux bleus en plus, c'était la plus belle et la plus intelligente. Les hommes disaient :
« Regardez-là, elle fait sa fraîche. »
Joséphine avait un mauvais langage « pas barrée comme on dit ». Maman disait :
« C'est un vrai gars, cette fille-là, mais elle est travaillante.
Quand j'étais petite, les filles s'engageaient à retrousser les mamans qui avaient des enfants à tous les ans. Joséphine était très en demande.
Armand, l'époux de Marie la trouvait bien de son goût. Il dit à sa femme :
« Prends Joséphine, prends la comme fille engagère. »
Le lendemain au petit déjeuner la voilà à servir le déjeuner avec une petite blouse transparente dont on apercevait ces petits seins dodus, en se titubant le derrière. Armand d'un air discret la regardait et lui faisait les yeux doux.
Soudain, Marie disait en criant :
« Armand vient voir ce que j'ai vu sur le bureau. À qui ce beau collier là? »
« Ça devrait être à mon fils Pierre, je ne sais pas. »

Et la journée passe. Le soir venu, Pierre entre. Quand Marie le voit entrer, elle lui dit :
« Tu as une blonde? »
« Non, qui t'a dit ça. »
« C'est ton père. »
« Vous ambitionnez sur le pain béni. Voyons donc, avoir une blonde. Voyons donc. »
Mais Joséphine servait toujours Armand le premier à la table, car le collier c'était pour la blonde Joséphine. Maman pendant ce temps avait bien des cordes à son arc. Évidemment elle s'est dit, je vais la watcher. Le matin venu, elle dit à la blonde :
« Joséphine tu vas préparer la table et moi je vais servir le déjeuner. »
Armand était à faire sa besogne alors il ne se doutait pas que c'était Marie qui servirait le déjeuner. Il entre dans la maison en disant :
« Que ça sent bon! » La blonde Joséphine lui répondit :
« Viens t'asseoir ton petit derrière, ton déjeuner est prêt. »
Hélas Marie avait pris soin de mettre la blouse transparente à Joséphine; avec stupeur elle apparaît en titubant avec le collier dans son cou.
Armand n'en croyait pas ses yeux. Croyant qu'elle était de connivence avec Marie, il dit à Joséphine :
« Prends la porte, prends la porte tout de suite. »
Il était fou de rage. Marie était bien contente de rire de l'étourderie d'Armand.
Voilà l'histoire que « si tout m'était conté ».
Quand j'étais petite, mon père Télesphore fumait la pipe de temps en temps. Je me demandais souvent où il avait pris cette belle blague blanche douce au toucher. Mais, papa disait souvent :
« Je vais vous le raconter. »
Hélas, le secret était toujours suspence. Évidemment, papa Télesphore la gardait dans sa poche arrière avec son porte-monnaie et personne n'osait y toucher. Il faut que je vous dise qu'on était bien curieux pour savoir le secret. Évidemment, quand on la voyait sur le bout de la table, avec la pipe à papa, on soufflait dedans en respirant l'odeur du tabac. Ça sentait vraiment bon en diable.
Un soir, après les fêtes de Noël, il faisait une grosse tempête, on voyait ni ciel ni terre. Papa dit aux jeunes je vais vous raconter l'histoire de la blague à tabac, c'est-à-dire la façon qu'il se la procurait.
Tout à coup, ça frappe à la porte et papa Télesphore va répondre. Pendant ce temps, nous les petites filles et mes frères, on ramasse la blague à tabac sur la table. Pour nous c'était un ballon et pour jouer un tour à papa Télesphore, on la cachée au grenier.
Le lendemain, il demande à maman : « Tu as pas vu ma blague à tabac? »
« Hé, les enfants vous avez pas vu ma blague à tabac? » Les enfants ensemble répondent :
« Non, non. »
Personne ne semblait l'avoir vue. Papa Télesphore s'est décidé à raconter l'histoire de la façon que la blague était fait c'est-à-dire avec une vessie de cochon vidée, nettoyée et séchée, après on la frotte et c'est ça une blague à tabac.
On s'est dit :
« Allons chercher la blague à tabac au grenier. »
Papa a retrouvé sa blague subito presto. Rien ne se perdait anciennement.
Blague retrouvée.


Marie-Rose Ouellet habite Saint-Jean-de-Dieu depuis toujours. Elle est mère de seize enfants et a participé toute sa vie aux travaux de la ferme familiale.
Madame Ouellet suit les ateliers du Centre Alpha depuis plusieurs années. Elle aime particulièrement l'expression orale et le théâtre. Toujours prête à endosser un costume particulier pour jouer un personnage de son cru lors des festivités locales. Elle est reconnue comme personne sympatique et enjouée.
Plusieurs de ses textes ont fait le tour du Québec dans des revues telles le magazine « Autrement dit » et « Mon Journal ». Cette année elle a remporté le premier prix du concours « Lettre à un ami » organisé dans le cadre de la « Semaine internationale de la francophonie ». Un de ses textes à aussi été retenu comme témoignage pour le « Plan national d'action en alphabétisation » du R.G.P.A.Q.
Elle nous livre ici un émouvant témoignage de toute une vie de famille nombreuse dans différents rangs de Saint-Jean-de-Dieu.
M.D.
Dans les méandres de ma mémoire
Marie-Rose c'est Lanou
Il y en a qui disent sûrement : « C'est qui ça, Marie-Rose ? », parce qu'à Saint-Jean-de-Dieu, il y en a pas beaucoup qui m'appellent par mon nom. Marie-Rose c'est Lanou. Puis ce nom-là c'est drôle, c'est moi qui me l'ai donné dans le fond. Quand j'ai commencé à parler, les choses qui étaient à moi, au lieu de dire c'est à moi, je disais c'est à nous. Là y trouvaient ça bien drôle les autres. Y m'appelaient « Tanou ». Tanou c'est devenu « Lanou ».
Mes souvenirs de la Rallonge
La cueillette de fraises
Une chose que je me rappelle par exemple du rang de la Rallonge, c'est quand un dimanche après-midi on était allé aux fraises. Il y avait le Bob, Lucien, puis on était trois-quatre, les jeunes en tout cas. Dans le clos chez mon oncle André, il y avait un troupeau de vaches et puis il y avait un gros boeuf malin. Nous autres, on était en train de ramasser des fraises puis un moment donné ce gros boeuf là ça s'en vient en hurlant, en grondant et en grattant dans la terre, y cornaillait dans la terre avec ses cornes. On était à moitié mort de peur. On savait pas si on devait se sauver ou rester là, on voulait ramasser des fraises. Le Bob casse un petit bougon de branche puis il fait une croix avec deux bouts un plus petit que l'autre. Il tient ça dans ses mains puis là nous autres on prie tout autour de la croix. Faut croire qu'on priait bien dans ce temps-là, en tout cas le boeuf s'est en allé, il s'est reviré de bord et il s'est en allé tout au fond du clos puis on l'a pas revu. Ça fait que ça, je n'oublierai jamais ça, quand ben même que je vivrais 100 ans.
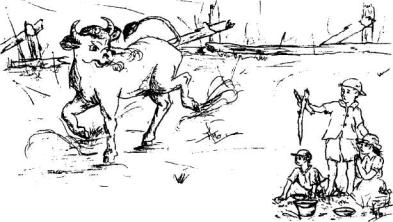
Les bottes de boue
Quand j'étais jeune, on se faisait des bottes avec de la vase. On se calait dans la vase jusqu'à moitié des jambes, des fois jusqu'aux genoux sur les bottes. Puis un moment donné quand on n'a fait trop souvent, on est venu les pieds crevassés. Maman nous disputait; elle nous disait :
« Regarde-moi c'tes airs bêtes, se faire des bottes avec de la vase. Vous allez avoir mal aux pieds mais vous allez les endurer. »
La maladie de mon père
Ce que je me rappelle aussi à la Rallonge, c'est quand mon père est tombé malade. Si je me rappelle ben, c'est quand Murielle est venue au monde, parce que maman avait eu un petit bébé dans une chambre. Mon père était dans l'autre chambre la même nuit que ma mère accouchait. Il avait vomi du sang, avait perdu connaissance puis on l'avait couché dans un lit. Il y avait un voisin qui était chez nous puis là il avait été chercher le docteur. Le docteur est arrivé puis il l'avait tellement trouvé malade en tout cas là, il l'a envoyé chercher le curé. Je vois ça comme si c'était hier . Le curé avec sa grande soutane noire puis son chapelet dans les mains faisant le tour du lit et priant. Le docteur lui dit :
« C'est des ulcères qu'il fait puis là, il est empoisonné. Pour le faire revenir de ça, il faut que je lui donne ce remède-là. »
Ça s'appelait du Vometik, c'est un remède très fort et même dangereux. Le docteur dit :
« Si dans 5 minutes, mique il l'ait bu, qui vomit, il va s'en clairer, on va le sauver. Si y vomit pas, ça va être la mort parce que ce remède, c'est un poison. »
Il a été d'une façon presque en danger de mort, y serait mort pareil. Là, le docteur lui a donné ça, puis le curé priait, priait et priait encore. Je me rappelle que le curé disait aux petits enfants :
« Priez, priez le petit Jésus, priez pour que votre père vomisse, parce que si il vomit pas il va mourir. »
Un moment donné tiens, me semble de le voir, il s'est levé sur son lit, il était pareil comme un mort, la face ben blanche, puis là, il s'est assis et s'est mis à vomir. En tout cas, il avait un grand bassin, il l'a presque rempli de sang et de cochonneries.
Tient, après qu'il a eu vomi, il a repris sa connaissance et il était correct. Il était assez faible en tout cas. Le lendemain il se levait et se tenait après les chaises pour marcher. Il a été plusieurs jours malade à la maison puis là, le docteur l'a envoyé à l'hôpital à Québec pour lui faire passer des examens. Le temps qu'il a été à l'hôpital, on avait assez peur qu'il meure. Là il l'on réchappé.
Quand il est revenu de l'hôpital, c'était dans le temps des foins. Murielle est née dans le mois de mai, ça fait qu'il avait été une bonne secousse malade. Mais quand on est jeune on remarque pas le temps. Quand il est arrivé de l'hôpital, y était en train de faire les foins. C'était mon oncle Eugène, mon oncle André, mon oncle Orner, c'était les mononcles, toutes les frères à moman et les frères à popa qui étaient toutes dans le champ puis ils fauchaient du foin. Dans ce temps-là le monde s'entraidait beaucoup, il se faisait des corvées. Fait que là mon père est arrivé puis il est allé les trouver dans le champ. Puis c'est comme s'il avait eu une guérison miraculeuse, en tout cas, après avoir été aussi malade. Il a repris son ouvrage tout de suite, de même. Il disait ça qu'il avait été guéri. Il a pas été longtemps là après parce qu'il a vendu sa terre. Il pouvait plus arriver dessus, il avait été malade, il avait, faut croire, accumulé du retard dans ses paiements puis là il a mis la terre en vente. Là nous autres, vendre la terre et s'en aller ailleurs, je te dis qu'on a trouvé ça pas mal dur. On restait près de ma tante Claudia, on l'aimait bien ma tante Claudia. Ensuite, la place où on est venue au monde on y est attachée. Il me semble de revoir ça quand on a paqueté le bagage puis qu'on s'en allait.
Au 8ième rang
Là on s'en allait au 8ième, dans la dernière maison du bout. On a resté là un an, on a monté là dans le printemps là puis on a passé l'été puis l'hiver. Suzanne est venu au monde là au 8ième.
La rougeole frappe
Dans l'hiver qu'on était au 8ième, mon père était dans le bois, maman était toute seule avec la gang d'enfants, puis on a toute poigne la rougeole, on était malade comme des chiens. Malade, malade là. Il y avait Laurent qui a rechuté et moi. Laurent lui ça y a tombé dans le cou, il est venu une grosse bosse après le cou, y
avait la tête couché sur l'épaule tellement que c'était enflé du côté gauche de la gorge. Il avait une bosse là, c'était énorme. Mon père avait été chez le curé puis il avait dit ça au curé. Là monsieur le Curé a dit à papa :
« Prenez du pain et faites tremper ça dans du lait chaud et mettez ça là-dessus. »
Puis c'est ça qu'ils ont fait, c'était pas le remède mais c'était la puissance du prêtre, je pense ben, parce que du lait et du pain pour faire partir une bosse pareille! Maman y mettait des tranches de pain trempées dans le lait. Elle lui mettait ça le matin, le midi, le soir. Ça pas pris ben ben de temps que la bosse était partie et son cou était correct.
Puis moi ça m'avait tombé dans les reins. J'ai été au moins 15 jours pas capable de marcher. Couchée, c'était pas endurable, debout c'était pas endurable; j'avais mal au reins c'était effrayant. Mettez des sirouanes à Joncas. C'était fait avec de la gomme de sapin et toute sorte d'ingrédients qui entraient là-dedans. Elle me mettait des sirouanes comme ça sur les reins puis à la longue ça fini par se passer.
Là, le printemps quand le beau temps commençait à reprendre, les oiseaux, les grenouilles, ah! que j'ai trouvé ça dur de vivre au 8ième. Je trouvais ça assez ennuyant, le soir dès que la brunante prenait, c'était les grenouilles qui se mettaient à jacasser puis les crapotes à travers de ça. Le bois était tout près de la maison, il y avait une forêt de bois. On avait assez peur qu'on sortait dehors puis on se dépêchait à rentrer. On voyait des sauvages, on voyait toutes sortes de bêtes dans le bois même si y en avait pas. Puis là, dans le mois de mai, je pense qu'on a toute ramassé les bagages puis on a déménagé à la Bellevue. Ça doit être en 1932 parce que Ti-Jo était le bébé et maman l'avait assis sur elle, il avait peut-être bien un an ou un an et demi.
La vie au rang Bellevue
Le petit camp

Une chose que je me rappelle ben quand on était à Bellevue, c'est le temps qu'on a resté dans le petit camp, un petit camp tout petit. Maman, elle, avait un petit coin de chambre, elle couchait là avec Ti-Jo, Ti-Jo était petit lui, Ti-Jo et Suzanne. Suzanne était dans le petit ber, puis Ti-Jo était dans une autre petite couchette, les autres étaient tous dans la grange puis nous autres on était au grenier. En tout cas ce grenier-là, le comble du camp, on était même pas capable de marcher debout là-dedans, fallait marcher à genoux. Maman avait mis des paillasses à terre puis là, on montait dans le grenier, on marchait à quatre pattes puis on allait se coucher là, les filles. Les gars eux autres couchaient dans la grange. Y avait du foin dans le fond des tasseries, maman l'eux avait mis ça confortable puis ils couchaient là. Ça y faisait de la peine maman. Des fois elle allait les voir le soir avant de se coucher puis ça dormait tout, tout pêle-mêle dans tasserie de foin, puis ils avaient l'air à se trouver ben. Elle, a n'en pleurait. Elle disait :
« Ça t'y de l'allure, des enfants couchés dans une grange. »
C'était une grange en croûte, puis les croûtes c'est pas comme de la planche, c'est toute par bosse, y a des noeuds, y avait des grands jours.
À la clarté eux autres le matin, dès que le soleil se levait, y avaient la clarté dans face. Puis y avait le coq aussi là. Le coq chantait puis ça les réveillait. En tout cas, ça se réveillait de bonne heure et puis ça ginguait dans la tasserie. Tant que mon père et ma mère se levait pas, y sortait pas de là. Ils s'amusaient là. Des fois on se réveillait nous autres puis on les entendait rire et culbuter là-dedans.

On avait une vache ou deux je pense dans ce temps-là. Maman et popa y se levaient eux autres là puis quand popa sortait dehors pour aller chercher puis tirer les vaches, là les ti-gars ça sortaient tout de la grange puis ils allaient le trouver. Là ça se mettait à ramasser des roches ou ben donc ils travaillaient avec papa tout le temps des vacances de l'été. Ils allaient à école mais quand y avait pas d'école, ils suivaient papa dans le champ puis ça ramassait des roches, puis ça ramassait des branches.
L'école de St-Médard
L'école à Saint-Médard, c'était pas une vraie école quand nous autres on a commencé à aller à l'école là. C'était une école en dessous de l'église. L'église, c'était la chapelle. La chapelle était en haut, on montait là par une grande escalier, puis en bas de ça, c'était l'école. J'ai pas vraiment de souvenir de l'école, il me semble que ça allait bien, on allait à école puis on était nu-pieds, tout l'été nu-pieds. Quand l'hiver prenait, l'automne là, que les gros frettes prenaient pis la neige bien là, on avait des petits robeurs. Des petits robeurs qui s'emplissaient de neige puis ça nous fondait dans nos chaussures. On était assis dans nos bancs à l'école puis on sentait l'eau nous couler à travers des orteils. Parce que des petits robeurs ça avait la hausse courte puis ça s'emplissait de neige.
Déménagement de l'école de la Rallonge
Puis là mon père y avait acheté une maison d'école à la Rallonge pour se reloger. Ça fait que là, il avait fait une corvée. Y avait plein de monde qui avaient été l'aider à défaire ça. Dans le temps de rien, l'école était toute défaite. Puis il avait tout défaite ça lui toute pan par pan. Il avait toute marqué son bois pour que ça soit plus facile à reloger. Je me rappellerai toujours la journée qui ont monté cette école là à Bellevue. On voyait envenir ça dans le rang. Là, il y avait peut-être bien dix teams de chevaux si c'est pas plus, attelés sur des waguines puis des grosses charges de planches, y n'avait c'était des farmes, d'autre c'était les poutres, y avait en tout cas assez de voitures pour amener tout l'école dans un voyage. Ils sont partis le matin puis y ont été charger ça, puis y ont toute emporté.
Le midi, quand que ça arrivé chez nous dans le courant de l'après-midi je pense, on voyait envenir ça dans la Bellevue des belles teams de chevaux. Moi j'ai toujours aimé les chevaux, puis
là on les voyait envenir un en arrière de l'autre, ça finissait plus. Il n'avait tout le temps, on en voyait 7, 8 puis on en voyait encore plus loin. À mesure que le team rentrait dans la cour, l'autre rentrait en arrière, puis là ils se plaçaient et déchargeaient le voyage. Il classait tout son bois pour que ce soit facile à loger, quand qu'il va se mettre à loger.

Ça pas pris ben ben de temps. Il a fait un petit peu de semence et s'est mis à loger sa maison. Ça pas été long que la maison a été debout, a été prêt à rentrer même si y avait rien de faite dedans. On s'est mis à coucher dedans dès qu'elle a été tout logé par dehors. Y avait pas de cloison en dedans, rien. On traînait nos paillasses là, ça fait qu'on couchait plus dans le camp, puis dans grange là, on couchait dans la maison.
Le partage des tâches familiales
À toutes les automnes, mon père allait dans le bois. Il partait pour le bois puis maman restait toute seule avec ça, la gang de jeunes. La petite besogne, était pas grosse, mais fallait y être. Y avait des cochons dans ce temps-là. On avait une trappe dans le plancher de la cuisine où le signe était et la pompe dans le nord-est de la maison. Y avait fait un bout de plancher là puis c'était dans le bois brusque. Y avait une trappe la dedans puis dans cette trappe là, il y avait un gros quart en fer, un gros chaudron de fer. Maman faisait ramasser de la balle par Laurent, de la balle de foin puis a mettait ça là dedans et a l'ébouillantait ça. Puis là, ça sa faisait de la nourriture pour les cochons. C'était une truie qu'on avait et là maman disait :
« Laurent, as-tu soigné ta truie? »

Puis là, Laurent y est venu choqué et dit :
« Que c 'est ça cette maudite truie là, est pas plus à moi qu'aux autres. »
Elle lui redisait :
« Laurent as-tu soigné ta truie? » Il lui répondait :
« Oui, oui, je l'ai soignée ma truie. »
L'hiver, maman ramassait toutes les vieux lainages des gilets des gars, des bas, quand c'était fini, que c'était plus mettable parce que ça avait été raccommodé des centaines de fois. Elle coupait toute ça par lisières et elle faisait du défaite avec ça. C'était nous autres qui défaisaient ça les jeunes. Puis là, elle nous disait :
« Si vous êtes vaillants puis si vous défaisez beaucoup de défaite, je vais vous conter des histoires, je vais vous conter des contes.»
Elle, a lisait beaucoup de livres et elle nous contait ça. Un soir, Laurent était assis à raz le poêle puis il défaisait du défaite, il disait pas un mot. Un moment donné il dit :
« Maudite job à pincer, moi j'haïs ça. »
Tout le monde était parti à rire. Ils l'ont fait pâtir avec ça les jobs à pincer. Laurent aimait pas ça les jobs à pincer. Y aimait ben ça avoir de quoi dans les mains.
Le voisinage
Un moment donné Eugène Gagnon avait entendu parler qu'on défaisait du défaite puis que maman nous contait des contes. Ça fait que lui aimait ça entendre conter des contes, fait qu'il venait nous trouver et il venait défaire du défaite puis maman nous
contait des contes. Quand on avait fini de toute défaire le défaite, on avait des pochetées de défaite. Il fallait qu'elle baratte ça, dans une baratte avec de l'eau bouillante. Quand tout ça était faite, elle nous faisait un petit plat de sucre à crème. Puis là, elle nous payait la traite; c'était notre récompense ça, un petit plat de sucre à crème. Maudit que c'était beau dans ce temps-là. Il y avait des soirs où elle n'avait pas toujours des contes, elle n'était pas pour toujours conter les mêmes, et bien là elle nous chantait des chansons. On lui disait :
« Maman chante nous celle-là, puis celle-là. »
Avant qu'elle ait faite le tour de tout le monde, elle en chantait plusieurs.

Eugène était quasiment toujours de la gang. Lui, il est ben venu chez nous Eugène. Maudit qu'il aimait ça entendre chanter des chansons. Des fois il faisait des tempêtes puis il partait de chez eux et il venait nous reconduire à école. Il montait spécialement pour aller nous reconduire à école. Quand on était rendu, il revirait de bord et redescendait chez eux. Il marchait en avant de nous autres et nous faisait des pas, des pistes, puis on marchait dans ses traces. Un qui est ben venu aussi, c'est le Léon, le Léon à Eugène. Il était tout seul chez eux lui et il s'adonnait ben avec les gars chez nous. Il a quasiment été élevé chez nous. Il allait chez eux pour ses repas puis c'est tout. Un moment donné, Eugène le cherchait puis il arrive chez nous les yeux tout blancs et il était choqué noir puis il disait :
« Calvaire de route. »
Il disait que Léon était toujours sur la route. Nous autres après, on se moquait de lui parce que lui aussi était toujours sur la route. On voyait passer Eugène puis maman disait :
« Calvaire de route. »
Maman faisait quasiment tout sa couture dans du vieux, ça faisait son filage à maison, ça faisait le défaite, a faisait carder ça, puis à filait ça. Le défaite pour faire des couvartes, puis la laine, puis tricoter quand on dit du premier morceau jusqu'au dernier. Les bas, les mitaines, les gilets, les camisoles, les caneçons, elle faisait toute, toute, toute à main. Toute au tricotage à main. Des fois, je me levais à minuit ou minuit et demi puis elle était assise à table puis elle tricotait, avec la lampe à l'huile. Puis nous autres, elle nous faisait des bas les filles. On avait pas dans ce temps-là des pantalons comme astheure, on était en petite robe. Fait que des bas ça en prenait long, fallait que ça nous vienne jusqu'en haut du genoux. Je te dis, pour tricoter une jambe de bas il fallait qu'a n'en fasse des tours. Il avait moi, il avait Lucie, il avait Murielle, ça n'en faisait des pattes à chausser ça.
L'école en hiver
Pour aller à l'école, on attachait nos bas en haut du genoux avec un lastique ou une corde, des fois a nous tressait des cordes avec de la laine puis on se faisait des cordes avec ça. Maudit qu'on a ben eu frette. Un petit coat sur le dos, on avait même pas de gilet en dessous de ça, puis on voyageait à l'école les cuisses à l'air. On arrivait à l'école les cuisses, entre nos culottes puis nos bas, c'était rouge, c'était glacé. Y a été des fois, moi je me rappelle, on avait monté le midi à école, puis nos petits robeurs s'était emplis de neige dans gueule en avant où les lacets, puis là on était assis dans nos bancs puis on sentait couler l'eau entre les orteils. Fait que quand on repartait de l'école le soir, pour descendre avec les bottes tout trempes de même, on arrivait chez nous les bas gelés dans le fond de nos petits robeurs. On ôtait nos robeurs puis les bas restaient dedans. Les pieds gelés ben dur puis les bas collés dans le fond. Moi j'ai arrêté jeune d'aller école, j'avais rien que 12 ans, j'aurais eu 13 ans au mois de novembre et j'ai arrêté dans l'automne parce que Lucie avait été engagée. Au mois de septembre, j'ai pas commencé parce que maman était tout seule avec sa gang d'enfants à nourrir puis à entretenir.
Les filles engagées
Chez nous, mon père était pas riche ben, ben. Dans ce temps-là, ça gagnait 50c par jour puis avec la famille qu'il avait et venir à bout de tout ça. C'est sûr que ça se vendait pas cher comme astheure mais ça en prenait encore pas mal. Fait que Lucie a été engagée chez mon oncle Siméon à Sainte-Rita. Elle avait 5 $ par mois. C'était une vraie risée. Ça y faisait 1.25 $ par semaine. Puis là, elle nous achetait des petites affaires : une petite robe (on pouvait payer ça 50c dans ce temps-là), une petite paire de souliers. Elle avait acheté des petites sandales puis c'était supposé d'être à moi mais c'était à tout le monde. C'est celui qui allait à la messe qui les mettaient, les autres y restaient nu-pieds. Il en avait une paire pour toute la famille. Lucie a été engagée là pas mal longtemps. Quand elle est sortie de là, elle a travaillé chez Désiré, a travaillé chez Thomas, a travaillé un petit peu partout. Elle s'est quasiment tout le temps engagée.
L'accident de ma soeur Lucie
Lucie a eu son accident quand elle travaillait Pierre Saucier dans le nord-est de Saint-Médard. Il avait un moulin à scie lui, puis il engageait des hommes. Puis là, sa femme avait eu un petit bébé, puis il avait engagé Lucie pour la relever. Dans nuit, Pierre Saucier et ses employés prenaient un coup. Ils étaient venus là dans nuit, ils avaient descendu dans la cave chercher de la bière. C'était une trappe dans le plancher, c'était pas comme on a astheure avec des portes. Puis eux autres y ont ouvert la trappe puis y ont été dans cave puis ils l'ont pas fermée. Ils ont resté la trappe ouverte. La trappe elle était drette en avant du poêle. Fait qu'y avait les deux chambres chaque bord du poêle puis Lucie couchait dans une et la femme à Pierre Saucier couchait dans l'autre. Dans nuit, le petit bébé s'est réveillé, il s'est mis à pleurer. Lucie a s'est levée elle, pour avoir soin du petit bébé. Elle a passé en avant du poêle pour aller dans l'autre chambre. Il y avait pas d'électricité dans ce temps-là ça fait qu'y se promenaient à noirceur. La femme à Pierre Saucier avait une petite lampe à l'huile dans sa chambre mais Lucie elle en avait pas. Fait qu'à s'est en allé là à noirceur. Puis là, a arrivé dans le trou, qu'eux autres avaient laissé la trappe ouverte. A tombé la dedans. Elle a arrivé les reins sur une marche d'escalier, puis là ben a resté au coup. Elle a remonté de là de peine et de misère. Mon Dieu elle avait assez mal aux reins! A l'avait assez mal aux reins! Fait que le lendemain soir elle était plus capable de toffer. Y ont fait demander popa en tout cas. Il est allé la chercher puis là, ils l'ont emmené à l'hôpital. Puis là, ces niaiseux-là, y ont même pas été capables de s'apercevoir que c'était un accident qu'elle avait eu puis que c'était un rein qui avait été décollé. Ils l'ont opéré pour l'appendicite. C'est de là qu'elle a commencé à être malade, puis elle a tout le temps été malade.
Au bout de trois-quatre ans, quand qui ont vu qu'a continuait d'être malade de même, ils lui on fait la grande opération. Puis a toujours été malade. Ça toujours été son rein qui a été son trouble puis y l'ont jamais trouvé. Ça été rien que plusieurs années après, y ont trouvé ça à Québec. Là, c'était plus le temps ils l'avait coupaillée partout.
Lucie s'est mariée avant d'être opérée pour la grande opération par exemple. Quand a été opéré pour l'appendicite, a restait avec son mal mais elle était par escousse qu'elle était pas si pire. En tout cas, elle s'est mariée puis elle a eu des enfants. Le premier qu'a eu,y a vécu 2 mois puis il est mort. Elle en a eu un autre qui a vécu une journée puis qui est mort. Puis elle a eu Raymond. Quand elle a eu Raymond monsieur le curé Lepage était à Saint-Médard dans le temps. Il avait passé puis y avait arrêté la voir. Il lui avait dit :
« Celui-là, il va vivre même s'il vient au monde avant son temps, il va vivre. »
Puis il a vécu. Elle en a eu un après Raymond puis il est mort aussi. C'est après ça qu'il lui ont fait la grande opération. Puis ils lui ont pas encore ôté son mal, c'était son rein. Ils ont vu ça plusieurs années après que c'était un rein qu'elle avait de flottant dans le corps, dû à cet accident là qu'elle avait fait sur Pierre Saucier.
Moi j'ai travaillé chez nous, j'ai été engagée une fois là chez Lucie quand elle a eu Raymond; c'est moi qui l'a relevée. Mais je me suis jamais engagée ailleurs, j'ai toujours travaillé chez nous. Puis là, je me suis mariée le 5 janvier 1943. J'ai resté là avec Lucie parce que nous autres on devait se marier l'été d'en suite. Puis là, Yvon avait eu des mots avec son père. Le père Ernest voulait plus rien savoir; il voulait plus qu'Yvon reste chez eux. Ça fait qu'Yvon avait demandé pour rester chez son frère Simon, le mari de Lucie. Puis le Simon lui a dit :
« Je te garderais ben mais Lucie a pas assez de santé. Ça prend tout pour avoir soin de nous autres, nos deux. Comment veux-tu qu'elle prenne soin d'un homme de plus. Pourquoi vous vous marieriez pas? Mariez-vous tout de suite au lieu de vous marier à l'été. Lanou va rester icitte pour être la fille engagère puis je vais vous garder pour rien parce que c'est Lanou qui va faire la fille engagère, elle va relever Lucie.»
Fait que c'est ça qu'on a fait, on s'est marié le 5 janvier puis on a resté chez Lucie. Là elle a eu son petit bébé le 19 de janvier puis il a vécu quelques jours celui-là puis il est mort.
Un enrôlement involontaire
La conscription
Dans le mois de mai, on était allé chez mes parents un dimanche. On allait à messe à toutes les dimanches à Saint-Médard. Quand on redescendait, on arrêtait chez nous. Puis là, maman nous gardait pour dîner. On dînait là puis on faisait un bout dans l'après-midi puis ensuite on s'en retournait. Nous autres dans ce temps on était parti de chez Lucie. On restait plus dans leur maison, on restait dans le petit camp.

Là dans l'hiver, Yvon s'était coupé du bois pour se loger une maison, puis on devait se loger là, s'établir là.
Puis là, un bon dimanche après-midi, il arrive en avant de la porte un gros char de l'armée, une grosse barouette verte puis quatre grosses polices là-dedans. Ça fait le tour de la maison, un en bas, un d'un bord l'autre de l'autre, puis l'autre entre dans la maison. Là ils venaient arrêter Yvon. Parce que lui, quand il avait fait son mois d'entraînement militaire au mois de décembre dans même année que Léon. Léon lui a tombé malade puis s'est en allé à l'hôpital, il a quasiment passé l'hiver là à l'hôpital, il est sorti dans le mois d'avril je pense. Il avait fait une pleurésie, il avait de l'eau sur les poumons. Il avait pas vu l'heure qui sortirait de là. Puis Yvon lui, il l'avait fait son mois d'entraînement puis quand qu'il est venu pour la dernière journée là ils lui ont dit :
« Là tu vas signer ce papier-là comme de quoi que tu as fait ton mois d'entraînement. »
Ce n'était pas vrai, il savait pas lire et il savait pas écrire, il savait pas ça lui ce qui était écrit sur le papier. Ils lui ont dit que c'était parce qu'il avait fait son mois d'entraînement mais c'était un engagement volontaire pour la guerre. Fait qu'en autant qu'il était engagé volontaire, eux autres quand ces papiers-là sont arrivés au gouvernement ou j'sais pas trop où en tout cas, ils ont tous fait un appel à ceux qui s'étaient engagés volontaires puis là, lui ils l'ont fait demander et c'était dans le printemps qu'il avait eu sa pleurésie, lui aussi, comme mon frère Léon. Il avait eu une grosse pleurésie, puis il avait été vraiment malade. Il était sur les soins du docteur puis il disait qu'il faisait une consomption galopante. Là, le docteur Catelier a écrit à l'armée puis il leur a dit qu'il pouvait pas se rendre parce qu'il était malade. Puis eux autres cette lettre là ça a été au panier. Ils n'ont même pas faite de cas. Quand que les policiers sont arrivés, ils ont dit qu'il était considéré comme un déserteur parce qu'il s'était pas présenté quand ils ont fait l'appel. Fait que là, ils venaient le chercher, menottes aux mains, pareil comme un bandit, un tueur. Ils l'ont embarqué dans leur boîte et ils sont partis avec pour Québec. De Québec, il l'on transféré à Clint à Rimouski. Puis là à Rimouski y a été un bon quinze jours, trois semaines.
Eugène et ses frères ils s'étaient tout organisés pour aller essayer de le faire sortir de là. Ils avaient fait faire une lettre sur un notaire. Fait que là ils lui ont fait une permission d'un mois. Puis au bout d'un mois il fallait qu'il aille se reporter et lui donnait encore une autre permission d'un mois, il fallait qu'il retourne encore se reporter puis un autre permission d'un mois. Puis là, au mois de juillet, ils lui en ont donné une de six mois. Le six mois finissait le 6 de janvier fait que là c'était pas à Rimouski qu'il fallait qu'il aille, il fallait qu'il aille à Québec pour avoir une autre permission.
Le 6 de janvier au matin, je me rappellerai tout le temps, c'était le Simon qui l'avait descendu au train. Il prenait le train pour monter à Québec. Quand qu'il est monté à Québec, il a rencontré monsieur Louis Paradis de Trois-Pistoles. C'était un gars qui avait fait la guerre de 1914. Il a dit :
« Toutes les gars que je connais, mes amis, mes parents, ils iront pas à la guerre. Prends ma parole que tu resteras pas là mais seulement, il va falloir que tu sois patient. Ça se fera pas dans une semaine. Vas-y et attends. »
Ça fait qu'il y a été. Monsieur Paradis a travaillé pour lui. Il connaissait ben le Caporal Linsey à Québec. Vu que ce monsieur Paradis était ben fort dans l'organisation, ben il leur a dit :
« Moi ce gars-là, je veux que vous le clairez de l'armée. Je veux que vous lui donniez sa discharge. »
Ben, ils se sont arrangé pour lui donner. Il se faisait dans ce temps-là des passes droit pareil comme quand il s'en ai tout le temps fait. Fait là ben, au mois d'avril quand il est revenu, il était clair de l'armée, il avait sa discharge dans ses poches. Ça faisait quasiment un an de ça, c'était dans le mois de mai qu'ils étaient venus le chercher puis on était rendu au mois de janvier de l'autre année.
Nicole était venue au monde elle au mois d'octobre. Quand qu'il a parti, Nicole avait 2 mois et quelque chose et quand qu'il est revenu au mois d'avril, elle se tenait assis dans sa couchette et elle se tenait debout. C'était pas croyable, il disait :
« Je la reconnais pas. » Il était là et la regardait puis il disait :
« Il me semble que c'est pas elle. » Il l'avait vu petit bébé puis là il la revoyait à cet âge-là.
C'est là que ça toute chambardé notre vie. Là, c'était plus le temps de se loger une maison. Simon lui avait décidé qu'il prendrait la maison de son père. Fait que Simon est déménagé là, sur le père Ernest puis nous autres on a racheté la maison du Simon avec sa terre puis on lui a revendu notre demi lot. Fait que le demi lot est allé au Simon puis nous autres on a acheté sa maison.
Notre maison était rien qu'en pièces, c'était pas fini. Pour mettre ça un peu plus propre, on avait rambrissé ça avec du cartron blanc. Des gros rouleaux de cartron, je pense qu'on payait ça 50c, puis on avait fait comme une tapisserie avec du cartron, ça mettait ça plus propre. Mais avec des enfants, du cartron je te dis que le bas des murs il y en manquait des morceaux. Ça fait qu'on rapiéçait ça puis on arrangeait ça du mieux qu'on pouvait pour mettre ça un peu plus propre. Les planchers de bois brossés avec une brosse. Mautadit que c'était dur!
Une famille comme celles d'autrefois
J'avais un enfant à tous les ans, tous les ans, tous les ans. Les quatre premiers ont venu au monde en dedans de quatre ans. C'est Charles-Henri qui est le quatrième puis il est venu au monde la journée du jour de l'an. Ça aurait fait quatre ans le 5 de janvier puis j'en avais quatre. Puis ça continué comme ça, j'en ai eu 16 en fin de compte. Mais là il a eu un espace un moment donné entre Diane et Marc-André, là j'en ai perdu 5. Ils voulaient me faire opérer, ils disaient que j'en aurais plus d'enfant puis j'avais un fibrome. Moi j'ai dit non, j'ai dit non. Si vous autres vous pensez ça, le bon Dieu pense pas ça. Le bon Dieu est encore plus fort que les médecins. Puis j'avais beaucoup, beaucoup confiance. Je priais beaucoup le bonne Sainte Anne puis le Seigneur. Fait que là j'avais fait une promesse, je voulais garder mon bébé. On dirait pas que je n'avais quatorze. J'aurais ben pu dire, j'en ai assez, coudon j'en ai quatorze. Mais non, j'ai assez ben prié que le bon Dieu m'a exaucé. Je l'ai eu mon bébé. C'était Marc-André puis ensuite après lui, j'ai eu Pauline. Fait que j'en ai eu seize.
Le passage aux temps modernes
Quand on commence une famille sur une petite terre avec une vache, un veau puis on monte ça à une cinquantaine de vaches, avec toute la reguine à chevaux et la reguine à main. Tout troquer ça pour de la reguine électrique, puis à gaz. Les tracteurs, les faucheuses à tracteur, puis le conditionneur, puis le séchoir à foin. Tout, tout, tout était équipé dans l'étable numéro 1 en tout cas. On avait la chambre à lait, le bulltink, la trayeuse, dire comment ce qu'on a eu de la misère les premières années à aller jusqu'à ces années-là.
Je pense qu'on a eu l'électricité nous autres chez nous en 1950 parce que c'est l'année où ce que Roger est venu au monde. Dans la Bellevue, elle avait passé avant ça mais on avait pas le moyen de la prendre nous autres. La besogne d'étable tout à main : pomper l'eau, gratter les vaches, tout à main. Puis, dans maison c'était pareil. Le poêle à bois en plein coeur du mois de juillet, il fallait que tu chauffes pour faire à manger. Puis laver dans une cuve avec une planche à laver. Tout ça en plus de charrier les petits. Fait que tout ce temps là, tout l'ouvrage se faisait à bras puis beaucoup beaucoup d'ouvrage, beaucoup de misère, beaucoup de couture, beaucoup de raccommodage. C'était pas facile. Étendre du linge dehors l'hiver puis entrer ça ben gelé, étendre ça sur des cordes dans la maison pour que ça sèche.
Eh bien moi, c'était comme ma mère. A avait tout le temps été pauvre puis elle avait tout le temps cousu pour habiller ses enfants. Puis moi j'avais absolument le même roule. Moi itou j'étais pauvre j'avais pas d'argent pour acheter du linge aux enfants. Ça fait que j'en faisais. Une chance que j'étais assez adroite pour faire du linge qui avait de l'allure. Ils étaient aussi ben habillés que les autres. J'en ai passé des veillées puis des parties de nuits au moulin à coudre à préparer un morceau de linge pour un qui avait besoin d'une froque le lendemain, ou qu'il avait besoin d'une paire de culottes, mais il fallait que je le fasse. Tricoter c'est pareil, tricoter les bas pour une gang de pieds de même, ça en prend des bas puis des mitaines.
De l'argent, je te dis que l'argent était rare. Les quatre premières années, Yvon restait à la maison l'automne pour aller bûcher sur la terre. Après, il fallait qu'il gagne plus. Il voulait s'acheter un étendeur à fumier, un cheval, de la réguine. On avait pas beaucoup de réguine. Fait que là, dans l'automne il partait dans le bois avec le Simon puis ça s'en allait sur la Saint-Anne au nord de Québec puis là il bûchait tout la grande hiver. Moi j'étais tout seule à maison avec mes jeunes, ma gang de jeunes, puis la besogne à faire à étable.
La besogne à la ferme
C'était une grosse besogne pour une femme tout seule, puis tout à main. Pomper l'eau, j'en aurais braillé des fois, c'était dur à pomper. Remplir le quart. Il fallait prendre l'eau avec des chaudières puis vider ça dans les auges. Puis retourne une chaudiérée d'eau, puis retourne... ça en prenait t'y des chaudières pour remplir une auge. Puis là, t'avais pas rien qu'une à remplir, tu n'avais trois. On avait deux sets de vaches cul à cul dans une rangée puis on avait un autre set de vache la tête à pompe. Cette auge-là, c'était moins dur. On mettait une auge puis on pompait dans l'auge puis ça s'en allait tout suite dans l'auge des vaches.

Ensuite, monter sur les tasseries, aller débouler le foin puis soigner ça à mitaine. Il fallait entrer les brassées de foin le long des vaches pour y eux donner ça. C'était pas à presse comme
astheure; on y eux sacre ça là puis on s'en va. Il fallait les soigner une par une. Ensuite le grattage de ça. On avait deux chevaux qui étaient tous les deux au bord, ça faisait ben plus loin. Des chevaux ça en fait du fumier! Gratter ça puis envoyer ça au fond, c'était pas facile.
C'était pas sur une allée ben lisse, c'était sur une vieille allée de bois. Puis un moment donné, une vache ou un cheval avait défoncé dedans puis le trou avait été bouché avec une planche. Fait que quand tu arrivais à planche, la pelle accotait après. Il fallait que tu la lèves avec ta pelletée de fumier pour passer pardessus la bosse puis continuer jusqu'au fond. Quand t'arrivais au fond puis que t'avais fini de tout gratter l'étable, il t'avait une montagne de fumier là. Il fallait que tu pognes le broc puis que tu sortes ça dehors à brocqueter. Ah! Il n'a coulé de l'eau là. C'est effrayant si j'ai trouvé ça dur, il faut dont être capable pour faire des ouvrages de même.
Puis là j'étais pas tranquille. J'étais pas à l'étable faire ma besogne et prendre mon temps. J'étais là à course, les enfants étaient tous seuls à maison puis ils étaient pas vieux. Fait qu'à tout bout de champ j'allais voir, bon! Puis là je leur donnais des affaires pour s'amuser puis « ça sera pas long ». Je retournais à l'étable, j'en faisais une secousse puis je retournais voir à maison.
Un coup c'était l'été. J'avais pris le champ pour aller chercher les vaches puis c'était Charles-Henri qui était le bébé en tout cas. Moi j'avais même pas de chaise haute. Je les assisais dans une chaise berçante puis je les attachais avec une cravate. Une maison pas trop trop finie des fois c'est pas chaud. On avait un poêle à bois. Quand que le bébé était chialeux, des fois je voyais ben que c'était parce qu'il avait pas chaud. J'emmenais la chaise près du poêle et j'ouvrais le panneau du fourneau. Puis là, le petit bébé sentait la chaleur. Ben là tiens, il se tranquillisait. Fait que là, Nicole était pas vieille elle, puis elle m'avait vu faire ça quand le bébé pleurait et je l'emmenais à raz le poêle puis il s'endormait souvent des fois.
Cette fois-là, je pars pour aller chercher les vaches puis j'avais mis un bon feu dans le poêle, j'avais mis mon souper sur le poêle. Quand je faisais la besogne, le souper cuisait puis quand on revenait et bien là, on soupait. Je reviens avec les vaches puis pour faire du mal, il en avait une qui était loin et j'ai pas vu l'heure que je l'emmènerais. Là j'arrive, je lâche ça dans la cour puis je ferme la barrière. On avait une manière de clos qu'on mettait les vaches là. Je rentre dans la maison, puis là le bébé braille mes amis à fendre l'âme.
Il est collé après le poêle, il est assez collé après le poêle que les deux petits pieds y frappent après le poêle à toutes les fois qui gigote. Vous savez qu'un bébé qui pleure ça gigote. Il avait tout le dessour des pieds en grosses boursoufles. En tout cas, c'était braillant à voir. Je le recule de là mais j'ai dit :
« Que c'est que t'as fait là? »
« Toi, tu l'emmènes ben à raz le poêle puis il dort. »
Mais moi, je l'avais pas emmené si proche que ça. Mais tu sais, un enfant, elle a s'avait pas rendu compte que le petit bébé les pieds lui touchaient après le poêle. C'était un poêle Colomb qu'on avait. Là, je lui met de l'onguent de camphre sur les pieds puis je le berce. En tout cas, je finis par l'endormir. Il était manqué d'avoir braillé lui. Fait que là il s'endort. Moi, y a pas à dire, je peux pas rester dans la maison puis watcher ce qui va se passer. Là, je leur ai dit :
« Assisez-vous, restez tranquilles et menez pas de train pour pas réveiller le petit bébé tandis qu'il dort. »
Là moi je m'en vais à l'étable puis j'attache les vaches avec des crochets, des carcans. C'était quasiment comme un cercle puis il avait un affaire après qui accroche. C'était dur à accrocher, ça prenait un peu de force pour pouvoir mettre ça et pour pouvoir passer le crochet. Ah! Que j'avais de la misère à faire ça. La chaudière entre les deux pattes puis tire les vaches, les queues dans face, les pattes dans la chaudière. Il fallait tout tirer ces garces de vaches là puis traîner le lait à la maison. Le centrifuge était à maison. Je faisais peut-être quatre, cinq voyages pour emmener le lait à maison, puis écrémer ça tout seule. Tout reporter ce lait là à étable pour aller faire boire les veaux, soigner les cochons, laver les chaudières, laverie centrifuge... Arriver puis donner à souper aux enfants, lave le petit puis lave l'autre puis coucher les enfants. Ah! J'en finissais plus. Ça été dur, ça été dur, ça été dur.
Si l'ouvrage ferait mourir, ça ferait longtemps que je serais plus icitte. Mais ça fait pas mourir parce que j'ai travaillé et pas tout le temps dans les bonnes conditions, mais c'est la vie. Une chance que j'étais courageuse. Moi je dis ce qui m'a aidé à vivre puis à tenir bon c'est parce ce que j'étais beaucoup beaucoup dévotieuse. Je priais beaucoup puis j'avais beaucoup d'aide du bon Dieu. Parce que sans ça, j'aurais pas toffé. Moi je dis que toutes ces misères-là ça se fait; c'est dur mais ça se fait.
Une épreuve insurmontable
Le coup de grâce je l'ai eu en 1971 quand que Nicole s'est fait tuer. Ça, ça été une période épouvantable. Je sais pas, on dirait que ça m'a basculé dans la tête quand j'ai appris qu'elle était morte. J'ai été pour un bout de temps, j'étais plus là, j'étais complètement perdue. C'était effrayant si j'ai eu de la peine. J'étais pas capable d'accepter cette épreuve-là. Du jour au lendemain, ça arrive là une tonne de briques sur la tête. Tu te relèves pas de là sans avoir des poques puis des blessures qui prennent du temps à guérir.
Nicole c'était quasiment mon poteau de vieillesse. Je m'étais tellement fait d'illusions, je m'étais tellement fait de projets avec Nicole. C'était la bonté du monde ça, Nicole. Ça avait jamais un mot plus haut que l'autre, toujours de bonne humeur. On lui demandait n'importe quoi c'était tout le temps oui. Elle était toujours au devant de moi. Elle disait :
« Laissez moi faire maman, je vas faire ça moi, puis je vas faire ça moi. »
Une chance que j'ai eu Suzanne. Elle était chez nous à toutes les jours. Pauvre Suzanne comme a été patiente à m'entendre conter ça. Elle avait toujours l'air intéressé, comme si elle aurait entendu ça pour la première fois. Ça de l'air que dans vie qu'on a toujours un ange de même. Quand qu'il nous arrive des grosses épreuves on a quelqu'un qui est là, qui a le courage qu'il faut et qu'il a la patience qu'il faut pour nous aider a vivre cette epreuve-là. Parce que sans elle moi je pense que j'aurais viré sur le top, j'aurais pas été capable de vivre ça. Je me serais laissée mourir je pense. J'avais rien à m'accrocher. Les plus vieux étaient partis puis les autres étaient jeunes.
L'exode à St-Jean
Ensuite, ce qui a été aussi dur peut-être, c'est quand on a parti de la Bellevue pour s'en venir à Saint-Jean. Là, ça été encore une grande déchirure. Tu prends pas un arbre de trente quelques années qui est planté à la même place puis l'arracher et aller le planter ailleurs. Il y a des racines qui cassent, y a des racines qui meurent. Non, il vit l'arbre mais il vit mal. Il lui manque des morceaux, il lui manque des branches. J'aimais pas la maison plus qu'il le faut. Moi mon chez nous c'était à la Bellevue, ça toujours été la Bellevue et ce sera toujours la Bellevue. J'ai élevé ma famille là, j'ai eu ma misère là puis on dirait que je suis enracinée là. À Saint-Jean j'ai jamais pris racine, peut-être que ça va en surprendre quelques uns.
Je me rappelle bien les premières années qu'on était icitte, Ti-Jo, Francis, Léon, le Bob, n'importe qui des gars venait veiller et me disait :
« Je suis content pour toi, t'as assez travaillé, tu mérites bien ça. »
Je disais oui, je disais oui avec ma tête c'était comme dans la chanson : je disais oui avec ma tête mais je disais non avec mon coeur. Puis j'osais pas leur dire que je m'ennuyais et que j'aimais pas ça. J'avais peur qu'ils me traitent de folle. Ils avaient l'air si content que je sois dans ma petite maison à Saint-Jean, plus de besogne à faire, tranquille. C'est vrai que j'aurais dû être bien, mais je l'étais pas, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de mon monde.
Je me rappelle trop dans le temps qu'on était a la Bellevue, les belles veillées qu'on passait toute la famille. Les jours de l'an que ça s'en venait chez nous, c'est des soirées que je n'oublierai jamais ça, tout le monde était dans place puis ça chantait des chansons à répondre. C'est une autre raison de m'attacher à la Bellevue. Après que j'ai été rendu à Saint-Jean, ça plus arrivé ces belles veillées-là. Je sais pas pourquoi; les enfants grandissaient probablement puis chacun avait sa famille puis il en a qui se sont mariés, ils recevaient leurs enfants. C'est ça qui fait que j'ai eu un peu d'amertume c'est normal parce que ma vie icitte, ça pas été facile.
J'avais pas beaucoup d'ouvrage à faire mais c'était tout un combat, une lutte continuelle pour pas faire paraître que je m'ennuyais, pour pas faire paraître que j'aurais voulu être ailleurs. Il venait du monde puis je faisais l'air de rien. Faire l'air de rien puis faire l'air qu'on est ben quand on est mal, c'est dur. Je sais pas si on peut appeler ça hypocrite mais c'était pas pour mal faire.
Plus les années ont passé, plus la maison s'est vidée. Moi mes enfants c'était ma vie, mes enfants c'était ma consolation. Ils étaient tellement bon pour moi. J'étais attachée à eux autres, c'est terrible. Là une année un s'en allait, l'autre année un autre s'en allait puis là je voyais venir le jour où je serais toute seule. Ça, j'appréhendais ça. Ça je ne voulais pas ça. Mais comment que tu ne le veux pas, ça arrive quand même. Mes petits oiseaux, mon panier qui en étaient plein, ben il se vidait, un s'envole, l'autre s'envole, puis l'autre s'envole. En 1987, la dernière s'est décidée de s'en aller à Val d'Or. C'était pas chez le voisin. À Val d'Or en plus, je n'avais un qui était là dans ce temps-là. Je m'ennuyais de lui c'était effrayant que je le trouvais dont loin. J'en avais deux qui étaient à Val d'Or, puis j'en avais deux qui étaient au Labrador. C'était encore à l'autre bout du monde. Mais j'en avais quelques uns par icitte qui étaient plus près. J'avais plus personne dans la maison. Là j'ai trouvé ça plate, j'ai trouvé ça long et j'ai trouvé ça dur. J'aurais dont voulu être capable d'apprendre à chauffer le char puis aller les voir mes frères et mes soeurs. Je m'ennuyais d'eux autres autant comme je m'ennuyais de mes enfants. Mais je pouvais pas sortir, j'étais braqué icitte avec le char dans le garage. Pas capable de sortir, être obligée d'attendre la visite. C'est sûr que de la visite on a eue, ils sont venus souvent. Tout le monde nous disait :
« Mais vous viendrez, vous viendrez. » « Oui, oui on va y aller. »
Mais on n'y allait pas, on n'y allait pas. Un moment donné, ils ce sont dit :
«Ben, ils viennent jamais, que c'est qu'on va allé faire là. Faut croire qu'ils aiment mieux pas nous voir.»
Fait là, y ont slacké de venir. Ça m'a manqué ça vous savez pas comment, de voir que mes frères et mes soeurs venaient plus icitte.
Ils venaient plus jamais, c'était rare, rare, rare. Ils venaient plus. C'était un peu de notre faute mais c'était pas de ma faute. Moi j'aurais voulu y aller, mais Yvon avait travaillé toute la journée fait que le soir ça lui tentait pas de sortir puis des fois il fallait qu'il aille à Sainte-Rita chercher des morceaux pour sa scie. Fait que je restais icitte. Je m'ennuyais, une chance que j'avais mes enfants, une chance qui en avait de proche et qu'ils venaient souvent parce que j'aurais trouvé la vie dure.
Grâce à mes enfants j'ai resté solide malgré tout, solide, solide il faut le dire vite. C'est sûr j'ai vieilli, j'ai moins de capacité que j'en avais, pas mal de moins. L'ouvrage que je faisais avant dans une demie journée, ça va me prendre deux jours mais toujours, ça va. J'ai fait mon devoir, j'ai accompli ma vie tout est bien...
|
Abatis : |
Terre encore jonché de branchages |
|
Achalé : |
Agacé, contrarié |
|
À mitaine : |
À la main |
|
À pic : |
Abrupt |
|
À plein : |
Beaucoup |
|
Arrondissement : |
Territoire d'une commission scolaire |
|
Assir : |
Asseoir |
|
Astheure : |
À présent, maintenant |
|
Bâdrer : |
Ennuyer, déranger |
|
Barrer : |
Fermer à clé |
|
Barouette : |
Brouette |
|
Ben: |
Bien |
|
Ber: |
Berceau |
|
Boss : |
Patron |
|
Bougon : |
Petit morceau de bois |
|
Boursoufles : |
Boursouflures |
|
Braqué : |
Laissé, abandonné |
|
Breaks : |
Freins |
|
Brocquetter : |
Se servir d'un broc |
|
Brusque : |
Brut |
|
Bulltink : |
Réservoir réfrigéré pour entreposer le lait |
|
Cabousse : |
Voiture d'hiver tirée par un cheval |
|
Caneçons : |
Caleçons |
|
Cartron : |
Carton |
|
Char: |
Automobile |
|
Chialeux : |
Qui se plaint, pleurnicher |
|
Choqué : |
Fâché |
|
Clair : |
Acquitté, libéré |
|
Clairer : |
Congédier |
|
Coat : |
Manteau |
|
Cornaillait : |
Donner des coups de cornes |
|
Coupaillé : |
Couper irrégulièrement |
|
Couvartes : |
Couvertures |
|
Crapote : |
Crapaud |
|
Défaite (nom) : |
Lainage récupéré de vieux vêtements |
|
Défaite (verbe) : |
Brisé, démoli |
|
Dessour : |
Dessous |
|
Dévotieuse : |
Pieuse, fervente |
|
Discharge : |
Démobilisé |
|
Dret-là : |
À côté |
|
Drette : |
Droit |
|
Engagère : |
Employée à gages dans une ferme |
|
Envenir : |
Venir, arriver |
|
Escousse : |
Un certain temps |
|
Faire le train : |
Soin donné aux animaux de l'étable tous les jours |
|
Farmes : |
Ferme |
|
Flo: |
Enfant |
|
Frette : |
Froid |
|
Froque: |
Manteau |
|
Gang : |
Bande |
|
Garroché : |
Lancé |
|
Ginguer : |
Courir en sautant |
|
Greyé : |
Équipé, préparé |
|
Gueule : |
Mâchoire ou ouverture |
|
Hausse : |
Partie supérieure de la bottine |
|
Icitte : |
Ici |
|
Itou: |
Aussi |
|
Jack : |
Lampe |
|
Jeunesses : |
Personnes jeunes |
|
Job: |
Travail |
|
Jours : |
Fentes |
|
Lastique : |
Bande élastique |
|
Maline : |
Dangereuse |
|
Magané : |
Endommagé, brisé |
|
Marde : |
Merde |
|
Manqué : |
Épuisé |
|
Mener pas de train |
: Ne pas faire de bruit |
|
Minot : |
Unité de mesure valant huit gallons |
|
Mique : |
Lorsque |
|
Moé : |
Moi |
|
Môman : |
Maman |
|
Mononcles : |
Mes oncles |
|
Paqueté : |
Faire ses bagages |
|
Pis : |
Puis |
|
Pivelé : |
Moucheté |
|
Plate : |
Ennuyant |
|
Pocheton : |
Sac |
|
Pogné : |
Attrappé |
|
Popa : |
Papa |
|
Pu: |
Plus |
|
Quanté : |
Couché |
|
Quart: |
Baril |
|
Raccommodé : |
Coudre |
|
Rack: |
Support quelconque |
|
Racotillé : |
Se ramasser sur soi-même |
|
Rageux : |
Qui s'irrite aisément |
|
Rambrisser : |
Revêtir |
|
Rapailler : |
Regrouper, ramasser |
|
Recommandés : |
Consultés |
|
Regrouillé : |
Bougé |
|
Reguine : |
Instrument aratoir |
|
Rentourages : |
Tout ce qui entoure (en planche) |
|
Retrousser : |
Aider une femme qui a accouchée |
|
Revirer : |
Tourner |
|
Robeur: |
Espèce de bottine en caoutchouc |
|
Ronait : |
Courrait |
|
Roule : |
Existance, destiné |
|
Sacre : |
Mettre |
|
Sacreur : |
Personne qui blasphème |
|
Secousse : |
Espace de temps, période |
|
Set: |
Ensemble |
|
Shed : |
Hangar, remise |
|
Signe : |
Évier |
|
Sirouane : |
Cataplasme |
|
Slacker : |
Diminué |
|
Sleigh : |
Traîneau |
|
Snow : |
Autoneige |
|
Stock : |
Matériel |
|
Su: |
Sur |
|
Sur: |
Chez |
|
Talle : |
Touffe de plantes d'une même espèce |
|
Taper : |
Battre |
|
Tapon : |
Amas |
|
Tasserie : |
Partie de la grange où l'on tasse le foin |
|
Taurâille : |
Jeune bœuf |
|
Team : |
Attelage de deux chevaux |
|
Tire : |
Traie |
|
Toffe : |
Endurer, tenir bon, supporter |
|
Toppe : |
Tête d'un arbre |
|
Tracel : |
Ponceau |
|
Train : |
Bruit |
|
Trempes : |
Mouillés |
|
Un coup : |
Une fois |
|
Une manière de : |
Une sorte de |
|
Verbe : |
Parole |
|
Viré sur le top : |
Devenir fou |
|
Waguines : |
Voiture de ferme à quatre roues |
|
Watché : |
Surveillé |
|
Y: |
Il, lui |
Le projet de produire un recueil de contes et récits de vie remonte à quelques années déjà au Centre Alpha des Basques. Il résulte des ateliers d'expression orale que nous organisons à chaque automne, lors du Festival de contes et récits de la francophonie et qui sont animés par le conteur Marc Laberge.
Quatre personnes ont participé au présent recueil. Bientôt, d'autres gens des différentes municipalités seront invités à exprimer par l'oral et par l'écrit, leur imaginaire et leurs souvenirs, toujours enluminés d'expressions à saveur locale, tel que vous le découvrirez à la lecture du présent ouvrage.
Par la production de cette oeuvre, le Centre Alpha des Basques souligne l'importance de promouvoir l'expression orale et écrite et de sauvegarder tous ces trésors enfouis dans nos mémoires.
Marcel Desjardins Centre Alpha des Basques