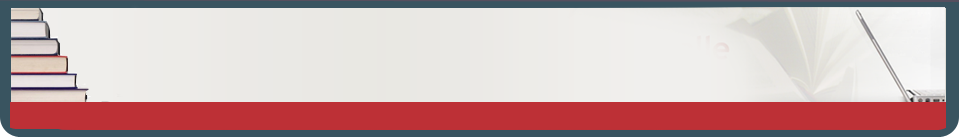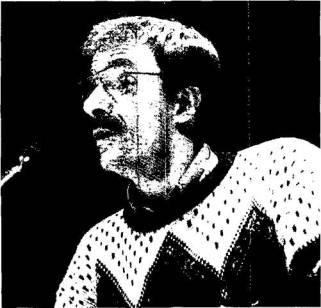Barrières |
Pistes |
1. Non-reconnaissance de l'analphabétisme au QuébecPlusieurs intervenantes et intervenants sociaux admettent difficilement l'existence de l'analphabétisme au Québec et le fait que ce problème de société affecte une couche importante de la population.
|
1. Prévenir l'analphabétismeTous les secteurs de la société devraient se concerter et favoriser de bonnes conditions d'apprentissage pour les enfants et les adultes. |
2. Absence de responsabilité socialeLe discours sur l'analphabétisme en fait un problème individuel plutôt qu'un problème social. Actuellement, les campagnes de sensibilisation interpellent les adultes qui ont des difficultés en lecture, écriture ou calcul sans responsabiliser l'ensemble des institutions sociales.
|
2. Lutter contre la pauvretéLes organismes qui veulent combattre l'analphabétisme devraient également mener la lutte à la pauvreté. Le type de développement économique actuellement privilégié, qui engendre la pauvreté et contribue à faire augmenter le taux d'analphabétisme, doit être réévalué. |
3. Augmentation des abandons scolairesLes approches privilégiées à l'école sont celles qui correspondent aux valeurs et au vécu des classes moyennes. Les conditions de vie des élèves de milieux défavorisés contribuent à les mettre en situation d'échec scolaire. Les seuils de réussite scolaire ont été haussés récemment, sans aucune mesure compensatoire pour éviter les abandons scolaires. |
3. S'adapter aux besoins des milieux défavorisésLe ministère de l'Éducation, en concertation avec les autres ministères, devrait relancer les programmes destinés aux milieux défavorisés.
|
4. Dévalorisation de la culture oraleLa société québécoise n'accorde pas beaucoup de valeur aux modes oraux de transmission de connaissances (exemple : chansons, danse, etc.). Ces moyens de communication font moins sérieux. |
4. Développer des services à la petite enfanceUn plus grand nombre de services à la petite enfance devraient être offerts, afin d'éviter dès les premières années du primaire des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. |
5. Absence de pouvoir des personnes analphabètesLes personnes analphabètes ont rarement du pouvoir ailleurs que dans leur vie privée. Et encore! Il est difficile pour elles de se convaincre que leur participation servira à quelque chose dans une activité où on ne tient pas compte de leur réalité. C'est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'exercer son droit de vote. |
5. Sensibiliser le publicLes organismes de tous les secteurs de la société doivent développer, de façon concertée, des moyens pour sensibiliser le public aux réalités des personnes analphabètes et à la responsabilité de la société face à l'analphabétisme. |
6. Absence de crédibilitéL'opinion des adultes qui possèdent un vocabulaire limité ou qui n'ont pas structuré leur pensée par l'écrit est rarement valorisée. Il faut maîtriser une certaine façon de parler pour être crédible auprès de plusieurs institutions et organismes. |
6. Planifier les actions dans les organismesTous les organismes, institutions et entreprises devraient établir un plan d'action pour participer, dans leurs domaines respectifs, à la lutte contre l'analphabétisme et aider les personnes analphabètes à exercer leurs droits. |
7. Exclusion des parents analphabètesL'école ne travaille pas autant qu'elle le devrait avec les familles où il y a plus de risques que l'enfant devienne analphabète. Les parents analphabètes sont souvent exclus du projet éducatif de l'école où étudient leurs enfants. |
7. Soutenir l'engagement dans la communautéLes établissements publics, les groupes communautaires, les syndicats et tous les organismes concernés devraient offrir aux personnes analphabètes qui veulent s'engager dans leur communauté, le soutien nécessaire pour suivre les discussions. Il faudrait adopter des modes de fonctionnement dans lesquels ces personnes peuvent évoluer sans difficultés. |
8. Des connaissances de base prises pour acquisDans les médias ou dans toute forme de communication publique, on donne souvent une information sans la situer dans son contexte. |
8. Encourager l'utilisation du droit de voteLes lois électorales devraient être modifiées de manière à ce que les personnes analphabètes puissent occuper la place qui leur revient dans le processus électoral et exercer leur droit de vote. |
9. Nouvelles technologies du téléphoneDe nouvelles pratiques téléphoniques, comme les numéros sans frais 1-800, la sélection automatique d'informations, sont apparues depuis quelques années. On prend pour acquis que tout le monde sait s'en servir. |
9. Collaborer avec les parents analphabètesLa Centrale de l'enseignement du Québec et les autres organismes représentant le personnel scolaire devraient sensibiliser leurs membres à l'importance du travail conjoint avec les parents et les outiller en ce sens. Les commissions scolaires pourraient mettre sur pied des programmes permettant aux parents de développer leur confiance en soi et leur capacité d'aider leur enfant. |
10. Culture des intervenantsLes intervenantes et les intervenants appartiennent souvent à des classes sociales différentes de la clientèle à qui ils s'adressent. Ils peuvent avoir de la difficulté à parler ou à écrire dans un langage accessible, à donner des exemples du quotidien, etc. |
10. Repenser les moyens de communicationL'ensemble des secteurs de la société devraient réévaluer l'importance accordée à l'écrit dans leurs communications publiques ou dans leurs rapports avec leur clientèle. Il faudrait privilégier les communications en langage de tous les jours, avec le recours régulier aux moyens audiovisuels. Les imprimés devraient être agréables à lire, rédigés et mis en page dans le but d'être compris par les personnes peu scolarisées. |
11. Prédominance de l'écritL'écrit est utilisé de façon presque exclusive par un bon nombre d'organismes, dans leurs communications avec leurs membres ou avec leur clientèle. |
11. Collaboration entre les différents secteursLes organismes publics de services devraient se référer de façon plus régulière aux groupes populaires et communautaires pour transmettre de l'information aux adultes analphabètes. |
12. Coûts des modes de communicationL'écrit constitue encore la façon de communiquer à distance la plus économique. La production audiovisuelle exige un appareillage plus sophistiqué. |
12. Rendre les médias écrits plus accessiblesLes directions des médias, quotidiens, journaux communautaires, bulletins syndicaux, devraient réserver une ou des pages à des articles s'a dressant à des lectrices et lecteurs débutants. On pourrait même créer un journal s'adressant spécifiquement aux adultes qui commencent à lire. |
13. Utilisation d'un langage spécialiséChaque domaine d'intervention sociale développe son vocabulaire. Certains mots ne veulent pas dire la même chose d'un domaine à l'autre. Plusieurs documents sont rédigés en des termes spécialisés. Les rédactrices et les rédacteurs doivent dire beaucoup de choses en peu de mots. Dans certains groupes, on utilise un langage complexe et recherché pour être pris au sérieux. |
Débat Droit à l'information. Marie Leahey, secrétaire d'atelier. |
14. Rythme de l'informationLes journalistes disposent de quelques heures seulement pour rédiger un article. Les médias électroniques diffusent de l'information en capsules de quelques secondes. On manque souvent de temps pour vulgariser l'information. |
13. Former les intervenantsLes responsables du perfectionnement du personnel devraient mettre à la disposition des intervenantes et intervenants sociaux, salariés et bénévoles, une formation sur la réalité des personnes analphabètes et les moyens pratiques de répondre à leurs besoins.
|
15. Choix des nouvellesLes médias choisissent souvent des nouvelles en fonction d'un parti-pris sensationnaliste. On ne privilégie pas des nouvelles susceptibles d'aider les gens dans leur vie quotidienne. On ne parlera pas de la réforme d'une loi si elle n'a pas fait l'objet de contestation. Les médias ne veulent pas être accusés de travaillerpour le gouvernement. |
14. Adopter une politique de plein emploiLe gouvernement québécois devrait adopter une politique de plein emploi qui tienne compte des besoins particuliers des adultes analphabètes. |
16. Surabondance de dépliantsLa quantité de dépliants et d'annonces de toutes sortes rend difficile la sélection de l'information utile. |
15. Revoir les exigencesLes employeurs, en collaboration avec les organismes représentant les travailleuses et les travailleurs, devraient réviser les exigences scolaires d'accès aux emplois en tenant compte des acquis fonctionnels des individus. |
17. Complexité des démarchesLes règles à suivre pour obtenir un service sont souvent complexes. Les gens doivent souvent s'adresser à plusieurs personnes avant d'arriver à celle qui pourra leur fournir l'information désirée. |
16. Développer la reconnaissance des compétencesLes organismes responsables de l'attestation de compétences (ex. : Commission de formation professionnelle) devraient annoncer leurs services auprès des personnes analphabètes et répondre aux besoins particuliers de cette clientèle. |
18. Appellation des servicesLa dénomination sociale de nombreux organismes ne rend pas compte des services qu'ils offrent. Les mots utilisés sont difficiles ou abstraits. |
17. Développer des programmes d'intégration à l'emploiLe gouvernement québécois devrait encourager des organismes du milieu à mettre sur pied des programmes d'intégration à l'emploi pour les personnes analphabètes. Ces personnes pourraient y poursuivre une démarche d'alphabétisation et d'orientation professionnelle ainsi que des stages en entreprise. |
19. Formulaires comme porte d'entréePour obtenir un service, il faut la plupart du temps faire une demande écrite. Les formulaires sont souvent difficiles à comprendre. |
18. Développer des programmes d'accès à l'égalitéLe gouvernement devrait instaurer un programme d'accès à l'égalité pour les personnes analphabètes : identifier des postes où la lecture, l'écriture ou le calcul ne sont pas nécessaires, inciter les entreprises à embaucher des personnes analphabètes à ces postes. Il faudrait assortir le programme de mesures incitatives à l'alphabétisation. |
20. Plaintes écritesLa plupart des organismes exigent qu'une plainte soit écrite pour être étudiée. |
19. Développer la concertation avec les personnes analphabètesLes partenaires impliqués dans les dossiers du travail devraient inviter les personnes analphabètes à participer à la recherche de solutions. La formation d'une association représentative des personnes analphabètes devrait être encouragée. |
21. Politiques d'accueil et contraintes administrativesLes utilisatrices et utilisateurs de services sont considérés comme des numéros, des statistiques administratives. Les personnes occupant des postes d'accueil sont soumises à des exigences de rendement et ont peu accès à des programmes de formation. |
20. Mettre en place des mesures de congé-éducationLes organismes impliqués dans le monde du travail devraient développer des mesures de congé-éducation, permettant aux gens de continuer à percevoir leur salaire tout en s'alphabétisant. |
22. Tout passe par l'écritL'accès à l'emploi passe par l'écrit : les offres d'emploi sont écrites, on doit adresser les demandes d'emploi par écrit. Le curriculum vitae a l'avantage de se préparer à l'avance contrairement aux formulaires qu'il faut remplir sur place. Mais il est rare qu'il soit accepté quand il s'agit de postes que pourraient exercer les personnes moins scolarisées. |
21. Favoriser l'alphabétisation en milieu de travailL'ensemble des partenaires devraient faire en sorte que les ressources en formation professionnelle (ex. : crédits d'impôt aux entreprises) puissent être utilisées pour de l'alphabétisation en milieu de travail. Les conventions collectives devraient prévoir des mesures favorisant l'alphabétisation. |
23. Taux de chômageLe fort taux de chômage incite les employeurs à exiger des diplômes même si ceux-ci ont peu de rapport direct avec l'emploi et ce, pour éliminer des candidatures.
|
22. Aider les gens à s'alphabétiserII faudrait que tous les centres Travail-Québec reconnaissent aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale, qui s'alphabétisent dans les groupes populaires, le droit de bénéficier des mêmes mesures de soutien que celles qui s'alphabétisent dans les commissions scolaires. Les personnes en chômage devraient pouvoir suivre une formation en alphabétisation sans être pénalisées. |
24. Exigences de diplômesEn 1990, il n'existe presque plus d'emploi pour lequel on n'exige pas un Secondaire V. Pour avoir accès à la formation professionnelle, il faut souvent avoir un diplôme de Secondaire III, IV ou V. |
23. Investir directement en alphabétisationLes gouvernements devraient dégager des sommes pour le financement des groupes populaires et des programmes de formation de base dans les commissions scolaires. Ils devraient également encourager l'alphabétisation en milieu de travail. Il faudrait prévoir pour les adultes qui s'alphabétisent un soutien financier direct (ex. : gardiennage, aide au transport). |
25. Changement d'exigencesJusqu'à maintenant, plusieurs types d'emploi exigeaient de la force et de l'endurance physique. La connaissance de l'écriture n'était pas valorisée. Aujourd'hui, avec les changements technologiques, les exigences changent sans qu'on donne le temps aux individus de se former.
|
24. Adopter une politique gouvernementale en alphabétisationLe gouvernement du Québec devrait adopter une politique d'ensemble sur l'alphabétisation, assortie de mesures financières de soutien. |
26. Nouvelles technologiesPresque toutes les nouvelles technologies sont basées sur l'utilisation de codes écrits et marginalisent les personnes analphabètes. |
25. Favoriser la concertation entre les intervenantes et les intervenants en alphabétisationLes organismes d'alphabétisation, les commissions scolaires et les groupes populaires devraient assurer une coordination de leurs actions et favoriser les échanges et la collaboration. |
27. Renvoi d'employés analphabètesLes gens craignent de perdre leur emploi s'ils admettent qu'ils ont des difficultés à lire, écrire ou calculer. Il arrive que des employeurs qui découvrent qu'un employé ne sait pas lire ou écrire, surtout s'il n'est pas syndiqué, utilisent ce motif pour justifier un licenciement. |
Des pratiques qui favorisent déjà l'exercice des droits des personnes analphabètes
Des activités ont été mises sur pied en collaboration avec la Commission scolaire régionale de Chambly. Quarante et un employés ayant en moyenne 15 années d'ancienneté se sont inscrits, sur une base volontaire, àune formation d'appoint en français et en mathématiques. La formation s'est déroulée sur les lieux de travail selon des horaires adaptés au roulement du personnel en place.
|
28. Autres responsabilitésS'alphabétiser tout en assumant ses autres responsabilités (ex. : travail, famille) n'est pas chose facile. Ces activités peuvent avoir pour effet d'allonger la durée de la démarche d'alphabétisation. |
|
29. Pressions de l'entourageEntreprendre une démarche d'alphabétisation, c'est avouer qu'on a des difficultés alors qu'on pouvait souvent s'arranger pour qu'elles passent inaperçues. La réaction de la famille, celle des collègues de travail ou de l'employeur créent souvent des pressions supplémentaires. |
|
30. Choix du lieu d'alphabétisationPlusieurs bureaux des centres Travail-Québec ne reconnaissent pas aux adultes bénéficiaires d'aide sociale la possibilité de recevoir l'aide financière additionnelle s'ils s'alphabétisent dans des groupes populaires. Dans plusieurs régions encore, seuls les cours des commissions scolaires sont reconnus. |
|
31. Une vision limitée des lieux d'apprentissageLa société survalorise les acquis scolaires au détriment des apprentissages réalisés ailleurs qu'à l'école. Elle ne reconnaît pas le rôle que peuvent jouer des milieux non scolaires, comme les médias, dans les apprentissages en lecture et en écriture. |
|
32. Conditions difficilesLe nombre d'adultes est souvent trop élevé dans les classes d'alphabétisation des commissions scolaires. Des coupures de financement ont entraîné une diminution des services de support et d'encadrement des adultes. Ceux-ci doivent terminer leur démarche d'alphabétisation dans une limite de 2 000 heures.
|
|
33. Financement de l'alphabétisation populaireLe sous-financement de l'alphabétisation populaire oblige des groupes à diminuer leurs services. |
4. Conférences
Un phénomène abstrait pour les journalistes
Trois premières conférences ont été prononcées par Claire Bonenfant, Anne-Marie Dussault et Michel Tremblay, au moment de la soirée d'ouverture. Une autre conférence, donnée par une intervenante en alphabétisation, Marjorie Villefranche, a eu lieu le samedi midi.
Une image vaut mille mots, c'est devenu un cliché. Faites le test avec dix personnes, mettez l'image à la télévision et coupez le son. Demandez aux gens de vous raconter ce qu'ils ont compris. Vous allez avoir dix histoires différentes. Même si on est à la télévision, il faut des mots. Il faut des mots compréhensibles, qui soient accessibles, qui soient dans une langue simple, dépouillée. Je ne suis pas sûre que, comme journalistes, on prenne le temps de parler la langue qui est comprise par la population.
Les politiques d'apartheid séparent des sociétés à partir de la couleur des personnes. Nous, on a des grands pans de notre société qui sont séparés parce que des gens ne savent pas lire et écrire, et je trouve ça dramatique.
Ce n 'est pas en éliminant l'écrit pour informer le public qu'on va nécessairement évoluer.
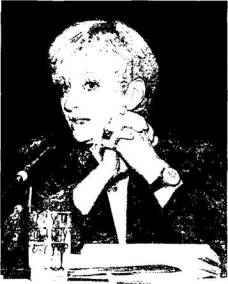
Anne-Marie Dussault est animatrice et journaliste à l'émission Le Point de la télévision de Radio-Canada. Elle s'est fait connaître comme journaliste d'enquête par l'émission Contrechamp à Québec.
Les artisans de l'information sont peu sensibilisés au problème de l'analphabétisme au Québec », affirme Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice à Radio-Canada. Ainsi, sur la trentaine de collègues à qui elle a posé la question, seuls quelques-uns se souvenaient que 1990 était l'Année internationale de l'alphabétisation!
L'animatrice du Point a avoué s'être peu intéressée au phénomène de l'analphabétisme au Québec... jusqu'au moment où elle a été invitée au forum. Elle a alors entrepris une courte recherche au centre de documentation de Radio-Canada. Cette recherche lui a fait découvrir que seulement 100 minutes, radio et télévision, avaient été diffusées sur le thème de l'analphabétisme et de l'alphabétisation à Radio-Canada depuis les cinq dernières années ! La nouvelle qui a suscité le plus grand nombre de reportages est... l'annonce de l'Année internationale de l'alphabétisation !
Selon Anne-Marie Dussault, le phénomène de l'analphabétisme reste très abstrait pour les journalistes. La façon de rendre l'information accessible aux personnes analphabètes est une préoccupation totalement absente, tout simplement parce qu'on ne pense pas que des milliers de personnes au Québec ont des difficultés à lire, écrire ou compter.
La journaliste a présenté certains de ses choix professionnels qui ont pu aider des personnes moins scolarisées à suivre ses reportages. « À l'émission Contrechamp, je n'utilisais jamais de mots incompréhensibles, des mots de spécialistes. Ce n'est pas le but de l'information de faire une émission par des journalistes pour des journalistes, par des profs d'université pour des profs d'université. »
Selon elle, il est possible de faire de l'information accessible sans tomber pour autant dans l'information spectacle ou l'information sensationnaliste. « Il ne faut pas créer deux classes d'information, où l'information dite sérieuse n'est pas accessible, à cause du langage ou de la façon dont les médias abordent les sujets. Les analphabètes du Québec ont droit de savoir pourquoi George Bush envoie cent milles hommes de troupe (dans le Golfe Persique) et si le Canada va entrer en guerre. »
Anne-Marie Dussault s'est engagée devant les quelque deux cents participantes et participants à ne plus être une inconditionnelle du sous-titrage.
« Si on veut atteindre nos objectifs, on ne peut tolérer qu'un million trois cent mille Québécois n'aient pas accès à ce qui est diffusé à la télévision. »
Alain Mireault, de Montréal, a confirmé l'importance du doublage en information. « J'ai de la misère à lire et à écrire. Mon information, a-t-il dit, je la prends au Point, je la prends à des émissions semblables. Hier soir, c'était sur le nucléaire, il y avait de très bons témoignages sauf qu'un moment donné, c'était écrit en bas. Le commencement était très intéressant... »

Le mouvement des femmes doit appuyer les groupes d'alphabétisation
Donat lisait son missel à l'envers, mademoiselle Adéla ne savait pas compter et elle nous vendait ses poireaux 50 cents et «pour vous ce sera trois pour deux piastres ! »
Dans les années 50, c 'étaient surtout les hommes qui manquaient « d'instruction », comme on disait à l'époque. Les filles, elles, bénéficiaient de la présence des couvents de religieuses. On retirait les garçons de l'école pour aider sur la ferme, pas plus tard qu 'à la 4e ou la 5e année, l'école n'étant pas obligatoire.
Être analphabète pour une femme, c'est être encore plus dépendante, plus isolée, en marge de la vie de son mari, de ses enfants.

Claire Bonenfant a été présidente du Conseil du statut de la femme (CSF) de 1978 à 1984. Elle est aujourd'hui consultante en équité en emploi et vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).
Selon Claire Bonenfant, le mouvement des femmes est aujourd'hui conscient que des milliers de Québécoises ne savent pas suffisamment lire, écrire ou compter pour être autonomes. Ce mouvement doit maintenant appuyer les groupes d'alphabétisation dans leurs revendications auprès du gouvernement.
Mais il doit faire plus, affirme celle qui est aujourd'hui consultante en équité en emploi et viceprésidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ).
La conférencière croit que les groupes de défense des droits, comme la FFQ et les groupes de services, doivent s'interroger sur l'accessibilité de leurs communications. « Peut-être, dit-elle, trouveronsnous là une des raisons qui expliquent les difficultés qu'éprouvent bien des groupes à susciter la mobilisation. »
Les organismes doivent se montrer attentifs aux difficultés rencontrées par une partie importante des personnes qu'ils représentent. « Qui dira les angoisses et souvent les démissions de celles qui ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, devant la lourdeur des procédures? Défense des droits, formulation des plaintes, risquent fort d'être le privilège des mieux nantis de notre système », admet Claire Bonenfant.
Elle rappelle que l'analphabétisme était une réalité encore méconnue au Québec il y a une dizaine d'années. Claire Bonenfant, alors présidente du Conseil du statut de la femme (CSF), ne se souvient pas que cet organisme ait traité du dossier durant les six années qu'a duré son mandat.
Le rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance publié en 1978, contient plus de 300 recommandations adressées au gouvernement, aux intervenantes et intervenants de tous les secteurs de la société. Claire Bonenfant raconte avoir passé au crible ce rapport qu'elle considère comme sa bible. Elle n'y a rien trouvé qui touche les besoins des femmes analphabètes. « Tout était prévu pour les femmes et les jeunes filles, depuis le doctorat jusqu'aux métiers non traditionnels. Mais on ne s'est pas préoccupé de savoir si elles savaient lire, écrire et compter... »
Pourtant, l'analphabétisme des femmes existait à cette époque de notre histoire, comme il existe toujours. Claire Bonenfant admet que jusqu'en 1983, la dernière année de son mandat à la présidence du CSF, l'analphabétisme était considéré comme un problème propre au tiers-monde. « Heureusement, dit-elle, le mouvement communautaire, les groupes populaires nous ont invitées un jour à regarder dans notre propre cour. »
Hommage aux adultes qui apprennent à lire et écrire
L'auteur des célèbres Chroniques du Plateau Mont-Royal ne s'était jamais demandé, avant ce soir du 9 novembre, si ses personnages savaient lire, écrire ou compter ou s'ils maîtrisaient suffisamment ces trois habiletés pour être autonomes. Il n'a pas voulu, non plus, se demander avec le recul si l'un ou l'autre de ses personnages pouvait être analphabète.
Élevé dans une famille où les livres avaient une grande place, Michel Tremblay admet qu'il a été privilégié. «Je ne me suis pas posé la question jusqu'à maintenant, probablement parce que j'ai évolué dans une famille qui avait la curiosité de la lecture, de l'écrit, même si c'étaient des gens qui n'étaient pas allés à l'école. »
L'écrivain a rendu hommage aux adultes qui ont la détermination d'apprendre à lire et à écrire. Son père, croit-il, a lui aussi appris à lire lorsqu'il était jeune adulte. Ce dernier avait dû quitter l'école en 4e année.
Passionné de la langue et de la littérature, il a regretté que des gens fassent le choix de ne pas lire ou écrire. Lorsqu'il avait 18 ans et qu'il étudiait en imprimerie, il se souvient des protestations des trois quarts de la classe contre l'existence des cours de français. « Ces jeunes, a-t-il dit, n'étaient pas intéressés par l'écriture. »
L'auteur des Chroniques du Plateau s'est dit réconforté d'apprendre que son roman La grosse femme d'à côté est enceinte ait suscité, chez des milliers de Québécois, le désir de poursuivre la lecture d'un livre. « Ils n'avaient jamais lu un livre de leur vie. Certains venaient d'apprendre à lire et d'autres qui savaient lire n'avaient jamais eu, jusque là, la curiosité de faire la lecture d'un roman. »
Le joual est né du fait que les femmes voulaient garder le français à la maison et que les hommes, qui étaient obligés de gagner leur vie en anglais dans les industries, ramenaient à la maison des expressions anglaises. La rencontre de l'homme et de la femme, la rencontre de ce que l'homme rapportait à la maison et de ce que la femme voulait garder, c'est-à-dire le français, a donné une langue de tradition orale. Le jouai est une langue orale parce que c'est une langue qui est née, c'est un langage qui est né de la volonté de parler français de gens qui ne savaient ni lire, ni écrire.
Les propos de Michel Tremblay ont provoqué de réactions parmi les gens de la salle. On ne peu pas expliquer l'analphabétisme par une question de choix personnel ou de curiosité, a affïrrné Monique Lortie, de la Commission des droits de la personne.

Michel Tremblay, auteur québécois bien connu, a publié de très nombreuses pièces de théâtre ainsi que plusieurs romans. Il a également écrit pour la télévision et a récemment créé en collaboration l'opéra Nelligan.
L'analphabétisme est un symptôme de la pauvreté
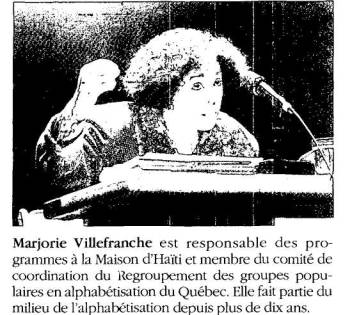
L'analphabétisme, c'est comme une espèce d'héritage que les familles à faibles revenus ont et se repassent, de père en fils », affirme Marjorie Villefranche, conférencière du samedi midi. Selon elle, l'analphabétisme est un symptôme, et non une cause de la pauvreté.
Marjorie Villefranche croit que l'école et la société québécoise dans son ensemble n'ont pu satisfaire les besoins d'une catégorie de citoyennes et de citoyens. « L'école québécoise est conçue pour les classes mieux nanties, affirme-t-elle. Les gens de milieux défavorisés n'ont pas trouvé à l'école ce qui correspond à eux et à ce qu'ils veulent devenir. La société québécoise doit admettre, dans un tout premier temps, qu'il y a des pauvres et qu'ils ne sont pas marginaux. »
Les mesures sociales aujourd'hui en vigueur, tant au fédéral qu'au provincial, sont tellement complexes, ajoute-t-elle, qu'il est difficile, même pour des gens alphabétisés, de savoir comment en bénéficier. De plus, on a toujours l'impression que ces mesures sont prises contre les chômeurs plutôt que contre le chômage, affirme Marjorie Villefranche.
L'analphabétisme : une préoccupation récente
La conférencière rappelle qu'en 1980, lors de la Commission d'étude sur la formation des adultes, la Commission Jean, les groupes populaires ont été les premiers à parler des besoins des personnes analphabètes. « On avait l'impression, à cette époque-là, que même le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires ne faisaient pas de ce dossier une de leurs préoccupations. »
Depuis, explique-t-elle, les entreprises ont commencé à faire des pressions sur le gouvernement afin que des améliorations soient apportées à la formation de la main-d'oeuvre. « Les entreprises exigent des travailleurs de plus en plus instruits. Des travailleurs bien rémunérés, ayant un emploi stable, se rendent compte qu'ils ne répondent plus aux besoins de l'entreprise. Brusquement, ces personnes se découvrent analphabètes. »
Encourager l'autonomie
Selon Marjorie Villefranche, il est difficile dans une société industrialisée comme le Québec d'identifier les adultes qui ont des difficultés importantes en lecture, écriture ou calcul. « Les personnes analphabètes ont toutes sortes de moyens de se faire oublier. Ce qui importe, dit-elle, c'est de modifier nos propres interventions pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible. »
La conférencière croit que les intervenantes et intervenants sociaux ne doivent pas compter sur le fait que plusieurs personnes analphabètes arrivent à contourner certains obstacles reliés à l'écrit (par exemple, le classique «j'ai oublié mes lunettes »). « II faut encourager l'autonomie sociale. C'est une ouverture sur d'autres potentiels. Il faut agir de telle sorte que les personnes analphabètes deviennent, peu à peu, des citoyens conscients des enjeux sociaux et capables d'agir en citoyens responsables », a expliqué la conférencière.
L'intervenante en alphabétisation a invité tous les secteurs de la société, le secteur de l'éducation, les milieux communautaires, les organismes publics et privés de services, les médias, les pouvoirs publics, à intervenir de façon concertée.
Elle a finalement rappelé sa conviction que c'est la responsabilité de l'Etat d'assurer l'éducation de ses citoyennes et de ses citoyens et d'assurer un leadership dans la lutte contre l'analphabétisme. « L'éducation ne doit dans aucun cas être la cible de compressions budgétaires », a-t-elle conclu.
« Lorsqu'un système scolaire réussit avec succès des campagnes d'alphabétisation, c'est parce qu'un projet de société va dans ce sens-là », a soutenu Jean-Claude Tardif, chercheur à la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ). Il a donné l'exemple du Nicaragua qui, en 1981, a fait chuter de façon importante le taux d'analphabétisme de la population.

On compte proportionnellement beaucoup moins de personnes analphabètes chez les 16-35 ans. Mais la situation des jeunes reste dramatique. « Ils ont devant eux toute une expérience professionnelle à acquérir sans diplôme, alors que les personnes de 55 ans ont pu avoir des expériences professionnelles sans diplôme », a affirmé Sylvie Roy, intervenante en alphabétisation.

5. Concours des imprimés accessibles!
Une action concrète : publier des imprimés accessibles
Remise des certificats d'accessibilité
Francine Drouin du CLSC Centre-Sud, Richard Cayer membre du jury et Rosette Côté de la CEQ.

Louise Miller du RGPAQ, Carole Forgues de la CÉCM et Michael McAndrew de l'OPC.

Carole Fuoco de la Commission scolaire Outaouais-Hull, Claude-Sylvie Lemery du quotidien Le Droit et Colette Lacroix de la Magie des lettres.

L'expérience des groupes en alphabétisation montre que les difficultés qu'ont les adultes à comprendre du matériel imprimé d'usage courant ne s'expliquent pas toujours par leurs problèmes en lecture. Le matériel est souvent rédigé et conçu de manière à être compris par des spécialistes en la matière.
Pourtant, si le matériel d'usage courant était plus facile à comprendre, l'ensemble de la population en bénéficierait. Et les adultes en processus d'alphabétisation et ceux qui se sentent plus ou moins à l'aise avec l'écrit seraient encouragés à lire.
Le concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES ! visait à mettre en lumière les efforts réalisés pour rendre accessibles les documents écrits et visuels publiés par les organismes qui s'adressent à la population.
Une vingtaine d'organismes ont participé à ce concours, provenant du milieu communautaire, des médias écrits, des services publics à la population, des syndicats, etc. Les imprimés relatifs à l'annonce de services d'alphabétisation étaient inscrits au concours dans une catégorie hors-compétition.
Dès le lendemain du forum, des organismes comme la Régie du logement, le Protecteur du citoyen, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), préparaient de nouvelles publications en tenant compte des besoins des adultes qui éprouvent des difficultés à lire. L'idée de répéter le concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!, tout en publicisant plus largement son existence, fait déjà son chemin.
Et les gagnants sont :
Dans la catégorie Dépliant :
Un pas de plus, pour votre sécurité, du CLSC Centre-Sud.
Dans la catégorie Guide d'information :
Série de cinq bandes dessinées, de l'Office de la protection du consommateur (OPC) et de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM).
Dans la catégorie Affiche :
Un pas de plus, pour votre sécurité, du CLSC Centre-Sud.
Dans la catégorie Publication régulière :
Page Lire pour dire du quotidien Le Droit.
Note : On trouvera des informations détaillées sur ces productions dans les fiches pratiques 11,13,14,15, 17 et 18.
6. Forum en images
Bernard Vallée, de l'Institut canadien d'éducation des adultes, a animé avec souplesse et chaleur les activités plénières du forum.

Micheline Bouzigon, du Protecteur du citoyen. « Notre organisme est peu connu des gens qui ont le plus besoin de nous. Notre prochaine campagne d'information devra rejoindre les adultes analphabètes. »

« La sensibilisation des milieux doit se poursuivre même si l'Année internationale de l'alphabétisation est terminée. » Mario Guertin du Comité national des jeunes de la CSN.

Céline Landry du quotidien La Presse, animatrice de l'atelier Médias écrits. « Les quotidiens font déjà des pages destinées aux jeunes lectrices et lecteurs. On pourrait faire la même chose pour des adultes lecteurs débutants. »

Vendredi soir, un peu avant 20 heures.
Une dizaine de volontaires s'affairent à la table d'inscription.

Samedi, 17 heures. Les participantes et les participants, les personnes-ressources et les responsables de l'organisation se retrouvent sur la grande place pour le cocktail DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES !

Conférence de presse du dimanche avant-midi. Maryse Perreault du RGPAQ, Nicole Boily de PICÉA et Micheline Jourdain de la CEQ.

Partie 2 : fiches pratiques
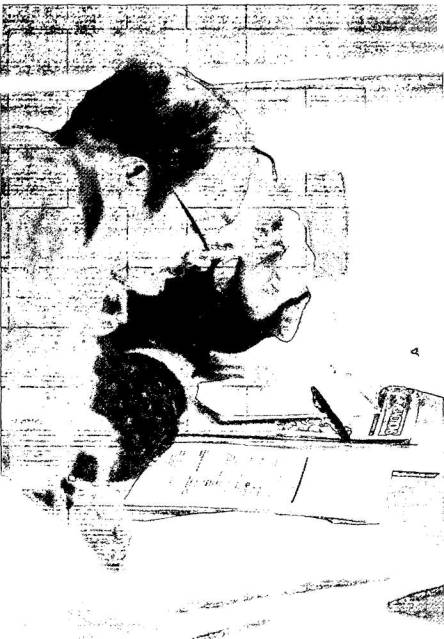
Présentation
L'objectif qui a guidé la création des fiches de cette deuxième partie visait à fournir, à court terme, des outils aux intervenantes et aux intervenants désireux d'agir pour diminuer des obstacles rencontrés par les personnes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer.
Les fiches ont été préparées à l'intention des personnes ayant déjà les connaissances de base dans leur domaine d'intervention. Elles pourront leur servir à titre de perfectionnement, aussi modeste soit-il. Les suggestions pratiques concernent spécifiquement les interventions auprès des adultes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer.
Ces fiches prennent comme point de départ les travaux du concours DES IMPRIMES ACCESSIBLES! et les ateliers pratiques du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES. Ces ateliers se divisaient en trois catégories différentes : ateliers de formation, ateliers d'exploration et ateliers de présentation.
Certains thèmes d'atelier n'ont pas de fiches. L'atelier sur l'utilisation de la vidéo, par exemple, reposait plutôt sur une expérimentation difficile à décrire dans le cadre de cet ouvrage. La Fiche 1, Sensibilisation, a été créée spécialement pour cet outil.
Les sources principales utilisées pour l'élaboration des fiches sont le matériel remis par les personnesressources et les notes des secrétaires des ateliers pratiques du dimanche. Les travaux du jury ont été très utiles à l'élaboration des fiches du Bloc 4 Communications écrites. Le vécu du forum, les échanges entre des intervenantes et des intervenants et des personnes en démarche d'alphabétisation ont également été utilisés.
Certaines fiches ont nécessité une recherche complémentaire aux échanges du forum. Les publications qui ont été consultées figurent à la rubrique POUR EN SAVOIR PLUS.
Mode de présentation des fiches :
SECTEURS-CLÉS
II s'agit du ou des secteurs de la société particulièrement concernés par le contenu de chaque fiche.
DOMAINES D'INTERVENTION
Il s'agit des différents champs professionnels interpellés par le contenu de chaque fiche.
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Une courte présentation situe certains des problèmes rencontrés par les personnes qui ont des difficultés à lire, écrire ou calculer.
VOS OBJECTIFS
Chaque fiche peut contribuer à atteindre des objectifs d'intervention particuliers.
SUGGESTIONS PRATIQUES
Il s'agit d'une série de suggestions parmi lesquelles les intervenantes et les intervenants pourront choisir, en fonction du lieu et du contexte d'intervention.
EXEMPLE
De façon à rendre certaines suggestions plus concrètes, un ou des exemples accompagnent les fiches. Cette rubrique n'apparaît pas sur toutes les fiches.
POUR EN SAVOIR PLUS
Cette rubrique renvoie la lectrice ou le lecteur aux fiches qui complètent la fiche consultée. S'il y a lieu, d'autres documents sont indiqués en référence. Ceux-ci sont disponibles au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), 1265, rue Berri, bureau 340, Montréal, Québec, H2L 4X4. Téléphone : 844-3674. Télécopieur : 844-1598.
Bloc 1 interventions globales
Fiche 1 Sensibilisation
SECTEURS-CLÉS
Tous les secteurs de la société.
DOMAINES D'INTERVENTION
Animation, communication, formation du personnel, gestion, prévention...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Des milliers de Québécoises et de Québécois sont analphabètes. Ces personnes éprouvent, dans leur vie quotidienne, des difficultés à exercer des droits pourtant reconnus à l'ensemble de la population. La sensibilisation du public, amorcée depuis déjà quelques années, n'a pas encore rejoint tous les secteurs d'activités. Il reste beaucoup de travail à faire pour amener tous les milieux à se sentir concernés par l'analphabétisme.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que votre secteur d'intervention soit sensibilisé au phénomène de l'analphabétisme. Vous souhaitez être mieux informé, informée, sur les réalités des personnes qui éprouvent de la difficulté à lire, écrire ou calculer et qui pourraient éventuellement bénéficier de vos services ou occuper un emploi dans votre entreprise.
SUGGESTIONS PRATIQUES"
- Il est recommandé d'organiser une session d'information, destinée aux intervenantes et aux intervenants d'un même milieu. On recommande une durée d'au moins deux heures et demie. Cette rencontre permettra de présenter les principaux aspects de la problématique, de discuter de ses impacts dans la vie des gens et dans le milieu d'intervention.
- On peut utiliser pour ce faire certains vidéos qui présentent les grandes données sur l'analphabétisme. Plusieurs vidéos fournissent aussi des informations sur la démarche d'alphabétisation.
- Les organismes d'alphabétisation sont souvent prêts à venir parler des causes et de l'impact de l'analphabétisme. Dans plusieurs groupes, des adultes en démarche d'alphabétisation acceptent de donner un témoignage.
- Il est également possible de mettre en situation les intervenantes et les intervenants. Il s'agit pour eux de décoder un texte simple à partir d'un alphabet inventé. L'exercice, décrit dans le guide des intervenants de La Jarnigoine, permet de se rappeler qu'apprendre à lire exige du temps. Il permet également de ressentir, quoique de façon beaucoup moins dramatique, l'insécurité vécue par les personnes analphabètes.
Pour en savoir plus voir la Fiche 2
Textes
• ICÉA, CEQ, RGPAQ. Programme détaillé du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES, Institut canadien d'éducation des adultes, Centrale de l'enseignement du Québec, Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Montréal, 1990, 36 p.
Textes de réflexion sur les obstacles à l'exercice des droits.
• JARNIGOINE (LA), Centre d'alphabétisation Villeray. L'analphabétisme : guide des intervenants, Montréal, 1987, 23 p.
Exercice de mise en situation, textes de sensibilisation.
• FOX, Mike, BAKER, Catherine. L'analphabétisme aux États-Unis : discours, recettes et réalité, dans Alpha 90, Recherches en alphabétisation, traduit de l'anglais par Jean-Paul Hautecoeur, Ministère de l'Éducation du Québec, 1990, pp. 85-120.
Pourquoi la société nord-américaine doit agir de façon concertée sans laisser la responsabilité de la lutte contre l'analphabétisme aux seuls adultes analphabètes et organismes d'alphabétisation.
• FTQ. Dossier spécial sur l'alphabétisation et la formation de base des travailleurs et des travailleuses, numéro spécial Le monde Ouvrier, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, février 1991, no 2, 16 p.
Outil dynamique de sensibilisation aux réalités des travailleuses et travailleurs peu scolarisés.
Documents audiovisuels
- RACHED, Tahani. Au chic Resto Pop, Office national du film, 1990, 84 min 48 sec. Disponible à l'ONF en 16mm ou sur vidéocassette. Émouvant témoignage de courage et de détermination d'adultes qui décident de s'alphabétiser.
- VANASSE, André. J'ai prouvé que je suis capable, Comité d'éducation des adultes de la Petite Bourgogne Saint-Henri et André Variasse, 1990, 25 min. Disponible pour achat ou location au Vidéographe, (514)521-2116. Données générales sur l'analphabétisme et témoignages d'adultes en démarche d'alphabétisation.
Ces documents et d'autres sont disponibles au Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF). Ce centre de documentation possède une collection importante d'ouvrages sur l'alphabétisation. CDÉACF, 1265, rue Berri, bureau 340, Montréal, H2L 4X4. (514) 844-3674.
Textes de sensibilisation
Nous reproduisons ici deux courts textes qui peuvent être photocopiés et utilisés comme textes déclencheurs lors d'une rencontre de sensibilisation. Ces textes sont tirés du programme détaillé du Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES, pages 6 et 7.
Répartition : selon quatre niveaux d'aptitude
La répartition selon quatre niveaux d'aptitude en lecture et en écriture conçue pour l'enquête de Statistique Canada donne des indications concrètes sur les capacités de lecture dans les deux langues officielles.
NIVEAU 1
Adultes qui déclarent être incapables de lire. On parle dans ce cas d'analphabètes de base.
Québec 6 %
Canada 7 %
NIVEAU 2
Adultes capables de repérer un mot familier dans un texte simple. Ces adultes déclarent généralement avoir de la difficulté à comprendre le matériel de lecture courante. Il s'agit là d'une portion des analphabètes fonctionnels.
Québec 13 %
Canada 9 %
NIVEAU 3
Adultes capables d'utiliser du matériel écrit à la condition que ce matériel soit clair et que les tâches à accomplir soient simples. En général, ces adultes disent ne pas éprouver de difficulté à lire mais ils ont tendance à éviter les situations où ils doivent lire.
Ils constituent une autre partie des analphabètes fonctionnels.
Québec 25 %
Canada 22 %
NIVEAU 4
Adultes capables de satisfaire aux exigences de lecture courante et de faire preuve de beaucoup de polyvalence dans leurs capacités de lecture. Ce sont là des personnes dites alphabétisées .
Québec 57 %
Canada 62 %
Tiré de STATISTIQUE CANADA. Enquête sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement, faits saillants des données provisoires, 30 mai 1990.
Il est possible d'imaginer des dizaines de situations qui permettent de comprendre pourquoi l'analphabétisme existe. Par exemple, une personne analphabète peut être :
Une personne qui était déjà adulte quand l'école primaire et secondaire est devenue accessible aux enfants québécois de tous les milieux (selon les résultats de l'enquête Southam News, 47 % des personnes du Québec âgées de 55 ans et plus seraient considérées analphabètes de base ou fonctionnels).
Une jeune, issue d'un milieu où des conditions de vie difficiles se concilient mal avec les études (il y a au moins 315 000 enfants vivant sous le seuil de la pauvreté au Québec).
Un travailleur qui a pu fonctionner jusqu'à maintenant et gagner très bien sa vie souvent en perdant ce qu'il avait appris à l'école parce que son travail n'impliquait aucun recours à l'écriture et qui se retrouve aujourd'hui face à des exigences croissantes suite aux changements technologiques.
Une personne immigrante, en provenance d'un pays où l'absence de réseau scolaire ne lui a pas permis de s'alphabétiser dans sa langue maternelle (il n'existe malheureusement aucune étude concernant le taux d'analphabétisme dans la langue maternelle chez les allophones du Québec).
Une personne qui a une ou plusieurs déficiences (physiques ou intellectuelles) et qui a été victime d'exclusion parce que jugée sommairement non-scolarisable ou non-intégrable (la loi 107, adoptée en 1988, reconnaît pour la première fois à tous les enfants handicapés le droit d'être scolarisés).
Une personne vivant en milieu rural qui a quitté l'école très tôt parce que le travail qui l'attendait n'exigeait pas de longues études (on estime que 27 % des personnes analphabètes vivent dans de petites agglomérations dont une bonne partie en milieu rural).
Une femme qui vit ce que vivent des milliers de femmes au Québec (monoparentalité, pauvreté, problèmes de garderie, isolement, etc.) et pour qui les possibilités de s'alphabétiser sont très réduites.
Un autochtone confronté à la société industrialisée et à la dévalorisation de la culture orale et des modes d'organisation des nations autochtones (l'école des blancs a longtemps été imposée comme un mécanisme d'assimilation) .
Une personne assistée sociale, vivant dans un grand centre urbain en transformation constante (28 % des adultes analphabètes canadiens proviennent des trois grandes villes : Toronto, Vancouver et Montréal).
Fiche 2 Plan d'action
SECTEURS-CLÉS
Tous les secteurs de la société.
DOMAINES D'INTERVENTION
Administration, action politique, communication, gestion, planification, ressources humaines...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Avec le développement de la technologie, les systèmes de communication et de production se complexifient. Des changements rapides s'imposent dans différents milieux et tout se déroule comme si tout le monde savait lire et écrire. Les personnes ayant des difficultés en lecture, en écriture ou en calcul sont constamment placées dans une situation difficile. Elles n'ont pas, par exemple, accès à l'information ; elles sont les premières menacées de perte d'emploi et n'ont pas accès à des services de base.
VOS OBJECTIFS
Vous désirez mener des actions concrètes dans votre milieu pour encourager les adultes à s'alphabétiser. Vous voulez vous assurer que les personnes éprouvant des difficultés à lire, écrire ou calculeraient accès à l'information et puissent exercer leurs droits.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Un plan d'action efficace met à contribution des partenaires représentant les ressources humaines, les services à la clientèle, les syndicats ainsi que les groupes de bénéficiaires.
- Un plan d'action en alphabétisation s'élabore selon les méthodes habituelles de résolution de problèmes et de planification.
- Un plan d'action en alphabétisation encourage les gens à s'alphabétiser, sans toutefois les contraindre à le faire. Certaines actions leur ouvrent l'accès à des ressources en éducation (commissions scolaires ou groupes populaires). D'autres contribuent à créer un environnement favorable où les adultes peuvent développer, peu à peu, des habiletés en lecture, écriture ou calcul.
Étape préliminaire
- Pour faciliter le travail d'identification des faits, il est intéressant d'organiser une première rencontre de sensibilisation générale à l'analphabétisme et à l'alphabétisation.
- Les intervenantes et les intervenants en alphabétisation, dans les groupes populaires ou les commissions scolaires, peuvent collaborer avec l'organisation qui désire élaborer un plan d'action.
Première étape Analyse de la situation
- Au moment d'identifier la clientèle touchée par la situation, on doit d'abord évaluer :
- quel niveau de difficultés peuvent rencontrer les personnes analphabètes ;
- dans quelles circonstances elles font face à ces difficultés ;
- quels sont les besoins particuliers de ces personnes.
- accès à l'information pour la clientèle qui utilise les services ;
- accès à l'information pour le personnel analphabète (de base ou fonctionnel) ;
- exécution de tâches par le personnel analphabète, incluant les tâches demandées au moment de l'analyse de la situation et, s'il y a lieu, celles prévues dans une réorganisation du travail.
Deuxième étape Planification
- On doit préciser les moyens que l'on veut prendre pour aider les adultes ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul. Si une des solutions envisagées consiste, par exemple, à référer son personnel à des groupes d'alphabétisation, il faut prévoir des mesures actives d'encouragement (ex. : libération sur le temps de travail, allocation de déplacement, ententes écrites avec garanties de non-licenciement).
- Les actions planifiées doivent être consignées dans un document de travail. La description des actions, le budget à prévoir, le service responsable sont quelques-unes des données essentielles à noter.
- Plusieurs actions peuvent être menées dans le cadre du budget courant de l'organisation. Par exemple, si le budget prévoit déjà la production d'un dépliant, il n'en coûtera pas plus cher de publier un dépliant accessible.
Troisième étape Mise en oeuvre
- Si ce n'est déjà fait, on doit s'assurer de l'implication de toutes les personnes qui peuvent contribuer au plan d'action. Un plan d'action en alphabétisation ne peut reposer sur une seule personne.
- L'interaction entre responsables de services différents peut encourager l'engagement des uns et des autres face au projet.
- Il est recommandé de faire connaître les actions en cours au sein de l'organisme et de susciter l'intérêt autour de ce projet.
Quatrième étape Évaluation
- Les mécanismes prévus pour évaluer dans quelle mesure les résultats ont été atteints doivent permettre de recueillir les commentaires de l'ensemble des partenaires impliqués. On devrait inviter les personnes analphabètes à participer à l'évaluation. Pour assurer cette participation, le mécanisme d'évaluation choisi doit être accessible.
- Il est recommandé d'informer chaque partenaire du plan d'action, des résultats obtenus par un autre secteur (ex. : publication d'un dépliant accessible, début du projet-pilote en alphabétisation en milieu de travail et nombre de travailleuses et de travailleurs inscrits). Cette information s'avère généralement stimulante.
POUR EN SAVOIR PLUS
Selon le type d'activités de l'organisation, toutes les autres fiches peuvent être utiles.
Textes
- CENTRAIDE. Intervenir en para-alphabétisation, Centraide Montréal, 1990. Pochette d'information à l'intention des organismes bénévoles et communautaires qui veulent soutenir les personnes analphabètes faisant partie de leur clientèle.
- DIVISION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE LA QUALITÉ DE SERVICE, Magali Brunei. Année internationale de l'alphabétisation 1990, Propositions d'interventions municipales, Ville de Montréal, juin 1990, 33 p.
EXEMPLE
Voici quelques-unes des interventions en cours à la Ville de Montréal. Ces actions ont été planifiées par un groupe de travail où huit services étaient représentés. La coordination du dossier est assumée par la Division du développement communautaire et de la qualité de service.
1. La Ville en tant qu'employeur
Projet-pilote de formation directe
Collaborations : Syndicat représentant les travailleuses et les travailleurs des services visés ; Centre de ressources en éducation populaire (CRÉP), centre d'alphabétisation de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM).
Les trois étapes du projet :
- Analyse des besoins.
- Session de formation de 45 heures. Les cours sont dispensés par le CRÉP à raison de deux heures par semaine durant les heures de travail. Vingt-huit employés de trois services différents participent actuellement à cette formation.
- Faciliter, par la suite, les démarches des individus qui voudront poursuivre leur cheminement en alphabétisation.
Sessions de sensibilisation pour les employés de première ligne
Le Service des Affaires corporatives offre à tous les employés qui sont en contact direct avec le public des sessions de sensibilisation aux difficultés que rencontrent les personnes analphabètes.
2. En tant qu'entreprise de services publics et agent de concertation
Les bureaux Accès Montréal
Le service téléphonique et le service au comptoir des bureaux Accès Montréal permettent un accès direct à l'information. La Ville veut également éviter que ses communications reposent trop exclusivement sur l'écrit.
Constitution d'une collection d'ouvrages
La Bibliothèque municipale constitue actuellement une collection d'ouvrages spécialement adaptés pour lectrices et lecteurs apprenants. Cette collection comportait, au printemps 1991, 700 titres. Les ouvrages ont été analysés et classifiés en fonction des besoins du public-cible (apprenantes, apprenants, formatrices et formateurs en alphabétisation). La collection pourra être consultée1 dans cinq succursales de la Bibliothèque. La bibliographie sera mise à la disposition de l'ensemble des bibliothèques scolaires et publiques du Québec et du Canada.
3. En tant que gouvernement municipal
Préparation de versions simplifiées de règlements et codes
La Ville prévoit, à long terme, produire des versions simplifiées de documents techniques. Par exemple, le Service de l'habitation et du développement urbain prépare actuellement une version simplifiée du Code du logement.
Fiche 3 : Campagne d'information
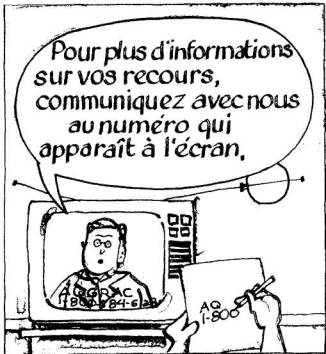
Une semaine plus tard.
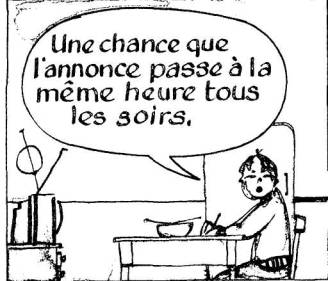
Lorsqu'on donne un numéro de téléphone ou un nom d'organisme par écrit à la télévision, on doit les laisser à l'écran pendant plusieurs secondes. On doit aussi les donner verbalement.
SECTEUR-CLÉ
Communication.
DOMAINES D'INTERVENTION
Créativité, information, marketing, planification, radio, rédaction, télévision...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Du groupe populaire désireux d'informer les gens du quartier jusqu'au ministère de la Santé et des Services sociaux qui mène une campagne de sensibilisation, un nombre croissant d'organismes utilisent les campagnes d'information pour rejoindre un public large. Ce grand public se compose de personnes scolarisées et d'autres qui le sont beaucoup moins. Dans bien des cas, les campagnes sont conçues pour rejoindre les premières, délaissant ainsi les personnes analphabètes. Celles-ci peuvent alors rester à l'écart d'une information qui aurait pu améliorer leurs conditions de vie.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez sensibiliser toutes les couches de la population à un problème social d'importance, à un service. Vous souhaitez que les personnes ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul puissent comprendre votre message.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Pour rejoindre les personnes analphabètes, dans le cadre d'une campagne destinée à un large public, il est nécessaire d'utiliser plusieurs sources de communication de masse (ex. •. radio, télévision, affiches publiques) et ne pas se limiter aux médias écrits.
- Il est également recommandé de prévoir des activités de communication personnalisée (ex. : kiosques dans des lieux publics, participation à une rencontre d'un groupe populaire).
- Le message s'adresse à des adultes. Il faut éviter de le rendre enfantin sous prétexte de le rendre compréhensible. Ce message doit être concret et se rapporter à des situations quotidiennes.
- À la radio ou à la télévision, on doit adopter un débit de parole posé. Il faut éviter le jargon spécialisé, les acronymes, les sigles, les statistiques. Il est préférable d'employer les mots de la vie de tous les jours, que l'on participe, à titre d'invité, à une émission d'information ou que l'on diffuse un message publicitaire informatif à partir d'un exposé ou sous forme de courtes histoires.
- À la télévision, on doit éviter de présenter du texte à l'écran, sauf s'il s'agit de fournir un numéro de téléphone. Dans ce cas, le numéro doit demeurer à l'écran pendant plusieurs secondes, afin que les personnes ayant des difficultés à lire et à écrire aient le temps de le noter. Le numéro doit être aussi donné verbalement.
- Selon le message et le public-cible, on peut utiliser le théâtre, la production de vidéos, les concours, les messages téléphoniques, etc. Il faut toujours se demander si des personnes ayant des difficultés à lire, écrire ou calculer peuvent facilement comprendre le message.
- On ne doit pas hésiter à faire appel à des organismes d'alphabétisation pour valider le matériel d'une campagne d'information.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir les Fiches 5, 6, 9 et tout le Bloc 4
EXEMPLE
Une campagne qui voulait rejoindre les personnes analphabètes
Cossette Communication-Marketing, bureau de Québec, s'est vu confier le mandat, en mai 1989, de la campagne de promotion d'un numéro sans frais 1-800, permettant d'obtenir les informations sur les services d'alphabétisation disponibles dans chaque région du Québec.
L'opération a été menée pour le compte de la Fondation québécoise de l'alphabétisation. Bell Canada a accepté d'être partenaire de cette campagne, dont le plan de communication prévoyait un coût approximatif de 400 000 $. Bell Canada a participé à la démarche de création et à diverses opérations de relations publiques.
La campagne de la Fondation a été conçue pour rejoindre à la fois le public en général et les personnes analphabètes. Elle comportait trois volets : l'imprimé, la radio et la télévision. La campagne écrite a duré de la mi-mai à la miseptembre (1990). On s'est associé aux quotidiens Québécor pour ce volet.
La campagne radio-télévision s'est déroulée du mois d'août à décembre. Les messages radiophoniques ont été diffusés sur le réseau Télémédia. À la télévision, on a pu conclure des ententes pour obtenir, avec le réseau TVA, deux diffusions gratuites pour une diffusion payée. Les messages ont été diffusés à des heures de grande écoute de juillet à décembre.
Compte tenu de son budget limité, la campagne n'a pas de volet évaluation et on ne connaît pas le profil de la clientèle rejointe ni le rapport coût et résultat. Toutefois, le nombre des appels est passé de 80 en mai à 500 au mois d'octobre.
Fiche 4 : Information aux personnes immigrantes
SECTEURS-CLES
Santé, services sociaux et éducation.
DOMAINES D'INTERVENTION
Aide sociale, communication, information, soins de santé...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les personnes immigrantes analphabètes, les personnes immigrantes alphabétisées dans une autre langue que le français ou l'anglais, n'ont pas accès à l'information utile à leur intégration dans la société québécoise. Cette information n'est souvent disponible que par écrit ou encore elle suppose des connaissances préalables sur l'organisation des services, par exemple.
VOS OBJECTIFS
Vous êtes consciente, conscient des nombreux changements vécus par les personnes immigrantes et voulez leur éviter des obstacles supplémentaires. Vous souhaitez que l'information que vous avez à leur transmettre soit accessible et utile.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Un climat d'accueil et d'écoute favorisera la compréhension de l'information. On doit saisir toutes les occasions pour établir une relation chaleureuse.
- Il est souhaitable de ne pas attendre les situations de crise pour établir le contact avec les personnes immigrantes. Il est préférable de susciter des rencontres par le biais d'activités courantes. Ce contexte sera plus approprié pour se sensibiliser à d'autres habitudes culturelles.
- La communication en français représente une grande difficulté pour plusieurs personnes immigrantes. Les intervenantes et les intervenants doivent s'assurer de bien décoder la requête qui leur est adressée. Elles doivent s'assurer d'avoir bien compris la demande.
- Les activités de francisation au Québec, les services d'alphabétisation dans certains pays, sont souvent plus accessibles aux hommes. Dans un couple, il arrive donc souvent que le conjoint masculin ait une meilleure connaissance de la langue écrite et parlée. Les femmes immigrantes ne peuvent souvent pas recourir aux informations écrites sur les ressources et services existants. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'elles connaissent le rôle des organismes sociaux, l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur leur vie, les moyens d'entrer en contact avec eux, etc.
- Les enfants peuvent jouer un rôle de relais d'information. Il ne faut toutefois pas oublier que cela peut influencer la dynamique familiale. Il faut chercher à ce que les femmes puissent acquérir leur autonomie le plus rapidement possible.
- Plusieurs personnes immigrantes ont dans leur entourage des gens qui les connaissent et peuvent les aider. Les membres de la famille élargie, un pasteur ou une autorité religieuse, des compatriotes d'associations culturelles, peuvent aussi jouer le rôle de relais d'information.
- Les organismes de services à la population doivent s'assurer que leurs informations rejoignent les associations culturelles. On peut en ce sens créer des liens de collaboration de manière à encourager une connaissance mutuelle des services offerts.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir la Fiche 7
Ce document est constitué de trois histoires présentées sous la forme d'un photo-roman. Chaque histoire est suivie d'un texte thématique. L'une des trois femmes dont on raconte l'histoire est analphabète. Centre de ressources de la troisième avenue, 3609, boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2V5. Téléphone : (514) 849-3271.
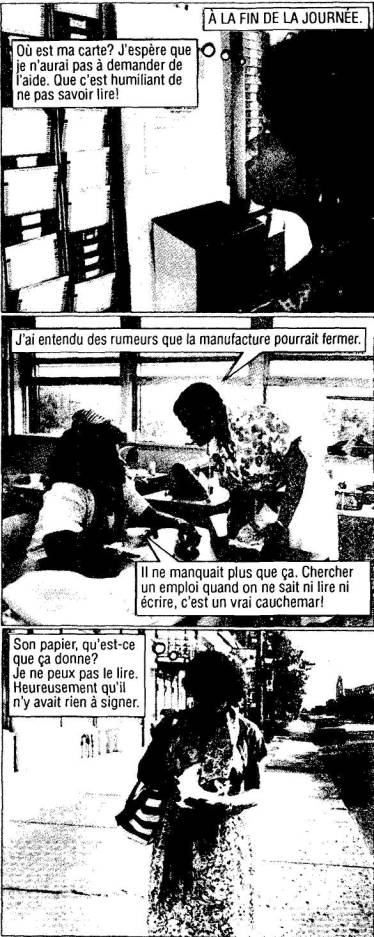
Tous les jours, Marguerite se heurte à de multiples difficultés parce qu'elle ne sait pas lire. Comme beaucoup d'autres femmes, elle n'a pas les moyens de s'alphabétiser tout en assumant ses responsabilités familiales.
Bloc 2 : Communications orales
Fiche 5 : Communication avec la clientèle
|
|

Il est plus facile pour une personne analphabète déparier d'elle-même et de ses besoins immédiats que de formuler sa demande d'aide dans le vocabulaire officiel.
SECTEUR-CLÉ
Service à la clientèle.
DOMAINES D'INTERVENTION
Accueil, aide sociale, droit, référence, travail social...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les communications orales, qu'elles se fassent de personne à personne ou au téléphone, représentent souvent une source de frustrations pour les personnes analphabètes. Le débit de parole, le vocabulaire employé, la complexité des explications données sont quelques-uns des obstacles rencontrés.
VOS OBJECTIFS
Vous avez à répondre et aider les gens au comptoir, dans la confidentialité d'un bureau ou au téléphone. Vous voulez que les gens soient satisfaits de l'information reçue et que celle-ci leur soit utile. Vous êtes responsable de politiques d'accueil et voulez vous assurer que les personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire ou à calculer puissent profiter des services offerts par votre organisme.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Les personnes ayant des difficultés en lecture, en écriture ou en calcul n'ont pas toutes la même attitude face à ce problème. Certaines personnes analphabètes n'éprouvent aucune gêne à parler de leur difficulté; par contre, d'autres préfèrent que cela ne paraisse pas. Il est donc préférable de ne pas demander de but en blanc à une personne si elle sait lire ou écrire.
- Une bonne communication avec des gens ayant des difficultés en lecture, écriture ou calcul exige les mêmes qualités et capacités que toute communication. Il est particulièrement important de faire preuve de courtoisie et de compréhension et d'aborder chaque personne sans préjugé.
- L'accueil et l'information à des personnes analphabètes demandent généralement plus de temps. Les gestionnaires de services doivent en tenir compte.
Informations de base
- Il ne faut pas oublier que certaines personnes éprouvent de la difficulté à noter les informations du genre adresse, numéro de formulaire, montant d'argent auquel elles ont droit. Elles doivent les mémoriser, ce qui prend souvent plus de temps. Cela peut également expliquer qu'une même question soit posée plusieurs fois.
- On peut renseigner les personnes analphabètes en utilisant des repères visuels (ex. : la bâtisse au coin de telle et telle rue, l'enveloppe avec une feuille d'érable).
- Si on remet une brochure ou un dépliant, il est recommandé de proposer aux gens de lire avec eux les parties importantes. Au cours de la lecture, on vérifie leur compréhension du document tout en soulignant, au crayon marqueur, les informations essentielles.
- Plusieurs personnes ayant des difficultés à écrire préfèrent, avec tout le temps voulu et l'aide nécessaire, remplir elles-mêmes leur formulaire ou noter une information. D'autres au contraire souhaitent qu'on le fasse à leur place. Autant que possible, on devrait respecter le choix des individus.
Démarches à expliquer
- Il est recommandé de spécifier si l'information donnée est un conseil ou une obligation à remplir pour obtenir tel service, comme par exemple une aide financière. Plusieurs personnes analphabètes saisissent difficilement les nuances qu'on trouve, par exemple, dans les temps de verbe (« vous devriez faire cela » ou « vous devrez faire ceci »).
- On suggère l'utilisation de matériel audiovisuel pour fournir aux gens des modèles de façons de procéder dans des situations données, ou pour leur permettre de s'outiller avant d'entreprendre une démarche complexe.
- Souvent, les personnes analphabètes éprouvent de la difficulté à formuler des questions pour compléter leur compréhension d'un sujet. Si la personne n'a pas demandé un renseignement qui lui sera précieux, il faut le lui donner.
Compréhension mutuelle
- Quand une relation de confiance a pu s'établir, on peut vérifier si les gens ont bien compris en leur demandant de faire un résumé de ce qu'ils ont retenu.
- Les personnes analphabètes parlent plus spontanément d'elles-mêmes et de leur propre besoin que de la mesure susceptible de les aider et des raisons qui les motivent à y faire appel. Le personnel d'accueil ne doit pas hésiter à poser des questions.
- En évoquant avec la personne des expériences qui lui sont familières, on peut lui expliquer une démarche à entreprendre. Il est conseillé de choisir des mots que la ou le bénéficiaire utilise.
POUR EN SAVOIR PLUS Voir les Fiches 3, 4, 6 et 7
Fiche 6 : Information enregistrée
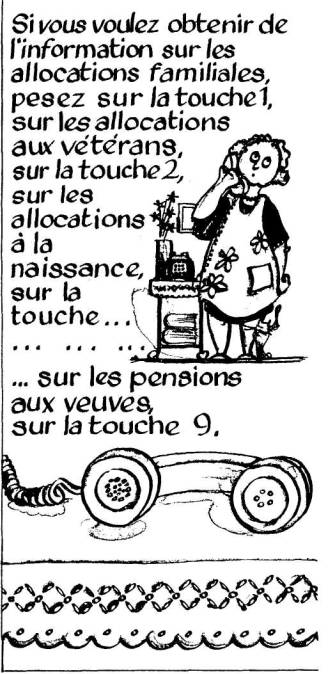
Tous les sujets ne se prêtent pas à l'enregistrement. On doit donner des instructions simples et brèves pour permettre à une personne d'obtenir rapidement une information adaptée à ses besoins. Les messages téléphoniques ne remplacent pas le personnel préposé à l'information.
secteur-clé
Information.
DOMAINES D'INTERVENTION
Accueil-référence, communication, réalisation audio, scénarisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les personnes analphabètes de base ne peuvent lire les dépliants, brochures et autre matériel mis à la disposition de la population par les organismes de services. Pour obtenir de l'information, elles doivent toujours engager une relation directe avec la personne préposée aux renseignements.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que les personnes analphabètes aient accès à l'information en dehors des heures habituelles de bureau. Vous cherchez une façon originale de mettre à leur disposition le contenu de vos publications.
Suggestions pratiques
Sujets
- Plusieurs informations générales se prêtent bien à l'enregistrement. Dans certaines circonstances, les personnes apprécient l'anonymat d'un message enregistré accessible (ex. : information générale sur les maladies transmises sexuellement MTS). Le message peut permettre aux gens de se familiariser avec un sujet avant de se présenter à un service.
- L'enregistrement n'est pas recommandé lorsque l'information varie en fonction de chaque cas précis. Le contact humain constitue alors le meilleur mode de communication.
- Le développement de la technologie permet aujourd'hui d'utiliser, à des fins multiples, les services de répondeurs et de renvois automatiques. Pour qu'une personne analphabète puisse les utiliser, les instructions doivent être brèves et simples. Il faut réduire au maximum les opérations qui exigent de la mémorisation.
- On doit éviter de demander aux gens d'écrire (ex. : remplir un formulaire, noter un numéro de téléphone) pendant que le message leur donne de nouvelles informations.
- Il y a des limites à l'utilisation de la cassette pour des textes de références (ex. : règlement de l'école des enfants). Peu de gens savent utiliser efficacement un magnétophone et faire le repérage pour une consultation rapide sur un sujet. La cassette doit plutôt servir pour une écoute dans une période de temps délimitée.
Préparation du texte
- On peut s'inspirer de certaines pratiques radiophoniques pour concevoir un message enregistré : phrases courtes, une idée par phrase, syntaxe ordonnée, utilisation du présent, du passé composé ou du futur. On doit éviter la lecture d'un texte conçu pour être imprimé.
- Il faut miser sur des mots qui font image plutôt que sur des termes abstraits. On doit retrouver une image forte dans les toutes premières phrases, ainsi qu'à la fin du message.
- L'information la plus importante doit être énoncée au tout début du message. On peut la rappeler à la fin. S'il s'agit d'informer les gens sur une démarche ou un événement, il faut suivre la chronologie.
- Pour rendre l'information vivante et concrète, on peut raconter une histoire. Les auditrices et les auditeurs auront plus de facilité à comprendre l'importance d'une information s'ils s'identifient à un ou plusieurs personnages.
- On peut s'inspirer des règles des scénarios radiophoniques pour créer les personnages et rédiger les dialogues. Par exemple, les personnages doivent être peu nombreux, on doit facilement pouvoir distinguer leur voix, il faut que les répliques soient brèves et le dialogue naturel et spontané.
- La langue utilisée par la narratrice, le narrateur ou les personnages doit être accessible, avec un vocabulaire courant et des structures de phrases simples.
Éléments sonores
- La voix de lecture doit reproduire un ton de conversation naturel. Elle doit être posée. Il est recommandé d'utiliser, sur un même message, une variété de voix (ex. : voix de femmes, d'hommes ou d'enfants).
- La musique peut servir de transition, par exemple entre deux informations ou deux éléments distincts d'une démarche.
POUR EN SAVOIR PLUS Voir les Fiches 3, 5 et 7
BLOC 3 PARTICIPATION
Fiche 7 : Soutien aux parents analphabètes
SECTEUR-CLÉ
Éducation.
DOMAINES D'INTERVENTION
Alphabétisation, administration, animation, information, organisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Plusieurs adultes analphabètes confirment que leurs parents éprouvaient aussi des difficultés à lire et à écrire. Des parents qui ne savent pas lire n'ont pas accès aux informations écrites de l'école et ne peuvent, de ce fait, intervenir en collaboration avec le milieu scolaire. Les parents avant des difficultés à lire, à écrire ou à calculer se sentent souvent dévalorisés lorsqu'ils cherchent à encourager leur enfant dans ses apprentissages scolaires.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que l'école et la famille agissent de concert auprès de l'enfant. Vous désirez encourager les parents analphabètes à jouer un rôle actif auprès de leur enfant. Vous voulez leur redonner confiance en eux-mêmes et en leurs capacités. Vous souhaitez faciliter les apprentissages et le développement personnel et social de l'enfant et des parents.
SUGGESTIONS PRATIQUES
Invitation
- Il est recommandé de rédiger les invitations et tous les autres documents s'adressant à l'ensemble des parents dans un langage simple et accessible. On peut utiliser des repères visuels pour illustrer les convocations (ex. : horloge, calendrier, plan du quartier).
- Les enfants peuvent jouer un rôle de relais de l'information. L'enseignante ou l'enseignant lit par exemple l'invitation en classe en soulignant les choses importantes. Les enfants peuvent encourager leurs parents à venir à l'école.
- Les enfants peuvent composer une invitation chantée à l'école. Avec leurs parents, ils pourront composer une réponse chantée. A l'occasion, il est possible d'utiliser des ballons sur lesquels les enfants écrivent, en classe, l'heure et la date de réunion, ou encore de faire dessiner une carte d'invitation par les enfants.
- Il faut privilégier les moyens de communication offerts par le milieu (ex. : journal local, radio communautaire, babillards dans les lieux de travail, les églises, les commerces).
- On peut organiser une chaîne téléphonique qui rappellera le moment et le lieu de la réunion. On rejoindra ainsi les parents qui n'ont pas pu lire la lettre d'invitation ou qui n'ont pas compris l'importance de la rencontre.
Rencontre
- La première rencontre de l'année doit être particulièrement dynamique. Il faut éviter qu'elle soit trop longue. Le personnel scolaire peut se présenter dans le cadre d'une mise en scène. L'humour est habituellement très apprécié. Dans les autres rencontres avec les parents, il est recommandé de varier les moyens de présenter les sujets.
- L'école peut bâtir une banque de photos et de diapositives, utilisée comme support d'information en classe et dans les rencontres avec les parents. On y retrouvera des photos des enfants et du personnel scolaire en action et des parents qui participent à des activités de l'école.
Circulation de l'information
- Un répondeur téléphonique peut servir en dehors des heures d'école pour renseigner les parents sur les activités de l'école. Les messages téléphoniques peuvent être préparés avec la participation des enfants.
- Le fait de mettre un local à la disposition des parents peut encourager leur sentiment d'appartenance à l'école.
- Durant la période des déménagements, l'école peut encourager les parents qui doivent se trouver un nouveau toit à rester dans le quartier. On affichera par exemple, dans le local des parents, une liste facile à consulter de logements libres dans le quartier.
- En collaboration avec les autres organismes du milieu, l'école peut remettre aux parents une liste, facile d'accès, des services et des ressources des groupes populaires du quartier, de la municipalité ou de la commission scolaire.
Activités de formation
- On peut mettre sur pied, en collaboration avec les services d'éducation des adultes de la commission scolaire, un programme de formation permettant aux parents de s'alphabétiser tout en s'initiant au programme scolaire de leur enfant.
- On peut mettre sur pied, en collaboration avec les services d'éducation aux adultes ou les groupes populaires, des activités permettant aux parents d'identifier et de développer leurs compétences dans le soutien de leur enfant.
- On peut aussi mettre sur pied des activités permettant au personnel scolaire de développer des compétences dans la collaboration avec les parents.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir les Fiches 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 15
- COCHRAN, Moncrieff, DEAN, Christiann. Le rôle de l'administrateur scolaire dans la promotion de la communication entre la famille et l'école, Family Matters Project, traduit et adapté par Sylvie Drapeau et Richard Marcotte, 13 p. Texte général présentant les fondements et la structure de ce programme à l'intention des parents et du personnel scolaire. Le texte n'aborde pas de façon spécifique la participation des parents analphabètes. Il fournit des pistes pour la reconnaissance des compétences de tous les parents.
- FECTEAU, Marie. J'apprends avec mon enfant, projet d'alphabétisation des parents en milieu scolaire, Guide informatif, Centre de ressources en éducation populaire (CRÉP), Commission des écoles catholiques de Montréal, septembre 1989.
CRÉP, 3000, rue Beaubien est, Montréal, Québec, H1Y 1H2. (514)596-4556.
EXEMPLE
J'apprends avec mon enfant, un programme qui aide les parents analphabètes
Ce texte est un résumé du matériel remis par Marie Fecteau de la CECM.
L'approche pédagogique du programme J'apprends avec mon enfant est centrée sur les besoins d'information et d'expression des parents. Cette approche leur permet de répondre à leurs besoins immédiats. La priorité consiste toutefois à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du vécu scolaire de l'enfant.
Le programme s'adresse à des personnes peu scolarisées liées à une ou un élève de l'école de la première à la quatrième année du primaire. Les parents, d'autres membres de la famille, des amis peuvent donc y participer.
Le programme est disponible de jour et de soir et se donne dans les locaux de l'école de l'enfant. Ce programme suppose une collaboration étroite entre le personnel de l'école primaire et le service d'éducation des adultes de la commission scolaire, volet alphabétisation.
Les groupes sont composés d'une dizaine de participantes et participants. Il est plus facile de travailler avec des groupes homogènes, c'est-àdire des parents dont les élèves sont de même niveau scolaire. Le programme peut toutefois être adapté à des groupes hétérogènes. Les groupes seront alors composés de parents maîtrisant le français à l'oral dont les enfants ne sont pas de même niveau. On peut aussi mettre sur pied des groupes où la majorité des parents ne maîtrisent pas ou peu le français à l'oral.
Au cours de l'automne 1990, le programme était utilisé principalement à des fins de francisation (parents allophones). Il semble difficile de recruter des parents francophones analphabètes. Le projet est soutenu par l'Opération renouveau du Conseil de l'île de Montréal. Il existe depuis 1983.
Fiche 8 : Pédagogie de la coopération1
SECTEUR-CLÉ
Éducation.
domaines d'intervention
Alphabétisation, animation, enseignement, organisation communautaire...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Plusieurs adultes analphabètes éprouvent de la difficulté à jouer un rôle social qui les satisfait. Les développements de la technologie et les changements rapides accentuent leurs difficultés à s'intégrer à la société et au marché du travail. Les niveaux de compétence et les besoins très variés des adultes qui s'inscrivent en démarche d'alphabétisation peuvent être source de tensions dans les groupes où toutes et tous sont pressés d'apprendre. De même, les adultes analphabètes qui participent à une formation en cours d'emploi ou à une activité en éducation populaire sont souvent marginalisés à cause de leurs difficultés à lire, à écrire ou à calculer.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez travailler avec des méthodes qui aident les adultes à améliorer leur connaissance de la langue écrite et parlée. Vous désirez que les participantes et les participants ayant des difficultés à lire, à écrire ou calculer puissent développer, en même temps que les autres, leurs connaissances et capacités dans divers domaines. Vous voulez inciter vos participantes et participants à coopérer entre eux.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Dans les méthodes de pédagogie de la coopération on favorise la formation de groupes hétérogènes. Par exemple, les participantes et les participants ont des habiletés, des expériences de vie, des origines culturelles, des âges et des niveaux de scolarité différents.
- La ou le responsable divise son groupe en petites équipes, de trois à six personnes.
- Les membres de l'équipe doivent se sentir solidaires des apprentissages des uns et des autres. Pour structurer cette interdépendance, il faut s'assurer que chaque personne a un rôle à jouer. Une coopération bien structurée empêche que l'une des personnes fasse la majeure partie du travail pour les autres.
- Chaque membre de l'équipe se voit donc attribuer un rôle particulier. Selon la tâche à remplir, on pourra répartir les rôles de façon différente. On peut, par exemple identifier des experts dans des domaines précis (voir la rubrique EXEMPLE ).
- On peut aussi répartir les rôles de la façon suivante : une personne s'occupe de l'animation, une autre de la prise de notes, une troisième est responsable du climat et une quatrième observe les travaux de son équipe.
- La tâche à accomplir doit être expliquée clairement dès le début de l'exercice (voir la rubrique >EXEMPLE).
- Chaque personne doit se sentir responsable de son propre apprentissage. Pour structurer la responsabilité individuelle, on soumet les participantes et les participants à des tests individuels qui leur permettent d'évaluer leurs acquis. Chaque personne doit apprendre la matière afin d'améliorer son propre résultat et celui de son équipe.
- On doit expliquer clairement, dès le début, sur quoi on mesurera le succès des individus et des équipes. Les personnes se sentiront ainsi motivées à participer puisqu'elles auront une évaluation de leur propre travail, une évaluation du travail de l'équipe et une reconnaissance de l'enseignante ou de l'enseignant et de toute la classe.
- Là où le responsable soutient le travail des équipes des experts et répond aux questions des équipes de base. Pour comprendre la différence entre ces deux types d'équipes, voir la rubrique Exemple.
- En alphabétisation, si le travail d'équipe est basé sur l'étude d'un texte, on recommande d'utiliser, autant que possible, de courts écrits au contenu utile pour les adultes. On pourra par exemple utiliser un dépliant de la Régie du logement ou une invitation à une consultation publique de la municipalité.
POUR EN SAVOIR PLUS
Les personnes qui veulent en savoir plus sur la pédagogie de la coopération peuvent s'adresser à :
- Centre d'éducation interculturelle et de compréhension internationale (CÉICI), 3925, rue Villeray, Montréal, Québec, H2A 1H1. Téléphone : (514) 721-8122. Télécopieur : (514) 721-8613.
Documentation plus complète (consultation sur place) et sessions de sensibilisation.
- Université McGill, Pédago, a/s Caroline Bookless, 3724, rue McTavish, Montréal, H3A 1Y2. Téléphone : (514)398-7044.
Sessions de sensibilisation et de formation.
- Commission scolaire Kativik, a/s Jim Howden, 305, rue Mimosa, Dorval, H9S 3K5. Téléphone : (514)636-8120.
Ressources en formation.
EXEMPLE
L'activité suivante est destinée à un groupe d'alphabétisation. Les rubriques sont celles que les responsables doivent préciser avant le début de l'activité. Il s'agit d'informations à transmettre au groupe.
L'activité, inspirée de la méthode Jiggsaw (Robert Slavin, 1980), a été préparée par le Centre d'éducation interculturelle et de compréhension internationale (CÉICI).
ACTIVITÉ: La nature des mots
TÂCHE : Découvrir tous les articles, les noms, les adjectifs et les verbes du texte.
HABILETÉS SOCIALES À DÉVELOPPER : Désigner les gens par leur nom, regarder son interlocuteur, encourager les autres et stimuler le groupe.
DÉMARCHE:
- Formation d'équipes de base de quatre personnes. Mandat: Déléguer un membre dans chacune des équipes d'experts.
- Formation de quatre équipes d'experts (article, nom, adjectif et verbe).
Mandat : Les membres de chaque équipe ont pour tâche de définir la nature du mot (article, verbe, nom ou adjectif), de rechercher tous les mots de même nature dans le texte et de les identifier sur leur feuille en inscrivant au-dessus du mot un signe approprié (v pour verbe, ad pour adjectif, ar pour article et n pour nom).
- Retour à l'équipe de base.
Mandat : Chaque expert informe les autres membres de l'équipe de la nature du mot qu'il a recherché et il les invite à les identifier dans le texte.
BILAN DE L'ACTIVITÉ :
Test individuel : Compilation des résultats personnels et de ceux des autres membres de l'équipe pour obtenir la note finale de chacun et chacune.
Critères de succès : Le test individuel compte pour 8 points et les résultats des autres membres de l'équipe pour 2 points de boni pour un total de 10 points. On utilise la note la plus faible obtenue dans l'équipe de base (0/8=0,2/8=.5,4/8=1,6/8=1.5 et 8/8=2) pour fixer le nombre de points de boni.
Fiche 9 : rencontre de groupes
SECTEURS-CLES
Tous les secteurs de la société.
DOMAINES D'INTERVENTION
Animation, information, mobilisation, organisation, présidence d'assemblée...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les personnes qui ont des difficultés à lire ou à écrire sont souvent peu familiarisées et mal à l'aise avec les fonctionnements collectifs. Elles peuvent trouver gênant de s'exprimer en groupe, surtout si des gens visiblement instruits se sont prononcés avant elles. Il leur arrive souvent ne pas oser poser de questions et ne pas oser dire qu'elles n'ont pas compris. Elles peuvent ainsi ne pas saisir à quel moment donner leur opinion sur un sujet précis. La référence à de nombreux documents écrits, les procédures complexes, le rythme accéléré du déroulement sont quelques-uns des obstacles rencontrés.
VOS OBJECTIFS
Il se peut qu'il y ait des personnes analphabètes au sein du public à qui s'adressent les rencontres que vous organisez. Vous désirez en faire des participantes et des participants à part entière. Vous voulez qu'elles soient satisfaites de leur participation et incitées à revenir.
SUGGESTIONS PRATIQUES 2
Convocation
Préparation
- Au moment de la préparation des documents, il faut appliquer les règles de lisibilité. À ce sujet, voir les Fiches 11 et 12.
- Certains sujets peuvent être présentés sous forme d'une pièce de théâtre ou sur vidéo.
- Si les gens ont des lectures à faire avant de se présenter à une rencontre (ex. : conseil d'administration), on peut guider leur lecture. On précise, par exemple, à quelles questions ils devraient pouvoir répondre au moment de la discussion en groupe.
- L'organisme doit s'assurer de choisir, pour assumer la présidence ou l'animation, une personne capable de s'exprimer en langage courant.
- L'ordre du jour doit être rédigé de manière à ce que les gens puissent savoir d'avance les sujets sur lesquels ils auront à prendre des décisions.
- Les procédures sont des moyens destinés à faciliter les échanges et la prise de décisions. Il faut choisir les plus simples.
- Le travail en petit groupe (moins de 15 personnes) favorise l'expression des personnes analphabètes. Si le type de rencontre s'y prête, on devrait prévoir du travail en atelier.
- L'organisme doit avertir les conférencières et les conférenciers qu'il peut y avoir des personnes analphabètes dans leur auditoire.
- Si une ou plusieurs personnes-ressources éprouvent des difficultés à lire ou écrire, on doit prendre le temps de bien leur expliquer le cadre de leur intervention. Il faut leur offrir la possibilité de communiquer avec une personne-référence pour toutes précisions supplémentaires. Le matériel écrit utilisé par les autres personnes-ressources doit leur être offert.
- Si l'organisme juge que plusieurs personnes analphabètes peuvent être intéressées par une rencontre, il peut procéder aux arrangements nécessaires pour assurer la présence de formatrices ou formateurs en alphabétisation, qui pourront jouer un rôle de soutien, si elles ou ils sont connus des personnes analphabètes.
- Dans les rencontres avec inscriptions et déplacements (ex. : congrès, colloques), on peut offrir un soutien aux personnes ayant des difficultés à lire qui en font la demande. On peut ainsi leur préparer des pochettes contenant leur horaire personnalisé, en gros caractères, avec les titres d'ateliers et les numéros de salle où elles sont attendues.
- Un plan des espaces occupés par l'événement, avec des repères visuels clairs, est nécessaire en cas de déplacements dans plus d'un secteur de l'édifice.
Accueil
- Il est recommandé de prévoir un service d'accueil. Les personnes moins habituées au fonctionnement pourront s'y référer en cas de besoin.
- Si des documents sont remis sur place, les gens qui ont des difficultés à lire risquent de les mettre de côté. Il est conseillé d'en donner une présentation détaillée pendant l'assemblée, surtout si leur contenu peut influencer les décisions à prendre.
- On peut utiliser un vidéo-maison pour présenter, avant le début de l'assemblée, un document ou d'autres points sur lesquels l'organisme juge bon de fournir des précisions.
Assemblée
- Les procédures doivent être annoncées clairement au début de la rencontre. Il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde les connaît. Ces explications sont indispensables.
- L'explication portera sur la logique qui sous-tend la procédure : pourquoi, par exemple, on utilise le deuxième tour de parole.
- Si l'assemblée doit prendre une décision sur des documents écrits (ex. : états financiers, rapport d'activités), il est recommandé d'en faire une présentation détaillée pendant l'assemblée.
- La personne responsable de la présidence ou de l'animation de l'assemblée prendra soin de déceler les difficultés de participation. Elle vérifiera régulièrement si tout le groupe suit ce qui se passe, tant du point de vue du contenu que de celui de la démarche.
- Si des intervenantes ou des intervenants emploient des concepts abstraits, des sigles, ou des statistiques dans leur exposé, l'animatrice ou l'animateur peut donner une explication ou la demander. On s'assurera de la clarté des propositions pour qu' elles soient simples et précises dans leur formulation. Les propositions seront répétées à quelques reprises.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir les Fiches 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15 et 17
EXEMPLE
Des procédures simples pour une participation du plus grand nombre
Les procédures suivantes sont applicables dans la plupart des assemblées décisionnelles. Elles peuvent facilement être adaptées pour les rencontres d'information, de consultation ou d'échanges.
Au début de la rencontre, l'animatrice ou l'animateur propose au groupe de :
- discuter d'un seul sujet à la fois;
- laisser parler une seule personne à la fois;
- essayer d'être concret et expliquer les termes spécialisés, les sigles ;
- ne pas revenir sur un sujet déjà discuté et sur lequel on a déjà pris une décision;
- respecter, à chaque point de l'ordre du jour, les étapes de base suivantes : clarifier de quoi on parle, discuter du sujet, prendre une décision.
- utiliser le deuxième tour de parole, c'est-à-dire donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore parlé.
- Cette procédure permet au plus grand nombre de personnes de s'exprimer et évite que seuls les habitués de la discussion donnent leur opinion.
- utiliser le comité plénier.
L'assemblée générale se transforme, pour permettre une discussion plus libre où il n'y a pas de vote. Cette procédure permet de faire le déblayage d'une question, de dresser un portrait des points de vue, de préparer des propositions. En fonctionnant ainsi, on évite les amendements et les sous-amendements.
Les procédures sont des règles du jeu qu'un groupe se donne pour atteindre un but. Les débats du forum ont permis de mettre en pratique certaines procédures qui favorisent la participation de personnes analphabètes dans des groupes où elles sont minoritaires.
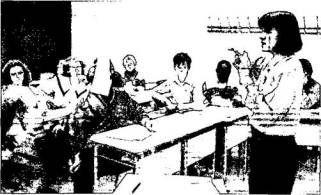
Fiche 10 Élection
SECTEURS-CLES
Tous les secteurs de la société.
DOMAINES D'INTERVENTION
Administration, communication, journalisme, organisation, politique, rédaction...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Au Québec, nous avons des élections à quatre paliers de gouvernement : le fédéral, le provincial, le municipal et le scolaire. Il faut y ajouter les élections dans les syndicats, les comités de bénéficiaires, les groupes populaires, les organismes de défense des droits. Certaines de ces élections se font à main levée, d'autres par vote secret, derrière un isoloir, d'autres encore par courrier. Mais plusieurs étapes du processus électoral reposent sur l'écrit et dans ces conditions, les adultes analphabètes peuvent difficilement exercer leur droit de vote.
VOS OBJECTIFS
Vous souhaitez rendre plus accessible aux personnes analphabètes l'ensemble du processus électoral. Vous trouvez essentiel que les personnes ayant des difficultés à lire ou à écrire puissent participer au choix des représentantes et représentants de leur communauté.
SUGGESTIONS PRATIQUES 3
Entre deux périodes électorales
- Le personnel électoral, les membres des partis, les responsables de l'organisation des assemblées, devraient être sensibilisés à la réalité des personnes analphabètes.
- Les démarches pour modifier les lois électorales doivent être entreprises à cette période, afin de rendre l'ensemble du processus électoral plus accessible aux personnes analphabètes (ex. : modification du bulletin de vote avec ajout de la photo des candidates et candidats et du sigle de leur parti, prolongation de la période de recensement).
Période électorale : avant les élections
• Le matériel utilisé pour l'exercice du droit de vote devrait être accessible aux lectrices et lecteurs débutants. Il faut qu'il se distingue de la publicité habituelle. Un numéro de téléphone, en très gros caractères, doit apparaître bien en évidence.
- On doit encourager, par d'autres moyens que l'écrit, les gens à s'inscrire sur la liste électorale (ex. : rappel téléphonique).
- Les organismes qui veulent encourager les personnes analphabètes à aller voter doivent leur fournir des exemples simples qui démontrent de façon concrète l'importance d'utiliser son droit de vote.
- Les visites des candidates et des candidats dans les établissements et organismes fréquentés par les personnes analphabètes sont particulièrement utiles aux personnes ayant des difficultés d'accès à l'écrit.
- Les candidates et les candidats devraient accepter les invitations aux débats publics afin de se rendre accessibles autrement que par les médias écrits.
- Les personnes qui interviewent un personnage politique, dans un débat public ou une émission d'affaires publiques, doivent poser des questions qui préoccupent les gens n'ayant que peu ou pas de pouvoir social. On doit éviter les concepts trop larges et utiliser un langage courant.
- Les bureaux de scrutin devraient être identifiés longtemps à l'avance. On privilégiera les endroits bien connus de la population et dans un secteur fréquenté. Les adultes qui ont des difficultés à lire les trouveront plus facilement.
- On peut aider les gens ayant des difficultés à lire à situer d'avance, sur une reproduction du bulletin de vote, le nom des candidates ou des candidats.
Période électorale : le jour des élections
- Un vidéo expliquant comment voter peut être diffusé dans le hall d'entrée du bureau de scrutin.
- L'accompagnement dans l'isoloir peut être offert discrètement. Ne pas trop insister : certaines personnes ayant des difficultés à lire préfèrent ne pas s'identifier comme telles, et aller voter seules.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir les Fiches 3, 5, 6, 9, et tout le Bloc 4
EXEMPLE
L'exercice du droit de vote : l'expérience du Nicaragua
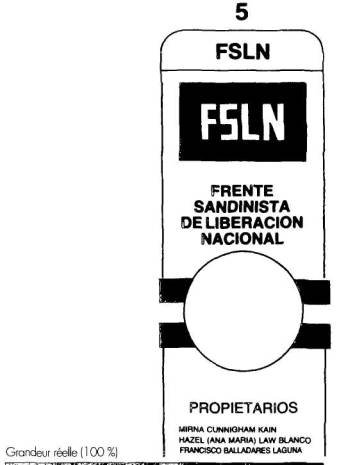
Lors des dernières élections au Nicaragua, le 25 février 1990, on a porté une attention particulière aux personnes analphabètes de manière à leur permettre d'exercer leur droit de vote. Dans certaines régions rurales, la télévision rejoint plus de gens que la distribution d'imprimés. Tout au long de la campagne électorale, la télévision a diffusé des tables rondes, les Frente al pueblo. Ces tables rondes étaient présentées à une heure de forte écoute et duraient une heure. Trois partis y participaient chaque jour.
À la radio, du temps d'antenne était offert gratuitement à tous les partis. Les assemblées publiques ont joué également un rôle d'éducation important et ont permis de faire ressortir l'importance de voter.
Au cours de cette élection, on a insisté sur le fait de voter pour les partis plutôt que pour les candidates et candidats. Chaque parti était identifié par un chiffre (ex : la UNO, Union national opositora, était identifiée au chiffre 1, le FSLN, Frente sandinista de liberation nacional, était identifié au 5, etc.). Tous les partis affichaient une couleur qui les distinguait.
Les partis ont produit des affiches représentant des bulletins de vote et la façon de les utiliser. Résultats : 90 % des adultes en âge de voter se sont inscrits sur les listes électorales. Près de 90 % d'entre eux ont exercé leur droit de vote. Quelques bulletins ont néanmoins dû être annulés parce que les gens ont écrit trois chiffres sur le bulletin ou confondu les chiffres 1 et 11.
Le même modèle de bulletin de vote a été utilisé dans toutes les régions du Nicaragua. Les chiffres 2, 3, 4 et 6 sont utilisés par des partis non-représentés dans la région7. Dans la région Yatama, il y a un onzième parti. Le bulletin est en couleur. Par exemple, la UNO utilise le bleu, le FSLN, le rouge et le noir.
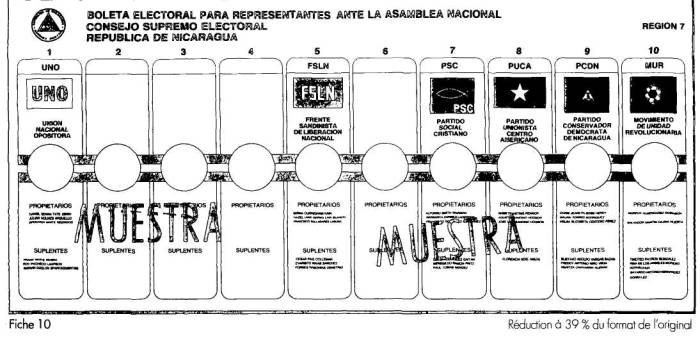
Bloc 4 : Communications écrites
Fiche 11 Rédaction
SECTEUR-CLÉ
Communication.
DOMAINES D'INTERVENTION
Alphabétisation, journalisme, rédaction, vulgarisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
L'expérience des groupes en alphabétisation révèle que les problèmes rencontrés par les adultes devant des imprimés d'usage courant ne s'expliquent pas toujours par leurs difficultés en lecture. Souvent, les documents sont rédigés et conçus de manière à être compris par des spécialistes en la matière.
VOS OBJECTIFS
Vous souhaitez encourager les gens à lire. Vous désirez que vos imprimés d'usage courant soient utiles aux adultes en processus d'alphabétisation et à ceux qui se sentent plus ou moins à l'aise avec l'écrit.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- En plus de respecter les règles de base de la rédaction, il faut porter une attention particulière aux aspects qui favorisent le décrochage des personnes analphabètes fonctionnelles : les mots de trois syllabes et plus, la longueur des phrases, le nombre de phrases dans un même paragraphe.
- La lisibilité des textes n'est pas propre aux besoins des personnes analphabètes. Le respect des règles de lisibilité est un premier objectif à atteindre et permettra de rejoindre un certain nombre d'adultes analphabètes fonctionnels.
- Les règles de lisibilité conçues pour une lectrice ou un lecteur moyen peuvent facilement être adaptées pour les gens qui éprouvent des difficultés en lecture. Dans les communications publiques, on conseille généralement des phrases de 15 à 20 mots. Pour une lectrice ou un lecteur débutant, les phrases devraient comporter de 9 à 15 mots.
- Il est préférable de conjuguer les verbes au présent, au passé composé et au futur.
- On conseille l'utilisation d'expressions synonymes plutôt que des termes non utilisés dans le langage courant. Par exemple, on écrira « la personne qui dépose une plainte » plutôt que « le plaignant », « la personne qui reçoit un service » et non « le bénéficiaire ». Le synonyme peut toutefois être mis entre parenthèses : par exemple, bénéficiaire (jpersonne qui reçoit le service).
- L'emploi de sigles ou d'acronymes (sigles prononcés comme un mot ordinaire : ONU, FIIQ) n'est pas recommandé dans les communications publiques, sauf quand le sigle est plus connu que le nom complet de l'organisme, comme par exemple CLSC (Centre local de services communautaires). Dans ces cas, le sigle et l'appellation complète peuvent être utilisés.
- Les organigrammes, les tableaux et les cartes demandent des habiletés supplémentaires en lecture et sont autant que possible à éviter. Les mots utilisés doivent être simples. La façon de lire ces graphiques doit se comprendre rapidement.
- La structure du texte et sa longueur doivent se prêter à un graphisme aéré.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir la fiche 1 (texte niveaux d'aptitude)
- FERNBACH, Nicole. La lisibilité dans la rédaction juridique au Québec, Centre canadien d'information juridique, Ottawa, 1990, 128 p.
Rapport de recherche sur la rédaction juridique et administrative en langue courante. Compilation de sources et synthèse de différentes idées sur la question de la lisibilité en langue française.
- FERNBACH, Nicole. Bibliographie sur la lisibilité et l'emploi de la langue courante, Centre canadien d'information juridique, Toronto, août 1990, 24 p.
Cette bibliographie recense un certain nombre d'ouvrages fondamentaux en français et en anglais, dans quelques domaines majeurs de recherche.
- RICHAUDEAU, François (sous la direction de). Recherches actuelles sur la lisibilité, Retz, Paris, 1984, 160 p.
Il s'agit de l'ouvrage consulté par F. Soucisse du CLSC Centre-Sud. François Richaudeau a publié plusieurs ouvrages sur la lisibilité.
Le Centre de promotion de la lisibilité, dispose d'une collection d'ouvrages et d'articles sur la lisibilité. Le centre fait partie du Centre canadien d'information juridique. Centre de promotion de la lisibilité, section du Québec, 1140, boul. deMaisonneuve ouest, bureau 1080, Montréal, H3A 1M8. Tél. : (514)845-4834.
EXEMPLE
Le CLSC Centre-Sud, gagnant de deux prix d'accessibilité au concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES !
Des principes de base à respecter
« Il n'y a pas de recette toute faite pour la rédaction d'un texte accessible. Mais, il y a des principes de base. Si on les respecte, on a plus de chances de rejoindre un public large », affirme François Soucisse, rédacteur et coordonnateur de la production du dépliant Un pas de plus, pour votre sécurité.
Le CLSC Centre-Sud a reçu un certificat de reconnaissance pour ce dépliant qui annonce le Programme Vigilance des facteurs dans le quartier Centre-Sud de Montréal. On estime que plus de 35 % des adultes du quartier sont analphabètes.
François Soucisse est un ancien formateur en alphabétisation. Lorsque le CLSC lui a demandé de coordonner la production et l'adaptation du matériel du programme Vigilance des facteurs, il s'est immédiatement préoccupé de son accessibilité. Avec, comme point de départ, deux dépliants sur le même programme, il a voulu que celui du CLSC Centre-Sud soit facile à comprendre pour les personnes ayant des difficultés à lire et à écrire.
François Soucisse reconnaît que son expérience en alphabétisation a pu l'aider, mais ce sont les règles de lisibilité qui lui ont été le plus utiles. «Je me suis inspiré des règles de lisibilité et je me suis aussi fié à mon intuition. Il y a des choses que tu sais, mais dont tu ne tiens pas toujours compte quand tu écris. Par exemple, qu'il faut éviter des termes génériques qui veulent dire n'importe quoi, qu'il est préférable de donner un seul exemple plutôt que d'avoir une phrase trop longue. »
Comme règle de base, le rédacteur s'est limité à des phrases de 9 à 15 mots. «Je crois, dit-il, qu'on peut dire les choses au premier degré sans paraître simpliste, ni enfantin. »
La validation du texte par les apprenantes et les apprenants de l'Atelier des lettres, le groupe populaire en alphabétisation du quartier CentreSud, a confirmé les choix du rédacteur.
Le jury du concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES ! a toutefois souligné que la formule légale du formulaire à remplir restait difficile à comprendre. Sa longueur et le vocabulaire employé la distingue de tout le reste du dépliant. « Cette formulation n'a effectivement pas été validée par les gens de l'Atelier des lettres. C'est un ajout de dernière heure. Comme il ne nous restait plus beaucoup de temps, nous avons pris une formule toute faite dont la portée légale était déjà reconnue », précise François Soucisse.
À la suite du concours, la directrice générale du CLSC, Renée Spain, a indiqué son intention d'instaurer de façon systématique la démarche suivie pour la production de l'affiche et du dépliant Un pas de plus, pour votre sécurité.

François Soucisse reçoit, au nom du CLSC Centre-Sud, un certificat d'accessibilité. Le certificat lui est remis par Diane Labelle, membre du jury et Jacques Proulx de l'ICÉA.
Fiche 12 : Graphisme
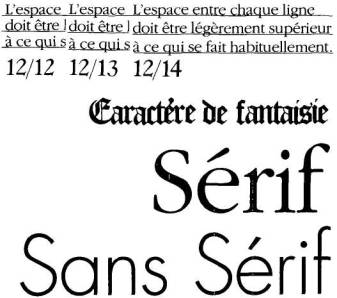
SECTEUR-CLÉ
Communication.
DOMAINES D'INTERVENTION
Coordination de projets, édition, graphisme, illustration, vulgarisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les adultes qui lisent peu et ceux qui apprennent à lire mettent fréquemment de côté des imprimés. Ils le font parce que le texte est trop dense ou que les informations importantes n'apparaissent pas au premier coup d'oeil. Il arrive aussi que certains codes graphiques leur soient inconnus et qu'ainsi, une information ou un mode d'utilisation de l'imprimé leur échappe.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que vos imprimés attirent un public qui ne lit pas beaucoup. Vous voulez éviter des difficultés supplémentaires aux personnes qui font des efforts pour apprendre à lire et à écrire.
SUGGESTIONS PRATIQUES
Typographie
- Les lectrices et les lecteurs débutants apprécient les caractères de bonne grosseur. Le texte courant devrait être d'au moins 12 points.
- L'espace entre chaque ligne doit être légèrement supérieur à ce qui se fait habituellement. On conseille un interligne de 1,2 fois plus grand que la taille des caractères. Les paragraphes doivent se distinguer au premier coup d'oeil.
- Il faut éviter les caractères typographiques qui fatiguent la vue. La plupart des caractères sérif se lisent plus facilement que les caractères sans sérif. Il est important qu'aucune lettre ne se confonde avec une autre.
- Les majuscules sont plus difficiles à lire et sont généralement moins connues par les personnes qui lisent très peu. On ne devrait pas les utiliser pour du texte courant ni pour de longs titres.
- Dans les textes pour lectrices ou lecteurs débutants, on doit éviter les coupures de mots et les colonnes étroites. Il est préférable de prévoir une mise en page avec de larges colonnes ou en alignant le texte à gauche seulement.
- La lectrice ou le lecteur débutant doit pouvoir reconnaître facilement où un mot commence et où il finit.
- Une variation modérée dans l'utilisation des styles de caractères, de leur graisse, des couleurs, peut servir à faire ressortir un mot, un titre, un paragraphe particulièrement important. On peut ainsi attirer l'attention d'une personne qui lit très peu sur une information spécifique.
- Certains codes graphiques utilisés par les personnes scolarisées sont souvent inconnus des lectrices et lecteurs débutants. C'est le cas, par exemple, de l'italique pour les titres de publication. Il est alors souhaitable d'indiquer, dans le texte, qu'il s'agit d'un livre.
Présentation
- Les illustrations et les photos doivent faciliter la compréhension du texte. Elles peuvent, entre autres, aider les lectrices et lecteurs à comprendre certains mots moins courants.
- L'impression d'un texte sur un dessin ou sur un fond tramé de même couleur ajoute souvent des difficultés de lecture. Il faut éviter les tramés qui forment une teinte sous un texte.
- On ne doit pas s'attendre à ce que les personnes analphabètes comprennent les pictogrammes plus facilement que le reste de la population. On conseille de travailler les projets de pictogrammes (ex. : consignes d'urgence, indications pour se repérer dans un édifice) en collaboration avec les organismes d'alphabétisation.
- L'utilisation de symboles tirés du code écrit pose des problèmes à plusieurs personnes analphabètes. Elles peuvent, par exemple, confondre ou tout simplement méconnaître les points d'interrogation ? et d'exclamation !. Ces signes, enseignés souvent après l'alphabet, devraient être évités dans les pictogrammes conçus spécialement pour aider les personnes analphabètes à se repérer.
POUR EN SAVOIR PLUS
- MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA. À propos des imprimés destinés aux aînés, Gouvernement du Canada, 1990, Cat. H88-3/7-1990, 8 p.
Recommandations simples et concises pour mieux rejoindre les aînés. Données générales sur l'édition.
Le Centre de promotion de la lisibilité dispose d'une collection d'ouvrages et d'articles sur le graphisme et la lisibilité. Centre de promotion de la lisibilité, section du Québec, 1140, boul. de Maisonneuve ouest, bureau 1080, Montréal, H3A 1M8. Tél. : (514)845-4834.
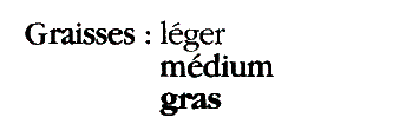
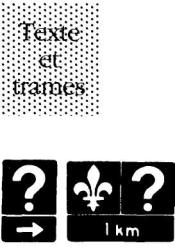
Fiche 13 : Bande dessinée
SECTEUR-CLÉ
Éducation.
DOMAINES D'INTERVENTION
Alphabétisation, illustration, information, scénarisation, vulgarisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Souvent, les personnes analphabètes de base ne peuvent pas utiliser l'information contenue dans les bandes dessinées ou les photos-romans, pourtant identifiés et publiés en vertu de leur accessibilité potentielle pour les personnes ayant des habiletés limitées en lecture. Le vocabulaire utilisé, la complexité des situations décrites sont quelques-uns des obstacles rencontrés.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez favoriser un changement d'attitudes ou d'habitudes dans un groupe de la population (ex. -. des personnes désireuses d'acheter une voiture usagée). Vous voulez donner aux citoyennes et aux citoyens moins scolarisés des outils qui leur permettront de trouver une solution à leurs problèmes.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- La bande dessinée doit respecter certaines règles pour que son contenu devienne vraiment accessible aux adultes lecteurs débutants. On pourra l'utiliser en alphabétisation pour aider les gens à acquérir du vocabulaire, augmenter leurs connaissances et changer certains comportements.
Scénario et dialogues
- La bande dessinée suscite chez certains groupes d'âge ou groupes culturels une réaction de résistance. Si on veut rallier ces gens, il faut que la page couverture et les premières cases leur montrent qu'ils trouveront dans la bande dessinée de l'information concrète et utile.
- Il est préférable que l'histoire parle du quotidien des lectrices et lecteurs, pour qu'ils s'identifient plus facilement au propos. Les dialogues doivent être écrits en langage parlé courant.
- Le scénario doit prévoir un rythme soutenu dans l'action. Mettre des personnages en situation rend le propos plus concret que de longues explications. Il faut que les étapes à franchir, tout au long de l'histoire, soient bien identifiées. Lorsqu'un nouveau personnage intervient, son rapport à l'histoire et son statut doivent apparaître clairement.
- Les onomatopées (ex. : ouach! cling clong!) ne sont pas recommandées. Elles sont difficiles à comprendre par des lectrices et des lecteurs débutants.
- Il peut être avantageux de faire la scénarisation en collaboration avec les gens en alphabétisation.
Dessins et mise en page
- Les dessins doivent rester assez simples. Les appendices sous les bulles doivent être suffisamment apparents pour que la lectrice ou le lecteur sache bien qui parle.
- On conseille d'utiliser une calligraphie standard. La plupart des personnes qui commencent à lire sont plus familières avec les minuscules.
- Il faut éviter de couper des mots (ex. : apprendre).
- La pagination doit être mise en évidence. La publication sera plus facile à utiliser dans les groupes d'alphabétisation.
- La façon de lire la bande dessinée doit se comprendre facilement. On peut indiquer le sens de la lecture, par des flèches par exemple.
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir la Fiche 11
EXEMPLE
La série de bandes dessinées de l'OPC et de la CECM
Gagnants au concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES ! Catégorie Guide d'information
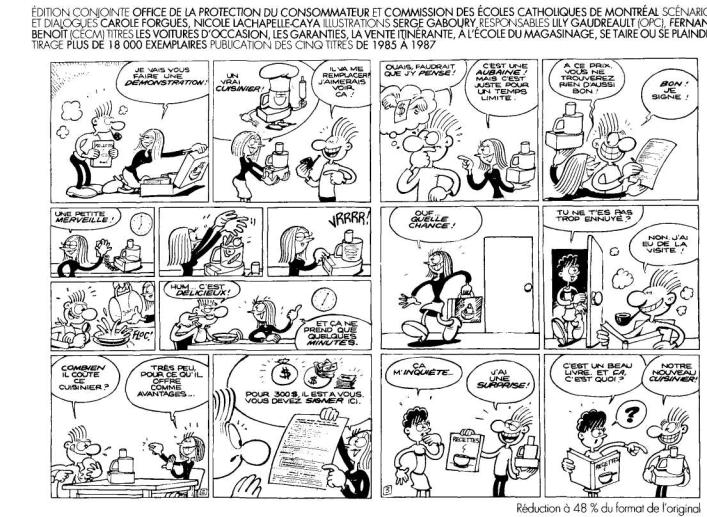
Notes du jury
- L'histoire permet de comprendre dans quel genre de situation on peut avoir besoin de connaître ses droits.
- L'histoire aide à comprendre les démarches à faire, les étapes à traverser. Ce n'est pas abstrait, on sent qu'on saura quoi faire dans une situation semblable.
- C'est intéressant parce que ça parle de sujets du quotidien.
- Les caractères sont gros et se lisent bien.
- Il reste des mots difficiles, mais les dessins permettent souvent de les comprendre.
- Il manque un numéro de téléphone pour savoir où s'adresser si on a besoin d'explications supplémentaires.
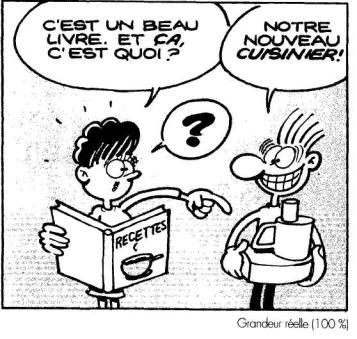
Fiche 14 : Affiche
SECTEUR-CLE
Information.
DOMAINES D'INTERVENTION
Coordination de projet, direction artistique, graphisme, illustration, photographie, rédaction...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les affiches sont fréquemment utilisées pour donner une première information sur un service. Même si elles comportent généralement peu de texte, leur message reste souvent inaccessible aux adultes ayant des difficultés à lire.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que votre affiche encourage les gens à exercer un droit, à utiliser un service existant. Vous souhaitez que les personnes qui ont des difficultés importantes en lecture se sentent concernées par le message de votre affiche.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Rejoindre les personnes ayant des difficultés à lire ne signifie pas pour autant cesser d'utiliser les mots. Toutefois, ceux qu'on utilise doivent aller droit au but.
- Le slogan est essentiel : il doit être court et composé de mots courants.
- Pour les affiches s'adressant à une clientèle spécifique (ex. : travailleuses et travailleurs en industrie, jeunes), on peut employer des termes qui ne sont pas courants pour un grand public mais qui font partie du langage de ce groupe précis.
- Les photos ou les illustrations doivent contribuer à aider les gens à comprendre le texte, pour renforcer le message.
POUR EN SAVOIR PLUS
Fiches 11, 12
EXEMPLE
L'affiche du CLSC Centre-Sud Un pas de plus, pour votre sécurité
Gagnant au concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!, catégorie Affiche
Édition clsc centre-sud rédaction françois soucisse graphisme pierre lachance validation atelier des lettres tirage 10 000 publication octobre 1990
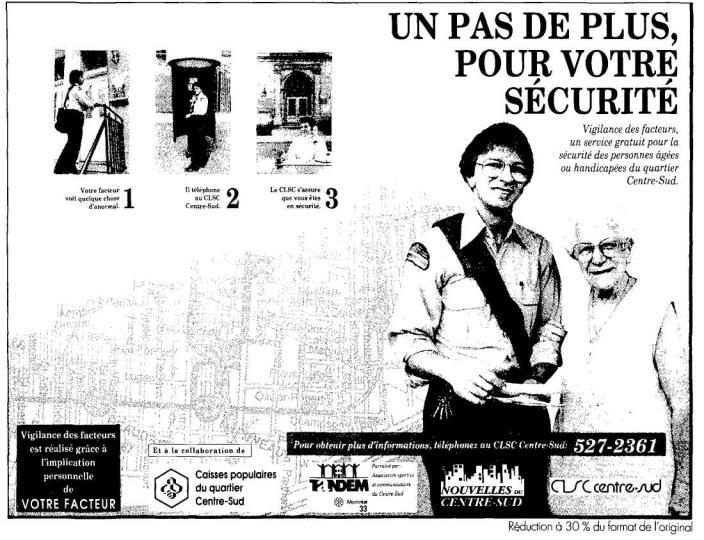
Notes du jury
- Le slogan qui domine l'affiche est facile à comprendre.
- L'utilisation des photos permet de comprendre les étapes du programme et de savoir à qui il s'adresse.
- Les mots choisis sont faciles sauf le mot « vigilance » dans le titre du programme. Le reste du texte permet toutefois de comprendre le sens de ce terme.
- Les caractères sont gros et encouragent la lecture.
- Le numéro de téléphone est mis en évidence.
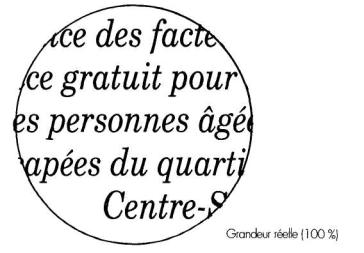
Fiche 15 : Dépliant
SECTEUR-CLE
Information.
DOMAINES D'INTERVENTION
Alphabétisation, coordination de projet, graphisme, promotion, rédaction...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Un grand nombre de dépliants destinés à informer la population sur ses droits, sur les procédures à suivre pour obtenir un service ou adhérer à une organisation restent inaccessibles aux personnes qui ne maîtrisent pas la lecture. L'information condensée, les longues phrases, le vocabulaire spécialisé constituent quelques-uns des obstacles auxquels se heurtent régulièrement les lectrices et les lecteurs débutants à qui on remet un dépliant, une brochure, une lettre d'information.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez faire connaître à la population une information qui l'aidera à exercer un droit. Vous cherchez à rejoindre aussi les gens peu scolarisés.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Un numéro de téléphone doit apparaître en évidence sur le dépliant. Les gens ayant des difficultés à lire pourront composer ce numéro et obtenir des explications sur le contenu du dépliant.
- Le sens de la lecture doit apparaître clairement, que ce soit pour le texte, les bandes dessinées, les organigrammes et les tableaux. Attention aux plis du dépliant : ils peuvent créer de la confusion, en particulier chez une lectrice ou un lecteur débutant.
- Parce qu'on dispose de peu d'espace, on utilise fréquemment de nombreux sigles. Ceux-ci sont souvent des nouveaux mots pour les lectrices et les lecteurs, qui ne les retiennent pas à la première lecture. Il vaut mieux écrire l'appellation complète tout au long du texte. Si ce n'est pas possible, on devra rappeler le nom au complet à quelques reprises.
- Si le dépliant contient une formule à remplir, il est recommandé d'expliquer, simplement et brièvement, à quoi serviront les informations recueillies.
POUR EN SAVOIR PLUS Voir les Fiches 11, 12 et 16
EXEMPLE
Le dépliant du CLSC Centre-Sud Un pas de plus, pour votre sécurité
Gagnant au concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!, catégorie Dépliant
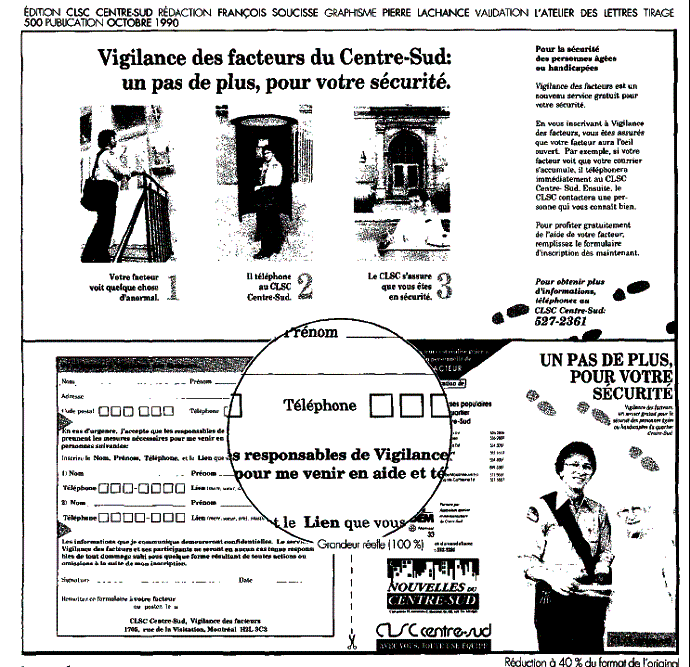
Notes du jury
- Le slogan du dépliant est facile à comprendre
- L'utilisation des photos permet de comprendre les étapes du programme.
- Les mots choisis sont faciles sauf le mot « vigilance » dans le titre du programme.
- Les caractères sont gros et encouragent la lecture.
- Le numéro de téléphone est mis en évidence.
- Le formulaire à remplir est plus difficile à comprendre que la description du programme. La formule de dégagement de responsabilité est intimidante et on ne sait pas vraiment à quoi on donne son accord. Cette partie ne doit pas servir comme modèle et nécessite certaines améliorations.
Fiche 16 : Formulaire
SECTEURS-CLES
Communication, administration.
DOMAINES D'INTERVENTION
Droit, enquête, gestion, graphisme, linguistique, rédaction, statistique...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les personnes qui ont des difficultés à lire, à écrire ou à calculer éprouvent toutes sortes d'embarras parce qu'elles ne parviennent pas à remplir les formulaires. Elles pourront difficilement faire connaître leurs besoins. Il leur sera difficile d'obtenir une aide gouvernementale, un emploi, de s'inscrire à un cours.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez vous assurer que les formulaires mis au point par votre organisme puissent être compris et remplis par des adultes peu scolarisés ou ayant des difficultés en lecture, écriture et calcul.
SUGGESTIONS PRATIQUES
Instructions
- Les instructions doivent être adaptées aux personnes à qui l'on s'adresse. Il faut conserver le même style, le même ton, du début à la fin.
- Il est conseillé d'adopter la forme du dialogue et d'utiliser le « vous ». En plus de donner un ton cordial au formulaire, le « vous » englobe le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel.
- Si la clientèle visée se compose autant d'universitaires que de gens peu scolarisés, on conseille d'adapter le texte à un degré de lecture de secondaire II.
- Plusieurs formulaires sont remplis par des gens en situation de crise (perte d'un emploi, accident de travail, difficultés financières, etc.). Des instructions précises et simples sont essentielles.
- Les instructions doivent indiquer de façon claire qui sont les personnes visées par le formulaire. On conseille également d'expliquer pourquoi il est important de le remplir et d'indiquer ce que l'organisme fera de l'information recueillie.
Questions et réponses
- Les questions doivent poursuivre le dialogue amorcé dans les instructions.
- Le terme « veuillez » est un mot difficile. Son sens peut échapper à plusieurs personnes. Un style plus direct permet d'éviter son utilisation.
- Lorsque le formulaire propose des choix de réponse, il faut que ces derniers soient rédigés en langage courant.
- Dans les questions ouvertes, il faut que l'espace aménagé pour répondre, en largeur et en hauteur, soit suffisant pour que les répondantes et les répondants écrivent de leur écriture habituelle. Plusieurs personnes se débrouillent assez bien en lecture, mais rencontrent de grandes difficultés en écriture. Elles écrivent souvent en plus gros caractères.
- L'endroit où les gens doivent répondre sera bien indiqué. L'espace prévu pour la signature doit permettre à la personne de signer son nom au complet et selon son style habituel.
- Certaines expressions toutes faites, et souvent incompréhensibles, sont utilisées de façon systématique dans les formulaires. C'est souvent le cas des formules qui précèdent la signature de la répondante ou du répondant. On peut conserver la valeur juridique d'un document tout en appliquant des règles de lisibilité. En cas de doute, il est possible de consulter des juristes s'intéressant à la communication en langue courante.
Longueur des formulaires
- On doit limiter le nombre de fonctions données à un formulaire de manière à éviter que celui-ci soit trop long.
- Un formulaire accessible exigera généralement plus d'espace qu'un formulaire préparé sans effort d'accessibilité. L'utilisation d'exemples ou d'expressions synonymes, la grosseur des caractères, l'espacement requis sont tous des éléments qui influent sur la longueur du document.
- Les espaces réservés à l'administration sont des obstacles à la lecture. On devrait les éviter le plus possible.
- Si l'organisme doit préparer un même formulaire en plusieurs langues, il est préférable de produire des formulaires distincts. L'utilisation de plus d'une langue est une source de confusion pour les personnes qui ne maîtrisent pas la lecture.
- S'il est impossible de faire un formulaire dans une seule langue, il vaut mieux que les deux langues figurent côte à côte dans des colonnes séparées, plutôt que l'une en dessous de l'autre.
Validation
POUR EN SAVOIR PLUS
Voir les Fiches 11 et 12
Centre de promotion de la lisibilité, section du Québec, 1140, boul. de Maisonneuve ouest, bureau 1080, Montréal, H3A 1M8. Tél. : (514)845-4834.
EXEMPLE
Il arrive que des personnes analphabètes soient accusées de fraude parce qu'elles n'ont pas compris les documents officiels.
Les exemples de formulaires ayant avantage à être révisés sont nombreux. Heureusement, suite au Forum UNE SOCIÉTÉ SANS BARRIÈRES, plusieurs organismes ont prévu apporter des modifications aux formulaires utilisés couramment.
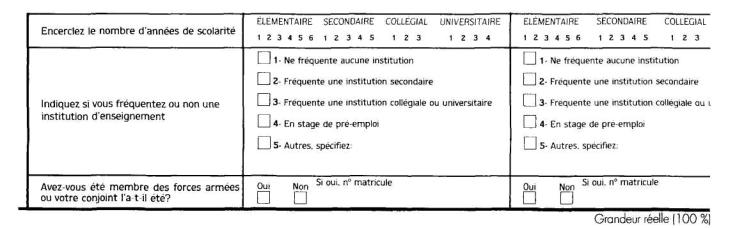
Fiche 17 : Publication régulière
SECTEUR-CLE
Information.
DOMAINES D'INTERVENTION
Alphabétisation, graphisme, journalisme, photographie, rédaction...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
La plupart des informations publiées dans les quotidiens, les journaux syndicaux ou communautaires, les revues et les hebdomadaires, restent inaccessibles aux adultes, lecteurs débutants. La longueur des textes, le vocabulaire employé, les connaissances préalables requises sont quelques-uns des obstacles rencontrés.
VOS OBJECTIFS
Vous voulez que l'information que vous publiez régulièrement serve à un large public. Vous souhaitez que des gens peu scolarisés puissent profiter de votre publication.
SUGGESTIONS PRATIQUES
- Pour rendre accessible une publication, en tout ou en partie, les responsables peuvent s'associer à un ou des groupes d'alphabétisation du territoire principal de diffusion.
- L'espace accordé dans la publication à l'information accessible aux personnes peu scolarisées peut varier. On consacrera, par exemple, plusieurs pages à chaque numéro du journal ou de la revue, ou une page par semaine, selon les ressources. On tiendra également compte de l'intérêt et des besoins des lectrices et lecteurs débutants appartenant à la clientèle-cible de la publication.
- L'équipe de travail peut se composer d'au moins trois personnes. La première représente la publication et coordonne le projet. La deuxième représente les groupes d'alphabétisation et la troisième assume la recherche et la rédaction.
- On pourra recueillir des commentaires auprès des lectrices et des lecteurs débutants qui fréquentent les groupes d'alphabétisation. Des ajustements pourront ainsi être apportés au fil des numéros.
EXEMPLE
Une page pour lecteurs débutants : Une question de volonté
« Une page pour nouveaux lecteurs à toutes les semaines, ce n'est pas compliqué à faire. Ce que ça demande d'un journal, c'est de la volonté », affirme Claude-Sylvie Lemery, chef des nouvelles au quotidien Le Droit.
La direction du Droit a accepté de mettre à la disposition du projet une page, sans publicité, toutes les semaines. Les groupes d'alphabétisation ont accepté de se partager les coûts des honoraires du rédacteur.
Information et alphabétisation
« Cette page est très utile en alphabétisation et les intervenants ont montré beaucoup d'enthousiasme », raconte Suzanne Rochon, représentante des organismes d'alphabétisation sur ce projet. Chaque semaine, les groupes composés d'apprenants capables de lire travaillent avec cette page. Sa lecture peut servir à toutes sortes d'activités. On peut, par exemple, apprendre de nouveaux mots, étudier la construction d'une phrase, vérifier la compréhension d'un sujet, découvrir les fonctions d'un journal dans la vie quotidienne.
Le journal est utilisé en alphabétisation depuis déjà longtemps. Mais les textes d'information, contrairement à d'autres rubriques comme les annonces classées, les faits divers, l'horoscope, sont souvent difficiles pour des lecteurs débutants. « Depuis qu'on utilise cette page en classe, explique madame Rochon, les gens comprennent mieux l'actualité. Ils réalisent qu'ils peuvent avoir une opinion intéressante sur un sujet. Ils se sentent plus à l'aise de participer à des discussions. »
Un projet basé sur la collaboration
« Le rédacteur de la page Lire pour dire ne fait pas le travail d'un journaliste, souligne Claude-Sylvie Lemery. Il ne va pas aux conférences de presse et ne fait pas d'entrevues. Sa matière première, c'est le journal Le Droit ».
La mise en page et le choix des photos sont assumés par l'équipe régulière du journal. Après quelques numéros, la préparation de la page Lire pour diren'exige pas plus de temps que les autres chroniques du journal.
EXEMPLE
La page Lire pour dire du journal Le Droit Gagnant au concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!, catégorie Publication régulière
ÉDITION LE DROIT RÉDACTION DANIEL CÔTÉ GRAPHISME CLAUDE BEAUREGARD RESPONSABLE DE LA PRODUCTION CLAUDE SYLVIE LEMERY COLLABORATION COMMISSIONS SCOLAIRES DES DRAVEURS, OUTAOUAIS+HULL, HAUTE GATINEAU, VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE, LES GROUPES POPULAIRES CENTRE D'EDUCATION DE BASE DANS L'OUTAOUAIS, CENTRE CULTUREL D'ORLEANS, MOI J'APPRENDS ET LA MAGIE DES LETTRES TIRAGE 40 000 EXEMPLAIRES PUBLIÉS DEPUIS SEPTEMBRE 1990, TOUS LES LUNDIS.
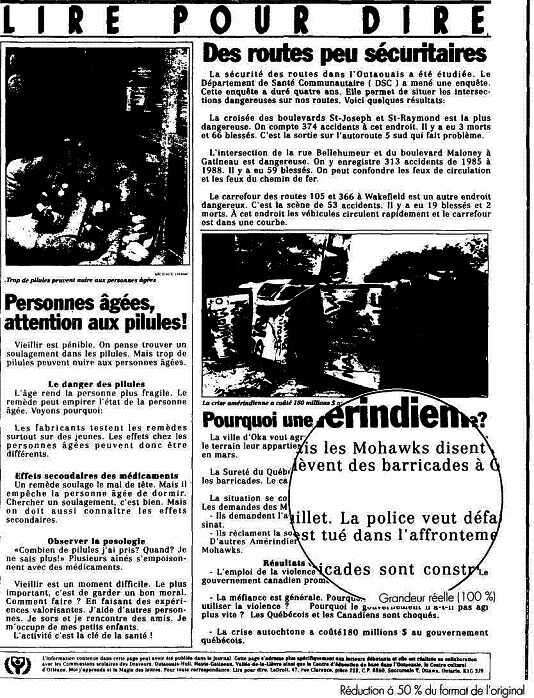
Notes du jury
- Les nouvelles choisies permettent aux francophones de l'Outaouais de connaître des services auxquels ils ont droit.
- La présentation des nouvelles permet de comprendre certains événements de l'actualité.
- La présentation des nouvelles permet de comprendre certains événements de l'actualité.
- Les sujets sont variés et peuvent répondre à tous les intérêts.
- Les mots sont faciles à lire et à comprendre à quelques exceptions près. La plupart du temps, celles-ci sont expliquées dans le texte.
- Les caractères sont gros, ce qui donne le goût de poursuivre la lecture.
Fiche 18 : Guide d'information
SECTEUR-CLE
Édition.
DOMAINES D'INTERVENTION
Communication, éducation, graphisme, rédaction, vulgarisation...
PROBLÈMES RENCONTRÉS
Les guides d'information sont souvent des ouvrages assez volumineux contenant des renseignements sur une problématique. Ces renseignements sont utiles pour mener des actions ou activités diverses. Ces guides sont basés essentiellement sur l'écrit et structurés de manière à pouvoir être consultés facilement et rapidement. Souvent, les personnes ayant des habiletés limitées en lecture n'ont pas accès à ces sources précieuses d'informations.
VOS OBJECTIFS
Vous souhaitez que l'information écrite que vous avez rassemblée soit accessible aux personnes ayant une formation de base en lecture. Vous voulez que l'information contenue dans le guide soit accessible à l'ensemble de la population.
SUGGESTIONS PRATIQUES
Contenu
- Le titre du document doit être formulé en langage courant. L'utilisation du langage spécialisé est acceptable à l'intérieur du guide, à certaines conditions.
- Le langage spécialisé peut être utilisé si la connaissance de certains termes peut aider les gens à exercer un droit. Dans ces cas, il faut expliquer le sens des termes spécialisés dans le texte. On recommande également de publier un lexique des termes spécialisés, à la fin du document.
- Un numéro de téléphone doit figurer bien en évidence pour les personnes qui veulent s'assurer qu'elles ont bien compris l'information.
- Le texte doit être le plus concret possible. Les exemples de la vie de tous les jours soutiennent l'intérêt de la lectrice et du lecteur. On recommande d'employer la façon de parler des gens (ex. : crise cardiaque). À ce titre, la rédactrice ou le rédacteur doit rechercher la collaboration du personnel en contact régulier avec la clientèle.
- La lecture, avant publication, par des personnes représentant le public visé, permet d'identifier les passages plus abstraits et de colorer le texte d'exemples. Toutefois, il faut prévoir un laps de temps suffisant dans le calendrier de production.
Présentation
- Le mode d'utilisation du guide doit être clair dès qu'on tourne la première page. Il faut que la manipulation de l'outil soit la plus simple possible. Il est préférable d'éviter les références en bas de page ou à la fin de section dans les ouvrages destinés à un public qui ne lit pas beaucoup.
- Un guide d'information conçu pour être lu, compris et utilisé par des adultes qui n'ont pas l'habitude de lire des livres demande généralement plus de pages qu'une publication s'adressant à des gens habitués à la lecture. La grosseur des caractères, les illustrations, le plus grand nombre de mots, l'utilisation d'exemples, influent sur le nombre de pages. On doit toutefois avoir le souci de ne pas produire un ouvrage trop volumineux et se limiter à donner de l'information plus concrète.
Diffusion
- Plusieurs adultes peu scolarisés prennent pour acquis qu'ils ne peuvent pas lire un livre. On doit prévoir dans la stratégie de diffusion des moyens pour informer ces lectrices et ces lecteurs de l'accessibilité du guide. On peut également organiser des rencontres d'information qui viseront, entre autres objectifs, à démystifier l'outil.
- Il est recommandé de prévoir d'autres moyens d'accès à l'information contenue dans le guide : vidéo, rencontres d'information, service de renseignements téléphoniques, réseau d'entraide.
EXEMPLE
Guide des premiers soins du CLSC Sainte-FoySillery Le Phare
Mention du jury, concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES!
EDITION LE PHARE CSRJEUNESSE CLSC SAINTE-FOY-SILLERY RECHERCHE ET RÉDACTION MARIE-BERTHE BÉDARD, RAYMONDE PÉPIN, LISE VERMETTE ILLUSTRATIONS CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE LAVAL (CHUL), GRAPHIDE COORDINATION ROLANDE VEILLEUX-GERVAIS, VAUDATION TIM ALLEN, URGENTOLOGUE (CHUL) TIRAGE 10 000 PUBLICATION lre EDITION 1986, 3e EDITION 1989.
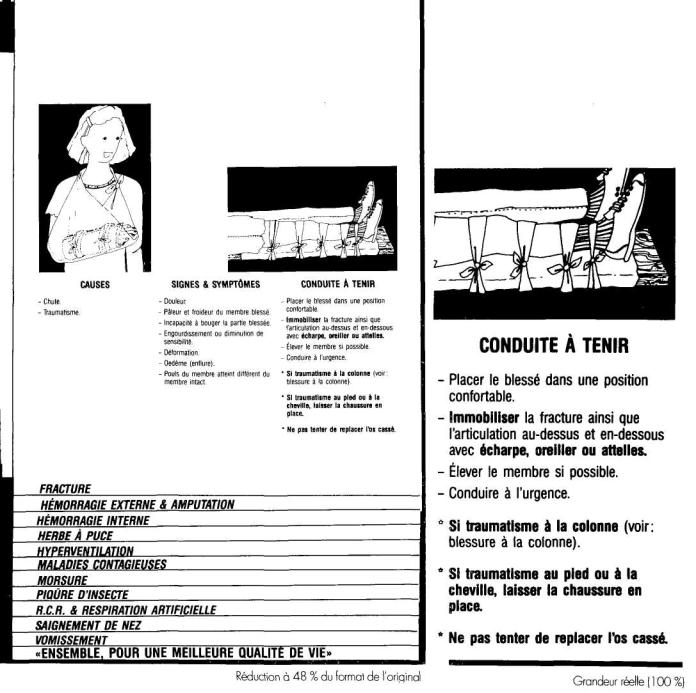
Notes du jury
- La présentation donne le goût de lire, on comprend facilement le mode d'utilisation.
- Les dessins aident à comprendre la façon de procéder pour donner les premiers soins.
- Le texte est aéré, les flèches donnent des caractères sont d'une bonne grosseur.
- Il reste quelques mots difficiles (ex : sudation, éruptions, cloques, persiste, alvéole). En situation d'urgence, ce n'est pas le moment de chercher son dictionnaire...
Annexes
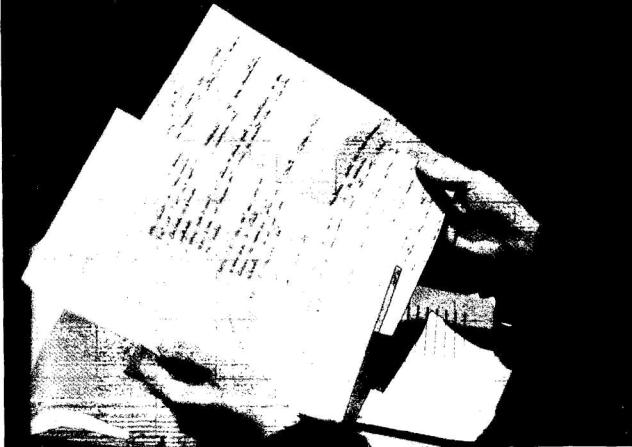
ANNEXE 1
Liste des participantes et des participants
1. Participantes et participants inscrits
Services à la population (public)
Aide juridique Saint-Georges-de-Beauce, Roch Baillargeon
Assemblée nationale, Louise Harel
Centre régional d'accueil et de référence de l'Ile de Montréal, France Moïse
Commission de formation professionnelle - Montréal métropolitain, Claude Charette
Commission de la santé et de la sécurité du travail, Claude Létourneau
Commission de la santé et de la sécurité du travail, Louise Lévesque-Vachon
Commission de la santé et de la sécurité du travail, François Vezeau
Commission des droits de la personne, Madeleine Boucher Commission des droits de la personne, Natalina Crescenzi
Commission des droits de la personne, Claire Grenier
Commission des droits de la personne, Monique Lortie
Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, Louise Sarrasin
Commission Emploi et Immigration Canada, Lucette Bellemare
Commission Emploi et Immigration Canada, Jocelyne Labelle-Joly
Commission Emploi et Immigration Canada, Pierre L'Allier
Commission Emploi et Immigration Canada, Jacques Mathurin
Commission Emploi et Immigration Canada, Normand Sabourin
Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Yves Denoncourt
Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Lucie Pépin
Commission scolaire catholique de Sherbrooke, Jacinthe Bélisle
Commission scolaire de Chicoutimi, Jean-Yves Simard
Commission scolaire de Lotbinière, Denise Archambault
Commission scolaire Manicouagan, Normand Valcourt
Commission scolaire Miguasha, Jean Poirier
Communication-Québec, Marjolaine Lévesque
Communication-Québec, Jean Talbot
Communication-Québec - Direction régionale de Québec, Marie Roux-Lambert
Conseil des communautés culturelles et de l'immigration,YvesAlavo
Consommation et Corporations Canada, Maryse Lavoie
Fédération des CLSC Région 05, Odette Dion
Institut des langues, Raymonde Dallaire
Ministère de l'Éducation, Margot Désilets
Ministère de l'Éducation, Lino Mastriani
Ministère de l'Éducation, Andrée Racine
Ministère de l'Éducation, Sylvie Roy
Ministère de l'Éducation, Francine Senécal
Ministère de l'Éducation - Formation à distance, Laila Valin
Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Normand Bureau
Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Denise Boulanger
Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Gil Michel
Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Claire Pelletier
Office de la protection du consommateur, Michael McAndrew
Office des personnes handicapées du Québec, Henri Bergeron
Office municipal d'habitation de Montréal, Benoît Fradette
Office municipal d'habitation de Montréal, Louise Hébert
Protecteur du citoyen, Micheline Bouzigon
Protecteur du citoyen, Hélène Brodeur
Protecteur du citoyen, Mariette Cailloux
Protecteur du citoyen, Lyne Chassé
Protecteur du citoyen, Diane Dubuc
Protecteur du citoyen, Lucie Gosselin
Protecteur du citoyen, Denise Labelle
Protecteur du citoyen, Lucie Levac
Protecteur du citoyen, Anne-Marie Racette
Protecteur du citoyen, Manon Robitaille
Protecteur du citoyen, Monique Sévigny
Régie des rentes du Québec, Normand Trottier
Régie du logement, Annie Autonès
Régie du logement, Michel Beaudry
Régie du logement, Colette Boucher
Régie du logement, Pauline Cyr
Régie du logement, Jacques Gagnon
Régie du logement, Maria Matakias
Régie du logement, Benoît de Margerie
Régie du logement, Roland Poirier
Régie du logement, Thérèse Jutras
Secrétariat d'État du Canada, Lyne Lalonde
Secrétarait d'État du Canada, Jean-Marie Martin
Secrétariat d'État du Canada, Claire Pilon
Service correctionnel du Canada, Roland Deneault
Société canadienne des postes, Robert Favreau
Société canadienne des postes, Lise Sylvain
Union des municipalités régionales de comté du Québec, Nicole Huneault
Université du Québec à Montréal, Claire Gélinas-Chebat
Université du Québec à Montréal, Lyne Kurtzman
Ville de Montréal, Lucie Bernier
Ville de Montréal, Magali Brunei
Ville de Montréal, Yves Chalifour
Ville de Montréal, Paule Drouin
Ville de Montréal, Louise Robichaud
Ville de Montréal, Robert Sauriol
Isabelle Binette, étudiante
Gérald Castonguay, formateur d'adultes
Diane Dubé, formatrice d'adultes
Pierre Majeau, consultant en ressources humaines
Andréa Richardson, étudiante
Services à la population (communautaire)
Bureau de consultation jeunesse, Lucie Bélanger
Centre d'éducation et d'action des femmes, Danielle Fournier
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, Thérèse Leblanc
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, Richard Morin
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine, Pierre Simard
Centre de formation populaire, Lise Gervais
Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi (COFFRE), Martine Roy
Centre d'orientation paralégale et sociale pour immigrants, Zorka Kovacic
Centre des Femmes en emploi, Johanne Forget
Centre St-Pierre, Lise Noël
Centrétape, Hélène Gautron
Comité des femmes chiliennes de Montréal, Eliana Cielo
Communauté enseignante de la Congrégation Notre-Dame, Marie Thibaudeau
Conférence religieuse canadienne - section du Québec, Clémence Laurin
Écho des femmes de la Petite Patrie, Danièle Bordeleau
Écho des femmes de la Petite Patrie, Augustine Gonzalez
Regroupement pour la relance économique et sociale du sud-ouest de Montréal (RÉSO), Nicole Gladu
Service d'orientation et de relance industrielle pour femmes (SORIF), Marie Leahey
Service d'orientation et de relance industrielle pour femmes (SORIF), Anne Raby
Service d'orientation et de relance industrielle pour femmes (SORIF), Raymonde Bergeron
Société des services Ozanam, Danielle Mongeau
Société Elizabeth Fry, Sylvie Boucher
Milieu syndical
Alliance des professeures et professeurs de Montréal (CEQ), Pierrette Bergeron
Alliance des professeures et professeurs de Montréal (CEQ), Ginette Leroux
Association professionnelle du personnel administratif de la CECM (CSN), Pierre Tremblay
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Francois Beauregard
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Lise Bourbeau
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Laurier Caron
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Rosette Côté
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Diane Fortin
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Michelle Savard
Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), Jean-Claude Tardif
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Gilles Boucher
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Michelle Bourget
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Claude Faucher
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Denis Giguère
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Mario Jodoin
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Pierre-Yvon Ouellet
Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Cécile Variasse
Comité national des jeunes de la CSN, Mario Guertin
Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jean Charest
Confédération des syndicats nationaux (CSN), Thérèse Jean
Confédération des syndicats nationaux (CSN), Céline Lamontagne
Confédération des syndicats nationaux (CSN), Marcel Pépin
Confédération des syndicats nationaux (CSN), Marie Roy
Conseil central de Montréal (CSN), Luc Garneau
Conseil central de Montréal (CSN), Suzanne Morin
Fédération des employées et employés de services publics (CSN), François Juneau
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ), Esther Désilets
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Johanne Deschamps
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Louise Miller
Fraternité nationale des charpentiers menuisiers, forestiers et travailleurs d'usine (FTQ), Gaston Boudreau
Syndicat de l'enseignement de Lanaudière (CEQ), Louise Patry
Syndicat de l'enseignement des Mille-Isles (CEQ), Louise Ducharme
Syndicat de l'enseignement des Mille-Isles (CEQ), Suzanne Harbour
Syndicat de l'enseignement du Grand Portage (CEQ), Pierrette O'Leary
Syndicat des cols bleus de Ville de Laval (CSD), Yvon Bourdon
Syndicat des salariés de la Boulangerie Weston (CSD), Daniel Beauchemin
Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada (FTQ), Alain Lamy
Syndicat national du lait (CSD), André Baribeau
Union des producteurs agricoles (UPA), Gaétane Fournier
Union des producteurs agricoles - Lanaudière (UPA), Odette Lavallée
Défense des droits
Au Bas de l'Échelle, Anick Druelle
Comité des bénéficiaires du Centre hospitalier L. H. Lafontaine, Lucien Landry
Conseil national des femmes juives du Canada, Craig Ryan
Fondation canadienne des droits humains, Shirley Sarna
Institut canadien d'éducation des adultes, Nicole Lacelle
Institut canadien d'éducation des adultes, Jacques Proulx
Institut canadien d'éducation des adultes, Lina Trudel
La Voix - Le Réseau canadien des aînés, Sylvie Deliencourt
Ligue des droits et libertés, Gérald McKenzie
L'R des Centres de femmes du Québec, Michèle Asselin
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), Diane Matte
Organisation nationale anti-pauvreté, Jane Gurr
Regroupement des maisons d'hébergement et de transition pour les femmes victimes de violence, Marie Pelchat
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, Lorraine Guay
Relais-femmes, Hélène Bohémier
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Patrick Alleyn
Réseau national d'action éducation femmes, Lucienne Cryte
Réseau national d'action éducation femmes, Louise Messier Nicole Kennedy, intervenante en maison d'hébergement
Médias et édition
Éditions Beauchemin, Isabelle Quentin
Guide Mont-Royal, Lucie Dufour
Office des communications sociales, Miville Boudreault
Radio-Québec, Céline Lavoie
Radio-Québec, May Poirier
Sylvain Couture, journaliste pigiste
Marcel Poirier, professeur de français, télévision communautaire
Alphabétisation
Atelier des lettres, Marie-Paule Garand
Atout-lire, Monique Olivier-Davignon
Atout-lire, Ginette Gauvin
Atout-lire, Colette Paquette
Carrefour d'éducation populaire, Diane Guérette
Carrefour d'éducation populaire de Pointe St-Charles, Lucie St-Germain
Centre Alpha de St-Honoré, Christiane Gagné
Centre d'alphabétisation de Jonquière, Carmen Bernier
Centre d'alphabétisation du comté Roberval, Aline Laforge
Centre de lecture et d'écriture (Clé), Léonie Couture
Centre de lecture et d'écriture (Clé), Carole Doré
Centre de lecture et d'écriture (Clé), Jeanne Francke
Centre de lecture et d'écriture (Clé), Diane Lambert
Centre de ressources en éducation populaire (CRÉP-CÉCM), Carole Forgues
Centre Mot à Mot Shipshaw, Claudette Bérubé
Clé des mots, Stéphane Boilard
Clé des mots, Anick Montpetit
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Laurent Santerre
Commission scolaire de la Haute-Gatineau, Josée Carie
Commission scolaire de la Haute-Gatineau, Nicole Duquette
Commission scolaire Outaouais Hull, Carole Fuoco
Commission scolaire régionale de Chambly, Louise Lemay
Commission scolaire Sault-St-Louis, Louise Dagenais
Commission scolaire Ste-Croix, Marie-Paule Désaulniers-Vaillancourt
Commission scolaire Vallée-de-la-Lièvre, Robert Langlois
Commission scolaire Vallée-de-la-Lièvre, Odette Lapointe
Comité d'éducation des adultes de St-Henri (CÉDA), Hélène Hagan
Comité d'entraide populaire en alphabétisation (CEPA), Lise Paradis
Comquat, Lucie Majeau
Équipe interrégionale en alphabétisation, Marie-Paule Dumas
Fondation québécoise pour l'alphabétisation, Jean-Yves Desjardins
La Boîte à lettres, Élise Massicotte
La Jarnigoine, Élise DeCoster
La Littérature de l'oreille, Johanne Carbonneau
La Magie des lettres, Suzanne Crête
La Magie des lettres, Colette Lacroix
La Magie des mots, Nicole Dumont
Les Ateliers mot à mot, Lise Leduc
LIRA, Louise Leblanc
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Nicole Lachapelle
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Berthe Lâchante
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Ginette Richard
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Micheline Séguin
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec, Sylvie Pelletier
The Centre for Literacy in the schools and the community, Marie-Francine Joron
France Poirier, formatrice
Dominique Thibault, étudiant
Partenaires hors Québec
Association sénégalaise de recherche et d'assistance au développement communautaire, Malanine Savane
Commission canadienne pour l'UNESCO, Isabelle Marquis
Conseil Alpha Kedgwick Fraser (N.-B.), Armand Savoie
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, Roger Doiron
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, Romain Landry
Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, Joseph Dione
Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, Malamine Sane
Frontier College, Irène Jansen
Programme Alphabétisation communautaire en Ontario (ACO), Richard R. Hudon
Service fransaskois d'éducation des adultes, Lucie Gauvin
Université d'Ottawa, Jacqueline Bossé-Andrieu
Personnes-ressources en démarche d'alphabétisation
Guy Bélanger, Atout-lire
Lise Brunelle, Arbralettre
Rhéo Desjardins, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Jeannine Dlon-Doucet, Atout-lire
Eugène Drouin, Atout-lire
Céline Foisy, La Jarnigoine
Alain Gagnon, Atout-lire
Jean Galipeau, La Jarnigoine
Guy Genest, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Martin GrandMaison, Arbralettre
Rachel Labelle, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Daniel Lachance, Arbralettre
Paul Langlois, Atout-lire
Michel Leduc, Clé des mots
Enrico Mattioli, La Jarnigoine
Alain Mireauh, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Lucie Montreuil, Clé des mots
Ginette Paiement, Arbralettre
Jeanne-d'Arc Perreauh, La Jarnigoine
Jean-Luc Savard, Atout-lire
Sylvie Sévigny, La Jarnigoine
Mariana Sirois, Atout-lire
Thérèse Tremblay, Atout-lire
Nicole Trudeau, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Membres du jury du concours DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES !
Richard Cayer, Centre de lecture et d'écriture (Clé)
Diane Labelle, Centre d'éducation des adultes de la commission scolaire Saint-Eustache
Johanne Pomerleau, Clé des mots
2. Autres participantes et participants
Animateur des plénières : Bernard Vallée (ICÉA)
Animatrices et animateurs des débats sur l'exercice des droits
Gisèle Lalande, journaliste, Radio-Canada
Danielle Fournier, professeure, École de service social, Université de Montréal
Antoine Char, chargé de cours, département des Communications, UQAM
Mlchaëlle Jean, journaliste et animatrice, Radio-Canada
Françoise Guénette, journaliste pigiste
Personnes-ressources des ateliers pratiques du dimanche matin
C-l Simplifier les formulaires
Nicole Fernbach (Centre de promotion de la lisibilité, Centre canadien d'information juridique)
C-2 Communiquer avec la clientèle
Marjolaine Lévesque (Communication-Québec)
C-3 Théâtre et vidéo
Pierre Slmard (animateur social)
André Variasse (vidéaste)
C-5 Aider les parents analphabètes
Marie Fecteau (Programme «J'apprends avec mon enfant », CECM)
Louise Sarrasin (Programme « Communication entre la famille et l'école », CEPGM)
C-6 La reconnaissance des compétences
Martine Roy (Centre d'orientation et de formation pour
femmes en recherche d'emploi, COFFRE)
C-7 Lire et enregistrer les textes d'information
Sylvie Roy (intervenante et chercheure en alphabétisation)
C-9 La bande dessinée
Carole Forgues (Centre de ressources en éducation populaire, CRÉP-CÉCM)
Michael McAndrew (Office de la protection du consommateur, OPC)
C-ll Les méthodes coopératives d'enseignement
Fernand Ouellet (Centre d'éducation interculturelle et de compréhension internationale, CÉICI)
C-l2 Campagne d'information pour un large public
Louis Delage (Cossette-Communication Marketing Québec)
Jean-Yves Desjardins (Fondation québécoise pour l'alphabétisation)
C-13 Le processus électoral
Lorraine Guay (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale)
Lucien Landry (Comité des bénéficiaires, Centre hospitalier L.-H. Lafontaine)
Françoise David (observatrice, élections au Nicaragua)
C-14 Médias écrits
Céline Landry (La Presse)
C-l5 Dépaysées, au bout du monde
Mireille Landry (Centre de ressources de la troisième avenue)
Carolle Delva (Maison d'Haïti)
Rose-Marie Mésidor
C-16 Mon client n'a pas compris
Roch Baillargeon (Aide juridique Saint-Georges-de-Beauce)
Hélène Bohémier (chargée de cours, Sciences juridiques, UQAM)
C-17 Plan d'action dans l'entreprise
Lucie Manoni (Société canadienne des postes)
Vincent Arsenault (Société canadienne des postes)
C-18 Favoriser la participation aux assemblées
Louise Desmarais (agente d'information)
Organisation
Comité organisateur : Louise Miller (RGPAQ), Maryse Perreault (RGPAQ), Micheline Jourdain (CEQ), Nicole Boily (ICÉA)
Coordination : Rachel Bélisle
Logistique : Sylvie Chénard
Recherche : Andrée Boucher
Communications : Marie Leclerc (ICÉA)
Administration : Francine Corbeil (ICÉA)
Inscription : Christlane Thomas (ICÉA)
Soutien technique aux communications et au concours : Éllette Beaulieu (ICÉA)
Suivi avec les volontaires : Nicole Caron (ICÉA)
Responsable de l'équipe d'orientation : Hélène Paré (ICÉA)
Exposition DES IMPRIMÉS ACCESSIBLES ! : Bernard Vallée (ICÉA)
Accompagnement : Carole Guérin
Responsable des ententes avec l'Université du Québec à Montréal : Roland Côté (UQAM)
Horaire des activités
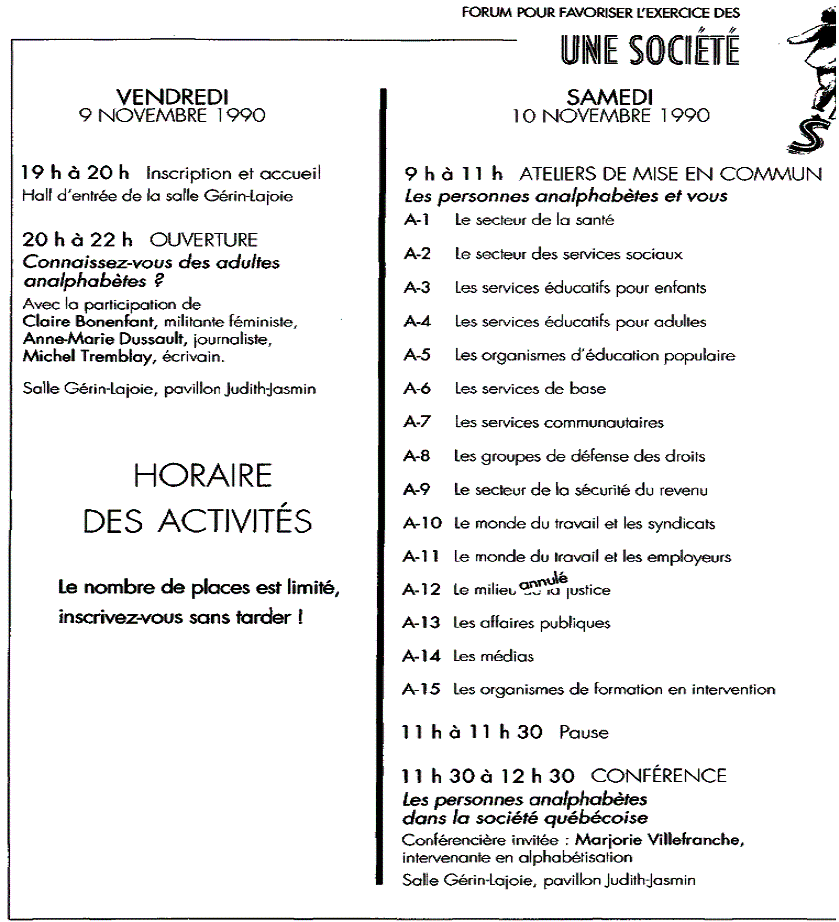
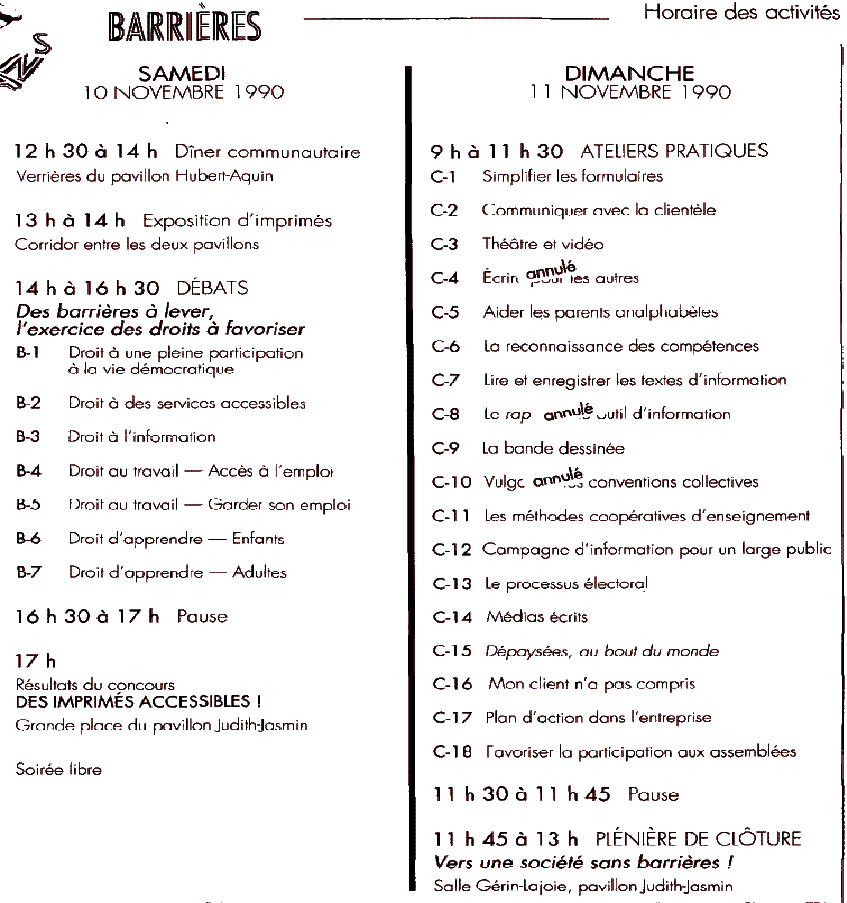
Annexe 3 : Quelques adresses
Alphabétisation
1. Services directs
1.1 Groupes populaires
Il existe des groupes populaires d'alphabétisation dans la plupart des régions du Québec. Une quarantaine d'entre eux sont membres du RGPAQ et ont été associés à la réflexion du forum.
BAS ST-LAURENT |
|
Centre d'alphabétisation des Basques 400, rue Jean Rioux Trois-Pistoles GOL 4K0 (418)851-1111 poste 100 (418)851-3320 |
SAGUENAY-LAC ST-JEAN |
|
Alpha-Albanel 306, rue de l'Église Albanel G0W 1A0 (418) 279-5702 |
|
Centre d'alpha du comté de Roberval 1286, Chanoine Boivin St-Félicien G8K 2C6 (418)679-5737 |
|
Groupe centre Lac d'Alma 475, rue St-Bernard ouest Alma G8B 4R1 (418) 668-3357 |
|
Centre d'alphabétisation de Jonquière 1975, Ozanne Jonquière, G7X 5B1 (418)547-7514 |
|
Centre alpha de la Baie 802, boul. Grande Baie nord La Baie G7B 3K7 (418) 544-2586 |
|
Centre alpha de St-Honoré 1970, rue Hôtel de Ville St-Honoré G0V 1L0 (418)673-4801 |
|
Centre mot-à-mot 3760, rue St-Léonard Shipshaw G0V 1V0 (418)695-5385 |
|
Lettres vivantes 709, rue Gauthier Larouche G0W 1Z0 (418) 542-5675 |
QUÉBEC |
|
Atout-lire 325, rue Ste-Thérèse Québec G1K 1M9 (418) 524-9353 |
|
Alphabeille Vanier 217, rue Bélanger Ville Vanier G1M 1V6 (418) 683-3941 |
MAURICIE-BOIS-FRANCS |
|
Alpha-Nicolet 160, rue Frère Dominique C.P. 2550 Nicolet JOG 1E0 (819) 293-5745 |
|
C.O.M.S.E.P. 749, rue St-Maurice Trois-Rivières G9A 3P5 (819) 378-6963 |
|
Ludolettre 128, rue Ouellette C.P. 488 St-Léonard-d'Aston JOC 1M0 (819) 399-3023 (819) 399-2494 |
ESTRIE |
|
Arbralettre 31, rue King ouest Sherbrooke J1H1N5 (819) 562-1466 |
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN |
|
Atelier des lettres 1710, rue Beaudry Montréal H2L 3E7 (514)524-0507 |
|
Ateliers mot-à-mot 6497, rue Azilda Anjou H1K 2Z8 (514)354-4299 |
|
Carrefour d'éducation populaire de Pointe St-Charles 2356, rue Centre Montréal H3K 1J7 (514)596-4444 |
|
Centre de lecture et d'écriture 3684, rue Mentana Montréal H2L 3R3 (514)527-9097 |
|
Centre haïtien d'animation et d'intervention sociale 7700, avenue d'Outremont C.P. 681, Succ. Mont-Royal Ville Mont-Royal H3P 3G4 (514) 271-7563 |
|
Centre portugais de référence et de promotion sociale 4050, rue St-Urbain Montréal H2W 1V3 (514)842-8045 |
|
Centre des lettres et des mots 8733, rue Hochelaga Montréal H1L 2M8 (514) 355-1641 |
|
Collectif de recherche et d'intervention Kiskeya (CRIK) 7115, Chemin Côte-des-Neiges Montréal H3R 2M2 (514)735-8867 |
|
Comité d'éducation des adultes de St-Henri (CÉDA) 2515, rue Delisle Montréal H3J 1K8 (514)596-4422 |
|
Centre N'a Rive 7027, rue St-Denis Montréal H2S 2S5 (514)278-2157 |
|
La jarnigoine 6815, rue St-Denis Montréal H2S 2S3 (514)273-6683 |
|
Lettres en main 2886, boul. Rosemont Montréal H1Y 1L7 (514) 729-3056 |
|
Maison d'Haïti 8833, boul. St-Michel Montréal H1Z3G3 (514)326-3022 |
|
Tour de lire 1437, boul. Pie LX Montréal HIV 2C2 (514)521-2075 |
|
Un Mondalire 14 224, rue Demontigny Montréal H1A 1K7 (514) 642-2279 |
MONTÉRÉGIE |
|
Boîte à lettres 112, rueNobert Longueuil J4J2Y9 (514)646-9273 |
|
Clé des mots 9, boul. Montcalm nord bureau 415 CandiacJ5R3L5 (514)659-7941 |
|
Comquat inc. 95, 5e avenue Pincourt DorionJ7V 5K8 (514)453-5226 |
|
La Porte ouverte 439, boul. Séminaire-nord St-Jean-sur-le-RichelieuJ3B 5L4 (514)349-6827 |
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE |
|
ABC des Manoirs 568, rue Léon Martel Terrebonne J6W 2J8 (514) 471-6928 |
|
Coop de services multiples Lanaudière 2566, rue Victoria Ste-Julienne JOK 2T0 (514) 831-3333 |
|
Regroupement des assistés sociaux de Joliette-métro 181, rue Lajoie sud Joliette J6E 5L3 614)759-7977 |
|
Regroupement des services communautaires de Berthier 584, rue Montcalm C.P. 1439 Berthierville JOK 1A0 (514) 836-7122 |
|
Alpha-Laurentides C.P. 351 Ste-Agathe-des-MontsJ8C 3C6 (819)326-3733 |
OUTAOUAIS |
|
Comité alpha Papineau 580, boul. Cité des Jeunes C.P. 7 Buckingham J8L 2X1 (819) 986-7506 |
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE |
|
Alpha-Témis 1019, route 382 LaverlochèreJOZ 2P0 (819)765-3431 |
CÔTE-NORD |
|
Lira 400, rue Arnaud Sept-Îles G4R 3A9 (418)968-9843 |
|
Popco inc. C.P. 366 Port-Cartier G5B 2G9 (418) 766-8047 |
1.2 Alphabétisation dans les commissions scolaires
On peut communiquer directement avec la commission scolaire de son territoire pour connaître les coordonnées des centres d'éducation des adultes qui font de l'alphabétisation. On peut également téléphoner au numéro 1-800361-9142, numéro général d'information sur les ressources en alphabétisation.
2. Organismes de coordination |
|
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 5040, boul. Saint-Laurent, bureau 1 Montréal (Québec) H2T 1R7 Téléphone : (514) 277-9976 |
|
Équipe interrégionale de concertation en alphabétisation C.P. 411, succ. Outremont Montréal (Québec) H2V 4N3 Téléphone : (514) 595-2047 Télécopieur : (514) 595-2081 |
|
Institut canadien d'éducation des adultes 506, rue Sainte-Catherine est, bureau 800 Montréal (Québec) H2L 2C7 Téléphone : (514) 842-2766 Télécopieur : (514) 844-1598 |
3. Centres de documentation |
|
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) 1265, rue Berri, bureau 340 Montréal (Québec) H2L4X4 Téléphone : (514) 844-3674 Télécopieur : (514) 844-1598 |
|
Centre for Literacy Dawson College 3040, rue Sherbrooke ouest, bureau 4B1 Montréal (Québec) H3Z1A4 Téléphone : (514)931-8731 |
LANGUE COURANTE |
|
Centre de promotion de la lisibilité, section du Québec 1140, boul. de Maisonneuve ouest, bureau 1080 Montréal (Québec) H3A 1M8 Téléphone : (514) 845-4834 Télécopieur : (514) 845-2055 |
|
Centre canadien d'information juridique Centre de promotion de la lisibilité 600, avenue Eglinton est, bureau 205 Toronto (Ontario) M4P 1P3 Téléphone : (416)483-3802 Télécopieur : (416)483-4436 |