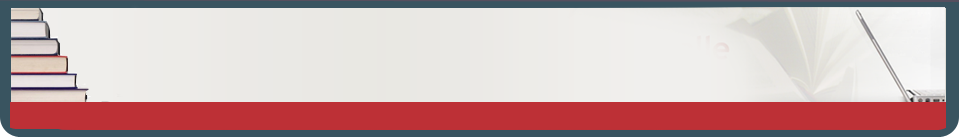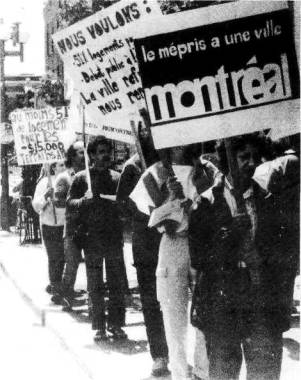Pour la survie des quartiers populaires : actes du colloque organisé par le FRAPRU les 6 et 7 octobre 1986, à Montréal
Publié par les Editions Luttes urbaines C.P. 263 Drummondville J2B 9Z9
Avec la collaboration du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 1212, rue Panet, local 322 H2L 2Y7
Premier trimestre 1987
Dessins: Patrick Riley
Photographie: Ross Peterson
Dépôt légal. Bibliothèque nationale du Canada et Montréal Bibliothèque nationale du Québec
TABLE DES MATIÈRES
UN COLLOQUE PAS COMME LES AUTRES
194 participants et participantes venant de tous les coins du Québec, de Sept-lles à Rouyn, de Hull à Matane, en passant par Rimouski, Roberval, Sherbrooke, Sorel, Shawinigan, Mont-Laurier et plusieurs quartiers de Montréal et Québec. Deux jours de débats, d'animation, de formation et de conscientisation sur les menaces et problèmes que nous vivons dans les quartiers populaires. Voilà ce qu'a permis le Colloque pour la survie des quartiers populaires tenu à Montréal, les 6 et 7 décembre 1986. Cet événement haut en couleur avait été organisé par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), un regroupement national actif depuis près d'une décennie dans la lutte pour le maintien de la population résidante dans les quartiers populaires de tout le Québec.
Le Colloque pour la survie des quartiers populaires visait deux grands objectifs. Faire le point sur la situation des quartiers populaires et favoriser des échanges sur les stratégies utilisées par les groupes dans la lutte pour la survie de ces quartiers et pour le droit au logement des faibles revenus. Le premier objectif fut le mieux atteint. Par le biais de l'animation du Théâtre Parminou et par le biais d'ateliers thématiques, les participantes ont pu prendre connaissance ou améliorer leurs connaissances des nouveaux défis auxquels sont quotidiennement confrontés les quartiers populaires: copropriété, rénovations domiciliaires, déplacement des populations, aménagement des quartiers.
Le colloque fut l'objet d'intéressantes communications de la part de personnes-ressources sollicitées par le FRAPRU pour entamer les différents ateliers. Le témoignage de ces personnes-ressources est d'autant plus pertinent qu'il s'agit de militant(e)s engagé(e)s, la plupart depuis de nombreuses années, dans la lutte au jour le jour pour le droit au logement des classes populaires, à Montréal, à Québec, à Hull ou dans la région des Bois-Francs.
Les exposés de ces personnes-ressources se retrouvent dans les pages suivantes regroupés sous les deux grands thèmes des ateliers: Où en sont nos quartiers? et Nos actions et nos luttes pour sauver nos quartiers.
Dans certains cas, ces exposés sont complétés des commentaires des participantes aux ateliers.
A la fin du document, on retrouvera une synthèse des débats les plus importants du Colloque.

C'est la troupe de théâtre Parminou, de Victoriaville, qui a ouvert le colloque. Parminou avait disposé la salle en 3 quartiers afin d'isoler les participant-e-s et leur remettre des avis d'éviction, question de provoquer l'assistance et de susciter la participation. La réaction fut au-delà de tout espoir, les résidant-e-s des autres quartiers formant spontanément une chaîne humaine autour du premier quartier touché et expulsant en deux temps trois mouvements le "spéculateur".
MOT D'OUVERTURE DU COLLOQUE
par François Saillant, du FRAPRU
Je veux vous souhaiter la bienvenue au Colloque pour la survie des quartiers populaires, un colloque qui risque fort d'être un événement en son genre, autant par le nombre de ses participants et participantes et par la diversité des groupes présents que par le nombre de villes qui y sont représentées.
Ce Colloque, il ne se veut pas un Colloque d'experts "universitaires". Il ne se veut pas une tribune pour politiciens en mal de promesses. Il se veut un Colloque populaire où ce sont les gens mêmes qui vivent les problèmes et qui luttent quotidiennement sur ceux-ci qui vont se prononcer. Et c'est là où la participation d'aujourd'hui est la plus importante.
Pour le FRAPRU, le Colloque pour la survie des quartiers populaires est à la fois une continuité et un moyen pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels nous sommes présentement confrontés dans nos quartiers et nos milieux respectifs. Une continuité parce que le FRAPRU est né suite à un Colloque du même genre qui s'est tenu en 1 978 pour faire le point sur les effets dans les quartiers populaires des programmes de rénovation urbaine. Une continuité parce que le FRAPRU a en 1 980 organisé une grande campagne précisément sur ce thème de la survie des quartiers populaires. Une continuité puisque c'est dans le but de permettre aux résidants et aux résidantes des quartiers populaires de demeurer dans leur quartier, dans des logements de qualité, à un prix qu'ils peuvent payer, que le FRAPRU lutte depuis 1981 pour obliger les gouvernements à construire plus de HLM et à aider plus de coopératives d'habitation.
Mais le Colloque, c'est aussi une occasion d'aller plus loin, en faisant le point sur les nouveaux défis auxquels nous avons eu à faire face surtout dans les dernières années. Ainsi, dans les grands centres-villes, nous avons assisté au cours des dernières années au développement à fond de train de ce qu'on a appelé l'embourgeoisement des quartiers populaires ou en d'autres mots le remplacement de la population traditionnelle de nos quartiers, retraités, assistés sociaux, petits travailleurs par une population plus jeune, plus instruite, plus professionnelle... et surtout plus cossue. Il suffit de vous promener autour du Centre Saint-Pierre, dans le quartier Centre-Sud, pour voir de vous-mêmes l'importance du phénomène. Dans Centre-Sud, on n'a pas seulement posé des lampadaires neufs; on n'a pas seulement remplacé les pavés; on n'a pas seulement aménagé des petits parcs en béton ou mis des arbres en boîte; on n'a pas seulement attiré des fines épiceries, des commerces sophistiqués et des marchands de tofu et de futon. On a aussi et surtout rénové des maisons à la tonne et transformé des logements ouvriers en condos... avec l'effet que la population qui y vivait avant a été chassée, chassée de leur logement, chassée de leur quartier. Et bienvenue aux yuppies! Quant à la population qui avait vécu traditionnellement dans le centre-ville, qui y avait enduré bien des misères, mais qui s'y était aussi bâtie un milieu de vie, on l'a déportée. Et on voit aujourd'hui de nouvelles zones de pauvreté faire leur apparition en périphérie des villes... à l'image des bidonvilles de l'Amérique Latine.
Dans les plus petites villes, on n'a peut-être pas assisté à un phénomène d'une telle ampleur, mais on a vu les commerces se transformer, souvent au détriment de l'habitation; on a vu les centres-villes se revitaliser; on a vu les loyers monter en flèche; on a vu les petits propriétaires tirer le diable par la queue pour arriver.
C'est ce portrait à jour de la situation de nos quartiers et des dangers qui nous guettent que nous voulons construire avec vous en fin de semaine.

Mais nous ne voulons pas que tracer le portrait de la situation. Nous voulons aussi regarder comment nous nous sommes organisés pour y faire face, les stratégies que nous avons utilisées, que ce soit les mobilisations, le lobbying, les recours légaux, la production de logements sociaux, les tentatives de réappropriation des logements de nos quartiers ou même la présentation de candidats à des élections municipales... Faire le point sur nos stratégies, ce n'est pas seulement se raconter nos bons coups et se flatter la bedaine, c'est surtout débattre des moyens pour mieux résister, pour arrêter de reculer.
Car nous avons perdu du terrain dans les dernières années. Nos quartiers ont été rasés par la rénovation et la copropriété avec une ampleur qui n'est pas sans rappeler les démolitions sauvages des années 60. La différence avec les années 60, c'est que dans ce temps-là on touchait d'un coup 600, 1 000, 1 200 personnes, tantôt pour une autoroute, tantôt pour un hôtel, un édifice à bureaux ou un parking. Maintenant, ça se fait en douce, maison par maison, personne par personne, mais le résultat est le même. Nous avons aussi perdu du terrain dans notre lutte pour du logement social, surtout dans la dernière année où les belles promesses des conservateurs fédéraux et des libéraux provinciaux d'aider les plus démunis se sont soldés par une perte de 3000 logements sociaux, par des loyers plus chers dans les coops, par une perte d'accessibilité de ces logements.
Il faut arrêter de reculer et pour cela, il faut mieux s'organiser, il faut donner du mordant et de l'efficacité à nos luttes quotidiennes. Si le Colloque ne nous permet que de faire un petit pas en ce sens, il aura déjà été un grand succès. Bon colloque.
OÙ EN SONT NOS QUARTIERS
Ateliers du samedi 6 décembre
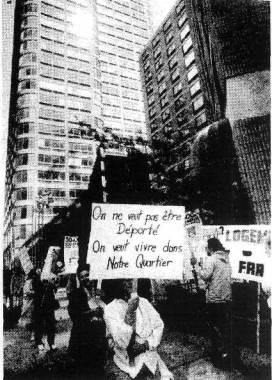
Atelier 1 : L'impact de la copropriété
COMMENT ON VEND LE PLATEAU MONT-ROYAL
par Pierre Marquis, du Comité Logement Saint-Louis (Montréal)
L'objectif prioritaire des différents paliers de gouvernement, pour la décennie 80, vise à mettre fin à l'Etat providence. Les moyens mis de l'avant sont connus, il s'agit de rationaliser les services offerts par l'Etat. On parle de désengagement et de la richesse du secteur privé.
L'habitation n'échappe pas à ce phénomène des temps modernes. L'orientation proposée par l'Etat en matière d'habitation se résume à favoriser l'accession à la propriété et à réinstaurer la libre concurrence. Dans la pratique, le gouvernement québécois envisage d'abolir ou de restreindre les pouvoirs de la Régie du logement et il avantage par ses programmes (exonération du gain en capital ou du revenu net, REEL, Corvée-Habitation,...), l'accession à la propriété privée.
La levée du moratoire sur les conversions en copropriété divise, prévue pour juillet 87, s'inscrit dans ce courant. La conversion des immeubles en copropriété est présentée comme l'occasion inespérée permettant aux locataires à revenu modeste d'accéder à la propriété.
La réalité n'est pas aussi encourageante! 51.2% des ménages locataires ont un revenu inférieur à $1 5,000. Loin de diminuer, cette proportion a augmenté de 2.6% entre 1971 et 1 981. Ces ménages locataires consacrent 40% de leur revenu pour se loger. Strictement d'un point de vue économique, ces locataires sont incapables financièrement d'acheter un immeuble ou un logement. Ils ne possèdent pas d'épargne et les institutions prêteuses ne leur fournissent aucune aide financière.
|
LA COPROPRIÉTÉ: SA DÉFINITION ET LA RÉGLEMENTATION DE LA CONVERSION |
||
|
|
Copropriété divise ou condominium |
Copropriété indivise |
|
définition |
chaque propriétaire de condominiums est propriétaire de son logement et d'une quote-part des parties communes (vestibule, toit, voie d'accès...) permise dans les immeubles neufs ou commerciaux. |
chaque propriétaire possède une partie proportionnelle à son investissement dans l'immeuble. Il peut occuper un logement sans en être propriétaire exclusif. permise dans les immeubles de 4 lologements et moins. |
|
réglementation |
défendue dans les logements loués, offerts en location ou vacants après location sans autorisation de la Régie. |
Défendue dans les immeubles de 5 logements ou plus. |
La situation actuelle, avec un moratoire sur la conversion en copropriété divise, affecte dramatiquement les ménages à faible revenu. Ils sont victimes d'harcèlement et d'intimidation et conséquemment ils perdent leur logement. Comme ils ne peuvent pas se reloger aux mêmes conditions, ils quittent le quartier où ils s'entassent.
La conversion de logements locatifs en copropriété est un enjeu vital pour les ménages à faible revenu. Les organismes voués à la défense des plus démunis, en commençant par les groupes logement, se doivent de réagir. Nous devons assumer notre rôle d'éducation et de sensibilisation sur ce sujet.
* Ce texte a été initialement produit pour la Coalition Sauvons nos logements qui l'a publié à l'automne 1986.

L'IMPACT DE LA CONVERSION
A) La spéculation
C'est dans les quartiers où la conversion en copropriété est à la mode que l'on retrouve les plus fortes valeurs marchandes.
Habituellement, dans les secteurs où la conversion en copropriété n'est pas appliquée systématiquement, le prix de vente des bâtiments locatifs se situe autour de cinq fois les revenus d'immeuble. Cet indice permet au propriétaire de rentabiliser son investissement tout en maintenant les loyers à leur niveau. Plus l'indice est élevé plus les hausses de loyer devront être importantes pour rentabiliser ou du moins amortir l'investissement.
Dans le Plateau Mont-Royal, comme dans plusieurs autres quartiers urbains, le prix de vente des immeubles est de huit, neuf, dix et onze fois les revenus annuels générés par les loyers.
Exemple:
Bâtiments de quatre logements loués à $250 chacun
Revenu annuel: $250 x 4 logements x 12 mois égale $12,000.
|
revenu annuel |
indice |
valeur marchande |
loyer de rentabilité |
|
$12,000 |
5 |
$ 60,000 |
$250 |
|
$12,000 |
8 |
$ 96,000 |
$400 |
|
$12,000 |
9 |
$108,000 |
$450 |
|
$12,000 |
10 |
$120,000 |
$500 |
|
$12,000 |
11 |
$132,000 |
$550 |
Un propriétaire qui achète l'immeuble de l'exemple précédent devra minimalement hausser ses loyers de $1 50 par mois, s'il désire rentabiliser son investissement.
Un locataire qui n'a pas assez d'argent pour amortir la hausse de loyer ou pour acheter son logement aura à investir énormément d'énergie s'il veut demeurer dans les lieux.
Les sociétés immobilières et les gros propriétaires ont développé avec les années une expertise difficile à contrer pour expulser les locataires. Ils procèdent souvent illégalement en envoyant des avis de réparations majeures non conformes souvent "agrémentés" d'un avis d'augmentation hors délai, des avis de conversion en copropriété laissant sous-entendre de futures reprises de possession ou encore des offres d'achat de baux (pour locataires récalcitrants seulement...). A force de harcèlement, ils parviennent à installer un climat de panique chez les locataires.
Habituellement, en moins d'un an, ils réussissent à vider les lieux. Les locataires mal informés de leurs droits se font coincer. Les mieux informés, eux, cèdent à cause de la complexité et des coûts élevés des recours juridiques.
B) Rétrécissement du stock de logements locatifs: Evictions
La conversion en copropriété à deux effets majeurs sur le stock de logements locatifs.
- abaissement du taux d'inoccupation
- rétrécissement du stock de logements locatifs
Le phénomène de la conversion en copropriété entraîne une rareté des logements à louer. Les propriétaires deviennent très sélectifs dans le choix de leurs locataires. La discrimination se pratique régulièrement lorsqu'un locataire se cherche un logement.
Dans le Plateau Mont-Royal, depuis 1981, la vente en propriété mixte (1,183 logements) et la copropriété (11,815 logements) ont fait disparaître 13,000 logements locatifs. Le stock de logements locatifs est passé de 42,656 à 29,657 logements.
Depuis 1981, environ 22,000 personnes ont été évincées de leur logement à cause de la copropriété. Il va de soi que le rétrécissement du stock de logements locatifs amène la population résidante traditionnelle à modifier leur habitude en matière d'habitation. On constate deux tendances chez les locataires évincés. La première consiste à sortir du quartier et la deuxième à partager un logement. Le phénomène de la colocation se développe non par choix mais par nécessité. Cette dernière solution respecte la capacité de payer des gens mais occasionne de sérieux inconvénients (perte de l'intimité, entassement,...).
C) Les sociétés immobilières: une sérieuse menace pour le droit au maintien dans les lieux.
En juin 86, les sociétés immobilières et les gros propriétaires possèdent plus de 8,000 des 29,000 logements locatifs du Plateau. Présentement, les promoteurs fouillent systématiquement le quartier. Ils attendent avec impatience le moment où le ministre Bourbeau lèvera le moratoire sur la conversion en copropriété divise. Des gros montants sont en jeux.
Parallèlement à cette course au trésor, plus de 34,000 personnes dépendent directement de prestations gouvernementales (assurance-chômage, bien-être social, pension de vieillesse). Ils résident dans les 29,000 logements locatifs du Plateau. Au rythme où les logements locatifs sont convertis (en moyenne 2,400 par année, depuis 1981) on prévoit une diminution de 5,000 logements locatifs d'ici 2 ans.
Le droit au maintien dans les lieux et le droit de rester locataire dans le Plateau sont sérieusement compromis. Le nombre de logements locatifs ne peut plus subir aucune perte car les locataires évincés devront obligatoirement quitter le quartier. La colocation a sa limite, celle du surpeuplement. Evincé par une conversion en copropriété ou évincé pour cause de surpeuplement, le résultat est le même. Les ménages locataires à faible revenu devront vivre l'exode.

D) Appropriation collective du logement:
Dans les quartiers où la conversion en copropriété est bien implantée, le développement de la formule "logement social" est sérieusement menacé.
Acheter des bâtiments susceptibles d'être convertis en coopératives et en O.S.B.L. est très difficile.
Pourquoi:
- Vitesse des transactions immobilières par rapport à la lenteur des délais administratifs pour constituer une coopérative ou un O.S.B.L.
- Les prix de vente des bâtiments sont trop élevés.
- Rareté des terrains et des bâtiments vacants.
- Programmes de financement insuffisants pour concurrencer le contexte spéculatif.
- Peu de participation de la ville de Montréal.
Dans le Plateau, il a actuellement 891 unités de logement H.L.M. Il n'a pas eu de construction depuis 1 984. La liste d'attente fixée par les critères très sélectifs de l'Office municipal de l'habitation est de 1615 unités.
LE MORATOIRE ET SON INEFFICACITE
- Comme un propriétaire d'une partie indivise peut reprendre possession d'un logement situé dans un immeuble de 4 logements ou moins, la conversion y est possible car nul copropriétaire n'est tenu de rester dans l'indivision.
- Comme nul ne peut enregistrer une déclaration en condominium sans l'autorisation de la Régie, il s'agit de s'organiser pour ne pas avoir à obtenir cette autorisation en s'excluant du cadre de la loi 107.
- La Cour supérieure a reconnu que si des logements avaient été détruits, modifiés ou démolis, ceux-ci faisaient place à de nouveaux logements jamais mis en location.
- Par la démolition de bâtiments et la reconstitution d'immeubles neufs.
- Comme le moratoire consiste en certains articles de la loi de la Régie du logement et que le recours à celle-ci se base généralement sur l'initiative des gens de s'en prévaloir, il s'agit d'éviter que le locataire en fasse utilisation.
Pour un convertisseur, il suffit de se débarrasser des locataires par du harcèlement (des menaces de vente, des hausses abusives de loyer, de l'intimidation), des reprises de possession de mauvaise foi, des obtentions de résiliation de bail, l'évacuation permanente des locataires lors de réparations majeures.
EXEMPLE:
- Le locateur avise les locataires qu'il met fin au bail parce qu'il va entreprendre des rénovations et vendre en copropriété. L'avis est non-conforme mais les locataires ont tout de même quitté. Les logements furent vendus 6 mois plus tard en condominium de luxe (rue St-Hubert).
- 12 unités de logements furent démolis. Les locataires avaient quitté. Rien n'empêche que les nouveaux logements construits puissent être vendus en condominiums (rue Mentana).
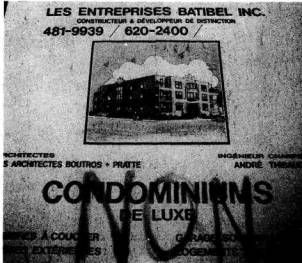
Une nouvelle forme de résistance à l'arrivée massive des condos dans nos quartiers a fait son apparition récemment: les graffitis sur les murs, les trottoirs ou les pancartes annonçant de nouveaux projets.
LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS
Les municipalités ont un rôle important à jouer en ce qui concerne le maintien du stock de logements locatifs et la conversion en copropriété; par conséquent nombre de leurs interventions ont rapport au droit au maintien dans les lieux des locataires.
Elles:
- conçoivent leurs schémas d'aménagement, leurs règlements de zonage...
- émettent des permis de construction, de rénovation, de démolition, etc.
- distribuent des programmes de subvention à la restauration, etc.
- possèdent des terrains (opération 20,000 log. à Mtl.)
- fournissent des services d'inspection, etc.
En plus de la question de la taxation foncière, il est facile de voir que les municipalités ont le pouvoir d'intervenir dans le domaine de l'habitation en ce qui a trait à la conversion.
A Montréal, par exemple, pourquoi n'offrirait-on pas un service d'information aux locataires au service de l'habitation ou de la restauration? Pourquoi ne vérifierait-on pas si les droits des locataires sont respectés avant d'accorder un permis de démolition, de restauration, etc.? Pourquoi ne réserverait-on pas des terrains pour la construction de logements sociaux? Pourquoi n'imposerait-on pas un moratoire sur la diminution du parc de logements locatifs à bas loyer? Pourquoi ne respecterait-on pas le droit des ménages à bas revenus de demeurer dans leurs quartiers?
Atelier 2: Les programmes de rénovation
QUAND LA RÉNOVATION A LE MÊME EFFET QUE LE BULLDOZER
par François Saillant, du FRAPRU
Pour beaucoup de résidants et de résidantes des quartiers populaires, les années 60 et 70 ont été synonymes de démolitions. A Québec, à Montréal, à Hull, des milliers de logements ouvriers ont été démolis et des centaines de milliers de personnes déplacées. Depuis le milieu des années 70, on ne démolit plus autant... on rénove. Pourtant, les résultats sont les mêmes. Loin de bénéficier des améliorations apportées à leur logement, les anciens locataires se voient forcés de déménager. Les bulldozers nous expulsaient, c'est au tour des décapeurs... et surtout des spéculateurs qui, après avoir laissé délibérément nos logements se taudifier (ou avoir acheté des logements déjà taudifiés), les retapent pour augmenter les loyers ou mieux encore pour les transformer en condos.
Une étude récente du Laboratoire de recherches en sciences immobilières de l'Université du Québec à Montréal (un organisme qui n'a jamais eu pour réputation d'être proche des préoccupations des locataires) a fourni des données révélatrices sur les effets de la restauration domiciliaire dans les quartiers centraux de Montréal. On y apprend notamment:
- que le loyer après restauration est de 38% supérieur au loyer avant les travaux;
- que la restauration aboutit bien souvent à la conversion du logement en copropriété (dans 67% des cas).
On y apprend surtout que 90% des logements restaurés sont occupés par de nouveaux résidants plus jeunes, plus scolarisés, mieux placés dans la hiérarchie sociale et surtout plus cossus. Le portrait type de l'acheteur de copropriété dans un logement restauré est à peu près le suivant: revenu de $42,000 par année; âge de moins de 40 ans; formation universitaire; professionnel ou col blanc...
Ailleurs en province, la rénovation, sans être aussi avancée qu'à Montréal, a des effets à peu près similaires. Une étude récente exécutée sur le quartier Saint-Sauveur à Québec a permis de constater que 55% des locataires de logements restaurés sont en fait de nouveaux locataires. Même chose à Sherbrooke où une étude du Comité des citoyen(ne)s de l'Accents a permis de constater que, dans le quartier Centre-Sud, la restauration de maisons accompagnant le Programme d'amélioration de quartier (un programme de rénovation urbaine qui touchait une quarantaine de villes dans les années 70) avait entraîné des hausses de loyer de 73% et que 63% des locataires avait dû quitter leur logement.
Donc partout les rénovations ont donné les mêmes résultats pour les locataires: hausses de loyer; obligation de déménager; remplacement par une nouvelle population plus fortunée.
Les études déjà mentionnées ont aussi fait ressortir deux phénomènes sur lesquels je voudrais maintenant attirer votre attention.
Le premier, c'est que pour une bonne part, les rénovations se font avec l'aide de subventions gouvernementales. Dans les quartiers centraux de Montréal, 68% de ceux qui ont fait des rénovations l'ont fait avec des subventions. Les gouvernements sont donc complices non seulement des hausses de loyer et des évictions dont nous sommes victimes, mais aussi des manoeuvres des spéculateurs. Car tous les moyens sont bons quand vient le temps de rénover: démolir les plafonds sur la tête des locataires comme ça s'est fait tout récemment encore dans le quartier Pointe Saint-Charles; couper l'eau chaude et le chauffage en plein hiver, comme s'est arrivé il y a quelques années sur la rue Esplanade (dans ce qui est devenu un des "beaux" condos de Montréal); utiliser les services de fiers-à-bras comme ça se fait encore présentement sur le Plateau Mont-Royal. La liste pourrait être longue, les spéculateurs n'étant pas à cours d'imagination quand vient le temps d'expulser les locataires.
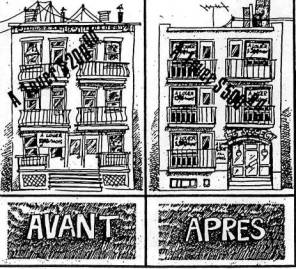
Dernière remarque, qui vient de l'étude sur Saint-Sauveur: les augmentations de loyer sont moins considérables et les expulsions moins importantes quand les rénovations sont faites par des propriétaires occupants plutôt que par des propriétaires bailleurs de l'extérieur du quartier. On sait pourtant que les subventions à la restauration n'ont jamais été faites à la mesure de ces petits propriétaires: subventions trop basses, obligation de faire certains travaux inutiles et coûteux. Ne faudrait-il pas obliger les gouvernements à diriger les subventions à la restauration vers ces petits propriétaires, ainsi que vers les coopératives d'habitation et. les OSBL (qui se sont révélés des formules non-spéculatives et permettant le maintien des résidants), plutôt que vers des proprios dont on sait bien qu'ils ne visent qu'à faire le plus de fric possible... peu importe les moyens?
Voyons maintenant si la situation va changer avec le nouveau programme d'aide à la rénovation lancé récemment par les gouvernements fédéral et provincial.
LE P.A.R.C.Q.: LES EXPULSIONS VONT CONTINUER
Le P.A.R.C.Q. est le nouveau programme d'aide à la restauration qui va remplacer le PAREL et le Loginove. Il sera financé à 50-50 par le fédéral et le provincial, mais sera administré par la Société d'habitation du Québec. Il touchera à la fois les propriétaires-bailleurs, les propriétaires occupants et la transformation de logements pour les personnes handicapées.
Programme pour les propriétaires-bailleurs
A première vue, le P.A.R.C.Q. semble offrir des améliorations pour les locataires:
- les propriétaires devront respecter un loyer maximal après rénovation, ainsi que les modalités d'augmentation de ce loyer;
- ils ne pourront pas reprendre possession de ces logements, ni pour eux ni pour les membres de leur famille;
- ils devront en respecter le caractère locatif;
- toutes ces garanties sont valables pour une durée maximale de 15 ans.
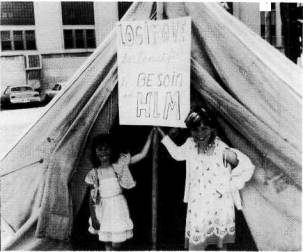
Une analyse un peu plus approfondie nous oblige cependant à déchanter.
- Le contrôle sur 1 5 ans (du loyer, de la préservation du caractère locatif du logement, des reprises de possession, etc.) sera exercé par la Société d'habitation du Québec... et ce par échantillonnage. On peut douter du sérieux d'un tel contrôle, surtout pour mater les manoeuvres des spéculateurs. Ce contrôle risque fort d'être tout aussi facilement contournable que l'Entente propriétaire-locataire de Loginove.
- Même si les loyers sont bien fixés et bien contrôlés, les rénovations se solderont malgré tout par des hausses de loyer que ne pourraient assumer la grande majorité des locataires à faibles revenus. Des calculs exécutés avec les formulaires de la S.H.Q. sur des logements 45 pièces 1 /2 dont les loyers avant restauration se situent entre $200 et $300 par mois nous permettent de constater que les locataires y assumeront des augmentations de 26 à 46%. (Les subventions à la restauration dépendront du loyer avant rénovation plus les loyers seront élevés, plus les subventions seront basses. Or, les hausses de loyer seront fixées à partir de la partie non-subventionnée des travaux).
- L'aide au relogement des locataires devant quitter temporairement leur logement en raison des travaux est encore plus ridicule que le $325 maximum prévu dans le programme Loginove: $ 100 pour une personne, $200 pour deux, $250 pour trois, etc. Il y a quelques années, le Comité des citoyen(ne)s du quartier Saint-Sauveur, à Québec, a déjà estimé à $800 les coûts moyens qu'entraînait un tel relogement forcé pour les locataires. On est bien loin de ce chiffre. Voilà un autre facteur qui va contribuer au départ définitif de bien des locataires.
Programme pour les propriétaires occupants
Pour les petits propriétaires occupants, le programme représente un net recul. Un ménage de 2 personnes gagnant plus de $15,000 par année n'aura plus droit à aucune forme d'aide à la restauration dans la grande majorité des villes du Québec. Seules exceptions: Hull où le seuil d'admissibilité sera de $1 7,500 et Québec où il sera de $1 6,000. Une famille de 4 personnes perdra toute aide à partir de $ 1 7,500 ($ 1 6,000 dans les plus petites villes). C'est donc dire que beaucoup de ménages considérés comme étant sous le seuil de la pauvreté ne seront même plus admissibles aux subventions pour propriétaires occupants.
Et l'aide reçue sera de beaucoup inférieure à ce qu'elle était dans le passé: $5,000 pour un ménage gagnant moins de $ 1 3,000, $4,000 pour les moins de $ 1 5,000, $3,500 pour un revenu de $16,000... Non seulement demande-t-on aux propriétaires occupants d'être "pauvres raides" pour avoir droit aux subventions, mais on ne leur subventionne qu'une partie minime des travaux, leur demandant de se débrouiller pour trouver le reste de l'argent... avec une capacité d'emprunt à peu près nulle.
Les résultats sont évidents: délabrement du stock de logements possédés par les petits propriétaires et vente possible à des propriétaires aux reins plus solides.
Programme pour les personnes handicapées
L'aide disponible pour la transformation de logements pour les personnes handicapées a été très sérieusement coupée avec le transfert de l'ensemble des programmes disponibles auparavant à cette fin vers le seul P.A.R.C.Q. Les personnes handicapées ne pourront maintenant bénéficier que de la moitié et même du tiers des sommes qu'elles pouvaient auparavant toucher pour adapter leur logement.
Ajoutez à tous ces problèmes que les gouvernements ne subventionneront plus les coops et OSBL ayant reçu une autre forme d'aide au logement social, et vous verrez que le P.A.R.C.Q. n'est pas meilleur que le Loginove, qu'il aura les mêmes effets d'expulsion des résidants des quartiers populaires et qu'on nous ment effrontément à Ottawa et à Québec quand on nous dit qu'il a été conçu "au profit des ménages les plus démunis"!
Atelier 3: Le déplacement des populations
LE DÉPLACEMENT DES POPULATIONS: BUMPING ET DUMPING SUR LE FRONT URBAIN
par Suzanne LaFerrière, de la Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles (Montréal)
Question: Identifiez une matière première que Montréal exporte de plus en plus?
Réponse: Les citoyen(ne)s de ses quartiers populaires.
Nos vieux quartiers se transforment. Non, il ne s'agit plus, à tout le moins dans les grands centres, des démolitions et expropriations massives qui décimaient nos quartiers il y a 15 ans. Ce qui se passe est plus subtil, plus insidieux: aujourd'hui, l'espace populaire n'est plus menacé par le bulldozer, mais par le Yuppie.1
Je gentrifie, tu gentrifies, etc.
Depuis quelques années, les vieux quartiers populaires sont l'objet de nouvelles convoitises. Des couches sociales montantes, scolarisées, mieux nanties viennent s'y installer. Près des lieux de travail du centre-ville, près des services et des activités culturelles, les vieux quartiers offrent en plus de grands logis "pittoresques". Nombreux sont ceux qui, désormais, ne quitteront plus la ville pour s'installer dans des banlieues lointaines, trop "familiales", peu "branchées".
Ce phénomène, marginal dans les années '70 (pensons au Carré Saint-Louis), a pris avec les années '80 l'allure d'un véritable mouvement...
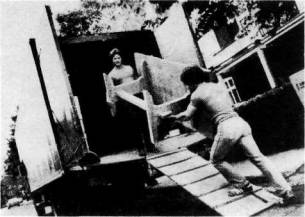
L'installation des arrivants dans leurs nouvelles pénates ne se fait pas sans casser des oeufs. Dans la majorité des cas, c'est le scénario reprise de possession plus éviction des locataires. Les transformations en copropriétés sont courantes. Le tandem rénovations plus hausses de loyers est aussi répandu, mis en oeuvre par des propriétaires-bailleurs (souvent subventionnés) voulant capitaliser sur la valeur locative accrue des vieux quartiers. Dans les secteurs centraux où les terrains vacants sont nombreux, des constructions neuves, en changeant le panorama, stimulent le marché et entraînent hausses de prix et hausses de loyers dans les bâtiments avoisinants. Un condo en attire un autre... Des commerces nouveaux emboîtent le pas, adaptés aux goûts d'une clientèle plus à l'aise. La gentrification2 devient visible. Mais, dans tout ceci, que deviennent les "anciens", la population traditionnelle à faibles revenus?
La réponse à cette question commence à apparaître. Au Québec, le phénomène de gentrification est encore jeune, frappant surtout, et de façon inégale, les vieux quartiers de Montréal, Québec, Hull. Mais l'expérience de nombreuses villes américaines nous renseigne sur le processus en cours: la gentrification s'accompagne quasi-fatalement du déplacement de la population à faibles revenus hors des vieux quartiers, voire même hors de la ville.
Prenant de l'ampleur au Québec, le mouvement de déplacement des populations risque d'avoir un impact aussi grand que l'épidémie de démolitions urbaines qui, à Montréal seulement, entre 1 960 et 1975, avait détruit près de 30,000 logis.
Plusieurs intervenants parlent actuellement d'exode, de déportation. L'affirmation semble grosse? Certains Don Quichotte seraient-ils en manque de noble cause? Aux gens des quartiers populaires, la réalité et la gravité de la situation ne font aujourd'hui plus de doute, et les observations des dernières années nous permettent maintenant de répondre à trois grands "mythes" qui circulent actuellement sur la gentrification et le bumping populaire qui l'accompagne.
Ces trois mythes pourraient se présenter ainsi:
- le déplacement de population est un phénomène marginal, peu étendu;
- le déplacement de population est nécessaire et bénéfique pour les vieux quartiers;
- le déplacement de population signifie une amélioration des conditions de vie des gens déplacés.
Ces trois arguments sont souvent repris par des promoteurs et diverses instances gouvernementales pour justifier leur action (ou inaction) dans ce qui s'annonce un des dossiers urbains les plus lourds de conséquences sociales.
1. Le mythe du "Petit secteur problème mineur"
On entend ici que la gentrification ne toucherait que quelques quartiers (ou fractions de quartiers) et qu'elle n'aurait d'incidence que sur un petit nombre de ménages possiblement relogés.
Précisons d'abord que la réponse à cet argument ne peut pas venir des statistiques provenant du dernier recensement disponible (i.e. 1981). D'une part, et les agents d'immeubles le confirment, l'intérêt large porté aux vieux quartiers date du début des années 80. De plus, c'est à cette époque qu'à Montréal, l'administration municipale désireuse de capitaliser sur l'engouement naissant, voulant redorer son assiette fiscale et corriger la démographie chancelante, mettait au point son discours de "Retour à la ville" et produisait, pour les quartiers populaires, des objectifs dits de revitalisation.3 Apparaissent alors: les PIQA ("Programmes d'intervention en quartiers anciens", embellissement de rues et ruelles et rénovations forcées); les sociétés para-municipales (Somham, Sodémont, etc.) de construction et rénovation résidentielles; et l'Opération 20,000 logements, de ventes de terrains municipaux pour fins de construction.
L'effet combiné de la Ville et du marché ne saurait donc être mesuré dans les statistiques de 1981. D'ailleurs, ces données indiquaient encore le fameux "T" inversé de la pauvreté, bien visible sur les cartes sociologiques de Montréal.
Pourtant, un tour d'horizon des quartiers centraux actuels (1986) indique que, côté transformations, "ils n'en meurent pas tous mais tous sont atteints".
Quelques indices:
Le Comité-logement Saint-Louis révélait récemment qu'au moins 22,000 (20% des locataires du Plateau Mont-Royal ont dû quitter leur logis, entre 1981 et 1986, suite à des conversions en copropriétés.4 On saisit ainsi pourquoi, dans ce quartier, la proportion de ménages locataires, de 86% qu'elle était il y a cinq ans, soit maintenant de l'ordre de 50%. On doit ajouter au tableau les départs causés par les rénovations (i.e. dans les logements qui restent locatifs): on sait maintenant que 90% des locataires touchés ne retrouvent pas leur logis.5
Evidemment, le Plateau est perçu, avec raison, comme le quartier "gentrifié" par excellence. Mais gentrification et déplacement se vérifient aussi dans Pointe SaintCharles, quartier longtemps considéré comme "à l'écart". Dès 1984, les organismes communautaires locaux constataient que les rénovations majeures chassaient les locataires (le secteur nord du quartier touché à 20%)6, et que déjà à cette date, 40% des délogés devaient quitter le quartier pour se reloger. Les intervenants sociaux du secteur estiment que ce pourcentage de "déportation" est plus élevé actuellement, le coût des loyers ayant grimpé, rénovations obligent.
La situation se répète aussi dans le Centre-Sud, comme le révélait récemment une enquête du journal La Criée, et des quartiers comme Saint-Henri rapportent déjà que les "nouveaux" occupant les logis restaurés forment de 1 5 à 20% des ménages du quartier.7
Le phénomène ne fait que débuter, et des éléments nouveaux peuvent s'ajouter; certains scénarios, prévoyant la levée du moratoire sur les conversions en copropriétés divises (condos), estiment que 20,000 logis pourraient disparaître du marché locatif, en deux ans, si cette mesure se réalisait.8
A ceux qui seraient tentés de croire qu'il n'existe qu'une clientèle limitée pour les retours aux quartiers anciens (et que par conséquent le phénomène connaîtra bientôt ses bornes), l'exemple de la Petite Bourgogne apporte un éclairage intéressant. Ce quartier, longtemps laissé pour compte avec un nombre effarant de terrains vacants, a d'abord reçu des bâtiments de l'Opération 20,000 logements d'esthétique banlieusarde à des prix (subventionnés) relativement modestes. Le succès des premières mises en marché, changeant l'allure du secteur, a permis que les constructions suivantes se vendent plus chères. De phases en phases, on atteint maintenant, pour la fin du développement, des prix "musclés", des condos post-modernistes, et une clientèle de "vrais" yuppies. L'exemple indique qu'avec un marketing approprié et une aide de l'Etat, même une population "petite-classe-moyenne" (mes excuses aux sociologues...) peut participer, ne seraitce qu'au début, au phénomène de transformation des vieux quartiers.
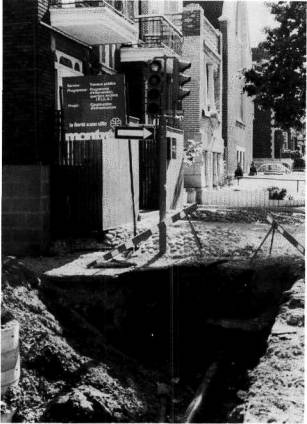
La Ville de Montréal a mis en place toute une série de programmes pour rendre la ville plus attrayante pour de nouvelles clientèles plus cossues: PIQA, revitalisation des artères commerciales, aide à la restauration résidentielle...
De plus, certaines interventions municipales (constructions ou rénovations) peuvent servir à rapiécer un secteur, dans l'objectif éventuel de déclencher l'intérêt des investisseurs privés dans un quartier jugé trop rébarbatif. C'est le cas à Pointe Saint-Charles, à Montréal, et sur les berges de la rivière St-Charles, à Québec (Notons qu'à Montréal, il n'est pas question de HLM; les constructions en question sont à prix dits "modérés", au double des loyers du quartier).
2. Le mythe du gentrificateur-sauveur
Cet argument affirme que les quartiers populaires sont devenus (ou en voie de devenir) des ghettos, des pépinières de problèmes, et que la venue de nouveaux groupes sociaux va alléger la situation; dans la même foulée, l'argument soutient que l'économie locale (i.e. les commerces) sera stimulée et que les retombées atteindront tout le quartier.
Cet argument est sans doute celui qui ébranle le plus ceux qui veulent travailler pour améliorer les conditions de vie des gens à faibles revenus. Mais ici encore, la réalité parle autrement.
La mixité sociale dont il est question, et qui semble exister à l'heure actuelle (ne parle-t-on pas de 20% de nouveaux à St-Henri, donc aussi de 80% d'anciens?), est une situation illusoire car TRANSITOIRE. Si l'on constate que le marché est en pleine expansion (et les taux d'intérêts actuels excitent une spéculation frénétique à Montréal 9), on doit aussi constater qu'il n'existe que très peu de protection pour les anciens résidants. Les comités-logement dénoncent depuis longtemps les vides juridiques qui permettent évictions et rénovations. Les contraintes aux reprises de possession ne sont qu'affaires de délais.
Les lois du marché signifient le départ des plus démunis. Peut-on parler de mixité quand, comme cela s'est produit dans Pointe Saint-Charles, tous les assistés sociaux d'une rue ont dû quitter, suite à des rénovations?
C'est aussi la loi du marché qui fait que dans les secteurs gentrifiés, les anciens résidants voient leurs commerces traditionnels remplacés par des boutiques spécialisées qui, en plus de ne pas être garantes d'emplois locaux, ne correspondent guère aux besoins des gens à faibles revenus.
Le discours de la mixité sonne faux pour d'autres raisons, qui ne sont plus seulement économiques. Des conflits sociaux surgissent. Dans le sud-ouest de Montréal, des occupants de nouveaux condos ont fait circuler une pétition, à saveur raciste, pour demander à la Ville de réduire le nombre de HLM dans leur patelin. Paraîtrait que ça nuit à la valeur des propriétés...
Par ailleurs, cette préoccupation de mixité sociale est brandie au gré des situations. A Rosemont, quand les citoyens ont demandé que les HLM et coops souhaités sur les terrains Angus reproduisent le profil social du quartier, ils se sont fait répondre que ça créerait un ghetto. Quand on sait que Rosemont est le quartier "statistiquement moyen" à Montréal, on reste songeur sur le sens du mot ghetto.
3. Le mythe de Tailleurs meilleur
Ce dernier argument prétend qu'en déménageant vers des secteurs moins vétustes, les ménages déplacés retrouveront des conditions de vie améliorées. D'abord, où vont les gens déplacés? Intervenants et chercheurs s'entendent pour dire que les ménages délogés tentent d'abord de rester "dans les parages", mais, n'y réussissant pas, sont par déménagements successifs progressivement éloignés de leur quartier de départ.10
Il semble que les corridors de migration se forment: circuits standard de recherche de logis abordables, de plus en plus loin du centre-ville. Les gens de Pointe SaintCharles se retrouvent à Verdun, Ville LaSalle, et même la rive-sud.11 Les anciens de Centre-sud essaiment vers le nord-est, aboutissant à St-Michel ou Montréal-Nord. L'élément déterminant: la disponibilité de logements à prix abordables. Car, sur le plan économique, les revenus des ménages déplacés ne se métamorphosent pas par miracle: ils demeurent ceux de petits salariés, pensionnés, assistés sociaux .12
En quittant leur ancien logis, au loyer très bas 13, ces ménages doivent forcément consacrer une part plus lourde de leur budget à l'item logement, et, par voie de conséquence, devront nécessairement opérer des coupures sur le reste des dépenses. Ces charges accrues sont dramatiques pour les familles à faibles revenus. Budget vêtements? budget alimentaire? La marge de manoeuvre des plus démunis est nulle. Les efforts pour se loger à bon compte pousseront certains à des grands déplacements. Mais le parc de logements locatifs, hors des vieux quartiers, est souvent dans son "bas de gamme", composé d'immeubles spéculatifs, dont les logis sont typiquement petits, mal insonorisés, à l'entretien aléatoire, et malgré tout plus chers que les anciens logements. L'amélioration de qualité de vie n'est pas évidente...

Mais l'argent n'est pas tout, diront les bonnes âmes. Sans doute. C'est pourquoi il faut aussi noter que les ménages déplacés perdent de surcroît les services (communautaires et autres; pensons aux centres d'éducation populaire, aux garderies, etc.) adaptés à leurs besoins et dont la présence caractérise les vieux quartiers. Il n'est pas assuré que dans la conjoncture "Etat-poids-plume" actuelle, la mise sur pied, ailleurs, d'organismes communautaires soit chose facile, et ce d'autant moins que la population concernée, saupoudrée dans de nouveaux espaces, sera difficile à repérer.
Les séquelles sociales du déplacement sont, quant à elles, impossibles à quantifier. Eloignement des amis, des parents; perte des réseaux de support et d'entraide, isolement en particulier des personnes âgées et des familles monoparentales. Les quartiers tricotés serrés, aux liens sociaux denses, ont la réputation (vérifiée d'ailleurs 14), de mieux gérer leurs problèmes sociaux que d'autres quartiers à revenus comparables mais sans tissu social fort. On aide plus facilement les gens qu'on connaît. D'autres villes, où se sont réalisés des programmes de rénovation urbaine 15, ont pu constater l'augmentation de la mortalité des personnes âgées déplacées de leur quartier. Faudra-t-il attendre que le phénomène soit détecté ici pour y croire?
Pour le droit de rester dans son quartier
C'est donc un ensemble de faits et d'observations, glanés ces cinq, six dernières années, qui nous font sursauter devant les discours rassurants sur la "revitalisation" des vieux quartiers. Comme à l'époque des grandes démolitions, la même vieille question lancinante revient: à qui profite la revitalisation? Croyons-nous vraiment que la dispersion des gens démunis sur un plus grand territoire soit une solution à quoi que ce soit?
Dans les vieux quartiers, la population a toujours voulu améliorer son sort. En témoignent abondamment les réalisations des mouvements sociaux qui ont pris racine dans ces quartiers. Encore aujourd'hui, une floraison de projets s'attaquent aux problèmes de conditions de vie vécus par la population. Coopératives d'habitation, services communautaires, relance locale et communautaire de l'emploi: l'étiquette de ghetto est loin de rendre justice à la vitalité de nos quartiers. C'est pourquoi nous disons non aux mythes qui circulent sur le déplacement des résidants des quartiers populaires. A quand des quartiers où nous aurons vraiment droit de cité?
Annexe
Le déplacement vu à la loupe: ou, comment on s'est rendu compte que Pointe Saint-Charles perdait son monde...
Mai 1981: La Ville de Montréal commence ses programmes PIQA en forçant les résidants d'un secteur à faire des rénovations. Une enquête porte-à-porte révèle que les travaux demandés risquent de coûter cher. Les groupes communautaires s'organisent et demandent a) une consultation publique et b) des subventions à la rénovation accrues avec contrôle des loyers.
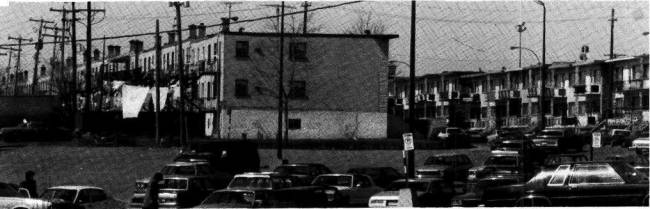
Eté 1981 :
Premières paniques de petits proprios qui découvrent qu'ils n'ont aucun recours contre la Ville.
Décembre 1981 :
Un côté complet de la rue Richmond est à vendre. La Ville donne quelques mois plus tard une hausse de subventions aux résidants des secteurs PIQA, mais il faut quand même payer une partie des travaux exigés.
1982:
Les élections s'en viennent. La Ville trouve que ses Programmes PIQA coûtent cher et n'avancent pas assez vite. Les chialeux sont, de plus, nombreux et bruyants. La Ville change de tactique: elle stimulera désormais le changement en construisant elle-même. Ses premières rénovations se font par le biais de sociétés para-municipales; les loyers tournent autour de $250 (Moyenne du quartier: $125.).
Constructions neuves, avec le concours de la Caisse Pop locale, à $350. par mois. C'est en coop, mais les groupes communautaires du coin ont dû gueuler pour faire baisser les prix initialement fixés à $450. Les propriétaires des maisons voisines ont une idée: ils montent leurs loyers "parce que le voisinage s'améliore". Premiers départs de locataires.
1983:
Sondage par des étudiant(e)s de l'U. de Montréal: dans le secteur PIQA le plus avancé, le pourcentage de locataires est tombé de 90 à 75% en deux ans. Un porte-à-porte exhaustif révèle que les rénovations dans les PIQA se multiplient. Beaucoup de départ de locataires! Mais les gens espèrent encore se trouver un logis dans le coin. Entretemps, un projet de "banque de logements" (liste de logis disponibles) avorte, faute... de logements disponibles.
Encore des constructions municipales. Prix: $450 par mois, sans service. Les PIQA ressortent des boules à mites, en partie. La Ville fait procéder à un programme d'enfouissement de fils électriques, qui force les gens à changer leur installation électrique et même à creuser leur cave. Mars 1 983. Un côté de la rue Ste-Madeleine est à vendre.
1984:
La population est de plus en plus inquiète. Les rénovations sont de plus en plus visibles. Les petites rénovations faites par les proprios résidants ne font pas trop grimper les loyers, mais les rénovations subventionnées sont désastreuses. Pourtant, on voudrait tous tellement rester dans de bons logements.
Trois études: une qui nous dit que 1 logis sur 6 est déjà rénové; l'autre qui nous apprend que 40% des locataires touchés par ces rénovations ont quitté le quartier; et une troisième qui révèle que la moyenne des loyers du quartier est de $1 60, mais que les rénovations font grimper ça rapidement. Et c'est pire dans les zones PIQA.
Sur un ancien terrain de la Ville, la Caisse (encore!) parraine un projet de condos. Prix de départ: 48,000. Les mensualités réelles (incluant taxes et chauffage) atteignent $720. Et ça se vend, mais lentement.
La SODEMONT s'essaie avec un petit projet de condos. Faute de preneurs, elle le transforme en logements loués. Prix: $475, sans service. Mais l'édifice "change la face" du secteur...
Fin 1984, des contracteurs privés tentent eux aussi l'expérience des condos. Certains sont vendus, d'autres doivent être loués. Les prix varient autour de 40-50,000.$ Les rénovations: ça continue. Porte-à-porte: on découvre que la rue Shearer a perdu tous ses assistés-sociaux. PIQA et rénovations...
1985:
Le comité-logement et les autres groupes du quartier sont assiégés par les gens qui cherchent des logements. Des logis minables se louent maintenant $400.
Sécurisés par les plans que l'administration a dévoilé pour le quartier (en novembre 1 984, elle publiait un Schéma d'aménagement pour la Pointe), des promoteurs annoncent des projets de transformations d'usines en condos, le long du Canal Lachine (le beau spot...).
1986:
Réalisation de certaines parties de ces projets. Par ailleurs, le prix de vente des maisons (non-rénovées) dans le quartier commence à monter. Les coops ont plus de difficultés à se trouver des bâtiments adéquats.
On découvre que 200 familles d'assistés sociaux ont quitté (en quelques mois) la Pointe (source: le bureau local du BES), et on découvre aussitôt qu'elles sont maintenant rendues à Verdun, via un autre bureau d'aide sociale.
Des intervenants de la Clinique retrouvent de leurs anciens patients dans un parc de roulotte à Mascouche; d'autres, à Lachine, etc.
1987:
A suivre.

Atelier 4: Aménagement des quartiers
RÉAMÉNAGEMENT URBAIN: PROBLÉMATIQUE DES GRANDES ET DES PETITES VILLES
par Marc Savaria, de l'Atelier du logement communautaire des Bois-Francs (Drummondville)
Les grandes villes
Les gouvernements interviennent dans le réaménagement des quartiers parce que l'espace n'est plus rentable et qu'une utilisation différente permettrait une plus grande rentabilité. Bien plus que le désir du retour en ville, c'est la volonté des municipalités de faire payer qui prime.
Au début des années '50, les villes se vidaient au profit des banlieues. Trente ans plus tard, le schéma est inversé (quoi que les banlieues ne se vident pas...) et c'est le retour en ville.
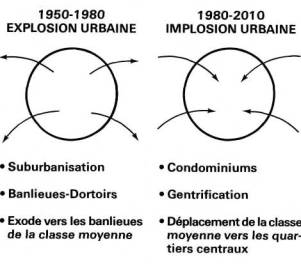
Dans les grands centres urbains, nous assistons au "retour" à la ville des couches aisées de la population. Encouragé par les administrations municipales à Québec et Montréal, ce "retour" se fait en délogeant les couches de population moins favorisées et plus âgées. Ce phénomène change complètement la nature des quartiers. Les municipalités y trouvent leur profit. Les banlieusards travaillaient en ville, utilisaient certains services, mais ne payaient pas de taxes. Avec le retour en ville, la machine est inversée.
Dans les grands centres urbains, l'implosion urbaine amène les couches populaires à revendiquer "le droit à la centrante", selon l'expression d'Henri Lefebvre qui a analysé ce phénomène à Paris dans les années 70. Le droit à la centralité, c'est celui d'habiter proche des services pour les personnes âgées, près du transport en commun, là où la vie culturelle, commerciale est active. En étant chassées des quartiers centraux, les populations démunies se retrouvent sur un marché de logement qui n'a rien à leur offrir.
Commentaires des participant(e)s
L'aménagement des quartiers ne se fait pas pour les populations traditionnelles. C'est ce qui s'est passé à la Petite Bourgogne. Il y a eu dix ans de rénovation, d'aménagement et de construction. Cela s'est fait pour une nouvelle population qui commence à arriver. Il y a une différence énorme entre rénover des logements pour les rendre conformes à de nouvelles normes d'hygiène par exemple, et tout chambarder pour amener de nouvelles populations et chasser les résidant(e)s. A Québec, l'aménagement du Vieux Port a chassé les chambreurs... On peut multiplier les exemples: Centre-Sud, St-Jean Baptiste, etc.
La vigilance des citoyen(ne)s face à ce qui se passe dans leur quartier et dans les autres quartiers reste très im-. portante. Les problèmes rencontrés dans Petite Bourgogne quant au réaménagement du quartier ont servi à la Pointe Saint-Charles pour s'organiser et résister. La même chose s'est produite dans St-Sauveur face à l'expérience, vécue dans St-Roch.
Le phénomène de la gentrification
Bien souvent, on voit le début du changement des" quartiers à travers la revitalisation des artères commerciales, qui se transforment pour accueillir une population plus aisée. Ensuite, le stock de logements se transforme à son tour pour cette population. C'est ce qu'on constate dans Rosemont: la rue Masson s'est transformée, il y a présentement beaucoup de vente de maisons, beaucoup; de cas de reprise de possession. Rosemont qui n'est pas un quartier cible des yuppies subit quand même des déportations de populations. Dans le quartier Villeray, la gentrification se développe tranquillement. On y voit de plus en plus de condos. Les seuls aménagements qu'on voit ne sont pas pour ceux qui les demandaient depuis trente ans' mais pour des nouvelles populations.
A Pointe Saint-Charles, la situation est différente. Lapopulation n'a pas bougé depuis trente ans: Ce sont des sans-emploi, des assistées sociales et assistés sociaux, des personnes âgées... C'est l'après Petite Bourgogne.
Le réaménagement urbain prend souvent l'allure du. progrès. Mais les populations traditionnelles des quartiers populaires le redoutent, à juste titre: on ne veut pas de nouvelles fenêtres, parce que ces rénovations vont entraîner une hausse de loyer... qui mène sur le trottoir. Alors les gens deviennent négatifs. Le vieux stock de logements aurait besoin d'être rénové mais les gens savent que ce ne sera pas pour eux. Le "progrès" chasse les gens qui devraient avoir le droit d'en profiter. C'est ça qui est grave. Ce que tous veulent, c'est le plein emploi, des quartiers bien équipés, le maintien des populations résidantes.

Un exemple de revitalisation d'une grande artère commerciale: la rue Wellington, à Sherbrooke.
Les petites villes
Au Québec, le programme de rénovation urbaine (PRU) (1968-1973) a considérablement marqué les villes moyennes. Que ce soit à Ste-Thérèse, Drummondville, Victoriaville, St-Hyacinthe ou ailleurs, on constate qu'autour des artères commerciales se sont constitués de vastes stationnements. Les marchands du centre-ville désiraient faire concurrence aux centres d'achats de la périphérie. Pour ce faire, on démolit les faubourgs du centreville: les programmes de rénovation urbaine étaient connus comme étant des "opérations Bulldozer"... Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la démolition des faubourgs a plus nuit aux commerçants du centre-ville que l'ajout de stationnement n'a apporté d'achalandage à leur commerce.
A partir du milieu des années 70, les gouvernements se sont mis à aménager nos quartiers (grâce à un programme fédéral-provincial qui s'appelait le PAQ). On ne démolissait plus autant, on aménageait des parcs, on changeait les systèmes d'égout et d'éclairage, on faisait des beaux trottoirs, on rénovait des maisons. Mais dans la majorité des villes où le programme a été appliqué, les résultats étaient les mêmes: on devait déménager... cette fois parce qu'on n'arrivait plus à payer les loyers de nos beaux restaurés.
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'activité dans les centres-villes: on parle de revitaliser les centres-villes. Des associations de marchands se sont constituées (SI DAC)... Privés d'une population résidante, remplis du vide morne des stationnements, souvent peu équipés pour soutenir la vie culturelle et sportive, les centres-villes n'ont plus d'âme. Dernièrement, les programmes REVICENTRE ont surtout servi à améliorer les conduites d'égout et d'aqueduc; les municipalités étaient surtout soucieuses de diminuer la facture des travaux d'assainissement des eaux. A l'automne '86, presque toutes les villes moyennes étaient en travaux pour moderniser leur service d'aqueduc et d'égout. Les MRC exigent un plan directeur et un plan de zonage: plusieurs villes préparent un plan particulier d'urbanisme (PPU) pour leur centre-ville qui souvent viendra confirmer ce qui existe déjà.

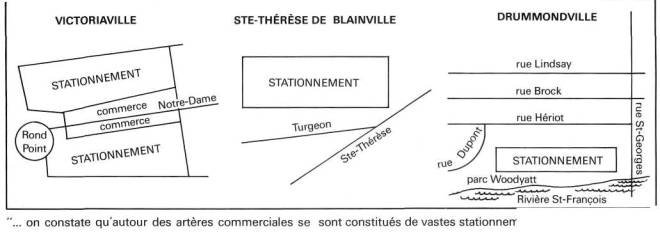
Les vingt-cinq dernières années de réaménagement urbain dans les villes moyennes au Québec ne nous montrent pas un effort constant et une ligne directrice, mais plutôt une gestion à la petite semaine au gré des programmes et des crédits alloués par les gouvernements supérieurs. A nous de proposer notre vision des centres-villes et d'en faire une réalité. Chose certaine, ça pourra pas être pire que ce qui s'est passé durant les 25 dernières années...
Commentaires des participant(e)s
A Rouyn, les maisons du centre-ville sont vieilles, pas rénovées et coûtent très cher. A Matane, quelques gros propriétaires ont le monopole, ils achètent les vieilles maisons et les rénovent, les gens doivent déménager, ils demandent des HLM inexistants, la liste d'attente compte 800 noms et seulement 40 unités ont été construites. De plus ces HLM sont construits à l'extérieur du centre-ville, loin des services. Les gens à faible revenu n'ont pas d'auto, ils sont donc privés des services essentiels à la vie quotidienne. A Sorel, le logement a été un dénominateur commun pour regrouper différentes personnes et groupes. Une plate-forme commune a été préparée. Ils ont apporté des analyses et des schémas d'aménagement, ils ont pu ainsi faire valoir leur vision de l'aménagement plutôt que de s'en faire imposer une.
NOS ACTIONS ET NOS LUTTES POUR SAUVER NOS QUARTIERS
Ateliers du dimanche 7 décembre
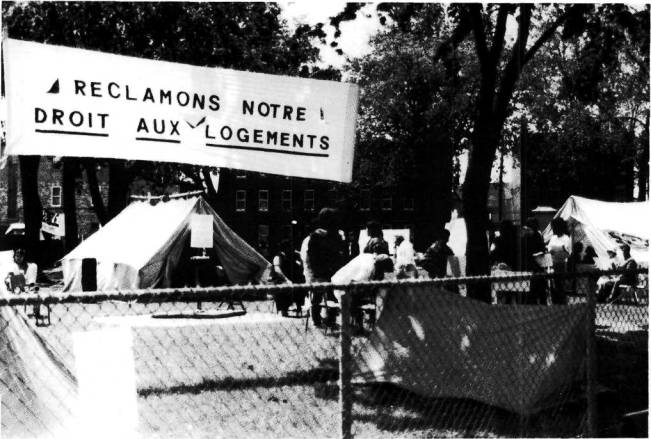
Atelier 5: Les recours légaux
LES RECOURS LÉGAUX: ENTRE L'ÉCRIT... ET LA PRATIQUE
par Jean-Pierre Wilsey, du Comité Logement St-Louis (Montréal)
Adoptée en 1 979, la législation sur le logement locatif (Loi sur la Régie du logement, articles sur le Louage de choses dans le code civil) avait comme objectif premier de protéger le stock de logements locatifs en reconnaissant aux locataires un droit essentiel: le droit au maintien dans les lieux. Le législateur avait prévu une série de mécanismes pour encadrer et assurer ce droit: contrôle du loyer; renouvellement automatique du contrat de location; moratoire sur la conversion en copropriété divise; création d'un tribunal, la Régie du logement; etc. Une lecture rapide de l'ensemble de ces textes nous donne l'impression que la loi limite et restreint sérieusement le droit de propriété. Hors, la pratique nous oblige à constater que ces restrictions sont fictives, voire même très fragiles lorsqu'elles sont confrontées aux lois du marché et à la spéculation foncière. En effet, tous les échappatoires, tout ce qui remet en question le maintien dans les lieux, et cela dans la législation sur le logement elle-même, ont systématiquement été utilisés afin d'accroître la valeur marchande des immeubles. Cela a eu comme principale conséquence d'évincer de leur logement une portion importante de gens qui n'avaient pas les moyens financiers pour assumer les nouveaux coûts de location.
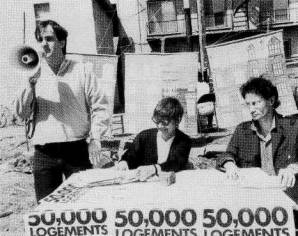
Les Entreprises Laro, qui avait démoli illégalement douze logements sur le Plateau Mont-Royal, n'ont été condamnés qu'à $20,000 d'amende... somme qu'elles n'auront aucune difficulté à payer avec le nouveau projet de luxe qu'elles édifieront sur le terrain devenu vacant.
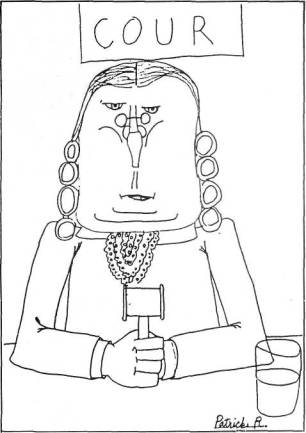
Les Entreprises Laro, qui avait démoli illégalement douze logements sur le Plateau Mont-Royal, n'ont été condamnés qu'à $20,000 d'amende... somme qu'elles n'auront aucune difficulté à payer avec le nouveau projet de luxe qu'elles édifieront sur le terrain devenu vacant.
Les moyens utilisés sont multiples et très souvent légaux:
- La démolition d'un immeuble (faire disparaître un vieux bâtiment peu rentable et le remplacer par un nouvel immeuble qui a l'avantage d'être soustrait de la fixation de loyer et du moratoire sur la conversion en condo.)
- La rénovation résidentielle (bénéficier des programmes de subvention, accroître la valeur marchande et augmenter les loyers).
- Le changement d'affectation subdivision (transformer un logement locatif en un local commercial non protégé par la Régie ou multiplier le nombre de logements donc de revenus).
- La reprise de possession (jouir de son droit de propriété).
Dans ce contexte, les recours légaux peuvent nous appaître illusoires et peu efficaces en égard aux enjeux économiques et aux règles du jeu imposées par le secteur immobilier. Il n'en demeure pas moins que ces recours peuvent nous être d'une certaine utilité à la condition de les lier à d'autres types d'interventions et de revendications: meilleur financement pour le logement social, abolition des nombreux abris fiscaux pour les entreprises immobilières, amendes plus sévères pour les pratiques illégales, contrôle obligatoire des loyers, rendre l'obtention des permis de rénovation et de démolition plus difficile, faire réellement reconnaître le caractère d'ordre public de la législation du logement locatif, etc..
Atelier 6: La mobilisation
LA MOBILISATION: PLUS QU'UNE QUESTION DE RECETTES
Exposé Thérèse Stanhope de la Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles (Montréal)
S'il y a une question que nous nous posons presque quotidiennement dans nos groupes, c'est bien: "Qu'estce que ça donne? Est-ce que ça vaut la peine?". A cela, je réponds sans hésitation: "Oui, ça vaut la peine. Même si on ne gagne pas toujours, on n'a rien perdu à se mobiliser".
Mais pourquoi certaines mobilisations marchent-elles et d'autres pas? Pour tenter de répondre à cette question, je vais partir de trois exemples de luttes dans lesquelles j'ai été personnellement impliquée. La première, c'est la lutte des locataires de HLM de Montréal sur l'échelle des loyers, sur l'accès à la Régie du logement et sur les conditions de vie dans les logements municipaux. Cette lutte a été assez difficile: il a été difficile de mobiliser et il a été difficile d'arracher des gains. On a remporté certaines victoires, comme l'accès des locataires de HLM à la Régie du logement, mais malheureusement à ce moment-là il ne restait plus personne dans le comité.
La seconde lutte, c'est celle des retraité(e)s contre la désindexation de leurs pensions. Celle-là a été superfacile: les gens se sont mobilisés et ont obtenu gain de cause dans un temps relativement court. Et le dernier exemple, c'est celui du Projet Saint-Charles pour arracher 500 logements sociaux dans la Pointe. Le projet a fait son bonhomme de chemin et il y a eu des gains, même si l'objectif de 500 logements n'a pas été atteint.
Si ces trois mobilisations ou tentatives de mobilisation ont donné des résultats différents, ce n'est pas seulement une question d'ingrédients, mais aussi une question de conjoncture et d'opinion publique.

Si la lutte des locataires de HLM a été si difficile et n'a pas réussi à mobiliser largement, c'est en bonne partie à cause de l'image manipulée dont ils étaient victimes. L'image qu'ont leur a fabriquée et qui les ébranlait eux-mêmes, c'était celle de "gens qui ne paient pas leur loyer", de "gens qui n'entretiennent pas leur logement", de "gens qui chialent pour rien". On a vu la même chose récemment avec les Boubou-macoutes.
La campagne de presse contre les assistés sociaux a préparé le terrain aux mesures de Pierre Paradis.
Les retraité(e)s en lutte contre la désindexation, eux, jouissaient au contraire d'une sympathie populaire dont ils ont su tirer parti. Leur manifestation à Ottawa a même été couverte favorablement par les médias... contrairement à ce qui arrive toujours aux syndicats.
Quant au Projet Saint-Charles, on s'y est rendu compte de l'image quand on a tenté de mobiliser la population autour d'un mot d'ordre comme "II faut garder nos logements". Ce mot d'ordre ne rejoignait pas les gens qui habitaient dans des logements détériorés dont ils n'étaient pas satisfaits. Garder son logement, est-ce que ça signifiait le garder comme il est présentement? Par contre, le mot d'ordre "Sauver notre quartier" a été plus mobilisateur et a même permis d'aller chercher les petits propriétaires de la Pointe Saint-Charles.
Une autre leçon de ces luttes, c'est l'importance de pouvoir gagner quelque chose et de pouvoir évaluer ces gains si minimes soient-ils. Il est vrai, par exemple, qu'il ne se fait plus autant de HLM qu'avant, mais il s'en fait encore. S'il n'y avait pas eu d'action, il n'y aurait plus de HLM. Le Projet Saint-Charles quant à lui n'a peut-être pas atteint son objectif de 500 logements, mais depuis deux ans la Pointe a obtenu 171 logements sociaux, alors qu'il ne s'en faisait auparavant que 20 par année. Ces logements-là, on les a arrachés et il faut revendiquer ce gain.
Il faut également maintenir la mobilisation, trouver des moyens pour garder l'intérêt de la population. Récemment, à la Pointe Saint-Charles, on a enterré un projet de coopératives dont les loyers fixés par la Société canadienne d'hypothèque et de logement étaient trop élevés pour la capacité de payer des gens du quartier. Cette action spectaculaire a permis de maintenir l'intérêt à la lutte. Il est enfin très important d'arriver le plus possible à élargir nos appuis, selon les enjeux politiques et économiques de nos luttes.
Un mot en terminant sur le lobbying. Le lobbying, estce que ça sert. Et à quoi ça sert? Je crois personnellement que ça peut servir, mais à condition de savoir l'utiliser, sans en être soi-même victime. Ainsi le lobbying attire souvent la sympathie de la presse. Quand on va rencontrer un député ou ministre, les journalistes se déplacent... pas nécessairement pour nous, mais pour les autorités. On n'en réussit pas moins à faire passer notre message. C'est un moyen qu'on utilise pour rejoindre notre journal local. On utilise le lobbying pour élargir nos appuis. Ce qu'il faut, c'est saisir toutes les occasions pour les retourner à notre profit, c'est être capables de récupérer la conjoncture à nos fins.

Il aura fallu trois ans et demi aux résidant-e-s du quartier Centre-Sud, à Montréal, pour gagner un mini-parc correspondant à leurs volontés. Pendant ce temps, le quartier continuait à s'embourgeoiser à vive allure...
Atelier 7: La copropriété comme alternative populaire?
LA COPROPRIÉTÉ COMME SOLUTION AU PROBLÈME DU LOGEMENT???
par Jacques Fiset, du comité des citoyen(ne)s du quartier Saint-Sauveur, de Québec
Le problème du logement est d'abord un problème de rapport entre son coût et la capacité de payer de l'occupant. Tous les autres problèmes découlent de ce premier, quelque soit le "mode de tenure". "Mode de tenure", c'est l'expression qu'on utilise dans les livres pour dire "façon d'occuper un logement", soit comme locataire, comme propriétaire, comme co-propriétaire, où comme coopérant. Cependant le mode de tenure y est pour quelque chose dans la capacité de payer.
Si l'on considère le coût d'un logement loué dans le marché privé, il est probable qu'il représente: le coût d'opération du logement par mois (entretien, taxes, assurances, énergie si c'est inclus), le coût du financement de la partie d'immeuble par mois (remboursement hypothécaire), une réserve de réparation majeure sur l'immeuble (si jamais le proprio s'en fait une), et un profit du propriétaire. Donc quelqu'un qui deviendrait propriétaire de son logement devrait théoriquement pouvoir diminuer le coût de son logement par mois.
Une tentative
C'est de ce principe que les membres du comité des citoyens du quartier St-Sauveur sont partis pour lancer l'opération "réappropriation de quartier". Nous nous rendions compte que beaucoup de maisons étaient mises en vente dans le quartier et que souvent elles étaient achetées par des propriétaires extérieurs au quartier. Qu'ils soient ou non entrepreneurs, qu'il y ait rénovation ou pas, la transaction amenait à plus ou moins long terme une hausse de loyer et éventuellement un départ des locataires. Nous favorisions à ce moment-là la formation de coopératives en priorité. Mais attendu l'évolution de la situation de ce côté-là, les délais nécessaires à une telle démarche, nous ne pouvions en rester là. Nous avons donc envisagé d'une part l'achat en copropriété et à la limite l'achat comme propriétaire résident.
Le type de copropriété que nous envisagions à ce moment-là était la copropriété indivise, où tous les occupants sont propriétaires ensemble de tout l'immeuble et sont en même temps locataires du logement qu'ils occupent. Il ne s'agit donc pas de transformation en condominium même si extérieurement ça y ressemble. D'ailleurs si l'on se fiait aux expériences en cours dans le quartier, c'était la formule généralement utilisée. Il s'agissait donc de proposer à des locataires dont la maison était mise en vente, de se regrouper et d'acheter ensemble leur immeuble.
Une belle histoire
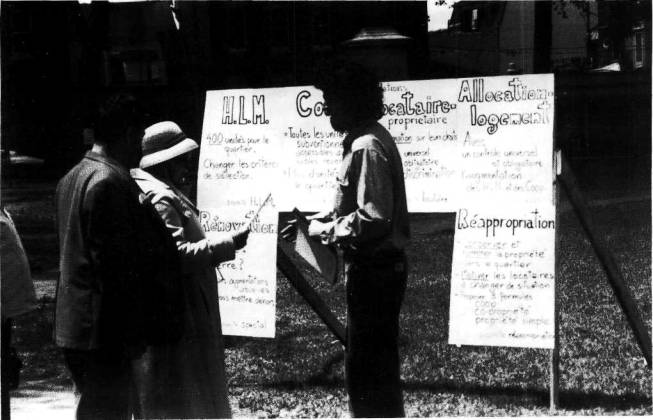
C'est à travers toutes les luttes qu'il menait pour le droit au logement que le Comité des citoyen-ne-s du quartier Saint-Sauveur, à Québec, a commencé à mettre de l'avant la réappropriation du quartier, notamment par le biais de la copropriété.
J'ai moi-même acheté la maison que j'habite actuellement de cette façon. Nous étions locataires d'une maison à trois logements, propriété des deux filles de l'ancienne propriétaire morte avant notre arrivée (donc aucun hypothèque sur la maison). Nous payions $250/mois. Un toit s'étant mis à couler, les propriétaires voulaient nous augmenter avant de faire la réparation. S'en suivit une altercation que je passe sous silence. Un bon samedi matin, toujours sans avoir fait la réparation, on nous offre d'acheter la maison. Ma copine était membre fondateur d'une coopérative d'habitation, nous décidons donc de leur demander d'acheter la maison. Mais c'était trop de délai... on ne pouvait rien promettre. Cependant nous étions bien dans cette maison. Nous allons voir les deux autres locataires; ils partent bientôt tous les deux. Nous finissons par trouver une amie qui accepte d'acheter avec nous et occuperait au départ du locataire, le logement du 3e. La caisse pop nous fait des misères, nos revenus sont trop bas, mais on finit par nous accepter compte tenu du bas prix de la maison, et de la fille du 3e qui aura sa maîtrise: "C'est de l'avenir". On emprunte le reste à des amis et on achète. Au départ des locataires, nous louons le 2e avec option d'achat d'une part à un copain. Et sept ans plus tard, nous payons $35/mois de plus cher, un logement arrangé à notre goût dans une maison entretenue à raison de $2000/ an de réparation.
Ça c'est une histoire. J'en connais quelques autres dans le quartier. Cependant, elles ne sont pas très nombreuses, et n'ont jamais réussi à créer un effet d'entraînement. Quels sont donc les obstacles à un tel effet, et un tel effet serait-il souhaitable?
Les obstacles
Le premier obstacle que l'on rencontre, et peut-être le plus important: être locataire, n'est pas qu'un mode quelconque de tenure, c'est aussi une mentalité et une manière de vivre. Ne devient pas propriétaire qui le veut. C'est d'ailleurs l'un des grands problèmes des coopératives d'habitation: un locataire, ça paie pour un service, il veut un bon service; de là à prendre la responsabilité de se donner un bon service, il y a un pas que tout le monde n'est pas prêt à franchir. Même dans notre copropriété, on peut distinguer ceux qui agissent comme propriétaires et ceux qui agissent comme locataires.
Le second obstacle, c'est le fait de "se mettre ensemble". C'est d'ailleurs l'aspect le plus difficile des coopératives d'habitation, ce n'est pas forcément plus facile parce qu'on était déjà voisin. D'ailleurs si avant on pouvait se plaindre par propriétaire interposé, ce ne sera plus possible. Donc à moins de liens un peu privilégiés, un tel projet apparaît peu réalisable.
Et même si ces liens existent il ne faut pas oublier qu'ils doivent durer sinon on sera forcé de cadastrer en condominium et là ça coûtera plus cher. En effet la loi régit bien les condominiums, mais la copropriété indivise n'a pratiquement pas d'existence légale.
Le troisième obstacle (mais seulement le troisième), c'est la mise de fonds. Evidemment, vaut mieux en avoir une, et pour quelqu'un qui vit de revenus de l'état et ne peut envisager d'en sortir à court terme, il ne pourra pas emprunter. Il est possible (comme dans notre cas) d'investir des montants différents, et donc d'avoir des responsabilités inégales sur l'hypothèque; mais il faut une bonne dose de confiance dans le groupe, et elle doit durer.
Est-ce souhaitable?
Le premier danger de la copropriété indivise, c'est la reprise de possession. En effet, plus il y a de propriétaires plus il y a de reprises possibles. C'est pourquoi, nous n'avons envisagé chez-nous l'achat en copropriété que par les occupants de la maison, ou en utilisant le roulement normal des locataires. C'est d'ailleurs en ce sens que la copropriété ne crée pas le mouvement de "gentrification" d'un quartier, mais elle est un catalyseur qui accélère le mouvement, si le quartier est déjà devenu à la mode. Ce qui n'est pas le cas à St-Sauveur.
Le second danger, c'est la spéculation. En effet, la copropriété indivise est à la merci du copropriétaire spéculateur. La durée n'est garantie que par la bonne foi des copropriétaires. Et plus il y a de propriétaires plus il risque d'y avoir de spéculation. Mais il y a spéculation possible s'il y a forte demande, donc mode. Ce qui est donc emmerdant, c'est la mode.

Atelier 8: Les limites du logement social
LOGEMENT SOCIAL: RETOMBERONS-NOUS À LA CASE 1?
par Louise Constantin, membre individuelle du FRAPRU et animatrice au groupe de ressources techniques de Verdun
Au colloque d'octobre 78, qui a vu la naissance du FRAPRU, la vingtaine de groupes représentés, venant des différentes régions du Québec, avaient fortement dénoncé les politiques gouvernementales de rénovation urbaine qui conduisaient à l'expulsion de larges segments de population des quartiers populaires. La même année, une dizaine de comités de logement de Montréal et de Québec décident de se regrouper autour d'une revendication unique et "punchée" et fondent le Regroupement pour le gel des loyers. Quelques années plus tard, il deviendra le Regroupement des comités-logement et associations de locataires.
En 79, le gouvernement péquiste s'apprête à voter une loi permanente pour définir les droits et obligations des locataires et des propriétaires. De grandes séances de consultation s'organisent et plusieurs associations de locataires forment alors un Front commun, à Montréal, pour présenter un mémoire au ministre Guy Tardif. Lorsque la loi 107 paraît, les locataires constatent que très peu de leurs revendications y figurent. Face à leur propriétaire, les locataires n'ont que peu de moyens de combattre les hausses de loyer, les reprises de possession et les évictions pour cause de rénovation. Victimes à la fois des décisions arbitraires de leur propriétaires et des politiques de rénovation urbaine de l'Etat, les locataires ne savent plus vers qui se tourner. Poursuivant leur réflexion, les groupes membres du FRAPRU en viennent, en 81, à se dire que si c'est à cause de l'Etat que les locataires se trouvent dans la misère, c'est donc à l'Etat à trouver une solution. Et cette solution réside selon eux dans la production directe de logements par l'Etat, plus particulièrement sous forme d'habitations à loyer modique (HLM) et de coopératives d'habitation.
Les misères des HLM
Toujours aux prises avec leurs problèmes personnels, beaucoup de locataires avaient d'ailleurs choisi de vivre en HLM. Or, les HLM seront toujours critiqués et ce pour plusieurs raisons. Ce sont de gros ensembles souvent mal construits, qui sont souvent perçus comme "des ghettos de pauvres" et des foyers de délinquance. Ils offrent toutefois une sécurité financière à ceux et celles qui y vivent, puisque le loyer est calculé en fonction du revenu et non plus en fonction du profit du proprio. De plus en plus, étant donné l'éclatement de la famille qu'entraîne la transformation des valeurs des années 60 et 70, les HLM recrutent leurs locataires parmi les femmes chef de famille monoparentale. Pour ces femmes, la formule HLM non seulement offre une solution contre la pauvreté, mais aussi une protection contre les abus de pouvoir et le harcèlement dont elles sont souvent victimes de la part de leur propriétaire. Toutefois, les HLM présentent deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y en a pas assez.
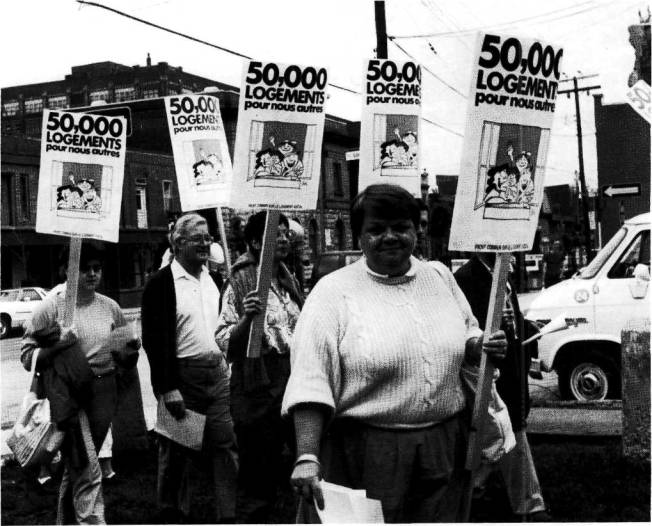
Dans l'élan de la révolution tranquille, le gouvernement québécois s'était donné comme objectif de relever le niveau de vie collectif et de faire passer l'ensemble de la population de la classe pauvre à la classe moyenne. Le gouvernement prend alors des mesures pour rendre universel l'accès aux services de santé et à l'éducation, il augmente le salaire minimum et favorise en partie la syndicalisation. Dans la même foulée, il prend à sa charge la construction de logements sociaux qui, d'une certaine façon, doit compenser pour les démolitions et les rénovations massives dans les quartiers populaires. Or, une génération après le début de la Révolution tranquille, le nombre des ménages en attente pour obtenir un logement HLM s'élève à 35,000 au Québec. L'Etat québécois n'a donc pas réussi à loger tout son monde. Et, loin de s'en montrer honteux, il laisse de plus entendre, par des déclarations de ministres suivies de démentis, que la production de HLM tire à sa fin. Que va devenir la liste d'attente? Va-t-elle prendre la poubelle? En partie, c'est ce qui a déjà commencé à arriver, puisque le gouvernement a décidé que les immigrants reçus n'étaient plus admissibles à un HLM. Si les immigrants n'ont plus accès au logement public, vont-ils aussi bientôt se voir refuser l'accès à l'éducation et à la santé?
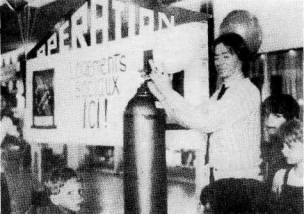
A Aylmer, le Comité logement urgence prend toutes sortes de moyens pour arracher des HLM.
L'autre problème que présentent les HLM réside dans les augmentations de loyer déguisées qu'ont subies les locataires au cours des ans. Ces augmentations ont pris la forme de coupures de services: par exemple, il y a quelques années, les appareils ménagers, qui étaient fournis avec le logement, ont été transférés à la charge des locataires. L'an dernier, la Société d'habitation du Québec a décidé de facturer aux locataires la peinture nécessaire à l'entretien des logements. De plus, l'Office municipal d'habitation de Montréal traîne systématiquement devant la Régie du logement les locataires qui ne paient pas leur loyer à la date due sans tenter de prendre des arrangements avec eux. Enfin, l'OMH de Montréal fixe maintenant le loyer sur la base du revenu de tous les membres du ménage, y compris les enfants bénéficiaires du Bien-être social. Et le plus fort, c'est que l'OMH interdit ensuite à des enfants de revenir vivre avec leurs parents une fois qu'ils ont quitté le foyer familial! Donc, ingérence dans la vie privée, tracasseries diverses, insécurité financière. Tout cela fait qu'il est de moins en moins intéressant de vivre dans un HLM. Mais où aller si on ne peut même plus vivre dans un HLM?
Les coopératives: Une nouvelle voie
Une autre forme de logement social est aussi disponible et, jusqu'à l'année dernière, beaucoup la considéraient comme la solution idéale à tous les problèmes. Il s'agit de la coopérative d'habitation, qui permet à la fois de remettre à neuf de vieux logements, de faire obstacles à la spéculation dans les quartiers anciens et surtout d'offrir de bons logis à un loyer abordable pour les ménages à faible revenu. Et par-dessus le marché, plus de proprio, ni privé, ni gouvernemental. Ce sont les locataires qui gèrent directement leur coop et disposent ainsi de tous les pouvoirs d'un propriétaire. Le développement des coops d'habitation démarre lui aussi vers la fin des années 70. A la faveur de la création du programme Logipop par la Société d'habitation du Québec en 77 et de la mise en place du programme 56.1 par le gouvernement fédéral en 79, certains comités de citoyens et citoyennes se transforme en Groupes de ressources techniques (GRT) ou obtiennent la fondation d'un GRT dans leur quartier ou leur ville. Au nombre de 37 au Québec actuellement, ces GRT offrent aux groupes de locataires les ressources techniques nécessaires pour réaliser une coop d'habitation, c'est-à-dire acquérir et rénover ou construire des immeubles et gérer collectivement leur entreprise coopérative. En 86, on évalue le nombre de coops à 800 au Québec, pour un total d'environ 1 5,000 logements. Dans 5 régions du Québec, le nombre de coops existantes a justifié la formation d'une fédération, et les 5 fédérations s'apprêtent à leur tour à se regrouper en confédération.
Dans la première moitié des années 80, certains mettent beaucoup, sinon tous leurs espoirs dans la formule coopérative. L'enthousiasme est tel que certains groupes réclament même du gouvernement qu'il cesse de financer les HLM et verse la totalité du budget du logement social au mouvement coopératif! Des divisions naissent entre les groupes qui représentent les locataires...
Il faut dire que les coops d'habitation remplissent bien leur rôle. Dans certains quartiers ou certaines villes, le développement des coops d'habitation prend l'allure de programmes d'aménagement urbain. Des rues entières sont ainsi "coopérativisées", et on parle de l'effet "déflationniste" des loyers des coops sur l'ensemble du quartier. En d'autres termes, parce que les coops peuvent offrir du logement neuf à bon marché, cela empêche le privé de demander un loyer élevé pour ses logements. Mais il faut garder en mémoire que les coops se sont développées à une époque où la construction était à plat...
Les coops n'auraient-elles ainsi que des qualités? Après une décennie de développement frénétique, certaines personnes qui y interviennent, surtout dans le domaine de l'éducation coopérative, font un bilan plus nuancé. La formule coop a elle aussi ses exigences et ses limites propres. Essentiellement, elle va à contre-courant de la façon de fonctionner dans notre société:
- sur le plan économique, la coop élimine le profit;
- sur le plan social, elle impose un fonctionnement de groupe plutôt qu'individuel;
- sur le plan plus humain, on constate que la vie en coop impose beaucoup de pressions. Dans beaucoup de cas, le membre d'une coop se retrouve à vivre et à travailler avec des personnes qu'il n'a pas choisies. Il doit consacrer plusieurs heures de travail "bénévole" à sa coop. Et la participation des membres à la gestion coopérative n'est pas toujours égale... des conflits naissent en enveniment la vie quotidienne et la cerise sur le sundae, c'est que, pour vivre dans une coop, il faut la plupart du temps le mériter par plusieurs années de travail, d'insécurité et de luttes. Beaucoup se découragent... et qui voudrait les blâmer?
De mal en pis
Les groupes qui ont dû consacrer deux, trois, quatre ans d'efforts pour obtenir un terrain ou une école ne sont pas l'exception. Pendant ce temps, le privé profite par exemple, de l'Opération 20,000 logements, qui gèle à son profit à peu près tout ce qu'il y a de terrains disponibles à Montréal. Et il profite en plus à la fois de subventions et de dégrèvements d'impôt!
La concurrence pour l'appropriation de terrains s'est faite particulièrement vive sur l'île de Montréal ces dernières années et a tourné en luttes politiques féroces. En effet, les municipalités souhaitent maintenant "rentabiliser" leur territoire et y attirer une population mieux nantie. Pour ce faire, elles se lancent dans la construction à grande échelle, de quoi? Mais de condos, voyons! Mais les condos, c'est pour ceux qui ont les moyens de les acheter. Ainsi les groupes de locataires se sont mobilisés encore une fois, pour réclamer leur part de ces terrains ainsi mis en exploitation.
Et ces luttes ont pris des formes nouvelles par l'arrivée d'un nouvel intervenant: la classe moyenne. Ainsi sur le site déjà Defense Industries Limited, la Ville a fini par accepter, après trois ans, de rendre une partie du terrain, en bordure de l'autoroute, à des coops d'habitation. La Ville a refusé catégoriquement l'implantation de HLM, afin de ne pas éloigner les acheteurs éventuels de condos et de maisons unifamiliales. Mais ces derniers, nouveaux arrivés à Verdun pour la plupart, sont allés encore plus loin et ont voulu empêcher la construction de coops par référendum municipal. A la Petite Bourgogne, les nouveaux propriétaires de condos sont même allés jusqu'à présenter une pétition à la Ville pour faire démolir les HLM voisins!
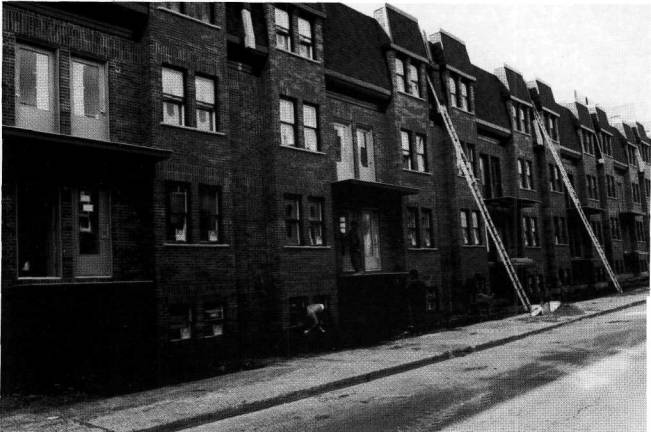
Coops d'habitation, sur la rue Saint-Timothée, à Montréal.
Et du côté de la rénovation, que se passe-t-il? Ici aussi, la classe moyenne est en train d'envahir les quartiers populaires, d'acheter et de rénover les vieilles maisons, avec comme conséquence l'augmentation du coût des maisons et des loyers dans le quartier. Quoi d'étonnant alors que les loyers dans les coops de 85-86 atteignent de $350 à $500! Et pour un propriétaire de condo, qui lui paie $800 par mois, cela semble scandaleux. Mais c'est scandaleux aussi pour les habitants traditionnels du quartier qui, eux, paient entre $150 et $250 et ne peuvent payer davantage. Mais la classe moyenne est en train d'envahir les coops aussi. Les coops alors non seulement cessent d'être du logement social, mais en plus elles contribuent à faire augmenter les loyers dans le reste du quartier. Il n'est pas surprenant alors que des coops, comme la coop Bric-à-Brac de Pointe St-Charles, décident d'enterrer leur projet.
De nouveaux enjeux
Que conclure de ce portrait plutôt pessimiste? D'abord que nous avons vécu dans l'illusion que quoi qu'il arrive dans le secteur privé, le logement social était notre protection.
Au contraire, on constate aujourd'hui que le développement du logement social est étroitement lié à celui du logement privé, à la fois par suite des politiques gouvernementales et des priorités municipales et par suite du jeu du marché.
Deuxièmement, si nous souhaitons défendre le logement social, il semble maintenant qu'il faille aussi intervenir dans les autres domaines touchant au logement. Plus particulièrement, il faut étudier de près les implications de la levée du moratoire annoncée par le ministre Bourbeau et réagir aux intentions plus ou moins avouées du gouvernement du Québec de réduire les pouvoirs de la Régie du logement ou même de céder aux pressions des associations de propriétaires, qui en veulent l'abolition pure et simple.
Enfin, il importe d'identifier clairement vers qui nos actions doivent être dirigées. Traditionnellement, nos revendications s'adressaient aux gouvernements, provincial, fédéral et municipal. Aujourd'hui, les attaques nous viennent des entrepreneurs, des spéculateurs et d'individus de la classe moyenne. Quel type d'action prend-on à l'endroit d'individus qui deviennent nos voisins? Cette situation devrait nous stimuler à développer des stratégies nouvelles.
En bref, après dix ans de luttes et d'expérimentation de formules différentes, nous avons réalisé des acquis certains qu'il faut identifier et exploiter. Dans le contexte actuel, toutefois, on peut avoir l'impression d'avoir joué au parchési pendant dix ans, d'avoir franchi de nombreuses cases pour arriver au grand serpent et là de retomber à la case 1. Ce qu'il faut viser maintenant, c'est d'atteindre la case de la grande échelle, celle de la construction et de la rénovation de logements sociaux.
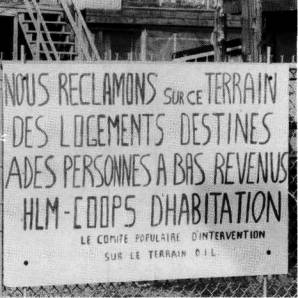

Des coopératives d'habitation ont finalement été érigées sur les terrains de l'ex-usine D.I.L., à Verdun, comme les groupes le demandaient depuis quatre ans.
Un tableau éloquent: LES RECULS DU LOGEMENT SOCIAL:
NOMBRE D'UNITÉS DE LOGEMENT SOCIAL AU QUÉBEC
Logements publics Coops OSBL Programmes de la S.C.H.L.
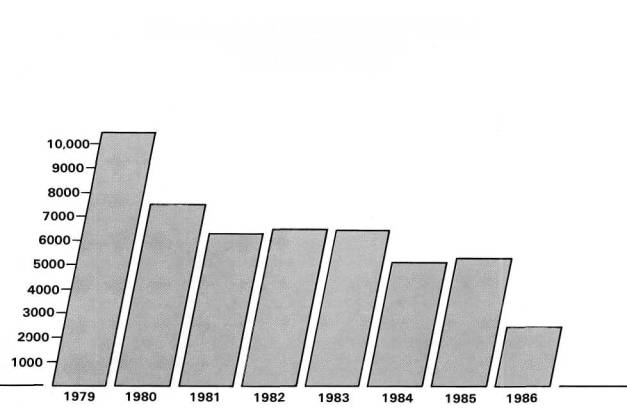
|
UNITÉS DE LOGEMENT SOCIAL ATTRIBUÉES AU QUÉBEC Comparaison 1985 et 1986 |
||
|
1985 |
1986 |
|
|
Logements publics |
|
|
|
HLM |
2161 |
2300 |
|
Sociétés municipales |
649 |
- |
|
Sous-total |
2810 |
2300 |
|
Logements privés sans but lucratif
|
|
|
|
OSBL |
1126 |
|
|
Coops |
1447 |
|
|
Sous-total |
2573 |
400 |
|
Suppléments au loyer |
190 |
700 |
|
Logements autochtones |
408 |
200 |
|
TOTAL |
5981 |
3600 |
Atelier 9:
Le terrain électoral municipal
PRÉSENTATION
Les gouvernements municipaux ont un rôle déterminant dans la transformation de nos quartiers. Ce sont les villes qui autorisent démolitions et constructions, qui aménagent les quartiers, les rues commerciales et les parcs. Elles sont souvent propriétaires de terrains. Ce sont les villes qui (ne) demandent (pas), construisent et gèrent les HLM.
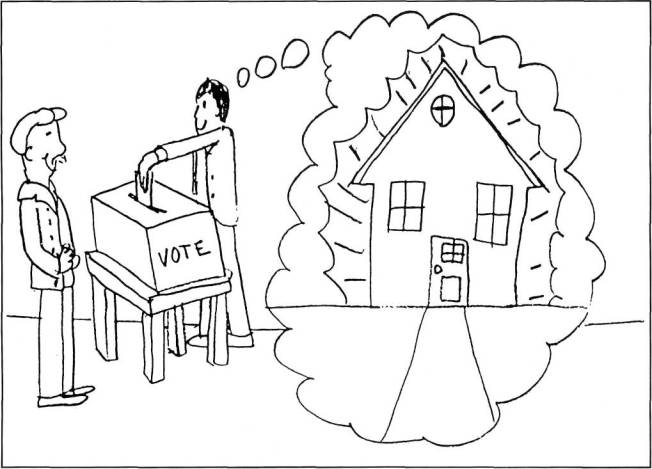
Plus souvent qu'autrement, les villes sont gérées pour et par les autres, malgré l'opposition constante des comités de citoyen(ne)s, groupes de logement, etc. Devant cette situation où nos revendications ne trouvent pas d'écoute au Conseil municipal, de nombreux militant(e)s ont décidé d'investir à ce niveau en se présentant aux élections. Depuis près de 20 ans, plusieurs mènent la bataille pour ne pas laisser les spéculateurs, les notables et les Chambres de commerce diriger seuls la Ville.
De succès relatifs en passant par des victoires morales jusqu'au balayage total, le terrain électoral demeure un lieu qui est privilégié par bon nombre de militant(e)s de nos groupes dans la bataille pour la survie des quartiers populaires.
Quelques faits.
A Hull, en 1974, 5 candidats populaires obtiennent 30% du vote. En 1 982, 3 autres candidats appuyés par les groupes populaires se présentent. Un d'entre eux est élu et se retrouve président de l'Office municipal d'habitation.
A Québec, depuis 3 élections, le Rassemblement populaire, malgré un travail constant et l'appui de nombreux militant(e)s des groupes populaires, ne réussit pas à se faire élire.
A Montréal, en 1 970, les groupes populaires appuient le Front d'action politique (FRAP) qui réussit à recueillir 1 6% des votes en pleine crise d'Octobre. Dès sa fondation en 74, le RCM reçoit l'appui des groupes populaires. 1 8 conseillers sont élus, plusieurs issus des groupes. En 1978, bon nombre de militant(e)s syndicaux et populaires, quittent le RCM dénoncé comme un parti comme les autres. Un seul conseiller est réélu. En 82, l'appui des groupes est mitigé. Le RCM fait élire 14 conseillers. Et en 86, c'est le balayage qu'on connaît. L'appui des groupes est quasi-unanime. Plusieurs militant(e)s sont élu(e)s conseillers.
UNE EXPERIENCE PARMI D'AUTRES: CELLE DE HULL
par Roger Poirier, ex-candidat aux élections municipales à Hull et directeur du Centre Saint-Henri
Introduction
J'ai participé de 1968 à 1986 à l'action sociale et communautaire de Hull. Dès le début de l'action sociale, la question s'est posée clairement: devions-nous nous lancer sur le terrain électoral? Dans ce bref exposé, je ferai un rappel de nos expériences à Hull autour de cette question et je tirerai quelques conclusions.
Les expériences:
1- Celle de 1970
Nous avions commencé notre action sociale fin des années '60, plus exactement en août 1 968, et en '69 nous avions mené une enquête-participation qui conduisait à la mise sur pied de comités de citoyens. Puis en '70 arrivent les élections municipales. Devionsnous participer?... et comment?

Nous étions conscients que nous avions des choses à dire. Nous étions conscients que nous voyions les problèmes sociaux, économiques et politiques d'une façon différente de celle véhiculée par ceux qui étaient au pouvoir; mais nous étions aussi conscients que nous étions un petit groupe qui commençait. Par conséquent, nous avons donc mené une action plutôt d'information lors de cette première campagne d'élections.
Dans ce cadre de formation, le Bureau de direction de l'Assemblée générale de l'Ile de Hull a lancé un projet intitulé "Information: élections municipales". Ce programme, assez ambitieux, avait trois objectifs. Premièrement, le programme entendait assurer une formation de base aux citoyens de Hull par une information programmée sur la nature et le fonctionnement des élections municipales. Deuxièmement, on voulait faciliter l'expression des citoyens au sujet de leurs besoins et de ceux de la collectivité par des rencontreséchanges avec les candidats. Troisièmement, on entendait promouvoir l'instauration d'une certaine démocratie de participation.
L'aspect le plus visible de ce programme d'information, en plus de la distribution de plusieurs milliers de tracts et d'un journal spécial, a été les rencontres que les comités de citoyens, en particulier celui des assistés sociaux, ont organisées avec les candidats pour leur poser une série de questions et rendre public un débat qui concernait l'ensemble de la population. Cette première action a été suivie avec beaucoup d'intérêt par la population et les médias, mais aussi par les candidats eux-mêmes qui ont tous participé aux assemblées publiques organisées par les comités de citoyens. Ce fut là notre première expérience autour des élections municipales à Hull en '70.
2- Celle de 1975
Lors des élections suivantes en '75, nous avions un peu plus de force politique puisque les comités de citoyens s'étaient multipliés, qu'ils étaient devenus vraiment visibles sur la place publique et qu'ils créaient par un ensemble d'interventions, un certain remous dans la population. C'est alors que nous avons décidé d'entrer de plein pied dans les élections municipales de '75 en présentant une équipe de candidats. Je dis candidats parce qu'il n'y avait pas encore de femmes présentes sur cette scène politique.
Le groupe a d'abord présenté une plate-forme électorale, c'est-à-dire un ensemble de revendications contenues dans un programme électoral touchant tous les aspects de la vie économique et sociale de Hull et, en particulier, de l'Ile de Hull. Cette équipe s'est présentée sous un titre: c'était l'équipe "Reconquérir notre ville". Nous étions à peine sortis de la période des expropriations et de rénovation urbaine et nous avions donc vécu cette période comme une période de spoliation: nous nous étions fait voler la rue Principale, pour ne pas dire notre ville!
Les cinq candidats n'étaient pas tous issus des milieux populaires. Un seul l'était, et représentait vraiment le milieu; mais les autres étaient davantage des alliés des milieux populaires et l'équipe avait accepté de se présenter comme groupe avec un programme commun, programme qui n'avait pas été complètement discuté par la base, mais qui avait été préparé par les recherchistes attachés aux comités de citoyens. Le soir des élections, l'équipe "Reconquérir notre ville" aura réussi à obtenir 29% des suffrages. Aucun d'entre eux n'a été élu, mais ils sont tous arrivés bon deuxièmes. Mais le candidat venant des groupes populaires a fait vraiment peur à l'establishment en place. Contre lui, on a présenté quatre adversaires.
D'autre part, il faut également souligner que la décision de former une équipe a été difficile à prendre. Plusieurs militants très proches des groupes politiques de "gauche" préconisaient une lutte simplement idéologique autour d'une plate-forme, méprisant toute action de type électoraliste. Pour eux, participer aux élections municipales était une perte de temps tant que le "grand pouvoir" n'était pas pris. D'autres militants, qui se disaient plus "réalistes", défendaient la thèse contraire: que tout en accordant beaucoup d'importance politique à un programme électoral bien articulé, fondé sur les besoins des citoyens, il fallait également présenter des candidats porte-parole de ce programme à l'intérieur d'un conseil municipal. Jusqu'à la dernière minute, ces deux tendances se sont affrontées à l'intérieur de l'équipe "Reconquérir notre ville".
3- Celle de 1982
Ce sera la dernière expérience d'équipe autour des questions municipales. Au début des années '80, de nombreux efforts ont été faits pour former un parti municipal. Mais les clivages entre péquistes et libéraux ont été un des facteurs d'échec. Autre facteur d'échec: le candidat à la mairie, après avoir cheminé avec le comité ad hoc pour former le parti, a décidé de se dissocier de ce projet et de fonctionner seul. Donc, il n'y a pas eu de parti municipal en 1 982 et les efforts ont mené à rien, sauf que trois membres de cette équipe, tous issus du milieu de l'Ile de Hull et des milieux populaires, ayant tous travaillé dans des comités de citoyens ou groupes populaires, se sont présentés avec un programme commun une équipe de travail, et l'un d'entre eux seulement a été élu comme conseiller municipal.
Enfin, aux élections de 1 986, le candidat élu en 1982, Raymond Ouimet, s'est présenté à nouveau et a été élu sans opposition. Il est considéré comme le représentant des groupes populaires mais sans avoir ni de parti politique en arrière de lui, ni une reconnaissance officielle du mouvement populaire.
Conclusions
De ces expériences, je tire cinq conclusions:
- Les élections sont des moments chauds qu'il faut exploiter au maximum pour faire valoir nos revendications, surtout autour des questions d'urbanisation et de logement. Durant les élections, tous les groupes ont accès plus facilement aux médias. Je trouve important que durant ces périodes, les groupes populaires s'efforcent d'inventer des formes d'intervention pour forcer les candidats à dévoiler leurs vraies couleurs et s'engager. Les élections sont l'occasion parfaite pour présenter nos alternatives et faire des alliances, celles-ci souvent plus tactiques que stratégiques.
- L'action électorale n'est qu'un moyen d'exercer le pouvoir. Le vrai pouvoir est entre les mains de la population et c'est cette population qui doit être maintenue active, intéressée et informée en tout temps.
- La politique, c'est l'art du possible et des compromis. Que ce soit à l'intérieur d'un parti organisé, articulé, ou à l'intérieur même d'une équipe, tous et toutes n'ont pas les mêmes racines sociales et culturelles. C'est un aspect important à ne pas oublier. Dans un parti, tous et toutes n'ont pas forcément les mêmes intérêts concrets. Dans un parti, tous et toutes sont soumis quotidiennement à des influences diverses et contradictoires.
- Je pense qu'un candidat élu, malgré sa bonne volonté et ses bonnes intentions, demeure un être fragile, même s'il est issu du milieu populaire. Il faut quand même donner la chance au coureur. Mais il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention: ne pas le laisser seul et distinguer nos relations d'amitié avec nos relations politiques. Enfin, il ne faut pas oublier que la ligne du "parti" ou de "l'équipe" a presque toujours priorité.
- Je crois qu'il faut aller sur le terrain électoral municipal dès qu'on peut analyser que nous avons une certaine force non uniquement en terme de contenu (idéologie variable, bonne analyse sociale, bon programme), mais aussi en terme d'organisation pour créer un rapport de force minimal.
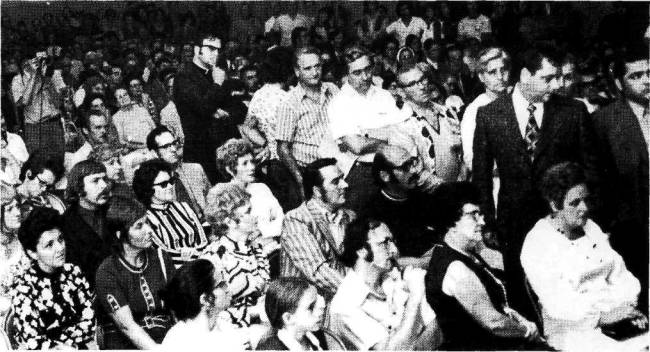
Dans les années 70, face à la trahison des élus locaux, plusieurs militants de Hull se sont lancés dans l'arène électorale au niveau municipal.
UN LIEU DE LUTTE A UTILISER... MAIS COMMENT?
par Marcel Sévigny, militant de la lutte pour le droit au logement, conseiller RCM du district Pointe Saint-Charles
Les enjeux...
Se retrouver à l'Hôtel de Ville, dans l'enceinte du pouvoir, c'est mettre le pied sur un terrain particulier, difficile d'accès et privilégié. Mais, avant d'arriver sur les banquettes de l'Hôtel de Ville, nous avions acquis la certitude, dans la conjoncture actuelle, que le terrain électoral est un moyen et un lieu de lutte comme un autre.
Mais soyons clairs, les progressistes qui se retrouvent au gouvernement, avec le RCM, ne sont pas là pour faire la révolution et ne doivent pas être pris aussi pour des sauveurs. Gagner une élection ça veut dire aller sur un terrain où l'ensemble des groupes d'intérêts sont représentés. Ainsi il faut se situer dans une conjoncture ou il faut négocier. On arrive là avec des idées et des projets qui seront soumis à des pressions de toutes sortes. Entre l'idéal et la réalité beaucoup de choses peuvent se passer. La question qui se pose est comment exercer son jugement.
Il faudra faire l'évaluation de ce qui se passe avec des objectifs mesurables comme par exemple:
- les engagements et le programme du parti au pouvoir
- le travail des élu(e)s pour concrétiser les projets
L'exemple de l'engagement du RCM sur les dossiers Shops Angus, Projet St-Charles et Ateliers municipaux de Rosemont (900 Logements) est un objectif mesurable. Jusqu'ici le programme du RCM et surtout l'intervention de certains candidats y sont pour quelque chose. Les candidats furent les relais des revendications populaires et communautaires. C'est sur ce genre d'éléments que la lutte doit porter.
Bien sûr que les critiques des milieux populaires et communautaires ne doivent pas être exclues, mais elles doivent être un outil pour faire avancer des dossiers qui nous tiennent à coeur. Ainsi il faudra applaudir les bons coups qui seront réussis.
Tant que la confiance règne...
Il y a eu pendant cette dernière élection une connivence qui s'est installée entre des candidat(e)s et les milieux populaires et communautaires. Le défi c'est que cette connivence puisse continuer malgré les problèmes qui ne manquerons pas de survenir.
La circulation de l'information, des enjeux devra être permanente avec les milieux intéressés si on veut sortir le maximum de possibilités du pouvoir municipal.
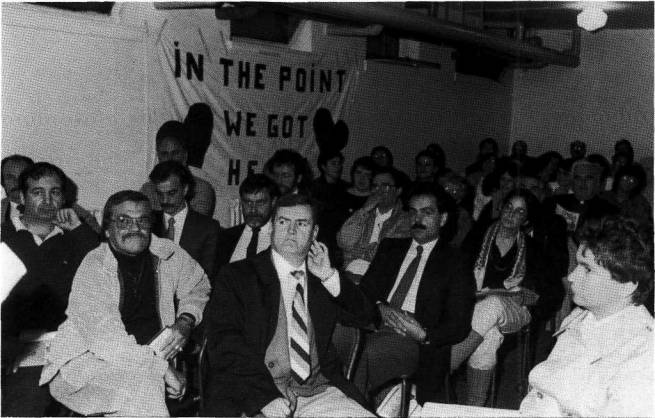
Présents au lancement d'un plan d'aménagement populaire à Pointe Saint-Charles, les nouveaux conseillers du RCM répondront-ils aux demandes des citoyen-ne-s maintenant qu'ils sont au pouvoir?
QUELQUES DÉBATS ET CONSTATS DU COLLOQUE
par Pierre Gaudreau, du FRAPRU

QUELQUES POINTS CHAUDS DU COLLOQUE
Que ce soit parce qu'elles étaient d'actualité ou qu'elles étaient controversées, plusieurs questions abordées dans les ateliers ont soulevé d'intéressants débats. Tout comme les textes des personnes-ressources, ces débats constituent une contribution à la lutte pour le droit au logement et nous en publions ici une courte synthèse.
L'AIDE À LA RÉNOVATION
Revendiquer des subventions au marché privé?
La revendication à avoir face aux problèmes qu'amènent les rénovations sur le marché privé (expulsions, augmentations, déplacements) a fait l'objet d'une polémique dans l'atelier portant sur cette question.
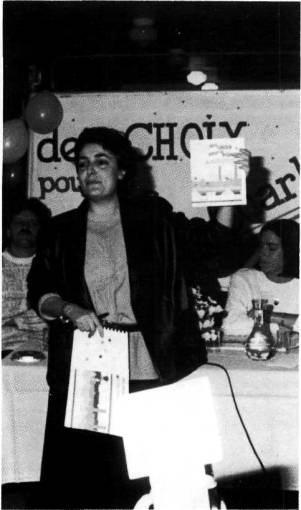
Lancement d'un plan d'aménagement populaire à Pointe Saint-Charles.
La première piste de revendication fort contestée était l'attribution d'une allocation-logement, de type Logirente, pour aider les locataires du marché privé à faire face aux augmentations conséquentes aux rénovations. A priori, cette formule semble intéressante, mais elle n'est pas sans poser de nombreuses questions.
- Ne s'agirait-il pas d'une subvention supplémentaire aux propriétaires privés, d'un encouragement de plus à la spéculation?
- Avec le contrôle des loyers qui existe présentement, cette aide ne risque-t-elle pas de ne profiter qu'aux propriétaires?
Ou prioritairement au logement social?
Une seconde piste de revendication qui est ressortie et qui a suscité l'assentiment général est la possibilité que les subventions à la restauration soit uniquement dirigées vers les organismes sans but lucratif et les petits propriétaires occupants. Pour une, la formule coopérative a démontré qu'il lui était possible de réussir là où le privé, avec sa logique de profit, échouait, en assurant le maintien dans les lieux des résident(e)s à un coût qu'ils et elles peuvent assumer. Ainsi, les participant(e)s se sont étonné(e)s que les coops bénéficiant du nouveau programme fédéral d'aide à cette formule (Programme à hypothèque indexée) ne puisse retirer une aide supplémentaire par le biais du programme PARCQ, ce qui en bénéficierait considérablement les loyers.
POUR QU'ON AMÉNAGE POUR NOUS
L'engouement pour le retour à la ville, c'est qu'on a vendu à ceux qui ont de l'argent un mode de vie urbain de qualité. Pour y arriver, on a déstructuré la population traditionnelle, en lui enlevant son mode dévie. Les pouvoirs ont beaucoup de moyens et peuvent monter des dossiers qui mystifient. On s'organise pour que les intérêts de quelques-uns prennent l'allure des besoins de tous... Il nous faut donc développer des propositions et des perspectives qui correspondent aux besoins des résidents. Et il nous faut le faire avec des perspectives à long terme: on doit apprendre à voir venir, histoire de ne pas nous-même améliorer nos quartiers pour d'autres...
Agir plutôt que réagir
II faut s'organiser pour atteindre ces objectifs. Il faut être capables de faire des projets populaires viables qui vont en ce sens. C'est massivement qu'il faut agir. Il commence à se dessiner une nouvelle formule: le regroupement sur l'aménagement global des quartiers. On y traite autant de l'aspect économique que de l'aménagement des quartiers ou que de la construction de logements. Il y a des exemples à Pointe St-Charles, dans Centre-Sud (Alerte Centre-Sud). Egalement dans Hochelaga-Maisonneuve: une consultation auprès de la population a permis d'arriver à une proposition de schéma d'aménagement. Les gens ne veulent plus être négatifs, et ce n'est pas que la petitebougeoisie qui parle de qualité de vie...
On s'est fait couper l'herbe sous le pied trop souvent en n'ayant rien à proposer... Aujourd'hui, tous les programmes d'aide au logement sont à la baisse... Il nous faut préserver nos acquis, mais aussi amener de nouvelles revendications.
La copropriété: ALTERNATIVE POSSIBLE OU MENACE CERTAINE?
Suite aux deux ateliers portant spécifiquement sur cette question, il se dégage clairement que la copropriété constitue de plus en plus un enjeu pour les quartiers populaires du Québec. De "Plateau Mont-Royalienne" au départ, la mode s'étend rapidement à d'autres villes ainsi qu'à d'autres quartiers de Montréal. Est-il possible de contenir ses impacts ou mieux de se servir de la formule? Voilà les débats qui ont marqué ces ateliers et plus largement de nombreuses discussions du colloque.
L'expérience vécue par plusieurs participant(e)s l'a clairement démontré: à prime abord la copropriété est attirante. Dans certains quartiers elle peut même apparaître comme le seul moyen, pour une couche de salarié(e)s à faible revenu, d'éviter la déportation. Mais l'expérience des participantes démontre aussi que les embûches sont énormes: il est difficile d'emprunter, la spéculation a fait tellement monter les prix dans certains quartiers qu'acheter exige un taux d'efforts exorbitant. De plus, comme le rapportait une participante, même une fois copropriétaire le taux d'effort pour faire les rénovations nécessaires quand on a un salaire de $20,000. devient tout à fait écrasant.
Non à moins de conditions extraordinaires comme des salaires stables, des maisons en bon état et pas trop chères, des copropriétaires qu'on connaît déjà, la copropriété c'est déjà depuis des années des dizaines de milliers d'expulsions dans les quartiers centraux de Québec et Montréal. Avec la contagion du phénomène des condos qui s'étend rapidement à de nombreuses régions ce sont des milliers d'autres locataires qui sont menacés. Avec la levée du moratoire qui est proposée par le gouvernement québécois, il y a, selon certains économistes, jusqu'à 1 50 000 logements qui seront convertis, sûrement pas par les locataires résident(e)s!
C'est en raison de tous ces impacts qu'a et pourrait avoir la copropriété qu'une vaste coalition a été créée en octoDre dernier. Sauvons nos logements revendique l'interdiction de toute transformation en copropriété jusqu'à ce que des programmes d'aide au logement social soient instaurés conjointement avec des mesures de protection réelle des locataires. Ce mot d'ordre d'interdiction de toute transformation en copropriété a été repris par plusieurs participantes au colloque de nombreux groupes se sont engagés à faire circuler la pétition de Sauvons nos logements.
Le terrain électoral: UN DÉBAT ANIMÉ
L'atelier sur le terrain électoral municipal fut l'occasion d'un des plus chauds débats du colloque. Suite à l'exposé des deux militants qui ont décidé de pousser leur démarche dans la lutte pour le droit au logement jusqu'à l'Hôtel de ville en se présentant comme conseillers municipaux, la discussion porta rapidement sur l'attitude à avoir face à un parti, appuyé par les groupes populaires, un coup celui-ci au pouvoir. Pour différentes raisons, c'est à partir de l'exemple du Rassemblement des Citoyen(ne)s de Montréal (RCM) que se fit le débat. D'abord la trentaine de personnes présentes étaient, à deux exceptions près, toutes de Montréal. Mais surtout, le colloque se tenait 4 semaines, jour pour jour, après l'élection du RCM à la tête de Montréal.
Aucun(e) des participantes à l'atelier ne se situa en opposition au RCM, ce qui ne fut cependant pas le cas lors du tribunal populaire qui clôtura le colloque le dimanche après-midi. C'est dans la perception de ce que représentait la victoire du RCM, dans les liens à avoir avec celui-ci, dans les attentes et la marge de manoeuvre qu'on laissait au RCM pour agir que des positions divergentes s'exprimèrent.
Ce qu'on attend d'un pouvoir favorable
Premièrement plusieurs personnes font remarquer qu'on ne doit pas s'illusionner. Si plusieurs militant(e)s issu(e)s des mouvements populaires et syndicaux sont rendu(e)s à l'hôtel de ville de Montréal, il y a d'autres groupes d'intérêt qui y sont aussi et les pressions des lobbys réactionnaires sont toujours aussi fortes.
|
|
Plusieurs militant-e-s impliqué-e-s dans la longue lutte pour du logement social sur le terrain des Shops Angus, à Montréal, ont décidé qu'il fallait investir le champ électoral municipal.
Aussi selon le point de vue d'André Lavallée, militant du comité logement Rosemont et nouvellement élu conseiller RCM, on ne doit pas s'attendre à ce que le RCM soit le sauveur de nos luttes. Il y a des engagements fermes, comme augmenter le nombre de logements sociaux aux Shops Angus, autour du métro Rosemont et à la Pointe StCharles. Encore faudra-t-il continuer la pression.
Un autre intervenant est surpris d'entendre dire que le RCM ne pourra être le sauveur de nos luttes. C'est sûr qu'il ne pourra tout régler, mais on est en droit d'avoir des attentes! Les gens du RCM sont issus du milieu, connaissent les dossiers et besoins, qu'ils agissent!
Pour d'autres, le RCM au pouvoir est une chance d'utiliser un réseau privilégié de contacts avec le pouvoir, de se servir du RCM comme relais pour nos revendications. Il y a aussi des attentes de "ménage" dans l'appareil municipal remplis d'incompétents, de bureaucrates, d'amis du Parti civique. Une intervenante tout en reconnaissant la nécessité de ce ménage, avoue se sentir mal à l'aise en tant que syndiquée face à l'idée de congédiements arbitraires: on se bat contre ça dans nos syndicats!
Les liens à avoir
Pour les deux conseillers RCM présents, il faudrait que des liens dynamiques se créent entre l'hôtel de ville et les groupes:
- en assurant une circulation mutuelle de l'information pour qu'on connaisse nos dossiers respectifs et leur évolution;
- en appuyant les démarches respectives (que les conseillers défendent les revendications des groupes, mais aussi que les groupes appuient les démarches positives des conseillers).
Face à cela, un militant du Comité logement St-Louis explique que s'il est important de porter nos revendications aux conseillers, ce que le Comité logement St-Louis fait depuis des années et continuera à faire, il est important que ces liens se basent sur des revendications concrètes. Ainsi il attend que ça bouge sur la protection des locataires face aux rénovations et à la copropriété, où il note l'absence d'engagement précis de la part du RCM. Sur la copropriété la position du RCM sur la levée du moratoire c'est la même que celle du ministre Bourbeau sur les immeubles de 4 logements et moins, précisément le type d'immeubles où 22 000 locataires ont été déplacés sur le Plateau.
A la Pointe Saint-Charles, une militante explique que même si tout le monde a appuyé le RCM et même si les revendications des groupes sont totalement intégrées au programme du RCM, il n'y a pas de danger de récupération des groupes: la force du réseau des groupes populaires dans la Pointe assure l'autonomie de ceux-ci.
L'autonomie et la spécificité à conserver
Si la majorité des gens présents sont sympathisants du RCM (ou d'expériences semblables dans d'autres villes) tous et toutes considèrent capital de conserver l'autonomie et le travail spécifique des groupes:
- il est important de voir comment on articule la lutte pour le pouvoir municipal avec les luttes quotidiennes pour sauver nos quartiers. Qu'est-ce qu'on laisse exclusivement à nos groupes pour éviter que tous les dossiers soient menés par le parti politique?
L'appui des militant(e)s ou des groupes?
Une différence importante ressort entre les différentes expériences des groupes logement face au terrain électoral municipal. Dans certains cas, à Hull en 1 975, à Sherbrooke 16en 1985 et à Montréal en 1970 et 74, c'étaient les groupes qui appuyaient des partis ou des candidates. A Montréal en 1986, comme à Hull en 1982 ou 1 986, ce ne sont pas les groupes qui se sont prononcés, mais les militant(e)s qui ont majoritairement investi dans les campagnes électorales. Plusieurs explications sont ramenées pour expliquer cette absence d'implication officielle des groupes dans la campagne:
- On ne pouvait appuyer le RCM,Centraide nous aurait coupé.
- La base de nos groupes est acquise aux vieux partis comme le Parti civique et elle aurait été choquée d'un appui au RCM.
- Pour André Lavallée, coordonnateur de son groupe jusqu'à son élection comme conseiller RCM, c'est une question d'autonomie du groupe, les activités et l'influence de celui-ci ne devant absolument pas servir au RCM.
- Un militant de la Pointe Saint-Charles demeure perplexe: pourquoi nos groupes ne se prononcent-ils pas quand tous nos membres militent pour le RCM et quand on met même en veilleuse des dossiers dans l'espoir d'une victoire du RCM?
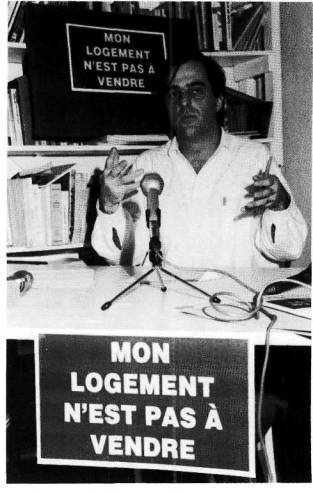
CLÔTURE DU COLLOQUE
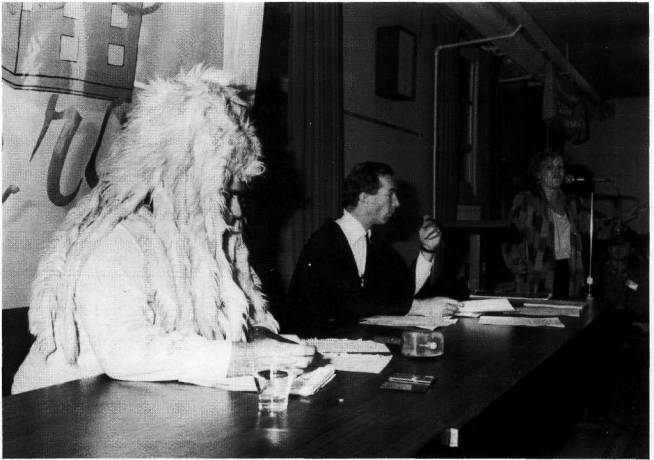
Comme il l'avait fait à l'ouverture du Colloque, c'est le Théâtre Parminou qui a eu pourtâche de clôturer la rencontre, cette fois sous la forme d'un tribunal populaire où les participant-e-s ont fait le procès des diverses stratégies utilisées dans la lutte pour la survie des quartiers populaires.
MOT DE CLOTURE
par François Saillant, du FRAPRU
Le Colloque pour la survie des quartiers populaires tire à sa fin, mais la lutte quotidienne pour sauver nos logements et nos quartiers, elle, est loin d'être finie.
Cette lutte, elle, doit être menée dans chacun de nos quartiers, dans chacune de nos villes, dans chacune de nos régions. Bon nombre de groupes sont déjà actifs sur cette question, mais le colloque de la fin de semaine nous a montré que le potentiel de mobilisation est beaucoup plus considérable. Il n'y a pas que les groupes-logement comme le FRAPRU qui se préoccupent de l'avenir des quartiers populaires, mais aussi les groupes d'assistées sociales, de femmes, de retraité(e)s, de familles monoparentales, de jeunes, de personnes handicapées, d'ex-psychiatrisé(e)s... Il faut non seulement préserver et étendre cet intérêt, mais surtout voir à ce qu'il débouche sur des actions partout à travers la province.

Vous pouvez beaucoup mieux que moi identifier les enjeux précis d'une telle lutte, de même que les actions à entreprendre. Il y a cependant trois suites que nous aimerions vous proposer à ce colloque.
- La première suite que nous vous proposons, c'est de participer à la campagne entreprise il y a quelques semaines par la Coalition Sauvons nos logements dont le FRAPRU fait partie avec le Regroupement des comités-logement et associations de locataires. Une pétition-affiche circule à plusieurs milliers d'exemplaires. Nous vous demandons de faire signer cette pétition bien sûr, mais aussi de demander aux membres de vos groupes de l'afficher à leur fenêtre pour qu'il soit bien clair qu'un peu partout à travers le Québec nous tenons à nos logements et à nos quartiers. Le sommet de cette campagne sera la participation massive et, espérons-le, bruyante à la commission parlementaire itinérante que le Gouvernement du Québec doit tenir en mai ou juin sur la levée du moratoire sur la transformation de logements locatifs en copropriétés. Il serait intéressant que vous alliez "en gang" à cette commission, si elle se montre le nez dans votre région.
- Deuxième suite au colloque: la lutte pour le logement social. Au cours des prochaines semaines, nous vous contacterons pour vous proposer de participer à une campagne visant à marquer l'Année internationale du logement des sans-abris. La campagne tournera autour de deux grands objectifs: la production d'un dossier noir visant à dénoncer les problèmes de logement qui se vivent encore aujourd'hui au Québec, ainsi que la dénonciation des politiques d'habitation qu'on nous a servies à Ottawa comme à Québec. On a mangé notre claque en 86. Il faut s'organiser pour rattraper le terrain perdu. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles là-dessus.
- Finalement, nous voulons vous proposer de conserver des liens plus réguliers avec le FRAPRU et la meilleure façon de le faire, c'est de devenir membre de notre organisme. Il est possible de le devenir comme groupe, il est aussi possible de l'être comme individu, et ce à un coût très minime.
En terminant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué, la plupart du temps bénévolement, à la bonne marche du colloque. Je pense aux animateurs et animatrices, aux personnes-ressources, aux secrétaires d'ateliers, à ceux et celles qui ont travaillé à diverses tâches techniques tout au long du Colloque. Merci aussi au Théâtre Parminou qui s'est chargé de l'animation du théâtre-forum et du tribunal populaire. Merci à Mireille Audet qui s'est chargée de la bouffe. Merci aux organismes qui ont contribué au financement du colloque. Merci enfin au personnel du FRAPRU: Anne-Marie Larocque, Ross Peterson, Raymond Villeneuve, Robert Pilon et surtout Grace Lee et Pierre Gaudreau qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois pour faire en sorte que ce colloque soit un succès. Et merci à vous tous et toutes de votre présence et de votre participation.
AVEZ-VOUS LU?
Pour une politique globale d'accès au logement, FRAPRU, 1985, 12 pages, $1.00 la copie
Le FRAPRU... bientôt dix ans de lutte. Une histoire à suivre., FRAPRU, 1 987, 24 pages, $1.00 la copie
Dossier noir sur le logement et la pauvreté, FRAPRU, 1987, $1.00 la copie
Discrimination, harcèlement et harcèlement sexuel. Rapport de l'Equipe Femmes et logement, Comité logement Rosemont et FRAPRU, 1 986, $10.00 la copie
Ces publications sont disponibles au FRAPRU, 1212, rue Panet, local 322, Montréal, H2L 2Y7, Tél. (514) 522-1010