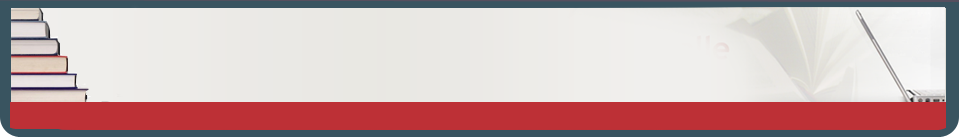La social-démocratie dans l'histoire du mouvement ouvrier International
par yves vaillancourt
On peut se procurer les publications du CFP au :
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 300 Montréal Québec H2R 2W3 Téléphone : (514) 842-2548, poste 223, (France Clavette) Télécopieur : (514) 842-1417 Courrier électronique : info@lecfp.qc.ca
Composition
Composition Solidaire enr. Conception et réalisation graphique Diane Petit
Dépôt légal : deuxième trimestre J978 Bibliothèque Nationale du Québec
Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés.
Ce texte a été réalisé dans le cadre d'un comité de travail du Centre de formation populaire, mis sur pied en avril 1977. Il constitue le dernier d'une série de trois dossiers qui ont été utilisés comme documents de base lors du débat sur la social-démocratie organisé par le CFP en mars 1978.
L'analyse présentée ici dégage les grands traits de l'évolution du courant social-démocrate dans l'histoire du mouvement ouvrier international . Elle contribue donc à mieux nous faire saisir l'orientation actuelle des partis qui se réclament de la social-démocratie et la nature véritable des politiques qu'ils proposent.
Le C.F.P.
TABLE DES MATIÈRES
2. LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE A UN SENS POSITIF (1869-1914)
1) Le parti social-démocrate allemand (S.P.D.) : l'ancêtre des partis social-démocrates
3) Quelques illusions nourries par le recours aux moyens parlementaires et légaux
4) Le révisionnisme de Bernstein
5) Deux fractions dans le Parti social-démocrate russe
3 LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE DEVIENT AMBIGUË (1914-1918)
1 ) La social-démocratie avant la Première guerre mondiale
2) La social-démocratie devant la Révolution d'Octobre (1917)
3) La polémique entre Lénine et Kautsky
4. LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE A UN SENS NEGATIF (1918 à aujourd'hui)
1 ) La création des partis communistes et de la IIIe Internationale communiste
2) La IIe Internationale continue d'exister jusqu'à aujourd'hui
3) Une trajectoire inquiétanteparmi d'autres : l'évolution du Parti social-démocrate allemand
1. INTRODUCTION
Dans une récente livraison du journal mensuel Le monde diplomatique, on trouvait en première page un article intitulé : "Les équivoques de la social-démocratie" (1). Cet article faisait ressortir les diverses tendances à l'intérieur de l'actuelle Internationale socialiste dans laquelle cohabitent des formations politiques appelées social-démocrates comme le parti social-démocrate allemand, le parti social-démocrate suédois, le parti travailliste anglais, le parti socialiste français, etc. Aux yeux de Jean Ziegler, l'auteur de cet article, il y aurait des "équivoques" dans le camp de la social-démocratie contemporaine parce que les partis politiques membres de l'Internationale socialiste sont ou bien de tendance "modérée" comme c'est le cas pour le parti social-démocrate allemand d'Helmut Schmidt, ou bien de tendance "radicale" comme c'est le cas pour le parti socialiste français de François Mitterand:
"Un fasse sépare les partis membres qui pratiquent une politique d'union dès gauches et ceux qui, tels les partis allemand, Scandinave, autrichien, restent farouchement opposés à toute collaboration avec un parti communiste quel qu'il soit". (2)
Ziegler a probablement raison de parler des équivoques de la social-démocratie contemporaine. Mais en tant qu'analyste identifié à l'aile dite "radicale" de l'Internationale socialiste, il se fait la partie belle et il augmente les sources d'équivocité en passant sous silence l'histoire de la social-démocratie et l'histoire de l'Internationale socialiste elle-même. En effet, sans référence à cette histoire, il n'y a rien à comprendre aux équivoques actuelles de la social-démocratie.
Il y a des concepts qui ont une histoire bizarre! Le concept de social-démocratie est un de ceux-là! Dans la tradition marxiste, ce mot était utilisé, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans un sens positif : à ce moment-là, être social-démocrate, pour une personne ou une organisation, c'était la même chose qu'être révolutionnaire; c'était s'inspirer des principes d'analyse et d'action synthétisés par Karl Marx. Mais, au moment de la Première guerre mondiale, le mot social-démocrate se mit à prendre un sens ambigu dans la mesure où les représentants de la social-démocratie européenne adoptèrent des positions variées et contradictoires en rapport notamment avec la guerre et la révolution russe. A partir de 1918, le mot social-démocratie prit carrément un sens négatif pour les marxistes révolutionnaires qui, pour sortir de l'ambiguïté, préféraient abandonner l'étiquette aux réformistes qui avaient dévié des enseignements de Marx.
En somme, dans l'histoire du mouvement ouvrier-international, le concept de social-démocratie est un concept qui, parmi d'autres, a été récupéré par la bourgeoisie. Pour comprendre ce processus de récupération, il faut distinguer trois périodes dans l'histoire du mot social-démocratie.
2. LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE A UN SENS POSITIF (1869-1914)
A partir des années 1870, Marx, Engels et leurs disciples utilisent généralement le mot social-démocrate pour caractériser des militants et des organisations appartenant à leur courant (3).
1) Le parti social-démocrate allemand (S.P.D.) : l'ancêtre des partis social-démocrates (4)
Les origines du S.P.D. constituent un point de référence fort important pour tous ceux qui veulent réfléchir sur les causes de la dégénérescence de ce parti et de la IIe Internationale (5)
- En 1863, Ferdinand Lassalle, un leader réformiste très populaire au sein des masses populaires, avait inspiré la fondation de l'Association générale des ouvriers allemands (A.G.O.A.). Les dirigeants de ce nouveau parti, appelés "les Lassalliens", étaient vus par Marx et Engels comme des réformistes dont les révolutionnaires devaient se démarquer. Marx et Engels reprochaient entre autres aux Lassalliens de se montrer plus empressés à collaborer avec l'Etat bourgeois de Bismarck qu'à miser sur l'action autonome du prolétariat (6). Mais les Lassalliens avaient beaucoup d'influence à l'intérieur des organisations ouvrières allemandes et, pour cette raison, les disciples de Marx et Engels en Allemagne pouvaient difficilement se permettre de les heurter de front.
- En 1869, sous l'inspiration de A. Bebel et W. Liebknecht, deux marxistes membres de la Première internationale, le Parti ouvrier social-démocrate d'Allemagne est fondé à Eisenach. D'où le nom de "Eisenachiens" conféré par la suite aux militants appartenant à ce courant.
En 1875, au Congrès de Gotha, les Lassalliens et les Eisenachiens fusionnèrent pour donner naissance à une nouvelle formation politique appelée le Parti ouvrier socialiste d'Allemagne. C'est ce parti qui en 1890 changera son nom en celui de Parti social-démocrate allemand (S.P.D.) qui existe encore aujourd'hui. Or la fusion de Gotha ne manqua pas de déterminer tout le cours ultérieur de la social-démocratie allemande et même du mouvement ouvrier de l'époque. Marx et Engels critiquèrent fortement cette fusion qui, à leurs yeux, était faite à l'avantage des Lassalliens et au désavantage des Eisenachiens (7).
C'est précisément jusqu'au Congrès de Gotha (1875) qu'il faut remonter pour identifier les racines des ambiguïtés et équivoques de la social-démocratie passée et présente. Dans ses lettres d'octobre 1875, Engels ne mâchait pas ses mots au sujet de ces ambiguïtés et équivoques :
"(...) Dans sa hâte à obtenir à tout prix l'unité. Liebnecht a fourvoyé toute l'entreprise (...). Cette fusion porte en elle le germe de la scission". (8)
Entre autres. Engels s'étonnait de ce que l'on puisse trouver dans le programme de Gotha :
"des phrases et des slogans lassalliens qu'il ne fallait accepter à aucune condition. Lorsque deux fractions fusionnent, on reprend dans le programme les points sur lesquels on est d'accord, et non les points en litige. En acceptant cependant de le faire, les nôtres sont passés sous les fourches caudines". (9)
Ce qui agaçait suprêmement Marx et Engels dans le programme de Gotha, c'était le réflexe lassallien de s'en remettre constamment à l'aide de l'Etat pour solutionner tous les maux sociaux (10).
Malgré toutes les ambiguïtés qui marquèrent ses origines et persistèrent par la suite, le Parti social-démocrate allemand fut considéré comme une sorte de modèle par la majorité des autres partis social-démocrates qui suivront. Un modèle dont les limites attribuables au poids des concessions faites aux Lassalliens n'échappèrent cependant jamais à Marx et Engels.
2) A la fin du XIXe siècle : essor des organisations social-démocrates et création de la IIe Internationale
Pendant les années 1870 et pendant la première moitié des années 1880, la conjoncture européenne ne fut guère favorable à l'apparition de nouveaux partis social-démocrates. Après l'échec de la Commune de Paris ( 1871 ), l'Europe était à l'heure de la répression anti-ouvrière et de la récession économique. En octobre 1878. l'Allemagne tombe sous le coup d'une loi d'exception appelée "loi anti-socialiste" (11). Mais à partir de la fin des années 1880, la conjoncture change : en Allemagne, c'est la levée de la loi d'exception; dans l'ensemble de l'Europe, à la faveur de l'absence de guerres et du pillage des colonies du Tiers Monde, l'industrialisation capitaliste fait d'immenses bonds en avant; dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France et les Etats-Unis, les monopoles se développent et, conséquemment, le capitalisme passe du stade concurrentiel au stade impérialiste, (12) ce qui permet l'émergence d'une "aristocratie ouvrière". Avec le bond en avant de l'industrialisation capitaliste en Europe et en Amérique du Nord, on assiste à une augmentation considérable du nombre des ouvriers industriels et du nombre des syndiqués.
C'est précisément dans cette nouvelle conjoncture que des délégués de 23 pays fondent la IIe Internationale à Paris en 1889. A l'origine, cette IIe Internationale, souvent appelée Internationale socialiste ou Internationale ouvrière est conçue comme un simple cadre pour des rencontres périodiques, des congrès et non pas comme une organisation puissante et centralisée (13).
Au tournant du siècle, la IIe Internationale ressemble à une sorte d'Auberge espagnole dans laquelle on retrouve de tout :
* D'une part, il y a des organisations qui s'appellent formellement social-démocrates. Parmi celles-ci, il y a :
- Le Parti social-démocrate allemand (1875);
- Le Parti social-démocrate de Suède (1889);
- Le Parti social-démocrate de Norvège (1889);
- Le Parti social-démocrate de Hongrie (1890);
- Le Parti social-démocrate de Roumanie (1893);
- Le Parti social-démocrate de Hollande (1894);
- Le Parti social-démocrate de Russie (1898);
- Le Parti social-démocrate de Suisse (1901);
* D'autre part, il y a des organisations qui ne s'appellent pas formellement social-démocrates. Parmi celles-ci, il y a :
- Les partis socialistes de France et d'Italie;
- Le Parti ouvrier de Belgique (1885);
- Le Parti travailliste d'Angleterre (1906).
Même si les organisations social-démocrates ne sont pas les seules à constituer la IIe Internationale, elles n'en conservent pas moins l'hégémonie et, par là, confèrent l'image de marque à l'ensemble de l'Internationale. Ainsi c'est toute l'Internationale qui apparaît social-démocrate. Et, à l'époque, être social-démocrate, c'est se référer positivement aux enseignements essentiels de Karl Marx.
En somme, les social-démocrates sont les socialistes marxistes de la IIe Internationale, tandis que les non social-démocrates — comme les membres du Parti travailliste anglais ou du Parti socialiste italien — passent pour être les socialistes non marxistes de l'Internationale.
3) Quelques illusions nourries par le recours aux moyens parlementaires et légaux
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la conjoncture incitait les militants social-démocrates dans plusieurs pays à recourir davantage aux moyens parlementaires et légaux. Après avoir accompli leurs "révolutions démocratiques bourgeoises" en 1870 et en 1871, des pays comme l'Allemagne et l'Italie s'ajoutaient à la France et à l'Angleterre sur la liste des pays dotés d'institutions démocratiques bourgeoises dont une portion significative des membres pouvaient être élus au suffrage universel.
Ne devenait-il pas alors normal que les organisations politiques social-démocrates songent à faire pénétrer certains de leurs représentants dans ces forteresses bourgeoises qu'étaient les assemblées législatives? C'est précisément ce qui se passa :
* Le Parti social-démocrate allemand traça la voie dans ce domaine comme dans d'autres. Il fit élire 9 députés en 1874, 12 en 1881, 35 en 1890, 56 en 1898 et 110 en 1912. Il représentait déjà 35 o/o des suffrages en 1912.
* A la veille de la Première guerre mondiale, les partis politiques de la IIe Internationale avaient, dans plusieurs pays, commencé à faire des percées électorales intéressantes : les "Socialistes" avaient 103 députés en France en 1914; les "Travaillistes" en avaient 26 en Angleterre en 1906; les "Social-démocrates" en avaient 19 en Hollande en 1913.
Une fois entrés en Chambre, les députés social-démocrates ne se trouvaient-ils pas en bonne position pour faire entendre une voix prolétarienne? Et si, d'élection en élection, les partis social-démocrates voyaient s'accroître le nombre de leurs représentants élus, est-ce que ces succès n'annonçaient pas la possibilité de s'approcher graduellement du pouvoir par des moyens électoraux, légaux et pacifiques?
C'est dans un tel contexte que plusieurs parlementaires social-démocrates, dans plusieurs pays, en vinrent à croire que la lutte des classes pouvait se développer à l'avantage des intérêts de la classe ouvrière sans qu'il y ait nécessité de ruptures, c'est-à-dire en recourant à des moyens exclusivement pacifiques et légaux. Les victoires électorales et les succès parlementaires des social-démocrates incitaient ces derniers à verser dans certaines illusions et déviations en rapport avec la question des limites des règles du jeu démocratique bourgeois. Subtilement, les conquêtes légales et parlementaires alimentèrent le penchant des social-démocrates dans la direction du réformisme : est-ce que la révolution ne pourrait pas être vue comme le résultat d'une longue marche à travers les institutions pour obtenir graduellement, par des négociations délicates, du mieux-être économique, social et politique pour la classe ouvrière?
Amenés à côtoyer quotidiennement une majorité d'autres parlementaires bourgeois et petits-bourgeois et à donner moins de temps aux tâches favorisant les contacts avec les masses populaires, les députés social-démocrates risquaient d'être à leur insu plus marqués par l'encadrement
idéologique du parlement bourgeois que par celui du parti de la classe ouvrière. C'est ce que voulaient dire Marx et Engels en reprochant aux parlementaires social-démocrates allemands de trop se préoccuper de plaire aux autres parlementaires "cultivés" et, en conséquence, de trop "arrondir les coins".
4) Le révisionnisme de Bernstein
Dans les années 1890, les deux grands noms du parti social-démocrate allemand ne sont plus Bebel et Leibnecht, mais Karl Kautsky et Edouard Bernstein. Secrétaire d'Engels dans les années qui précédèrent sa mort en 1895, Bernstein apparaissait comme un théoricien prometteur de la. social-démocratie allemande. Dans les années 1896-1898, il publia une série d'articles sur les "problèmes du socialisme" qui devaient alimenter une grande controverse. En 1899, il regroupa ces articles dans un livre : Les prémisses du socialisme et les tâches de la social-démocratie ( 14). Sensibilisé aux caractéristiques nouvelles que s'appropriait le capitalisme rendu au stade de l'impérialisme, Bernstein prétendait "réviser" le marxisme tout en demeurant dans le cadre du marxisme. Mais comme cette "révision", au jugement d'autres marxistes, allait apparaître comme une "trahison", Bernstein était destiné à devenir l'ancêtre du révisionisme au sens strict.
Les principales thèses défendues par Bernstein dans son livre de 1899 étaient les suivantes :
- Contrairement à ce qu'avait annoncé Marx, le phénomène de la concentration économique du capital entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de capitalistes ne s'est pas développé au cours des dernières années :
- "Le nombre des possédants n'a pas diminué, il s'est accru. La richesse sociale, en se multipliant, ne s'est pas concentrée entre les mains de quelques magnats que la théorie voulait de moins en moins nombreux" ( 15).
- Les richesses produites dans le système capitaliste sont de plus en plus distribuées.
- La "catastrophe imminente" du capitalisme annoncée par Marx dans le Manifeste n'aura pas lieu.
- Deux voies peuvent conduire du capitalisme au socialisme : d'une part, il y a la voie révolutionnaire et d'autre part, il y a la voie réformiste; ces deux voies ne se distinguent pas d'après la fin (la construction du socialisme) mais d'après les moyens. La voie révolutionnaire implique le recours à la violence. La voie réformiste permet d'arriver au socialisme par une série de réformes cumulatives, réalisées au cours d'un très long processus, sans violence, par une série de compromis successifs. La démocratie bourgeoise peut être utilisée comme moyen pour établir le socialisme :
"Dans le domaine politique, nous voyons les privilèges de la bourgeoisie capitaliste s'effacer peu à peu devant les progrès des institutions démocratiques. Et la démocratie, ainsi que les pressions accrues du mouvement ouvrier, en viennent à contrecarrer l'exploitation capitaliste. Cette action, encore hésitante et tâtonnante, tend à généraliser ses effets. La législation du travail, la démocratisation de la gestion municipale, l'extension du pouvoir des communes, la disparition de toute entrave légale au développement des syndicats et des coopératives, l'attention portée aux organisations ouvrières lors de chaque commande de l'Etat, autant de faits qui définissent la phase de l'évolution sociale que nous traversons". (16)
- Grâce au droit de vote, le passage du capitalisme au socialisme peut maintenant s'effectuer graduellement, sans rupture, sans violence :
"Je crois qu'une victoire durable naîtra plus facilement d'une progression constante que d'une rupture incontrôlable". (17)
"De nos jours, en votant, ou en manifestant, nous imposons des réformes qui eussent nécessité, il y a cent ans, des révolutions sanglantes". (18)
- L'Etat est neutre, au-dessus des classes. Il est l'enjeu de la lutte. Il faut le conquérir et non pas le détruire.
- La démocratie est plus que le "gouvernement du peuple". Elle est "l'absence de domination de classe, c'est-à-dire un état social où nulle classe ne dispose à elle seule du privilège politique". (19) En conséquence, elle "est à la fois un moyen et un but. C'est un outil pour instaurer le socialisme et la forme de sa réalisation". (20)
- La notion de dictature du prolétariat est dépassée. Il est possible d'accéder au socialisme par le suffrage universel :
"Le droit de vote fait de celui qui l'exerce un membre de la collectivité. Même si cette participation n'est d'abord que virtuelle, elle finit, à la longue, par devenir effective. Tant que la classe ouvrière reste numériquement faible et politiquement peu formée, le droit de vote peut sembler se réduire au droit de choisir son "bourreau". Mais à mesure que les ouvriers sont plus nombreux et que leur niveau de connaissances s'élève, le suffrage universel devient l'instrument par lequel ils peuvent transformer les parlementaires en serviteurs du peuple". (21)
"Quels sens cela a-t-il de rester accroché à l'idée de dictature du prolétariat, alors que partout les représentants de la social-démocratie se prêtent au jeu de la représentation proportionnelle et du pouvoir législatif, toutes pratiques qui sont à l'opposé de la dictature? La notion de dictature du prolétariat est aujourd'hui à ce point dépassée qu'il faille, pour continuer à en user, la dépouiller de sa signification originelle (...)". (22)
Les thèses révisionnistes de Bersntein furent critiquées par Karl Kautsky dans les congrès de la social-démocratie allemande de 1898 à 1903. (23) Mais Bersntein ne fut pas pour autant exclu du parti social-démocrate allemand... et la tendance réformiste qu'il représentait à l'intérieur de la social-démocratie européenne ne fut pas pour autant démantelée.
5) Deux fractions dans le Parti social-démocrate russe
Au tournant du siècle, la Russie vivait encore sous l'emprise du Tsar et n'avait pas encore fait sa révolution démocratique bourgeoise.
C'était un pays qui demeurait très marqué par le féodalisme même si l'industrialisation capitaliste progressait à grands pas sous l'impulsion des bourgeoisies des pays impérialistes européens. Dans un tel contexte, les militants social-démocrates russes devaient tenir compte de conditions et de contraintes assez distinctes de celles qui prévalaient dans les pays capitalistes de l'Europe de l'Ouest. Par exemple, l'apprentissage des habitudes de clandestinité était une question de vie ou de mort; les militants qui avaient participé au premier congrès du Parti ouvrier social-démocrate russe (P.O.S.D.R.) en 1898 l'avaient d'ailleurs appris à leurs dépens lorsqu'ils avaient tous été cueillis par la police tsariste peu de temps après le congrès.
En dépit de ces caractéristiques propres au contexte russe, le P.O.S.D.R. ne devait pas moins être traversé, lui aussi, par des contradictions qui s'apparentaient à celles qu'on retrouvait dans l'ensemble de la social-démocratie mondiale et, plus particulièrement, dans le Parti social-démocrate allemand. Ces contradictions apparurent au grand jour lors du deuxième congrès du P.O.S.D.R. tenu en 1903. Lors de ce congrès, deux fractions s'affrontèrent :
- D'une part, il y avait la fraction bolchevik. C'était le groupe de la majorité dirigé par Lénine.
- D'autre part, il y avait la fraction menchevik. C'était le groupe de la minorité dirigé par Martov. (24)
Au début, les points de démarcation entre les Bolcheviks et les Mencheviks paraissaient assez ténus : par exemple, Lénine et Martov ne s'entendaient pas sur la façon de définir qui pouvait être membre du parti. Mais avec le temps, le clivage devait devenir beaucoup plus profond; deux conceptions assez distinctes du parti apparurent :
- D'une part, les Bolcheviks mettaient l'accent sur le parti d'avant-garde, insistaient sur l'importance du centralisme démocratique, de l'organisation clandestine, des moyens d'action illégale ; en somme, faisant état de l'absence totale des libertés démocratiques bourgeoises et des immenses moyens des forces répressives dans la Russie tsariste, les Bolcheviks, en s'inspirant du Que Faire de Lénine privilégiaient le rôle des "révolutionnaires professionnels" capables de pratiquer une "discipline de fer", de se coopter au besoin quand les normes de sécurité l'exigent, etc.
- D'autre part, les Mencheviks mettaient l'accent sur le parti de masse, insistaient sur l'importance du centralisme démocratique, minimisaient la nécessité des formes d'organisation clandestines, misaient sur les moyens d'action légale, privilégiaient le recours à l'élection pour choisir les dirigeants et mettaient beaucoup d'espoir dans les possibilités de l'action parlementaire (après février 1917 surtout).
De 1903 à 1917, la division entre les Bolcheviks et les Mencheviks occupa une place centrale dans les débats de la social-démocratie russe et même européenne. Quoique surnommée tendance "de la majorité", la fraction bolchevik fut souvent mise en minorité dans le P.O.S.D.R. : elle se trouvait dans une situation précaire à partir du moment où la fraction Menchevik pouvait compter sur l'appui des grands noms de la social-démocratie russe, soit les Plekhanov, Potresov, Alexrod, Zassoulitch, etc. Pendant les années qui s'intercalèrent entre le deuxième congrès et la veille de la révolution d'octobre (mai 1917) Trotsky, tout en prétendant jouer le rôle de conciliateur entre les deux camps, se trouva néanmoins, dans la pratique, à donner son soutien aux Mencheviks plus qu'aux Bolcheviks. (25) Ainsi, sur la scène internationale, les Mencheviks, grâce à leurs porte-parole prestigieux, se trouvaient bien placés pour faire valoir leur cause et condamner les Bolcheviks accusés souvent à l'époque (par exemple par Rosa Luxembourg) de fomenter les schismes.
Jusqu'en 1912, les Bolcheviks et les Mencheviks fonctionnèrent à la manière de deux fractions d'un même parti. Puis, à partir de 1912, ils apparurent de plus en plus comme deux partis distincts. (26) Pourtant, les uns comme les autres continuent à se réclamer de l'héritage théorique de Marx.
3 LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE DEVIENT AMBIGUË (1914-1918)
Comme nous l'avons vu, la social-démocratie, dès ses origines, portait en germes certaines ambiguïtés. Mais pour que ces ambiguïtés se manifestent au grand jour, il fallait attendre que des événements assument le rôle de révélateurs. Parmi ces événements, il y en eut deux en particulier : la Première guerre mondiale et la Révolution d'Octobre 1917.
1 ) La social-démocratie avant la Première guerre mondiale
Dès le 4 août, Rosa Luxembourg, une militante révolutionnaire polonaise, déclarait que la social-démocratie allemande était devenue un "cadavre puant" parce que, sur tous les députés social-démocrates siégeant au Reichtag, seuls Karl Leibnecht (fils de l'autre) et Otto Rühle avaient représenté la cause du socialisme, la cause du prolétariat, la cause de la révolution prolétarienne. (27) Si la social-démocratie était devenue un "cadavre puant" (pas seulement en Allemagne mais également en France, en Italie, en Belgique, etc.), c'était parce que la majorité de ses représentants dans les parlements européens avaient trahi le principe de l'internationalisme prolétarien en appuyant explicitement ou implicitement les gouvernements bourgeois de leurs pays dans la politique de guerre. Peu de temps après le début de la guerre, trois tendances apparurent dans la IIe Internationale :
- Une tendance "social-chauvine" et "jusqu'auboutiste" quicollaborait ouvertement avec la bourgeoisie nationale, votait avecenthousiasme des crédits de guerre et n'hésitait pas à faire passer leprincipe bourgeois de l'intérêt national avant le principe marxiste del'internationalisme prolétarien.
- Une tendance "centriste" ou "kautskiste" qui paraissait hésiterentre le principe de l'internationalisme prolétarien et celui de l'intérêtnational et qui, dans les faits, par son hésitation, faisait le jeu desintérêts de la bourgeoisie nationale des pays dans lesquels elle setrouvait.
- Une tendance "internationaliste" et "socialiste" qui refusait decollaborer avec la bourgeoisie nationale de son pays en appuyant laguerre impérialiste. Cette tendance était celle du Parti Bolchevik russedirigé par Lénine; c'était aussi celle de Leibnecht, de Rosa Luxembourg.
Donc, avec l'apparition de ces trois tendances, on s'apercevait qu'il y avait de tout dans la social-démocratie!
2) La social-démocratie devant la Révolution d'Octobre (1917) (28)
avec les événements de 1917 en Russie, notamment avec la révolution bolchevique d'Octobre, les clivages à l'intérieur du camp de la social-démocratie s'accentuèrent encore davantage. En gros, les Menchéviks en Russie et la majorité des organisations et des dirigeants social-démocrates de la IIe Internationale reprochèrent à Lénine et au Parti Bolchévik :
1) De ne pas avoir utilisé les possibilités offertes par le parlementarisme bourgeois à la suite de la révolution bourgeoise de février 1917. En effet, contrairement aux Menchéviks, les Bolcheviks ne participèrent pas aux gouvernements provisoires de coalition qui se succédèrent entre février et octobre 1917; ils avaient vu que le terrain où se déroulait vraiment la lutte politique des classes était celui des Soviets (conseil d'ouvriers, de paysans, de soldats...);
- D'avoir déclenché l'insurrection armée dans la nuit du 24 au 25octobre 1917;
- D'avoir établi un Gouvernement des Soviets, soit une dictature duprolétariat, au lieu d'avoir fait appel à l'Assemblée constituante aulendemain de la Révolution d'Octobre;
- D'avoir supprimé les libertés démocratiques bourgeoises, telle laliberté de presse, etc.
3) La polémique entre Lénine et Kautsky
En 1918, la lutte entre la tendance révolutionnaire et la tendance réformiste était à son apogée dans la social-démocratie européenne. Cette lutte de tendances s'exprima dans la polémique entre Lénine et Kautsky. Kautsky publia d'abord une brochure intitulée : La dictature du prolétariat. Lénine répliqua peu de temps après avec une autre brochure intitulée : La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Dans cette polémique, le principal point de divergence était en rapport avec la question de la dictature du prolétariat. A la suite de Bernstein qu'il avait pourtant déjà réfuté dans le passé, Kautsky "révisait" à son tour la pensée de Marx en prétendant que ce dernier avait très rarement utilisé l'expression "dictature du prolétariat". Puis il reprochait à Lénine et aux Bolcheviks le fait d'avoir utilisé des moyens non-démocratiques et une méthode dictatoriale. En réponse à Kautsky, Lénine rappelait que Marx et Engels avaient parlé de dictature du prolétariat pendant quarante ans (de 1852 à 1891). Lénine reprochait entre autres à Kautsky :
1) De cacher le fait que la révolution prolétarienne passe par la destruction de l'Etat bourgeois et son remplacement par une machine d'Etat prolétarienne, ce qui implique nécessairement des ruptures.
2) De semer la confusion en parlant constamment de démocratie en général sans préciser qu'il s'agit de la démocratie bourgeoise et de dictature en général sans préciser qu'il s'agit de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire de la dictature d'une majorité pour empêcher une minorité de restaurer l'ancien ordre établi en fonction de ses intérêts.
3) De répéter à la suite des Menchéviks "que la Russie n'est pas encore mûre pour le socialisme: d'où il résulte logiquement qu'il est encore trop tôt pour transformer les Soviets d'organes de combat en organisations d'Etat (autrement dit : il est opportun de transformer les Soviets, avec l'aide des chefs menchéviks, en organes de subordination des ouvriers à la bourgeoisie impérialiste)". (29)
En un mot, Lénine reprochait à Kautsky d'être, dans la foulée de Bernstein, un renégat et un révisionniste, c'est-à-dire de collaborer dans les faits, avec la bourgeoisie tout en continuant à se réclamer en parole des enseignements de Karl Marx.
4. LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA SOCIAL-DEMOCRATIE A UN SENS NEGATIF (1918 à aujourd'hui)
Après la Révolution d'Octobre, il était devenu clair que la grande famille social-démocrate était irrémédiablement fissurée. D'ailleurs, depuis le congrès de Zimmerwald (1915), (30) tous les conciliateurs avaient compris que c'était peine perdue que de tenter de racommoder les deux grandes tendances. Il valait mieux accepter l'idée de la séparation. Pour la tendance révolutionnaire dirigée par Lénine, il devenait urgent de procéder à la création d'une IIIe Internationale. En effet, parce qu'ils se retrouvaient minoritaires à l'intérieur de la IIe Internationale, ils n'avaient plus rien à faire là. Le fait de retarder le moment de la rupture ne faisait que favoriser la prolongation des ambiguïtés : le mot même de social-démocratie avait perdu toute signification positive; il était devenu le symbole d'une tendance "jaune" qui collaborait avec la bourgeoisie et rejetait la dictature du prolétariat. Dès lors, les marxistes authentiquement révolutionnaires ne pouvaient plus se permettre de s'identifier à cette étiquette. Pour se démarquer, il leur appartenait d'abandonner l'appellation social-démocrate récupérée par les réformistes et d'en adopter une autre, moins ambiguë.
1 ) La création des partis communistes et de la IIIe Internationale communiste (31)
C'est ainsi qu'à partir de la fin de la guerre, une série de faits traduisent
le désir de se démarquer propre aux marxistes de la tendance
révolutionnaire :
1) Les Bolcheviks, à leur Congrès de mars 1918, changèrent le nom ce
leur parti; ils abandonnèrent celui de Parti social-démocrate bolchevique
de Russie pour adopter celui de "Parti communiste bolchevique de
Russie".
2.) Dans les années 1918-1921, les fractions révolutionnaires des partis social-démocrates de plusieurs pays imitèrent le geste des Bolcheviks en se séparant des social-démocrates de leur pays et en fondant de nouveaux partis communistes. C'est ce qui se produisit en Allemagne en décembre 1918, en France en 1920, en Italie, au Chili, au Canada, etc. en 1921.
3) En mars 1919, le premier congrès de la IIIe Internationale communiste avait lieu à Moscou.
En somme, depuis la fin de la Première guerre, les marxistes se réclamant de la tendance révolutionnaire cessèrent d'utiliser le terme "social-démocrate" pour se désigner eux-mêmes, pour désigner leurs organisations et leurs luttes. Ils commencèrent à utiliser le terme dans un autre sens : pour désigner les personnes, les organisations et les luttes de la tendance réformiste de la IIe Internationale.
2) La IIe Internationale continue d'exister jusqu'à aujourd'hui
Lorsque les marxistes de la tendance révolutionnaire eurent quitté avec fracas la IIe Internationale pour fonder la IIIe Internationale communiste, cela ne signifia pas la disparition de la IIe Internationale.
Bien sûr, après la guerre, la IIe Internationale avait du plomb dans l'aile, en raison de la crise profonde qu'elle venait de traverser. Saignée par les départs, elle ne représentait plus qu'une portion du mouvement "socialiste" et ne se trouvait pas pour autant à l'abri des tensions idéologiques et politiques. D'où le caractère laborieux et le semi-échec des rencontres de la IIe Internationale convoquées en 1919 et 1920.
Mais en dépit de ces difficultés, l'Internationale ouvrière socialiste conservait de précieux atouts. Entre autres, elle avait le nombre de son côté. En effet, au début des années '20, 47 partis ou organisations ouvrières affiliées faisaient encore partie de ses rangs. Parmi ces organisations, il y avait :
- Le Parti travailliste anglais (4,000,000 de membres);
- Le Parti social-démocrate d'Allemagne (1,000,000 de membres);
- Le Parti ouvrier belge (500,000 membres). (32)
A son congrès de Hambourg, en mai 1923, la IIe Internationale, dite socialiste, s'employa à regrouper tous les courants qui ne se réclamaient pas du bolchévisme, (c'est-à-dire les restes des partis social-démocrates allemand, autrichien et suédois; les restes des partis socialistes français et italien; le Parti travailliste anglais, etc.) et tenta de se redonner un second souffle.
La IIe Internationale existe encore aujourd'hui. Certes, avec le temps, la référence au marxisme a été abandonnée par les organisations membres qui y tenaient encore dans les années '20 (comme c'était le cas pour les partis social-démocrates allemand et suédois). Aujourd'hui, les partis membres de la IIe Internationale parlent encore de socialisme, mais d'un "socialisme démocratique". D'ailleurs la IIe Internationale s'appelle toujours l'Internationale socialiste.
Dans les années 1970, avec la crise du capitalisme international et l'intensification de la lutte des classes dans plusieurs pays, l'Internationale socialiste semble avoir connu un regain de dynamisme. (33) En septembre 1975, à l'occasion d'une rencontre de cette Internationale tenue à Londres, les participants les plus prestigieux étaient François Mitterand du Parti socialiste français, Olof Palme du Parti social-démocrate suédois, Willy Brandt du Parti social-démocrate allemand, Harold Wilson du Labour Party anglais, Mario Soares du Parti socialiste portugais et Golda Meir du Parti travailliste israélien. Malgré leurs différences de noms et de lignes, les formations politiques membres de l'Internationale socialiste sont considérées comme les représentants du camp de la social-démocratie au sens où on l'entend généralement depuis la fin de la Première guerre mondiale.
3) Une trajectoire inquiétanteparmi d'autres : l'évolutiondu Parti social-démocrate allemand (34)
Plus la social-démocratie s'est approchée du pouvoir, plus elle semble s'être éloignée du marxisme et de l'objectif du socialisme pris dans un sens le moindrement strict (appropriation collective des moyens de production, etc.). La trajectoire du Parti social-démocrate allemand, au cours des dernières décennies semble illustrer assez bien, en tout cas, ce que nous pourrions appeler le processus de dé-radicalisation vécu par les partis social-démocrates à mesure qu'ils s'approchent du pouvoir.
- Pendant la République de Weimar (1919-1933), le Parti social-démocrate en voulant à la fois lutter contre le fascisme naissant et lerival communiste ne contribua pas à barrer la route au fascisme (cequi n'excuse pas pour autant le P.C. A. lequel commit également degraves erreurs pendant cette période).
- Sous le règne de Hitler, le Parti social-démocrate, tout comme leParti communiste, fut contraint à la clandestinité et partiellementdémantelé.
- Après la Deuxième guerre, le Parti social-démocrate allemand doitpratiquement être reconstruit. Graduellement, il s'écarte de plus enplus de la pensée marxiste.
- En 1959, au Congrès de Bad Godeshetgja rupture avec le marxismeest officiellement consommée. Le programme du parti est alors amputéde tout ce qui, de près ou de loin, fait référence au socialismescientifique :
a) Le parti cesse d'être le "parti de la classe ouvrière" pour devenir "le parti du peuple tout entier".
- Des garanties non équivoques sont offertes aux capitalistes :"La concurrence libre et la libre initiative des entrepreneurs sontdes éléments importants de la politique économique social-démocrate". Ou encore : "La propriété privée des moyens deproduction a le droit d'être protégée et encouragée dans la mesureoù elle n'empêche pas la création d'un ordre social juste".
- Si le mot socialisme est parfois utilisé, il est toujours qualifié defaçon à être vidé subtilement de son contenu : le programme seréfère par exemple à un "socialisme démocratique qui, en Europe,est enraciné dans l'éthique chrétienne, dans l'humanisme et dans laphilosophie classique".
5) A partir de 1959, libéré de tout ce qui entravait ses chancesélectorales, le S.P.D. se mit à enregistrer des gains substantiels :
de 29 o/o du vote en 1949, il passa à 36 o/o en 1961 et à 46 o/o en 1972.
6) Présentement le Parti social-démocrate est au pouvoir en Allemagne et cela donne un bon gouvernement capitaliste qui entretient d'excellents liens organiques avec le mouvement ouvrier. Au plan européen et même international, le Parti social-démocrate allemand continue de se présenter comme le modèle et le soutien d'autres organisations politiques qui se réclament de la social-démocratie : au cours des trois dernières années, le parti de Brandt, puis de Schmidt, n'a raté aucune occasion de tenter d'influencer l'évolution des partis socialistes portuguais, espagnol, français, etc.; en 1976, à Helsingôr, Schmidt a tout fait pour apparaître comme le chef de file des "vrais" social-démocrates qui reprochaient à Mitterand et au Parti socialiste français de faire alliance avec le Parti communiste français!
En somme, on a comme l'impression que plus les social-démocratess'approchent du pouvoir, plus ils s'éloignent de leur programmeoriginel : au début de la deuxième période (de notre historique), lessocial-démocrates prétendaient se démarquer des marxistesrévolutionnaires seulement au niveau des "moyens tactiques" et du"langage"; avec le temps cependant, "la tactique a fini par manger lastratégie". Pendant un temps, les social-démocrates disaient, à la suitede Bernstein : nous sommes réformistes au niveau des moyens etrévolutionnaires au niveau des fins; mais après un temps ils finirent paradapter les fins aux moyens.

5 septembre 1975 : à l'issue de leur réunion à Londres, les dirigeants européens de l'Internationale socialiste donnent une conférence de presse. De gauche à droite : François Mitterand, Olof Palme, Willy Brandt, Harold Wilson et Mario Soares.
5. CONCLUSION
L'histoire de la social-démocratie se présente donc comme une histoire étrange et triste. Au début (pendant la phase I), les social-démocrates étaient des socialistes qui s'efforçaient d'appliquer les enseignements du marxisme. Puis (pendant la phase II), la majorité des social-démocrates se mirent à "réviser", au sens d'oublier, les enseignements du marxisme, ce qui eut pour effet d'obliger la minorité à changer de nom. Enfin (pendant la phase III), les social-démocrates finirent par cesser tout simplement de se référer au marxisme... Ainsi, alors qu'il fallait être marxiste pour être social-démocrate pendant la première phase, il faut ne pas être marxiste pour être social-démocrate pendant la troisième phase. (35) Si à l'origine les social-démocrates étaient des socialistes scientifiques, aujourd'hui ils ne parviennent tout simplement pas à rompre avec le camp capitaliste, même s'ils continuent souvent à se présenter comme des "socialistes démocratiques".
NOTES
- Jean Ziegler, "Les équivoques de la social-démocratie; un carrefour de cynismeet d'espérances", dans Le Monde Diplomatique, janvier 1978, pp. 1-2.
- Loc. cit.
- Nous disons "généralement" et non pas "toujours" pour tenir compte du faitqu'Engels, occasionnellement disait préférer le mot "communiste" au mot"social-démocrate "auquel il prêtait un sens plus péjoratif. Par exemple, dans la préface à la brochure du Volksstaat de 1871-1875, Engels disait : "Dans tousces écrits, je ne me qualifie jamais de social-démocrate, mais de communiste.Pour Marx, comme pour moi, il est absolument impossible d'employer uneexpression aussi élastique pour désigner notre conception propre". Cité dans Marx et Engels, La social-démocratie
- Pour une analyse plus fouillée de l'histoire de la social-démocratie allemande,consulter le dossier de Pierre Beaulne publié au Centre de formation populaireen mars 1978.
- La IIe Internationale prit la relève de la Première Internationale appeléel'Association internationale des travailleurs, fondée par Marx et Engels en1864 et dissoute en 1876. Pour un tour d'horizon rapide des internationalesouvrières, consulter Annie Kriegel, Les internationales ouvrières, PressesUnversitaires de France, Coll. "Que sais-je?", No 1129, 1964.
- Marx et Engels considéraient que les Lassalliens faisaient le jeu de Bismarck enappuyant ce dernier d'une façon inconditionnelle lorsqu'il promettait desréformes comme le suffrage universel, des coopératives d'Etat, des politiquessociales concernant les personnes âgées, etc. Pour avoir un aperçu des critiquesadressées par Marx et Engels aux Lassalliens, voir Le parti social-démocrate allemand, pp. 54-58.
- Voir sur cette question K. Marx, Critique du programme de Gotha, (texte rédigé en 1875)
- Lettre d'Engels à Bebel, 12 octobre 1875, dans Marx Engels, La social-démocratie allemande, p. 83.
- Ibid, p. 84.
- Ibid, p. 86.
- Par cette loi anti-socialiste, Bismarck visait le démantèlement des journauxouvriers et des associations ouvrières. Dans les districts où l'état de siège étaitdécrété, la police avait le droit d'expulser quiconque pouvait lui apparaitre toutsimplement "suspect" de faire de la propagande socialiste. Voir Marx etEngels, Ibid, p. 121.
- Même si le phénomène de l'impérialisme apparaît avant le tournant du siècledans les pays capitalistes avancés de l'époque, c'est seulement avec la Premièreguerre mondiale que Lénine pourra l'identifier et l'expliquer avec netteté.Voir Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916.
- Cf. Annie Kriegel, Ibid, pp. 36-37.
- (14)Ce livre vient tout juste d'être réédité en français : E. Bernslein, Les présupposés du socialisme, Seuil, 1974.
- (15)Ibid. p. 14.
- Loc. cit.
- Ibid., A 16
- Ibid., p. 18. Voir aussi p. 176.
- Ibid., p. 172.
- Ibid., p. 1 74.
- Ibid., p. 176.
- Ibid., pp. 177-178.
- Les positions de Berstein furent également critiquées sévèrement par RosaLuxembourg et par Lénine. Voir entre autres Lénine, Que faire?, 1902, début de la première partie.
- Au sujet de la division entre les Bolcheviks et les Mencheviks. consulter J.M.Piotte, Sur Lénine, éditions Parti Pris, Montréal, 1972, pp. 103-1 72 et, en particulier 124-129. Pour avoir accès directement au point de vue de Lénine sur laquestion, voir l'analyse du deuxième congres qu'il produisit "a chaud" peu detemps après le congrès et publiée en 1904 : Un pas en avant, deux pas enarrière, reprise dans Lénine, Oeuvres Choisies, éditions de Moscou, Tome 1, pp. 263-444.
- Ce rôle de conciliateur joué par Trotsky avant qu'il ne prenne nettement position pour les Bolcheviks dès son retour d'exil en mai 1917 est relevé à maintes reprises dans une biographie qui demeure pourtant sympathique à l'endroit de Trotsky Isaac Deutscher, Trotsky, coll. 10/18, Paris, 1972 (première édition : 1962, Tome I.
- D 'ailleurs, à partir de 1912, les bolcheviks s'appellent le Parti ouvrier social-démocrate russe (bolchevik), ce qui renvoie à l'abréviation P.O.S.D.R. (b).
- Lénine, "Les tâches du prolétariat dans la présente révolution " (avril 1917) dans Oeuvres Choisies, éditions de Moscou, tome II, pp. 39 et 59-64, et "La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky " (1918) dans ibid., tome III, p. 75.
- Au sujet de la Révolution d'Octobre 1917, voir : Charles Bettleheim, Les luttes de classes en URSS, 1ère période 1917-1923, Seuil/Maspero Paris 1974 pp. 55-111.
- Lénine, "La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky " (1918) dans Oeuvres Choisies, tome III, pp. 92-93.
- Au sujet de la Conférence de Zimmerwald, voici ce que dit A. Kriegel, ibid. p.66 : "La Conférence de Zimmerwald du nom du village de l'Oberland bernois où elle se tint du 5 au 8 septembre 1915, première manifestation collective d'un courant international contre la guerre, rassembla 38 socialistes de 11 pays, inégalement représentatifs, d'ailleurs, du triple point de vue de leur place dans leur parti, de la place de leur parti dans leur pays, de la place de leur pays dans la guerre. Mais la présence simultanée de ressortissants français et allemands, malgré la prédominance des neutres et des réfugiés politiques (parmi lesquels le leader menchevik Martov, Trotsky et Lénine), suffit à ce que cette réunion prenne toute sa signification : celle de refuser une stratégie ouvrière qui suspendait les perspectives de la révolution sociale à la victoire d'un bloc de nations sur l'autre".
- Sur la création de la IIIe Internationale , voir A. Kriegel, ibid., pp. 73-78.
- A. Kriegel, ibid. p. 72.
- Sur l'Internationale socialiste aujourd'hui, voir, en plus de l'article cité à la note : (1)Maurice Duverger, Joseph Rovan, Jean Parent et François Bédarida,"Social-démocratie" dans Universalia 1977, Paris, 1977, pp. 77-86.
- Voir note (2) en page 9.
- Si bien qu' un parti politique social-démocrate canadien comme le CCF/NPD né en 1932, soit pendant la troisième phase de notre périodisation, n 'a jamais eu besoin de se référer positivement au marxisme. Sur les origines du CCF/NPD, voir M. Pelletier et Y. Vaillancourt, Les politiques sociales et les travailleurs, Cahier II, pp. 69-75.