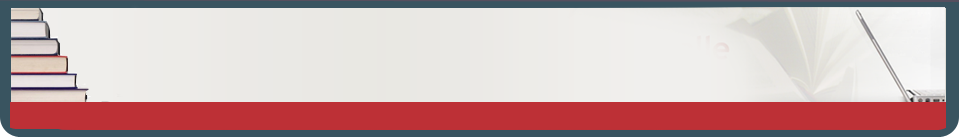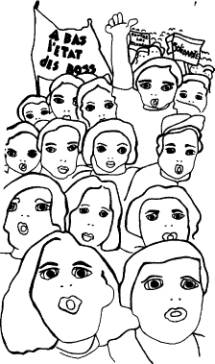Les syndicats et la question du parti des travailleurs
Quelques expériences dans l’histoire du mouvement ouvrier international
Par Louis Favreau
Le dossier que nous publions a été réalisé par un militant, membre du Centre de formation populaire, et a déjà été soumis à plusieurs militants de groupes syndicaux et populaires.
La question des rapports entre partis et syndicats fait l'objet, depuis déjà quelques années, de nombreuses discussions entre militants de divers milieux et de différentes instances. Il nous est apparu que ce texte pouvait alimenter de façon pertinente le débat actuel en proposant une analyse de quelques expériences vécues au sein du mouvement ouvrier international et en dégageant quelques grandes orientations qui peuvent guider le développement d'une organisation politique conforme aux intérêts des travailleurs.
Il ne faut donc pas chercher dans ce texte la position du CFP sur le type même d'organisation politique à entreprendre ici, mais plutôt tenter de cerner avec l'auteur la question complexe des rapports pouvant exister entre le syndicalisme et l'organisation politique des travailleurs, dans le but de mieux orienter nos pratiques visant une plus grande autonomie du mouvement ouvrier.
Le C.F.P.
TABLE DES MATIÈRES
1. OU EN SOMMES-NOUS PRESENTEMENT?
2. ETUDIER L'HISTOIRE DUMOUVEMENT OUVRIERINTERNATIONAL
2. PRESENTATION SOMMAIRE DES EXPERIENCES
3. LE GOMPERISME OU LE REFUS DE L'ACTION POLITIQUE AUTONOME DE LA CLASSE OUVRIERE
4. LE TRAVAILLISME OU LA DEPENDANCE DU PARTI VIS-A-VIS DES DIRECTIONS SYNDICALES
5. LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE OU LA CONCURRENCE ENTRE LE SYNDICAT ET LE PARTI
LA CHARTE D'AMIENS (ou charte du syndicalisme révolutionnaire)
1. KARL MARX ET LA 1 ère INTERNATIONALE (L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 1864 - 1872)
2. LA THEORIE LENINISTE DU PARTI ET DE SES RAPPORTS AVEC LES ORGANISATIONS DE MASSE
L'INTERNATIONALE COMMUNISTE ET LES SYNDICATS
4. GRAMSCI OU LA THEORIEDE LA TRANSFORMATION RECIPROQUE DU PARTI ET DES ORGANISATIONS DE MASSE
EXTRAITS DES THESES DE LYON (GRAMSCI)
5. QUELQUES ELEMENTSDE SYNTHESE A PARTIR DE MARX, LENINE ET GRAMSCI
7. LES EXPERIENCES HISTORIQUES ET LA REALITE D'AUJOURD'HUI: QUELQUES INDICATIONS
8. EN GUISE DE CONCLUSION : QUELQUES POINTS DE REPERE ET UNE DIRECTION DE RECHERCHE
1. QUE FAIRE AUJOURD'HUI ET MAINTENANT
LES RAPPORTS PARTIS/SYNDICATS DANS LE MOUVEMENT OUVRIER ITALIEN
3. SUR LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE
4. SUR LE MOUVEMENTOUVRIER DE TRADITION MARXISTE
1. PRESENTATION
|
|
Le débat sur la participation ou non du mouvement syndical au sommet économique du gouvernement québécois aura fourni une autre occasion de discuter du rôle du syndicalisme dans la société, de nous redemander ce que sont réellement nos syndicats : des lieux d'organisation et de lutte contre le système d'exploitation capitaliste ou de simples moyens de limiter les abus du système et de négocier notre part du gâteau?
Remarquons tout de suite qu'une nouvelle réponse à cette question a commencé à surgir à l'intérieur même du mouvement syndical, à la fin des années '60 mais de façon plus catégorique en 1971-72, au moment du Front commun et de la publication des manifestes des centrales syndicales. C'est le manifeste de la CSN, "Ne comptons que sur nos propres moyens", qui allait ouvrir la discussion sur le régime économique dans une bonne partie du mouvement ouvrier. Qu'est-il résulté globalement de cette confrontation d'idées sur le capitalisme? D'abord, pour une minorité significative, un rejet explicite du capitalisme : le système capitaliste ne permettra jamais la libération économique, politique et culturelle des travailleurs. D'autre part apparaissent de façon fragmentaire des éléments de propositions pour la construction ici d'une nouvelle société, de caractère socialiste, dirigée et organisée par les travailleurs eux-mêmes. Et pour parvenir au socialisme, au pouvoir des travailleurs, plusieurs militants affirmaient deux choses : 1 ) il faut changer nos pratiques syndicales, rompre avec le syndicalisme d'affaires et bâtir un syndicalisme de classe et de combat; 2) il faut s'occuper de la politique parce que la politique, elle, s'occupe de nous : d'où l'affirmation de plus en plus nette par la suite de la nécessité d'un parti politique de travailleurs.
En réalité, sur ce dernier point, nous partions de loin : le mouvement syndical québécois dans son ensemble (à l'exception des velléités d'appui de la FTQ au NPD) disait bien haut (et cela depuis des dizaines d'années) que le mouvement syndical ne devait pas faire de politique. En cela, au Québec, jusqu'en 1970-71, notre syndicalisme ne différait guère des mouvements syndicaux canadien et américain. Notre position coïncidait avec celle de la tradition syndicale dominante en Amérique du nord, une tradition de neutralité politique de principe. Ce qui n'empêchait pas les uns et les autres de faire de la politique de toute manière : "lobbying" à Québec et/ou à Ottawa à l'occasion du passage de telle ou telle loi, appui tacite à un parti politique à l'occasion d'une campagne électorale (appui de la CSN au Parti libéral en 1960 par exemple) ou encore, des cadres et des dirigeants syndicaux qui quittent le mouvement pour passer ouvertement de l'autre côté de la clôture et faire de la politique active... pour la classe dominante (1).
1. OU EN SOMMES-NOUS PRESENTEMENT?
On le sait, de façon bien manifeste, il n'y a toujours pas de parti de travailleurs au Québec. Il n'y a pas de parti au sens le plus radical de ce terme : il n'y a pas de parti de classe, un parti qui regroupe les militants les plus actifs, un parti qui lutte pour le socialisme en répondant aux intérêts à court et à long terme des travailleurs et de toutes les couches exploitées du peuple, un parti qui systématise, oriente et unifie les luttes qui se mènent sur les différents fronts contre le capitalisme.
Certains groupes ont certes la prétention d'être le noyau à partir duquel ce parti sera constitué. Mais dans les faits, ils sont plus souvent qu'autrement extérieurs à la classe ouvrière et à ses luttes. C'est que derrière leurs discours, les intérêts et les valeurs de la petite-bourgeoisie intellectuelle sont largement véhiculés.
Par ailleurs, il faut compter aujourd'hui avec une gauche syndicale, avec une nouvelle génération de militants syndicaux surtout à la CSN et à la CEQ mais aussi à la FTQ quoique de façon moins visible. Dans les six ou sept dernières années, de plus en plus de militants ont réfléchi sur leur pratique syndicale passée et ont travaillé à transformer leur syndicat de manière à ce qu'il devienne un lieu réel de mobilisation, de soutien aux autres travailleurs en lutte et de prise de conscience de la nécessité d'abattre le capitalisme. En outre, l'intervention de plus en plus marquée de l'Etat dans les conflits a politisé davantage les luttes (2), ce qui a eu pour effet de politiser un peu plus le mouvement syndical.
Mais à travers ces luttes et les confrontations d'idées qui en découlent ont surgi de nouvelles questions que la gauche dans le mouvement syndical n'a pas encore très bien clarifiées. Une fois le principe de l'action politique autonome des travailleurs admis, plusieurs questions sont demeurées en suspens. Les principales sont sans doute les suivantes :
- De quel type de parti avons-nous besoin pour arriver àbâtir une société socialiste?
- Quelle peut être notre contribution comme militantssyndicaux dans la construction de ce parti?
- Quel type de liens convient-il d'établir entre ces deuxorganisations que sont les partis et les syndicats?
2. ETUDIER L'HISTOIRE DUMOUVEMENT OUVRIERINTERNATIONAL
Certaines de ces questions peuvent paraître relativement nouvelles ici mais elles ont surgi il y a bien longtemps dans un bon nombre de pays. La connaissance d'expériences de lutte du mouvement ouvrier dans le monde à différentes époques et dans différents pays est toujours éclairante sous un aspect ou sous un autre : il ne s'agit pas de copier une expérience (existante ou ayant existé ailleurs) mais de réfléchir sur les acquis des autres travailleurs pour guider notre action.
Ce texte présente donc quelques expériences des rapports qui existent, dans le mouvement ouvrier international, entre les partis politiques de la classe ouvrière et les syndicats. Une première enquête nous a permis de dégager quatre catégories différentes d'expériences (le gompérisme, le travaillisme, le syndicalisme révolutionnaire et le mouvement ouvrier de tradition marxiste). Le présent texte veut les décrire à grands traits (en montrer les caractéristiques principales) en fournissant les points de repère historiques nécessaires. Il ne va pas au-delà de cet objectif. Dans ce sens, il ne constitue qu'un premier déblayage de la question des rapports partis-syndicats, question qui a plus de cent ans d'histoire dans le mouvement ouvrier international. Nous sommes donc très conscients des limites que le présent texte comporte. Cependant nous pensons qu'il peut stimuler la réflexion des militants.
|
|
|
Le Front commun de 1972. |
Le présent texte appelle également une dernière remarque : les différentes expériences ne peuvent être mises sur pied d'égalité. Aussi avons-nous porté plus d'attention à l'expérience du mouvement ouvrier de tradition marxiste (qui est celle du mouvement ouvrier en France, en Italie ou au Chili pour ne mentionner que les exemples les plus clairs), car ce courant s'est développé précisément là où la classe ouvrière est des plus combatives dans sa lutte pour transformer la société. Notre objectif premier est finalement de fournir une direction de recherche et quelques pistes de réflexion sur le débouché politique du syndicalisme de classe et de combat et sur les liens qui doivent s'établir entre ces deux composantes que sont les syndicats et le parti, ce que permet plus que les autres l'expérience du mouvement ouvrier de tradition marxiste.
2. PRESENTATION SOMMAIRE DES EXPERIENCES
La question des rapports entre les syndicats et les partis a trouvé à travers l'histoire des solutions fort variées. Les rapports qui se sont constitués entre les syndicats et les partis politiques de la classe ouvrière dépendent de plusieurs facteurs :
1) le poids de l'histoire et de la tradition de chaque mouvement(par exemple au Québec l'influence du syndicalisme chrétien et laquestion nationale);
2) les conjonctures nationale et internationale (relations des syndicats avec un parti dans l'opposition ou au pouvoir, relations obligéesdu mouvement syndical avec plusieurs partis plutôt qu'avec un).
Il est toutefois possible de dégager les expériences les plus significatives de rapports qui existent, dans le mouvement ouvrier international, entre les partis politiques de la classe ouvrière et les organisations syndicales. Les quatre (4) expériences sélectionnées ici l'ont été sur la base de l'importance relative qu'elles ont eue et qu'elles ont encore dans le mouvement ouvrier. Ce sont ces expériences qui, de fait, ont marqué le plus la plupart des mouvements non seulement en Europe et en Amérique du Nord mais dans d'autres parties du monde (Amérique latine...). Les 4 expériences dont nous voulons faire ici la présentation critique sont les suivantes :
- Le gompérisme ou le refus de l'action politique autonome de la classe ouvrière : cette position qualifie notamment l'expérience du mouvement syndical américain. C'est le gompérisme, ainsi nommé par référence au fondateur de l'American Fédération of Labor (A.F.L.) aux Etats-Unis, Samuel Gompers.
- le travaillisme ou la dépendance du parti vis-à-vis des directionssyndicales : cette situation caractérise le travaillisme et trouveson illustration la plus complète dans l'expérience du mouvement syndical britannique.
- le syndicalisme révolutionnaire ou la concurrence entre le syndicat et le parti: cette position qui considère le syndicatsupérieur au parti dans la lutte contre le capitalisme se rapporte au syndicalisme révolutionnaire (3). Il se rattache tout particulièrement au mouvement ouvrier français des débuts duXXe siècle.
- le mouvement ouvrier de tradition marxiste ou l'interdépendance entre le parti d'avant-garde et le syndicat : c'est à cette expérience que se rattache le mouvement communiste. Mais cette expérience se réfère aussi à de nombreux mouvements ouvriers nationaux qui ont une perspective socialiste sans être pour autant communistes (c'est-à-dire appuyant inconditionnellement la direction du parti communiste de l'U.R.S.S. ou de la Chine (4)
Mentionnons de plus que ces expériences, même si elles ont pris formeau début du siècle, sont pleinement présentes dans l'actualité du mouvement ouvrier. Ces expériences ont en effet inspiré des courants ou tendances, lesquels peuvent coexister à des degrés divers et s'affronter àl'intérieur d'un même mouvement ouvrier national.

3. LE GOMPERISME OU LE REFUS DE L'ACTION POLITIQUE AUTONOME DE LA CLASSE OUVRIERE
|
|
Samuel Gompers, 1874.
C'est en 1886, aux Etats-Unis, que l'American Fédération of Labor (A.F.L.) se constitue en centrale syndicale. Samuel Gompers allait être son président jusqu'en 1923.
La naissance de cette centrale marque un tournant dans l'histoire du mouvement ouvrier américain : elle surgit d'une guerre ouverte avec les Chevaliers du travail (5) qui avaient à ce moment-là derrière eux une dizaine d'années de luttes vigoureuses tant sur le plan syndical que sur le plan politique. Avec l'A.F.L., c'est une nouvelle période qui s'ouvre où l'organisation syndicale se fait sur la base des métiers (laissant de côté l'organisation des travailleurs non qualifiés) et en mettant l'accent principal sur la négociation de contrats de travail.
Pour Gompers, les objectifs syndicaux se réduisent aux seules revendications salariales car les unions ne sont et ne doivent être que "les organisations d'affaires des salariés, qui s'occupent des affaires des salariés". Pour Gompers, le capitalisme n'est pas un adversaire mais l'élément essentiel pour obtenir de meilleurs salaires. L'hégémonie du capitalisme (son influence idéologique et politique prédominante) n'est pas remise en cause et sa domination économique n'est contestée que sur la base de groupes de travailleurs pris isolément. La solidarité de classe (de l'ensemble de la classe ouvrière) n'est pas conçue par l'A.F.L. comme principe fondamental de la lutte syndicale.
En réalité l'A.F.L. de Gompers va plus loin en rejetant toute forme de socialisme qui (aux dires même de Gompers) "nous menacerait, s'il pouvait être mis sur pied, du pire système d'effort et d'activité restrictif jamais conçu par l'entendement humain" (6).
Le gompérisme fait donc confiance au capitalisme et prend même ouvertement position contre le socialisme. Il n'est pas surprenant dans ce sens qu'il dénie pratiquement à la classe ouvrière la possibilité de se constituer en force politique autonome et qu'il affiche officiellement une position de neutralité politique de principe.
Pourtant l'A.F.L. de Gompers prend souvent position sur les questions d'ordre politique. Comment pourrait-il en être autrement compte tenu de la force que le mouvement syndical représente dans la société! Mais l'A.F.L. le fait à la manière d'un groupe de pression, d'un "lobby" qui entre en action par intermittence, à l'occasion notamment de la présentation de projets de lois, surtout de ceux qui l'affectent directement. Elle le fait encore au moment d'élections par l'appui financier et le soutien public aux partis de la bourgeoisie (l'un ou l'autre selon ce qui est avancé dans les programmes de ces partis).
Il faut noter en outre que cette conception de neutralité politique de principe doublée d'une pratique de lobbying n'existe à l'état presque pur qu'en Amérique du Nord. Elle a cependant une influence qui est loin d'être négligeable à l'extérieur, particulièrement en Amérique latine, à travers des mécanismes que l'A.F.L. a elle-même établis tels l'Organisation régionale inter-américaine du travail (ORIT) et l'Institut américain pour le développement du syndicalisme libre (IADSL) (7)
On aura reconnu, dans cette présentation du gompérisme, la traditionpolitique du syndicalisme d'affaires. Ce n'est qu'aux Etats-Unis quecette conception demeure officiellement celle du mouvement syndicaldans son ensemble. Nous n'insisterons pas sur cette tradition avec laquelle nous cherchons à rompre depuis quelques années. La neutralitépolitique des syndicats est un mythe. Elle n'existe réellement nullepart, même pas aux Etats-Unis. Comme force organisée, le mouvementsyndical a un impact politique dans la société sans pour autant avoir àse transformer en parti politique — ce qu'aucun mouvement syndicaln'a jamais fait dans le passé —. Toute la question est de savoir au service de quels intérêts et de quelle classe cette force que représente le syndicalisme est mise à profit.
4. LE TRAVAILLISME OU LA DEPENDANCE DU PARTI VIS-A-VIS DES DIRECTIONS SYNDICALES
Le travaillisme est un courant politique issu de l'histoire du syndicalisme britannique (8). Son origine remonte au début du siècle. Le congrès des T.U.C. (Trade Unions Congress) (9) en 1899 vote alors le principe d'un organisme officiel d'action politique des syndicats. Il fait plus : il décide de convoquer un congrès spécial auquel il invite toutes les organisations de la classe ouvrière (coopératives, syndicats, groupements socialistes...) afin de constituer un organisme qui aurait pour fonction de faire entrer au Parlement des représentants de la classe ouvrière. C'est ainsi que naît le "comité de représentation du travail". Peu à peu ce comité reçoit l'adhésion de syndicats moyennant une petite cotisation fixée selon le nombre de membres.
Quelques années plus tard, l'initiative de la centrale devait se trouver renforcée par "l'affaire du Taff Vale". "L'affaire du Taff Vale", c'est celle d'un syndicat de cheminots qui se voit obligé par un tribunal de payer une forte amende pour grève illégale. Les T.U.C. font rebondir l'affaire aux Communes mais ne parviennent pas à obtenir de législation pour empêcher qu'une telle mesure de répression se reproduise dans l'avenir.
Il n'en fallait pas plus pour convaincre nombre de syndicats de la nécessité d'avoir leurs propres députés au parlement.
Au congrès des T.U.C. en 1903, le principe d'un parti politique indépendant — c'est-à-dire distinct du parti conservateur et du parti libéral et devant s'abstenir de se solidariser avec eux — est définitivement admis et obtient l'accord de la grande majorité des syndicats présents.
En 1906 le "comité de représentation du travail" présente une quarantaine de candidats aux élections dont 29 sont élus. Peu de temps après, il se constitue en parti. Le Parti travailliste (Labour Party) est donc fondé à partir de ce noyau de syndicalistes élus au parlement et sur la base d'adhésions collectives (affiliation des syndicats en tant que tels au parti).
"Le Parti travailliste fut, dans une large mesure, l'arme forgée par les chefs syndicalistes pour faire annuler le jugement du 'Taff Vale' " (10). Le travaillisme ne découle donc pas en droite ligne d'une théorie du changement social (cas des partis socialistes à l'époque) mais est bien plutôt le prolongement politique d'une lutte syndicale particulière; plus précisément le débouché sur le plan électoral et parlementaire de l'action du mouvement syndical. C'est ce qui nous fait caractériser le travaillisme par la dépendance du parti vis-à-vis des directions syndicales.
Examinons de plus près comment se traduit aujourd'hui cette dépendance.
Le Parti travailliste diffère des partis traditionnels parce qu'il est d'abord un rassemblement d'organisations avant d'être un regroupement
de militants pris sur une base individuelle. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1968 sur 6,086,625 adhérents on retrouve 5,364,484 adhésions d'origine syndicale et 21,285 adhérents en provenance des coopératives pour 700,856 adhérents individuels rattachés aux sections locales du parti (11) : 90 %des adhérents sont donc des adhérents collectifs dont la majorité provient des syndicats. La représentation de chacun au congrès est proportionnelle à ces chiffres (à raison d'un délégué par 5,000 adhérents dans le cas des syndicats). Le poids des syndicats dans le parti est de ce fait énorme puisque les délégués syndicaux sont à 6 contre 1 au niveau du congrès annuel.
La force des syndicats dans le parti ne s'arrête pas là : elle se renforce par une pratique particulière dite du vote en bloc ("block-voting") c'est-à-dire que chaque fédération de la centrale met d'un coup l'ensemble de ses mandats dans la balance sans jamais les diviser. On ne tient donc pas compte des tendances minoritaires qui existent au sein de chacune de ces fédérations. Cette pratique est d'ailleurs aussi vieille que le parti lui-même. Le résultat est évidemment que les dirigeants des fédérations et de la centrale peuvent faire valoir leurs vues beaucoup plus que les autres.
Compte tenu de leur prédominance dans le congrès, les syndicats contrôlent aussi l'appareil du parti : sur 28 membres du comité directeur du parti, les syndicats ont 12 représentants et en influencent directement six autres (le trésorier et 5 représentants des femmes).
Un des résultats de tout cela c'est que l'influence des syndicats dans le parti est plutôt modératrice (12). La centrale syndicale cherche à représenter, pourrait-on dire, la "conscience moyenne" des travailleurs syndiqués. La démonstration de cette situation peut se faire de manière indirecte : l'aile gauche du parti se retrouve, règle générale, dans les sections locales (adhérents individuels).

Le nouveau Premier ministre travailliste James Callaghan, sous le portrait de son prédécesseur, Harold Wilson, démissionnaire (mars 1976).
Il faut aussi compléter le tableau de la dépendance en parlant du financement du parti. Le financement du parti par les syndicats est un fait majeur. Grâce à la formule du "contracting-out" (le syndiqué d'un syndicat affilié au parti travailliste est automatiquement membre du parti et paie une cotisation), les rentrées d'argent au parti sont imposantes (13). Les cotisations syndicales représentent plus des trois quarts des recettes du parti pour son fonctionnement ordinaire. En période électorale elles dépassent le 90 %.
Cette dépendance générale du parti est évidemment tempérée par certains faits : le leader du parti est l'élu du groupe parlementaire et non pas l'élu des structures; et les candidats élus ne sont parrainés directement par les syndicats que dans une proportion d'environ 50 % (dans les premières années du parti, le parrainage direct prévalait dans la très grande majorité des cas). Plus important encore : le mouvement syndical prend généralement ses distances vis-à-vis du parti lorsque celui-ci arrive au pouvoir. Cependant, cette autonomie très relative des deux structures est d'ordre strictement fonctionnel : il s'agit d'une marge de manoeuvre qu'on se laisse mutuellement pour assurer une meilleure efficacité quant à l'essentiel; et l'essentiel c'est d'assurer au mouvement syndical l'acheminement et la réalisation de ses revendications économiques et sociales du moment.
Les relations du trade-unionisme avec un parti politique sont donc permanentes et de caractère organique. Ces relations se traduisent par une dépendance effective de ce dernier vis-à-vis du mouvement syndical. Les manifestations de cette dépendance peuvent se résumer de la façon suivante :
- Contrôle financier d'abord par le moyen de cotisations syndicales qui constituent à elles seules plus de 75 %des recettesdu parti.
- Contrôle du congrès et de l'appareil ensuite : par l'affiliationmassive, les syndicats s'assurent une représentation majoritaire à tous les niveaux de la structure du parti.
Ce qui donne au mouvement syndical une influence déterminante sur le programme du parti; programme qui pour l'essentiel se trouve à prendre en charge les revendications économiques et sociales générales du mouvement syndical.
Malgré ces liens très étroits entre le mouvement syndical et le parti, liens caractérisés par la dépendance de ce dernier vis-à-vis de l'organisation syndicale, il n'en reste pas moins que les deux plans (économique et politique) sont séparés. L'expression "la ville au parti, l'usine au syndicat" traduit assez bien ce "partage des tâches" : le parti se confine au champ parlementaire, prolongeant en cela la lutte que le syndicat mène au jour le jour dans l'entreprise.

Dave Barrett, alors Premier ministre de la Colombie Britannique (1972).
Pour être plus rigoureux nous dirions que pour le travaillisme la lutte é-conomique doit certes se doubler d'une lutte politique (pour la conquête du pouvoir politique) mais cette lutte politique elle-même se confine au fond à des objectifs économiques dans le cadre du capitalisme.
Le trade-unionisme mène une lutte politique mais cette lutte politique est de caractère défensif. Elle est centrée sur le droit de grève, le droit syndical, la législation sociale, la législation du travail... sans remettre en cause les fondements du capitalisme (propriété privée des moyens de production, rôle de l'Etat capitaliste, division du travail manuel et du travail intellectuel...). Il n'a pas de visée révolutionnaire; il propose un réaménagement mais dans le même cadre, celui du régime capitaliste.
A la différence du gompérisme, le mouvement syndical en Grande-Bretagne (tout comme dans les pays Scandinaves et au Canada anglais) atravaillé d'arrache-pied à construire un parti qui lui soit propre et aveclequel il entretient des relations permanentes. A la différence également du mouvement syndical américain la lutte politique dans laquelleil est impliqué ne le fait pas agir de façon ponctuelle et à la pièce. Il soutient son parti de façon constante et globale en participant à l'élaboration d'un programme politique d'ensemble pour les travailleurs. Maisd'un autre côté le travaillisme comme ligne politique et le parti qui soutient cette ligne réduit la lutte politique à la défense des intérêts à courtterme de la classe ouvrière; il réduit la lutte pour le pouvoir à la seulelutte électorale et parlementaire dans le cadre du capitalisme et il s'yconfine. Le Parti travailliste veut donc être porte-parole au parlementde revendications immédiates des travailleurs mais sa ligne politiquecherche à maintenir la lutte de la classe ouvrière dans ce seul corridor.Il refuse de mettre de l'avant les intérêts à long terme de la classe ouvrière : la rupture avec le capitalisme et la construction d'une sociétésocialiste où le pouvoir serait aux travailleurs. Les années de pouvoir duParti travailliste en Angleterre et du Parti social-démocrate en Suède entémoignent largement. Plus près de nous, le NPD, en Colombie Britannique et en Saskatchewan, démontre les limites très nettes de cette lignepolitique et de la pratique qui s'y rattache.
5. LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE OU LA CONCURRENCE ENTRE LE SYNDICAT ET LE PARTI
|
|
La Commune de 1871 fusillade des insurgés
Historiquement le syndicalisme révolutionnaire se rapporte surtout au mouvement ouvrier français des débuts du siècle (1895-1914) (14). Ce type de syndicalisme s'enracine en France dans une conjoncture particulière. Le développement rapide de la grande entreprise et la menace que représente celle-ci pour les ouvriers professionnels de la petite entreprise feront de ces ouvriers le fer de lance du mouvement syndical français d'alors et l'incarnation même de ce type de syndicalisme.
Mais c'est aussi dans une certaine mesure une partie de l'héritage de la Commune de Paris (1871) (15) qui inspire le syndicalisme révolutionnaire : la lutte de la classe ouvrière pour renverser le capitalisme et instaurer une société égalitaire.
Sur le plan politique à l'intérieur du mouvement ouvrier, l'organisation des militants socialistes se reconstitue peu à peu après la dure répression qui a marqué l'expérience de la Commune. Le mouvement socialiste français offre toutefois le tableau d'une grande division puisqu'il n'y a pas moins de cinq partis ouvriers.
Aux yeux des militants syndicaux d'option révolutionnaire, l'organisation au plan politique est facteur de division. Elle amène avec elle les risques d'une récupération du mouvement ouvrier par des socialistes au pouvoir (cas de Millerand, socialiste indépendant devenu ministre de gouvernement en 1899) ou encore alimente le sectarisme doctrinaire. Le mouvement socialiste français de cette époque subordonne en effet étroitement l'action syndicale à l'action politique. Le syndicat se voit définir comme simple organisation professionnelle ayant pour rôle de transmettre les directives du parti.
C'est dans ce contexte que le syndicalisme révolutionnaire organisé dans_ la Confédération générale du travail (C.G.T.) se donne une charte, la charte d'Amiens (16) à son congrès de 1906 :
"La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat...
... cette besogne (l'oeuvre revendicatrice quotidienne) n'est qu'un côté de l'oeuvre du syndicalisme : il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d'action la grève générale... "(17).
Il faut d'abord dire que le syndicalisme révolutionnaire ne se confond. pas-avec l'anarchisme (bien que plusieurs groupes anarchistes y aient été liés à ses débuts) : la révolution telle que préconisée par la charte d'Amiens n'est pas centrée sur la libération individuelle mais bien sur la libération de la classe ouvrière dans son ensemble. Le syndicalisme révolutionnaire reprend à son compte la devise de Marx qui figure dans les statuts de l'Association internationale des travailleurs : "l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes" (18).
Fondamentalement la conception du syndicalisme et de l'action politique de même que les moyens de lutte de cette tendance s'articulent autour de trois idées-maîtresses :
- le syndicalisme n'a pas pour seule fonction de mener des luttespour des revendications immédiates, il est également un agent detransformation radicale de la société. Plus, il en est l'agent principal.
- le syndicalisme organise les travailleurs conscients. Il a le rôle premier par rapport au parti : "aujourd'hui groupement de résistance,dans l'avenir, base de la réorganisation sociale".
- le syndicalisme renversera le capitalisme en s'emparant d'abord etessentiellement de l'appareil productif par la grève générale. Detoute façon ce qui doit prédominer en toute circonstance, c'estl'action directe, car c'est dans l'action que la masse des travailleurss'éduque, qu'elle découvre ses aspirations et ses possibilités réelles.
Il faut cependant ajouter qu'en réalité deux courants traversent le syndicalisme révolutionnaire à partir du congrès d'Amiens. D'une part, il y a ceux, minoritaires, pour qui l'indépendance syndicale est synonyme de neutralité politique ou d'apolitisme (courant de droite se rapprochant à la limite du gompérisme). D'autre part, il y a ceux, majoritaires, qui se méfient des partis politiques parce que la conception qu'ils ont du syndicalisme est hautement politique : c'est le syndicat qui doit prendre en charge la lutte politique des travailleurs. Il se suffit à lui-même pour transformer radicalement la société et réaliser la société sans classes qui abolira le patronat et le salariat. C'est ce dernier courant qui aura une vive sympathie pour la révolution d'octobre 1917 en Russie. Certains parmi les militants de ce courant seront aussi à l'origine du Parti communiste français et de la Confédération générale du travail unifiée (C.G.T.U.) (19). Ils ne seront toutefois que très rarement des inconditionnels du Parti communiste et certaines dissidences se manifesteront par la suite à cause de la volonté de contrôle du P.C. sur la C.G.T.U. jugée excessive.
Mais l'histoire du mouvement ouvrier européen du début des années '20 donne tort aux théories du syndicalisme révolutionnaire : c'est l'échec de la grève générale en France en 1920; c'est l'échec du mouvement des conseils ouvriers en Italie en 1919-1920, en Allemagne et en Hongrie en 1919; c'est également l'échec du One Big Union et des International Workers of the World au Canada et aux Etats-Unis... Ce n'est qu'en Espagne qu'il maintiendra sa force jusqu'à la fin de la guerre civile (1936-1939). Mentionnons par ailleurs le renouvellement de ce courant dans certains mouvements syndicaux d'origine chrétienne dans le cours des années '60 : c'est le cas de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) en France ou du mouvement Action catholique des travailleurs italiens (ACLI) en Italie.
Les traits du syndicalisme révolutionnaire, en ce qui concerne les rapports entre syndicats et partis, diffèrent donc nettement de ceux qui caractérisent les deux expériences décrites précédemment. Le syndicalisme révolutionnaire se méfie de façon viscérale des partis politiques et cherche, à la limite, à assumer l'ensemble des tâches révolutionnaires. Ce qui se traduit en pratique par une situation de concurrence avec le ou les partis de la classe ouvrière présents sur la scène politique, ou encore, par un rôle de suppléance, le syndicat cherchant à compenser l'insuffisance des partis dans la lutte contre le capitalisme et pour le socialisme. A la différence des modèles antérieurs, ce type de syndicalisme a une perspective révolutionnaire et une préoccupation d'autonomie de classe dans laquelle le rôle du syndicat est privilégié sur celui du parti.
Sous certains aspects le syndicalisme révolutionnaire est donc positif : en premier lieu parce qu'il est résolument anti-capitaliste, qu'il prône une société égalitaire et finalement qu'il possède un réflexe fort sain de conservation de l'autonomie de la classe ouvrière devant le réformisme et l'opportunisme (de droite ou de gauche). Il demeure cependant qu'il sous-estime grandement les réalités suivantes :
- l'importance de l'Etat : l'Etat permet en effet la reproduction et la défense du système capitaliste par l'intermédiaire d'appareils répressifs (armée, police), d'appareils d'intervention économique (planification, politique de main-d'oeuvre...) et d'appareils idéologiques (écoles, mass-média...). De telle sorte que mener la lutte exclusivement au niveau des entreprises (système de production) est tôt ou tard voué à l'échec.
|
|
|
Grèves dans le nord de la France (années '10). |
- la nécessité du parti : un mouvement de masse combatif et vigoureux, bien qu'il soit indispensable au renversement du capitalisme, ne suffit pas. Il est tout aussi indispensable que les travailleurs les plus conscients et les plus expérimentés constituent un parti révolutionnaire et travaillent à unifier les luttes et à leur donner une orientation, une direction et une perspective à long terme.
LA CHARTE D'AMIENS (ou charte du syndicalisme révolutionnaire)
Le congrès confédéral d'Amiens confirme l'article 2, constitutif de la C.G.T.
"La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat".
Le congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression tant matérielle que morale, mises en oeuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière.
Le congrès précise sur les points suivants cette affirmation théorique :
Dans l'oeuvre revendicative quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc.
Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'oeuvre du syndicalisme : il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir, le groupe de production et de répartition, base de ré-organisation sociale.
Le congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions et leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat.
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le congrès affirme l'entière liberté, pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe en dehors.
En ce qui concerne les organisations, le congrès décide qu'afin que le syndicalisme atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale ( 20).
6. LE MOUVEMENT OUVRIER DE TRADITION MARXISTE OU L'INTERDEPENDANCE DU PARTI D'AVANT-GARDE ET DU SYNDICAT
La pointe la plus visible de cette tradition du mouvement ouvrier international se rattache au mouvement communiste des années '20-'30, c'est-à-dire à Lénine, à la Révolution d'octobre 1917 en Russie et à la création de partis communistes constitués dès 1919 en une Internationale appelée IIIe Internationale ou Internationale communiste (1919-1943).
Mais cette tradition ne se réfère pas exclusivement aux partis communistes ayant pris leur élan à cette période. Elle se réfère également à de nombreux mouvements ouvriers nationaux où des organisations politiques socialistes ont pris corps sans pour autant être communistes.
Cette tradition révolutionnaire du mouvement ouvrier reprend à son compte, d'une manière ou d'une autre mais avec des accents différents, l'héritage théorique de Marx et donc l'expérience de lutte du mouvement ouvrier en Europe dans la seconde partie du XIXe siècle et tout particulièrement la théorie et la pratique de l'Association internationale des travailleurs (A.I.T.) ou 1ère Internationale. Compte tenu de l'ampleur de cette tradition nous nous en tiendrons à l'essentiel en ne dégageant que les lignes directrices de la pensée de Marx, de Lénine et de Gramsci sur le parti et sur les rapports partis-syndicats.
1. KARL MARX ET LA 1 ère INTERNATIONALE (L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 1864 - 1872)
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la question des rapports entre partis et syndicats se pose essentiellement en terme de jonction :
- d'une part de militants socialistes en train d'élaborer une théorierévolutionnaire;
- avec, d'autre part, un mouvement ouvrier en voie de s'organisersolidement sur le plan professionnel. Le mouvement syndical est doncà la veille d'acquérir sa maturité organisationnelle à travers une lutteéconomique vigoureuse et radicale, tandis que les militants politiquescommencent à dégager leur perspective de lutte (stratégie de lutte pourle socialisme, identification des éléments moteurs de la révolution...)Ces militants demeurent toutefois encore faiblement enracinés dansla classe ouvrière.
C'est dans un contexte de luttes ouvrières intenses auxquelles il se lie que Marx va peu à peu développer sa théorie de l'exploitation de la force de travail et sa conception de la révolution comme auto-émancipation de la classe ouvrière. Il aura aussi à mener une lutte idéologique intense pour faire valoir que le rôle des militants révolutionnaires, c'est d'être les catalyseurs des luttes de la classe ouvrière contre le capitalisme et non celui d'un groupe de conspirateurs planifiant et faisant la révolution au nom des travailleurs et à leur place :
"Tous les mouvements historiques ont été, jusqu'ici, accomplis par des minorités ou au profit des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité" (21).
Par la même occasion, Marx est appelé à s'interroger sur le syndicalisme, sur sa portée et ses limites :
"Les syndicats et les grèves ont une importance fondamentale, parce qu'ils sont la première tentative faite par les ouvriers pour supprimer la concurrence... Ils agissent utilement en formant des centres de résistance aux empiétements du capital" (22).
En revanche, "ces associations sont impuissantes contre toutes les grandes causes qui déterminent le rapport entre l'offre et la demande" (23). Le syndicalisme est donc nécessaire mais insuffisant; nécessaire parce qu'il travaille à faire disparaître la concurrence des travailleurs entre eux, insuffisant parce qu'impuissant à s'attaquer aux fondements mêmes de la domination de classe. Il indique du même coup l'importance d'un mouvement politique et son rôle.
Mais si dans cette analyse du syndicalisme Marx distingue très clairement lutte économique et lutte politique, il insiste aussi sur l'unité et la complémentarité des différents types de luttes menées par la classe ou-vrère : "Les syndicats doivent maintenant agir comme foyers d'organisation de la classe ouvrière dans le grand but de son émancipation radicale. Ils doivent aider tout mouvement social et politique tendant dans cette direction" (24).
Par ailleurs on ne trouve pas chez Marx une théorie systématique du parti de la classe ouvrière. On retrouve chez Marx l'idée centrale que le parti est un instrument indispensable pour réaliser la révolution comme auto-émancipation de la classe ouvrière. C'est ainsi qu'il affirme dans le Manifeste du Parti communiste (1848) que le parti existe et doit exister comme entité propre ayant ses qualités spécifiques : le parti regroupe "le secteur le plus résolu du mouvement ouvrier" et bénéficie de "l'avantage théorique de sa claire vision des conditions de la marche et des résultats généraux du mouvement prolétarien" (25). Cependant, l'avant-garde doit se constituer dans la classe, au coeur de la lutte du mouvement de masse (26). Mais on cherchera en vain chez Marx des précisions sur son mode d'organisation et sur les mécanismes à créer entre ce parti et les organisations de masse.
|
|
Karl Marx.
En fait, Marx insiste moins sur la démarcation du parti vis-à-vis du mouvement de masse (les organisations syndicales) que sur la construction du parti révolutionnaire par la jonction des militants socialistes avec les travailleurs en lutte. De telle sorte qu'on trouve regroupés dans une même organisation, l'Association internationale des travailleurs (1864-1876), partis et syndicats. De la même manière, l'organisation politique n'est pas chargée de diriger d'en haut les luttes ouvrières mais bien plutôt de "créer un point central de communication et de coopération entre les organisations ouvrières des différents pays" (27).
Il nous semble, en résumé qu'il faille retenir les lignes directrices suivantes dans la pensée et l'action de Marx :
la révolution socialiste est conçue comme auto-émancipation de la classe ouvrière;
l'action syndicale est nécessaire mais insuffisante pour abattre le capitalisme;
la distinction entre la lutte économique et la lutte politique s'impose mais aussi l'importance cruciale de favoriser l'unité de ces deux types de lutte;
le parti politique de la classe ouvrière est considéré comme avant-garde du mouvement de masse et comme catalyseur des luttes de la classe ouvrière contre le capitalisme;
les syndicats sont invités à politiser leur action et à se poser le problème du pouvoir.
S'il n'y a pas chez Marx de théorie de la dépendance du syndicat vis-à-vis du parti, on retrouve cependant chez lui l'idée que le parti constitue l'avant-garde théorique et pratique du mouvement ouvrier.
Trente ans plus tard, soit au début du XXe siècle, cette "vieille" question des rapports partis-syndicats se posera de nouveau, mais cette fois-ci militants syndicaux et militants politiques chercheront à préciser la nature des rapports entre deux institutions ayant chacune leur implantation, leur structure, leur mode d'intervention et leurs objectifs. Deux thèses s'opposent dès lors : la première qui veut, comme on l'a vu avec la tradition du syndicalisme révolutionnaire, l'autonomie complète des syndicats vis-à-vis des partis, la seconde qui entend placer les syndicats sous la direction politique des partis. Quelle est la signification de cette seconde thèse? C'est ce qu'il nous faut voir en étudiant la pensée de Lénine et de Gramsci sur ce sujet.
2. LA THEORIE LENINISTE DU PARTI ET DE SES RAPPORTS AVEC LES ORGANISATIONS DE MASSE
Avec l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste (le capitalisme de monopoles), celui-ci se révèle capable de concéder des améliorations, souvent substantielles, aux travailleurs quant à leurs conditions de vie. Cette situation de fait alimente l'esprit d'accommodement dans certaines couches de la classe ouvrière de même que la révision doctrinale chez certains dirigeants du mouvement ouvrier de tradition marxiste (Bernstein...) : remise en question des positions de Marx concernant la nécessité de faire la révolution pour changer la condition de la classe ouvrière... Face à Bernstein (28),Kautsky (29) soutient que l'accalmie n'est que provisoire et qu'à la longue l'impérialisme provoquera l'aggravation de l'antagonisme entre les classes.
Kautsky est également amené à développer l'idée que "la conscience socialiste est un élément importé du dehors (par les intellectuels bourgeois) dans la lutte de classe du prolétariat et non quelque chose qui en surgit spontanément" (30).
C'est cette même position que Lénine reprend à son compte dans Que faire?, écrit en 1902. Le fondement théorique des rapports parti-syndicats réside en effet chez le Lénine du Que faire? dans la distinction radicale qu'il établit entre deux formes de conscience de classe : la conscience trade-unioniste et la conscience révolutionnaire :
|
|
Lénine.
• la conscience trade-unioniste : c'est la conviction qu'a la classe ouvrière qu'il faut s'unir en syndicats, lutter contre les patrons, exiger du gouvernement des réformes quant à la législation sociale... C'est le niveau le plus élevé que la classe ouvrière peut atteindre par elle-même : "par ses seules forces, laclasse ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience trade-unioniste..." (31).
• la conscience révolutionnaire : elle ne surgit pas spontané-. ment dans le mouvement ouvrier, elle ne peut être introduite
que 'du dehors' par les intellectuels originaires d'autres classes de la société ; "la tâche des social-démocrates (32) est de transformer cette politique trade-unioniste en une lutte politique social-démocrate, de profiter des lueurs de conscience politique que la lutte économique a fait pénétrer dans l'esprit des ouvriers pour élever ces derniers à la conscience social-démocrate" (33).
A la différence de Marx, Lénine insiste, dans Que faire? tout au moins, sur la démarcation nette qui existe entre le parti et la classe, entre l'avant-garde et le mouvement de masse. Il va plus loin en précisant, à propos du rôle général qu'il attribue au parti, les formes organisation-nelles que ce dernier doit prendre et les liens qu'il doit établir avec les organisations de masse.
Le parti ne doit regrouper que des révolutionnaires professionnels : 1 ) il est composé d'hommes dont la profession est l'action révolutionnaire contrairement à ceux qui militent dans les organisations de lutte économique, organisations qui ont un caractère de masse ; 2) il se construit du sommet à la base et non de la base au sommet ; 3) il doit régler sa vie interne sur une discipline de fer ; 4) ce noyau centralisé et discipliné de révolutionnaires professionnels doit cependant être organiquement lié à un ensemble plus large composé de révolutionnaires non-professionnels et d'organisations de masse de divers types.
Selon Lénine, organisé ainsi, le parti peut diriger efficacement la lutte contre le capitalisme et la mener à terme. Quant aux rapports de ce parti avec les organisations de masse, Lénine les précise plus tard de la façon suivante :
"Lorsqu'il s'agit de créer des liens d'organisations entre les syndicats et le Parti social-démocrate ou de faire reconnaître par les premiers la direction du second... les social-démocrates doivent défendre avec fermeté les conceptions social-démocrates dans toute leur intégrité, travailler sans relâche à l'acceptation par les syndicats de la direction idéologique de la social-démocratie et l'établissement de liens d'organisations réels et permanents entre eux" ( 34 ).
Cependant la conception du parti chez Lénine ne se réduit pas à celle qui se dégage du Que faire? même si cet écrit a prévalu pendant plusieurs décennies dans le mouvement ouvrier de tradition marxiste, surtout dans les partis communistes (35).
Si dans le Que faire? il est finalement considéré que le parti est l'unique lieu de la conscience révolutionnaire, dans d'autres écrits (notamment dans les périodes d'intenses luttes ouvrières, voire de crise révolutionnaire comme en 1905-1907 et 1917) (36), Lénine donne plus de crédit au mouvement spontané des travailleurs qui dans leur lutte ne se réfugient pas nécessairement sous l'aile de la bourgeoisie. C'est ainsi qu'apparaît dans les écrits de 1905 l'idée du parti conçu comme parti de masse (plutôt que comme parti ne regroupant que des révolutionnaires professionnels) et que l'accent est mis sur la démocratie interne (liberté de critique...). A certaines occasions on retrouve même Lénine affirmant une confiance plus grande dans la classe ouvrière que dans son propre parti : "Le pays des ouvriers et des paysans pauvres est cent fois plus à gauche que nous" (37).
Il est donc tout à fait erroné de ne retenir de Lénine que le Que faire?, d'isoler le Que faire? en ne l'inscrivant pas dans le cadre général de sa démarche (l'ensemble de son oeuvre) et dans le cadre général de la lutte des classes en U.R.S.S., en l'isolant des propositions et de la démarche de Marx et en ne le situant pas à l'intérieur des débats qui ont eu lieu à cette période entre Lénine et d'autres dirigeants révolutionnaires tels
|
|
Rosa Luxembourg.
Rosa Luxembourg ( 38 ). Il est tout aussi erroné d'ignorer l'apport particulier d'autres dirigeants révolutionnaires de cette période, comme Gramsci en Italie, par exemple (39).
Compte tenu de tout cela, on peut dégager de la pensée de Lénine les points suivants :
- il y a primauté de l'action politique sur l'action économique : ilfaut mener la lutte économique dans le cadre d'organisations demasse comme les syndicats, mais la lutte politique est plus essentielle, plus décisive parce qu'elle prend en charge les intérêts àlong terme de la classe ouvrière en visant la prise du pouvoir d'Etat ;
- de cette primauté du politique découle le rôle dirigeant du parti. Ilfaut l'intervention active du parti pour diriger les organisations demasse car le mouvement ouvrier ne peut dépasser le trade-unio-nisme. Toutefois, soulignons, de façon critique, que cette positiontelle qu'elle ressort du Que faire? recèle le danger de l'avant-gar-disme (40) en surestimant le rôle des intellectuels définis commeseuls porteurs de la conscience révolutionnaire dans la classe ouvrière. Il faut ajouter à ce danger l'identification que maintientLénine entre deux notions qui ne sont pas synonymes, celle dethéorie révolutionnaire et celle de conscience révolutionnaire (41).
Lénine dégage cependant clairement la démarcation entre une action politique de type trade-unionisme et une action politique révolutionnaire. L'action politique ne se réduit pas à la lutte électorale et n'est pas qu'une simple dimension de la lutte économique. La lutte politique est le lieu où s'articulent toutes les luttes, le lieu où s'affrontent toutes les classes dans leur rapport à l'Etat :
"La conscience de la classe ouvrière ne peut être une conscience véritable si les ouvriers ne sont pas habitués à réagir contre tout abus, toute manifestation d'arbitraire, d'oppression et de violence, quelles que soient les classes qui en sont victimes" ( 42 ).
De cela découle la volonté de lier le plus étroitement possible les syndicats au parti, en partant des milieux de travail mêmes où se constituent des sections, cellules ou noyaux de militants du parti à côté du syndicat proprement dit. Ces militants politiques qui se regroupent sur leur base propre cherchent à orienter et diriger le syndicat suivant les orientations déterminées par leur parti.
3. LA IIIe INTERNATIONALE (INTERNATIONALE COMMUNISTE) : LES SYNDICATS COMME COURROIES DE TRANSMISSION DU PARTI
La conception de Lénine (celle du Que faire?) et de son parti, le Parti bolchevique, sera reprise intégralement par la IIIe Internationale (1919-1943). Elle sera non seulement reprise dans son intégralité mais durcie considérablement au point de transformer les syndicats en simples courroies de transmission du parti auprès des masses ouvrières. Dans les périodes de durcissement les plus marquées (en particulier en 1919-1920 et en 1928-1934) la IIIe Internationale met de l'avant une politique de soumission organisationnelle (formellement ou autrement) des syndicats au parti doublée d'une politique de lutte au sein du mouvement syndical dirigée contre tous les syndicats qui ne suivent pas la ligne du parti (qu'ils soient de gauche ou de droite) (43).
Ce n'est qu'en 1921 et dans les quelques années qui suivent que Lénine et les dirigeants de la IIIe Internationale ont une position différente. Contrairement à la période précédente (1919-1920), ils mettent de l'avant une politique d'unité syndicale et considèrent différemment le rôle du parti vis-à-vis des syndicats :
"Le parti doit savoir exercer l'influence la plus décisive sur les syndicats sans les soumettre à la moindre tutelle. Le parti a des noyaux dans tels et tels syndicats, mais le syndicat lui-même ne lui est pas soumis" (44).
Par la suite, la ligne que Staline (45) représente deviendra prédominante dans l'Internationale communiste : aux yeux des principaux dirigeants communistes, les syndicats sont "les organismes auxiliaires et les courroies de transmission reliant le parti à la classe". Pour Staline, le parti est le détenteur de la science marxiste-léniniste tandis que les masses, elles, sont aveugles et dupes (c'est-à-dire nécessairement réformistes de par l'influence presque totale qu'exerce sur elles l'idéologie bourgeoise). L'élaboration de la ligne politique devient donc l'affaire exclusive du parti. Le parti est à lui-même sa propre garantie. Par conséquent, le parti est l'état-major et les masses, son armée : le rapport entre les deux en est un de commandement, de subordination. Il faut faire remarquer ici que la théorie stalinienne du parti, et son corollaire, la subordination pure et simple des organisations de masses au parti (en tant que courroies de transmission) mène à l'impasse parce qu'elle bloque les liens vivants qui peuvent et doivent exister entre la classe et ses organisations et entre les organisations elles-mêmes (partis et organisations de masses) (46).
De façon plus générale les partis communistes dans les années '20 et dans les années '30 alterneront entre deux positions :
- soit que les militants communistes mènent à outrance la ligne du parti dans le syndicat en ratant par là leur travail de militants syndicaux. Ils font le vide autour d'eux et le syndicat perd ainsi son caractère d'organisation de masse ;
- soit que les militants communistes prennent la lutte
syndicale au sérieux mais en abandonnant à la
limite tout travail politique au bénéfice
d'une concurrence avec les directions syndicales jugées réformistes sur le terrain des revendications économiques immédiates.
L'INTERNATIONALE COMMUNISTE ET LES SYNDICATS (47)
A. Quelques-unes des 21 conditions d'admission à la IIIe Internationale
- Toute organisation désireuse d'adhérer à l'Internationale communiste doitrégulièrement et systématiquement écarter des postes impliquant tant soitpeu de responsabilité dans le mouvement ouvrier (organisations de parti,rédactions, syndicats, fractions parlementaires, coopératives, municipalités)les réformistes et les "centristes" et les remplacer par des communisteséprouvés — sans craindre d'avoir à remplacer, surtout au début, des militantsexpérimentés, par des travailleurs sortis du rang (2e condition).
- Tout parti désireux d'appartenir à l'Internationale communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats,coopératives et autres organisations des masses ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés dont le travail opiniâtre et constant conquerrales syndicats au communisme. Leur devoir sera de révéler à tout instant latrahison des social-patriotes et les hésitations du "centre". Ces noyauxcommunistes doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du Parti(9e condition).
- Tout parti appartenant à l'Internationale communiste a pour devoir decombattre avec énergie et ténacité l'"Internationale" des syndicats jaunesfondée à Amsterdam.Ils doivent répandre avec ténacité au sein des syndicatsouvriers l'idée de la nécessité de la rupture avec l'Internationale jaune d'Amsterdam. Il doit par contre concourir de tout son pouvoir à l'union internationale des syndicats rouges adhérant à l'Internationale communiste (10econdition).
B. Résolution sur le rôle du Parti communiste dans la révolution prolétarienne (48)
... L'ancienne subdivision classique du mouvement ouvrier en trois formes (partis, syndicats, coopératives) a fait son temps. La révolution prolétarienne en Russie a suscité la forme essentielle de la dictature prolétarienne, les Soviets. La nouvelle division que nous mettons partout en valeur est celle-ci : l) le parti, 2) le soviet, 3) le syndicat.
Mais le travail dans les soviets de même que dans les syndicats d'industrie devenus révolutionnaires doit être invariablement et systématiquement dirigé par le Parti du prolétariat, c'est-à-dire par le Parti communiste. Avant-garde organisée de la classe ouvrière, le Parti communiste répond également aux besoins économiques, politiques et spirituels de la classe ouvrière tout entière. Il doit être l'âme des syndicats et des soviets ainsi que de toutes les autres formes d'organisation prolétarienne.
4. GRAMSCI OU LA THEORIEDE LA TRANSFORMATION RECIPROQUE DU PARTI ET DES ORGANISATIONS DE MASSE
Tout comme Marx et Lénine, Gramsci (49), fondateur du Parti.Communiste italien après avoir été dans la gauche du Parti socialiste, dère essentiels les points suivants :
- la nécessité pour la classe ouvrière de s'organiser en parti de classepour mener à terme sa lutte contre le capitalisme ;
- la nécessité d'un parti révolutionnaire pour renverser le capitalismeet construire le pouvoir ouvrier et populaire (il n'y a pas de transformation graduelle du capitalisme au socialisme) ;
- la nécessité d'un parti d'avant-garde, d'un parti exprimant ce qu'il y a de plus combatif et de plus conscient dans la classe ouvrière.
Toutefois, Gramsci aura l'occasion d'articuler davantage l'idée qu'il se fait du parti et de ses rapports avec les organisations de masse (dont les syndicats) notamment à partir d'une lutte qu'il sera amené à conduire à l'intérieur de son parti contre la tendance gauchiste lors du congrès de Lyon (50) en 1926.
Pour Gramsci, la constitution d'un parti d'avant-garde est d'abord une question de réalisme politique : les classes exploitées et opprimées dans la société capitaliste sont souvent incapables d'initiative politique de par leur condition même ou du moins sont incapables d'une cohésion suffisante. Concevoir un parti comme avant-garde est moins un principe, quelque chose qui doit être par définition, qu'un réalité obligée.
Le parti a donc pour rôle essentiel d'assurer la cohésion nécessaire dans la lutte pour permettre l'apparition d'une volonté collective populaire anti-capitaliste et pour le socialisme parce que c'est la seule organisation qui puisse vraiment le faire en pratique. Gramsci assortit cette position d'un certain nombre de propositions qui mettent l'accent sur le fait que :
- la classe ouvrière, dans son rapport avec le parti, n'est pas un simpleinstrument matériel de renversement social. Les travailleurs sont etdoivent être les protagonistes conscients de la révolution (51) ;
- le parti n'a pas à diriger de l'extérieur et de façon autoritaire (52) ;
|
|
Gramsci.
le parti doit participer à toutes les luttes en prenant au sérieux les revendications immédiates, même si elles ont un caractère partiel, tout en les reliant à l'objectif à long terme qui est le socialisme (53)
Gramsci se démarque de la conception qui guide la IIIe Internationale et qui conduit celle-ci à vouloir subordonner purement et simplement les organisations de masse et donc les syndicats au parti. Il considère au contraire que des liens vivants doivent exister et s'établir entre la classe ouvrière et ses organisations, et entre les organisations elles-mêmes (partis et syndicats). Pour Gramsci, le parti est le "résultat d'un processus dialectique dans lequel convergent le mouvement spontané des masses révolutionnaires et l'activité de direction, son organisation" (54). Plus concrètement, cette position de principe signifie que :
"Le parti ne doit pas prétendre imposer son point de vue à la classe ouvrière. Il propose simplement et appelle les autres groupes de travailleurs à se prononcer sur celui-ci et à le discuter en commun, pour que de cette discussion sorte le programme effectif, défini et accepté en commun" (55).
Il n'est donc pas question pour les militants du parti travaillant dans les entreprises d'imposer d'en-haut quoi que ce soit aux syndicats.
Bref, il ne s'agit pas pour le parti de soumettre les syndicats de façon disciplinaire (à la manière de Staline), mais bien de stimuler chez tous les travailleurs organisés en syndicats un débat que seuls les militants engagés syndicalement et dans le parti sont à même de mener à terme dans leur milieu de travail. De cette façon les travailleurs de chaque entreprise où le syndicat est présent sont en mesure de faire un choix démocratique et collectif. C'est de cette façon et seulement de cette façon que peut être comprise l'idée que le parti dans la tradition marxiste oriente, dirige et unifie les luttes en alliance avec les organisations de masse des travailleurs (syndicats...).
EXTRAITS DES THESES DE LYON (GRAMSCI)
A. La situation italienne et lestâches du P.C.I. (ou les thèses de Lyon)
Les thèses de Lyon furent rédigées par Gramsci et Togliatti pour le IIIe congrès du Parti communiste italien qui eut lieu à Lyon en 1926, et sanctionna la défaite de l'extrémisme de Bordiga. Les thèses, en effet, représentent tout d'abord une rupture avec les extrémistes d'ultra-gauche et Bordiga, la première tentative pour doter le P.C.I., fondé depuis peu, d'une ligne et d'un programme organique basé sur l'analyse de la réalité italienne, d'un compréhension historique des objectifs politiques du prolétariat révolutionnaire, sur une réelle volonté politique de se lier aux masses. Le refus du dogmatisme, du sectarisme, d'une vision purement intellectualiste du léninisme ; le refus, en somme, de ce "purisme idéologique" auquel ne correspondaient aucune ligne de masse ni aucune possibilité pratique pour le parti de s'implanter dans les masses et de se placer à leur tête : c'est de cette position que sont nées les thèses de Lyon, en tant que tentative de conciliation féconde entre la vérité du léninisme et la connaissance de l'état particulier des rapports de classes en Italie. C'est de la théorie et de son application concrète contre la ligne bordiguiste, majoritaire dans le parti, que procèdent les thèses. Par ailleurs, et c'est l'autre grand mérite de ces thèses, elles se donnent pour la première tentative organique et globale d'opérer une rupture avec les positions extrémistes, sans pour autant tomber dans le réformisme et le révisionnisme.
Dans les Thèses de Lyon qui, il faut le rappeler, sont l'avant-dernière oeuvre de Gramsci avant son emprisonnement (la dernière sera La question méridionnale, qui restera inachevée), nous retrouvons tous les thèmes de la pensée gramscienne : son interprétation de l'histoire italienne, la question méridionnale, les concepts de l'hégémonie, des alliances de classes, de forces motrices de la révolution, de dictature du prolétariat, de parti, de centralisme démocratique, l'analyse du fascisme, etc. C'est ce qui explique toute l'importance des thèses et toute leur actualité sous de nombreux aspects. Le P.C.I. ne les a pourtant rééditées que deux fois : en 1951, dans "Trente ans de vie du P.C.I." (Quaderno di Rinascita, No.2) et en 1971, dans le dernier volume des Oeuvres de Gramsci (mais jamais en édition populaire!). C'est surtout II Manifeste qui, au cours de ces dernières années, a publié à différentes reprises des passages essentiels des analyses politiques gramsciennes. (56).
B. Quelques-unes des 44 thèses de Lyon
XXIX Tous les problèmes d'organisation sont des problèmes politiques. Leur solution doit permettre au parti d'accomplir sa tâche fondamentale, de faire accéder le prolétariat à une indépendance politique complète, de lui donner une physionomie, une personnalité, une conscience révolutionnaire précise, d'empêcher toute infiltration et influence désagrégatrices de la part des classes et des éléments qui, bien qu'ayant des intérêts contraires à ceux du capitalisme, ne veulent pas mener la lutte contre celui-ci jusqu'à ses ultimes conséquences.
Il y a en premier lieu, un problème politique : celui de la base de l'organisation. L'organisation du parti doit se faire sur la base de la production, et donc à partir du lieu de travail (cellules). C'est là un principe essentiel pour la création d'un parti "bolchevik". Il relève de la nécessité pour le parti d'être armé pour diriger le mouvement de masse de la classe ouvrière, laquelle est naturellement unifiée par le développement du capitalisme selon le procès de production.
En situant la base organisationnelle sur le lieu de production, le parti effectue un choix concernant la classe sur laquelle il s'appuie. Il se proclame parti de classe et parti d'une seule classe, la classe ouvrière.
Toutes les objections au principe fondant l'organisation du parti sur la base de la production procèdent de conceptions qui sont propres à des classes étrangères au prolétariat, même lorsqu'elles sont défendues par des camarades et des groupes qui se disent "d'extrême-gauche". Elles se fondent sur une évaluation pessimiste des capacités révolutionnaires de l'ouvrier, et de l'ouvrier communiste, et sont l'expression de l'esprit antiprolétarien de l'intellectuel petit-bourgeois qui se prend pour le sel de la terre et voit dans l'ouvrier l'instrument matériel du renversement social, non le protagoniste conscient et intelligent de la révolution.
A l'intérieur du parti italien, on retrouve, à propos de la formation des cellules, les discussions et les conflits qui aboutirent en Russie à la scission entre bolcheviks et mencheviks sur cette même question du choix de la classe, du caractère de classe du parti et du mode d'adhésion au parti d'éléments non prolétaires.
Replacé dans le contexte italien, ce fait revêt d'ailleurs une importance exceptionnelle. C'est la structure sociale elle-même ainsi que les conditions et traditions de la lutte politique qui rendent, en Italie beaucoup plus sérieusement qu'ailleurs, le risque de voir le parti s'édifier sur la base d'une "synthèse" d'éléments hétérogènes pouvant ouvrir la voie à l'influence paralysante d'autres classes que le prolétariat. Il s'agit d'ailleurs d'un danger que la politique du fascisme elle-même ne fera qu'aggraver, en rejetant sur le terrain révolutionnaire des couches entières de la petite-bourgeoisie.
Il est certain que le Parti communiste ne peut être seulement un parti d'ouvriers. La classe ouvrière et son parti ne sauraient se passer des intellectuels, ignorer la nécessité de regrouper autour d'eux et de guider tous les éléments qui, d'une façon ou d'une autre, sont poussés à se révolter contre le capitalisme. C'est ainsi que le Parti communiste ne peut fermer la porte aux paysans : il doit, au contraire, se servir d'eux pour resserrer les liens politiques entre le prolétariat et les classes rurales. Mais il faut rejeter catégoriquement, comme contre-révolutionnaire, toute conception faisant du parti une "synthèse" d'éléments hétérogènes, au lieu de soutenir sans aucune réserve qu'il est une partie du prolétariat, qu'il doit recevoir du prolétariat la marque de sa propre organisation, et qu'il doit assurer au prolétariat, au sein du parti lui-même, une fonction dirigeante.
XXXVI Le principe selon lequel le parti dirige la classe ouvrière ne doit pas être interprété de façon mécanique. Il ne faut pas croire que le parti peut diriger la classe ouvrière en s'imposant à elle de l'extérieur et de façon autoritaire : ceci n'est pas plus vrai pour la période qui précède la prise du pouvoir que pour celle qui lui succède. L'erreur que représente l'interprétation mécaniste de ce principe doit être combattue dans le Parti italien comme une conséquence possible des déviations idéologiques d'extrême-gauche ; ces déviations mènent à une surestimation arbitraire et formelle du rôle dirigeant du parti. Nous affirmons que la capacité de diriger la classe ne tient pas au fait que le parti se "proclame" son organe révolutionnaire, mais au fait qu'il parvient "effectivement", en tant que parti de la classe ouvrière, à rester en liaison avec toutes les couches de cette même classe, à impulser les masses dans la direction souhaitée et la plus favorable, compte tenu des conditions objectives. Le fait d'être reconnu par les masses comme "leur" parti (conquête de la majorité) n'est que la conséquence de l'action menée parmi elles, et c'est à cette condition seulement que le parti peut se prévaloir d'être suivi par la classe ouvrière. Cette action dans les masses est un impératif qui l'emporte sur tout "patriotisme" de parti.
XXXIX Le parti dirige et unifie la classe ouvrière en participant à toutes les luttes de caractère partiel, en formulant et en avançant un programme de revendications immédiates pour la classe laborieuse. Il lui faut considérer les actions partielles et
limitées comme des étapes nécessaires pour parvenir à la mobilisation progressive et à l'unification de toutes les forces de la classe laborieuse.
Le parti dénonce la thèse selon laquelle il faut s'abstenir de soutenir les actions partielles et d'y prendre part, sous prétexte que les problèmes intéressant la classe laborieuse ne peuvent être résolus que par la destruction du régime capitaliste et une offensive générale de toutes les forces anticapitalistes. Il sait bien qu'il est impossible d'améliorer sérieusement et durablement la condition des travailleurs dans la période de l'impérialisme, et aussi longtemps que le régime capitaliste n'aura pas été abattu. Mais la mise en avant d'un programme de revendications immédiates et de soutien des luttes partielles est la seule façon de gagner les grandes masses et de les mobiliser contre le capital. D'autre part, toute agitation ou victoire de la classe ouvrière dans le domaine des revendications immédiates rend la crise du capitalisme plus aiguë, et précipite, ne serait-ce que subjectivement, la chute du capitalisme, dans la mesure où elle rompt, sur le plan économique, l'équilibre instable sur lequel il fonde aujourd'hui son pouvoir...
5. QUELQUES ELEMENTSDE SYNTHESE A PARTIR DE MARX, LENINE ET GRAMSCI
La conception du parti et des rapports parti-syndicats dans la tradition marxiste comporte finalement deux variantes importantes. On peut même dire à la limite qu'il y a deux conceptions du parti, deux façons de vivre le parti et de considérer les rapports avec les syndicats dans cette tradition :
- Avec le Lénine du Que faire? et la IIIe Internationale (Staline), onpeut définir le parti comme étant l'Instrument de la lutte contre le capitalisme, constitué de révolutionnaires professionnels, endehors de la classe ouvrière et de sa lutte quotidienne, et à la limite forgé comme un état-major d'armée : il est très centralisé, il estdirigeant en tout et il entretient avec les organisations de masse desrapports tels que celles-ci lui sont complètement subordonnées.
- Avec Marx, avec Lénine (après 1905) et avec Gramsci en particulier, il est possible de dégager une tout autre façon de voir la question. Avec Marx, on a vu que le parti, conçu comme avant-garde, constitue le regroupement du secteur le plus résolu de la classeouvrière, un mouvement qui s'identifie aux visées les plus radicalesdu mouvement de masse. Il est en quelque sorte la pointe avancéedu mouvement de masse tout en étant organisé sur ses propres bases. Ce parti, nous l'avons vu avec Gramsci, doit être en étroite relation avec les autres organisations de la classe ouvrière sans pourautant vouloir les subordonner ou être à leur remorque. C'est aussiun parti qui, tout en mettant de l'avant la nécessité du centralismepour lutter efficacement contre le capitalisme, mise beaucoup surles débats à l'intérieur du parti, avec les organisations de masse età l'intérieur de celles-ci comme facteur de développement de laconscience de classe.

7. LES EXPERIENCES HISTORIQUES ET LA REALITE D'AUJOURD'HUI: QUELQUES INDICATIONS

Convention de Fondation du NPD à Ottawa en juillet 1961.
L'expérience de chaque mouvement ouvrier national a ses caractères propres. On retrouve peu de situations où un type d'expérience est prédominant au point de se présenter presque à l'état pur et au point également de se maintenir intégralement sur une très longue période. Ce qu'on peut déceler ce sont des tendances. Ce à quoi il faut ajouter que des modifications, parfois substantielles, ont pu surgir : tel ou tel trait hier essentiel à l'une ou à l'autre des expériences peut avoir été sérieusement mis en cause et ne plus valoir aujourd'hui ou être moins important qu'on ne le laissait supposer.
On retrouve aujourd'hui mis à part le syndicalisme américain et celui qui s'en inspire directement :
1 ) la tendance générale du syndicalisme anglo-saxon où les rapports syndicats-parti vont dans le sens d'une dépendance organique du parti vis-à-vis des directions syndicales : cas de la Grande-Bretagne, des pays Scandinaves, du Canada anglais (le CTC avec le NPD dans certaines provinces). Ce qui amène l'affiliation pure et simple des syndicats au parti et la mise en place d'un système de cotisations collectives et de représentation du mouvement syndical dans les structures de ce parti.
2) la relation privilégiée des syndicats avec un ou des partis dans le sens d'une dépendance des syndicats vis-à-vis du parti ou dans le sens d'une interdépendance entre les deux organisations dans leur lutte contre le capitalisme :
a) liaison organique comme mode de relation des partis et des syndicats de tradition communiste (IIIe Internationale). Mode de relation qui a longtemps fait de ces derniers la courroie de transmission des partis, cette situation étant rendue possible à travers le contrôle exercé sur les directions syndicales par le parti. Mode de relation qui tend aujourd'hui à se modifier dans le sens d'un renforcement de la position des syndicats dans la relation entre les deux. C'est le cas de la Confédération générale du Travail (C.G.T.) en France avec le Parti communiste français (P.C.F.). C'est aussi le cas des commissions ouvrières en Espagne en rapport avec le Parti communiste espagnol (P.C.E.) et de la Confédération générale italienne du travail (C.G.I.L.) en Italie avec le Parti communiste italien (P.C.I.) et son homologue socialiste, le P.S.I.
b) appui direct et actif du mouvement syndical à un ou des partis et qui suppose une collaboration constante des deux structures, lesquelles maintiennent une relative autonomie (cas complexe du Chili avant 1973 où la C.U.T., centrale unique, était traversée par les différents partis de gauche, de l'extrême-gauche et même du centre).

Au Chili, la Centrale unique des travailleurs (CUT) a lancé à plusieurs reprises le mot d'ordre de mobilisation générale.
- appui indirect et actif du mouvement syndical qui peut comporter des positions communes au mouvement syndical et à certains partis de gauche de même qu'une collaboration critique etoccasionnelle. Le mouvement syndical y garde une autonomieforte sur le plan organisationnel et tient à la garder. C'est le casde la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) en France dans sa relation avec le Parti socialiste et le Parti socialiste unifié (P.S.U.).
8. EN GUISE DE CONCLUSION : QUELQUES POINTS DE REPERE ET UNE DIRECTION DE RECHERCHE
De quel parti le mouvement ouvrier québécois a-t-il besoin? Quelle peut être notre contribution comme militants syndicaux dans la construction de ce parti? Quel type de liens convient-il d'établir entre ces deux organisations? Telles sont les questions que nous nous posions au point de départ. L'expérience acquise dans le
passé par le mouvement ouvrier de certains pays, si elle ne nous permet pas d'avancer des conclusions définitives, peut tout au moins nous indiquer quelques points de repère et une direction de recherche. Dans ce sens-là, nous pouvons faire les propositions suivantes :
- L'expérience du syndicalisme d'affaires nord-américain représentece avec quoi une partie du mouvement syndical québécois cherche àrompre depuis une dizaine d'années. Car le gompérisme représente pourla gauche syndicale une voie qui mène à l'impasse. Le "syndicalisme d'affaires" ne rejette pas le capitalisme et refuse l'action politique autonome de la classe ouvrière en se mettant à la remorque des partis bourgeois. Ce type de syndicalisme encourage le développement d'une "aristocratie ouvrière", travaille à l'intégration d'une partie de la classe ouvrière à la société capitaliste et lui fait perdre de vue ses intérêts à longterme comme classe.
- L'expérience du mouvement syndical britannique, le travaillisme,nous révèle autre chose. Si le travaillisme favorise la création d'un partipolitique de travailleurs, la conception qu'il s'en fait est néanmoins insuffisante. Ce parti limite en effet son action à la lutte électorale et parlementaire. Il fait aussi de cette action politique l'"affaire " qui occupe surtout les cadres du mouvement syndical, l'appareil dirigeant. Finalement, le travaillisme ne permet que l'obtention de meilleures mesuressociales pour certains secteurs de la classe ouvrière et certaines couchesdu peuple. Mais la propriété privée des moyens de production n'est passubstantiellement touchée de telle sorte que les inégalités sociales continuent d'exister et le pouvoir réel des travailleurs sur la société est réduità sa plus simple expression. Un parti créé à l'initiative des centrales syndicales prises comme centrales n'est donc pas susceptible de nous menerplus loin que le travaillisme anglais ou son équivalent canadien (leNPD), d'autant que le Parti québécois remplit déjà certaines fonctionshabituellement exercées par ce type de parti.
- L'expérience du syndicalisme révolutionnaire a ouvert la voie àune lutte syndicale faite dans une perspective anti-capitaliste. Le syndicalisme révolutionnaire a aussi posé le problème de l'autonomie des syndicats vis-à-vis des partis politiques de la classe ouvrière qui ont voulu trop facilement réduire leur rôle au champ étroit de la revendication é-conomique à court terme ou encore qui ont voulu en faire de simples"courroies de transmission". Mais en cherchant à jouer tous les rôles à la fois, en cherchant à concurrencer les organisations politiques de la classe ouvrière sur leur terrain, le syndicalisme révolutionnaire se trouve finalement à nier le caractère politique de la lutte pour renverser le pouvoir d'Etat. Le syndicalisme a pour rôle de contester le pouvoir sur tous les fronts, il ne peut cependant suppléer à la tâche d'organiser politiquement la classe ouvrière en vue de la prise du pouvoir. Par contre, l'expérience du syndicalisme révolutionnaire, particulièrement en France, révèle qu'on ne réussira pas à créer une organisation politique sans l'apport décisif d'un nombre important de militants syndicaux. Pour construire un véritable parti de la classe ouvrière il faut des militants formés et ayant une bonne expérience de lutte. Le syndicalisme est à même de fournir beaucoup à ce niveau. La naissance et le développement du Parti communiste français dans les années '20 témoigne de cette situation car de nombreux syndicalistes révolutionnaires ont alors rejoint ce parti suite à l'échec de la grève générale de 1919.
|
|
4) L'expérience du mouvement ouvrier de tradition marxiste (expérience de mouvements ouvriers de pays tels que la France, l'Italie ou le Chili pour ne mentionner que des pays où la tradition marxiste est large, profonde et continue) : de tous les courants, c'est celui qui représente pour nous le plus d'intérêt car le courant marxiste s'est développé là où précisément le mouvement ouvrier a été et est des plus vigoureux dans sa lutte contre le capitalisme. C'est là que réside son intérêt et de ce fait le rend plus susceptible de nous fournir des éléments de réponse aux questions posées antérieurement, Le mouvement ouvrier de tradition marxiste pose d'emblée la nécessité d'une lutte syndicale de classe et de masse (les syndicats sont des centres de résistance au capital nous dit Marx). Il juge cependant cette lutte syndicale insuffisante pour s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation capitaliste. La lutte politique est donc tout aussi nécessaire. Mais si la lutte économique et la lutte politique vont de pair dans une espèce de "division naturelle des tâches" dont l'une est assumée par le syndicat et l'autre par le parti, le courant marxiste accorde par contre la primauté au politique et attribue au parti le rôle de direction en le définissant comme organisation d'avant-garde. Ce parti, pour jouer véritablement son rôle de direction, doit chercher à regrouper les militants les plus combatifs, les plus expérimentés et les plus conscients de la nécessité de lutter pour le socialisme ; un parti de militants qui est organisé sur tous les fronts (et en premier lieu sur les bases mêmes de la classe ouvrière que sont les lieux de travail) et qui mobilise les travailleurs contre toutes les manifestations d'oppression.
Cette conception du rôle du parti a cependant donné lieu à deux interprétations et à deux pratiques différentes dans l'histoire du mouvement ouvrier international. La première position, qui a historiquement prévalu, définit le parti comme étant l'unique lieu de synthèse des revendications des travailleurs dans leur lutte contre le capitalisme et pour le socialisme, d'où la nécessaire subordination des syndicats au parti ou si l'on veut des rapports statutaires et hiérarchiques entre les deux organisations. Le point culminant de cette position renvoie aux années 1928-1934 dans l'Internationale communiste alors dirigée par Staline. Depuis une quinzaine d'années cette position est battue en brèche par l'apparition à l'intérieur du marxisme de nouveaux courants politiques et syndicaux qui luttent pour revitaliser le mouvement syndical, débureaucratiser la lutte politique et rebâtir une nouvelle synthèse des rapports entre l'organisation politique et les autres formes d'organisation de la classe ouvrière. La seconde position peut être stimulante pour notre réflexion. Elle ne définit pas le parti comme unique lieu de synthèse de la lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme et pour le socialisme. D'une part, le parti est conçu comme disposant de certains avantages sur les autres organisations de la classe ouvrière puisqu'il regroupe les militants les plus formés et les plus résolus et que son champ d'action recouvre tous les fronts de lutte. Mais d'autre part, cette conception reconnaît l'interdépendance nécessaire des partis et des organisations syndicales (et donc leur transformation mutuelle) parce qu'elles aussi peuvent opérer leur propre synthèse de la lutte à mener, qu'elles le font effectivement et qu'elles réussissent souvent à faire avancer la classe ouvrière dans son ensemble tout autant que le parti. En dernière instance, on admet la réalité voire la nécessité d'une alliance conflictuelle entre les organisations syndicales et le ou les partis dans la lutte pour le socialisme. C'est, par exemple, ce que semble suggérer l'évolution du mouvement ouvrier italien des dix dernières années (57).
|
|
1. QUE FAIRE AUJOURD'HUI ET MAINTENANT
La connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier international permet donc de se réapproprier un certain nombre d'indications généralesutiles pour l'action. Mais la question qui demeure en suspens est évidemment celle du que faire aujourd'hui et maintenant? Les indicationstirées de l'histoire du mouvement ouvrier international ne suffisent pasà elles seules : il nous faut également faire l'examen de notre conjoncture nationale... A cet égard, sans prétendre vouloir répondre de façoncomplète à cette question, il nous semble que la construction au Québec d'un véritable parti de la classe ouvrière repose minimalement surnotre capacité de faire la synthèse des acquis de la lutte contre l'exploitation et contre l'oppression nationale telle qu'elle s'est développéechez nous depuis une dizaine d'années. Le développement d'un parti dela classe ouvrière ne peut passer à côté de l'expérience du "syndicalisme de combat" ni éviter d'assumer pleinement la question nationalequébécoise. C'est là une première constatation. La seconde renvoie à lanécessité pour les militants de la gauche ouvrière et populaire (y compris les militants intellectuels près de cette gauche ouvrière et populaire)d'entamer dès maintenant un processus de regroupement de caractèrepolitique ou tout au moins semi-politique afin de faire la synthèse desacquis de lutte sur les différents fronts, afin d'élargir notre horizon politique et donc de développer un point de vue d'ensemble sur la sociétédans la perspective d'imposer la classe ouvrière comme classe dominante, dans la perspective de construire le pouvoir populaire.
LES RAPPORTS PARTIS/SYNDICATS DANS LE MOUVEMENT OUVRIER ITALIEN (58 )
A. Le mouvement syndical italien : le plus combatif et le plus puissant en Occident
Nous connaissons tous un peu l'Italie par la présence numériquement importante d'Italiens au Québec et surtout à Montréal. A eux seuls, les Italiens forment en effet plus de 7 %de la population montréalaise et de 15 à 20 %de la population de certains quartiers ouvriers du nord de la ville, comme Villeray et St-Michel. Mais nous connaissons peu de choses de l'Italie elle-même, de l'Italie en lutte. Pourtant le mouvement ouvrier de ce pays est sans doute le mouvement le plus combatif et le plus puissant de tous les mouvements ouvriers de l'Europe capitaliste (France, Angleterre, Allemagne...). A titre d'exemple, mentionnons que dans les trois premiers mois de 1976, quatre grèves générales ont mobilisé chacune entre 10 et 12 millions de travailleurs.
Comment s'explique l'ampleur de la lutte syndicale dans ce pays? D'abord la situation économique et sociale de l'Italie n'a cessé de se dégrader depuis une dizaine d'années. Et davantage encore depuis 1974 : plus de deux millions de travailleurs sont en chômage, sans compter le sous-emploi qui affecte grandement une autre frange de la population active. Cette situation est particulièrement grave dans les villes du Sud, comme Naples, où l'émigration est un phénomène massif... et explosif : entre 1958 et 1969, on compte près de trois millions d'émigrés, dont un tiers à l'étranger et le reste dans les villes industrielles du Nord. Le taux d'inflation traduit également la dégradation de la situation, il atteignait l'an dernier 26 %.
B. De nouvelles revendications
Mais si la situation se détériore depuis déjà plusieurs années, la mentalité d'un nombre de plus en plus considérable de travailleurs tend aussi à se modifier : les jeunes (jeunes travailleurs et étudiants), les femmes nouvellement arrivées sur le marché du travail (suite au boom industriel commencé dans les années '50, jusqu'en 1963) et les émigrés de l'intérieur n'acceptent plus cette situation ; ils aiguillonnent le mouvement syndical pour qu'il transforme ses méthodes de lutte, qu'il assume de nouvelles revendications (réduction de l'inégalité des salaires, refus du travail à la pièce et des heures supplémentaires, refus d'effectuer des travaux nuisibles à la santé pour un salaire plus élevé, réduction du rythme de travail...) et pour qu'il élargisse la participation aux luttes (comités d'entreprises et comités de zone).
Ces jeunes travailleurs, ces femmes, ces émigrés (notamment ceux qui travaillent dans la métallurgie, à la FIAT de Turin pour ne nommer que celle-là, qui à elle seule emploie plusieurs dizaines de milliers de travailleurs) ont revitalisé le mouvement syndical dans son ensemble, au prix souvent de dures luttes à l'intérieur de leurs organisations en imposant l'unité d'action des trois centrales et en stimulant le processus d'unité organique (fusion des trois fédérations de la métallurgie) qu'avait entamé une partie de l'appareil syndical où sont présents de nouveaux courants politiques.
C. L'action des partis politiques dans les syndicats
Cette tendance à l'unité syndicale, avec les hauts et les bas inévitables que cela implique, caractérise les années '70. Mais un des obstacles importants a sans doute été les vieux clivages politiques présents dans le pays, clivages politiques qui se répercutent directement dans le mouvement syndical lui-même, chaque centrale ayant des affinités avec des partis politiques précis. Le mouvement syndical italien, fort de plus de 6 millions de travailleurs adhérents, a en effet été divisé en trois centrales syndicales jusqu'à la fin des années '60, selon les clivages politiques hérités de l'après-guerre.
|
|
La CGIL (Confédération générale italienne du travail) est la plus importante centrale avec plus de 3 millions d'adhérents. L'influence la plus déterminante provient des travailleurs communistes qui y militent. Mais si le PCI (Parti communiste italien) prédomine dans cette centrale, le PSI (Parti socialiste italien) n'y a pas une influence négligeable. La CISL (Confédération italienne des syndicats de travailleurs) regroupe quant à elle quelques 2 millions de membres. D'inspiration catholique à l'origine, elle fut jusqu'à la fin des années '60 sous la direction de dirigeants syndicaux démocrates-chrétiens. De son côté, l'Union italienne du travail (UIL) regroupe près d'un million de travailleurs et sa direction est d'appartenance socialiste et social-démocrate.
Cette présence très marquée des partis politiques dans le mouvement syndical par l'intermédiaire de leurs militants ne doit pas nous surprendre outre mesure : le syndicalisme en Italie s'est développé grâce à l'initiative de militants de partis qui en voyaient la nécessité pour eux-mêmes et pour leurs camarades de travail (partis de gauche) ou encore pour assurer à leur parti la base de masse indispensable pour se maintenir au pouvoir (Démocratie chrétienne). Les centrales syndicales sont donc jusqu'à un certain point les enfants des partis. A partir des années '60, cette situation tend à se transformer : la Démocratie chrétienne perd de plus en plus de terrain à l'intérieur de la CISL et le PCI évolue plus en souplesse vis-à-vis de la CGIL où la gauche ne tolère plus la subordination. Les grandes grèves de 1961-1962 et l'automne chaud de 1969 (59) ont fait que l'unité s'est imposée comme nécessaire en dépit des divisions politiques traditionnelles. C'est à la faveur de ces périodes de mobilisation massive qu'est apparue à l'intérieur de la CISL une gauche syndicale catholique qui refuse la dépendance de la centrale à l'égard de la DC ; et à l'intérieur de la CGIL une gauche communiste et une extrême-gauche qui se refusent à jouer le jeu politique du PCI et du PSI.
D. La marche vers l'unité syndicale
Les clivages traditionnels entre les centrales syndicales persistent. Ils sont même encore largement dominants. Toutefois, le PCI, dont l'influence dans la classe ouvrière et dans le peuple en général (35%des électeurs en juin 1976) est sans contredit la plus forte, manifeste une certaine volonté de compromis avec la DC au pouvoir, pour contrer la crise. Si la collaboration entre ces deux partis allait s'accentuer dans une tentative commune de régler la crise sur le dos des travailleurs, plusieurs secteurs du mouvement ouvrier (y compris certaines directions syndicales au sommet) ne manqueraient pas de prendre leurs distances de façon plus radicale encore par rapport au PCI.
L'enjeu italien dans les années qui viennent est déterminant pour toute l'Europe. De plus, l'expérience d'unité syndicale qui s'y est amorcée depuis près de 10 ans est riche d'enseignements pour nous. L'unité syndicale profonde et réelle ne s'obtient pas par décret ou par résolution de congrès. Elle est un processus de maturation lente où plusieurs facteurs jouent en même temps : 1. l'unité s'impose à la faveur d'une crise aiguë du capitalisme ; 2. l'unité doit non seulement correspondre à des aspirations à la base mais davantage à une volonté explicite et organisée de cette base.
Dans ce sens-là, elle n'est pas le fruit de la seule entente entre les directions syndicales au sommet ; 3. elle ne doit pas reposer sur la seule base d'une plate-forme de lutte sur les problèmes immédiats. Elle doit également se fonder sur une stratégie commune de transformation sociale, sur un projet de lutte à moyen et à long terme quirejette radicalement le type de société dans laquelle on vit parce qu'elle n'a pasd'avenir (pour paraphraser un certain manifeste...). •

Manifestation durant la grève générale du 7 mai 1974 à Milan.
- LES SYNDICATS
CGIL : Confédération générale italienne du travail : 3 millions d'adhérents.
CISL : Confédération italienne des syndicats de travailleurs : 2 millions d'adhérents.
UIL : Union italienne du travail : près d'un million d'adhérents.
- LES PARTIS
PCI : Parti communiste italien : 1,600,000 membres ; 35%des électeurs en 1976.
DC : Démocratie Chrétienne : 1,800,000 adhérents ; au gouvernement depuis la Libération en 1945 ; 38.7%des suffrages aux élections législatives en 1976.
PSI : Parti socialiste italien ; 400,000 adhérents ; 12% du vote en 1976.
Gauche révolutionnaire : (PDUP. Lotta continua, Avanguardia operaia...) ; quelques dizaines de milliers de membres ; 3 à 4% du vote en 1976.
9. LECTURES SUGGEREES
1. SUR LE GOMPERISME
Lipton, C., Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec, Parti-Pris, Montréal, 1976, 500p.
Une analyse du mouvement syndical canadien et québécois, de ses luttes, de ses hauts et de ses bas de 1827 jusqu'à 1960. Quelques points de repère pertinents sur l'influence du gompérisme chez nous. Par un historien du mouvement ouvrier qui est aussi un militant de longue date.
Piotte, J. M., Syndicalisme de boutique, d'affaires et de combat dans le livre Le syndicalisme de combat, A. St-Martin, Montréal, 1977, pp. 33 à 42.
En six ou sept pages un tableau des caractéristiques du gompérisme tel que pratiqué aujourd'hui et mis en rapport avec le syndicalisme de combat, courant issu des luttes des dix dernières années au Québec, qui cherche à rompre avec le vieux modèle américain.
2. SUR LE TRAVAILLISME
Chariot, Monica, Le syndicalisme en Grande-Bretagne, A. Collin, Paris, 1970.
Pelling, Henry, Histoire du syndicalisme britannique, Seuil, Paris, 1967, 285p.
A ceux qui voudraient des données concrètes portant sur le travaillisme à partir de ses débuts jusqu'à nos jours, nous suggérons ces deux auteurs. Ils n'ont toutefois pas d'approche très critique sur le sujet.
3. SUR LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE
Dubief, H., Le syndicalisme révolutionnaire, A. Collin, Collection U, Paris, 1969,300p.
Une introduction d'une trentaine de pages qui nous met dans le contexte de l'époque (la France des débuts du siècle) et qui nous fournit certaines indications fort précieuses pour la compréhension de cette tradition syndicale. La suite comporte une série de textes choisis par l'auteur, et écrits par des militants syndicalistes révolutionnaires.
4. SUR LE MOUVEMENT OUVRIER DE TRADITION MARXISTE
Abendroth, W., Histoire du mouvement ouvrier en Europe, Maspero, Paris, 1973, 172p.
Un tour d'horizon rapide du mouvement ouvrier en Europe des débuts du XIXe siècle jusqu'à nos jours.
Kriegel, A., Les internationales ouvrières, Paris, PUF, 1964, Que sais-je? no 1129, 125p.
Tour d'horizon rapide des trois Internationales. Information historique précieuse mais appréciation politique désinvolte des hauts et des bas de l'internationalisme vécu à partir des Internationales.
Claudin, F., La crise du mouvement communiste, Maspero, 1972, Paris, tome I, 364 p., tome II, 404 p.
F. Claudin a été pendant plus de 30 ans dirigeant de premier plan à l'intérieur du mouvement ouvrier espagnol. Exclu de la direction du Parti communiste espagnol (PCE) et du parti en 1965 pour critique de gauche, l'auteur est devenu par la suite un des rares ana-lystes marxistesdu mouvement communiste international. Ses te années de militantisme dans ce mouvement et près de dix ans de réflexion sur la question font de lui quelqu'un qui sait ce dont il parle. Il parle avec force, notamment du problème du stalinisme. Sonouvrage est une analyse des différents tournants du mouvement communiste de 1919 jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. A partir de l'expérience des principaux pays où le mouvement s'est implanté (France, Espagne, Italie, Allemagne).
Trentin, B. et Girardi, G., Parti et syndicat : une synthèse nouvelle, Politique aujourd'hui, septembre-octobre 1976, pp. 73 à 85.
Une position qui annonce du nouveau sur la question des rapports partis-syndicats à partir de l'expérience de lutte du mouvement ouvrier italien des dix dernières années. Une douzaine de pages très denses et qui stimulent la réflexion.
Pour ce qui est de Marx, Lénine, Rosa Luxembourg et Gramsci nous vous référons aux ouvrages suivants :
Marx, K., Le syndicalisme, deux tomes, Maspero, 1972.
Il s'agit de textes de Marx choisis par R. Dangeville qui portent le syndicalisme.
Marx, K., Le manifeste du Parti communiste, Ed. sociales, Paris, 1969, 96p.
La conception du parti de la classe ouvrière chez Marx. Lénine, Textes sur les syndicats, Ed. du Progrès, Moscou, 1970, 450 p.
Une sélection de textes de Lénine allant de 1894 à 1922 qui traduit bien sa conception du syndicalisme et de l'organisation politique à différentes périodes. Pour en faire une lecture critique nous suggérons le livre de J. M. Piotte, Sur Lénine, chap. 2, pp. 103 à
172.
Luxembourg, Rosa, Grève de masses, parti et syndicats, Maspero, Paris, pp. 91 à 174.
Un point de vue qui diffère de celui de Lénine sans s'y opposer radicalement : importance de la grève de masse, impossibilité de séparer schématiquement lutte économique et lutte politique... Mais insistance sur le caractère spontané de la lutte et sur les réflexes anti-bureaucratiques à développer.
Gramsci, A., Thèses de Lyon (1926), dans Pour Gramsci de M. A. Mac-ciocchi, Seuil, 1974, pp. 337 et suivantes.
NOTES
- Le cas le plus patent est sans doute celui de Jean Marchand, ex-président de la CSN, devenu ministre libéral à Ottawa. Mais il y a des dizaines et des dizaines de cas autant à la CEQ, à la FTQ qu'à la CSN. Mentionnons ici quelques exemples connus : Jacques Brûlé, ex-membre de l'exécutif de la FTQ, aujourd'hui haut-fonctionnaire de l'Office de l'industrie de la construction du Québec; Guy Chevrette et Guy Bisaillon, anciens dirigeants de la CEQ, maintenant députés du P.Q.; Jacques Desmarais, ex-coordonnateur pour la CSN dans le Front commun de 1976, aujourd'hui au ministère de la consommation à Québec.
- La loi C-73 et le rejet par nombre de syndicats des limites de salaires que cette loi imposait en fournit un bon exemple.
- Egalement qualifié sous l'épithète d'anarcho-syndicalisme.
- Nous pensons ici à de nombreux mouvements de libération nationale comme par exemple le mouvement du 26 juillet (dirigé par F. Castro) à Cuba à la fin des années '50, à la gauche d'un certain nombre de partis socialistes en Europe pendant les années '30 et, aujourd'hui, à la gauche révolutionnaire ou à la nouvelle gauche de plusieurs pays d'Europe (France, Italie, Espagne...) et d'Amérique latine (Chili, Bolivie, Argentine...)
- Les Chevaliers du travail ont été la principale organisation du mouvement syndical en Amérique du nord (Etats-Unis, Canada, Québec) dans les années 1870-1880. En 1885 les Chevaliers regroupaient près d'un million et demi d'adhérents dans toute l'Amérique. Une des plus importantes batailles menées parcette organisation a été la journée de 8 heures. Lancée par les unions de métiercette bataille a été principalement prise en charge par les Chevaliers. Cette prise en charge donna lieu à la première tentative de grève générale nationale auxEtats-Unis : le 1er mai 1886.
- Cité par J. Dofny dans Le syndicalisme au Québec : structure et mouvement, étude No. 9, Ottawa, 1968, p. 26.
- Voir à ce sujet "Les unions américaines : complices des boss et de la C.I.A. en Amérique latine", février 1977, Secrétariat Québec-Amérique latine, Montréal.
- Au Canada anglais, ce courant domine le mouvement syndical à travers d'abordle CCF puis le NPD.
- Les T.U.C. forment la seule centrale syndicale de Grande-Bretagne. Fondéeen 1868, la Centrale regroupe aujourd'hui plus de 10 millions d'adhérents(40 o/o des travailleurs de G-Bj et a toujours partie liée avec le Parti travailliste auquel elle a donné naissance.
- H. Pelling, Histoire du syndicalisme britannique, Seuil, Paris, 1967, p. 141.
- Monica Chariot, Le syndicalisme en Grande-Bretagne, Paris, A.Colin, 1970.
- Cette modération est amplifiée par une pratique politique qui se situe principalement au Parlement.
- Le syndiqué qui refuse l'adhésion au parti par l'intermédiaire de son syndicat doit faire une demande spéciale...
- Un courant comparable anime aussi à la même époque le mouvement syndical aux Etats-Unis et au Canada : il s'agit aux Etats-Unis des International Workers of the World (I. W. W.) qui tinrent leur premier congrès en 1905 et du One Big Union (O.B.U.) au Canada (surtout dans l'Ouest). Voir à ce sujet Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec, C. Lipton, Ed. Parti-Pris, Mil. 1976, p. 283 à 338.
- La Commune de Paris est un des faits politiques les plus marquants de l'histoire de la classe ouvrière française et internationale. C'est en fait la première expérience socialiste de l'histoire : mécontent de la situation qui lui était imposée par la guerre entre la France et l'Allemagne, le peuple de Paris se soulève, renverse le régime en place et prend possession de la Ville. Pendant près de trois mois les travailleurs de Paris dirigeront la Ville en la réorganisant à tous les niveaux (justice populaire, ravitaillement, santé...). La bourgeoisie ne pouvait évidemment tolérer une telle situation. Une fois l'armée réorganisée, elle chercha immédiatement à reprendre l'offensive. Une sanglante répression s'ensuivit de telle sorte que plus de 20,000 ouvriers furent fusillés et un nombre équivalent envoyé au bagne ou en exil. Sur la portée de la Commune et sur les leçons de cette première expérience de pouvoir populaire voir La guerre civi en France de Karl Marx.
- Voir la Charte d'Amiens en page 20.
- Extraits de la Charte d'Amiens tirés du livre de J.D. Reynaud, Les syndicatsen France, Seuil, Paris, 1975, tome II, p. 26-27.
- L'Association internationale des travailleurs ou 1ère Internationale (1864-1876) naît de la nécessité de la solidarité internationale des travailleurs en Europe (Angleterre, France, Allemagne...) : K. Marx en sera un des principaux dirigeants. La 1ère Internationale se compose à la fois de syndicats et de partispolitiques, tandis que les Internationales qui suivront ne seront composées quede partis politiques.
- Voir à ce sujet le livre de H. Dubief, Le syndicalisme révolutionnaire, A. Colin Collection U, Paris, 1969, p. 232-233-234.
- Motion présentée par le secrétaire général de la C.G. T. et adoptée à forte majorité par le congrès tenu à Amiens en France, du 8 au 16 octobre 1906. Texte tiré du livre de J.D. Reynaud, Les syndicats en France, tome II, p. 26-27.
- K. Marx, Manifeste du Parti communiste, Oeuvres choisies, Ed. du Progrès, Moscou, p. 4L
- K. Marx, Le syndicalisme, /, Maspero, Paris, 1972, p. 33 et 54.
- K. Marx, Le syndicalisme, /, Maspero, 1972, p. 31.
- Résolution de l'Association internationale des travailleurs sur les syndicats,1866, dans K. Marx, Le syndicalisme, p. 69-70.
- Tiré du Manifeste du Parti communiste de K. Marx, Oeuvres choisies, Ed. du Progrès, Moscou, p. 42.
- Mao reprendra plus tard la même idée : "Un groupe dirigeant vraiment uni et lié aux masses se constituera progressivement dans la lutte même des masses et non à l'écart de celle-ci" A propos des méthodes de
- Statuts provisoires de l'Association internationale des travailleurs, dans K. Marx, Le parti de classe, //, Maspero, Paris, 1973, p. 93. On ne peut manquer ici de noter le contraste avec la définition que se donnait d'elle-même la IIIe Internationale : "instance suprême" et "état-major" (pour son exécutif).
- Bernstein : théoricien et dirigeant de l'aile droite du Parti social-démocrate allemand. Bernstein revise de fond en comble le marxisme en mettant de l'avant une conception du socialisme qui n'implique plus l'expropriation des capitalistes.
- Kautsky : théoricien et dirigeant de l'aile centriste du Parti social-démocrate allemand. Kautsky demeure fidèle à la pensée marxiste jusqu'en 1918, moment où il adresse une critique à Lénine et à son parti en rejetant complètement l'apport et le mérite de la Révolution d'octobre 1917 en Russie.
- Cité par Lénine dans le Que faire ?, Oeuvres choisies, I, p. 141.
- Lénine, Que faire?, O.C.I., p. 135.
- Social-démocratie : Plusieurs des partis politiques qui fondent la IIe Internationale en 1889 s'appellent formellement "social-démocrates" (cas de l'Allemagne en 1869, de la Suède en 1889, de la Russie en 1898...). Jusqu'à la 1èreguerre mondiale, Lénine et son groupe sont membres du parti social-démocrate russe. Au moment où il écrit ces lignes, (soit en 1902), le terme "social-démocrate " est positif. C'est dix ans plus tard que cette expression devient synonyme d'ambiguïté voire même de collaboration de classe. Voir à ce sujet Y.Vaillancourt, CFP, La social-démocratie dans l'histoire
- Lénine, Que faire?, p. 168.
- Lénine, Troisième conférence du POSDR, 1907, dans Textes sur les syndicats,Editions du Progrès, Moscou, 1970, p. 169.
- Voir à ce sujet le livre de F. Claudin, La crise du mouvement communiste,tome II, Paris, Maspero, 1972, p. 686 à 731. Voir surtout les pages 720 à 725.Voir plus loin à
- A propos de la Révolution russe et de ses antécédents (crise révolutionnairede 1905), voir Le projet socialiste (approche historique), Louis Favreau, à paraître.
- Lénine, Oeuvres complètes, vol. 24, 1917, cité par Marcel Liebman, Seuil, Paris, tome I, p. 270.
- Rosa Luxembourg (1871-1919) : D'abord militante de l'aile gauche du Parti social-démocrate allemand, elle rompt avec celui-ci en 1914 au moment où le groupe parlementaire du Parti vote les crédits de guerre. Rosa Luxembourg et son groupe fonderont alors la Ligue Spartakus qui deviendra quelques années plus tard (1918) le Parti communiste allemand. Rosa Luxembourg a beaucoup écrit pour lutter contre la tendance réformiste du Parti social-démocrate (Bernstein et de) qui avait fini par miser presqu'exclusivement sur le parlement et sur les élections plutôt que sur l'organisation et la mobilisation de la classe ouvrière dans la lutte contre le capitalisme. Mais on doit aussi à Rosa Luxembourg des critiques qui ont leur part de vérité à l'adresse de Lénine sur la conception qu'il se fait du Parti (dans Grève de masses, parti et syndicats -1906) et sur l'avenir de la Révolution en Russie (dans La Révolution russe -1918).
- Ce que font la plupart des groupes politiques de gauche au Québec et toutparticulièrement les "marxistes-léninistes" (pro-chinois).
- Déviation qui se caractérise par la croyance a) que la révolution socialiste estl'affaire d'une petite avant-garde constituée en parti préalablement à touteaction de classe, b) qu'en dehors du parti, il n'y a que des actions réformistes.
- La conscience révolutionnaire est autre chose que la théorie révolutionnaire.On peut accepter le marxisme, le maîtriser même sans avoir aucune conscience révolutionnaire. Combien d'universitaires, par exemple, acceptent lemarxisme, sans pour autant avoir une pratique de lutte effective en lien avecla classe ouvrière. La conscience révolutionnaire exige qu'on relie concrètement théorie et pratique politique. A ce sujet voir J. M. Piotte, Sur Lénine, laconclusion du chapitre 2 portant sur le parti, p. 162 à 167.
- Lénine, Que faire?, O.C.I., p. 165.
- Voir la partie portant sur l'Internationale communiste et les syndicats en pagepage 30.
- Recueil de textes, L'Internationale communiste et les syndicats, 3e congrès,1921, Librairie progressiste, Montréal.
- Staline deviendra dirigeant de l'Internationale communiste en 1924, après lamort de Lénine. Il le demeurera jusqu' à la dissolution de cette organisation en1943. Pendant toute cette période il sera également dirigeant du Parti communiste russe jusqu' à sa mort en 1953.
- II n'est pas inutile de mentionner que c'est cette conception stalinienne duparti que véhiculent les groupes politiques "m-l" comme En lutte et la Liguecommuniste. Il ne faut pas se surprendre outre mesure de leurs faits et gestesdans les groupes populaires et dans les syndicats où ils sont présents cor cesfaits et gestes sont commandés par cette conception. Le stalinisme est encoretrop souvent un boulet que traîne le mouvement ouvrier de tradition marxiste.
- L'Internationale communiste, lors de son 2e congrès en juillet 1920, posait 21conditions d'admission à ses membres. Les 2e, 9e et 10e conditions ici présentées illustrent en fait la conception qui a longtemps prévalu dans le mouvement communiste sur les rapports parti-syndicats.
- Texte adopté au IIe congrès de juillet 1920.
- Gramsci (1890-1937) : d'abord militant dans l'aile gauche du Parti socialiste italien, A. Gramsci participe à la fondation du Parti communiste. Luttantavec son parti contre le fascisme, il est finalement arrêté en 1926 et passe les10 dernières années de sa vie en prison. Le courant marxiste dans le mouvement ouvrier italien et international doit beaucoup à ses écrits sur le fascisme, sur le rôle du parti de la classe ouvrière mais aussi et de façon particulièresur le rôle des intellectuels et de l'Etat dans une société capitaliste.
- Voir page 33 : Extraits des thèses de Lyon (Gramsci).
- Thèses de Lyon (1926), thèse No 29.
- Idem., thèse No 36.
- Thèses de Lyon (1926), thèse No 39.
- Gramsci, La formation du groupe dirigeant, écrit de 1924, reproduit par C.B. Glucksmann dans Gramsci et l'Etat, Fayard, Paris, 1975, p. 587.
- 55 A. Gramsci, écrit de 1925, cité par G. Bonomi dans Partito e rivoluzione enGramsci, p. 142.
- Ce commentaire d'introduction aux Thèses de Lyon de même que les extraits sélectionnés sont tirés du livre de M.-A. Macchiocchi, Pour Gramsci, Paris, Seuil, 1974, p. 337 et suivantes.
- A ce sujet, voir page suivante. Voir aussi Politique aujourd'hui, sept. - oct. 76, pp. 73 à 85, Parti et syndicat, vers une synthèse nouvelle.
- Tiré du journal Solidarité, publication du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), nov.-déc. 1977, vol. 2, No 3.
- Suite à la révolte des étudiants, en 1968, qui servira de détonateur pour le mouvement ouvrier, une série d'occupations d'usines se produiront dans les principales villes d'Italie, provoquant ce que les observateurs de la vie politique italienne ont identifé comme "la plus violente secousse sociale connue par l'Italie moderne".