La part des femmes il faut la dire.Graphisme de la page couverture: Dominique Pothier Illustration des textes: Yves Lecompte Ce recueil a été réalisé grâce à un appui financier du Ministère des affaires intergouvernementales du Québec dans le cadre d'un programme de collaboration au développement des communautés francophones hors Québec. "C'est à travers la pensée de nos mères que nous pensons, si nous sommes femmes. " Virginia Woolf, Une chambre à soi PREFACEDepuis sa fondation en 1914, à Ottawa, la Fédération des femmes canadiennes- françaises n'a cessé de grandir et d'oeuvrer dans toutes les sphères de la société. Au moment de sa création, elle s'occupait principalement d'oeuvres de bienfaisance et patriotiques de toutes espèces en plus d'instituer des cours de toutes sortes et de subventionner les établissements d'éducation française. Au cours des années, elle a eu pour but principal d'assister la femme dans ses devoirs de mère et d'éducatrice, de sauvegarder la religion catholique et la langue fran- çaise. Caractérisé par le bénévolat traditionnel, l'organisme a subi les contre-coups de l'évolution sociale, que ce soit dans les attitudes, dans les besoins, dans les motivations ou dans les implications. Etant d'avis que l'action volontaire est le civisme vécu, celui des hommes et des femmes qui acceptent de façonner leur communauté ou leur pays et décident d'agir en conséquence, la Fédération depuis quelques années est entrée dans le dur processus de l'auto-évaluation, de la redéfinition et de la réorientation. Afin de cerner le mieux possible la direction à prendre, il s'avérait nécessaire de mieux connaître et de mieux comprendre les réalités de vie des femmes francophones en milieu minoritaire. Compte tenu que le rôle des femmes s'est transformé depuis les débuts de la Fédération, il était vital pour l'organisme de comprendre ces changements et de s'y adapter. C'est dans cette optique que la Fédération a amorcé son projet de recherche- action sur la contribution cachée des femmes au développement de leur milieu. Cette étude visait non seulement à mettre en valeur le rôle indispensable qu'elles ont joué, mais aussi à en comprendre toute I évolution en rapport avec le développement des communautés. Le présent recueil se situe dans le cadre de ce projet de recherche. Il est le résultat concret d'une consultation auprès des femmes francophones des différentes régions. Il veut valoriser le très grand engagement des femmes que l'histoire traditionnelle a passé sous silence. Pourtant, elles n'ont jamais cessé de faire avancer notre nation. Elles furent et sont toujours à l'oeuvre! Le contenu du recueil témoigne que les femmes n'ont pas déserté le champ de bataille. Il illustre bien comment, par leur pensée juste, leur vive sensibilité et leur comportement avisé, elles ont souvent dépassé le cercle familial pour s'engager à d'autres niveaux et être ainsi une force progressiste dans notre société. Cette étude a été rendue possible grâce à un prêt de personnel et un appui financier du ministère des Affaires intergouvemementales du Québec. Des femmes de toutes les régions du pays y ont collaboré de façon particulière, soit en accordant des entrevues, en rendant des témoignages, en travaillant au sein des comités de recherche, en compilant des archives ou des renseignements afférents. L'agent de recherche et le personnel y ont apporté une aide précieuse. Nous les remercions tous bien sincèrement. Enfin, après deux ans de travail acharné, c'est à la lumière d'une meilleure compréhension de la situation que la Fédération pourra orienter son action en fonction des besoins actuels des femmes francophones hors Québec. La lutte des femmes: un présent à organiser, un futur à définir. La lutte des femmes francophones: un double défi. Dans le cadre de la réalité politique actuelle, en plus de vivre leur quotidien dans une position dévalorisée par rapport à celle des hommes, ces femmes vivent en minorité "francophone" au Canada. Cette situation d'infériorité qu'elles subissent est double et indissociable. Il ne faut pas le cacher, elles revendiquent toujours sur deux fronts à la fois: la conservation de la langue et l'amélioration de leur situation en tant que femme. La Fédération des années 1980 doit rester dynamique. Elle doit être un espoir pour une société plus humaine. Elle doit assurer la visibilité et la reconnaissance de l'apport des femmes francophones si l'on veut que son action demeure le meilleur catalyseur social. Elle agira avec vigueur pour améliorer la condition de vie des femmes afin que, demain comme hier, elles soient les inlassables tisseuses de nos lendemains.
Gisèle Richer Présidente nationale TABLE DES MATIERES
INTRODUCTIONEntre le travail de la maison, le soin des enfants, la préparation des conserves, la couture, l'entretien du jardin, le "train" des animaux et l'aide aux champs, les femmes ont toujours trouvé le temps de s'occuper des pauvres, de soigner les malades, d'être sage-femme ou enseignante, d'assurer le financement des paroisses par leurs ventes de charité et ce, tout en menant les luttes scolaires les plus âpres. Voilà le programme de vie de ces pionnières francophones qui ont vécu dans des conditions généralement précaires. A l'est, ce sont les femmes acadiennes, marquées par des décennies d'instabilité et de misère qui ont su développer, une force de caractère, un humour et un sens de la vie exceptionnels. A l'ouest, ce sont surtout des Québécoises, mais aussi des Françaises et des Belges, qui, répondant à l'appel des colonisateurs, suivirent leur mari vers ce paradis qu'on leur promettait mais lent à venir. C'est grâce à toutes ces femmes que les valeurs culturelles francophones se sont transmises. Ce sont elles qui ont chanté, raconté des histoires, enseigné les prières et la langue à leurs enfants, afin de combler les failles des systèmes scolaires qui ne reconnaissaient pas les droits des francophones. Et ce sont les filles de ces pionnières qui continuent aujourd'hui à se battre pour que leurs enfants aient accès à une éducation en français. La forme de leur implication communautaire a changé en même temps que la famille et l'organisation sociale se sont transformées. Elles ne sont plus sages-femmes ou guérisseuses; elles s'occupent moins des orphelins et des handicapés. Ces lieux de "pouvoir" des femmes ont été peu à peu institution- nalisés et pris en charge par l'Etat. Mais elles continuent d'oeuvrer dans leur milieu, en mettant davantage l'accent sur leurs propres besoins, comme femmes francophones. Pourtant, le travail de ces femmes n'a jamais été reconnu publiquement; on n'a pas parlé d'elles dans les livres d'histoire; on n'a pas tenu compte de la contribution de ces milliers de femmes "ordinaires" au développement de leur communauté. Parce que l'histoire officielle ne s'intéresse qu'aux grands événements politiques, économiques et sociaux, elle ne rend pas compte de la vie privée des gens ordinaires. Et puisque la vie des femmes est centrée, d'abord et avant tout, sur le privé, famille et environnement immédiat, elle ne constitue pas un sujet d'intérêt pour l'histoire. Ce recueil de témoignages vise donc à faire connaître et surtout reconnaître la participation des femmes francophones hors Québec au développement de leur communauté. Il est le résultat d'un travail de recherche qui s'est échelonné sur une période d'un an, auquel ont collaboré plus d'une centaine de femmes dans les différentes provinces; il a permis de recueillir près de 500 témoignages ou biographies de femmes francophones à travers le pays. L'objectif de départ n'était pas de publier un tel recueil mais plutôt d'élaborer une analyse descriptive de l'évolution du rôle des femmes dans les commu- nautés francophones, à partir de témoignages recueillis auprès de femmes francophones de différents âges et de différents milieux. Mais devant l'intérêt manifesté par les femmes et devant l'ampleur de leur participation, il nous a semblé indispensable de publier un certain nombre de témoignages qui rendraient non seulement hommage au travail qu'elles ont accompli, mais qui permettraient aussi de mieux comprendre la situation telle que vécue et sentie par ces femmes. Nous avons évidemment effectué une sélection dans les témoignages en tenant compte de la diversité de l'information recueillie. Comme la recherche avait pour but de dégager les changements qui se sont produits dans le statut des femmes, avec le développement des commu- nautés francophones, nous avons voulu mettre en parallèle la situation des femmes "Dans c'temps-là..." "Et aujourd'hui.. .". Ainsi, pour chacune des sphères d'activité des femmes, soit la famille, le marché du travail et l'implication communautaire, nous retrouvons, dans une première partie, des témoignages de personnes ayant vécu leur vie "active" du début du siècle jusqu'aux années '50; la deuxième section, regroupe les témoignages de nos contemporaines. Quelques observations se dégagent des témoignages exprimés par les femmes. Dans l'ensemble, leur rôle ne semble pas avoir beaucoup changé avec le développement de la communauté. On pourrait même dire que, sur certains aspects, "Plus ça change, plus c'est pareil...". Au chapitre I, les témoignages démontrent que même si les dévelop- pements technologiques ont modifié l'organisation familiale et, par le fait même le travail domestique, les femmes ne sont pas plus libres ou plus disponibles pour d'autres activités. Alors que dans les grandes familles d'autrefois, les aînés(es) aidaient la mère aux travaux de la maison, les mères d'aujourd'hui sont maintenant seules pour assurer le travail ménager et le soin de leurs deux ou trois enfants. Les jeunes mères affirment en effet, que lorsqu'elles n'occupent pas un emploi rémunéré à l'extérieur, le partage des tâches entre elle et leur mari est quasi-inexistant. En somme, même si le travail ménager prend une forme différente de celui qu'effectuaient nos grand- mères, il n'en demande pas moins de temps. Les critères qui définissent ce que doit être une "bonne femme d'intérieur" ont considérablement augmenté, si bien que les femmes passent souvent autant de temps qu'autrefois à préparer les repas, à entretenir la maison et ce, malgré l'existence d'appareils ménagers automatiques. Quant aux tâches maternelles, elles ont été tellement mystifiées que les femmes se sentent mauvaise mère si elles ne répondent pas à toutes les normes décrites dans les manuels sur la psychologie de l'enfant. En fait, ces nouvelles responsabilités confiées aux femmes, en les isolant davantage, n'ont fait qu'accentuer l'idée que le "privé", c'est leur domaine. Quant au marché du travail, on constate qu'aujourd'hui comme hier, les femmes vont travailler à l'extérieur d'abord pour des raisons financières. Que ce soit pour contribuer avec le mari à faire vivre la famille ou que ce soit parce qu'elles sont seules, avec ou sans enfant, elles sont souvent placées devant la nécessité d'occuper un emploi rémunéré. Selon les témoignages recueillis, les inégalités persistent quoique plus subtiles. Elles obtiennent généralement le même salaire que les hommes pour le même travail mais c'est surtout au niveau des possibilités d'accès à des postes supérieurs ou au niveau de la définition des tâches que la discrimination se manifeste. On constate encore aujourd'hui, que les femmes se retrouvent le plus souvent dans des emplois considérés comme le prolongement des fonctions domestiques (serveuses, femmes de ménage, couturières) et dans des secteurs sous-payes (travail d'usine, secrétariat). La dévalorisation du travail des femmes dans la famille se reproduit sur le marché du travail. De plus, le travail rémunéré ne doit pas nuire au travail de la maison. Pour cette raison, les femmes travaillent à temps partiel afin d'avoir le temps de s'occuper de la famille, ou elles s'absentent complètement du marché du travail durant les années où elles éduquent leurs enfants. Ceci ne fait que confirmer l'idée que la place des femmes, c'est à la maison. Toutes les mères rencontrées ont soulevé le problème de la garde de leurs enfants comme étant leur préoccupation première dans leur choix de travailler à l'extérieur ou non. Si nos grand-mères avaient la possibilité d'amener leurs enfants avec elles lorsqu'elles enseignaient dans les écoles de campagne, il est rare que les mères d'aujourd'hui aient cette opportunité. Quant au partage des tâches, presque toutes les femmes reconnaissent que lorsqu'elles travaillent à l'extérieur, "il les aide", mais qu'elles demeurent toujours "la" responsable des tâches domestiques. En somme, la participation des femmes au marché du travail, qui répond à un besoin financier ou personnel, n'est pas encore un droit acquis: les femmes continuent d'être au bas de l'échelle, dans des ghettos d'emplois féminins, sans oublier la deuxième journée de travail qui les attend à la maison. Quant au rôle des femmes dans la sphère "para-domestique", c'est-à-dire cette zone frontière entre le "privé" et le "public" comprenant les différentes formes d'engagement social, il s'est lui aussi transformé en fonction des besoins de la communauté. Par leur implication communautaire, les femmes ont pu constituer leur propre "vie publique", source de valorisation, tout en rendant des services inestimables à la société, à l'Eglise, à l'Etat. Toutefois, avec le développement des soins de santé et le contrôle qu'y exerce le corps médical, avec la prise en charge des services sociaux par l'Etat, les femmes ont été dépossédées des fonctions qu'elles avaient assumées jusque-là. L'élimination des besoins qui étaient leur principale raison de s'impliquer les a obligées à repenser leur action sociale et à trouver d'autres formes d'enga- gement. Elles ont pu faire un cheminement dans le sens d'une prise de conscience de leurs propres besoins. De l'aide aux pauvres, aux malades, aux nécessiteux, fondée sur le don et l'oubli de soi, leur action sociale s'oriente de plus en plus vers des services qu'elles doivent se donner comme femmes francophones. Enfin, si l'expérience des femmes francophones, telle qu'elles l'ont elles- mêmes décrites nous oblige à conclure à une absence de changements fondamentaux dans la position des femmes au sein de la famille et sur le marché du travail, on peut toutefois exprimer plus d'enthousiasme par rapport aux transformations qui s'effectuent, pour plusieurs d'entre elles, dans la forme de leur implication communautaire. Souhaitons que ce recueil soit un outil de discussion et favorise l'amorce d'une réflexion sur la vraie place qu'occupé les femmes francophones au sein de leur communauté. Le dire est un premier pas vers la reconnaissance. Il faut continuer cette démarche. Pauline Proulx, Agent de recherche MERCI À toutes ces femmes qui, ont accepté de faire partie d'un comité de recherche dans leur région. Les heures qu'elles ont passées à fouiller les archives, à interviewer les personnes âgées de leur entourage, nous permettent de lever un coin du voile sur l'activité des femmes francophones dans leur commu- nauté. A toutes ces femmes qui nous ont reçues si chaleureu- sement et qui ont accepté de partager leurs souvenirs et leurs expériences quotidiennes. Enfin, à toute l'équipe de la Fédération des femmes canadiennes-françaises qui, par leur collaboration constante et leurs commentaires pertinents ont contribué à la mise en forme du recueil. Sans le travail concerté de toutes ces femmes, ce recueil de témoignages n'aurait pu voir le jour.
 "Vers l'année 1898, mon père décida de ven- dre sa terre et de venir tenter sa chance dans le nord de l'Ontario. Il répondait ainsi à l'appel du Père Paradis, un prêtre colonisateur. Dans ce temps-là, on ne pensait même pas à consulter l'épouse pour une telle décision. Ma mère n'osa jamais lui dire à quel point elle était opposée à cette idée. Jusqu'à sa mort en 1964, à l'âge de 99 ans, elle ne pouvait raconter cet épisode de sa vie sans pleurer à chaudes larmes." (River Valley, Ontario)Mon grand-père maternel est venu de France en 1905. On faisait de la propagande. On leur promettait le paradis avec un avenir pour leurs enfants. Ça coûtait seulement $10.00 pour un homestead. Ma mère, elle, ne voulait pas venir. Elle avait seulement 10 ans à ce moment-là. Elle n'est jamais allée à l'école au Canada. Les voisins étaient distancés de 4 à 5 milles. Mon grand-père serait retourné s'il en avait eu les moyens. Mais il n'avait plus d'argent, il avait tout dépensé pour s'installer." (St-Denis, Saskatchewan)"Nous autres on se mariait et on suivait notre mari. On n'avait pas le choix. Mon mari était à la base militaire. Je restais 24 heures par jour dans une chambre qu'on avait louée. Il y avait un sofa qu'on ouvrait le soir puis un petit poêle à deux ronds. Il y avait un crate d'oranges que j'avais recouvert avec du matériel; on avait un bureau, ma grosse valise comme de raison, un gros trunk pour mettre mes affaires, mon linge. J'ai déména- gé cinq fois. A certaines places il y avait des coquerelles et des punaises; à d'autres places tu pouvais même pas manger de fruits dans ta cham- bre. Mais on vivait et on vivait très heureux. Je suis restée à Kingston trois ans et deux mois. C'est là que j'ai eu mon premier bébé. C'était pendant la deuxième guerre." (Cornwall, Ontario)"Quand je suis arrivée, les trois premières années, je suis sortie trois fois de chez moi. Je suis allée faire mes Pâques. Il n'y a pas de mot pour décrire ce que je ressentais. Comme on le disait: c'était pas un cadeau, je vous l'assure. Après avoir vécu en ville, goûté à l'électricité, chambre de bain, l'eau courante, je ne comprends pas encore comment j'ai pu accepter les misères vécues ces années-là. Oui, ma machine à laver électrique fut échangée pour un cheval." (Girouxville, Alberta)'Quand on prend mari, on prend pays. Mon mari aimait la ferme et il a décidé d'acheter une ferme et de déménager pour faire plus d'argent, pour rencontrer nos obligations. J'avais une peur bleue. Heureusement, mon mari avait acheté un chien de garde. Avec lui je me sentais plus sécure. Les voisins étaient à un mille." (St-Pierre-Jolys, Manitoba)"On est venu pour gagner notre vie, comme les autres. Chez-nous, on n'avait pas assez grand de terre pour faire vivre une famille et puis mon mari avait de la parenté ici. Comme il ne pouvait pas travailler dans les chantiers l'hiver, dans le froid, sa soeur lui a dit de venir la trouver à Welland. Y'avait des bons salaires et puis la Cotton avait fait bâtir des maisons pour héberger les gens qui venaient travailler pour eux. Quand je suis arrivée, y'avait pas beaucoup de français, mais moi j'ai pas eu beaucoup de misère à m'adapter parce que je restais à la maison pour élever mes p'tits. Ça fait que c'est mon mari qui faisait toutes les commissions. Puis lui y connaissait la langue un peu parce qu'y était déjà venu. J'me souviens y'allait au magasin m'acheter des robes des fois, puis la femme lui en donnait deux ou trois en lui disant: "Fais-lui essayer les trois. Elle gardera celle qui conviendra et tu me rapporteras les autres." C'était pareil avec mes chaussures aussi. Aujourd'hui on fait plus ça comme de raison." (Welland, Ontario)Â
DES CONDITIONS DE VIE PAS TOUJOURS FACILES..."A l'intérieur, un lit de fer dans un coin, un tas de foin dans l'autre; ce foin devait servir de lit aux enfants en attendant qu'arrivé notre mobilier. Un petit poêle en fonte, une tablette pour le seau à l'eau et une cuvette pour se laver, voilà tout ce qui garnissait notre cuisine. Madame Lavigne nous avait prêté une table et les choses les plus nécessaires. Pas d'arrnoire, très peu de vaisselle, ainsi commençait notre vie de pionniers. Papa avait semé cinq acres en avoine avant notre arrivée. Notre premier été fut court, pluvieux et très frais. La première neige tomba le 12 septembre; ce n'était pas gai. Afin de protéger un peu du froid ses trois chevaux, papa avait construit une sorte d'abri avec des planches, appuyées aux murs de la maison. Et nous, dans la chaumière, nous n'étions guère mieux. Le bousittage entre les troncs équarris, délayé par l'eau qui pénétrait par le toit de tourbe, tombait par morceaux sur le plancher. Mous les ramassions par pelletées. Nos meilleurs vêtements furent tous abîmés, et l'humidité laissait une senteur de moisi. J'étais si découragée de voir ce dégât que je me promettais bien de retourner à la civilisation lorsque j'aurais atteint mes 18 ans. Nous n'avions pas de moustiquaires aux fenêtres et les maringouins, surtout après la pluie, criblaient l'air et formaient des nuages autour de nous. Il était impossible de marcher dans la prairie sans voile sur nos chapeaux. Nos bras et nos jambes étaient couverts de piqûres. Le soir, il fallait faire de la fumée pour éloigner de nous et des animaux, ces insectes endiablés. On se servait d'une vieille chaudière, on allumait un peu de foin sec que l'on recouvrait d'herbe et que l'on surveillait pour que le feu ne s'éteigne pas." (North Battleford, Saskatchewan)"Grand-père, aide de ses voisins, bâtit un shack en logs et le recouvrit d'un toit de terre et de foin. Comme on n'avait pas apporte de meubles des Etats-Unis, grand-père Jodoin fabri- qua donc une table, des petits bancs avec des logs équarries ainsi que des lits avec des perches. On fit les paillasses de paille ou de foin. On acheta un poêle à quatre ronds et un petit fourneau. On chauffait en plus au gros Buck stove, un poêle en fonte. Il pleuvait beaucoup dans cette maison. Grand-mère devait souvent sortir son linge des valises faites de toile, parfois rincer ce linge ou le laver et le faire sécher. Il arriva plusieurs fois que la famille traversa un slough à pied dans six à huit pouces d'eau pour aller coucher chez le voisin. On y apportait ies couvertures sous les bras. C'était en 1912". <Ste-Lina,Alberta)"Ma famille est arrivée en 1908 avec 6 enfants, le plus vieux avait 10 ans et le bébé 4 mois. Mon oncle était arrivé en 1907, un an avant nous autres. Y'avait pas de transportation. pas de chemin. On vivait au bord du lac, pour le poisson. On vivait dans un shack que mon oncle nous avait construit. C'était ben p'tit, c'était comme un caveau quasiment, c'était un trou dans terre. Y'avait trois faces dans terre. Pas de châssis, pas rien. On s'éclairait à la chandelle. Trois murs de terre, le plafond de bois rond avec de la terre par-dessus. En avant, c'était du bois rond. C'était au ras Moose Lake. Cette bâtisse-là existait y a encore pas long- temps. Y'avait seulement un petit châssis avec d'autres petites vitres du côté sud. Le soleil entrait un petit peu par là. Mais on était presque tout le temps à la chandelle, l'hiver. On était 6 enfants là- dedans. On mangeait assis avec nos assiettes sur nos genoux. Y'avait seulement une petite table. La pluie a commencé à tomber au printemps, la couverture a commencé à couler, l'eau tombait dans la maison, les enfants pleuraient." (Cold Lake, Alberta)Â
"Faire son ordinaire""Je me levais tôt. Nous étions 11 personnes à table. J'allais traire les vaches, écrémer le lait, faire le beurre, amener l'eau à la chaudière, fendre et rentrer du bois, laver les vêtements à la main, frotter le plancher avec une brosse. Enfin, tout l'entretien de la famille et de la maison. C'était de l'ouvrage dur! Il fallait raccommoder, aussi on rapié- çait beaucoup. De temps à autre, j'allais même aider aux champs, racler du foin ou encore mettre du feu dans des tas de racines." (Girouxville, Alberta)"Quand on revenait de la grange le matin et que nos chaudières étaient propres, il fallait faire les lits, laver toutes les lampes, laver les tuyaux puis remplir les lampes d'huile. Y'avait une lampe dans chaque chambre. C'était ça qu'on faisait avant de commencer autre chose. Fallait que notre maison soit propre et que les lampes soient toutes prêtes pour le soir." (Embrun, Ontario)"Fallait tirer les vaches, faire notre pain, notre beurre, préparer les repas, tenir les enfants propres, laver sur une planche à laver. J'faisions l'étoffe, j'faisions des chemises, des robes. Fallait carder, filer, brocher la laine, faire les souliers. C'est mon mari qui faisait les souliers. J'travaillons beaucoup. Mon mari allait à la pêche des fois la nuit, J'dormions pas beaucoup. " (Cap St-Georges, Terre-Neuve)
"On n'avait pas d'eau courante"
"Le lavage était fait dans une cuve d'eau avec une planche à laver et du savon domestique. Le linge, une fois nettoyé, était placé dans un réci- pient d'eau bouillante sur le poêle afin d'être stérilisé et minimiser les maladies." (Hanmer, Ontario)
"A l'âge de 16 ans, c'est dur d'élever une famille quand t'as rien. On lavait à la planche, on n'avait pas d'eau dans la maison seulement. Mon mari la charroyait dans des chaudières pour laver. Le lavage se faisait dans un moulin avec une roue puis un poignée dans le côté. Fallait brasser ça jusqu'à temps qu'on vienne le bras mort. La plupart du temps ça décrassait même pas. Fallait chauffer nos fers sur le poêle pour le repassage; ça fait qu'y fallait chauffer le poêle si on voulait repasser." (Welland, Ontario) "L'été, j'allais avec d'autres femmes du village faire mon lavage à la rivière. Il n'y avait aucun service d'électricité, ni d'eau dans le village. On devait puiser l'eau nécessaire à la maison, à la rivière en bas d'une longue côte." (River Valley, Ontario)Le savon du pays
"Pour faire le savon, les femmes conservaient le suif des boucheries de l'automne. Au mois de mai, le gros chaudron de fonte était suspendu à une perche placée sur deux chevalets. On y mettait ce gras-là, on ajoutait du lessie et de l'arcanson et on faisait dessous un feu d'écopeaux de bois. Tout devait fondre lentement; alors, en surveillant le savon qu'elles brassaient souvent avec une grosse palette de bois, elles faisaient le ménage de la cour, de la remise à bois et du hangar. Elles balayaient le tout avec un balai de branches de cèdre de leur confection. Ce même balai servait à balayer le devant de porte tous les samedis. Lorsque tout était bien fondu et bien cuit dans le chaudron, elles ajoutaient une poignée de sel en brassant davantage et le savon montait sur le dessus et la potasse reposait au fond. A tous les samedis, on nettoyait le siège et le plancher des toilettes à l'extérieur avec cette même potasse." (Casselman, Ontario)"Le savon était confectionné à la maison par ma mère: il était fait à base de graisse d'animaux et de lessive. La lessive était une solution qu'elle obtenait de la cendre de bois dur, chêne, frêne et orme, brûlé durant l'hiver. Elle plaçait la cendre dans une vieille canne à lait qui était percée à quelques endroits dans le fond. Ensuite, elle ver- sait de l'eau sur cette cendre et y recueillait une solution qui était la lessive. Dehors, elle faisait un feu et dans un grand chaudron en fonte, elle faisait bouillir la graisse fondue avec la lessive. Elle le surveillait et le brassait avec une grande palette qu'elle appelait la palette à potasse. Quand le mélange voulait bouillir trop rapidement et renverser, elle y ajoutait d'autre lessive. Vers la fin de la cuisson, elle ajoutait de l'arcanson pour donner une odeur agréable à son savon. Ensuite, elle versait son mélange dans des plats pour le laisser durcir afin de le couper en barres. Ce qui restait au fond du chaudron était de qualité infé- rieure. Elle se servait de cela pour frotter ses planchers de bois. Ce savon n'était pas polluant." (Alberta)Des provisions pour l'année"Le porc, on le salait. On mangeait du boeuf l'hiver car on le gelait et ce qui restait au printemps, on le mettait en conserve ainsi que le maigre du lard. Quand au gras du lard, on le salait. On mettait les légumes en conserve, les betteraves dans le vinaigre. Les patates se conservaient plus facilement." (Otterburne, Manitoba)
"On faisait boucherie l'automne et on gardait le lard dans le sel, dans des pots de grès ou on le mettait en conserve. On mettait le boeuf dans le grain durant l'hiver et on le mettait en conserve le printemps. Les oeufs étaient gardés dans le sel avec la coquille. J'allais aux bleuets. Pour en avoir pour l'hiver, je les faisais sécher au soleil sur des linges blancs et je les mettais en bouteilles. Pour s'en servir il n'y avait qu'à ajouter un peu d'eau." (Sturgeon Falls, Ontario) "Le menu commun était des grillades salées, des fèves au lard, des prunes sèches. Le premier fruit ou dessert d'un bébé qui commençait à manger, était du jus de prunes. Quand venait le jour de faire du pain, il fallait commencer le soir d'avant, faire tremper le levain, la pâte, etc., pour le boulanger le lendemain matin. C'était des poches de cent livres de farine qu'il fallait manoeu- vrer. Quinze à vingt pains cuits à la fois étaient ensuite mis dans des poches de coton, ensuite dans un récipient en tôle, et mis à la cave pour les protéger des souris et insectes." (Saskatchewan)"Les légumes étaient cultivés sur la ferme. On gardait des poules pour les oeufs. Quant à la viande, l'été on mangeait surtout du lard salé et en canne. L'hiver, c'était du boeuf qu'on mangeait le plus et du gibier. Il y avait aussi un boucher qui passait par les portes une fois par semaine. On achetait en gros la farine, les fèves et le thé. On faisait les confitures à la maison. Aussi.à l'automne, on faisait le beurre pour l'hiver, qu'on entreposait dans une tinette de bois, qui était cirée en dedans... une tinette contenait environ 60 livres de beurre." (River Valley, Ontario) "Nos caves fraîches, n'étant pas chauffées, c'était l'endroit pour conserver les patates et tous les légumes de notre potager. Les choux étaient suspendus par les racines, les oignons en nattes, les carottes et les betteraves recouvertes de sable, les pommes bien enrobées de papier journal et disposées dans des boîtes ou des barils de bois. Le saloir de lard salé avait toujours sa place. Les armoires et les tablettes de la cave étaient bien garnies de conserves de toutes sortes: confitures de fraises, de framboises, de bleuets, de pommes, de prunes, de groseilles, de citronnelles. Les gros pots de grès étaient remplis de marinades et de tomates salées pour la soupe d'hiver. Certains conservaient les oeufs en les recouvrant de gros sel ou d'avoine: les poules ne pondaient pas l'hiver, manque d'éclairage. 11 fallait pas compter sur les légumes frais du magasin car les moyens de les transporter n'existaient pas." (Casselman, Ontario)"En été, nous avions un grand plaisir à faire un grand et beau jardin où tout poussait si bien. Nous faisions beaucoup de conserves: légumes, petits fruits, framboises, myrtilles, airelles, etc., viande d'orignal, de chevreuil et le poisson. Mon mari était bon chasseur de gros gibier: orignal, chevreuil, ours. Mon fils préférait chasser les canards, les outardes, les perdrix et pêcher. Moi, j'aimais aller à la chasse aux lièvres pour soigner les chiens de traîne et les chats." (Chard,Alberta)"Pour conserver les produits laitiers, je les descendais dans une chaudière, dans un grand puits. Je faisais un grand jardin et j'avais ainsi tous les légumes dont on avait besoin. J'élevais beaucoup de volailles, des canards et des oies ainsi que des cochons que je vendais pour avoir un peu d'argent." (St-Joachim, Ontario)"Je faisais du neuf avec du vieux""On n'avait pas beaucoup de vêtements! On s'habillait comme on le pouvait. Je cousais du neuf dans du vieux, pour les enfants. Je me servais des sacs vides de farine et de sucre pour faire des sous-vêtements, des draps de lit et des couvre-oreillers. J'achetais de la laine. Je tricotais des bas pour les enfants. Je tricotais aussi des gilets et des mitaines. J'ai même cardé et filé un peu de laine. J'ai aussi fait des chapeaux de paille avec de la paille de blé. On avait aussi un catalogue. On achetait d'eux, des vêtements non à la mode et ils étaient bien grands. On décousait ces vêtements. Ensuite on se servait de ce matériel pour coudre de nouveaux habits." (Girouxville, Alberta)"Quand nous étions en Saskatchewan, les vêtements, c'étaient vraiment quelque chose... Premièrement... la laine. C'était toute une cérémonie! Mous passions de grandes veillées d'hiver à travailler ensemble. Tous les enfants échiffaient la laine pour enlever les mauvaises herbes et les saletés dedans. Ensuite, papa la cardait. Durant ce temps, maman filait ce qui était déjà prêt d'une session précédente. Le lendemain, elle lavait la laine cardée le soir d'avant, et la plaçait pour la faire sécher; après ça, elle la cardait encore une fois et ensuite elle la filait. Après que tout était prêt, elle tricotait le restant de l'hiver durant des veillées entières. Pour le linge de corps, elle faisait bouillir les sacs de sel, sucre et farine pour les blanchir. Ensuite, elle les teignait... et non pas avec de la teinture commerciale, car je crois que ça n'existait pas. Même si elle eut existé, nous n'avions pas d'argent pour en acheter. Alors, pour des couleurs rose, cardinal et rouge, maman bouillait le matériel dans du jus de betteraves, ajoutant du sel et du vinaigre. Pour les jaunes, tans et bruns... des pelures d'oignons. Pour les bleus.. . du bleu à laver. Ensuite, elle cousait pour la famille. Les sacs à sel servaient pour fabriquer des manteaux, cars ils étaient bien épais." (Port Alberni, Colombie Britannique)"Je faisais du neuf dans du vieux. Les vêtements passaient de l'un à l'autre. Avec les retailles on faisait des couvre-pieds et des tapis Je filais la laine de nos moutons. Les petits gars s'amusaient à la tordre et à la diviser en écheveaux. Ensuite, ils tricotaient les chaussons avec la tricoteuse et moi les mitaines tandis que la laine, pour les douces couvertes de lit, était la spécialité de ma mère. 11 fallait aussi la teindre selon l'usage." (Casselman, Ontario) "Nos vêtements étaient tous faits à la maison. Maman achetait du matériel à la verge en ville, à la Bay ou chez Eaton après qu'elle avait vendu ses fraises et ses framboises. (St-Adolphe, Manitoba) "Ils faisaient leur linge, avec des sacs de farine. Les sacs ça se conser- vaient, puis ils blanchissaient ça, puis ils faisaient du linge avec ça. Parfois quand on allait à des pique-nique, on pouvait voir un petit peu l'écriture Robin Hood, qui était encore un peu imprimé sur le bord lorsque les sacs n'avaient pas bien été blanchis." (Zenon Park, Saskatchewan)
"Pour les vêtements, on faisait presque toujours venir dans le catalogue. Après que j'aie été mariée, on pouvait plus facilement aller à Ottawa. Là, il y avait des magasins et on pouvait acheter du tissu à la verge. Je faisais même les manteaux, les costumes. On habillait les enfants nous autres mêmes; bien souvent avec les pan- talons des hommes, on refaisait des petits habits. On n'était pas orgueilleux comme à présent." (Embrun, Ontario)"Au sujet de l'habillement, on avait un moulin à coudre. Ma mère cousait. On achetait des bas et des sous-vêtements. On se faisait de beaux ta- bliers blancs. On suivait la mode du magasin. J'ai cousu assez mon linge, pas comme une vraie modiste, mais c'était pratique. Le linge propre était acheté." (Otterburne, Manitoba)"Ma mère et mes tantes glanaient la paille de blé après la récolte. Avec ça, elles tressaient les chapeaux pour la famille. Ceux des filles étaient plus beaux; dans les tresses, elles mélangeaient des pailles qu'elles teignaient de couleurs vives puis les gansaient d'une mousseline à pois." (Casselman, Ontario)"Ma belle-mère, comme la majorité des fem- mes, devait se rendre au marché pour vendre les produits de son jardin. Tous les membres de la famille avaient préparé les produits la journée précédente et le lendemain elle se levait vers les 4 heures du matin et on se rendait, à cheval, se trouver une place sur le marché. 11 fallait payer cette place avant d'avoir vendu un seul chou. Elle vendait toute la journée. Certains jours, elle était occupée à en oublier de manger; en d'autres occasions, comme les gens de la ville n'avaient pas d'argent, les journées s'éternisaient. Quelque- fois on retournait le soir avec une moitié de voyage." (Ottawa, Ontario)"Les femmes, on aidait nos maris. On allait traire les vaches. Quand on pouvait laisser la maison, on allait travailler sur les machines. Moi, mes enfants mouraient à mesure alors j'aidais à mon mari. Les femmes qui pouvaient laisser la maison faisaient ça. On élevait tous les veaux, c'était de l'ouvrage ça. On allait à la fromagerie. Les femmes qui étaient libres pour donner du temps, on le faisait." (Debden, Saskatchewan)"Y'avait les enfants, le ménage; y'avait les vaches, les poules, les cochons, les veaux. Y fallait tous travailler ensemble pour survivre. Puis souvent j'allais à la côte donner la main à mon mari avec la pêche. Je m'occupais du jardinage. J'achetions rien que la farine. J'avions notre viande, notre blé, notre bois." (Cap St-Georges, Terre-Neuve)"Je travaillais autant au dehors que dans la maison. C'est moi qui faisais l'employée sur la ferme avec mon mari. Même quand j'ai eu les enfants, dans le temps des gros travaux, mon mari s'occupait de la ferme et je m'occupais pas mal des animaux. J'empilais ma vaisselle du matin au soir, puis le soir après le souper, bien là, je lavais la vaisselle pour une heure de temps, puis mon mari m'aidait." (Ottawa, Ontario)"Mon mari était cuisinier dans les chantiers au nord de River Valley. Quand je me suis mariée, en 1915, il venait d'acheter une petite épicerie. J'ai tenu le magasin de 7 heures du matin jusqu'à tard dans la soirée. 11 fallait scier la viande gelée l'hiver, manoeuvrer les poches de farine, de sucre, les barils de mélasse, en plus de faire un grand jardin pour vendre les légumes." (River Valley, Ontario)"Mon père n'était pas instruit, c'est ma mère qui lui a montré à signer son nom. Il avait fait un cours de couture. Mais c'est maman qui voyait à toutes ses affaires. Elle faisait la tenue de livre Maman c'était le côté intellectuel et spirituel, pis papa c'était le côté pratique." (Rockland, Ontario)"Mon mari décide de se lancer dans une entre- prise de laine. 11 achète l'équipement complet, grosse carde, rouet, métier. Sitôt installé, sitôt en marche. Il s'agit d'avoir des contrats. Je lisais les journaux et j'écrivais à différents endroits. C'est comme ça que j'ai réussi à obtenir un contrat de 100,000 livres de laine pour la Croix-Rouge. Je m'occupais aussi de faire les payes des employés à toutes les semaines, assurance-chômage, compensation, déductions d'impôt en plus des rapports mensuels au ministère du Revenu, comptes à payer, etc. C'était durant la guerre." (Rockland, Ontario)"Elle s'occupait de ce qu'on appelle du train de la grange, ça voulait dire s'occuper des vaches et les traire, les emmener au pâturage, et ça j'ai vu ma mère le faire. Lorsque les enfants étaient très jeunes, elle ne le faisait pas. Lorsque venait le temps de préparer les patates pour les semailles, elle jouait un rôle très important. Elle sauvait les restes de la table pour nourrir les poules et les cochons. Elle a joué un rôle très très important dans la famille, pas seulement comme mère, mais comme chef, leader, parce que souvent mon père n'était pas à la maison, comme je l'ai dit au tout début, il partait très tôt le matin et revenait très tard le soir." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse) "Dans c'temps-là, on allait aider dans le temps des récoltes. Moi-même j'y allais. On allait faire des stookes. Quand les enfants étaient petits, je les emmenais dans une brouette au champs. Je leur emmenais leur petite beurrée de beurre, quelque chose pour les faire manger."
"Les débuts furent modestes. Mon mari abattait les animaux de la ferme: vaches, veaux, cochons. Il débitait ces animaux. Je lui aidais à enlever la peau et à les débiter. J'enveloppais la viande pour la vendre. Nous avons eu dès le début une bonne clientèle. On livrait la viande chez eux. En peu de temps les animaux de la ferme ne suffisant plus à la demande, il fallut en acheter. Il nous fallut construire une remise pour entreposer la viande. Il nous fallait faire notre glace l'hiver. En 1950, l'électricité fut installée chez nous. Donc le travail devenait plus facile. Je commençai à faire du boudin, de la saucisse, de la tête fromagée, des tourtières. Le tout se vendait comme un charme. Les anglais raffolaient de mes tourtières. Nous vendions également de la viande à tourtières. Je gardais des oiseaux de la basse-cour: dindes, oies, canards, poulets. Les dimanches après-midi, nous avions des concours de tir à l'arc dont l'enjeu était une volaille. C'était en même temps une rencontre sociale. Je faisais aussi du savon tiré du gras qui restait après que la boucherie a été faite. Mon savon était très en demande." (Verner, Ontario)"Peu après qu'on soit arrivé, vers la fin de la guerre je crois, mon mari a ouvert un magasin. On a été chanceux car les enfants sont restés avec nous, puis y'ont poussé de l'avant avec leur père. Les enfants donnaient tout leur salaire à la maison pour que la famille puisse survivre et puis on leur donnait chacun 2 piastres par semaine pour leurs dépenses. Dans c'temps-là, y'allaient aux vues pour 35¢ puis y's'achetaient un hamburgpour 10¢. Y'fallait peser le sucre, les pois, puis les pecks de patates. Ça j'en ai pesé. .. tout venait à la livre, fallait le peser nous autres mêmes. Les profits d'une business ne se font pas dans le jour, ça se fait après que le magasin est fermé. Et puis y'faut savoir quoi acheter comme stock. Mon mari allait au marché trois ou quatre fois par semaine pour acheter les végétais puis y'fallait pas en acheter trop parce qu'on voulait les garder toujours frais. Si ça pourrissait, mon mari disait: "Ah, ben c'est ma perte". En tous cas, on en a mangé des bananes à la peau brune, des sandwichs au bananes, du pain aux bananes et puis du gâteau aux bananes... Le monde aime pas ça les acheter parce qu'y'regardent pas ben." (Welland, Ontario)
"L'ouvrage était plus ou moins partagé entre les enfants. Moi j'ai toujours bien haï traire les vaches, alors de temps en temps quand ils étaient pris, j'y allais. J'aimais beaucoup mieux entrer le charbon et le bois et l'eau. J'étais l'avant-dernière. Pour survivre, il fallait que nous aidions tous. Il n'y avait pas beaucoup de machineries dont les trois dernières filles ne savaient pas se servir. Pendant quelques années, nous avions même un tracteur qui tirait trois binders pour couper les récoltes. Les trois filles étaient sur les binders. Après souper, nous retournions tous aux champs pour aider aux hommes à stooker. Je n'ai jamais aimé la ferme, car il y avait trop d'ouvrage sans fin, et tout l'argent qui se faisait semblait toujours retourner sur le maintien des machineries. (Port Alberni, Colombie-Britannique) "Les enfants, on avait tous nos tâches. Le matin, c'était les chambres qui se faisaient avant que l'on parte pour l'école, le lavage ça c'est fait pas mal par les enfants quand on était assez grand, un faisait l'époussetage, l'autre faisait le lavage. Les tâches étaient toujours partagées entre nous et notre mère. Les garçons eux, rentraient le bois." (Pembroke, Ontario)"Quand c'était le temps des semences, le temps de couper et d'entrer le bois, les enfants étaient toujours impliqués dès qu'ils pouvaient aider. En plus du travail domestique, j'allais avec les enfants stooker: pour aider pendant le temps des foins, soit pour conduire le tracteur ou le camion et plus tard pour charger les balots. Au début, j'aidais à manoeu- vrer le foin, puis à pousser le grain dans les graineries. C'était toujours une petite coopérative, tout le monde acceptait le travail, exceptés les plus petits." (Manitoba)"La plus vieille de mes soeurs aidait ma mère dans la maison. Ma soeur et moi, on travaillait dehors sauf pour laver le plancher au lessie deux fois par semaine. Fallait que le plancher soit jaune. Les garçons les plus vieux aidaient mon père au moulin à scie." (ColdLake, Alberta)
"Les enfants, nous autres, on faisait tout ce qu'on pouvait dans le jardin, piocher les patates, mettre de la poudre pour enlever les bébittes sur les patates, sarcler le jardin, charroyer l'eau. Puis dans la maison, c'était la même chose; on faisait tout ce que l'on pouvait faire quand on était jeune: laver la vaisselle, ma mère faisait le pain, le manger, lavait ses patates, des affaires de même." (Pembroke, Ontario)"Je suis allée au couvent trois ou quatre ans. J'ai dû laisser mes études avant l'âge de 12 ans. J'aimais ça mais mon père faisait des chemins avec les chevaux et avait besoin d'une cuisinière pour nourrir les 10 hommes engagés qui vivaient dans les cabooses. La première fois que j'ai fait des tartes, je n'avais pas mis de sucre dedans. Il y avait du raisin mais pas de sucre. Les patates n'avaient pas de sel. J'avais 12 ans." (Otterburne, Manitoba)"Ç'a toujours été notre mère qui faisait beau- coup des tâches dures parce que mon père faisait la pêche et il n'y avait pas de garçons chez nous. Alors quand on avait à traire les vaches, c'est nous autres, les filles, qui y allions. Quand papa avait besoin de quelqu'un parce qu'il devait faire telle chose en charpenterie, bien il fallait y aller, il n'était pas question de dire qu'on va attendre que les gars arrivent de l'école, il n'y en avait pas." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) ET LE MARI, LUI..."Pendant que je faisais la vaisselle, mon mari se berçait et chantait de belles chansons pour les enfants." (Espanola, Ontario) "Quand ma mère est morte, je suis restée avec mon père. Il ne se faisait même pas chauffer de l'eau pour faire du thé. Il n'y avait pas de partage entre les hommes et les femmes. Chez nous il y avait trois femmes: maman, ma tante et ma grand-mère. C'est elles qui faisaient tout." (Ottawa, Ontario) "Quand mon père pouvait, il aidait beaucoup au travail dans la maison parce que ma mère enseignait. Quand mon père était pris pour d'autre travail, nous les enfants, fallait se partager les tâches." (Girouxville, Alberta) "Quand je me suis mariée, mon mari m'a demandé si j'étais pour me lever pour lui faire un déjeuner chaud. Je lui ai dit: "A condition que tu te lèves pour allumer le poêle. Si tu allumes le poêle, quand ça sera chaud je descendrai pour faire le déjeuner, sinon j'descends pas." Il a tellement bien tenu cela que je ne sais pas allumer un poêle. Il s'est toujours occupé de faire tous les travaux qu'un homme peut faire dans la maison..."
 "Les femmes se rassemblaient pour carder la laine, piquer les couvre-lits et bien d'autres travaux étaient faits en équipe. A l'automne, quand les hommes se rassemblaient pour battre le grain, les femmes qui le pouvaient, allaient aider leurs voi- sines à préparer les repas pour les travailleurs, s'occuper de la ferme et faire le train." (River Valley, Ontario)"Ils faisaient des tapis avec des vieux bas, des chandails qu'ils taillaient, qu'ils effilochaient; ils cousaient ça sur des vieux sacs, des poches de patates. Ça ils appelaient ça des tapis à effisures. Y'avaient aussi des tapis tressés, des tapis aussi par guenilles de coton, coupées et hookées." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"Presque toutes les femmes travaillaient aux tapis. Elles travaillaient ensemble. Elles faisaient les fileries, des écharpisseries, c'était plus de plaisir. Elles commençaient à 8 heures du matin à hooker pis elles finissaient à 9 heures le soir. Les enfants étaient confiés aux servantes ou à leurs grandes filles. Les premières, pour teindre la laine, elles allaient à la rivière. Dans le temps du carême, elles commen- çaient à hooker pis elles chantaient toute la messe en latin en commençant la journée tout le temps du carême. Pis avant de partir elles arrêtaient à 10 minutes de 9 heures et elles disaient le grand chapelet." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse) "Il existait une autre peste bien connue dans tous les foyers, c'étaient les punaises. Une poudre se vendait pour les détruire mais il ne semblait pas y avoir de différence jusqu'à l'arrivée du D.D.T. après la guerre. A chaque semaine, il fallait recom- mencer à mettre de la poudre dans les springs des matelas et dans les murs." (Debden, Saskatchewan)
"Quel événement que l'eau haute! Maman se préparait d'avance: gâteaux, beignes, tartes, galettes, pain de ménage s'accumulaient dans des bidons, un autre contenait le lait. Fallait rester au deuxième étage, se chauffer avec un poêle à l'huile à trois brûleurs. L'eau montait partout dans la maison. Quand le vent s'élevait maman nous calmait par la récitation du chapelet. Une année, la porte de devant s'est ouverte par la force du courant. Maman a commencé à avancer dans l'eau à l'aide de chaises puis elle a tout simplement marché jusqu'à la porte qu'elle a clouée avec des clous de 6 pouces. Pour nous, c'était un pique- nique. Quand la glace levait, là fallait prier. Puis les eaux se retiraient, maman lavait les murs au balai. En 1928, l'eau est montée si haute qu'elle a rejoint le linge propre tout plié dans l'armoire. Quand ma mère a pu étendre dehors, on voyait une belle cordée de linge blanc, de broderie, de dentelles destinées à l'empesage et au repas- sage..." (Ste-Anne de Prescott, Ontario)"Pour ma mère, le pire fléau était bien les poux. C'était tellement commun à l'école qu'on finissait bien par en attraper de temps à autre." (River Valley, Ontario)"La vermine ne manquait pas surtout les souris dont on essayait de se débarrasser avec des trappes et du poison. 11 y avait des rats surtout à l'étable et dans les graineries où le grain les attirait. Il était plus difficile de se débarrasser des rats que des souris car on n'osait pas mettre du poison par rapport aux poules. Malgré les chats qu'on avait, on ne pouvait pas s'en débarrasser complètement.' (Otterburne, Manitoba)
"Quand la guerre a pris en '14, au mois de juin, ç'a aidé à mettre plus d'ambition; l'argent roulait mieux; le prix de la terre montait. En 1916, ça faisait 2 ans que la guerre durait, là les prix étaient vraiment remontés. On avait un steer, un boeuf de 2 ans, et bien on l'a vendu $100.00. Mes beaux- parents ne nous croyaient pas. Après la guerre, les affaires ont baissé. L'argent a baissé encore une fois. L'argent n'avait plus de valeur; on vendait les oeufs 6¢ Â la douzaine, les porcs 6 piastres. On avait de l'argent juste pour passer à travers. Après ça la sécheresse est venue, 10 ans après. On faisait rien, le blé on vendait ça une piastre le minot. Les récoltes étaient basses. Les gens du sud eux ont souffert. Ils ont eu de l'aide de la province du Québec pour être capables de manger." (Debden, Saskatchewan)"Il y en a plusieurs qui sont allés à la première guerre. Mon mari n'a pas eu besoin d'y aller, il avait un homestead. Ma soeur était mariée avec un garçon du Maine. Pour s'empê- cher d'aller à la guerre, il est monté ici et a pris un homestead. Les gens qui prenaient des homesteads étaient protégés, ils n'étaient pas obligés d'aller à la guerre." (Debden, Saskatchewan)
"On avait peur parce qu'il y avait presqu'autant de monde qui mourait de la grippe qu'il y en avait de morts à la guerre. On n'avait pas le temps d'ensevelir les morts. C'était bien épouvantable. On les enveloppait dans une couverte et tout de suite on allait les enterrer." (Espanola, Ontario) "Le principal drame de ma vie de jeune fille fut la grippe espagnole. Tout le monde était malade. Nous n'avions aucun traitement de médecin, ni d'hôpitaux. Les écoles et les églises étaient fermées. Personne ne voulait soigner les malades de peur de contracter la maladie. Les femmes enceintes accouchaient avant terme et presque toutes mouraient ainsi que l'enfant. Et même toutes les femmes et les jeunes filles étaient menstruées. M'ayant pas d'aide, on enveloppait les morts dans des couvertures et on les enterrait tout de suite sans service funèbre. Chez nous, nous étions 9 enfants malades, six semaines sans sortir de nos chambres. Mon père faisait le principal des travaux de la ferme seul et ma mère prenait soin de nous, jour et nuit. Le médecin recommandait de nous soigner avec des ponces de gin chaud." (Casselman, Ontario) "J'ai acheté un shack, une maison qui était toute défaite. Je ne pouvais trouver d'autre place. Quand j'ai visité la maison, les cloisons étaient toutes à terre, il ne restait que les 2 par 4. J'avais donné ma notice où je restais, ma maison était déjà louée. Il fallait que j'achète cette maison-là. C'était la Caisse de Ste-Anne. Le gérant m'a dit: "Je vais faire un marché avec vous, je vais vous la laisser à $1500.00. Je vais vous allouer ça à $15.00 par mois sans intérêt." C'était pas cher pour un carré de maison. J'ai signé les papiers sans en parler à mon mari, ni rien." (Ottawa, Ontario)"Sur une ferme on s'arrange toujours avec les vaches, les poules, le jardin. On a survécu. Quand les 10 ans ont été passés, la chance est revenue. Quand la deuxième guerre est venue, c'est devenu prospère." (North Battleford, Saskatchewan)
"J'ai remarqué j'avais raccommodé les panta- lons de mon mari 7 fois, une pièce à côté de l'autre. Ceux qui étaient plus fortunés nous pas- saient le linge de leurs enfants. C'était avec ça que je faisais tout. Pendant deux ans, j'enlevais le linge sur le des des enfants, je le lavais et je leur remettais. C'était la grande dépression. J'ai eu une machine à coudre en 1940. Avant ça j'avais toujours fait ma couture à la main. Mes draps, mes taies d'oreillers, les tabliers, les nappes, le linge de bébé, je faisais tout cela à la main. J'ai lavé à la planche, dans une cuvette jusqu'en 1938." (Ottawa, Ontario)"Le revenus de la famille étaient misérables: 50¢ par jour pour faire une corde bois. Durant la crise, c'était dur. Si on pouvait se garder un porc, récolter des fèves blanches, on préparait de la soupe aux pois avec du lard salé. Pour les légu- mes, patates, carottes, on les cultivait nous- mêmes. On faisait nos conserves pour l'hiver. Mon mari a été malade durant la crise. L'aide sociale nous donnait $2.50 par semaine pour 6 enfants plus mes parents." (Ste-Anne de Prescott, Ontario)"Je prenais du linge qui m'était donné puis je le revirais à l'envers et j'en faisais du linge neuf. Je faisais beaucoup de couture. Je faisais les costumes de ma voisine, elle avait trois garçons. On mangeait beaucoup de baloney. On appe- lait ça le relief steak. On faisait des fèves au lard. Les enfants aimaient beaucoup les fèves au lard. Quand ils arrivaient de l'école, il y avait un bon pain chaud avec de la mélasse ou du sucre brun. On est venu à bout de survivre. Mon mari faisait la chasse. Il trouvait beau- coup de perdrix. On les faisait geler pour l'hiver. On avait un champ; quand il avait son congé, il passait son temps là et moi je le suivais. Il y avait beaucoup plus d'animaux sauvages dans c'temps- là. J'allais avec mon mari faire la trappe." (Espanola, Ontario) "Durant la dépression, le relief nous donnait $18.00 par mois pour une famille de 9. Quand nous sommes déménagés à Périgord, ils ont coupé cela à $9.00. Durant ces temps de dépression et de sécheresse, car nous étions dans le Dust Bowl des prairies, rien ne poussait. Le petit peu qui poussait était mangé par une peste de sauterelles... non pas des sauterelles étendues partout, des sauterelles qui voyageaient en voilier. Peut-être que ça semble bizarre, mais nous les voyions et les entendions venir. C'était comme une nuée. Elles atterrissaient en quelque part, et si il y avait un brin d'herbe, il y en avait une dizaine qui le mangeait. Nous avons aussi eu des army worms, petits vers de trois quarts de pouce de longueur qui mangeaient tout ce qui restait. Au lieu de faire le tour d'une maison, ils grimpaient par dessus. Les murs en étaient recouverts. 11 y en a même qui entraient par les trous des screens. J'en ai encore frayeur... surtout après en avoir trouvés dans mon lit!. . . Vous pouvez alors voir qu'il n'y avait pas grand chose à manger. Je me souviens.. .quand maman faisait les repas, les larmes aux yeux. Deux repas par jour. Il y avait juste une sauce blanche et même pas d'oignon pour mettre dedans. Nous mangions ça avec du pain. Oui, Dieu a eu pitié de nous, car nous avons tous survécu." (Port Alberni, Colombie-Britannique)
"Pendant la sécheresse et la dépression des années '30 et les suivantes, chaque matin le soleil se levait rouge comme une boule de feu. Le vent qui s'était un peu calmé pendant la nuit, reprenait de plus belle vers les 8 heures du matin et charroyait des nuages de poussière qui assombrissaient la clarté du jour. Les automobilistes devaient laisser leurs phares allumés comme pendant la nuit. Souvent, dans les maisons, nous allumions les lampes en plein jour. Peu à peu s'envolait le meilleur du sol emportant les grains de semence et de'sséchant ce qui avait réussi à lever dans les champs. Les animaux étaient contraints à lécher la terre pour rejoindre quelques brins d'herbe, si bien qu'ils mouraient l'estomac rempli de sable." (North Battleford, Saskatchewan) "La grêle, c'a tué les poules, les dindes, les oies. Les animaux avaient de grosses bosses partout sur le dos. La plus grosse misère a été pour ceux qui avaient rien d'avance comme nous autres. L'année d'avant, on avait un petit morceau de terre. Pour le semer, on a acheté des grains, on les avait payés $1.00 le minot; après la récolte, on a vendu notre grain à 25¢ le minot. On avait travaillé pour rien, ça ne se vendait pas. C'était la dépression la dirty thirty. Là, on a laissé pis on s'est enuenu à Cold Lake. (ColdLake.Alberta)
AUGMENTER LE REVENU FAMILIALSANS QUITTER LA FAMILLE..."Je faisais des robes de soirée pour 2 piastres. Dans une semaine je faisais $12.00, des fois $15.00. C'était beaucoup de travail à $2.00 la robe. Je faisais deux bords de robes pour 25¢. (Cornwall, Ontario) "Je vendais des oeufs au chemin à des clients qui, voyant l'annonce s'arrêtaient et aussi à d'au- tres clients réguliers qui venaient même de Détroit. Ceux-ci apportaient souvent du linge pour les petits et je leur servais un lunch. Mon mari élevait 25 à 30 moutons qu'il tondait chaque printemps. La laine était mise dans des gros sacs de jute et envoyée laver à Strathroy. Ensuite, je la vendais aux Américains." (St-Joachim, Ontario)"On pouvait s'engager dans les maisons privées. On avait 3 piastres par mois et on travail- lait fort. Ils nous faisaient laver les murs, laver le linge à la planche. Mon père m'a dit de rester à la maison et de tricoter des chaussons pour vendre. C'était mieux! On vendait aussi des framboises 3¢ la livre. On ramassait 100 livres de framboises par jour avec mes frères et soeurs." (Baker Brook, Nouveau-Brunswick) "Dans le temps de la dépression, les talents de couturière de ma mère lui valurent une mine d'or. Souvent il était deux heures du matin et elle était encore assise à sa machine à coudre. En plus pour subvenir aux besoins de la nombreuse famille, elle prodiguait son temps et ses forces à l'entretien de pensionnaires. Il y en avait toujours au moins deux et durant cinq mois, elle en garda sept." (Ottawa, Ontario)"En 1928-29, y'a commencé à venir les Juifs avec toutes sortes de choses, du linge, de la vaisselle, des couvertes de flanalette. Y passaient dans toutes les maisons. Pis les femmes échan- geaient leurs tapis contre la marchandise. C'était la seule monnaie d'échange, y'avait pas d'argent dans ce temps-là." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"J'ai beaucoup pris des enfants en pension. J'en ai eu de la Société d'Aide à l'Enfance mais je ne les ai pas gardés longtemps. Pour l'argent qu'on nous donnait, ça ne nous aidait pas à survivre et ça demandait trop de travail et d'attention. Donc j'ai laissé. Après j'en ai repris d'autres, quatre petites filles que j'ai gardées durant un an et demi. J'ai été obligée de laisser après un an et demi parce que c'était trop dur. J'étais épuisée. J'avais les trois miens avec ces quatre-là. Quand je suis venus vivre en ville j'ai toujours gardé des pensionnaires." (Ottawa, Ontario)"Afin d'améliorer nos finances, j'avais décidé de faire l'élevage des volailles. Mais comment exécuter mon projet sans argent? Au printemps, une bonne voisine me fit cadeau d'une couvée d'oeufs de dindes. Ce fut un premier succès. A l'automne, je vendis pour $25.00 de dindes, ce qui me permit d'acheter une couveuse artificielle. Je pouvais faire couver quatre cents oeufs à la fois. Mous avions un voisin qui avait une bonne race de poules. Une idée me vint de lui demander s'il ne me fournirait pas les oeufs et nous partagerions les poussins. En remplissant la couveuse deux fois, cela nous donnerait à chacun quatre cents poussins éclos en mars. A l'automne, je fis inspecter mes poulettes, mettant de côté les sujets indésirables qui ne répondaient pas aux exigences du gouvernement. Il me resta cent trentre poulettes de choix. Je fus autorisée à vendre les oeufs au Couvoir où l'on m'offrit un meilleur prix. Dans le voisinage, personne n'avait encore songé à se lancer dans cette nouvelle industrie, mais mon exemple fut bientôt suivi par plusieurs de nos voisins. La satisfaction de réussir m'encou- ragea si bien que j'oubliais un peu nos misères. Les années devenaient meilleures. Nous reprenions un peu d'espoir." (North Battleford, Saskatchewan)
"Pendant la guerre '14-18, ils fournissaient la laine en écheveaux aux femmes qui voulaient tricoter des mitaines pour les soldats. Ça payait $1.25 la douzaine de mitaines. J'ai entraîné les enfants à faire ce travail avec moi. Chacun devait finir sa mitaine avant de se coucher. Je faisais les poignets et finissais le bout et les enfant trico- taient le reste. Souvent je devais rester debout jusqu'à deux heures du matin pour les compléter." (St-Joachim, Ontario)"Je faisais le blanchissage pour les religieu- ses. On me donnait $2.00 le lavage, repassé et reprisé. On ne devait pas manquer une telle occa- sion de se faire un peu d'argent même si ce n'était que pour acheter l'huile à lampe qui servait à s'éclairer et à dépouiller les enfants." (Sturgeon Falls, Ontario)"Ma mère avait son petit commerce, elle éle- vait des dindes. C'est elle qui gérait ça. Avec l'argent, elle aidait mon père pour la nourriture et pour les paiements." (St-Malo, Manitoba)
"A notre arrivée sur le homestead, nous habi- tions une maison bousillée ce qui était typique de ces temps-là. Mon mari devait travailler à gages car les revenus du homestead étaient trop mini- mes. De mon côté, j'envoyais une canisse de crème par semaine que je vendais $1.50 ou $2.00. Je vendais aussi des oeufs 5¢ la douzaine, 60¢ la caisse. J'allais les porter à pied au magasin du village à Spiritwood, à une distance de 7 milles. A notre arrivée, nous avions deux vaches mais nous avons dû en vendre une pour construire le toit de la maison et l'autre pour acheter des provisions. A la longue, on a réussi à avoir d'autres animaux, des volailles et on récoltait les pommes de terre pour l'année." (Debden, Saskatchewan)"En 1925, il ouvrit un magasin à Donnelly où les gens d'alentour s'approvisionnaient. Lorsqu'il était occupé avec l'érection des bâtiments, sa femme voyait à la bonne marche du magasin, y faisait les achats et les ventes, tout en tenant bien les livres." (Donnelly, Alberta)LES FEMMES GARDIENNES DE LA CULTURE"Ma mère est allée au couvent à Montréal. Ça parlait pas acadien. Ma mère voulait pas nous laisser parler comme notre grand-mère. Les soeurs lui avaient fait comprendre que c'était pas du bon français. Maman parlait du beau français. Je crois que c'est de là que vient mon intérêt pour la cause française et la nécessité de trouver de l'argent pour faire étudier nos enfants en français." (Tignish, Ile du Prince Edouard)"Elle a enseigné toutes les prières et le catéchisme à ses enfants. Elle leur a aussi aidé dans les basses classes. Elle leur racontait beaucoup d'histoires qui lui avaient été racontées par sa mère et ses grands-parents. Tous les enfants parlaient très bien leur français et quelques mots d'anglais avant de commencer l'école. Aujourd'hui ils parlent encore leur français." (Port Alberni, Colombie-Britannique)"Je m'occupais des enfants, je leur apprenais à lire et à écrire, je leur chantais des chansons françaises apprises dans mon village natal sur les bords de l'Outaouais." (Ottawa, Ontario)"Souvent c'était la femme qui instruisait les enfants car il n'y avait pas d'école. Moi, j'ai des tantes qui ont montré à lire à leurs enfants avec les annales de Ste-Anne, des livres comme ça." (Moncton, Nouveau-Brunswick)
"Même devenue maman, elle resta institutrice de profession; et c'est ainsi qu'elle fit l'école à ses trois plus vieux, chez elle autour de sa table de cuisine pendant cinq ans. Mais bientôt l'inspecteur d'école en fut informé et lui conseilla d'envoyer ses enfants à l'école du village. Il y avait les bienfaits de l'anglais, de l'association avec d'autres enfants, etc... Et ce fut fait, mais un peu à contre-coeur." (Manitoba) "Je me suis toujours battue pour le français. C'a été inculqué en nous dans la famille: maman et papa étaient québécois, maman ne parlait presque pas l'anglais." (Ottawa, Ontario) "Chez nous, la formation intellectuelle ça comptait parce qu'y traînait des livres partout. Maman lisait toute la nuit. Elle a toujours trouvé l'argent pour nous acheter des livres; on était abonné à "La Semaine de Suzette", la "Revue Moderne". Puis aussi une revue musicale qui venait de France. Mais maman a jamais eu de manteau de fourrure." (Rockland, Ontario) "Sans fierté on n'est personne. Ma mère m'aviont appris d'avoir jamais peur. J'avions toujours été fière d'être française. C'est à l'école qu'y'auiont effacé notre français parce que chez nous j'parlions toujours français. Maintenant les écoles essayiont d'apprendre aux enfants le français mais ij'parliont anglais dans les maisons. Ça va jamais marcher jusqu'à temps que les parents parliont français à la maison." (Tignish, Ile du Prince Edouard)"Très jeunes, je leur montrais leurs prières. Avant de se coucher, je leur disais de dire bonsoir au Bon Dieu. Je leur enseignais ce qui était mal et ce qui était bien, les bonnes manières. Je réalise que je leur enseignais beaucoup plus ce qui était mal que ce qui était bien. Je me suis souvent reprochée ça. Je les ai toujours secondés et encouragés à l'école. Je leur racontais beaucoup d'histoires, pas toujours des histoires religieuses. Je tricotais et les enfants se mettaient autour de moi et je leur racontais des histoires que j'inventais." (Manitoba)"Dans ma famille il y a des talents musicaux et cela remonte à ma mère qui aimait la musique. Elle chantait à l'église et nous chantait des chan- sons. Elle jouait un peu d'accordéon pas pour dire qu'elle était musicienne. Elle nous a appris à jouer des instruments musicaux. Moi, je jouais de la musique à bouche ainsi qu'un de mes frères. Ma mère chantait autour du poêle et on l'accompagnait. Ma mère aimait chanter et raconter des histoires. Ma mère nous montrait nos prières et à lire. Quand j'ai commencé l'école, je savais déjà lire et écrire. Après tout son ouvrage, elle prenait le temps de nous apprendre à lire et à réciter nos prières." (Otterburne, Manitoba)"Ma mère, femme de race, n'aurait jamais toléré que nous parlions l'anglais au foyer ou encore que nous ayions de mauvaises notes en dépit de la mince heure qui nous était accordée. L'unique heure de français par jour, cette heure nous devions la faire profiter au centuple." (Falher,Alberta)
EN L'ABSENCE DU MARI..."J'étais souvent seule, mon mari partant en tournée d'inspection d'écoles parfois 2 ou 3 semaines à la fois. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons, il fallait en acheter une fois par semaine. L'hiver on faisait fondre la glace. Je m'occupais de l'ordinaire: faire les lavages à bras, pomper l'eau du puits, rentrer le bois pour le poêle, faire toute la couture à la lueur de la lampe à l'huile, en plus de soigner ma belle-mère malade." (Ottawa, Ontario) "Quand il y a eu l'accident du bateau qui a explosé à Halifax, mon mari a été envoyé là-bas pour réparer les maisons qui avaient été détruites. Je relevais d'un bébé. J'avais été un mois au lit. Je me suis levée pour qu'il parte. Je me suis trouvée seule avec les enfants pendant 9 mois. Il m'a envoyé de l'argent après un mois. Avant ça j'avais rien. Il me fallait casser mon bois, charroyer l'eau du puits. Heureusement j'avais une voisine qui me visitait chaque jour. Je ne pouvais pas sortir, j'étais malade." (Ottawa, Ontario) "Quand mon père est mort, il avait une petite assurance et puis maman a fait séparer la maison pour en louer une partie. Ça lui faisait un revenu. Elle n'a jamais eu une cenne du gouvernement parce que la maison était payée. Elle faisait toute sa couture, même les pantalons pour les garçons." (Cornwall, Ontario) "Après que mon mari est mort, j'avais 54.17 piastres par mois du gouvernement comme compensation pour les veuves. J'ai retiré $3000.00 d'assurances. Je cousais pour les autres. J'avais une de mes soeurs qui avait ben du linge. Elle me donnait des coats et des robes pour les enfants. Je faisais beaucoup de couture pour mes enfants et pour les autres aussi." (Espanola, Ontario)"A la mort de mon mari en 1927, j'étais un peu découragée. J'avais une fille de mariée, il me restait 11 enfants; j'ai eu une offre pour mes terres et tout ce que j'avais. Je me suis dit si je vends, j'irai vivre en ville et mes filles travailleront dans les restaurants ou ailleurs, ce que je n'aimais pas du tout. J'ai pensé essayer un an, de garder la ferme, ensuite je me déciderais. Nous avons continué à traire les vaches, faire du beurre, on devait se lever à 4 heures le samedi matin pour aller vendre les produits au marché. Les enfants ont grandi, j'ai acheté une ferme pas loin pour un de mes garçon, le deuxième est resté avec moi." (Alberta)"Je suis devenue veuve à 55 ans en 1944. J'ai continué sur la terre 4 ans avec des employés. Je m'occupais de la ferme. Je connaissais toutes les affaires. J'ai grossi la besogne en plus pour être capable de payer mes deux hommes. Après 4 ans, j'étais fatiguée. J'ai déclaré à mes hommes que j'abandonnais." (Debden, Saskatchewan)QUAND LA MERE MOURAIT..."Le 26 juillet 1932, ma grand-mère maternelle mourrait. Nous sommes allés vivre avec mon grand-père. Le 10 août de la même année, ma mère partait pour l'hôpital avec une hernie et revenait dans son cercueil. J'avais 16 ans alors. Fallait prendre la tête de la maisonnée. Ma grand-mère paternelle est donc venue habiter avec nous en novem- bre. Agée de 64 ans, malade, ayant élevé 13 enfants dans de tristes conditions aussi, je l'admire et l'en remercie car sans elle nous aurions été séparés. Puis le 3 janvier 1934, mon père mourait. Ma jeune soeur a regardé dans son portefeuille; il n'y avait que de la monnaie. Le cercueil fut simple et la pierre tombale ne vint que 15 ans plus tard. Mille misères pour obtenir la pension des mères nécessiteuses. Enfin $20.00 par mois et un petit $5.00 additionnel par enfant. Et ce, pour les deux grands-parents et les 7 enfants. L'été, nous allions aux fraises, framboises, bleuets, que nous vendions $1.00 pour 2 gallons et trois quarts. Vers la fin août, nous allions au houblon. On recevait $1.00 pour une boîte de 3 par 3 par 8 pieds remplie de petites caboches destinées à la bière. Avant la rentrée des classes, je prenais cet argent pour l'achat des articles d'école et le linge d'hiver. Peu à peu la maison s'est vidée. Une de mes soeurs est entrée au couvent; les deux autres sont allées travailler au collège de Rigaud où mon frère faisait ses études. L'une d'elle versait $5.00 et l'autre $10.00 par mois pour ses cours." (Ste-Anne de Prescott, Ontario)"Trois de ses frères étaient venus s'établir sur des homesteads à French- ville, Saskatchewan, vers 1912. L'un d'entre eux perdit sa femme, laissant trois jeunes enfants. Etant incapable de prendre soin de sa famille et de cultiver aussi, il demande à sa soeur, si elle pouvait venir aider. C'était une demande presque impossible à refuser, alors sacrifiant sa carrière de garde- malade, elle vint en Saskatchewan." (Saskatchewan)"Le 29 février 1929 fut pour nous une date inoubliable. Ma mère enceinte, dû être transportée d'urgence à l'hôpital de St-Boniface. Mais en vain. Elle mourut sur la table d'opération ainsi que son enfant. Elle avait 41 ans. Moi j'allais avoir mes 19 ans et mon plus jeune frère n'en avait que trois. Comme pour confirmer ce que déjà je désirais faire, une religieuse venue nous visiter me dit en nous quittant: "Il te faudra aider à ton père maintenant". Ce que je fis au meilleur de ma connaissance; sans toutefois demeurer constamment avec la famille pendant les 17 années qui suivirent." (Lorette, Manitoba)"ÇA ME REVOLTAIT, JE M'DISAIS POURQUOI?""Je ne sais pas si je suis née avant mon temps ou quoi. En tout cas, depuis mon adolescence, je n'ai jamais compris pourquoi la femme doit être soumise à l'homme. Je pensais qu'on était deux êtres humains qui devaient marcher ensemble. C'est vrai que dans la famille il devrait y avoir une tête et un coeur et que la femme soit le coeur et l'homme la tête. Selon moi, toutes les décisions qui concernent la famille et les enfants, tout cela devrait être discuté à deux. C'est une vie à deux que l'on fait." (Manitoba)"Je me disais: "Pourquoi? J'aurais continuer mes études. J'ai fait un an de pédagogie. A 17 ans, j'étais pensionnaire à Ottawa. Mais après il était pas question de continuer, j'avais un frère aux études supérieures et un autre qui était prêt a y aller. J'étais heureuse d'enseigner mais j'avais bien de la peine de laisser mes études, à un tel point que quand j'ai fait ma pédagogie chez les Soeurs Grises, j'ai failli entrer au couvent, mon seul but était de continuer à étudier; j'ai pris des cours d'été." (Rockland, Ontario)"Pourquoi célibataire? Parce que j'ai pas rencontré une personne que j'aimais assez. J'ai déjà eu des demandes en mariage. J'étais bien comme ça. Des fois, les femmes mariées me trouvaient bien chanceuse. Laisser son mari ça ne se faisait pas.Y'en a qu'en ont ben arraché. Y a des hommes qui battaient leur femme. Les hommes auraient pas laissé sortir leur femme toute seule, y en avaient des jaloux. Une femme mérite pas de rester avec un homme qui la bat." (Rockland, Ontario)"Les hommes pensaient qu'ils travaillaient plus forts que nous autres. Petite fille, je faisais la même chose qu'un homme dans le champ avec les chevaux. J'aimais mieux cela qu'à la maison. C'était plus d'ouvrage à la maison, faire le ménage et le lavage, laver les planchers sans prélart. Les hommes arrivaient et avaient le temps de se reposer et de dormir un petit som. Il y avait de l'ouvrage des hommes qui n'était pas si dur que celui de la femme. Les femmes pouvaient avoir des opinions mais les hommes ne les prenaient pas toujours. Je me rappelle que ma mère avait souvent des meilleures idées que mon père, suffit que c'était lui qui était le chef, elle le laissait la marier comme il le voulait. La femme était toujours en arrière. Moi aussi c'était pareil, si mon mari disait que c'était de même et que son idée était la meilleure, moi je le laissais faire. 11 ne s'occupait pas de mon idée et prenait la sienne. Je n'étais pas pour me chicaner pour ça. Les hommes n'étaient pas pour demander l'opinion des femmes et la discuter. Mais non, c'était eux autres qui prenaient leurs idées. C'aurait été mieux autrement." (Otterburne, Manitoba)"Je ne suis pas féministe, mais j'admets que j'ai corrigé bien des choses, Exemple: Y'avait des soupers de famille. Les femmes préparaient à souper, elles servaient d'abord les enfants à la première tablée, ensuite à la deuxième, elles servaient les hommes puis y'en restait toujours de la nourriture mais c'était pas mal défraîchi. Si les hommes pis les enfants avaient bien mangé, les femmes se contentaient des restes . . . même des fois on mangeait pas parce qu'on était trop fatigué. Ça, ça me révoltait, mais je ne le disais pas. A la maison, au village, les petits garçons avaient à entrer le bois dans la cave et c'était tout, mais les filles, elles... Je ne me souviens pas de m'être levée de table et de ne pas avoir eu à faire la vaisselle. Les petits garçons s'en allaient jouer. Là, où il y avait une place d'honneur comme servir la messe ou quand Monseigneur venait, c'était mon frère, un vrai diable, qu'était choisi. Nous autres les filles on ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire. Ça me révoltait, je me disais pourquoi? Les autres femmes c'étaient pas comme ça mais moi je me révoltais. Quand les femmes se sont réveillées, j'étais assez heureuse de voir ça. Si j'étais plus jeune, je pousserais." (Rockland, Ontario)PLUS ÇA CHANGE, PLUS C'EST PAREIL"Les différences de rôles c'est beaucoup à l'école que ça se fait. C'est plus grave encore, dans le high school, les orienteurs orientent les gars en scientifique et général, les filles dans le commerce. C'est tous des hommes orienteurs dans les écoles. Il n'y a pas de femme." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "Elles sont encore bonnes femmes de maison, bonnes femmes de ménage, bonnes cuisinières. Elles se valorisent à partir de cela. Puis il y a certaines femmes que ça dérangerait ben gros si à un moment donné le mari se mettait à faire du ménage. Pour elles, ça leur enlèverait leur raison d'être, leur identification." (Shippagan, Nouveau-Brunswick)
"C'est une affaire que ma mère a toujours dit: "Il faut absolument que tu aies un métier". Elle aurait tellement voulu que je fasse ce qu'elle n'a pu faire. Elle avait beaucoup à faire avec ses 10 enfants, mon père l'a toujours empêchée d'aller à des réunions. Je trouvais ça terrible. Elle s'est faite une raison, elle s'évadait dans les livres. Les femmes devaient rester tout le temps à la maison, moi je suis le genre de personne qui aurait aimé aller à la pêche, faire des choses comme ça. Je ne suis pas comme le modèle féminin." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "C'est après que je me suis mariée que j'ai senti qu'il y avait des gens qui attendaient de moi que je fasse des confitures, des conserves, toutes sortes de choses comme ça; puis moi, ça me plaisait pas, ce n'était pas dans moi; je n'étais pas la petite femme modèle, je n'entrais pas dans le moule qu'on voulait m'imposer. Des fois ça me causait des problèmes de culpabilité, j'étais différente des autres. Je suis une originale. J'étais assez forte de caractère pour continuer pareil. Je suis plus intéressée par les choses intellectuelles. Puis je suis restée 10 ans à la maison sans travailler. Quand les enfants étaient petits, je rêvais du jour où j'allais retourner au travail." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "Autrefois, la fille de 18 ans qui se mariait, souvent elle avait travaillé trois ou quatre ans. Tandis que maintenant elles n'ont jamais travaillé. Elles n'ont aucun sens de l'argent. Aucun sens que leur ménage peut tomber, puis qu'est-ce qu'elles feront avec les enfants. Comment elles vont gagner leur vie? Elles s'imaginent encore que les maris vont les faire vivre. Moi j'ai des amies de mon âge qui ont des grandes filles, c'est des teenagers. Elles me disent qu'elles sont vraiment découragées de voir que les ambitions de leurs filles c'est de se marier, que ça se limite là: "pourvu que je puisse avoir un petit travail de secrétaire". Elles sont pas toujours prêtes à s'impliquer." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "J'ai un salaire mais c'est étrange, j'ai quand même gardé l'idée du chef de famille. Je me suis surprise à un moment donné, par exemple, de vouloir aller m'acheter des vêtements, puis de consulter mon mari avant de le faire." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "Si tu n'es pas mariée et que tu n'as pas deux, trois enfants... tu n'es pas la femme modèle. Il y a vraiment une pression sociale qui influence les couples à avoir des enfants." (Pubnico, Nouvelle-Ecosse) "Entre mon travail, la maison, les enfants, le mari, le patron, je me sens tiraillée de tous côtés. Je suis comme une queue de veau. Un pied dans la maison, un pied à la job. Je cours tout le temps. Quand je prends du temps pour moi, j'ai l'impression de le voler ailleurs." (Ottawa, Ontario)
"Quatre enfants, c'est la grande famille main- tenant. Mais on a dépassé le stage où on en aura plus d'enfants. 11 y a eu ce groupe de femmes qui se mariaient et ne voulaient point d'enfant. Main- tenant c'est très rare que tu retrouves ce couple- là. Ils en veulent un, deux. Disons que la tendance est peut-être plus vers trois, avant ça c'était un, deux. Ils arrêtaient là. C'est peut-être la famille idéale trois." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"C'est le milieu familial qui manque. C'est pas facile pour la mère d'aujourd'hui qui travaille, puis qui doit continuer de s'occuper de la maison. C'est un gros travail à faire. Par ici, les enfants se font tous garder dans des familles. Ils vont à leur gardienne, puis ils se plaisent." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)Â "Des enfants? Je ne suis pas prête. Je ne suis pas certaine que je voudrais rester à la maison quand j'aurai des enfants. En réalité, je le sais ce qui arriverait, je pense que je deviendrais folle si je restais à la maison, sans contact avec l'exté- rieur. Il a été question que ce soit lui qui reste à la maison. Ça dépendrait lequel des deux a le meilleur salaire." (St-Vital, Manitoba)"Avoir des dizaines d'enfants ce n'est plus pensable. Aujourd'hui t'en as un ou deux. C'est surtout à cause des finances. Moi, je ne voulais pas avoir des enfants après 30 ans. Je trouvais que ma mère était trop vieille quand elle m'a eue. J'ai toujours connu ma mère vieille. Je ne voulais pas ça pour mes enfants." (Rockland, Ontario)"Moi, je ne voulais pas passer ma vie à élever des enfants. 11 y avait beaucoup trop de choses que je voulais faire." (Plantagenet, Ontario)"A cause de mon travail, je ne pouvais pas avoir plus de deux enfants, Quand j'ai eu mes enfants, j'ai pris un congé de maternité de trois mois. C'est difficile de réveiller le bébé à 6 heures le matin pour aller le porter chez la gardienne." (Ottawa, Ontario)"Les femmes vont hésiter avant de songer au divorce. Il y a quand même un pas à franchir. Je ne sais pas si c'est le côté religieux, c'est que la femme qui se marie, elle ne se marie pas pour divorcer. Il faut dire que dans les villages, elles se font encore montrer du doigt. Il y en a encore qui vont avoir une vie familiale assez pénible, plutôt que de se séparer. Souvent la parenté va essayer de les tenir ensemble." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Je suis vraiment seule. J'ai eu rien qu'un enfant puis elle est mariée et vit aux Etats-Unis. Maintenant, je gagne $128.00 par semaine mais j'ai de la misère à vivre. Si j'étais mariée puis que mon mari avait 65 ans, moi j'pourrais avoir une demi-pension. Mais j'ai un autre dix-douze ans à aller avant que je sois rendue à 65 ans. Je te garantis que mes os vont tous être cassés. Les autres femmes seules sont sur le Welfare. Ça fait une grosse différence d'être mariée pis de pas l'être. Vraiment, si j'avais le courage, j'prendrais un homme-là, n'importe qui pis je le marierais. Mais j'ai pas la patience. Le gouvernement me force à faire ça; j'y pense sérieusement parce que y'a pas de manière que je peux continuer à vivre. Si j'avais pas mon jardin l'été pis la pêche... je pense pas que je vais mourir de faim. C'est pas d'ça que j'ai peur, c'est l'huile, le chauffage, l'élec- tricité." (Tignish, Ile du Prince-Edouard)"La plupart du temps si une séparation arrive c'est parce que l'homme va avoir un vrai problème d'alcoolisme ou d'adultère prononcé. Des cas de même, vraiment saillants ça va arriver très rare- ment. Souvent ça va être des gens qui vont venir à Zenon Park, mais qui viennent de l'extérieur, qui vont se séparer. Mais on les voit pas nous autres. Ils ne resteront pas à Zenon Park, parce que c'est trop fermé, ils ne pourront pas vivre. Ils ne pourront pas respirer. Une jeune femme séparée ici, elle ne pourrait pas vivre. Elle ne serait pas acceptée du tout parce que les gens sont conditionnés à ce que la femme soit mariée. Mais tranquillement, il y a bien des choses qui sont acceptées qui ne l'étaient pas avant." (Zenon Park, Saskatchewan)"Les hommes sont pêcheurs et sont jamais aux alentours. C'est la femme qui a la charge de toute la maison, de tout le budget; l'homme arrive à toutes les deux semaines pour deux ou trois jours. Les femmes de pêcheurs sont souvent seules, elles se mettent ensemble et vont faire les choses ensemble. Ce sont elles qui sont le boss des maisons." (Pubnico, Nouvelle-Ecosse)
"Ici, c'est presque rien que ça, des femmes séparées. Ici, c'est le Winnipeg Régional Housing, c'est le gouvernement, le Low Reniai C'est pas à moi la maison. Si je travaille ils ne prennent qu'un pourcentage pour mon loyer. C'est vraiment moins que ce que je paierais ailleurs. Si je perds mon emploi, ils arrangent mon loyer d'après mes revenus. J'ai pas eu de misère à entrer ici, mais d'habi- tude elles ont de la misère. Moi, ça m'a pris un mois et demi. D'habitude elles attendent 6 mois." (St-Boniface, Manitoba)
"La société voit la séparation et le divorce comme si tu avais eu un échec. Il y a quelques femmes qui sont fortes assez pour dire: "Non, c'est pas un échec de ma vie. C'est une partie de ma vie, maintenant allons vers autre chose." Il y a beaucoup de pressions sociales. Si tu ne fais pas partie d'un couple, tu es à part. Il faut que tu fasses une autre vie sociale, tu te'crées de nouvelles valeurs, puis c'est pas facile." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Quand une femme reste à la maison, elle passe autant de temps dans sa cuisine que sa grand-mère. Le travail est moins dur mais il est aussi long. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appareils ménagers, mais il faut les frotter, les entretenir, les remplir, les vider, les réparer. Faut servir nos robots... Ma grand-mère faisait son ménage de prin- temps et celui de l'automne. Moi, j'en fais à tous les jours, mais c'est facile avec les laveuses et les sécheuses." (Rockland, Ontario)"Du ménage, ma mère en faisait mais moi j'en fais pas. Je trouve qu'on a beaucoup moins de boulot c'est plus facile à cause des machines." (Ottawa, Ontario)"Les heures que nos mères passaient à faire le pain et le beurre, nous il faut le passer au super- marché, à la boucherie. Ça prend du temps aussi pour lire les journaux, la publicité afin de trouver les meilleurs prix." (Plantagenet, Ontario)
DE NOUVELLES RESPONSABILITES QUI REVIENNENT À LA MÈRE"Aujourd'hui avec l'assurance maladie, on passe notre temps chez les pédiatres, dentistes et autres. La société nous pousse à prendre la santé trop au sérieux. Si tes enfants ne vont pas chez le pédiatre deux fois par année, t'es pas bon parent." (Rockland, Ontario) "Avec la télévision, les enfants sont beaucoup plus éveillés et plus exigeants. Ceci signifie des jobbines supplémentaires: faire des fêtes d'enfants car tous les amis en ont... Combien de fois, il faut popoter pour les Jeannettes ou les Scouts..." (Medicine Hat, Alberta) "Chez nous, c'est moi qui fais les travaux de réparation, mon mari n'est pas bricoleur, C'est moi qui peinture, qui tapisse. L'entretien autour de la maison, le jardinage, les plates-bandes, c'est aussi moi qui m'en charge." (Rockland, Ontario) "Le matin, je suis toujours à la course: faire les lunchs des enfants, habiller la petite pour l'amener chez la gardienne. Il faut que je me lève à 6 heures, 6 heures et quart pour réussir à faire tout ça avant de commencer à travailler à 8 heures et demie. En plus, il y a le linge à apporter chez le nettoyeur, les souliers chez le cordonnier..." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Le samedi, je le passe à courailler à l'épicerie, à l'aréna pour mon garçon qui joue au hockey, au ballet-jazz pour ma fille. Le vendredi soir, c'est son cours de natation. Il faut aussi que je les conduise chez le dentiste. C'est aussi moi qui va rencontrer les professeurs à l'école..." (Vancouver, Colombie-Britannique)
PARTAGE DES TACHES DOMESTIQUES ...LA FEMME RESTE EN CHARGE"Mon mari n'aide pas tellement dans les tâches domestiques. Un homme, c'est pas comme une femme, il est plutôt gauche. Un moment donné, il faisait des gâteaux. C'est bien bon mais il ne faisait pas sa vaisselle. Alors, je lui ai dit: "Si tu laves pas la vaisselle, j'aime mieux que tu fasses pas à manger." (St-Malo, Manitoba) "Lorsque moi je travaille à l'extérieur, c'est le premier qui arrive à la maison qui commence le souper. Chez les jeunes couples qui sont allés étudier à l'extérieur y'a des changements à ce niveau-là. Pour ceux qui sont pas sortis de l'Ile, c'est encore comme avant." (Abrams Village, Ile du Prince-Edouard)
"Dans le cas où la femme ne travaille pas, il y a encore beaucoup de tâches ménagères qui sont faites par la femme mais même quand la femme travaille et que le mari fait sa part, il va dire: "J'aide ma femme, je vais faire tes plancher?" Ce sont les planchers de la femme. Ils vont souligner qu'ils aident la femme. Il y a une amélioration, mais il y a encore place pour beaucoup d'amélioration." (Moncton, Nouveau-Brunswick) "Tu peux t'organiser si tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche de sortir le soir même si tu as des enfants. Parce que moi, je dis que ce n'est pas plus à l'un qu'à l'autre. Il faut que tu respectes les idées de ton parte- naire. Moi, je n'ai pas eu de problème parce qu'on est les deux pareils. Mon mari aime ça aussi le travail communautaire. Je n'ai jamais eu de diffi- culté, mais je connais des amies qui iraient à des réunions, mais leur mari ne comprend pas, elles ne peuvent pas se fier à lui." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"Il y a un couple d'amis que je connais où la femme n'a pas fait la vaisselle une fois dans les cinq dernières années. C'est toujours lui, c'est sa tâche de faire la vaisselle. Puis s'occuper du bébé, bien finalement, c'est moitié moitié. Lui doit se lever pour aller travailler à huit heures et demie; il la fait lever à la dernière minute quand il est prêt à s'en aller. Tout le temps que le bébé est réveillé c'est lui qui s'en occupe à ce moment-là. Ça fausse presque le portrait parce que je sais qu'ailleurs ce n'est pas comme ça." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "Je peux dire qu'il partage, mais s'il fait du lavage, c'est pour m'aider, c'est pas son travail; le souper, il va le mettre au feu si la viande est sortie. On en discute beaucoup, il est prêt à accepter mes Idées, mais de là à passer à l'action... Il y a quatre ou cinq ans, si quelqu'un était entré pendant qu'il essuyait la vaisselle, il aurait arrêter, pour être certain que ses amis le voient pas faire la vaisselle. Maintenant c'est changé." (Mont-Carmel, Ile du Prince-Edouard) "Il y a un certain partage mais c'est toujours moi qui suis en charge. Quand il veut faire quelque chose, il me demande: "Qu'est-ce que tu veux que je fasse?" C'est vraiment moi qui organise. Il prend certaines responsabilités mais souvent, il oublie. C'est pas aussi important pour lui que pour moi." (St-Vital, Manitoba)"J'ai de l'aide de mon mari et des plus vieux. Chacun a quelque chose à faire. Le plus vieux, 13 ans, est sérieux, il prend ses responsabilités. C'est pas vraiment compliqué avec les machines auto- matiques." (Tignish, Ile du Prince-Edouard)"Non, mon mari ne m'aide pas beaucoup. Il va aller faire l'épicerie, c'est tout. Je l'ai gâté quand j'étais jeune mariée. Il y a des choses qu'il va faire, mais d'autres non. Il travaille de longues heures, souvent 10 heures par jour. Souvent il travaille le samedi. Moi, je travaille à temps plein depuis trois ans. Le dimanche matin, il fait le déjeuner." (St-Jean, Terre-Neuve) "Le temps que j'travaille pas, c'est ma job les travaux ménagers. Mais quand j'travaille, c'est plus difficile. Même là, j'vois pas mon mari dans la cuisine." (Harper Road, Ile du Prince-Edouard)LES FEMMES COLLABORATRICESIl n'y a pas tellement de femmes qui aident leur mari comme moi. Les femmes qui le font, ce sont plutôt les anglaises. Dans la mentalité des canadiens-français, les femmes sont plus à la maison. Moi, je ne suis pas une femme de business, mais dans les décisions, je dis mon mot. Je n'ai pas de salaire. Tout l'argent va à la même place. Pour l'achat des gros morceaux, on en discute. Nos terres ne sont pas conjointes. Ce sont les terres de ses parents et ça aurait coûte' cher de changer ça. Je gagne quand même une partie, puis j'ai droit à cette partie-là. Lui, il pense que je veux lui en ôter pour partir ou je ne sais pas quoi. J'ai beau lui expliquer que c'est pour la sécurité des enfants, ça lui fait peur. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est un testament. Les hommes considèrent qu'élever les enfants, c'est pas de l'ouvrage ça." (St-Malo, Manitoba)"Chez les jeunes couples, les maris s'occupent des enfants et les femmes ont leur mot à dire dans l'administration de la ferme. Elles ont aussi leur nom sur les papiers du terrain. C'est différent d'avec nous autres. Autrefois, la femme n'était pas consultée pour les décisions importantes sur les fermes." (Sud de la Saskatchewan)"On a ouvert un centre de décoration vers '70. Au début, je travaillais avec mon mari. Il me donnait $25.00 par semaine pour que je puisse payer la gardienne. A ce moment-là, il n'avait pas le droit de payer un salaire à son épouse. Il ne pouvait pas le déduire de son impôt." (Rockland, Ontario)"J'ai une amie dont le mari est dentiste. Elle a une formation en éducation pré-scolaire. Elle a abandonné sa carrière pour l'aider à organiser son bureau au début. Finalement c'est elle qui continue de s'occuper de toute la comptabilité du bureau." (Shippagan, Nouveau-Brunswick)"Moi, je travaille avec mon mari au magasin. Il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients. On apporte avec nous les problèmes de la maison au travail et ceux du travail à la maison. Si je travaillais ailleurs, ça serait plus facile de me détacher de mes problèmes personnels. Un autre problème c'est que je ne peux pas payer d'assurance-chômage. S'il n'y a plus d'ouvrage pour moi au magasin, je me retrouve devant rien." (Rockland, Ontario) "Je me lève à 7 heures moins quart. Je vais traire les vaches. J'aide à mon mari. Et on finit tous les deux ensemble. On rentre à 9 heures, 9 heures et demie le matin. Le soir, on sort vers 6 heures. On trait 40 vaches. Dans le jour, mon mari va soigner les animaux dehors. L'été, c'est le train, matin et soir et ensuite les jardins. Dans le temps des semailles, je lui aide toute la journée dehors, je remplis la semeuse de grains,... Il y a des ouvrages que je fais pas, je suis pas assez forte. Des fois, je conduis les tracteurs quand ça me tente. Il y a des jobs que j'aime, mais comme semer, ça m'énerve. J'ai été élevée sur une terre mais tout ce que je faisais c'est traire les vaches." (St-Malo, Manitoba)
LES FEMMES ET LE MONDE DU TRAVAIL
|
|
|
"Ma mère était une femme de carrière. Moi, j'ai été élevée sans jamais voir maman faire les travaux ménagers ou presque pas. Elle avait ce qu'on appelait communément des servantes. Elle était maîtresse de station du C.N. C'était la seule femme au Canada qui avait un poste de même, dans ce temps-là, c'était inconcevable. C'était en anglais, Station Agent. C'était une grosse responsabilité. Elle a élevé sa famille et elle a toujours maintenu cette position. Elle était spéciale, dans le sens qu'elle n'avait pas plus d'éducation que les gens de son temps, puis que dans ce temps-là, l'école c'était la huitième année, mais elle avait beaucoup d'intelligence. Elle apprenait tout en faisant les choses."
(Bouctouche, Nouveau-Brunswick)
|
|
"Après que le médecin m'a dit que mon mari était sérieusement malade, j'ai commencé à penser à me trouver un emploi. J'avais travaillé à temps partiel à l'atelier de couture avant. J'ai alors appliqué pour le poste de maîtresse de poste et je l'ai eu.
Ce travail a été une expérience inoubliable. J'étais un peu craintive au début. Je me disais: Qu'est-ce que les gens vont dire d'une femme maîtresse de poste? Je vais être capable. Je vais faire mon possible. La première année, j'ai trouvé ça un peu difficile, après ça, c'a bien marché. Les gens étaient plutôt indulgents. Il y en avait qui me disaient, un homme surtout: "Je ne sais pas comment tu as pogné cette job-là, toi? J'aurais jamais pensé qu'ils auraient mis une femme là." Ça m'a un peu surprise. J'ai répondu: "Quoi, je ne fais pas l'ouvrage comme il faut?" Cet homme en particulier me répondit: "C'est pas ça que je disais, mais je peux pas voir comment ça se fait que tu es là."
(St-Pierre-Jolys, Manitoba)
"PARTIR EN AFFAIRES"
|
|
"Pour augmenter le revenu familial, elle décida de réaliser un rêve d'enfance, posséder un magasin. Elle équipa d'abord un coin de sa maison mais plus tard, le magasin fut installé au corner comme elle dit. Son moyen de transport était son cheval et sa voiture...
Elle partait pour la ville de Yarmouth, où elle faisait ses provisions, cela lui prenait environ deux heures, selon les affaires qui l'attendaient. Parfois, elle manquait d'argent pour alimenter son stock, alors elle se décidait d'aller travailler pour faire de l'argent. Il n'était pas rare d'apprendre qu'elle était allée travailler à Boston, au Cap-Breton, pendant deux ou trois mois, et qu'elle revenait chez elle, par exemple, avec une quantité de tissus à 10 cents la verge; "Je revenais avec de grosses valises pleines de stuff,"raconte-t-elle.
Lorsqu'elle partait, elle s'assurait que les enfants étaient entre les bonnes mains de son mari, et aussi les plus vieilles se prêtaient aux soins de la famille."
(Le Courrier, Nouvelle-Ecosse, jeudi, le 22 novembre 1979, p.8)"Elle était une pionnière de San Francisco. Au moment de la ruée vers l'or en Colombie-Britannique, elle vint s'installer à Victoria et pour quelque temps, enseigna à l'école instituée par Monseigneur Demers. En 1859, elle ouvrit sa propre école pour jeunes filles. Une annonce dans la Gazette de Victoria indique: "Madame Pettibeau informs the public that she has opened a seminary for young ladies, on Fort Street, between Government and Broad Street. Lessons given in French music. For terms and references, apply at the school."
(Les Français en Californie, San Francisco, 1884, p.119, Victoria Gazette, le 10 mars 1859)"On est durant la crise. Son mari vient de perdre son emploi comme traducteur. Sans préparation aucune, elle prend la direction du premier hebdomadaire français de Cornwall. Son mari s'occupe de la publicité et de l'aspect financier de l'entreprise. Elle s'occupe de tout le reste, court les nouvelles, rédige les articles, fait la correction d'épreuves. Comme toutes les femmes de toutes les époques, c'est la nécessité d'abord qui la fait sortir de son foyer, puis elle y prend goût. "Je ferai un succès de l'affaire, j'en suis certaine, car ça me plaît beaucoup." Elle y met tout son coeur et ne ménage pas les efforts. Le soin des enfants est alors partagé avec les grands-parents qui habitent l'appartement d'en bas."
(Ottawa, Ontario)
"Elle enseigna deux ans à Carleton puis deux ans au couvent d'Irishtown. Sa carrière d'enseignante ne dura pas longtemps car le salaire minime de $125.00 par année l'amena à abandonner la profession. On était dans les années 1910-15. Elle accepta un poste de téléphoniste à New-Richmond au Québec, mais elle n'y travailla que quelque temps car la pression était trop forte. Elle fut alors engagée comme commis dans un magasin général à Maria. C'est là que se développa son goût d'exercer le métier de marchande. Elle décida donc, en 1933, d'ouvrir son propre commerce et devint ainsi la première marchande francophone à Carnpbellton."
(Campbellton, Nouveau-Brunswick)J'ai vécu grâce aux tapis. Je faisais faire des tapis par des femmes au village. Je dessinais la toile, je fournissais la laine, puis je vendais les tapis à plusieurs endroits au Canada. Je faisais un petit peu d'argent parce que je travaillais dur. J'avais 10% sur les tapis que je faisais faire. Une chance que le banquier me trustait. Je vivais d'avances. J'avançais de l'argent aux femmes. Je dépensais pas, j'avais pas le temps. J'étais toute seule pour faire ma correspondance, mes comptes. Dans l'hiver, des fois, y'avait 200 personnes qui hookaient pour moi."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)
"Je venais des Prairies et je m'ennuyais à Victoria; je rencontre une autre francophone de Winnipeg qui était dans la même situation que moi. A discuter ensemble, l'idée nous vient d'ouvrir un petit commerce. On a pensé à une librairie française parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un magazine français à Victoria. Alors l'idée a grandi comme ça. Chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait de la future librairie. Là, il fallait en parler à nos maris anglophones. Ils nous disent: "Une librairie française... pourquoi pas un librairie tout court... Il n'y aura pas assez de clients pour vous faire vivre. Une librairie anglaise, cela vous permettrait de faire des bénéfices." Mais c'était pas cela que nous voulions. Nous voulions un lieu de rendez-vous pour les Français qui arrivent à Victoria. Mais il fallait quand même que nos maris nous fournissent l'argent. A force de supplications, chacune de notre côté, on a réussi à obtenir l'argent pour commencer et nous avons cherché un local. Moi, je suis partie à Montréal pour faire les achats pendant que mon amie s'est mise à peindre les murs, les étagères, avec des amis qui sont venus nous aider. A mon retour on a fait de la publicité à la radio. On a eu le premier programme en français à la radio anglaise en 1952. L'annonceur expliquait que c'était la librairie française qui avait payé le programme. A chaque soir, il faisait jouer six disques français. Quand on a dû arrêter l'émission parce qu'on n'avait pas assez d'argent, les gens sont venus nous dire: "C'est la première fois qu'on avait de si jolies chansons à la radio, et en français, c'est dommage que vous arrêtiez." Voilà comment a commencé notre librairie."
(Victoria, Colombie-Britannique)

LA CRISE ET LES PROBLEMES QUI EN DECOULENT...
"Durant la grande dépression, plutôt que de renvoyer des employés, nos salaires étaient coupés de 10%. Comme salaire, j'avais $3.50 par semaine. La Compagnie faisait faillite. Une amie m'a dit: "Si tu veux, ils ont besoin de quelqu'un chez Caplan, je pourrais donner ton nom." J'ai dit: "C'est correct. Il faut que je travaille."Je suis entrée chez Caplan en 1935, j'avais 16 ans. Ils devaient me donner $7.00 par semaine, j'en ai eu $8.00. On commençait à travaillera 8 heures le matin, on finissait à 6 heures. On avait une heure pour dîner. Si on était en retard, on était chargé 1¢ pour deux minutes."
(Ottawa, Ontario)"Mon mari a été obligé d'aller casser de la pierre pour gagner des provisions. C'était la dépression. Mon mari est tombé malade; on a fait venir le médecin, puis le médecin a dit: "Plus de cassage de pierre. Tu vas rester dans ton lit." Comme il ne travaillait pas, je n'avais pas d'argent. J'ai dû travailler pour nous autres, pour avoir ce qu'il nous fallait. J'étais obligée. Mon plus vieux avait neuf ans, ma petite fille avait huit ans, j'avais cinq enfants. Je partais le matin, j'allais à la manu- facture de tomates, j'allais faire ma journée; à cinq heures, j'allais au bureau demander ma paie de la journée pour pouvoir acheter des choses pour le lendemain, pour être capable de donner à manger à mes enfants. Puis, je retournais au gouvernement faire le ménage des bureaux jusqu'à neuf heures. A neuf heures, je m'en revenais. C'était mon plus vieux qui gardait la maison. A la manufacture de tomates, je gagnais $1.50 par jour. Plus on en faisait, plus on était payé. Pour le ménage au gouvernement, j'étais payée $40.00 par mois."
(Ottawa, Ontario)"La grande dépression de 1930, c'a été le plus grand drame. C'a été terrible, pas seulement pour nous autres; pour tout le monde, c'était terrible. . . Il paraît qu'il y avait seulement ceux qui travaillaient au gouvernement qui ne perdaient pas leur emploi, puis encore.. . J'ai fait mon cours d'infirmière à l'hôpital St-Vincent; j'ai gradué le 1er mai 1928 puis je me suis mariée le l0 juillet 1929; la dépres- sion a commencé tout de suite après ça. Même les médecins, les internes n'avaient plus d'ouvrage; il n'y avait pas d'ouvrage pour les infirmières. Il n'y avait rien, c'était terrible.
Quand on est arrivé sur notre ferme, c'est là que j'ai travaillé comme garde-pratique. J'allais sur les cas; des cas de maternité, de médecine, mais c'était un cas par-ci par-là. Surtout des cas privés. J'allais à domicile. Sur nos fermes, on avait ce qu'il nous fallait, on gagnait notre subsistance. Le travail d'infirmière, c'était à peu près bénévole. Durant la dépression, les gens n'étaient pas capables de payer. C'étaient des voisins, des parents, des amis, alors je ne leur chargeais pas. J'ai eu quelques cas, des gens à l'aise; je chargeais $3.00 pour 24 heures. Je laissais mon époux avec les enfants, je ne partais jamais pour plusieurs jours. C'est arrivé une fois que je suis partie pour trois jours, il fallait que je fasse mon ouvrage pareil après, à la maison et sur la ferme."
(Ottawa, Ontario)On enseignait à crédit, combien d'institutrices comme moi sont parties, parce que la commission scolaire nous devait 300 à 400 piastres. L'argent ne rentrait pas, les taxes ne rentraient pas; c'est la municipalité qui envoyait l'argent, ça rentrait pas, il n'y avait pas d'argent pour payer les salaires."
(Zenon Park, Saskatchewan)ET AUJOURD'HUI

|
|
"Ici, il y a les femmes de ménage et les hommes de ménage qui font le même travail et les mêmes heures, mais la femme est payée moins. Il y a des tâches qui sont réservées aux hommes. Laver le plancher, ce sont les hommes et le salaire est plus élevé. Comme une des concierges me disait: "Quand il y en a un qui est malade, on les lave, nous autres, les planchers. Donc on est capable de le faire." C'est comme ça qu'ils ont contourné la chose; ils ont défini des tâches et on dit qu'elles demandaient des forces physiques différentes."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"A notre bureau, il y a deux catégories d'emplois; les cadres et les secrétaires. Les femmes sont toutes classées comme des secrétaires, peu importe le travail qu'elles font. Les postes de cadres, ce sont les hommes qui les remplissent. Le travail des femmes est dévalorisé. On leur confie des secteurs considérés comme moins importants. C'est le chauvinisme mâle à son meilleur."
(Edmonton, Alberta)"Je travaille dans un foyer de vieillards depuis trois ans. J'entretiens le linge des résidents. Je fais $5.25 de l'heure. Les hommes qui travaillent avec nous ont un meilleur salaire que nous autres et, en réalité, ils travaillent moins fort."
(St-Jean, Terre-Neuve)'Je travaille de 7h45 le matin à 4 heures l'après- midi. Je travaille depuis 12 ans comme technicienne en laboratoire. Je suis syndiquée. C'est un syndicat composé à 60% de femmes. L'échelle de salaires est la même pour les hommes et pour les femmes, mais, pour les promotions, c'est toujours les hommes qui ont la priorité."
(St-Vital, Manitoba)"Une étude a été faite sur le salaire des femmes professeurs à l'université et les femmes gagnaient moins. Que ce soit pas juste qu'une secrétaire touche peut être moins que le concierge d'un édi- fice, ça, j'étais consciente que c'était parce qu'elle était une femme, mais qu'une femme qui avait fait des études universitaires, qui était professeur à l'université, qui avait les mêmes diplômes, la même expérience..."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Je travaille avec un homme qui est engagé pour faire le même travail que moi. Pourtant, il gagne plus que moi, juste parce que c'est un homme. Et j'en connais plus que lui parce que ça fait plus longtemps que je suis là."
(Edmonton, Alberta)"II y a énormément de discrimination dans les salaires. Par exemple, dans un magasin, une femme qui vend des sweaters d'un côté du magasin et l'homme qui vend des sweathers de l'autre côté du magasin, ils ne font pas le même salaire."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"C'EST PAS SEULEMENT UN PROBLEME DE SALAIRE..."
"C'est très énervant de travailler à l'industrie de couture. Il y a une certaine pression, une vitesse qui pousse beaucoup. Ici, on est à la campagne. Les femmes ne sont pas habituées à travailler sous pression. Au début, il y en a à qui ça faisait peur, surtout les jeunes femmes."
(Zenon Park, Saskatchewan)
"A North Bay, il y a une manufacture de jeans qui emploie des femmes parce que ça coûte pas cher. On les paie à la pièce et lorsqu'elles sont rendues trop bonnes, on les change de machines. Comme ça, elles ne réussissent jamais à augmenter leur salaire."
(North Bay, Ontario)
"Avant on n'avait pas de congé de maternité. Les femmes étaient obligées de prendre leurs journées de maladie. Après avoir pris tes journées de maladie, t'as plus le droit d'être malade. Mais c'est toujours les hommes qui négocient, c'est toujours les hommes qui sont dans les comités. Je pense que les femmes ne se rendent pas compte, elles ne sont peut être pas suffisamment informées, pour se rendre compte que ce sont des choses qu'elles pourraient réclamer. Elles sont majoritaires dans leur syndicat. Je me suis battue comme une chienne enragée pour obtenir le congé de maternité. Les hommes n'étaient pas d'accord. Je disais: "Ce n'est pas pour moi que je veux ça,"
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Il commence à y avoir des femmes qui travaillent dans les mines mais elles n'ont pas le droit d'aller sous terre. Elles occupent surtout des emplois de bureau. Les salaires sont très bons, c'est pour ça que ça intéresse les femmes. Une téléphoniste par exemple, gagne $1100. par mois. Mais comme les hommes n'aiment pas que les femmes empiètent sur leur terrain, ils s'organisent pour leur rendre la vie difficile."
(Elliot Lake, Ontario)|
|
"Je travaille juste en anglais. Mon français ne s'améliore pas. C'est difficile quand tu travailles huit heures par jour en anglais.. .quand t'arrives à la maison et que tu veux parler de ton travail, ce sont les expressions anglaises qui viennent plus facilement."
(St-Vital, Manitoba)"Les usines de poissons, c'est un travail saisonnier. Ça débute au mois d'avril, puis ça se termine en novembre. Dans cette période, les femmes travaillent tous les jours en général. Il y a des journées où ils décident de nous téléphoner et nous dire de ne pas rentrer. Je travaille de 8 heures le matin à 5 heures le soir. Il y a un problème d'humidité. C'est pas tout le monde qui peut travailler là-dedans. 11 y a beaucoup de femmes qui font des allergies. Il y en a qui développent de l'asthme; elles ne peuvent pas respirer l'odeur; ça irrite la gorge puis tu étouffes.
Les patrons demandent qu'on fasse une bonne production mais on n'est pas poussé. On a une union. On est payé 8 heures par jour; si on fait du supplémentaire, on est payé temps et demi. Le salaire régulier pour l'année '80 était de $4.70 de l'heure. Si tu es malade, t'es pas payée."
(Tracadie, Nouveau-Brunswick)"Dans le textile, les conditions de travail sont pénibles. Il y a les horaires de 4 jours. Il faut donc faire 40 heures en 4 jours, 10 heures par jour. Tu es là de 7 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir. En plus, il y a le temps supplémentaire qu'on te demande souvent de faire. Il y a des femmes qui sont là depuis 20 ans et elles ont toujours le salaire minimum. Elles sont payéesà la pièce et quand elles deviennent trop rapides, on les change de place. On peut te mettre à la porte du jour au lendemain. Il n'y a pas de syndicat pour nous protéger."
(Hawkesbury, Ontario)"Chez nous, ils engagent beaucoup de femmes comme professeurs à temps partiel. Ça, c'est une manière évidemment de sauver de l'argent. Elles sont payées à petits salaires. Et ça évite à l'employeur de payer le fond de pension, les assurances, etc. Ces gens-là ne sont pas syndiqués. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans des conditions comme celles-là."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Mous sommes en bas de l'échelle des salaires au Canada. C'est le plus bas salaire pour les enseignants. C'est nous aussi qui avons le moins grand nombre d'élèves par classe. Alors, c'est pas tellement les conditions de travail comme le salaire."
(Bouctouche, Nouveau-Brunswick)C'est encore divisé en rôles dans l'enseigne- ment. Le français et l'histoire, ça c'est pour les femmes. Les mathématiques et les sciences c'est pour les hommes. Moi, j'enseigne les mathémati- ques et le français. Je suis un drôle de numéro. Quand j'ai pris les mathématiques, on m'a presque fait le reproche que le poste était pour un homme. Ça ne me dérangeait pas, quand j'ai commencé; mais quand j'ai eu mon fils, j'avais des remords parfois, parce qu'on me disait: "Ecoute, tu as passé la moitié de la nuit debout avec un enfant qui est malade, comment peux-tu donner une bonne jour- née?" Jusqu'à ce que je me sois mise à regarder autour de moi. Eux autres aussi veillaient tard, à courir et à brosser, puis ils s'en venaient faire la classe le lendemain. Je les entendais dire aux élèves: "Vous allez avoir une période d'étude." Leur tête devait être trop lourde. Ben là, j'ai arrêté de me faire des complexes."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"La femme a toujours été écrasée. On lui a toujours montré qu'elle était inférieure. Ce sont les hommes qui sont directeurs d'affaires. Un bon gérant, c'est un homme, pas une femme. Je me demande si ça nous a pas marquées. Moi-même, ça ne me marquerait pas parce que j'ai du front assez, de l'assurance. Il y a pourtant des preuves qui disent que les femmes sont aussi bonnes."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)
Ce sont surtout des femmes qui travaillent dans les manufactures de textiles mais ce sont des hommes qui occupent les postes de superviseurs. Les hommes et les femmes ont les mêmes salaires pour le même travail mais ce sont toujours les hommes qui ont les promotions."
(Hawkesbury, Ontario)
"ÇA M'LAISSE LE TEMPS DE M'OCCUPER DE LA MAISON..."
"Quand on a besoin de moi au foyer des vieil- lards, on m'appelle. Comme ça, ça me permet de me consacrer entièrement à ma famille tout en restant en contact avec le milieu du travail. Ça me donne la chance d'être créative."
(Rockland, Ontario)
"Quand j'enseignais à plein temps, ça me plai- sait pas. Je travaillais pas pour l'argent, même si on n'est pas riche, mais pour le plaisir. Je me suis Je me suis trouvée un professeur qui voulait faire aussi du temps partiel et on s'est partagé le travail."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)
"Il y a beaucoup de femmes qui travaillent à l'usine, même elles vont préférer travailler à l'usine de poisson que travailler comme secrétaire. Ça paye plus. Elle travaillent seulement d'avril à octobre, puis elles ont fini."
(Shippagan, Nouveau-Brunswick)
"Je n'aurais pas pris un travail à temps plein. Je ne me vois pas travailler à plein temps parce que je trouve que le travail à la maison, c'est déjà du plein temps. J'ai aimé ça sortir pour travailler. J'ai jamais été obligée de sortir travailler pour l'argent. C'était pour changer. Je suis faite pour travailler à la maison. L'histoire du français dans les écoles, ça me touchait très personnellement. C'est pour ça que j'ai pris l'emploi. Et ça m'a fait du bien de sortir à travers le public."
(Harper Road, Ile-du-Prince-Edouard)
"Les femmes, ce qu'elles veulent, ça se comprend, c'est de travailler six semaines pour retirer l'assurance-chômage. Et ça se comprend d'autant plus, qu'il n'y a pas de garderies."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Moi, j'ai besoin de travailler et de faire des choses à l'extérieur de la maison mais quand j'ai eu mes enfants, je suis toujours restée à la maison pour un bout de temps, pour m'occuper de la famille. Il faut que je m'arrange pour que mon travail à l'extérieur ne dérange pas trop la routine de la maison. Présentement, je vends de l'assu- rance. Ça me permet d'organiser mon horaire comme je veux et d'être à la maison quand c'est nécessaire."
(Zenon Park, Saskatchewan)90
|
|
"Ça me tentait de faire ce travail là avec un groupe de maternelle en français. Ça m'amuse. C'est un temps partiel. Ça me donne assez de temps pour mes enfants. C'est pas vraiment une nécessité financière. A temps partiel, j'ai le temps de faire mon ménage."
(Tignish, He-du-Prince-Edouard)"Moi j'ai décidé d'avoir un enfant et je sais que je ne peux pas à la fois bien m'occuper de mon enfant et de la maison et travailler à temps plein. J'ai donc décidé de travailler à temps partiel. Dans l'enseignement, c'est plus facile."
(Medicine Hat, Alberta)|
|
"A cause de leurs responsabilités familiales, souvent les femmes aiment des heures un peu plus libres, des heures plus courtes. On pourrait combler un poste avec deux personnes.
A mon travail, les secrétaires avaient perçu le besoin de travailler juste à temps partiel. Elles se sont organisées: une rentrait le matin, l'autre l'après-midi; mais elles gardaient leurs bénéfices puis elles avaient un meilleur salaire. Si tu travailles la moitié de l'année, tu reçois la moitié d'un salaire annuel, c'est pas comme travailler à temps partiel."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Il y a beaucoup de femmes qui font de la comptabilité. Il y en a qui le font chez elles. Elles font ça peut être deux jours par semaine, la comptabilité pour deux, trois compagnies. Il y a beaucoup de femmes qui sont employées à temps partiel."
(Shippagan, Nouveau-Brunswick)9l
LES TYPES D'EMPLOIS DISPONIBLES: INFIRMIÈRE, CAISSIÈRE, SECRETAIRE...
"Les femmes ont la possibilité de travailler dans les mines maintenant. Mais c'est un monde d'hommes et c'est pas toujours facile pour une femme. Par exemple, il n'y a pas de salles de toilettes pour les femmes. Il faut être vraiment décidé pour travailler dans ces conditions."
(Sudbury, Ontario)
"Le genre de travail que peuvent faire les femmes, c'est dans les maisons pour personnes âgées, comme infirmière ou femme de ménage. Il y a un peu de travail dans les banques ou caisses populaires, mais il n'y a pas d'usine. Ici, c'est un milieu agricole. Les gens vivent très bien sur les fermes. Les femmes n'ont pas besoin de travailler."
(Ponteix, Saskatchewan)
"A Chéticamp, la plus grande affaire pour les femmes, c'est le tapis. On peut pas vivre des tapis, y'a pas assez d'argent pour ça. La Coopérative Artisanale, garde 30% sur les marchan- dises; les femmes sont payées $12.00 le pied. La responsable de la coopérative va dans des expositions et elle prend des commandes. Ensuite, il y a les magasins, les secrétaires, le personnel enseignant. C'est très limité. Il y a les services d'hôpitaux, et le foyer qui emploient 90% de femmes."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)
"A part l'enseignement, il y a un groupe qui travaille dans les projets Canada au Travail, dans le domaine de l'artisanat. Il y a aussi quelques magasins qui engagent des femmes comme commis, les restaurants, l'usine de poissons. C'est une minorité de femmes qui travaillent à l'extérieur. C'est limité par le nombre d'emplois. L'été, il y a un peu plus de travail à cause du tourisme."
(Tignish, lle-du-Prince-Edouard)"Il y a la caisse qui emploie 6 femmes ou même plus, parce qu'il y a trois patrons. Il y a la banque qui emploie quatre ou cinq femmes, puis deux hommes. On a une coiffeuse, on a un barbier, on a les restaurants, qui emploient des dames. Le bureau de poste, l'école, des magasins, qui emploient quelques femmes. Puis l'Institut, j'oubliais notre seule industrie. L'Institut, c'était l'université St-Joseph puis c'est devenu un centre d'éducation d'adultes. Il y a aussi une manufacture qui fait des bouteilles, qui emploie des femmes."
(Memramcook, Nouveau-Brunswick)
"Ici, c'est une ville d'hommes, à cause du pétrole. Les seuls emplois disponibles sont la manufacture de verre où c'est 90% des femmes qui travaillent. Il y a les serres et les centres d'achats. La plupart des femmes travaillent avec leur mari sur la ferme."
(Medicine Hat, Alberta)"Quand on est arrivé à Terre-Neuve en 1960, je ne pouvais pas travailler parce que je ne parlais pas anglais. Maintenant, je travaille dans un foyer pour personnes âgées. Les seuls emplois possibles sont les hôpitaux, les magasins, les bureaux. Il n'y a même pas d'usine."
(St-Jean, Terre-Neuve)
 "Jetions une Jack-of-all-trade.
J'faisions n'importe quoi;
peinturage, décapage, bâtir dehors. Ici, c'est un
winterproject
D'habitude, ça dure un certain nombre de semaines. C'est
la
sorte d'ouvrage que j'pouuions avoir où je travaille
sur un grater
ou sur les patates. Ça dure pas longtemps ça. Ce
travail-ci,
c'est pour 22 semaines après ça.j'avionsun p'tit
check d'assu-
rance-chômage."
"Jetions une Jack-of-all-trade.
J'faisions n'importe quoi;
peinturage, décapage, bâtir dehors. Ici, c'est un
winterproject
D'habitude, ça dure un certain nombre de semaines. C'est
la
sorte d'ouvrage que j'pouuions avoir où je travaille
sur un grater
ou sur les patates. Ça dure pas longtemps ça. Ce
travail-ci,
c'est pour 22 semaines après ça.j'avionsun p'tit
check d'assu-
rance-chômage."
93
"J'aime ça être femme de ménage. J'entre et, quand j'ai fini, je sors, l'argent est là. C'est fatigant parce que tu es toute seule à faire le ménage. Il y a des tas de choses qui me passent dans la tête. C'est assez plaisant, tu fais plaisir au monde. Je suis une personne de même."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)
"A Pubnico, les bonne jobs pour les femmes, ce sont institutrices, garde-malades, les jobs dans la banque et quel- ques offices, les magasins. Le grand emploi des femmes c'est aux usines de poisson, c'est pas des positions...
Ici, on a la boulangerie, la plupart du monde qui travaille là, c'est des femmes. On n'a pas vraiment de manufactures. Il y en a d'autres qui font des couvertures piquées, elles les vendent dans les boutiques autour d'ici, aux touristes."
(Pubnico, Nouvelle-Ecosse)
"Ça fait seulement deux ans et demi que je suis gérante de la caisse. Mon mari a toujours été très impliqué dans le mouvement coopératif. Alors, il était directeur de la caisse populaire, puis le gérant a démissionné, et on m'a demandé de prendre la position."
(Wedgeport, Nouvelle-Ecosse)"Le Centre de Main-d'oeuvre a organisé un stage de formation pour les femmes qui voulaient travailler dans les industries. Il y a maintenant 56 femmes qui travaillent pour la compagnie. Ce sont surtout des anglaises. Les femmes ont les mêmes conditions de travail que les hommes, mêmes salaires, mêmes horaires."
(Labrador City, Terre-Neuve)"Les possibilités d'emplois pour les femmes, c'est tout ce qui concerne les services, travail de restaurant et dans le commerce et aussi les manufactures de textiles et autres petites usines locale. Ces petites manufactures-là engagent majoritairement des femmes. Il n'y a plus beaucoup de débou- chés professionnels pour les femmes."
(Hawkesbury, Ontario)CRÉER SON PROPRE EMPLOI
"Maintenant, les femmes sont en affaires. Il y a même des femmes qui ont leur terre, qui achètent leur terrain. C'est comme en ville, les femmes, maintenant, partent leur propre affaire. Une femme va avoir son propre salon de coiffure, son petit magasin, ou quelque chose qui était impensable autre- fois."
(Zenon Park, Saskatchewan)
"Parmi les choses que j'ai apprises, c'est le fait que les livres de lecture sont trop difficiles pour nos enfants et, au lieu de les intéresser à la lecture, ça les détourne. C'est pour ça que j'ai écrit mes livres pour enfants. J'ai obtenu une subvention qui m'a aidée. L'idée était d'enseigner 4 à 5 mots nouveaux par historiette. Dans mes livres d'enfants, je vise un français correct mais acadien... "
(Saulnierville, Nouvelle-Ecosse)
"La raison pour laquelle on a décidé de partir une revue franco-ontarienne c'était pour entendre parler de nous autres. Nos problèmes sont différents. On a fait une demande de subvention au Secrétariat d'Etat pour avoir trois salaires. C'a été notre façon de se créer une job qui nous intéressait."
(Rockland, Ontario)"Moi, je me suis organisée pour partir ma propre affaire, une agence de voyage. C'est pas toujours facile parce que c'est un monde d'hommes. Il y a beaucoup de compétition et il faut que tu sois fonceuse. Mais quand tu veux vraiment, tu peux réussir."
(Edmonton, Alberta)"L'année dernière, j'ai voulu aller sur le marché du travail. Moi, je suis secrétaire malgré que ça ne me tente pas tellement
d'être renfermée de neuf à cinq. Mais, je voulais aller travailler parce que j'étais à la maison à rien faire. J'ai passé tout l'hiver sans rien trouver. Puis, en février, j'aurais pu avoir un travail de réceptionniste avec un petit salaire. A ce moment, mon mari a proposé qu'on se parte une petite entreprise. On pourrait travailler ensemble et organiser notre travail comme on veut."
On a une entreprise qui nous appartient, dans le domaine des annonces publicitaires. Ça fait un an qu'on en fait. Il a commencé à la maison. Moi, je l'aidais, je faisais les pancartes, le peinturage. C'est la première année qu'il ne pêche pas. Je suis propriétaire de l'entreprise. C'est mon mari qui travaille avec moi. On a mis ça comme ça, pour la simple raison que mon mari veut continuer à pêcher. Maintenant, les lois de la pêche sont sévères. S'il avait un commerce, il ne pourrait pas avoir sa licence pour pêcher. Moi, j'ai toujours travaillé avec mon mari. Quand il faisait seulement de la pêche, je sortais avec lui parce que j'aimais ça, puis pour l'aider. J'aimais démailler, mais je ne nettoyais pas le poisson, j'aimais pas ça, j'ai pris l'habitude de laisser ça à mon mari.
(Tracadie, Nouveau-Brunswick)

"Je travaillais au bureau et puis quand j'avais une grossesse, je lâchais pour une secousse et puis là, il me rappelait pour que je retourne et
c'était toujours le même problème. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Puis là, mon patron m'a dit: "Si tu veux partir une garderie à l'usine, on a l'emplacement, fais ce que tu veux avec." Au début, il m'a laissée organiser ça sur mes heures de travail. Ça marchait et ça profitait pas juste aux femmes de l'usine mais aussi aux autres femmes du village qui travaillaient."
(Zenon Park, Saskatchewan)"Les femmes qui travaillent à l'usine, l'été, font garder leurs enfants par les plus vieux ou par une gardienne ou par une parente."
(Mont-Carmel, Ile-du-Prince-Edouard)
"Ici, la garderie c'est un gros problème, même pour celles qui ne travaillent pas parce qu'il y a des fois, t'as des courses à faire ou tu as envie de sortir, bien c'est impossible. Les gens ne sont pas dispo- nibles pour garder. L'été, c'est quand même plus facile, les étudiantes sont libres."
(Tracadie, Nouveau-Brunswick)
"Quant à moi, les garderies c'est le problème numéro un. Si je travaille, ça peut me coûter jusqu'à $200.00. Là, il y a toutes sortes d'aides du gouver- nement auxquelles tu peux appliquer. Ça prend du temps avant d'avoir une réponse. Ça peut prendre jusqu'à trois mois. Pendant ce temps-là tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu devrais chercher une job.
Il y a une garderie, mais ils ne prennent pas les enfants en bas de deux ans. Les garderies privées ne donnent pas de reçus pour tes impôts et ils n'ont pas de subsides du gouvernement. Il n'y a que les cas spéciaux qu'ils prennent avant deux ans."
(St-Boniface, Manitoba)C'est un gros problème, on peut pas sortir sans les enfants. On peut pas aller à l'épicerie sans les enfants, des fois on dirait qu'on vient assez pris. Et quand on sort sans les enfants ça coûte cher. Là, je me suis adonnée avec une femme dans le bloc ici. J'ai mis une affiche que je voulais me trouver une gardienne: "Just a few hours a week and l'm willing to exchange baby sitting services." Alors cette femme-là, elle a aussi 2 enfants, elle m'a appelée et on va s'arranger ensemble. Quand elle, elle sort, je vais garder et quand moi je sors, elle va garder."
(St-Boniface, Manitoba)"Quand j'ai commencé à travailler à l'usine de poisson, j'avais 31 ans; j'avais cinq enfants à la maison. Il y avait une gardienne qui gardait les plus petits. Quand ma fille arrivait de l'école, à trois heures et demie, c'est elle qui prenait la garde des enfants. C'est elle qui faisait le souper, tout ça."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"Si on voulait résumer les principaux problè- mes rencontrés par les femmes francophones ici dans la région, ce sont les garderies. Je dirais que c'est une priorité. Pour les femmes chefs de famille, c'est un sérieux problème."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Je travaillais le soir à l'Hôtel-Dieu de Campbellton. La plus vieille de me filles et mon mari surveillaient la famille, six enfants. Quand mon aînée est partie pour l'université, j'ai dû changer de travail. Je me suis mise à travailler de jour pendant que les enfants étaient tous à l'école."
(Campbellton, Nouveau-Brunswick)
"On n'a pas de garderie, on n'a même pas de maternelle publique. Avec l'Ile-du-Prince-Edouard, on est les deux seules provinces au Canada, qui n'ont pas de maternelle publique. Il y a plusieurs maternelles, mais il faut payer pour envoyer les enfants.
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"On va avoir des problèmes de garderie long- temps parce que les gouvernements municipaux n'y croient pas. Ils pensent encore que la place de la femme c'est à la maison. Et pour une garderie subventionnée, il faut passer par la municipalité."
(Rockland, Ontario)"Moi, quand je me suis séparée, mes enfants avaient huit et dix ans. J'ai été obligée d'embaucher une servante à plein temps. Elle restait chez moi. Alors ça, ça veut dire de l'argent. C'est pas tout le monde qui peut payer ça avec leur salaire. J'ai été chanceuse. J'en connais qui vont les déposer ailleurs, à tous les matins, elles les habillent. Des fois, c'est la parenté, une grand-mère, une tante, il y'en a beaucoup qui se fient sur des solutions comme cela, faute d'argent et faute de garderie.
Il y a très peu de garderies, il y en a une à Moncton, c'est pour les familles défavorisées."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"QUAND J'TRAVAILLE A L'EXTERIEUR, IL M'AIDE"
"Surtout avec les femmes qui travaillent, le partage des tâches se fait beaucoup plus facilement qu'autrefois. C'est entendu qu'un mari a un peu soin des enfants. Moi, je vois ça maintenant dans toutes les familles que je connais, les pères jouent leur rôle, ils vont changer les bébés, puis ils vont leur donner le biberon. Ce qui ne se faisait pas vraiment autrefois. Moi, où j'étais, ça ne se faisait pas du tout."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)

"De temps en temps, il m'aide, il va passer l'aspirateur dans le salon, quelque chose comme cela. Ça, c'est des petites choses, puis quand il le fait, il pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut toujours que je me batte contre cette mentalité là. Souvent je ne l'accepte pas, ça cause des problè- mes. Puis lui, il se dit toujours, plus il va m'en faire plus je vais sortir. S'il m'aide trop, je vais être embarquée dans trop de choses à part de mon travail. C'est peut être pour ça qu'il a peur de m'aider trop. Ça le fruste un peu que je fasse toutes sortes de choses."
(Zenon Park, Saskatchewan)
|
|
"Quand j'ai commencé à travailler, il s'est vite rendu compte que je ne pouvais pas faire les deux. Après ça, c'était à part égale. Il faisait les lits, passait l'aspirateur, lavait les planchers. C'est venu tout naturellement. Quand j'arrivais, j'avais le droit d'être fatiguée autant que lui. Il faisait à manger, s'occupait des enfants, ç'a été plus facile du fait que sa mère a toujours travaillé. Les enfants ont appris à se débrouiller. Je l'avais un peu gâté après notre mariage. Ç'a été une période de réadaptation pour lui."
(MedicineHat, Alberta)"En réalité, je peux dire que mon mari m'aide, surtout quand je travaille. Au début, je trouvais qu'il ne faisait pas exactement ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Par exemple, j'aurais aimé qu'il passe le vacuum à toutes les deux semaines, mais lui y'avait pas le goût de le faire aussi souvent. Finalement, j'ai réalisé que c'était mes propres attentes que je voulais lui imposer. Alors j'ai arrêté de m'en faire."
(Rockland, Ontario)"Je pense à ma soeur qui a un bébé, c'est peut être une famille acadienne moyenne. Elle travaille, son mari va faire le souper, il va s'occuper de l'enfant autant qu'elle, c'est entendu. C'est ça dans leur milieu à eux. La responsabilité des lessives et la responsabilité d'acheter des draps, d'autres choses, ça c'est relégué aux femmes encore comme autrefois; mais il y a une grosse évolution de ce côté-là. Avant, personne ne voyait dans le village, un homme avec un enfant dans les bras. Changer un enfant de couche, non, ça ne se faisait vraiment pas. Le partage des tâches se fait, mais je ne dirais pas que c'est rendu au niveau idéal. Il y a une amélioration dans la situation."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"C'est sûr que faire le lavage, si j'ai divisé le linge, il va le faire. Mais, c'est pas une chose qu'il aime faire. Moi ça ne me déplaît pas.
Si j'ai une réunion, je ne me pose pas la question à savoir si les devoirs des enfants sont faits ou pas. Je sais que s'ils ne sont pas faits, il va les faire avec eux. Mais, j'ai des voisines dont le mari n'a jamais fait faire les devoirs aux enfants.
Les repas, c'est la même chose. Le midi, c'est lui qui assume ça. C'est quand même pas des grosses choses. Il s'organise aussi bien que moi. H sait que moi, je n'aime pas faire la vaisselle, mais lui ça ne lui déplaît pas. A un moment donné, il peut se lancer à faire la vaisselle, alors que moi, je suis tout simplement en train de lire le journal. La responsabilité du ménage, je croirais que c'est encore moi qui l'ai. Ça ne le dérange pas lui que ce ne soit pas fait."
(Shippagan, Nouveau-Brunswick)
"Moi, je dis que les trois quarts des femmes sont au travail pour une raison financière premiè- rement, mais il y a que moi, je suis plus heureuse à travailler à l'école qu'à rester à faire du ménage à la maison. Ça me satisfait plus. Le travail de maison, je peux le subir, je peux m'en passer aussi, la routine devient tellement abrutissante.. .mais à l'école, je n'ai jamais cette sensation-là. C'est un travail que j'ai toujours aimé, une profession. Avoir des enfants et puis rester à la maison, c'était pas un package deal".
(Bouctouche, Nouveau-Brunswick)
"Je ne suis vraiment pas une femme d'intérieur. Je ne peux pas rester à la maison trop longtemps. Je suis retournée travailler parce que je n'en pouvais plus. Cet automne, j'ai pilé sur mon orgueil. J'ai engagé quelqu'un pour faire mon ménage. Ça m'a vraiment fait mal parce qu'ici, personne ne fait ça. Elles sont toutes à la hauteur. Mais ça m'a fait du bien."
(Zenon Park, Saskatchewan)"Moi, j'ai besoin de sortir de la maison. Quand ça fait un bout de temps que j'ai pas travaillé. Je sens que les murs m'étouffent, je deviens impa- tiente avec les enfants. Ma fille me dit: "Ça va te faire du bien d'aller travailler." C'est qu'elle aussi trouve que je suis plus satisfaite. Je suis valorisée par ce que je fais et ça se reflète sur les enfants. Le temps que je leur donne est plus valable."
(Rockland, Ontario)"Après que les enfants ont commencé l'école, je me suis retrouvée toute seule à la maison. Après que le ménage est fini, qu'est-ce que tu as à faire? J'ai envisagé la possibilité d'aller travailler. Ce n'était pas vraiment des besoins financiers, c'était vraiment pour moi, pour me satisfaire personnellement. Ç'a vraiment fait du bien. Maintenant ça prendrait une autre réadaptation pour me réhabituer à la maison. J'ai mon chèque à moi. Si la facture d'électricité arrive, je vais la payer. Je ne dis pas c'est mon chèque à moi. Ça va tout à la même place."
(Tracadie, Nouveau-Brunswick)"Je pense que je deviendrais folle si je devais rester à la maison. J'ai besoin de rencontrer des gens, de communiquer. C'est pour ça que je con- tinue à travailler."
(St-Vital, Manitoba)POUR DES RAISONS FINANCIÈRES
"J'avais le goût de sortir de la maison, puis c'était pour aidera mon mari. Je feelais que je faisais de l'argent moi aussi. Je faisais mon argent. Je n'avais pas toujours à demander à mon mari de l'argent."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"Ici, il y a un problème de logements. Il y en a peu et ils sont très chers. Il faut que la femme travaille pour arriver à payer la maison."
(Calgary, Alberta)"Quand tu es une femme seule avec un enfant, il n'est même pas question de choix. Il faut que tu travailles. Le problème, c'est de trouver un emploi qui nous permette de vivre convenablement car ça coûte très cher vivre ici."
(Vancouver, Colombie-Britannique)"II faut que je travaille pour gagner ma vie, j'ai deux enfants et je suis chef de famille. De cette façon je peux continuer à m'émanciper. Je ne suis pas allée sur le bien-être social à cause d'une question de principe; c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux gagner ma vie."
(Rockland, Ontario)"Les femmes qui travaillent aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'elles en ont réellement besoin."
(Pubnico, Nouvelle-Ecosse)"Ma mère n'a pas eu le choix. Elle était institutrice. Quand on a commencé à venir au monde, elle a été obligée de rester à la maison parce qu'on se suivait toutes, puis mon père était absent du lundi matin au vendredi soir. Elle était prise avec nous autres, jusqu'au moment où on était d'âge scolaire; elle a décidé de retourner faire de la suppléance, c'était une façon pour elle d'amener plus d'argent au foyer."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)TRAVAIL A LA MAISON... OU TRAVAIL REMUNERE?
"J'ai enseigné après que j'étais mariée. On a eu deux enfants, moi, je me sentais pas capable de faire les deux. J'aurais été insatisfaite de ce que je faisais à la maison et insatisfaite de ce que je faisais sur le marché du travail. Moi, c'a pas été un problème, j'ai choisi de rester à la maison."
(Bathrust, Nouveau-Brunswick)"Je sens que je devrais retourner aux études, pour me satisfaire moi-même, même me remettre à l'enseignement. Je me demande vraiment si je retournerais à l'enseignement. En même temps, je sens que j'aurais quelque chose à cultiver dans ce sens-là, j'aime bien les enfants, j'aime travailler avec les enfants, j'aime apprendre. J'ai bien aimé l'enseignement avant mon mariage. J'ai enseigné pendant 8 ans. Et parfois, il me semble que la société me donne l'idée que parce que je reste à la maison, je suis paresseuse. Quelqu'un va dire tu ne travailles pas. Je trouve que dans le moment, ma responsabilité est ici. Pour moi, ça me satisfait." (St-Boniface, Manitoba)

"Maman n'a jamais accepté que j'aie continué à travailler après que j'aie eu les enfants. Elle était toujours restée à la maison. Elle était toujours là. Je me suis sentie coupable bien des années à cause de ça. Maman me donnait ce sentiment de culpabilité. Je regarde mes filles aujourd'hui. Elle sont épanouies aussi bien que n'importe quel autre enfant, je me dis c'est pas la quantité de temps que je leur donne, c'est la qualité."
(Caraquet, Nouveau-Brunswick)"J'hésite entre travailler à l'extérieur à plein temps et rester à la maison. J'ai juste un enfant, je sais que j'en n'aurai pas d'autre. J'ai un sentiment de culpabilité quand je le laisse trop longtemps. Je trouve que je devrais lui donner une bonne par- tance. Quand il sera un peu plus vieux, ce sera plus facile."
(MedicineHat,Alberta)"J'ai jamais laissé la maison parce que pour moi, les enfants ont des besoins. C'est important. Ça fait 15 ans que je suis mariée, puis c'est la première job que je prends. Quand tu fais du bénévolat, tu peux plus ou moins jouer avec ça. Mais quand tu travailles à plein temps, il faut que tu sois là. Puis la tension est différente. Puis la mentalité des gens a changé aussi. Avant la femme qui travaillait était presque pointée du doigt. C'est plus comme ça. Ç'a évolué un grand bout."
(Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)
POUR AIDER...LES SOLDATS, LES MALADES, LES NÉCESSITEUX.
"Je suis devenue membre de la Fédération des femmes canadiennes-françaises durant le temps de la guerre. Alors, c'était pour aider. On tricotait pour envoyer des chaussons aux soldats. Le premier but de la Fédération a été d'aider. Aider aux femmes dont les maris étaient partis en guerre."
(Ottawa, Ontario)
"En 1938, elle organisa le club des Bonnes Amies. Le but était d'organiser des cours d'artisanat, mais aussi de venir en aide à une jeune fille paralysée depuis 19 ans. Par leur travail, elles ont réussi à payer 6 mois d'hôpital pour la malade."
(Legal, Alberta)
"Ç'a jamais été une femme qui a travaillé en dehors. Elle allait où il y avait des gens dans le besoin. Pendant les deux guerres, elle a tricoté. Elle en a fait du linge pour tous et chacun. Elle s'est toujours occupée."
(Pembroke, Ontario)
"En 1926, un groupe de cinq jeunes femmes désireuses de contribuer au bien-être de la jeunesse féminine ont fondé les Bonnes Amies, dont le but était de regrouper les jeunes filles francophones de la ville pour leur fournir l'occasion de se connaître et de s'occuper, d'une façon générale, d'oeuvres sociales et patriotiques."
(Morinville, Alberta)
"Durant la guerre de '14-'18, j'ai travaillé comme aide- bénévole pour soulager les malades de la grippe espagnole. Nous allions chercher de la nourriture à l'Hôtel de Ville, rue Elgin, durant le jour. Le soir nous confectionnions des layettes et des vêtements pour les familles éprouvées."
(Ottawa, Ontario)
"Dès mon mariage en 1947, j'ai été une per- sonne très active dans le bénévolat. J'ai adhéré à plusieurs mouvements, entre autres la Ste-Eli- zabeth, la St-Vincent de Paul. Maman aussi en faisait partie. On allait deux fois par semaine faire de la couture. J'ai aussi donné énormément de mon temps à la Ligue de la Jeunesse Féminine. Ça c'était pour chausser les enfants. Ma maison a souvent été transformée en atelier de travail. J'avais des femmes qui venaient tailler et coudre pour le coin de Noël. On donnait aux enfants des tricots, des tuques, des mitaines, des écharpes et des sou- liers.
Quand on a ouvert la maison de retraite fermée à Overbrook, on avait demandé à la FFCF d'organiser une kermesse pour aider les religieuses. On a vendu des pâtisseries. J'ai aidé à recruter des personnes pour les retraites; je suis allée à la campagne voir des curés pour organiser des re- traites pour que ça rapporte un peu d'argent aux religieuses.
Ma mère et ma grand-mère étaient comme ça, on a toujours aidé aux familles pauvres. On n'aimait pas à voir souffrir personne. Mon bénévolat, je l'ai jamais fait pour la gloire."
(Ottawa, Ontario)"Elle fut la première gérante de la Caisse populaire de St-Norbert, du mois de septembre 1942 jusqu'au mois de mars 1947. Elle faisait ce travail chez elle et cela bénévolement. Le temps qu'elle mit à recueillir de l'argent pour le Manitoba Health Care était aussi donné de bon coeur.
Elle devint ensuite présidente de l'Association des Institutrices de langue française en 1944. Son énergie indomptable trouvait toujours quelque bien à faire. Durant la guerre de 1939 à 1945, elle forma un groupe de Dames Canadiennes-Françaises à St-Norbert afin d'aider l'oeuvre de secours à la France. Elle corrigea bénévolement les examens français de l'Association de l'Education durant les vacances pendant plusieurs années, même après s'être retirée de l'enseignement."
(St-Norbert, Manitoba)"A l'âge de 5 ans, son fils fut atteint d'épilepsie. Vers 1935, les attaques se répétaient si fréquem- ment qu'on dû le retirer de l'école. Après de nom- breuses recherches à travers le Canada, elle cons- tata qu'il n'y avait aucun hôpital ou maison de santé qui avait les facilités nécessaires pour soigner son fils. L'échec de ses recherches l'amena à constater que bien d'autres parents avaient à envi- sager le même problème qu'elle.
Elle décida alors d'ouvrir une maison pour répondre à ce besoin. Sa première préoccupation était de trouver un logis convenable qui pourrait accommoder les malades. En vendant sa maison à l'Ile-des-Chênes, elle put acheter une autre maison plus adéquate. Le 15 août 1939, elle déménagea dans sa nouvelle demeure qu'elle nomma "Hôpital Youville."
Un mois après l'ouverture de l'Hôpital Youville, les premiers patients épileptiques furent transférés de St-Boniface à Transcona. L'année suivante, elle offrait l'hospitalité aux enfants dépourvus menta- lement et physiquement. C'est avec amour qu'elle se dévoua entièrement aux soins de ceux qui étaient souvent négligés par la société."
(Transcona, Manitoba)"Etant plus disponible que beaucoup de dames du village et poussée par ce besoin d'aider les autres, elle accepta de rendre service à plusieurs communautés religieuses. Elle servit de taxi aux Chanoinesses des Cinq-Plaies qui, à la descente du train à Somerset, devaient se rendre à St-Léon, situé sept milles plus loin et à Notre-Dame de Lourdes qui se trouvait à 14 milles de la station. Elle accompagnait de porte en porte les Soeurs Franciscaines qui venaient tous les deux ans vendre le linge fabriqué par leurs élèves, vente qui leur permettait de soutenir leurs oeuvres. Il y avait aussi les Soeurs de la Charité de l'orphelinat de St-Norbert, qui devaient faire une quête dans les paroisses manitobaines pour les aider à soutenir l'oeuvre qu'on appelait 'la crèche'. Et c'était encore elle qui les hébergeait et faisait la tournée avec elles."
(Somerset, Manitoba)

"ÇA REPONDAIT A MES BESOINS..."
"J'ai fait beaucoup pour la Fédération, mais ça m'a rapporté beaucoup aussi. Mon but dans la Fédération, après mon épanouissement, c'était la langue. J'avais perdu mon mari depuis 3 ans, je vivais juste pour mes enfants. Un moment donné, il a fallu que je sorte de la maison. Je pouvais pas aller dans des party parce que j'étais seule. Il n'y avait pes un homme qui pouvait me regarder sans que je parte à pleurer. Il fallait que je fasse quelque chose. Mes soeurs faisaient partie de la Fédération à Ottawa. Elles me racontaient ce qu'elles faisaient. Je les trouvais donc chanceuses. Ici à Rockland, il y avait absolument rien. Il y avait seulement que le Catholic Women's League. Je me trouvais traître à ma langue quand j'allais là. J'ai été acceptée comme membre de la Fédération à Ottawa. L'aumônier m'a dit que je pourrais avoir un groupe à Rockland. J'ai été élue présidente sans que je m'en aperçoive. J'étais au courant de rien, je savais pas comment ça marchait. J'ai été présidente six ou sept ans. Tout mon temps libre, je le consacrais à la FFCF."
(Rockland, Ontario)"Vers l'âge de 30 ans, j'ai été présidente des Dames de Ste-Anne. A ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai été m'impliquée là-dedans. Je trou- vais que ça ne se passait pas comme j'aurais voulu. J'étais une femme pour essayer de corriger ce que je déplorais. Je me suis impliquée et je suis devenue présidente. Je n'ai pas changé grand chose. J'ai appris à mieux connaître les autres. C'était un besoin aussi de sortir du foyer parce que quand tu es sur la ferme et que tu as de jeunes enfants, tu es toujours là, à la même tâche, aux mêmes travaux, avec les mêmes personnes, tu sens un besoin à un moment donné de rencontrer d'autres personnes, de discuter de tes problèmes, parler de ta famille, parler de tes enfants. Tu sais que d'autres vont te comprendre si elles sont dans la même situation."
(St-Pierre-Jolys, Manitoba)|
|
Â
"Le peu d'argent qui rentrait à la maison devait toujours servir à l'achat et à la réparation des machines agricoles. Il n'y avait jamais d'argent pour acheter des vêtements, faire les grands ménages. Il fallait toujours attendre. J'avais entendu parler de caisses populaires et je pensais qu'on pouvait nous aussi s'organiser pour faire fructifier notre argent. Comme j'étais une femme, je savais que j'aurais de la misère à faire valoir mon idée. J'ai décidé d'en parler à Monsieur le Curé, qui, la première fois ne m'a pas encouragée. Je suis revenue à la charge en lui disant: si vous ne voulez pas d'une caisse populaire pour la paroisse, je vais en organiser une pour les Dames de Ste-Anne. Ça l'a convaincu. J'ai fait venir de la documentation. Je me suis mise à rencontrer des gens pour leur expliquer le mouvement. Finalement, l'idée a fait son chemin, et quelques mois plus tard, notre caisse paroissiale était inaugurée."
(North Battleford, Saskatchewan)
"Il faut dire que ma mère était une femme active, puis il y avait des voisines qui trouvaient qu'elle était trotteuse, parce qu'elle aimait aller à des réunions. Mais ça, ça l'avait jamais dérangée. Mon père disait "Si ça te fait du bien, vas-y". Puis quand elle allait à ses réunions, elle disait aux voisines, je vais prendre mes remèdes."
(Moncton, Nouveau-Brunswick)"Au début, elle allait dans les associations par intérêt, parce que lorsqu'on est en affaire, il faut aller partout. Par la suite, elle s'impliqua davantage pour modifier les orientations des associations. Elle s'est battue à poings fermés pour que la Fédération offre des livres aux élèves plutôt que les traditionnelles médailles, comme prix de fin d'année. Au moment de la guerre, lorsqu'on fait appel aux services des femmes, elle regroupe tout son monde et forme un cercle de tricot. Plutôt que de perdre leur temps en conversations inutiles, elle suggère aux femmes de lire chacune un livre et d'en faire le résumé au cercle de tricot. Par la suite, elle mettra sur pied plusieurs cercles de la Société d'étude et de conférences."
(Ottawa, Ontario)"J'ai appartenu à la Société d'Agriculture, mais n'ai jamais été dans l'exécutif. On s'occupait d'amener des produits aux expositions. Ça, j'aimais cela. J'ai fait cela pendant plusieurs années. J'ame- nais des pâtisseries, des tapis nattés, des produits de la ferme, mais pas de linge. Je gagnais le plus souvent avec mes pâtisseries et mes légumes."
(Otterburne, Manitoba)"Je travaillais comme couturière chez Eaton. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas qu'il y avait des Canadiens-français. Comme passe-temps, j'ai joint des organisations anglaises comme Little Theater, Kiwanis, Upper Society. Je n'avais pas rencontré de Canadiens-français avant '45 à peu près. Par hasard, une de mes compagnes de travail m'a dit qu'il y avait une veillée de Canadiens- français et j'y suis allée. C'est là, que j'ai rencontré un Docteur Robinson, qui m'a demandé si j'étais intéressée à partir une troupe de théâtre. J'ai hésité parce que j'avais à m'occuper de ma famille. Mes filles allaient encore à l'école. Finalement, je me suis laissée persuader. Je croyais vraiment que le théâtre et la musique étaient les moyens les plus efficaces de maintenir notre langue et notre culture dans l'Ouest du Canada. La troupe a été organisée en 1946. On a donné notre première production en juin à la St-Jean-Baptiste. Ç'a été le début de mes activités avec le théâtre français à Vancouver."
(Vancouver, Colombie-Britannique)
"Je prenais aussi une part active dans les orga- nisations de notre nouvelle paroisse, surtout en ce qui regardait notre vie nationale. Je fus secrétaire- trésorière de l'Association catholique franco-cana- dienne pendant 10 ans. En soutenant ce groupe, nous avons ainsi obtenu une paroisse française dans la ville."
(North Battleford, Saskatchewan)
"Sa situation de mère de famille ne l'empêcha pas de se dévouer pour sa communauté. Lorsque elle-même et d'autres parents sentirent le besoin de s'unir pour s'informer, veiller et défendre les droits des écoles françaises, elle n'hésita pas à travailler à la mise sur pied d'un groupe Parents et Maîtres à Lorette."
(Lorette, Manitoba)"Je suis devenue présidente des Parents et Maîtres quand les enfants ont commencé à aller à l'école. Le mouvement existait mais toujours en tirant vers l'anglais. Quand je suis devenue prési- dente, c'est devenu bilingue. Pour avoir du français, il fallait qu'il y ait de l'anglais aussi, il fallait faire des compromis."
(Cold Lake,Alberta)"L'heure était angoissante au Manitoba: la grande lutte des écoles catholiques, d'où l'enseignement du français est banni durait encore. Monseigneur Langevin fait appel au dévouement bénévole des jeunes filles pour aller enseigner une année dans les écoles des campagnes environnantes. Répondant au désir de son Pasteur, elle s'engage dans la carrière d'institutrice pour deux années, avec sa soeur. Elle exercera son dévouement à Letellier, déployant un zèle infatigable méritant d'autant plus d'éloges qu'il n'était pas rétribué. Ses deux années terminées, elle continuera d'enseigner et ce sera à St-Charles."
(Manitoba)"Je me suis battue, j'ai lutté pour que mes enfants apprennent le français à l'école. Dans les années '50, on était cinq ou six familles françaises à Tignish, des grosses familles. On a obtenu du gouvernement qu'il paie notre institutrice fran- çaise pour les trois premières classes parce que mes enfants pouvaient pas parler anglais quand ils ont commencé l'école. On avait à peu près 20 à 25 élèves. Tous mes enfants ont passé à travers ça et ça marchait bien. Et puis, on l'aperdue parce que les parents voulaient pas se battre, j'étais toute seule."
(Tignish, Ile-du-Prince-Edouard)"Comme nos jeunes enfants étaient de plus en plus anglicisés, nous avons senti le besoin de mettre sur pied une maternelle. Une dame a accepté d'enseigner la maternelle dans sa maison et de refranciser nos enfants. Puis la Fédération des femmes a été créée afin d'obtenir des fonds pour le fonctionnement de la maternelle. Mous avons toujours dirigé nos efforts vers le fait français dans la région."
(Windsor, Ontario)"Les buts premiers de la FFCF consistaient à appuyer les parents d'Ottawa qui s'opposaient au Règlement 17 dans les écoles. Après on s'en est détaché un peu pour le côté social, pour intéresser le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est attaché à sa langue."
(Rockland, Ontario)"En 1929, on a décidé de former une asso- ciation des "Dames et Demoiselles de langue française de la Colombie". On trouvait que, puisque nous étions une petite minorité, c'était important de se regrouper. C'était une bonne occasion pour moi de rencontrer d'autres femmes francophones. Nous avons demandé une charte à Victoria et nous avons été enregistrées "Les Dames et Demoiselles de Langue Française". Mous avons formé un petit groupe dramatique et nous avons joué trois pièces de langue française à Maillairdville. Mous avions nos assemblées deux fois par mois. Mous avons eu des repas du bon vieux temps avec une bonne assistance, des bonnes tourtières, des ragoûts de pattes de cochon et puis on a toujours eu du plaisir à se rencontrer. Mous avons aussi formé un choeur de chant."
(Vancouver, Colombie-Britannique)

BRAS DROIT DES PRETRES...
"Elle dépensa beaucoup d'énergie dans les organisations qui existaient alors dans la paroisse de la Nativité de Somerset. Elle fut très active pendant plusieurs années au sein de la confrérie des Dames de Ste-Anne. Plus tard, lorsque cette organisation cessa d'exister, elle continua à soutenir la paroisse en organisant des parties de cartes et des bazars comme moyens de prélèvement de fonds. De plus, elle lavait et empesait les surplis du prêtre et des enfants de choeur et raccommodait les soutanes. Elle prépara plusieurs fois devant sa maison, le reposoir de la Fête-Dieu. Lors de fêtes religieuses dans la paroisse, elle ne compta jamais son temps pour préparer les décorations d'autel, souvent avec des fleurs de son jardin et des drapeaux qui rehaussaient le parcours des processions."
(Somerset, Manitoba)

"La Société des Dames de l'autel fut l'instrument principal qui permit de ramasser les $18,000 à $20,000 nécessaires à l'amélioration de la paroisse. Elles ont été le bras droit du curé dans le financement d'entreprises paroissiales."
(St-Joachim, Ontario)
"Le but de l'association des Dames de Ste-Anne était de s'assembler pour prier ensemble. Le dimanche, on avait une bannière pour les processions. On avait des assemblées avec le curé qui parlait à toutes les femmes mariées, prêchant la morale et nous demandant d'être soumise à nos maris, nous disant comment élever nos enfants. Il n'y avait pas tellement d'échanges d'idées. On écoutait. On avait aussi de grandes retraites."
(Otterburne, Manitoba)"Le curé m'a fait demander, il m'a demandés! je lâcherais ma couture pour aller travailler pour lui au presbytère, lui faire sa nourriture. J'ai travaillé un an au grand presbytère de la Nativité. Il fallait toujours que j'aie des mets spéciaux, je faisais tout moi-même. C'était une maison de 15 appartements. Au bout d'un an, j'étais rendue à bout. Je ne pouvais plus coudre, j'avais trop d'ouvrage. Encore du bénévolat."
(Cornwall, Ontario)"En 1921, elle arrive à Edmonton où, sans tarder elle met ses magnifiques talents artistiques à large contribution. Pendant 47 ans, elle cumule bénévolement les fonctions d'organiste et de maître de chapelle aux églises de l'Immaculée Conception et de Maria Goretti. Les professeurs de l'école Sacré-Coeur bénéficient de son savoir-faire lors des exercices de chant religieux et profane pour la préparation de fêtes et de concerts scolaires."
(Edmonton, Alberta)"Ma mère avait enseigné le catéchisme pour la première communion une année. Il y avait 17 enfants qui venaient chez nous tous les jours. Moi, j'avais fait ma première communion et j'étais confirmée, je n'avais pas besoin d'apprendre le caté- chisme, elle nous l'avait enseigné elle-même. J'avais 12-13 ans dans ce temps-là, j'avais soin des autres petits pendant qu'elle leur enseignait le catéchisme. Elle a fait du bénévolat tout le temps de sa vie."
(Pembroke, Ontario)"Le prêtre comptait beaucoup dans la paroisse et dans notre vie. On a toujours travaillé avec lui. Il nous visitait souvent. On s'occupait de tout. On chantait la messe. J'ai accompagné à l'église longtemps même si ce n'était pas de meilleure qualité. Nos voisins étaient de bons chanteurs. Ainsi, on n'entendait pas les défauts de l'accompagnatrice."
(Otterburne, Manitoba)"Comme il n'y avait pas de paroisse, les femmes du village se sont mise à organiser des soupers-paniers, des pique- niques, des rafles, pour défrayer la construction d'une église. Quand le prêtre venait dans la paroisse, les femmes le rece- vaient toutes à tour de rôle. En 1935, quand la paroisse eut un prêtre résidant, les femmes se sont remises à ramasser des fonds pour construire un presbytère."
(River Valley, Ontario)"Chez nous, la Fédération des femmes canadiennes-fran- çaises a été formée spécialement pour aider à bâtir l'église."
(Cornwall, Ontario)"Comme ils vivent à six milles de l'église, on obtient d'avoir la messe une fois par mois dans l'école. Enceinte d'un troisième enfant, une des femmes trouve le temps de montrer aux autres à faire des fleurs pour l'autel. Elle aide au bazar paroissial et participe aux séances. Elle organise le Mois de Marie, chez elle et fonde une chorale pour jeunes filles. Jusqu'à 75 personnes assistent au Mois de Marie."
(Ottawa, Ontario)"Je m'occupais de la sacristie, du lavage et du repassage des surplis. Monsieur le Curé demandait qu'ils soient bien craqués. Je faisais aussi de la broderie sur les nappes d'autel et les singulons pour les prêtres."
(Sturgeon Falls, Ontario)"Elle se fit un nom à St-Louis de Kent par le fait qu'elle était sage-femme et guérisseuse. Comme à l'époque ( 1850-1900) il était très difficile d'avoir un médecin, les gens se rendaient chez elle, ou elle allait chez les gens pour les soigner et les guérir. Ses médicaments étaient un mélange d'herbages et de tisanes. De plus, elle faisait des expériences avec plusieurs sortes d'herbages. C'est comme ça qu'elle découvrit un médicament qui détruisait le cancer de la pipe, mieux connu sous le nom de mauvais mal. Les gens venaient de partout pour se faire brûler le mauvais mal. "
(St-Louis de Kent, Nouveau-Brunswick)
"Elle soignait le mal de gorge avec de l'iode ou du vinaigre chaud sur une flanelle. Une fois, elle a replacé la jambe cassée d'un garçon et il n'est pas resté infirme. Elle a sauvé de la mort certaine deux bébés qui avaient une pneumonie. Elle a utilisé de l'huile électrique chaude avec des oignons tranchés, dans des sacs de flanelle chauds."
(River Valley, Ontario)
|
|
"Tout au cours de sa vie, elle se porta aux soins des malades. Tellement qu'on l'avait sur- nommée DocteurRatico. A un moment donné, toute une famille était atteinte d'une maladie contagieuse et avait été mise en quarantaine. Seule, elle allait leur porter secours. Elle faisait elle-même ses médicaments. L'été, elle cueillait de l'herbe à dinde pour faire une tisane qui servait à faire baisser la fièvre. Elle cueillait aussi de la belle Angélique qu'elle utilisait pour soigner les crampes des bébés.
(Sturgeon Falls, Ontario)|
|
"Y'avait pas de médecin, mais y'avait des vieilles qui soignaient avec toutes sortes de remèdes qu'elles faisaient. Moi, j'avais un panari à un doigt, j'faisais rien que brailler. La vieille m'a soignée et elle m'a guérie. J'ai juste perdu l'ongle. Une autre femme en a eu un, pis le docteur lui a coupé le doigt. On avait souvent ça à travailler à la morue pis dans la laine."
(Cap St-Georges, Terre-Neuve)"Ma grand-mère était le médecin du groupe. L'été, elle ramassait de l'herbe à dinde pour la fièvre, puis pour le rhumatisme. L'écorce d'épinette rouge servait à laver et guérir les plaies, le souffre et le saindoux pour les plaies coulantes. Elle faisait une tisane qui éclaircissait le sang et, à chaque printemps, c'était la grande purgation. Elle accou- chait les mères, et surveillait pendant 40 jours leur montée de lait, soignant les abcès aux seins ou les hémorragies, toujours avec des médicaments qu'elle faisait."
(Casselman, Ontario)"Que de vies elle a sauvées par ses bons soins au temps de la grippe espagnole après la guerre de '14-'18. On l'appelait et, tout de suite, elle s'y rendait. Souvent toute la famille était au lit. Alors, elle faisait tout, préparant les repas et oubliant qu'elle pouvait elle-même contracter la maladie. Ses remèdes, un peu de boisson, des briques réchauffées sur le poêle, enveloppées dans de la laine et placées aux côtés du malade.
Souvent aussi, on allait la chercher pour assister les mourantes afin de les préparer pour le grand départ, puis les ensevelir après leur mort, donc les laver, les habiller dans la toilette réservée pour ce moment."
(St-Joachim, Ontario)"Pour guérir une pneumonie, on prend un morceau de butin, de la flanelle rouge ou blanche, on met dessus des oignons qu'on a fait fricasser dans un peu d'huile et on met un autre morceau de flanelle dessus. Tu mets ça chaud et tu changes tout le temps, ta pneumonie viendra mieux. Pour le rhume, tu mets de l'huile, du gingembre, des oignons, de la mélasse et une miette de poivre; tu fais bouillir et tu manges ça. C'est bon pour le rhume. Pour une blessure, tu mets une feuille de plantain dessus."
(Wedgeport, Nouvelle-Ecosse)J'avais seulement 16 ans quand je suis allée soigner des voisins. Les oreillons, on soignait ça avec du vinaigre chaud, on mettait ça sur la gorge avec une flanelle. Le Hong Kong Flu quand j'avais eu cette grosse grippe-là, maman m'avait fait cuire des oignons dans la cendre puis elle m'avait mis ça en-dessous des pieds pour faire baisser la température. Quand quelqu'un faisait des clous, on soignait avec une sorte d'onguent qui se faisait avec du savon fait à la maison puis du sucre brun. On mettait ça sur le pied, ça faisait sortir l'infection."
(Ottawa, Ontario)"Pour le rhume, maman mélangeait du sirop avec de la glycérine et 25¢ de créosote et du miel. Quand elle faisait sa recette, elle allait en porter à des familles pauvres.
Quand un enfant faisait du faux croup, pour faire de l'humidité dans la chambre, on mettait un bol rempli d'eau sur un meuble et un autre à terre, l'eau descendait d'un bol à l'autre par une serviette qui trempait dans les deux bols."
(Ottawa, Ontario)

"ELLE A MISÂ PLUS DE MILLE ENFANTS AU MONDE..."
"Elle prêtait main-forte aux voisins qui étaient dans le besoin. Elle a agi comme sage-femme en mettant au monde plusieurs enfants de l'arrondissement. Après l'accouchement, elle passait une dizaine de jours à relever la maman et à donner le bain au nouveau-né, tout en s'occupant des repas pour le reste de la famille."
(Hanmer, Ontario)
"Maman a mis plus de 1000 enfants au monde. Elle ensevelissait les morts aussi. Dans c'temps-là, les femmes ensevelissaient les femmes et les hommes le faisaient pour les hommes."
(Cap St-Georges, Terre-Neuve)
|
|
|
"Ma mère était sage-femme. Après l'accouchement, s'il le fallait, elle prenait soin de la mère et du bébé pour 3 à 4 jours. S'il y avait des complications, elle retournait pendant 40 jours faire la toilette du bébé et soigner la mère. On avait aussi recours à elle pour les grands malades." (Casselman, Ontario)"Elle soigna toutes sortes de maladies, des os cassés à la pneumonie, des brûlures aux accouchements. Sage-femme fut sa principale occupation. Plus de 3000 enfants ont vu le jour grâce à elle." (Caraquet, Nouveau-Brunswick)"A ce moment-là, les femmes ne recevaient aucune anesthésie. C'était vraiment la méthode naturelle. La sage- femme demeurait près de l'accouchée et la guidait dans sa respiration. Elle lui épongeait le front, lui lavait et lui essuyait le visage, l'encourageait par des paroles douces et charitables, lui aidait même à prier Dieu dans ce moment difficile de sa vie. Après la naissance, elle voyait à laver l'enfant et le vêtir. Avant de partir, elle s'assurait que sa patiente avait mangé un peu de soupe peur reprendre ses forces. Tous les jours, pendant les 10 jours qui suivaient un accouchement, elle se rendait chez la nouvelle maman pour l'aider à faire sa toilette et donner le bain à l'enfant. Il fallait attendre 10 jours pour se lever afin de ne pas précipiter une hémorragie car il n'existait aucun remède pour faire cailler le sang. (Somerset, Manitoba)
UN ROLE D'APPUI EN POLITIQUE?"Son intérêt pour l'éducation ne se limita pas à sa famille. Elle s'impliqua comme commissaire d'école pour la division scolaire Barkam pendant 18 ans et comme secrétaire de la même division pendant 21 ans. C'est avec plaisir qu'elle hébergeait les institutrices avec qui elle aimait partager ses expériences. Elle assistait religieusement à toutes les réunions du comité exécutif du Manitoba Trustees Association malgré les tâches qui lui incombaient en tant que mère de famille et fermière." (St-Norbert, Manitoba)"Je me suis occupée de campagnes politiques pour le fait français au municipal. J'ai travaillé aussi au provincial et au fédéral. Pour les élections des conseillers scolaires, j'ai fait des téléphones." (Ottawa, Ontario)"Vers 1900, elle se fit un nom parmi les institu- teurs et institutrices du temps et fut élue vice- présidente de leur Association. A une grande convention, le président devait prononcer un discours très important mais à la dernière minute, c'est elle qui doit assumer la tâche. Elle devait naturellement improviser, mais elle le fit si bien qu'elle fut félicitée par toute l'assistance ainsi que par les autorités religieuses et les journaux du temps." (Manitoba)"Quand c'était le temps des élections, si mon père était libéral, ma mère n'aurait pas jugé bien de voter pour l'autre parti parce que d'après mon père, si ça se produisait, c'était aussi bien que tu ne votes pas, parce que tu éliminais le vote, alors tous les .deux devaient voter pour la même couleur." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse)"J'ai été active dans les femmes libérales toute ma vie. Ça m'a toujours intéressée. Je tenais ça de mon père. J'ai travaillé pour tous les ministres qui sont venus à Ottawa. Tous ceux qui étaient libéraux. A la mairie aussi, j'ai travaillé. J'étais demandée pour m'occuper des dames. Comme présidente de l'Association des femmes libérales, c'est moi qui engageais les dames, qui leur donnais leur ouvrage." (Ottawa, Ontario)"Je me disais, comme j'ai un magasin, il faut que je sois amie avec les deux partis, les libéraux et les conservateurs. On me disait que les tories étaient des gens qui travaillaient pour les riches, alors j'ai décidé de voter libéral. J'ai fait de la cabale pour eux. Ils voulaient que je découvre qui voterait pour qui. Et pour mes efforts j'avais reçu une laveuse. En ce temps-là, c'était des laveuses à bras en bois. J'étais heureuse de ça." (Butte des Comeau, Nouvelle-Ecosse, extrait de "Le Courrier", jeudi le 22 novembre 1979, p. 8)"Les femmes avaient leurs idées en politique. Quand on a eu le droit de vote, moi, je disais a mon mari: "Vote pour qui tu voudras." Puis des fois, je votais de la même manière que la sienne. Il y a des femmes qui disaient qu'elles votaient de la même manière que leur mari. Moi, j'aimais m'occuper de mes affaires. A chaque fois que quelqu'un entrait en la politique, j'avais mon idée." (Otterburne, Manitoba)LES RELIGIEUSES: MISSIONNAIRES,INSTITUTRICES, INFIRMIERES...
"C'était en 1916, année funeste pour les Canadiens-français car on enleva le français dans les écoles manitobaines. C'est à ce moment-là, que nous arrivâmes du Québec, et elle fut ma première maîtresse. Elle enseigna l'anglais, mais tous les autres cours étaient en français. Elle ne tolérait pas d'anglicisme et stimulait notre attachement à la culture française. Elle était présente à toutes les organisations paroissiales toujours prête à déployer son dévouement et son savoir-faire." (Manitoba)"J'ai débuté à l'école de Wetaskiwin comme directrice, tout en distribuant l'enseignement aux élèves des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e années, pendant trois ans. Transférée à Edmonton en 1925, j'ai enseigné à l'école Sacré-Coeur. Il s'agissait d'ensei- gner la belle langue française, mais sans nuire à l'enseignement de l'anglais. Pour soutenir l'intérêt des jeunes, il me vint à l'idée d'inventer des jeux pour chacune des règles de grammaire: c'était la pêche, la chasse, le postillon, le jeu de croquet, la balle au champ, etc...La Bonne Chanson ne manqua pas d'apporter sa note d'agrément. Enfin, les livres de la bibliothèque charmaient les petits Albertains qui en découvraient les beautés. Les professeurs bilingues de la province, s'intéressèrent à mes méthodes et me demandèrent de partager mes trouvailles avec eux. C'est ainsi que, pendant deux étés, j'enseignai à l'Université de l'Alberta ainsi qu'au Collège St-Jean." (Edmonton, Alberta)"La Colombie-Britannique a eu la chance d'avoir les religieuses de Ste-Anne, qui ont joué un rôle important dans la colonisation de la province. Elles ont soigné les malades et pris en charge l'éducation. A la demande de Monseigneur Demers, elles quittèrent Lachine le 14 avril 1858, passèrent par le canal de Panama et débarquèrent à Victoria le 5 juin 1858. Elles organisèrent des orphelinats, des écoles et des missions un peu partout en Colombie-Britannique." (Colombie-Britannique)
"Pour ces jeunes qui seraient d'âge de voter à 18 ans, il fallait une formation de longue main, un intérêt au civisme de longue haleine. Alors, nous assistions, mes élèves et moi, chaque année, à la session parlementaire puis aux séances munici- pales. En classe, nous avions ensuite nos sessions parlementaires; nous passions des lois, nous les amendions, etc.. . tout se faisait en bonne procé- dure. La justice avait sa part de procès, de jury, de témoins, de juges, il va sans dire. Préalablement, j'invitais des hommes du métier pour nous dégour- dir et répondre à nos "qui, comment, pourquoi". Puis l'application suivait et portait des fruits." (Edmonton, Alberta)"Missionnaires auprès des Indiens, institutrices dans nos écoles, cuisinières hors ligne, officières d'emploi, supérieures toujours à la corvée pour sauvegarder le bien familial, infirmières, surveillan- tes de récréation, toutes peinent au dur labeur. Tâche obscure parfois, lorsqu'il s'agissait de pour- voir la maisonnée d'eau potable, en faisant chaque soir la provision du lendemain à l'aide d'un gros baril. Puis, il y avait le bois de chauffage à entrer, la fournaise à chauffer, la préparation des menus qui dépendaient souvent de la charité des gens. Sans oublier les grands jardins d'autrefois, dont la pro- duction de légumes aidait au cannage pour l'année." (Manitoba)ET AUJOURD'HUI
FEMMES... ET FRANCOPHONES.."Etre minoritaire, c'est un certain avantage. On dirait qu'on a plus de courage pour se battre; on est plus consciente de nos lacunes dans nos droits de femmes. Parce qu'ici, au Nouveau- Brunswick, chaque fois que les femmes se sont réveillées, c'était des francophones. A Moncton, ce sont les femmes francophones qui se sont battues pour avoir des réunions provinciales. On n'aurait pas de Conseil Consultatif si c'avait pas été des femmes francophones." (Moncton, Nouveau-Brunswick)Dans l'temps, on nous disait que c'était une fierté d'être Canadienne-française tandis qu'au- jourd'hui, ça ne prend plus. Il faut qu'on apprenne aux enfants que si on veut se développer, il faut en apprendre le plus possible. Moi, si j'étais proche de la ville, j'apprendrais une troisième langue." (St-Denis, Saskatchewan)"Quand je me suis retrouvée veuve, j'étais à Edmonton. J'étais seule. J'avais besoin de rencon- trer des gens parce que je me sentais très insécure. Je voulais me joindre à un groupe. Je trouvais plus facile de me retrouver avec des femmes. Je me sentais plus à l'aise. Je voulais aussi que ce soit des francophones parce qu'elles me compren- draient mieux." (Cold Lake, Alberta)"Nous sommes plus politisées parce que nous autres, on est obligé de lutter sur deux plans à la fois en tant que femme et en tant que franco- phone. En tant que francophone, on a déjà à se battre pour obtenir ce qu'on veut. Puis en tant que femme aussi. On est doublement politisé." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Ici, ce sont les femmes qui ont vu à ce que notre école secondaire soit déclarée française par notre Conseil Scolaire. Ce sont aussi les femmes qui ont fait des pressions pour que notre école secondaire soit agrandie. Ce sont les femmes qui sont les chiens de garde pour que le français ait sa place dans notre ville." (Rockland, Ontario) "Je trouve que les associations de franco- phones ne font pas assez de place aux femmes. En général, ce sont les hommes qui sont dans les postes de direction. Je ne sais pas pourquoi." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Nous autres, nos priorités, c'est de s'assurer qu'on ait plus de français dans les écoles, être sûr que nos enfants soient bien. Notre but est de faire retrouver les coutumes anciennes; c'est surtout faire revivre les chants, promouvoir la culture acadienne, les danses, tout ce qui regarde la culture." (Pubnico, Nouvelle-Ecosse)"Je continue encore à me battre pour la franco- phonie. C'est important d'avoir les deux langues. Mais, quand je vais dans un congrès bilingue à Frédéricton, avec des féministes anglophones, j'en- rage parce qu'il faut que je parle anglais pour qu'elles me comprennent. J'essaie de leur expliquer que je subis la même domination qu'elles, de la part des hommes. Je me sens comme si le patron me pinçait les fesses." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Nous autres, la raison pour laquelle on a décidé d'être francophone comme association, c'est qu'on s'est dit qu'une femme chef de famille, qui a des problèmes, elle est émotivement toute à l'envers. Elle a besoin de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Déjà elle a un handicap psychologique, si en plus, on lui impose le handicap de parler dans une langue seconde, elle ne pourra pas vraiment s'exprimer et dire ce qu'elle a dans le fond d'elle- même." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Ce qui est important pour nous toutes, c'est de se regrouper comme femmes francophones, de pouvoir parler en français. Mais on n'a pas toutes les mêmes intérêts et les mêmes besoins. Les femmes qui travaillent ont besoin du support des autres femmes professionnelles, culturellement différentes de la majorité et qui essaient de faire carrière dans le milieu qu'elles ont choisi. Pour les femmes qui ont déjeunes enfants, le besoin, c'est que leurs enfants puissent jouer avec d'autres petits francophones ou encore d'échanger des gar- diennes. C'est pour ça que c'est difficile de se struc- turer, de décider ce qu'on va faire. Pour moi, mon identification comme femme est prioritaire à celle d'être francophone. Ce serait idéal pour moi de faire partie de ce groupe si, être femme est primor- dial et cela, en français." (Vancouver, Colombie-Britannique) "J'ai toujours oeuvré du côté des femmes et du côté nationaliste. Je me suis plus orientée vers les femmes parce que j'ai réalisé qu'il y avait là un besoin. En fin de compte on reléguait nos tâches aux hommes. C'est comme dans une association bilingue, on finit par parler anglais. Je sentais qu'au sein des associations mixtes, la même chose se produisait. Nous les femmes, on finissait par ne pas s'exprimer parce que ce n'était pas toujours bien vu de dire notre opinion. Alors, j'ai préféré aller oeuvrer avec les Dames d'Acadie. Les objectifs étaient d'encourager les femmes à jouer un rôle plus actif dans la société, d'apprendre à se valoriser, à se présenter à des postes." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"L'an dernier, on a organisé une Journée de la Femme, et c'a marché. Soixante-cinq femmes y ont participé. Alors, on s'est réuni, toutes les femmes qui avaient travaillé à cette journée-là et on s'est dit que ça valait la peine de s'organiser pour avoir d'autres activités semblables. Les femmes qui avaient participé à la journée étaient intéressées à avoir d'autres choses. C'est à partir de ça que l'association s'est formée. Notre but, c'est de desservir les Acadiennes francophones de l'Ile. Je me demande si on ne fait pas compétition au Women's Instituts. Mais nous autres, franco- phones, on a des besoins qu'elles, anglophones, n'ont pas." (Mont-Carmel, Ile-du-Prince-Edouard) "J'ai réalisé qu'il y avait un besoin de s'extério- riser chez les femmes. C'était le temps de former une association féminine. Au début, on voulait s'associer au Richelieu, devenir l'aile féminine. Mais eux, ils n'étaient pas intéressés. Dans le fond, ce fut un bonne chose. Nous avons volé de nos propres ailes. En '68, le premier cercle des Dames d'Acadie fut fondé. Notre but était de promouvoir les droits de la femme et les droits des francophones." (Campbellton, Nouveau-Brunswick) "ÇA FAIT DU BIEN DE SORTIR DE LA MAISON""Avant que je me marie, j'avais une équipe de folklore. Après, j'ai fait un arrêt de quelques années. Je m'imaginais qu'une fois que je prenais mari, fallait que je me consacre à lui continuellement. Un moment donné, je trouvais les murs de ma maison assez proches, alors, j'ai commencé à m'impliquer dans le mouvement Guide et les Jeannettes. Ça fait 10 ans que je m'occupe de ça. Un moment donné, je me suis occupée du comité des activités culturelles, des spectacles, des ciné- clubs. Y'a pas beaucoup de femmes qui sont prêtes à faire ce que j'ai fait. J'ai quatre enfants et j'ai voyagé à Ottawa, à Montréal, à Halifax pour différents comités. Quand je revenais, je me sentais moins servante." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse) "Je suis seule et il faut que je trouve une façon de passer mon temps. Si je passe un seule journée à la maison à ne rien faire, je me sens inutile." (Hawkesbury, Ontario) "Je me suis impliquée en politique parce que je voulais sortir de la maison. Ça me permettait de sortir, j'allais dans les réunions puis je pouvais parler. Je ne pouvais pas discuter de politique avec mon mari. Il n'était pas intéressé. C'est comme ça que je me suis impliquée. J'avais des assemblées avec des hommes, je pouvais parler de politique et de ce qui m'intéressait. Mon mari ne m'encourageait pas, mais il ne m'empêchait pas non plus. J'ai l'impression que ça doit me venir de ma grand- mère, elle n'était pas dans la politique, mais elle menait tout." (Tignish, Île-du-Prince-Edouard)
"Les femmes prennent beaucoup de cours. Je serais curieuse de savoir combien de femmes suivent des cours proportionnellement aux hommes. Elles suivent des cours d'artisanat, de comptabilité, de conditionnement physique. Ça ne les mène à rien de précis. Pour elles, c'est une sortie." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "J'ai toujours senti le besoin d'organiser des choses. Ça me passionnait. J'ai été très active au foyer-école. On travaillait pour que les droits des francophones soient respectés. Je me sentirais brimée si je devais rester à la maison." (Campbellton, Nouveau-Brunswick) "Je ne sentais pas que j'avais quelque chose à apporter aux autres femmes. J'allais là, parce que ça me permettait de sortir de la maison et de rencontrer du monde. Je crois qu'à ce moment-là, c'était pas une réaction de prise de conscience de femmes, c'était plus l'aspect social." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "Je devrais normalement terminer mon mandat à l'exécutif de la Fédération cette année. Mais puisque mes enfants sont adultes et n'ont plus besoin de moi, je vais peut-être recon- sidérer la question. Je ne me vois pas rester à la maison tous les soirs, moi qui ai été impliquée dans différents organismes depuis le début de mon mariage. J'en ai discuté avec mon mari et c'est lui qui m'a fait réaliser que je trouverais cela diffi- cile de ne plus être aussi active." (Rockland, Ontario) "Moi, j'ai besoin de sortir de la maison sinon je deviens de mauvaise humeur. Je reste sur une ferme et je m'ennuie. C'est pour ça que je participe à différents comités." (St-Malo, Manitoba)
"On se rencontre une fois par mois. Moi, je me dis que même si on n'accomplit pas grand'chose au niveau de la communauté, l'important c'est qu'on se rencontre et qu'on se parle. Après la réunion, il y a toujours une bonne discussion." (Mont-Carmel, Ile-du-Prince-Edouard) "Moi, ça correspondait à ce besoin-là, j'avais besoin de rencontrer des femmes pour discuter mais à ce moment-là, je ne sentais pas le besoin de travailler à leur épanouissement." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "A certains moments, c'est bon d'avoir une rencontre avec des femmes. Il y a des choses qui n'intéressent pas les hommes. Ça prend une ren- contre de femmes pour parler de ces choses-là. C'est très important. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on n'est pas seule à vivre ces choses-là et que c'est commun." (Groupe de femmes de la Saskatchewan) "Moi, je ne m'identifie pas à une cause ou à un groupe en particulier. Il y a un paquet de choses qui m'intéressent et, l'important pour moi, c'est de pouvoir échanger des idées. Je participerais à un regroupement de femmes dont les objectifs seraient très larges et qui me permettraient de satisfaire plusieurs de mes besoins." (Ottawa, Ontario)"Les femmes au foyer ne manqueraient pas un souper des Dames d'Acadie parce que c'est une soirée pour elles, ça correspond vraiment à un besoin. C'est leur occasion d'aller rencontrer d'autres femmes. C'est une occasion aussi de se valoriser." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "ÇA REPOND A MES INTERETS PERSONNELS""En Ontario français, la seule implication qui est valorisée depuis toujours, c'est la lutte scolaire. Moi, je n'ai pas eu ce cheminement-là du tout. La seule crise scolaire que j'ai faite, c'est quand ils ont démoli mon couvent pour construire un restaurant. .. Moi, ma première forme d'implication s'est faite avec les expropriés de la basse-ville. Et ça m'a fait prendre conscience que les francophones ont des problèmes autres que linguistiques. Il n'y a pas juste au niveau scolaire qu'il y a du travail à faire... J'ai fait mon cheminement de cette façon- là, d'autres peuvent le faire autrement." (Ottawa, Ontario)"Actuellement, je suis vivement intéressée dans l'art et l'artisanat. Mon rêve est d'arriver à voir produire dans la région une forme d'artisanat qui va refléter notre culture. Ça n'existe pas. Les femmes font des courte-pointes avec des doigts de fées. Mais, les modèles sont des patrons amé- ricains. Je voudrais qu'on arrive à s'intéresser à quelque chose de plus représentatif. C'est difficile. Notre petit groupe de femmes travaille là-dessus présentement. (Saulnierville, Nouvelle-Ecosse)"Y'en avait d'autres comme moi qui étouffaient dans une situation où les enfants apprenaient juste l'anglais. Le français à la maison, c'est pas suffisant, il faut qu'ils l'apprennent à l'école. Je me suis battue pour qu'on ait une maternelle en français. Faut que ça me touche pour faire partie d'une organi- sation, j'ferais pas ça pour le fun. Là, ça me touchait." (Tignish, He-du-Prince-Edouard)"Je travaille pour la cause. Il y avait aussi d'autres femmes qui voulaient vraiment que leur enfant ait leur éducation en français. On a travaillé fort. C'était un travail à plein temps. Il fallait faire des téléphones pour trouver des gens dont les enfants étaient prêts à entrer à la maternelle. Une semaine avant l'entrée des classes, on n'avait pas le nombre requis. Alors, j'ai dit: on n'a pas tout essayé. On devrait contacter tous les parents qui sont intéressés, faire une réunion et s'organiser pour aller faire des pressions en groupe à la Com- mission Scolaire. Ça a marché, ils ont été obligés de commencer une école désignée." (Saskatoon, Saskatchewan)"Il y a une fierté qui se développe. Puis qui se maintient, qui grandit. Moi, je fais partie du comité culturel de l'école. Nos ambitions, cette année, sont d'essayer de promouvoir la fierté française, de trouver des moyens d'éliminer autant d'angli- cismes que l'on peut chez les enfants et chez les enseignants." (Bouctouche, Nouveau-Brunswick) "Je m'occupe des Jeannettes parce que j'adore être avec les jeunes. Elles ont tellement de dyna- misme que le mien me revient au grand galop quand je suis avec elles. Le dynamisme des jeunes me conserve et me donne de !a vitalité. Les adultes sont toujours remplis de problèmes alors que les jeunes, c'est un monde merveilleux." (Rockland, Ontario)"Ça fait six ans que je m'occupe des Guides. J'aime le mouvement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu fais du béné- volat mais ça te donne beaucoup de choses à toi. Il y a des cours d'animation une fois par année et on se rencontre trois, quatre fois par année. J'échange avec les femmes qui travaillent avec moi au niveau du diocèse et au niveau national. Mon mari sait que c'est important pour moi. Je lui ai dit clairement en me mariant qu'il comptait pour moi, mais qu'il fallait aussi que je fasse de la place pour mes intérêts personnels. Et puis, il est d'accord." (St-Vital, Manitoba)
"Que tu sois présidente d'une association où il y a à la fois des femmes qui sont sur le bien-être social et d'autres qui sont maîtresses d'école, ça ne pose pas de problèmes. Tout le monde est égal. C'est toutes des femmes qui ont eu des problèmes, des tas de problèmes. Tu sens une solidarité entre personnes séparées. Le fait que les femmes aient vécu les mêmes situations, ça les rapproche." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Chez les gens âgés, les problèmes se ressemblent. On a besoin de se distraire, de jouer aux cartes, au bingo, d'avoir quelqu'un pour nous aider, faire nos commissions, C'est pour ça que c'est important de se regrouper. Nous autres on est considéré un peu comme séparatistes parce qu'on dit que ce sont nos gens d'âge d'or francophones qu'on veut regrouper. On n'a rien contre les Anglais mais on veut se réunir entre Français, faire nos soirées en français." (St-Boniface, Manitoba)"On se sentait isolé, on sentait qu'on avait beaucoup de choses en commun, même si on avait toutes des situations différentes. On avait quand même des enfants à élever et on était seules pour les élever. On avait des besoins psycholo- giques, financiers, légaux." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Les femmes chefs de famille, sont conscientes de la situation qui existe; la discrimination, elles l'ont toutes vécue. Ce ne sont pas les femmes les plus instruites qui sont les plus conscientes. On s'aperçoit moins de sa condition de femme quand on vit bien. On a des privilèges que les femmes défavorisées n'ont pas. Les femmes chefs de famille, sont beaucoup plus revendicatrices et je dirais que c'est peut-être elles qui s'impliquent le plus." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"A la suite d'une conférence en '74, on avait un atelier sur les femmes chefs de famille. On s'est retrouvé sept femmes, veuves, séparées, divorcées et mères célibataires. A la suite de cet atelier-là, on a réalisé qu'on avait des problèmes communs et qu'on devrait se regrouper. On s'est impliqué dans des pressions pour changer les lois sur les biens matrimoniaux puis, ensuite, pour avoir une maison pour les femmes battues." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Quand je me suis séparée, je ne voulais pas sortir dans les hôtels, je ne voulais pas me trouver un autre homme mais je voulais faire partie d'un groupe, juste pour me distraire, me faire des amies. Alors, je voulais rencontrer du monde dans la même situation que moi, avec les mêmes problèmes, qui pourraient me comprendre. C'est comme ça que je suis allée au groupe de chefs de famille. Ça coûte juste $2. par année pour faire partie du Club. C'est important ça parce que j'ai pas d'argent pour mes loisirs." (St-Boniface, Manitoba)"C'est le fait d'être dans l'association de femmes chefs de famille qui a fait ce changement-là. Tu ne te sens pas toute seule dans le monde, puis tu sais que tu es comme les autres. Tu sais qu'elles ont des problèmes avec leurs enfants, comme toi. A l'association, tu as un tas d'information, si tu as un problème, tu sais où aller. Avant ça, je ne savais rien, rien, rien." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Il y avait beaucoup de jeunes femmes comme moi qui sentaient un besoin de regroupement, un besoin de faire des choses. On a repris le mouve- ment des Dames Chrétiennes qui était un peu en perte de vitesse. On a pris des responsabilités plus grandes. Finalement, il y en a qui sont devenues présidentes de caisses populaires, responsables d'organismes; il y en a qui se lancent en politique. Vraiment sur le moment, je ne pensais pas que quelque chose arriverait avec ça, mais à force de faire des récep- tions, des choses comme ça, ça leur donnait confiance en elles-mêmes. On avait des conféren- ciers. Tranquillement, elles prenaient plus confiance en elles-mêmes." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Ça m'a pris huit ans à me décider. Il ne s'était rien présenté qui m'intéressait. On cherchait quel- qu'un qui était prêt à s'impliquer au niveau des garderies. Je me suis dit pourquoi pas. C'a été une expérience difficile. Après je me suis impliquée dans la Fédération parce qu'on m'offrait des choses qui m'intéressait: atelier d'affirmation de soi. Ça m'a donné confiance. Ça m'a fait découvrir mon potentiel. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de diplôme universitaire pour faire quelque chose." (Rockland, Ontario)"Faire partie d'un groupe, ça m'a fait découvrir que les femmes avaient des problèmes en commun. J'ai eu l'occasion d'écrire des articles pour le journal francophone. J'avais jamais eu l'occasion de faire ça et je pensais que j'étais pas capable. Ç'a été une bonne chose pour moi." (Medicine Hat, Alberta)"Faire partie d'un groupe de femmes, ça t'aide à prendre confiance en toi. Il y a des femmes qui n'avaient jamais parlé en public et maintenant elles sont capables. Après, c'est plus facile de s'impliquer ailleurs." (St-Malo, Manitoba)"Moi, je trouve qu'une femme qui s'implique, même si c'est dans l'organisation d'une parade de mode, il faut qu'elle commence par quelque chose. C'est en travaillant ensemble qu'on vient à se connaître, qu'on acquiert une confiance. Il faut commencer avec ce qui les intéresse. Ensuite, il faut aller encore plus loin, c'est là où va être le gros du travail. Il y en a par exemple qui ont acquis beaucoup et c'est grâce aux Dames d'Acadie si elles commen- cent à s'affirmer et avoir confiance en elles-mêmes." (Bathurst, Nouveau-Brunswick)"On est un comité de femmes qui a travaillé à mettre sur pied une garderie parce qu'on avait besoin de ça. C'est une expérience extraordinaire pour moi, c'est une chose qui m'a débloquée: savoir m'organiser, savoir rencontrer des gens, les con- tacter, faire des sondages, des choses comme ça. C'étaient des choses que je n'avais jamais faites. C'est ma première expérience en tant que pré- sidente d'un groupe. C'est une expérience enrichis- sante à tous les points de vue, parce que j'ai appris un tas de choses." (Zenon Park, Saskatchewan)"Elles n'avaient jamais pensé qu'elles pou- vaient faire quelque chose; elles n'avaient jamais d'idées; elles pensaient qu'elles ne pouvaient rien faire de leurs mains. A part de faire la cuisine et du ménage, elles pensaient qu'elles étaient capables de rien faire. Elles ont découvert qu'elles avaient des idées. Elles ont travaillé sur des comités pour le petit bazar et ... elles sont sorties de leur coquille!" (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "ON A BESOIN D'INFORMATION""A l'association des chefs de foyer, on donne beaucoup d'information aux gens. Les membres veulent qu'on fasse des pressions pour avoir un livre sur nos droits. Puis, elles veulent avoir un cours d'affirmation de soi, des informations sur comment aider les enfants. Elles veulent qu'on change la loi sur le divorce, que ce soit un consen- tement mutuel." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"On a organisé des conférences sur la femme et ses besoins, la femme autonome, la femme et ses échecs et sur le droit familial. Les femmes ont été vraiment intéressées. Les jeunes femmes aime- raient avoir de l'information sur l'éducation des enfants." (Rockland, Ontario)"Les femmes ont besoin de renseignements, d'information et de formation. C'est pour ça qu'elles viennent à nos réunions. Moi, ça m'a fait évoluer de 200%." (Sud de la Saskatchewan)"Les conférences ont attiré beaucoup de fem- mes. C'est important, c'est pour se préparer. Les conférencières ont expliqué aux femmes comment tu n'as jamais pensé que tu pourrais devenir veuve, les testaments, toutes ces choses-là; les affaires qu'on n'est pas au courant." (St-Boniface, Manitoba)"Il y a par exemple des animatrices qui sont embauchées pour faire des cours d'affirmation de soi. C'est un groupe d'action politique qui nous a proposé ça: comment faire du lobbying, comment présenter des mémoires, faire des pressions poli- tiques, comment s'organiser en groupe." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"On a commencé tout de suite à organiser des conférences sur tous les sujets d'actualité qui touchaient les femmes: les droits, la santé, le viol, le budget, les biens matrimoniaux. On a eu jusqu'à 175 femmes à certaines sessions. En moyenne, on a eu 50 à 75 femmes. Le groupe qui s'est formé s'appelle les Femmes Acadiennes. Notre $3,000.00 a duré deux ans, deux ans et demi. On était des volontaires, on donnait notre temps, notre essence, notre voiture." (Saulnierville, Nouvelle-Ecosse)
"Des fois, tu vas demander une chose à une femme puis elle va te dire: "Moi, je ne suis pas capable". C'est pas qu'elle n'est pas capable et puis je ne peux pas dire que c'est qu'elle ne veut pas. Des fois, c'est des petites tâches bien banales, elles vont te dire "Moi, je n'ai jamais fait ça, je ne suis pas capable de faire ça". C'est un manque de confiance. C'est probablement toujours les mêmes que tu vois, t'as besoin de quelqu'un, bien souvent, tu va demander encore aux mêmes. S'il y a une réunion annuelle par exemple, c'est toujours les mêmes qui y vont, les autres ont peur. Elles ont peur qu'on les parachute dans des postes. J'ai pas l'impression que c'est la majorité des femmes qui participent à quelque chose." (Shippagan, Nouveau-Brunswick) "Il y aurait peut-être un genre d'éducation à faire auprès des femmes qui leur montrerait qu'elles sont aussi capables que les hommes. Son opinion est aussi respectable que celle des hommes. Il faudrait quelque chose qui pousserait les femmes à prendre conscience de leurs aptitudes à faire des choses. Moi j'en connais dans la région qui sont vraiment capables mais qui ne s'impliquent pas." (Chéticamp, Nouvelle-Ecosse) "Moi, je trouve que les femmes de mon âge, si elles sont à la maison, elles sont prêtes à commencer leur famille. Elles n'ont pas beaucoup de temps. J'ai appelé une femme et elle m'a dit: "Je suis à la veille d'accoucher, je ne peux pas." Il y a beaucoup de problèmes, des jeunes enfants à la maison, elles n'ont pas de temps à elles. Les femmes au travail, au début de leur carrière, elles se dépensent sans compter au travail." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"C'est à partie de 40 ans que les femmes sont prêtes à s'impliquer. Les enfants sont élevés. Elles se retrouvent seules, n'ont rien à faire. Les jeunes femmes, c'est dur de les intéresser. Elles ont les enfants." (St-Vital, Manitoba)"Comme il y a tellement de femmes sur le marché du travail et qu'elles ont moins de temps libre, c'a changé nos associations. Nous autres, notre réunion du mois, c'était notre sortie. Tandis qu'aujourd'hui, les dames ne cherchent pas les sorties. Si elles sortent le soir pour une réunion, elles ne voient plus leurs enfants. De plus, elles sont fatiguées et ne peuvent pas donner un bon rendement partout." (Memramcook, Nouveau-Brunswick)"Dans certains milieux, les prêtres veulent garder les femmes au service de l'Eglise et à leur service à eux. Ça influence les femmes. Pour beaucoup de femmes c'est de faire valoir les valeurs pas de la religion catholique qui est important." (St-Malo, Manitoba)"Elles ne voulaient pas continuer si le curé ne les appuyait pas. Si le curé mettait des bâtons dans les roues, à ce moment-là , elles perdaient leur confiance. C'est arrivé dans des paroisses.. . Chez certaines femmes, la religion est encore forte. D'autres ne sont pas pratiquantes. Il y a un mélange. L'influence de la religion est peut être moins grande. Ça prenait tout notre courage pour essayer d'encourager notre présidente de section locale, à avoir confiance en elle-même. Parce que vraiment, c'est ancré dans leur subconscient qu'elles sont faites pour faire la popote et les soupers de paroisse." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Mous, dans notre milieu, on considère qu'il faut qu'on trouve des solutions à la baisse de la pratique religieuse chez les jeunes. C'est une des priorités de notre groupe qui va de pair avec le maintien de la famille et le bien-être des enfants." (Girouxville, Alberta)"Comme la religion est intimement liée à la survivance de la langue, c'est important que les valeurs religieuses soient maintenues par les femmes. C'est une des bases de la survivance des francophones." (Saskatchewan-Sud)
"Dans notre milieu, c'est important la religion. Quand je suis devenue seule, si j'avais pas eu ça, ça aurait été difficile. Ce n'est pas nécessairement la religion, c'est la communauté, ça va ensemble. C'est une communauté qui a une certaine solidarité, et pour moi, c'est important. Pour quelqu'un qui se trouve toute seule dans des moments comme ça, c'est vraiment important la foi. Tu t'accroches après quelque chose. On peut l'appeler communauté chrétienne, pas obligé d'être catholique. L'esprit chrétien c'est plus important." (St-Boniface, Manitoba)"Si elles font des soupers, des bingos, ou des choses comme ça, c'est tout le temps en vue de la catéchèse." (St-Boniface, Manitoba)"Elle fut élue à la mairie du village de Bas- Caraquet en 1974, devenant ainsi la première femme maire acadienne au Nouveau-Brunswick. Ce fut une élection chaudement disputée où elle ne gagna que par deux voix. Elle fut aussi candidate conservatrice lors de l'élection provinciale de 1978 et fut battue par le candidat libéral. Pour elle, ce fut une expérience extraordinaire qu'elle referait sans hésiter." (Bas-Caraquet, Nouveau-Brunswick) "Les groupes d'action politique, ça fait peur, mais je me dis qu'il faut quand même le faire. Même si c'est seulement une minorité qui est intéressée. Quand même qu'on n'est pas un gros groupe, on fait beaucoup de choses. On envisage aussi la possibilité de payer les gardiennes quand on a des réunions pour libérer un peu les femmes." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"La politique, ça m'intéresse. Il me semble que j'aurais des choses à dire. Mais, je trouve que les gens deviennent pognés quand ils rentrent dans un parti. Mais, je m'intéresse quand même à la politique. Je m'intéresse aux choses qui se passent dans mon milieu aussi. Pas au point de travailler dans les campagnes électorales, travailler pour un parti ou quelque chose comme ça. Non. Travail- ler pour un parti ça ne m'intéresse pas vraiment. Il me semble d'abord qu'il y a des cadres trop rigides et auxquels il faut se restreindre. Je ne suis pas toujours d'accord non plus avec le rôle d'opposition. Quand tu vois qu'il y a des choses qui sont bien faites et que tu dois critiquer ça et le démolir. .. Moi, à mon point de vue, il y a des choses qui sont bien faites. Si j'étais dans l'opposition, je ne pourrais pas dire que c'est mal, je ne serais pas une bonne critique." (Bathurst, Nouveau-Brunswick)"Je suis politicienne et j'en suis fière. J'aime être commissaire d'école; ça présente un défi; ça comporte ses récompenses; c'est parfois pénible et toujours instructif. J'essaie de baser toutes mes décisions sur ce que je juge valable en éducation et j'essaie de visualiser l'enfant ou les enfants qui seront affectés par mes décisions afin de faire des choix justes et appropriés. Je veux travailler à éliminer les manuels sexistes, les politiques sexistes et les priorités budgétaires sexistes. Je me consi- dère comme une féministe chrétienne, malgré l'attitude négative et étroite de certaines Eglises chrétiennes envers les femmes, parce que je crois que, dans le Christ, il n'y a ni mâle, ni femelle." (Calgary, Alberta)"Je me suis présentée comme candidate aux élections provinciales. Mais, c'était le parti acadien et j'avais aucune chance d'être élue. J'ai eu un pourcentage intéressant parce que c'était dans une circonscription de Moncton, à 50% francophone; j'ai eu presque 7% du vote total, ce qui veut dire que j'ai peut être eu entre 12 et 15% du vote francophone. Les hommes ont eu moins que ça. C'était la première élection où on avait des candidats dans toutes les circonscriptions. C'était mon milieu, une circonscription universitaire, alors les profes- seurs ont voté pour moi, non pas parce que j'étais une femme mais parce qu'ils ne voulaient pas voter conservateur ou libéral." (Moncton, Nouveau-Brunswick)"Ils sont venus me voir, ils ont dit: "Est-ce que ça t'intéresserait d'entrer au conseil municipal?" J'ai dit: "Je ne connais rien du tout là-dedans." Je me suis décidée et puis j'ai embarqué. Mais, je n'ai jamais visé à devenir maire. J'ai complété deux termes. J'ai été élue par acclamation la première fois, ça, c'était pour deux ans. Tu as besoin de savoir si les gens te veulent vraiment là. Tu te prépares à une défaite, il faut que tu l'acceptes. Il ne faut pas que ça te détruise. Mais là, j'ai été élue, j'ai vécu ces trois années-là, là je disais, c'est fini, puis après j'ai été élue maire. (Memramcook, Nouveau-Brunswick) "C'était un besoin moral, intellectuel, quelque chose que je ressentais impérieusement qui m'a fait faire mes premiers pas en politique. Je ne pouvais pas ne pas agir. J'ai commencé à un niveau local en mettant sur pied un groupe de pression. Je ne savais vraiment pas comment faire et j'appre- nais au fur et à mesure. C'est encore un besoin d'agir qui m'a poussée vers une organisation natio- nale. Avec l'expérience que j'avais acquise, j'ai accepté d'être déléguée au premier congrès na- tional. Enfin, en septembre 1978, j'ai fait le grand pas et j'ai adhéré à un parti politique. Un concours de circonstances fait que je me retrouve dans une circonscription qui vient de perdre son candidat. Je veux me présenter mais je n'ose pas. La peur, le doute. Je me demande si je suis capable, quelles sont mes chances, quels sont les risques pour une femme en politique, et surtout, comment perdre avec élégance. Finalement, j'ai fait appel à une femme qui avait déjà fait de la politique. Elle m'a parlé de son expérience, j'ai pu lui poser des questions. Et c'est elle qui m'a fait comprendre que même perdre peut être une expérience enrichis- sante. J'attends les élections avec impatience. Je vais faire tout mon possible pour obtenir la nomi- nation dans ma circonscription. Je veux vivre cette expérience politique." (Vancouver, Colombie-Britannique)
"MAIS C'EST PAS FACILE QUAND T'ES UNE FEMME""Moi, je trouve que parce qu'on est des femmes, il faut qu'on fasse mieux que des hommes. On est obligé . Moi, j'ai toujours essayé d'écouter autant que de parler, même plus. Si on me demandait mon idée, j'avais écouté assez que je pouvais discuter l'affaire. Puis, j'étais pas mal sûre de ce que je disais. J'étais surprise d'être appelée par des comités du gouvernement, par des high up. J'ai été présidente de la commission scolaire pendant plusieurs années. Au niveau municipal, j'ai été là cinq ans avant d'être nommée maire. On est trois femmes maires à l'Ile-du-Prince-Edouard, dont celle de Charlottetown." (Tignish, Ile-du-Prince-Edouard) "Après la réunion du Conseil, les hommes s'en allaient prendre une bière et moi, je ne me sentais pas capable d'aller avec eux. S'ils m'avaient invitée à aller chez eux, à leur maison, c'aurait été différent. Ici, c'est une petite communauté, je ne voulais pas faire jaser. Pourtant, c'est à ce moment qu'on a le plus de chances de discuter. Moi, je ne pouvais pas le faire. J'aurais pu, mais, je ne voulais pas. Ça m'aurait permis de mieux connaître mes confrères. Quand tu es assis à une table de réunion, avec un agenda, il n'y a pas grand'chose qui sort. Si j'avais été un homme, en sortant de l'assemblée, j'aurais embarqué." (Bouctouche, Nouveau-Brunswick)"Mes difficultés personnelles, en politique, ont été d'abord, d'être trop sensible aux critiques, ensuite de concilier vie familiale et vie politique et enfin, mes propres sentiments d'insuffisance. J'ai donc dû me convaincre que j'aimais mieux être déterminée que populaire. Je me suis aussi efforcée d'établir un équilibre entre ma vie familiale et ma vie publique. Et enfin, les succès que j'ai obtenus en terme de changements dans les politiques scolaires m'ont convaincue que je pouvais être efficace." (Calgary, Alberta) "Moi, je vois certains problèmes à être une femme en politique. Par exemple, comme maire quand on discute une question de tuyaux, ou des choses comme ça, tout de suite, je dis o.k., je suis une femme, je ne connais pas trop ça. L'autre fois, je discutais avec l'administrateur puis je lui disais ça, c'est comme une barrière, il me manque de l'information sur certaines choses qu'on discute. Il m'a répondu, "Il y a bien des choses que tu connais et sur lesquelles moi, je n'ai pas d'information. C'est comme l'administration, moi, je vis là- dedans, toi, ce n'est pas ton domaine. C'est pas plus mal que ça."
ALBERTAPatricia Auger-lannatone-- Medicine HatGertrude Baril-Biais-- Edmonton Angèle Boudreau-- Edmonton Brigitte Bugeaud-- Girouxville Cécile Currat-Pahud- Chard Suzanne Dalziel-- Edmonton France Faure-Tellier Edmonton Yolande Gagnon-Leroux Simone Gignac--Edmonton Dolorès Jodoin-Corbière-- Ste-Lina Laura Labrie-Lacombe- Fort Kent Thérèse Laplante- Cold Lake Mme Arthur Lirette- Cold Lake Régina Moreau-Bilodeau--Edmonton Malvina Morin-Laverdière--Girouxville Syvlie Pollard-Kientzel--Edmonton Ella Perron-Cunningham--Girouxville Thérèse Perron--Edmonton Ernestine Poirier-Lapierre- St-Paul Irène Robidas-Turgeon--Edmonton Sr Aimée du Divin-Coeur (née Amabilis Cloutier)--Edmonton Sr Marie de St-Joseph (née Armandine Héon)-- Edmonton Rachel Wilson-- Edmonton COLOMBIE-BRITANNIQUEChristiane Côté--VancouverCécile F. Coutu-Kropminski--Port Alberni Louise Delisle--Vancouver Eva Dionne Vancouver Adrienne Doré-DemersÂPort Alberni Olga Kempo Vancouver Rose-Blanche McBride-- Victoria Louise Merler Vancouver Mme Pettibeau --La Société historique de Vancouver Religieuses de Ste-Anne-- Victoria ILE-DU-PRINCE-EDOUARDLéona Arsenault  Abram VillageThérèse Beaudin  Mont Carmel Anita Chiasson  Tignish Réjeanne Doucet  Harper Road Anne-Marie Perry  Tignish MANITOBAMadeleine Balcaen  St-BonifaceEstelle Boyer  Somerset Marguerite Carrière-Lagassé  St-Adolphe Alphonsine Côté-Laroche  Otterburne Marie Courchênes-Touron  St-Pierre Béatrice Cyr-St-Armand  Trancona Isabelle de la Gimodière  St-Boniface Emma Gosselin  St-Pierre-Jolys Aurore Goulet  St-Malo Jocelyne Hébert  St-Malo Marie-Elise Houde  St-Norbert Rosa Johnson-Thérrien  Lorette Euphigénie Lafrenière-Girouard  Somerset Elisa Lambert  St-Malo Antoinette Lamoureux-Lemaire  St-Norbert Elaine Landry  St-Vital Jeannette Lussier  St-Boniface Mère Marie Joseph du Sacré-Coeur Sr Marie Aloyse du Précieux Sang (née Marie-Thérèse Collin) Sr Marie Immaculée (née Anna LeBrice de Keroack) Elise Touron-Vermette  St-Pierre Délia Trudeau-D'Auteuil  Lorette Marthe Wasse-Poiron  Somerset NOUVEAU-BRUNSWICKMarie-Anna Bois  St-BasileEsther Boudreau-Vermette  Campbellton Léona Bourque  Bouctouche Edith Branch-Pinet  Caraquet Alice Breault  Moncton Gisèle Brideau  Tracadie Gemma Caron  Campbellton Jacqueline Collette  Moncton Cécily Duguay  Bathurst Claire Frigault - Caraquet Corinne dallant  Moncton Thérèse Gaudet  Memramcook Huberte Gautreau  Moncton Gilberte Jean  Campbellton Hedwidge Landry  Caraquet Simone Leblanc-Cormier  Dieppe Simone Leblanc-Rainville  Moncton Edmée Martin  Campbellton Alphonsine Ranger (mère Maillet)  St-Basile Anita Robichaud  Shippagan Barbe Thibodeau-Babineau  St-Louis de Kent Micole Viennau-Colette  Dieppe Eugénie Robert  Baker Brook Ernestine Young  Moncton NOUVELLE-ECOSSEJeannine Aucoin  ChéticampRose Cottreau ÂWedgeport Jeannelle D'Entremont  Pubnico Anne-Marie Deveau  Chéticamp Marie Deveau  Chéticamp Mère de Yvon Deveau  Chéticamp Marie-Stella Doucet  Chéticamp Anna Fitzgerald  Butte des Comeau Annette Leblanc  Pubnico Céleste Leblanc  Pubnico Edith Comeau-Tufts  Saunierville ONTARIOAline F. Allard  RocklandHélène Aubin-Vachon  Sturgeon Falls Pauline Auger  Rockland Glorine Baillargeon-Quenneville  St-Joachim Délima Barrette  Ottawa Aurore Beaudette-Sylvestre  St-Joachim Catherine Beaudry-Carré  River Valley Laura Berlinguette  Ste-Anne de Prescott Yvette Boulard-Tessier  River Valley Alexina Bourgon-Pagé  Casselman Françoise Boyle-Chateauvert  Ottawa Marie-Louise Boyle-Desjardins  Ottawa Yvette Brisson-Lafrance  Cornwall Yvonne Brisson-Millaire  Embrun Rosa-Anna Brouillette-Gauthier  Verner Françoise Viau-Brunet Rockland Rachel Charbonneau Ottawa Marie Chenier Rockland Gertrude Denis Plantagenet Aurore Chrétien-Rochon Ottawa Flora Desautels Pembroke Delioza Dignard-GirouxÂRiver Valley Monique Dion Ottawa Célestine Ducharme-ForestÂSturgeon Falls Lumina Dupuis-Comartin-- St-Joachim Hélène Emond--Pembroke Ghislaine GagnéÂElliott Lake Lyse Huot Plantagenet Aline Hurteau-Michaud Ottawa Irène Jacques-DemersÂWelland Denise Labonté Rockland Marie LabrieÂWelland Eliane Ladouceur-Drouin Casselman Geneviève Lafleur-Morris Rockland Anita Lapointe Port Colborne Reine Laurin Ottawa Adèle Lavoie Ottawa Adéline Leclair Pembroke Ella Lefrançois-Goulet Pointe-aux-Roches Herméline Legault-Robert Sturgeon Falls Thérèse Lemieux Ottawa Zoé Lemire-Dupras River Valley Eva Lessard-Lamontagne- Welland Lucie Liard-Goulard Sturgeon Falls Dolorès Marentette Windsor Hermosa Martin-Lévesque Sturgeon Falls Jeanne Martin Rockland Laurette Martin-Leroux Cornwall Julia Milette-Devis Hanmer Gabrielle Miner Hawkesbury Alberta Miron-Piché Espanola Bernadette Mont-Petit-Tyo Cornwall Aldéa Nadeau Espanola Carmen Paquette-- Ottawa Marie-Anne Perrier-Quesnel Casselman Ida Picard-Rocheleau Ottawa Lauda-Ali Renaud-Oriet St-Joachim Gisèle Richer Rockland Ida Rifou-Savage Sturgeon Falls Philomène Rivest-Robitaille Sturgeon Falls Lucette Roy Rockland Ginette Sabourin Ottawa Béatrice Sauvé Ottawa Cornélia St-Amour-Dupras River Valley Dorothy Walker-Leboeuf St-Joachim Claire Wallace North Bay SASKATCHEWANBernadette Baillargeon  North BattlefordJeannette Beaulac-Larose  Debden Aima Coulombe-Douville  Ponteix Marie-Antoinette De Marjorie-Papen  North Battleford Cécile Dupperreault  Saskatoon Léa Goddu-Ruest  Ponteix Groupe de femmes de la Saskatchewan Marguerite Hounjet  St-Denis Lucie-Anna Levasseur-Lajeunesse  Debden Jeanne Pelletier-Hudon  Zenon Park Nicole Poulin  Zenon Park TERRE-NEUVEMarie Cormier  Cap St-GeorgesDiane Larocque  Labrador City Véronique Louvelle-Simon  Cap St-Georges Mariette Vanasse  St-Jean Composition, montage et impression par Kaice-tec Reproduction Ltée. 1506, rue Michael Ottawa (Ontario) K1B 3S1 Tél.: (613) 741-5701 pour le compte de La Fédération des femmes canadiennes-françaises |

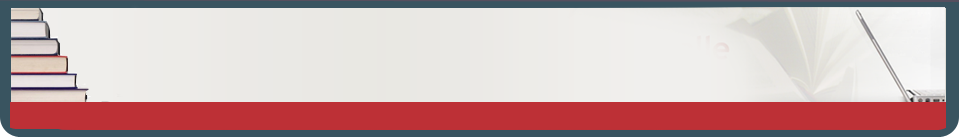



























 "En 1923, la récolte fut excellente.
Malheureusement, nous n'avions
ensemencé que quelques acres afin de faire du labour
d'été. Les trois années
qui suivirent ne produisirent qu'un maigre revenu. La
récolte de 1927 nous
aurait permis de nous remettre sur pied, mais le blé se
vendait 17¢ le minot.
Nous avons passé à travers une période de disette
que je n'ai jamais pu
oublier. La sécheresse dura 10 ans. Pendant ce temps la
famille augmentait."
"En 1923, la récolte fut excellente.
Malheureusement, nous n'avions
ensemencé que quelques acres afin de faire du labour
d'été. Les trois années
qui suivirent ne produisirent qu'un maigre revenu. La
récolte de 1927 nous
aurait permis de nous remettre sur pied, mais le blé se
vendait 17¢ le minot.
Nous avons passé à travers une période de disette
que je n'ai jamais pu
oublier. La sécheresse dura 10 ans. Pendant ce temps la
famille augmentait."





































 "Nommée Supérieure de l'Hôtel-Dieu
de St-Basile en 1880,
elle y demeurera durant près d'un quart de siècle.
Pendant ce
temps, elle continua son oeuvre en donnant les soins aux
malades, en aidant les pauvres et en recueillant les
orphelins.
Elle organisa aussi la première briqueterie du Madawaska.
On
la vit même cuire de ses mains, les premières briques
rouges
de l'hôpital neuf de St-Basile. Poursuivie en Cour pour
cette
audacieuses initiative, on la vit défendre ses droits. Le
chapelet
à
lamainetl'Avesurles
lèvres, elle tient tête à tout le monde."
"Nommée Supérieure de l'Hôtel-Dieu
de St-Basile en 1880,
elle y demeurera durant près d'un quart de siècle.
Pendant ce
temps, elle continua son oeuvre en donnant les soins aux
malades, en aidant les pauvres et en recueillant les
orphelins.
Elle organisa aussi la première briqueterie du Madawaska.
On
la vit même cuire de ses mains, les premières briques
rouges
de l'hôpital neuf de St-Basile. Poursuivie en Cour pour
cette
audacieuses initiative, on la vit défendre ses droits. Le
chapelet
à
lamainetl'Avesurles
lèvres, elle tient tête à tout le monde."









